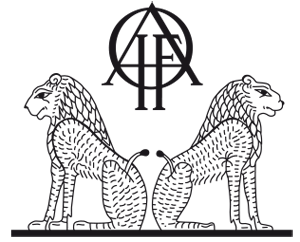254 récits de voyageurs, 251 voyageurs
|
|
6e siècle |
ANONYME DE PLAISANCE (560-570)Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, II/3, Leyde, 1932.
Cette relation a été attribuée à Antonin de Plaisance, saint patron de cette ville. Mais il semblerait que l’auteur de ce texte soit inconnu. Celestina Milani, dans le titre de son ouvrage, propose de dater ce récit aux alentours de 560-570.1 p. 389 verso :
« En descendant à travers l’Égypte, nous vînmes dans la ville d’Alepi 2, chez saint Mennas, qui pratique dans ce pays de grandes vertus. Ensuite, en naviguant à travers un lac, nous vînmes à Alexandrie. Dans ce lac, nous vîmes une multitude de crocodiles. Alexandrie est une belle cité, dont la population est futile, mais reçoit aimablement les étrangers ; il y a parmi elle de nombreuses hérésies. C’est là que dort de son dernier sommeil, Athanase, évêque de cette ville, qui, au temps de Constance, fils de l’empereur Constantin, fils d’Hélène, lutta pour la foi du Christ contre Arius, prêtre hérétique de cette même cité, et s’exposa ainsi très souvent à des dangers mortels. C’est également là que reposent saint Fauste, saint Épimaque et saint Antoine ou saint Maur, et les corps d’autres saints.
1 Anonyme de Plaisance, Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in Terra Santa del 560-570 d. C., par C. Milani, Milan, 1977.
2 Dans le texte latin : Athlefi. - 7 - Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
|
7e siècle |
MORIENO ROMANO (VIIe siècle)Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,1879, p. 429-615.
Morieno, originaire de Rome, est un philosophe moine du VIIe siècle, qui choisit de s’exiler à Alexandrie pour recevoir l’enseignement d’Adfar comme il l’écrit dans son court récit. Il est considéré comme l’un des meilleurs auteurs alchimistes. Deux ouvrages de Morieno nous sont parvenus : Librum de composicione alchymiae et De distinctione Mercurii aquarum.3 Robert de Chester a été le premier à traduire le texte de Morieno de l'arabe en latin en 1144.
p. 432 :
« Un homme, beaucoup d'années après la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, trouva le livre. Or cet homme était originaire d'Alexandrie. C’est pourquoi on l'appelait Adfar d'Alexandrie. Cet homme divin donna beaucoup de préceptes de cette science ; celle-ci s'était divulguée sous son nom dans toutes les parties de notre région. Lorsque je séjournais à Rome, le nom de cet homme, avec la réputation de Sa science, me parvint pour ainsi dire, à tire d'aile. À cette époque-là, en effet, j'étais établi à Rome (dont j'étais aussi originaire). D'ailleurs j'étais alors un jeune homme en cours d'étude, et pour la doctrine chrétien depuis mon plus jeune âge, du fait de mes deux parents. Aussi, quand j'entendis le nom et la réputation de cet homme, je quittai à la hâte parents avec patrie, et ne donnai guère de repos à mes membres que je n’en aie gagné Alexandrie. Je suis donc entré dans la ville, et j'ai marché par ses rues et ses chemins en hôte nouveau, jusqu'à trouver la maison de cet homme. Enfin je demeurai avec lui, et je me montrai à lui si aimable qu'il me dit les secrets de toute la divinité universelle. Puis Adfar mourut, et quelques jours après son décès, je quittai Alexandrie et gagnai Jérusalem, dans le territoire de laquelle je choisis un lieu désert où je puisse mener une vie conforme à ma foi et à ma profession. »4
3 Jöcher, Ch. G., Allgemeines Gelehrten-Lexikon, vol. 3, Leipzig, 1751, p. 156.
4 Traduction : G. Favrelle. - 8 - Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
ARCULFE (avant 688)Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/1, Leyde, 1930.
À son retour de voyage, le pèlerin Arculfe aurait été jeté par une tempête sur les côtes de la Grande-Bretagne. L’abbé Adamnan, qui le recueille, a rédigé un récit d’après ses conversations : Libri di situ Terrae. D’après son éditeur, Arculfe serait un évêque gaulois.5 Ces données biographiques sont les seules qui nous soient parvenues, mais on peut supposer qu’il est évêque régionnaire, c’est-à-dire un missionnaire évangélique, puisqu’il ne fait mention nulle part de l’église qu’il gouverne.6 p. 491 :
« Relation d’Arculfe sur les saints lieux écrite par saint Adamnan. Alexandrie, le fleuve le Nil et ses crocodiles.
Cette grande cité, autrefois la métropole de l’Égypte, se nommait jadis en hébreu No. C’est une ville très peuplée, laquelle d’après son célèbre fondateur Alexandre, roi des Macédoniens, est connue chez tous les peuples sous le nom d’Alexandrie ; elle reçut ainsi de cette construction sa grandeur en tant que cité et son nom. Arculfe, au sujet de ce qu’il raconte de sa situation, ne diffère en rien de ce que nous avons déjà appris par nos lectures.
Descendant de Jérusalem, et commençant sa navigation à partir de Joppé, il eut quarante jours de voyage jusqu’à Alexandrie, dont le prophète Nahum parle brièvement quand il dit : « L’eau l’entoure de toutes parts ; sa richesse, c’est la mer ; ses murailles, ce sont les flots. » En effet, elle est ceinte du côté du sud par les bouches du Nil, et du côté du nord par la plage. Sa position étant ainsi définie, on voit clairement que, située sur le Nil et la mer, elle est entourée de toutes parts par les eaux et qu’elle se trouve interposée comme une barrière entre l’Égypte et la grande Mer. C’est une ville dont le port est mauvais et elle est d’un accès difficile pour qui vient de la haute mer ; son port est plus difficile que les autres, parce qu’il est, absolument comme un corps humain, plus large à sa tête, qui est la rade, mais plus étroit à son goulet, là où il reçoit le mouvement de la mer et des vaisseaux, et par lequel se trouvent donnés au port quelques secours pour respirer. Aussitôt que l’on est échappé du goulet et de l’entrée du port, la mer, tout comme le reste de la forme du corps humain, se développe tant en longueur qu’en largeur.
À droite du port, se trouve une petite île, sur laquelle il y a une très haute tour, que les Grecs et les Latins ont également appelé le Phare, par suite de son usage ; parce que ceux qui naviguent l’aperçoivent de loin, de telle sorte que dans la nuit, avant qu’ils n’arrivent sur les approches du port, ils connaissent par la lumière des flammes, que la terre est voisine et toute proche d’eux, de manière à ce que, trompés par les ténèbres, ils ne tombent pas sur les rochers, et afin qu’ils puissent trouver le chenal du goulet. Il y a là des fonctionnaires, qui ont l’office, en entassant des brandons et des amas de bois, d’entretenir le feu, dont le rôle est ainsi d’annoncer et de montrer la terre, de faire voir à celui qui entre, l’étroitesse des chenaux du port, les sillons des ondes, et les sinuosités du goulet, afin que la carène fragile ne touche les écueils, et n’aille heurter, en cherchant à pénétrer dans le port, les rochers couverts par les flots. C’est pourquoi il faut incliner un peu la course en droite ligne du navire, pour qu’il n’aille pas donner sur les rochers invisibles qui sont dans ces parages, et tomber en péril.
En effet, le chenal qui donne accès dans le port est plus étroit que la partie latérale de droite, tandis que l’accès du port est plus large dans sa partie de gauche. En effet, autour de l’île, on a jeté des môles d’une grandeur immense, afin que ses fondements, assaillis par l’assaut incessant de la mer en furie, ne cèdent, et ne soient désagrégés par la violence des vents. De là vient, sans aucun doute, que ce chenal, qui, dans toute sa longueur, passe entre les rochers rudes et des môles interrompus, soit constamment agité, et ses flots bouleversés, que dans toute sa traversée, l’entrée des navires soit pleine de périls. La grandeur du port s’étend en dimension à trente stades. Quoique la tempête soit la plus violente, le port, dans son intérieur, est très sûr pour le mouillage, parce qu’il écarte loin de lui les flots de la mer, par le moyen de ces chenaux que nous avons mentionnés ci-dessus et de la barrière constituée par l’île ; en effet, par ces mêmes chenaux du littoral qui rendent l’accès si difficile, la rade immense de tout le port est garantie des tempêtes et protégée contre les froids…
Il (Arculfe) commença à entrer dans la ville (d’Alexandrie) à la troisième heure, au mois d’octobre, se promenant à travers toute la longueur da la cité ; ce fut à peine s’il put parvenir à l’extrémité de sa longueur avant l’heure du crépuscule. Cette ville est entourée par une longue enceinte de murs qui sont fortifiés par des tours se suivant à de courts intervalles, lesquels murs s’élèvent tout à son alentour, sur les bords du fleuve et sur la rive de la mer dont la plage est incurvée. Les personnes qui arrivent du côté de l’Égypte, et qui entrent dans Alexandrie, rencontrent dans la partie de la ville qui est voisine de sa limite septentrionale, une église de dimensions immenses, dans laquelle, dans la terre, gît, inhumé, Marc l’Évangéliste ; on montre son sépulcre devant l’autel, dans la partie orientale de cette église, qui est construite sous la forme d’un rectangle, surmonté d’un monument commémoratif construit en blocs de marbre.
Telles sont les choses que nous savons sur Alexandrie, qui avant qu’Alexandre le Grand l’eût construite, en l’amplifiant considérablement, était nommée No, comme nous l’avons dit plus haut. L’embouchure du fleuve Nil, qui est adjacente à cette ville, et que l’on nomme l’embouchure de Canope, sépare, comme cela a été dit précédemment l’Asie de l’Égypte et de la Libye. Les Égyptiens, à cause de l’inondation du fleuve Nil, construisent de hautes digues autour de ses rives ; si ces digues, par l’effet de la négligence de ceux qui ont la charge de les garder, ou de leur trop petit nombre, viennent à être rompues par l’irruption des eaux, les flots du fleuve n’irriguent point les champs situés en contre-bas, mais les ruinent et les dévastent.
C’est pour cette raison que le plus grand nombre de ceux qui cultivent les plaines de l’Égypte, suivant ce que rapporte saint Arculfe, qui, voyageant en Égypte, a souvent navigué sur ce flot, habitent dans des maisons qui s’élèvent au-dessus des eaux, et qui sont construites sur un tablier de poutres.
Les crocodiles, comme le mentionne Arculfe, sont des animaux quadrupèdes aquatiques, qui demeurent dans le Nil ; ils ne sont pas très grands, mais ils sont voraces, et d’une telle force que si l’un d’eux, par hasard, peut trouver un chenal, ou un âne, ou un bœuf broutant l’herbe tout près de la rive du fleuve, il bondit se précipitant hors des eaux d’un mouvement subit, et le saisissant à pleines dents par le pied, il l’entraîne sous les flots, et dévore l’animal tout entier. »
5 Delierneux, N., « Arculfe, sanctus episcopus gente Gallus : une existence historique discutable »,
Rev. belge philol. hist. 75/4, 1997, p. 911.
Dezobry, Ch. et Bachelet, Th., Dictionnaire général de biographie et d'histoire de mythologie, de géographie ancienne et moderne, Paris, 1880, p. 127.
6 Collectif, Histoire litéraire (sic) de la France où l’on traite…, t. III, Paris, 1735, p. 650.
- 9 - 10 - Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
8e siècle |
|
9e siècle |
BERNARD LE MOINE (vers 870)Deluz, C., « Itinéraire de Bernard, moine franc. Bernard le Moine, IXe siècle », dans D. Régnier-Bohler (éd.),Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XIIe-XVIe siècles, Paris, 1997.
Nous ne savons pas grand chose de l’auteur de ce récit sauf le fait qu’il est né en France comme il l'affirme lui-même7. Bien que les manuscrits affirment qu'il écrivit son Itinéraire en 970, le texte même nous fournit des preuves convaincantes que son pèlerinage se situe autour de 8708. p. 920-921 :
« Nous sommes montés dans un des deux autres navires, où se trouvaient aussi le même nombre de captifs et, au bout de trente jours de navigation, nous avons été débarqués au port d’Alexandrie. Nous voulions descendre à terre, mais le chef des marins – ils étaient plus de soixante – nous en empêcha et, pour obtenir l’autorisation de débarquer, il fallut lui donner six aurei.
De là nous sommes allés nous présenter au prince d’Alexandrie, auquel nous avons montré la lettre que nous avait donnée le sultan. Mais elle ne nous servit à rien, bien qu’il eût dit qu’il reconnaissait les lettres du sultan. Il nous contraignit à lui verser chacun treize deniers et il nous donna des lettres de recommandation pour le maître de Babylone. Chez ces gens, la coutume veut que l’on accepte que pour son poids tout ce qui peut se peser, de sorte que six sous et six deniers de chez nous ne valent pour eux que trois sous et trois deniers.
Cette ville d’Alexandrie est située au bord de la mer. C’est là que saint Marc l’Évangéliste prêcha et occupa la charge d’évêque. Au-delà de la porte orientale, se trouve le monastère de ce saint, avec des moines, près de l’église où il fut d’abord enseveli. Mais des Vénitiens vinrent par mer, prirent furtivement le corps à l’insu des gardiens et l’emportèrent dans leur île. À la sortie de la porte occidentale, il y a un monastère dit des Quarante Saints, où demeurent aussi des moines. Le port est au nord de la ville. Au midi se trouve l’embouchure du Gyron ou du Nil, qui arrose l’Égypte et traverse la ville, avant de se jeter en mer dans ce port. »
7 Tobler, T., Descriptiones Terrae Sanctae, Leipzig, 1874, p. 85.
8 Deluz, C., « Itinéraire de Bernard, moine franc. Bernard le Moine, IXe siècle », dans D. Régnier-Bohler (éd.), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XIIe-XVIe siècles, Paris, 1997, p. 916.
- 11 - Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
YA‘KŪBĪ (dernier quart du IXe siècle)
AḤMAD B. ABĪ YAQŪB
Ya`kūbī, Les Pays, par G. Wiet, Le Caire, 1937.
Né à Bagdad qu’il quitte dans son jeune âge pour se rendre en Arménie, Ya`kūbī appartient à une famille
dont l’un des membres, affranchi du khalife abbasside Al-Mansour, est gouverneur d’Arménie, puis d’Égypte.
Jusqu’en 873, il réside en Arménie dans le Khorasan et rédige un ouvrage d’histoire. Par la suite, il
entreprend de longs voyages qui le mènent de l’Inde jusqu’au Maghreb où il se met à écrire en 889 un
ouvrage géographique intitulé Kitāb al-Buldān (Le Livre des Pays). Nous ne connaissons pas exactement
ses activités. Nous savons qu’il est fonctionnaire un temps en Égypte. Sa vie est celle d’un curieux qui
emploie son temps à s’instruire, à parcourir le monde musulman et à écrire. Il meurt après 905.9
p. 185 :
« ‘Amr conquit les districts d’Égypte par traité, à l’exception d’Alexandrie : il dut assiéger la garnison
d’Alexandrie pendant trois ans et ne s’en empara qu’en l’année 23 (644). Il s’y acharna parce qu’il n’y avait
dans le pays aucune autre ville qui pût lui être comparée sous le rapport de la solidité, de l’étendue et de
l’abondance des approvisionnements. »
p. 196-197 :
« Alexandrie, grande et splendide cité, dont on ne peut décrire l'étendue et la beauté, [est] très riche en
monuments antiques. Parmi ses prodigieux édifices, on compte le phare, situé au bord de la mer, à l'entrée
du grand port, c'est une tour solide et bien construite, haute de 175 coudées, au sommet de laquelle se
trouve un foyer où l'on allume des feux lorsque les vigies aperçoivent des navires loin au large. Il y a aussi
les deux obélisques en pierres bigarrées, reposant sur des écrevisses de cuivre, et recouvertes
d'inscriptions anciennes. Les autres Antiquités et merveilles sont très nombreuses. Un canal amène l'eau
douce du Nil et se jette dans la mer.
D’Alexandrie dépendent un certain nombre de cantons.
Les uns ne se trouvent pas sur le littoral, mais bordent des canaux dérivés du Nil : ce sont les cantons de
Buhaira, Masil, Mallidis, sur le canal d’Alexandrie qui pénètre la cité ; les cantons de Tarnut, Kartasa,
Kharbita, qui sont également sur le canal ; les cantons de Sa, Shabas, Haiyiz, Badakun, Shirak, situés sur
un canal dérivé du Nil, qu’on appelle canal de Nastaru ; d’autres cantons dépendent encore d’Alexandrie,
ceux de Mariout, plein d’arbres et de vignes, et dont les fruits sont renommés, de Libye et de Marakiya, tous
deux sur le littoral, dont les villages les plus voisins d’Alexandrie sont habités par des Banu Mudlidj, fraction
des Kinana, mais la population de ces deux cantons est en majorité berbère : outre les villages, il s’y trouve
des forteresses. »
9 Blachère, R., Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Âge, Paris, Beyrouth, 1932, p. 116.
- 12 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
10e siècle |
IBN RUSTA (903-913)
ABŪ ‘ALĪ AḤMAD B. ‘UMAR B. RUSTA
Ibn Rusta, Ibn Rusteh. Les Atours précieux, par G. Wiet, Le Caire, 1955.
Nous savons seulement qu’il naît à Ispahan et qu’il fait un voyage dans le Hedjaz en 903, c’est
probablement à ce moment-là qu’il visite Alexandrie. Sa description d’Alexandrie se trouve dans le Kitāb
al-A‘lāk al-nafīsa (Les Atours précieux) dont seul le septième tome de cet ouvrage est conservé.10
p. 132-133 :
Le narrateur ajoute que ses compagnons et lui se rendirent à Alexandrie par la voie du fleuve, montée sur
les bateaux qui sont utilisés sur le Nil. Ils descendirent le fleuve pendant quelques jours et arrivèrent à
Alexandrie. C’est une ville agréable, très prospère : ce sont ici les marches extrêmes de l’Islam sur la
Méditerranée. Il vit là un endroit qu’on appelle les Colonnes de Salomon, où se trouvait son palais
résidentiel. Les corps de bâtiments et les murs se sont effondrés et il ne subsiste plus que des colonnes, qui
ne supportent aucune toiture. On trouve encore la porte d’entrée, dont les deux battants, les jambages et le
seuil sont des blocs monolithes taillés dans le roc. Cette porte est pure et lisse comme un miroir car on y voit
s’y refléter les nuages du ciel et la teinte verte de la mer : elle est toute marbrée de points versicolores. Il
examina une de ces colonnes : sa circonférence était si large que deux hommes ne pourraient l’étreindre.
Elle penche d’un côté, sans qu’on la touche. Il resta un long moment à la considérer, puis prenant un
morceau de bois, il s’assit au pied : lorsque la colonne se pencha il introduisit le bois en dessous, mais ne
put le retirer. Il prêta attention aux autres colonnes, mais aucune autre ne remuait. Il remarqua là une
coupole, appelée la Coupole Verte, qu’on lui dit avoir été la Coupole du Pharaon : elle était soutenue par 16
colonnes monolithes, taillées dans le roc, recouvertes de bas-reliefs, statues et motifs divers, en partie
effacés. Cet endroit se nomme la Porte de Pharaon.
Près de la colonnade il vit deux obélisques cubiques, lisses, dressés sur des scorpions en laiton ou en
cuivre, sur lesquels se lisent des inscriptions incompréhensibles : on prétend que ce sont des formules
talismaniques. Il apprit plus tard qu’on avait allumé du feu sous ces scorpions, ce qui les avait fait fondre, et
les obélisques étaient tombés.
Sur le littoral il y a des fortins, dont les vagues de la mer viennent baigner les murs ; on les nomme mahras.
Route de Fustat à Alexandrie
On descend en bateau et, après un parcours de 30 parasanges, on parvient aux remparts d’Alexandrie : on
voit défiler, à droite et à gauche, des palmeraies, des jardins et des villages. Par une jetée en pierres de
taille, qui s’avance sur la mer sur une longueur d’une centaine de pas, on arrive au Phare d’Alexandrie. Ce
Phare célèbre est posé sur quatre crabes en verre. Sa hauteur est de 300 degrés et, à chaque degré, une
lucarne est ouverte sur la mer. Selon d’autres sources, cette hauteur est de 300 coudées royales, ce qui
équivaut à 450 coudées manuelles. En entrant à Alexandrie par la porte de l’Est, on rencontre une coupole
verte, qui repose sur 16 colonnes de marbre. Elle marque le centre de la cité et a été construite par
Alexandre : la mer est à droite de cette coupole, à gauche de laquelle s’étend des plantations de sycomores
et des vignobles. En face se trouve un marché : en y pénétrant vers la droite, on chemine pendant environ
une parasange dans un local en marbre, pavé et lambrissé de marbre, si bien qu’il est infiniment rare qu’on y
salisse ses vêtements. »
10 Maqbul Ahmad, S., « Ibn Rusta », EI2 III, Leyde, Paris, 1990, p. 944-945.
- 13 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
IBN ḤAWQĀL (milieu Xe siècle)
ABŪ L- QĀSIM MUḤAMMAD B. `ALĪ AL-NASĪBĪ
Ibn Ḥawqāl, La configuration de la terre, par J. H. Kramers et G. Wiet, Paris, 2001.
Ibn Ḥawqāl serait né soit à Naṣībīn11 soit à Bagdad. Selon les manuscrits, le titre mentionne « de Niṣībīn »
ou « de Bagdad ». Tout ce ce que l’on connaît à son sujet est tiré de son ouvrage dans lequel il écrit qu’il se
trouve en 932 à Madā’in, au sud de Bagdad, et qu’il est présent à Bagdad en 937. Il avance également qu’il
débute son voyage le 15 mai 943 à partir de la capitale abbasside alors qu’il est dans la fleur de l’âge.12 Ses
péripéties, qui s’étalent sur une trentaine d’années, le conduisent en Afrique du Nord, en Espagne, aux
confins méridionaux du Sahara, en Égypte, en Syrie, à Arḍ al-Ǧazīra (Haute Mésopotamie), aux régions
septentrionales de l’islam et en Sicile. André Miquel affirme qu’il serait l’un des meilleurs représentants, avec
son comtemporain Al-Muqaddasī, de la géographie fondée sur le voyage et l’observation directe et que l’on
peut avancer que ses occupations seraient celles, entre autres, d’un commerçant-missionnaire.13
p. 148-149 (tome I) :
« Une des villes célèbres du pays, dont les Antiquités sont des merveilles, est Alexandrie, située sur une
langue de terre, au bord de la mer Méditerranée. On y voit des antiquités bien apparentes et des
monuments authentiques de ces anciens habitants, témoignages éloquents de royauté et de puissance, et
qui font connaître sa domination sur les autres pays, sa grandeur, sa supériorité glorieuse, et qui constitue
un avertissement et un exemple. Ce sont de gros blocs de pierre, preuves tangibles de civilisation : il y a là
d’immenses colonnes et toutes sortes de dalles de marbre, dont une seule ne peut être remuée que par des
milliers de travailleurs, et qui sont hissées entre ciel et terre à une hauteur de cent coudées, chaque bloc
reposant sur les chapiteaux des colonnes. La circonférence d’une de ces colonnes est de quinze à vingt
coudées, alors que le bloc qu’il porte est un cube de dix coudées de côté. Le tout est décoré avec des
nuances étonnantes et des couleurs prodigieuses.
Si l’on pouvait interroger ces débris sur ceux qui les ont construits et habités, on les entendrait raconter à
leur sujet des histoires impressionnantes.
La ville possède des rues pavées de diverses espèces de marbre, de pierres multicolores. Dans les églises
on trouve des colonnes qui, par leur polissage parfait et par la beauté de leur coloris, paraissent être faites
d’émeraude verte, ou, d’onyx tantôt jaune, tantôt rouge. Les plus importants de ces édifices ont été édifiés
sur des colonnes dont les blocs ont été scellés à l’aide de tiges de fer invisibles ; il en est qui s’élèvent sur
des pilastres en cuivre, et le tout a été mis en place à l’aide de mélanges chimiques, pour que le temps
n’altère rien. Au pied de chaque colonne, il y a trois ou quatre crabes en cuivre, et au sommet, la colonne est
couverte de différentes figures, connues ou inconnues. C’est dans cet édifice que (p. 149) se trouve le Phare
célèbre, bâti en pierres solidement agencées et jointoyées avec du plomb. Ce Phare n’a rein de comparable
sur toute la terre, ou même qui en approche, par sa forme, sa structure, ses propriétés merveilleuses, et
symboliques, dans lesquelles est contenu un avertissement divin évident, et qui permettent de conclure à
l’existence d’un ancien royaume puissant, gouverné par un prince d’une grande autorité et d’une
omnipotence indéniable. C’est là ce Phare dont la réputation s’est répandue à travers le monde, dans le
grand public comme chez les savants spécialisés, qui, d’un commun accord, assurent que son fondateur l’a
construit pour observer le firmament et pour acquérir par ce moyen des notions astronomiques : c’est par là
qu’il a dominé cette science et a obtenu la connaissance de la voûte céleste. Il obtint cette réussite, dont
profitèrent ses successeurs, grâce à l’espace libre, au ciel ouvert de tous côtés qui l’entoure, à l’absence
presque complète de vapeurs s’élevant dans la plaine, car si chaque pièce de terre a une dose de nuages
proportionnée à ses dimensions, les environs du Phare ne sont nullement baignés par des brouillards. Sa
hauteur était autrefois de plus de trois cents coudées, mais une coupole immense est tombée, qui coiffait le
sommet de l’édifice depuis des temps immémoriaux. Contrairement aux histoires absurdes forgées et aux
stupidités débitées par des hâbleurs, cette coupole n’avait pas été construite pour abriter un miroir dans
lequel on pouvait voir tout ce qui pénétrait dans la mer Méditerranée, dromons porteurs de troupes, ou
navires de combat. Des gens prétendent que le Phare et les Pyramides ont été fondés par le même
souverain, mais d’autres rapportent des traditions différentes. »
11 Cette ville faisait partie de la contrée appelée Arḍ al-Ǧazīra, au nord de l’Irak. Actuellement, elle se trouve
en Turquie sous le nom de Nisibis.
12 Kramers, J. H., Wiet, G., Ibn Hauqal. Configuration de la terre, tome 1, Paris, 1964, p. XI.
Garcin, J.-C., « Ibn Hawqal, l’Orient et le Maghreb », dans ROMM 35, 1983, p. 79. Jean-Claude Garcin émet
l’hypothèse que la famille de cet auteur serait de Niṣībīn et que celui-ci serait né à Bagdad.
13 Miquel, A., « Ibn Ḥawḳāl », EI2 III, Leyde, Paris, 1990, p. 810.
Miquel, A., La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle, tome 1, Paris, 2001,
p. 299-309.
- 14 - 15 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-MAS‘ŪDĪ (milieu du Xe siècle)
ABŪ L-ḤASAN `ALI B. AL-ḤUSAYN
Al-Mas`ūdī, Maçoudi. Les Prairies d’or, par C. Barbier de Meynard et A. Pavet de Courteille, Paris, 1861-
1877.
Al-Mas`ūdī naît à Bagdad vers 893 et meurt probablement à Fostat en 956. Il passe sa jeunesse à Bagdad
où il suit les cours de grandes célébrités de l’époque. Bien que l’on ne connaisse pas sa profession, on sait
qu’il effectue de longs voyages à l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman. André Miquel14 émet
l’hypothèse qu’il aurait pu être un émissaire des ismaéliens. En 915, il visite la Perse, l’Inde et peut-être
Ceylan et la Chine. En 916, il rentre dans son pays. Puis de 918 à 928, il voyage en Irak, en Syrie et
peut-être en Arabie. Vers 932, il visite les provinces de la Caspienne et l’Arménie. À partir de 941, il réside
en Égypte où il rédige en 943, Kitāb Murūǧ al-Ḏahab (Livre des Prairies d’or). On sait qu’il visite Alexandrie
et la Haute-Égypte. C’est à Fostat qu’il paraît avoir passé ses dernières années à revoir ses ouvrages et à
en écrire de nouveaux, particulièrement Kitāb al-Tanbih wa-l-išrāf (Livre de l’avertissement et des révisions),
achevé en 956. Par ailleurs, il est l’auteur de 36 ouvrages, mais seuls les deux cités ci-dessus nous sont
parvenus.15
p. 209-210 (tome I) :
« Le Nil se partage ensuite en plusieurs branches qui se dirigent sur Tinnis, Damiette et Rosette, jusqu’à
Alexandrie, et se décharge dans la Méditerranée ; il forme plusieurs lacs dans ces parages. Cependant le Nil
s’est retiré du territoire d’Alexandrie avant la crue de la présente année (332 de l’hégire). Je me trouvais à
Antioche et sur les frontières de la Syrie, lorsque je reçus la nouvelle que le fleuve venait d’atteindre dix-huit
coudées ; mais je ne pus savoir si l’eau avait pénétré ou non dans le canal d’Alexandrie.
(p. 210) Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, bâtit cette ville sur ce bras du Nil ; la plus grande partie du
fleuve pénétrait dans ce canal et arrosait les campagnes d’Alexandrie et de Mariout (Maréotis). Le pays de
Mariout, en particulier, était cultivé avec le plus grand soin, et offrait une suite non interrompue de jardins
jusqu’à Barkah, dans le Maghreb. Les bâtiments qui descendaient le Nil arrivés jusqu’aux marchés
d’Alexandrie, dont les quais étaient formés de dalles et de blocs de marbre. Plus tard des éboulements ont
bouché ce canal et empêché l’eau d’y entrer ; d’autres obstacles encore n’ont pas permis, dit-on de nettoyer
le canal et de donner un libre cours à l’eau ; mais nous ne pouvons admettre tous ces détails dans un livre
qui n’est qu’un résumé. Depuis lors les habitants boivent de l’eau du puits, car ils sont à une journée environ
du fleuve. On trouvera plus bas, dans le chapitre consacré à Alexandrie, d’autres détails sur cette ville et sa
fondation. »
p. 296-297 (tome II) :
« Pour en revenir à ce prince [César], il fit la conquête de la Syrie, de l’Égypte et d’Alexandrie. C’est lui qui fit
disparaître le dernier des souverains d’Alexandrie et de Macédoine, formant le royaume d’Égypte ; car nous
avons fait remarquer plus haut que ceux qui gouvernaient la Macédoine et Alexandrie étaient tous désignés
sous le nom de Ptolémée. Auguste s’empara des trésors des rois d’Alexandrie et de Macédoine, et les
transporta à Rome. »
p. 420-440 (tome II) :
« Plusieurs savants rapportent qu’Alexandre le Macédonien, après avoir consolidé son autorité dans son
pays, se mit à la recherche d’une contrée salubre, fertile et bien arrosée. En arrivant sur l’emplacement
d’Alexandrie, il y trouva les vestiges d’un vaste édifice et un grand nombre de colonnes de marbre. Au
centre s’élevait une haute colonne portant l’inscription suivante tracée en caractères mosned, c’est-à-dire
dans l’écriture primitive de Himyar et des rois de Ad : « Moi Cheddad, fils de Ad, fils de Cheddad, fils de Ad,
dont le bras a protégé la terre, j’ai taillé de grandes colonnes dans les montagnes et les carrières, j’ai bâti
Irem aux piliers qui n’a pas d’égale au monde. Puis j’ai voulu bâtir ici une ville semblable à Irem et y réunir
tous les hommes nobles et généreux, l’élite des tribus et des nations, parce que ce pays est exempt de
dangers, et à l’abri des atteintes de la fortune, des désastres et des fléaux. Mais j’ai rencontré celui qui m’a
contraint de me hâter et de renoncer à mon projet, en me suscitant des obstacles qui ont prolongé mes
soucis et mes craintes et abrégé mon sommeil et mon repos. Alors j’ai quitté avec sécurité ma demeure, non
pas en fuyant devant un roi superbe ou une armée nombreuse, ni en cédant à la crainte ou à la honte, mais
parce que le terme de la durée (de ma vie) était arrivé et que tout doit s’effacer devant le pouvoir du Dieu
glorieux et tout-puissant. Vous qui verrez ces vestiges, vous qui connaîtrez mon histoire, ma longue
existence, la sûreté de mes vues, ma fermeté et ma prudence, ne vous laissez pas séduire, après moi par la
fortune. » L’inscription offrait de longues sentences sur le néant de ce monde et le danger de céder à ses
illusions et de placer en lui sa confiance. Alexandre s’arrêta pour méditer ces paroles et en faire son profit. Il
rassembla ensuite des ouvriers de tous les pays, et fit le tracé de ses fondations, qui s’étendirent à plusieurs
milles en long et en large. Il réunit des blocs de pierre et de marbre. Ses navires lui apportèrent différentes
sortes de marbres et de pierres provenant de la Sicile, de l’Ifrikyah, de Crète et des confins de la
Méditerranée, là où cette mer débouche de l’Océan. Il en reçut aussi de l’île de Rhodes. Cette île est située
en face d’Alexandrie, à la distance d’une nuit de navigation, c’est là que commence le pays des Francs.
Aujourd’hui, en 332 de l’hégire, Rhodes est un arsenal où les Grecs construisent leurs vaisseaux de guerre ;
elle est habitée en partie par les Grecs, et leur flotte sillonne les eaux d’Alexandrie et les autres parages de
l’Égypte ; ils y abordent et font des prisonniers qu’ils réduisent en esclavage.
Sur l’ordre d’Alexandre, les ouvriers se placèrent autour du tracé des murailles. De distance en distance, des
pieux furent fixés en terre, et l’on y attacha des cordes entrelacées dont l’extrémité venait aboutir à une
colonne de marbre, devant la tente du roi. Alexandre fit placer au sommet de cette colonne une grosse
cloche au timbre sonore, puis il donna ses ordres aux conducteurs des travaux. Dès que la cloche retentirait
et mettrait en mouvement les cordes, au bout desquelles on avait attaché des cloches plus petites, ils
devaient commander aux ouvriers de jeter les fondations en même temps et sur toute la ligne du tracé. Il
voulait par ce moyen qu’une heure et un horoscope fortuné fixés par lui présidassent à l’inauguration des
travaux. Un jour qu’il épiait l’arrivée de l’heure propice à l’observation de l’horoscope, il se sentit la tête
lourde et s’endormit. Un corbeau vint se poser au sommet de la colonne sur la grosse cloche, et la fit sonner.
Les cordes s’agitèrent et mirent en branle les petites cloches, grâce à un procédé qu’on avait emprunté à la
science et aux lois de la mécanique. Les ouvriers, voyant les cordes vibrer et entendant le son de ces
cloches, jetèrent tous ensemble les fondations, et firent retentirent l’air de leurs actions de grâces et de leurs
prières. Alexandre se réveilla et fut très étonné en apprenant la cause de ces rumeurs. Il dit alors : « J’avais
voulu une chose, Dieu en a voulu une autre ; il rejette ce qui est contraire à sa volonté. Je désirais assurer la
durée de cette ville, Dieu a décidé qu’elle périrait et disparaîtrait bientôt, après avoir appartenu à différents
rois. » Cependant la construction d’Alexandrie était commencée et les fondements en étaient posés, lorsque
à la faveur de la nuit, des animaux sortirent du fond de la mer et détruisirent tout ce qui avait été fait. Le
lendemain Alexandre tira de cet événement les plus fâcheux pronostics. « Voilà, s’écria-t-il, le
commencement de sa décadence, et déjà se vérifient les décrets de Dieu sur sa ruine prochaine ! »
À mesure que la construction avançait, et malgré la présence des gardiens chargés de repousser les
animaux lorsqu’ils sortaient de l’eau, tous les matins l’ouvrage de la veille se trouvait détruit. Alexandre fut
saisi d’inquiétude à ce spectacle ; il médita sur ce qu’il y avait à faire et chercha le moyen d’éloigner de la
ville une pareille calamité. Une nuit pendant qu’il réfléchissait, dans la solitude, sur tous ces événements, un
stratagème se présenta à son esprit. Le lendemain matin il appela des ouvriers et se fit construire un coffre
en bois long de dix coudées, sur cinq coudées de large. Tout autour de ce coffre, et à l’intérieur, on posa des
plaques de verre et l’on appliqua sur le bois des couches de poix, de résine et d’autres enduits de nature à
empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur ; on réserva aussi une place pour y attacher des cordes. Alexandre y
entra alors avec deux de ces secrétaires, dessinateurs habiles, et ordonna qu’on fermât l’ouverture du coffre
et qu’on la bouchât avec les mêmes enduits. Deux grands vaisseaux gagnèrent le large. Des poids en fer et
en plomb et de lourdes pierres avaient été attachés à la partie inférieure du coffre pour l’entraîner au fond de
l’eau, parce que étant rempli d’air, il aurait flotté à la surface sans pouvoir gagner le fond. Puis on l’attacha
avec des câbles entre les deux bâtiments que des planches mises en travers empêchaient de se séparer
l’un de l’autre, on laissa filer les câbles, et le coffre descendit jusqu’au fond de la mer. Grâce à la
transparence du verre et à la limpidité de l’eau, Alexandre et ses deux compagnons virent des animaux
marins et des espèces de démons ayant une forme humaine et la tête semblable à celles des bêtes féroces.
Les uns tenaient des haches, les autres des scies ou des marteaux, et ils ressemblaient aux ouvriers avec
ses outils analogues aux leurs. Alexandre et ses compagnons tracèrent sur le papier et dessinèrent
exactement tous ces monstres, en reproduisant leur aspect hideux, leur stature et leurs formes variées. Puis
ils agitèrent les cordes, et, à ce signal, le coffre fut hissé par l’équipage des deux bâtiments. Alexandre en
sortit et retourna à Alexandrie. Là, il ordonna aux ouvriers qui travaillaient le fer, le cuivre et la pierre, de
reproduire ces animaux d’après les dessins qu’il avait apportés. Ces figures étant terminées, il les fit placer
sur des blocs le long du rivage ; puis on reprit la construction de la ville. La nuit venue, lorsque les monstres
marins sortirent de l’eau et se trouvèrent en face de leur propre image placée sur le bord de la mer, ils
regagnèrent aussitôt le large et ne se montrèrent plus.
Une fois Alexandrie et ses fortifications terminées, le roi fit mettre cette inscription sur les portes de la ville :
« Voici Alexandrie ; je voulais la bâtir sur les bases de la sécurité et du salut, assurer son bonheur, sa félicité
et sa durée ; mais Dieu le tout-puissant, le roi des cieux et de la terre, le destructeur des peuples, en a
décidé autrement. J’ai construit cette ville sur des fondements solides ; j’ai fortifié ses murailles. Dieu m’a
donné la science et la sagesse en toutes choses, et m’a aplani les voies. Aucune de mes entreprises ici-bas
n’a échoué, tout ce que j’ai souhaité m’a été accordé par la grâce de ce Dieu glorieux et la bonté qu’il m’a
témoignée pour réaliser le bonheur de ces serviteurs qui ont vécu dans mon siècle. Gloire à Dieu, maîtres
des mondes, il n’y a pas d’autre Dieu que lui, le souverain de l’univers ! » la suite de cette inscription
annonçait tous les événements futurs concernant Alexandrie, sa postérité, sa ruine et en général tout ce qui
l’attendait dans l’avenir, jusqu’à la fin du monde.
Alexandrie était bâtie en gradins, et au-dessous de ces maisons s’étendaient des voûtes cintrées. Un
cavalier armé de sa lance pouvait, sans être gêné par l’espace, faire le tour de ces voûtes et de ces
souterrains. On y avait pratiqué des ouvertures et des soupiraux pour laisser pénétrer l’air et la lumière.
Pendant la nuit, la ville était éclairée, sans le secours de flambeaux et par le seul éclat de ses marbres. Les
marchés, les rues et les ruelles étaient voûtés, et les passants y trouvaient un abri contre la pluie. Son
enceinte se composait de sept murailles en pierres de différentes couleurs et séparées par des fossés ;
entre chaque fossé et la muraille voisine s’élevait un retranchement. Souvent on suspendait au-dessus de la
ville des voiles en soie verte pour protéger les yeux contre la blancheur éclatante du marbre. Quand
Alexandrie fut bâtie et peuplée, les monstres et les animaux marins reparurent pendant la nuit, s’il faut en
croire les conteurs égyptiens et alexandrins, de sorte que chaque matin on constatait un vide considérable
dans la population. Alexandre plaça alors des talismans sur des colonnes nommées el-Mesal, lesquelles
existent encore. Chacune de ces colonnes est en forme de flèche, elle a quatre-vingt coudées de haut et
repose sur un piédestal d’airain. Alexandre fit placer à la base des images, des statues et des inscriptions,
en ayant soin de choisir le moment où quelques degrés de la sphère céleste s’étaient abaissés et
rapprochés de la terre. En effet ceux qui appliquent l’étude de l’astronomie et de la sphère céleste aux
talismans prétendent que lorsque certains degrés de la sphère s’élèvent et que d’autres s’inclinent, ce qui a
lieu dans une période déterminée, égale à six cents ans environ, les talismans exercent sur la terre leur
action tutélaire et défensive. Ce fait est avancé par plusieurs auteurs de tables et d’observations
astronomiques, et il se trouve dans les ouvrages qui traitent de cette science. Leurs théories sur les
mystères de la sphère céleste, l’opinion de ceux qui considèrent cette influence comme la plus bénigne des
forces universelles, et d’autres opinions analogues ne peuvent trouver place ici. Mais les explications
relatives aux degrés de la sphère sont rapportées dans les ouvrages des plus savants astronomes
modernes, tels que Abou Machar de Balkh, el-Khârezmi, Mohammed, fils de Kethir el-Fergani, Machallah,
Habech, el-Yezidi, Mohammed, fils de Djabir el-Boutani, dans sa grande Table astronomique, Tabit, fils de
Korrah, et d’autres savants qui ont traité de la sphère céleste et des constellations.
Au rapport de la plupart des historiens originaires de l’Égypte et d’Alexandrie, le phare d’Alexandrie fut bâti
par Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, dans les circonstances rapportées ci-dessus au sujet de la
fondation de cette ville. D’après d’autres auteurs, ce fut la vieille reine Deloukeh qui le bâti et en fit un poste
d’observation destiné à surveiller les mouvements de l’ennemi. D’autres en attribuent l’origine au dixième
Pharaon, dont il a été parlé précédemment. Enfin d’autres auteurs assurent que c’est au fondateur de Rome
qu’Alexandrie, le phare et les pyramides doivent leur existence ; dans cette hypothèse, le nom d’Alexandrie
viendrait seulement de la célébrité d’Alexandre dont les armes subjuguèrent la plus grande partie du monde.
À l’appui de cette opinion, on cite plusieurs faits. Alexandre, dit-on par exemple, n’avait pas besoin de faire
de ce phare un poste d’observation, puisqu’il ne redoutait aucune attaque par mer, et que nul souverain
étranger n’aurait osé envahir ses États et marcher sur sa capitale. On ajoute que le véritable auteur du
phare le bâtit sur un piédestal de verre en forme d’écrevisse, qui reposait sur le fond de la mer, à l’extrémité
de cette langue de terre qui se détache du continent (île de Pharos). Il couronna le faîte de l’édifice de
statues de bronze et d’autre métal. Une de ces statues avait l’indicateur de la main droite constamment
tourné vers le point où se trouvait le soleil ; s’il était au milieu de sa course, le doigt en indiquait la position ;
s’il disparaissait de l’horizon, la main de la statue s’abaissait, et décrivait ainsi la révolution de l’astre. Une
autre statue tournait vers la mer, dès que l’ennemi était à la distance d’une nuit de navigation. Quand il
arrivait à portée de la vue, un son effrayant et qu’on entendait à deux ou trois milles de là sortait de la statue.
Les habitants, avertis ainsi de l’approche de l’ennemi, pouvaient en surveiller les mouvements. Une
troisième statue indiquait toutes les heures du jour et de la nuit par un son harmonieux, et qui variait avec
chaque heure.
Sous le règne d’el-Walid, fils d’Abd el Mélik, fils de Merwan, le roi de Byzance envoya en mission secrète un
de ses eunuques favoris. Ce serviteur, doué d’une prudence et d’une astuce consommées, parvint sain et
sauf, grâce à d’habiles manoeuvres, jusqu’à la frontière musulmane, lui et les gens de sa suite. Conduit en
présence d’el-Walid, il lui apprit qu’il était un des courtisans du roi grec, et que ce roi, dans un mouvement
de colère et sur des soupçons mal fondés, ayant voulu le mettre à mort, il avait quitté la cour. Cet étranger
manifesta le désir de devenir musulman et fit sa profession de foi entre les mains d’el-Walid. Peu à peu il
capta les bonnes grâces de ce prince, et lui révéla l’existence de trésors cachés à Damas et dans d’autres
localités de la Syrie, d’après des indications précises fournies par certains livres qu’il avait apportés. Lorsque
la vue de ces trésors et de ces bijoux eut redoublé la curiosité et la convoitise d’el-Walid, l’eunuque lui dit un
jour : « Prince des croyants, il y a ici même des trésors, des pierres précieuses et d’autres objets de prix
cachés par les anciens rois. » Et sur les instances d’el-Walid, il ajouta : « C’est sous le phare d’Alexandrie
que sont enfouis les trésors de la terre. Sachez, en effet, que lorsque Alexandre s’empara des biens et des
pierres précieuses qui avaient appartenu à Cheddad, fils de Ad, ou à d’autres rois arabes en Égypte et en
Syrie, il fit construire des caves et des chambres souterraines, surmontées de voûtes et d’arcades. C’est là
qu’il déposa tous ses trésors, lingots, valeurs monnayées et pierres fines. Au-dessus de ces souterrains il
bâtit le phare, qui n’avait pas moins de mille coudées de haut, et plaça au faîte le miroir et un poste de
veilleurs. Dès que l’ennemi se montrait au large, ils criaient pour avertir les postes voisins et donnaient, à
l’aide de signaux, l’éveil aux plus éloignés. De cette façon les habitants étaient avertis, ils couraient à la
défense de la ville et déjouaient les tentatives de l’ennemi. » En conséquence el-Walid fit partir cet eunuque
avec des soldats et quelques courtisans dévoués ; ils démolirent le phare jusqu’à la moitié de sa hauteur, et
détruisirent le miroir. Cette manoeuvre de destruction indigna les habitants d’Alexandrie et des autres villes,
car ils comprirent que c’était une ruse et une manoeuvre perfide dont ils seraient les victimes. Voyant que
ces rumeurs se propageaient et qu’elles ne tarderaient pas à venir jusqu’à el-Walid, l’eunuque, dont le but
était atteint, s’échappa pendant la nuit et s’éloigna sur un bâtiment que des gens apostés par lui tenaient
tout prêt à partir. Ainsi s’accomplit son stratagème, et depuis lors le phare est resté à demi ruiné, jusqu’à la
présente année 332 de l’hégire.
Il y avait dans les parages voisins d’Alexandrie une pêcherie pour les fragments de pierres précieuses qu’on
retirait de la mer et dont on faisait des chatons de bagues ; on y trouvait toutes sortes de pierres fines
comme le kerken, l’adrak et l’esbadédjechm. On a prétendu qu’elles ornaient les vases dont se servait
Alexandre dans ses festins, et qu’après sa mort sa mère les fit briser et jeter dans l’eau en cet endroit.
D’autres racontent qu’Alexandre réunit ces bijoux et les jeta à dessein dans la mer, afin que les abords du
phare ne fussent jamais déserts. Car les pierres précieuses, qu’elles soient dans le sein de la mine ou au
fond de la mer, doivent être en tout temps l’objet des recherches de l’homme, et le lieu qui les recèle est
toujours un centre d’agglomération. De toutes les pierres qu’on pêche aux alentours du phare, celles qu’on
retire le plus souvent sont de l’espèce dite esbadédjechm.
J’ai vu plusieurs lapidaires et artisans qui travaillent les pierres nommées occidentales façonner
l’esbadédjechm et en faire des chatons de bague et d’autres bijoux. Il en est de même des chatons nommés
bakalemoun (pour bakalemoun camaléon), qui offrent à l’oeil des nuances chatoyantes et variées entre le
rouge, le vert, le jaune, etc. Nous en avons parlé précédemment. Le chatoiement résulte de l’éclat et de la
limpidité de la pierre, et aussi de l’angle sous lequel l’oeil la considère. Dans la pierre nommée bakalemoun,
le chatoiement rappelle les reflets multiples que présentent la queue et les ailes des paons, mais chez le
mâle seulement. J’ai vu dans l’Inde quelques-uns de ces oiseaux dont le plumage offrait au regard des
nuances innombrables et qu’on ne saurait comparer à aucune couleur connue. Ces nuances se succédaient
l’une à l’autre et variaient suivant la grosseur de l’oiseau, sa taille et la longueur de ses plumes. Les paons
sont d’une beauté remarquable dans l’Inde, mais, lorsqu’on les portes en pays musulmans et qu’ils pondent
loin de leur pays natal, les petits deviennent chétifs ; leur plumage se ternit et perd ses couleurs variées, et
ils n’ont plus qu’une vague ressemblance avec les paons indiens. Ceci doit s’entendre des mâles et non des
femelles. On peut en dire autant de l’oranger et du citronnier rond, qui furent apportés de l’Inde,
postérieurement à l’an 300, et semés d’abord dans l’Oman. De là on les planta à Basrah, en Irak et en
Syrie ; ils devinrent très communs dans les maisons de Tarsous et d’autres villes frontières de la Syrie, à
Antioche, sur les côtes de Syrie, en Palestine et en Égypte, contrées où ils étaient inconnus auparavant.
Mais ils perdirent l’odeur pénétrante et suave ainsi que l’éclat qu’ils avaient dans l’Inde, n’étant plus dans les
conditions de climat, de terroir et d’eau qui sont particulières à ce pays.
On croit que le miroir placé au sommet du phare ne devait son origine qu’aux attaques dirigées par les rois
grecs, successeurs d’Alexandre, contre les rois d’Alexandrie et d’Égypte. Les maîtres d’Alexandrie se
servaient de ce miroir pour reconnaître les ennemis qui venaient par mer. En outre, quiconque pénétrait
dans le phare, sans en connaître l’accès et les issues, se perdait dans cette foule de chambres, d’étages et
de passages inextricables. On raconte aussi que, durant le règne d’el-Moktadi, lorsque l’armée des Maures
entra dans Alexandrie sous la conduite du maître de l’occident (Sahib el-Magreb), une troupe de cavaliers
pénétra dans le phare et s’y égara dans un dédale de rues qui aboutissaient à des couloirs étroits au-dessus
de l’écrevisse de verre ; il y avait là des ouvertures donnant sur la mer et par où ils tombèrent avec leurs
chevaux. Ainsi qu’on le sut plus tard, le nombre des victimes fut considérable. Suivant une autre version du
haut d’une plate-forme qui s’étendait devant le phare. Cet emplacement est occupé aujourd’hui par une
mosquée où séjournent pendant l’été les volontaires égyptiens et d’autres contrées.
L’Égypte, Alexandrie, le Maghreb, l’Espagne, Rome et en général tous les pays situés à l’orient et au
couchant au nord et au midi, referment plusieurs localités intéressantes, des monuments et des ruines
remarquables, et des propriétés locales dont l’influence se fait sentir sur leurs habitants. Les détails que
nous avons donnés dans nos autres ouvrages sur les merveilles du monde, les êtres qui habitent le
continent et la mer, etc. nous dispensent d’y revenir ici. »
- 16 - 20 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-MUQADDASĪ (avant 985)
ŠAMS AL-DĪN ABŪ `ABD ALLĀH MUḤAMMAD B. AḤMAD B. ABĪ BAKR AL-BANNĀ’ AL-AMĪ
Miquel, A., « L’Égypte vue par un géographe arabe du IV/Xe siècle : Al-Muqqaddassi », AnIsl 11, 1972,
p. 109-139.
Sa vie est fort mal connue, nous savons qu’il était Palestinien et qu’il serait mort aux alentours de 990. Il fit
deux pèlerinages à La Mecque en 967 et en 978. Il prit la décision de composer ce livre à Shiraz en 985.16
p. 115 :
« Al-Iskandariyya (Alexandrie) est un chef-lieu magnifique, dominé par une redoutable forteresse, sur le bord
de la mer du Rum : pays noble, riche en hommes vertueux et pieux. On y boit l'eau du Nil : aux jours de sa
crue, un canal la porte jusque chez l'habitant, où elle vient emplir les réservoirs. Alexandrie qui est syrienne
(samiyya) par son climat et ses coutumes, bénéficie de pluies abondantes et rassemble les produits les plus
contrastés ; elle a un canton important, des fruits et des raisins excellents ; elle est agréable et propre, bâtie
en pierre marine ; c'est une mine de marbre. Elle a deux grandes mosquées. Aux citernes, on voit des
portes, que l'on ferme la nuit pour empêcher les voleurs de monter par là. Les autres cités sont prospères et
agréables : leurs territoires produisent la caroube, l'olive, l'amande, les exploitations suivant [les règles de] la
culture sèche. C'est à Alexandrie que le Nil se déverse dans la mer du Rum. Cité de Du l-Qarnayn, elle a un
extraordinaire chef-lieu. »
p. 131 :
« …le Nil arrive aussi jusqu'à Alexandrie17 et y entre par un conduit de fer ; les gens, alors, emplissent leurs
réservoirs ; après quoi, l'eau se retire. »
p. 132 :
« A Alexandrie, il est un poisson rayé, du nom de sarb (saupe ?), dont la chair consommée produit des
hallucinations18, sauf chez qui est habitué à boire du vin, auquel cas elle ne produit aucun mal. »
p. 135 :
« Le phare d'Alexandrie a ses fondations enfoncées dans une presqu'île ; on y accède par un chemin étroit,
fait de grosses pierres, parfaitement aménagées. L'eau vient battre le phare du côté ouest, tout comme elle
fait à la forteresse de la ville, à cette différence près que le phare est sur une [presqu']île. Le phare se
compose de trois cents pièces, dont certaines peuvent être atteintes à cheval, et toutes avec [l'aide d']un
guide. Le phare domine toutes les cités de la mer ; il avait, dit-on, un miroir où se voyait tout vaisseau faisant
voile à partir de n'importe quel rivage. Un préposé y demeurait en permanence, de nuit et de jour aux
aguets ; quand un navire lui apparaissait, il informait le gouverneur et lâchait les pigeons19 sur la côte pour
que les gens se tinssent prêts. Ces chiens de Byzantins dépêchèrent un des leurs qui, à force de ruses et de
simagrées, réussit à se faire nommer préposé : il put alors entreprendre de [détruire] le phare et même,
disent certains, le détruisit et le précipita dans la mer. Dans le Livre des Talismans, il est dit que le phare fut
bâti pour [servir de] talisman et éviter à la terre d'Égypte d'être submergée par l'eau de la mer ; et c'est
pourquoi ces chiens de Byzantins intriguèrent afin de détruire le sommet, mais sans succès. »
p. 138 :
« J'ai vu, sur le rivage de Tinnis, un employé d'octroi en faction, et l'on m'a assuré que ce poste rapportait
mille dinars par jour. Il y en a de semblables, fort nombreux, sur les rives du haut Nil et sur les côtes
d'Alexandrie, et d'autres encore, à Alexandrie, pour les bateaux [venant de] l'ouest, ou à al-Farama, pour
ceux du Sam. »
p. 139 :
« …par eau, d'al-Farama à Tinnis : une étape ; puis une pour Dimyat, une pour al-Mahallat al-kabira, et deux
pour Alexandrie. »
«D'Alexandrie à ar-Rafi'a : une étape. »
«D'Alexandrie à al-Gadira : une étape. »
16 Miquel, A., « Al-Muḳaddasi », EI2 VII, Leyde, New York, Paris, 1993, p. 492-493.
17 Littéralement : « au chef lieu [de la région] d'Alexandrie ». Note de A. Miquel.
18 Manamat wahsa : des rêves sauvages. Note de A. Miquel.
19 Littéralement : les oiseaux. Note de A. Miquel.
- 21 - 22 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
11e siècle |
NĀṢIR L-ḪUSRAW (1047-1050)
ABŪ MU`ĪN NĀṢIR B. ḪUSRAW B. ḤĀRIṮ AL-QUBĀḎIYĀNĪ
Nāṣir l-Ḫusraw, Sefer Nameh. Relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en
Arabie et en Perse, pendant les années de l’hégire 437-444 (1035-1042), par Ch. Schefer, Paris, 1881.
Nāṣir l-Ḫusraw (1004-1072/1078), poète et prosateur persan, voyageur et philosophe, appartient à une
famille de propriétaires terriens et de fonctionnaires de Kubadhiyani. Il travaille comme fonctionnaire à Marw
tout en poursuivant ses études. Il s’intéresse à la philosophie, aux sciences, aux mathématiques et à la
poésie. En 1045, accompagné de son frère et d’un domestique, il part pour un voyage qui dure sept ans. Il
explique sa décision par un rêve. Après avoir accompli le pèlerinage, il se rend en Égypte et arrive au Caire
en 1047 où il reste trois ans, se familiarisant avec la doctrine ismaélienne. Il quitte cette ville en 1050 et se
rend à La Mecque puis à Balkh où il arrive en 1052. Là commence la phase suivante de sa vie où il se
charge de prêcher.20
p. 119-120 :
« On compte trente fersengs21 de Misr à Alexandrie qui se trouve sur le bord de la mer de Roum non loin de
la rive du Nil. On transporte de cette ville à Misr22, sur des barques, une quantité considérable de fruits.
Je vis à Alexandrie un phare qui était en bon état de conservation. On avait jadis placé au sommet un miroir
ardent qui incendiait les navires grecs venant de Constantinople, lorsqu’ils se trouvaient en face de lui. Les
Grecs firent de nombreuses tentatives et eurent recours à divers stratagèmes pour détruire ce miroir. À la
fin, ils envoyèrent un homme qui réussit à le briser.
A l’époque où Hakim bi Amr Illah régnait en Égypte, un individu se présenta devant lui et prit l’engagement
de réparer ce miroir et de le remettre en son état primitif. Hakim bi amr illah lui répondit qu’il n’y voyait pas de
nécessité, parce qu’à cette époque les Grecs payaient tous les ans un tribut en or et en marchandises ; ils
se conduisent, disait-il, de cette façon que nos troupes (p. 120) n’ont pas à marcher contre eux et les deux
pays jouissent d’une paix profonde.
L'eau que l'on boit à Alexandrie est de l'eau de pluie. La plaine qui entoure la ville est jonchée de colonnes
de pierre gisant à terre et qui ressemblent à celles dont j’ai parlé précédemment. »
20 Nanji, A., « Nāṣir l-Ḫusraw », EI2 VII, Leyde, New York, Paris, 1993, p. 1007-1009.
21 Le parasange, unité de distance perse, correspond à environ 5,6 km. Ce qui revient à 168 km entre le
Caire et Alexandrie.
22 Le Caire.
- 23 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ABŪ BAKR B. AL-‘ARABĪ (1092 et 1100)
Abū Bakr b. al-‘Arabī, Ma‘a al-qāḍī abī Bakr b. al-‘Arabī, par Sa’īd A‘rab, Beyrouth, 1987.
Abū Bakr b. al-‘Arabī23, originaire de Séville (1076-1148), est issu d’une grande famille de dignitaires
abbadites. En 1092, il décide d’effectuer un voyage en Orient en compagnie de son père, jurisconsulte, en
raison de la détérioration de la situation au moment de la chute des Abbadites et de l'installation du
gouvernement almoravide. Alors que le père est motivé par le pèlerinage, Abū Bakr souhaite davantage
s’instruire au cours de cette expérience puisqu’il affirme : « Si tu as l'intention d'effectuer le pèlerinage,
réalise ton voeu, moi je ne suis désireux d'aborder ce pays que pour y apprendre la science qui s’y trouve. Je
considère cela comme un congé scientifique et un moyen d'accéder aux divers degrés de la
connaissance »24. Les deux voyageurs passent par Alexandrie, à l’aller, en 1092, et au retour, en 1100, date
à laquelle le père meurt dans cette ville. Entre temps, Abū Bakr réside à Jérusalem, Damas et Bagdad pour
y étudier sous la direction, entre autres, d’Abū Ḥāmid al-Ġazālī. Il accomplit le pèlerinage à La Mecque en
1096. Après dix ans de voyage, il regagne Séville en 1102 où il s’installe pour y donner des consultations
juridiques, enseigner le Droit et les Fondements de la religion, pratiquer l'exégèse coranique. Ses cours ne
manquent pas d’attirer de très nombreux disciples.
Sa Riḥla s’intitule : Tartīb al-riḥla li-l-tarġib fī-l-milla (La mise en ordre du voyage pour réveiller le désir dans
la religion).25
p. 17-18 et 65-70.
« Ibn al-‘Arabī en Orient
En Égypte
Le jeune homme et le cheikh26 descendirent à Alexandrie, puis continuèrent leur chemin au Caire. Ils ne
(p. 18) s’arrêtèrent pas longtemps dans ce beau port qui fourmillait d’exportateurs et d’importateurs, car ils
avaient dans leur esprit une autre intention bien précise ! Le destin leur réserva un autre rendez-vous ; ils y
séjourneront plus longtemps, et peut-être l’un des deux y restera pour toujours.
Leur arrivée au Caire était vers la fin de rabī‘ le second de l’an 48527, mais les conditions qui prévalaient en
Égypte à cette époque ont changé le regard du jeune homme sur la ville, qui se tourna vers une autre
direction.
Le pouvoir à ce moment-là était entre les mains d’Al-Mustanṣir abī Tamīm Ma‘ad. La propagande fatimide
touchait à son comble. Les oulémas étaient complètement indolents et les lettrés ne levaient aucunement la
voix. Ibn Al-‘Arabī nous raconte à ce propos : « nous y trouvâmes un groupe d’oulémas et parmi eux des
muḥaddiṯ28, des savants et des mutakallimūn29 dont la nonchalance s’était emparée d’eux. Ils [le groupe
d’oulémas] étaient tellement engourdis et délaissés par les gens qu’on n’indiquait à quiconque où ils se
trouvaient. Ils ne se prononçaient pas sur la science et ne s’attribuaient aucune connaissance dans aucun
art. La littérature s’était appauvrie... »
Ses cheikhs
Malgré le marasme scientifique en Égypte décrit par Ibn al-‘Arabi, il y avait des oulémas chez lesquels Abū
Bakr puisa son savoir. À leur tête, était le juge Abū al-Ḥasan al-Ḫula‘ī, le transmetteur (musnad) de l’Égypte
et le cheikh suprême du chaféisme de son temps. Il s’était retiré dans le petit cimetière de Qarāfa près du
sanctuaire de l’imam Al-Šāfiʿī. Ibn al-‘Arabi a dit à son propos : « le cheikh qui vit retiré, a des récits
sublimes, et a beaucoup d’avantages… »
Il [Abū Bakr b. al-‘Arabī] a assisté à quelques cours du cheikh Abī al-Ḥasan b. abī Dāwūd al-Fārisī (p. 19) à
Fusṭāṭ. Il a écouté Abī al-Ḥasan b. Mušarraf, Mahdī al-Warrāq, Abī ʿAbd Allāh al-ʿUṯmānī, Al-Salāmī, Al-
‘Abdarī, et Muḥammad b. Qāsim al-Kātib. Il a appris d’eux des questions sur les sciences du kalām. Il
s’exerça en dialectique, débattit avec les Chiites et les fatalistes. Il dit dans la description de ces
communautés (Ṭawā’if) que c’est : « …une foule gagnée par la mauvaise croyance, qui se développe sans
sevrage avec le lait de l’entêtement, et que le désespoir s’en est saisit – ce à quoi on peut ajouter la
corruption… ».
Il a fréquenté les cours des récitateurs et fut émerveillé par leurs lectures.
(p. 65) À Alexandrie
Ibn Al-‘Arabi entra à Alexandrie au début de l’an 49230 et descendit chez son maître spirituel (ustāḏ) Abī
Bakr al-Ṭurṭūšī dont l’itinéraire avait pris fin dans cette ville frontière devenue une seconde patrie pour lui et
où il obtint une place de choix. Cet homme avait ravivé la doctrine sunnite dans ce pays et avait combattu
les hérésies et l’égarement. Il était franc dans la justice et n’avait peur en Dieu d’encourir les reproches de
désapprobation. Ibn al-‘Arabī n’était pas nouveau dans cette ville, il y était passé huit ans auparavant. Il avait
connu son maître spirituel (ustāḏ) à Jérusalem et avait passé auprès de lui plus de trois ans, s’abreuvant de
sa science abondante. Al-Ṭurṭūšī traitait le jeune Ibn al-‘Arabī non seulement comme un disciple, mais aussi
comme un ami. Il lui enseignait et le consultait, se faisait assister et lui venait en aide. Ainsi, les liens
d’affection se consolidèrent entre eux. Ils ont vécu en amis proches pendant plus de six ans, Ibn al-‘Arabī fut
grandement influencé par son maître spirituel Al-Ṭurṭūšī dans son comportement et dans tous les autres
domaines.
(p. 66) « …C’est au cours de mon voyage retour que j’ai rencontré l’ascète de ce temps-là, exempt de haine,
possédant de solides sciences toutes difficiles et implicites. Lors de ma seconde visite à la ville frontière
d’Alexandrie, j’ai séjourné avec lui [Al-Ṭurṭūšī], conversant sur les finalités des questions et examinant tout
ce qui se racontait ici et là… »
Ibn al-‘Arabī parle beaucoup son maître spirituel Al-Ṭurṭūšī, il ne le mentionne que couplé de vénération et
de respect, et le décrit en lui attribuant science et vertu, continence et application en ce qui le concerne.
Il ne fait aucun doute qu’Ibn al-‘Arabī a été en contact avec d’autres maîtres spirituels dont il a bénéficié et
qui ont bénéficié de lui.
Deux évènements :
Il arriva à Ibn al-‘Arabī d’être choqué, durant son séjour à Alexandrie, par deux évènements graves qui l’ont
marqué.
1) La conquête de Jérusalem par les croisés et les massacres atroces qu’ils ont commis dans les contrées
saintes, les martyres de nombre de ses cheikhs et ses connaissances, dont son maître spirituel Al-Ḥāfiẓ
Makkī b. ‘Abd al-Salām al-Rumaylī.
Comme il est dit, l’histoire se répète avec son lot de bien et de mal. Ainsi le monde fut secoué par ce
tragique événement. Les regards se tournèrent vers Bagdad où les foules se rassemblèrent autour du palais
(p. 67) des califes, les recrues vinrent de toutes directions et recoins, les prédicateurs discoururent, les
poètes déplorèrent la tragédie des musulmans en Palestine et à Jérusalem. Mais le calife de Bagdad, qui
était devenu comme une marionnette entre les mains des princes seldjoukides, n’a pas levé le petit doigt.
Quelle ironie du destin que celui d’un calife, dont les foules viennent jusqu’à son domaine depuis les confins
de l’occident pour demander aide et secours, et qui se trouve incapable de repousser le mal loin de lui et
d’éloigner les intrus de ses lieux… !
En fait, ce sont les Seldjoukides et les princes des communautés (ṭawā’if) d’Andalousie qui ont ouvert la
porte du mal à l’Islam en orient et en occident. Ils ont effacé la crainte des musulmans des coeurs de leurs
ennemis en raison de leur appétit pour leurs intérêts personnels et leurs querelles jusqu’à s’entretuer pour le
siège du pouvoir. Que les traîtres sont nombreux en tout temps et en tout lieu !
Mais l’Histoire n’oubliera pas leur traîtrise et perfidie, elle les évoquera avec diffamation et honte à jamais.
Elle se souviendra avec fierté et orgueil de tous les fidèles héros, tels que Ṣalāḥ al-dīn al-Ayyūbī et Yūsuf
b. Tāšafīn qui donnèrent aux Croisés une dure leçon qui restera un symbole de l’héroïsme islamique
pendant des générations… !
Nous attendons des descendants d’Ibn Tāšafīn et Ṣalāḥ al-dīn qu’ils vengent leur honneur et qu’ils réveillent
le démon de la guerre une deuxième fois contre les agresseurs et usurpateurs. Ce qui n’est pas difficile au
vu de l’ardeur des fidèles !
2) Le second événement [qui marqua Abū Bakr est] la mort de son père, compagnon de voyage, confident
en terre étrangère et bras droit lors des moments sombres : « …Il était avec moi un [homme] sévère dont je
ne craignais pas le bâton, un cheval dont je n’attendais pas l’effondrement, un père dans l’ordre et un frère
dans la compagnie. Il se faisait assister et prêtait assistance. Il abreuvait de conseils avec l’eau [d’une
source] intarissable… ». Sa mort eut lieu au mois de muḥarram de l’an 49331. Il semblerait qu’avec la mort
de ce père, cette lueur d’espoir qu’il convoitait se soit éteinte car ils [Abū Bakr et son père] travaillaient côte
à côte pour la réaliser et l’atteindre. Ainsi en est-il : le navire qui le conduisait s’écrasa, son pilote se noya
dans les profondeurs !
(p. 68) Peut-être est-ce cela qui fit vivre Ibn al-‘Arabī à l’écart de la vie des gens et un certain temps auprès
des adorateurs et des ascètes dans les maḥris-s32 et les ribāṭ-s33.
Un voile dense couvre le séjour d’Ibn al-‘Arabī à Alexandrie, les sources en gardent la bouche close. Les
informations que nous conservons sont minces, elles présentent à peine les aspects de cette période vécue
par Ibn al-‘Arabī dans cette ville frontière paisible.
Tout ce que nous savons est, premièrement, qu’il a vécu à la ville frontière d’Alexandrie un certain temps
comme il le précise en voulant se mêler aux gens dans leur vie de labeur, en s’habituant à la dureté et à la
rugosité de la vie, à la patience sur les épreuves, et en se consacrant au culte et à la pureté de l'âme :
« …Nous séjournions au à la ville frontière d’Alexandrie durant des jours et nous avions parmi nos amis un
forgeron qui faisait sa prière du matin avec nous et louait Dieu jusqu’au lever du soleil. Ensuite, celui-ci se
rendait à son travail et dès qu’il entendait l’appel à la prière du midi, il laissait son enclume, allait faire ses
ablutions et venait à la mosquée pour prier. Puis il continuait ses prières et ses louanges jusqu’à la prière de
l’après-midi. Après quoi, il rentrait chez lui pour ses besoins quotidiens… »
[Tout ce que nous savons est,] deuxièmement, qu’il [Abū Bakr] était chargé de l’enseignement dans le
maḥris d’Ibn al-Šawāa’ où il a probablement logé. Ce maḥris donnait sur la mer, et les cinq prières y avaient
lieu. Les maḥris-s et les mosquées étaient nombreux à la ville frontière d’Alexandrie ! « …Il – en parlant du
cheikh Al-Ṭurṭūšī – était venu chez moi au maḥris d’Ibn al-Šawāa’ à la ville frontière, lieu de mon
enseignement, à l’heure de la prière du midi. Il entra dans la mosquée du maḥris susmentionné, et avança
jusqu’au premier rang – moi j’étais assis à l’arrière, du côté des fenêtres donnant sur la mer pour respirer
l’air frais tellement il faisait chaud. Au même rang, il y avait Abū Ṯamna, chef et caïd de la mer, et
quelques-uns de ses amis attendant la prière, et observant les bateaux en bas du port… ».
Troisièmement, [nous savons que] il se rendait, probablement, de temps à autre, dans les bibliothèques
d’Alexandrie afin d’y trouver (p. 69) d’anciennes oeuvres originales qui pourraient ne pas se trouver ailleurs.
Quatrièmement, parmi ses observations dans cette ville frontière d’Alexandrie, [nous savons que] si les gens
perdent un des leurs, ils lui font une statue en bois et la place dans leur maison. Ils la couvrent de ses bijoux
si c’était une femme et ils ferment la porte sur elle. S’il arrive un malheur à quelqu’un de la famille, on ouvre
la porte de la pièce où est la statue, on s’assied à côté d’elle en pleurant et en l’invoquant. Au fur et à
mesure, les gens les ont adoré en complément des idoles en métal et en pierre.
Cinquièmement, parmi leurs habitudes, ils [les Alexandrins] n’ont personne dans ce pays qui porte les
cercueils, mais ils font paraître le mort sur la route et disent : « Portez [et vous serez] portés ». Alors les
gens se dirigent vers lui [le défunt] jusqu’à se resserrer autour. Mais si les oulémas meurent, ils ne sont
portés que par leurs amis : « …Un de nos amis de la ville frontière d’Alexandrie est mort – peut-être faisait-il
allusion à son père – je l’ai porté moi-même avec Al-Ṭurṭūšī – que Dieu accueille son âme… ».
Sixièmement, il [Abū Bakr] nous parle des prises de position de son cheikh l’imam Al-Ṭurṭūšī pour raviver la
sunna et exterminer les hérésies jusqu’au point de s’exposer à la mort en défiant les tyrans et les despotes –
il est connu ainsi. Combien de fois a-t-il souffert des tribulations et des horreurs en suivant cette voie,
néanmoins il patienta et s’en remit à Dieu ! : « …Il entra dans la mosquée et se mit à prier, il leva ses mains
en se prosternant, et en relevant sa tête. Alors Abū Ṯamna, le chef de la mer, dit à ses amis : “Ne
voyez-vous pas comment ce levantin est entré dans notre mosquée ? Levez-vous et allez le tuer, jetez-le à
la mer, personne ne vous verra.” Mon coeur sortit de mes côtes et je dis : “Gloire à Dieu, il s’agit d’Al-Ṭurṭūšī,
faqīh de notre temps !” Ils me répondirent : “Pourquoi lève-t-il ses mains ?” Je dis : “Ainsi faisait le Prophète,
que la paix soit sur lui.” Puis je continuai à les faire taire et à les calmer jusqu’à ce qu’il [Al-Ṭurṭūšī] eut fini sa
prière, je partis avec lui jusqu’à son logement dans le maḥris. Il [Al-Ṭurṭūšī] vit le changement sur mon
visage qui lui déplut. Il me demanda [la raison] et je l’informai. Il se mit à rire (p. 70) et dit : “Que ne ferai-je
pour être tué pour Sa sunna.”34
- 24 - 27 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
12e siècle |
ABŪ ḤĀMID AL-ĠARNĀṬĪ (1117 et 1121)
MUḤAMMAD B. `ABD AL-RAḤMĀN B. SULAYMĀN AL-MĀZĪNĪ AL-QAYSĪ
Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī, De Grenade à Bagdad. La relation de voyage d'Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī (1080-1168) ou
Al-Mu‘rib ʿan baʿḍ ʿajāʼib al-Maġrib, par J.-Ch. Ducène, Paris, 2006.
Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī naît à Grenade en 1080. Nous savons qu’il se trouve à deux reprises à Alexandrie,
une en 1117 et la seconde en 1121. Voyageur infatigable, on le retrouve, pour commencer, à Damas et à
Bagdad où il suit des cours et donne des leçons de hadith. Par la suite, il voyage en Perse, dans la région
de la Volga, de Bactres, et en Hongrie. Puis en 1160, il revient à Bagdad où il est accueilli par le vizir Yaḥyā
b. Hubayra pour lequel il compose l’ouvrage Al-Mu‘rib ʿan baʿḍ ʿajāʼib al-Maġrib (Exposition claire de
quelques merveilles de l’Occident). Deux ans plus tard, en 1162, étant à Mossoul, il rédige le Tuḥfat al-Albād
sur les instances du pieux et savant cheikh Mu’in al-Ḥaḍir al-Ardabilī. Il meurt à Damas en 1169-1170.35
p. 56-58 :
« Alexandrie et ses merveilles
C’est une ville immense avec beaucoup de bâtiments tant en surface que sous sol. J’y découvris d’ailleurs
des lieux voûtés souterrains. Leur hauteur était de vingt coudées pour une largeur de huit. Ils avaient été
édifiés dans une pierre taillée qui n’avait pas de pareille en matière en matière de construction. Cette voûte
allait du début de la ville jusqu’à son extrémité. Sous terre, il y en a beaucoup d’autres semblables en
largeur et en longueur qui communiquent entre elles.
À l’extérieur de la ville, se trouve le Phare d’Alexandrie, qui est l’une des merveilles du monde. Sa base est
carrée et construite de pierres équarries ; au-dessus se trouve une tour octogonale, elle-même surmontée
d’une fine tour circulaire. Le premier élément a une longueur de quatre-vingt-dix coudées, la partie
octogonale également et (p. 57) le petit en fait trente, comme sur l’image. À l’intérieur, il y a plus de mille
pièces, grandes et petites. Les grandes sont dans les angles et les petites entre eux. Le vent d’est pénètre
dans toutes les parties. On prétend qu’au faîte se trouvait un miroir où l’on voyait ce qui venait de la
Méditerranée sur une distance de plusieurs jours et plusieurs nuits, à ce que l’on dit.
En dehors d’Alexandrie, il y a une colline construite de pierres taillées, qui supporte une salle d’audience
édifiée par les djinns pour Salomon et reposant sur d’incomparables colonnes de marbre. Chaque colonne a
un socle de marbre et est surmontée d’un chapiteau de la même pierre. Ils sont de griotte rouge piqueté de
blanc et de noir, comme du jaspe yéménite mais plus beau. La hauteur de chaque colonne est de quatrevingts
coudées pour une circonférence de huit. La salle possède une porte de marbre alors que la marche,
le seuil et les deux montants sont également de ce marbre rouge, qui a la beauté du jaspe de première
qualité. Il est lisse comme un miroir : quand on y regarde, on voit ce qui vient à pied, derrière soi, depuis
Alexandrie. Cette salle est entourée de plus de trois cents colonnes monolithiques d’un même type. Les
angles sont formés de [blocs] de marbre quadrangulaires. Chaque angle est délimité à l’extérieur, et à
l’intérieur il possède deux pilastres taillés dans ce même marbre, selon cette image36. Au centre de la salle, il
y a un pilier de marbre sur un socle de la même pierre, il a une (p. 58) hauteur de cent vingt coudées –
estimé par l’ombre – pour une circonférence de quarante-cinq empans, selon ma main. Je le mesurai en
effet à la main lorsque j’arrivai à Alexandrie en 515/1121.
Parmi toutes les colonnes orientales de ce bâtiment, il y en a une qui, selon les gens, bouge avec le
mouvement du soleil. Quand il est à l’orient, elle penche à l’orient, quand il est à l’occident, elle incline vers
l’occident, et quand il est immobile, elle l’est aussi. Cela est évident à sa base : lorsqu’elle penche vers l’est,
sa partie inférieure monte vers l’ouest et s’éloigne de son assise au point qu’un homme (insān) peut mettre
la main dessous et y introduire une pierre. Quand la colonne s’abaisse dessus, elle l’écrase, la réduisant en
poussière. Elle s’élève vers l’est de la même manière. Les hommes y viennent assidûment. Elle fait partie
des merveilles du monde.
À Alexandrie, il y a [aussi] une source pauvre en eau. Elle possède une sorte de coquillage. On le prend, on
le cuit, on [le] mange et on boit son bouillon pour se prémunir de l’éléphantiasis. On emporte continuellement
ces coquillages mais la source n’en tarit jamais.
Un canal [provenant] du Nil arrive à Alexandrie. Les habitants boivent de son eau et en remplissent des
citernes dans leurs demeures. [D’ailleurs], l’eau de pluie et celle de la source se réunissent dans ces
citernes. Dans cette ville, il n’y a que l’eau du Nil ou celle de la pluie ou encore celle de la source aux
coquillages. L’eau n’y est pas en grande quantité et elle n’est pas bonne. »
35 Ferrand, G., « Toḥfat al-Albād de Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Ġarnāṭī », JournAs CCVII, 1925, p. 14-22.
Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī, De Grenade à Bagdad. La relation de voyage d'Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī (1080-1168) ou
Al-Mu‘rib ʿan baʿḍ ʿajāʼib al-Maġrib, par J.-Ch. Ducène, Paris, 2006, p. 18-22.
36 Cette image est manquante dans tous les manuscrits conservés. Note de J.-Ch. Ducêne.
- 28 - 29 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-IDRĪSĪ (avant 1166)
ABŪ `ABD ALLĀH MUḤAMMAD B. MUḤAMMED B. `ABD ALLĀH B. IDRĪSĪ AL-`ALĪ BI-AMR ALLĀH
Al-Idrīsī, Edrisi. Description de l’Afrique et de l’Espagne, par R. Dozy et M. J. de Goeje, Leyde, 1968.
On a longtemps fait naître Al-Idrīsī à Ceuta (Maroc), mais d’après les recherches d’Henri Bresc et Annliese
Nef, celui-ci aurait probablement vu le jour en Sicile. Il en est de même pour la date retenue de 1154 qui
serait celle de l’achèvement de son ouvrage commandé par le roi de Sicile Roger II. En fait, cette oeuvre
intitulée Kitāb Nuzhat al-muštāq fī ḫtirāq al-āfāq (Livre de divertissement pour celui qui désire parcourir le
monde) n’aurait été terminée que sous ler règne de Guillaume 1er (1154-1166). Elle était accompagnée d’un
grand planisphère en argent construit par l’auteur pour illustrer ses propos géographiques. Quant à la date
de décès de l’auteur, Annliese Nef retient 1175-1176 plutôt que 1165 comme il est communément écrit pour
des raisons obscures.37
p. 165-169 :
« Quant à Alexandrie, c'est une ville bâtie par Alexandre qui lui (p. 166) donna son nom. Elle est située sur
les bords de la Méditerranée, et l’on y remarque d’étonnants vestiges et des monuments encore subsistants,
qui attestent l’autorité et la puissance de celui qui les éleva, autant que sa prévoyance et son savoir. Cette
ville est entourée de fortes murailles et de beaux vergers. Elle est vaste, très peuplée, commerçante et
couverte de hauts et nombreux édifices. Ses rues sont larges et ses constructions solides ; les maisons y
sont carrelées en marbre, et les voûtes inférieures des édifices [sont] soutenues par de fortes colonnes. Ses
marchés sont vastes et ses campagnes productives.
Les eaux de la branche occidentale du Nil, qui coule vers cette ville, passent sous les voûtes des maisons,
et ces voûtes sont contiguës les unes aux autres ; quant à la ville, elle est bien éclairée et parfaitement
construite. On y remarque le phare fameux qui n'a pas son pareil au monde sous le rapport de la structure et
sous celui de la solidité ; car, indépendamment de ce qu'il est fait en excellentes pierres de l'espèce dite
caddzân, les assises de ces pierres sont scellées les unes contre les autres avec du plomb fondu, et les
jointures sont tellement adhérentes que le tout est indissoluble, bien que les flots de la mer, du côté du
nord, frappent continuellement cet édifice. La distance qui sépare le phare de la ville est, par mer, d'un mille,
et par terre, de trois milles. Sa hauteur est de 300 coudées de la mesure dite rachâchi38, laquelle équivaut à
trois empans, ce qui fait donc 100 brasses de haut, dont 96 jusqu'à la coupole, et 4 pour hauteur de la
coupole. Du sol à la galerie du milieu, on compte exactement 70 brasses ; et de cette galerie au sommet du
phare, 26. On y monte par un escalier large, construit dans l'intérieur, comme le sont ordinairement ceux
qu'on pratique dans les tours des mosquées. Le premier escalier se termine vers le milieu du phare, et là
l'édifice devient, par ses quatre côtés, plus étroit. Dans l'intérieur et sous l'escalier, on a construit des
chambres. À partir de la galerie du milieu, le phare s'élève (p. 167) jusqu'à son sommet, en se rétrécissant
de plus en plus, pas au-delà cependant qu'un homme n'en puisse toujours faire le tour en montant.
De cette même galerie on monte de nouveau, pour atteindre le sommet, par un escalier de dimensions plus
étroites que celles de l'escalier inférieur. Le phare est percé, dans toutes ses parties, de fenêtres destinées à
procurer du jour aux personnes qui montent, et afin qu'elles puissent placer convenablement leurs pieds en
montant.
Cet édifice est singulièrement remarquable, tant à cause de sa hauteur qu'à cause de sa solidité ; il est très
utile en ce qu'on y allume nuit et jour du feu pour servir de signal aux navigateurs durant la saison entière
des villages ; les gens des navires reconnaissent ce feu et se dirigent en conséquence, car il est visible
d'une journée maritime (100 milles) de distance. Durant la nuit, il apparaît comme une étoile brillante ; durant
le jour on en distingue la fumée.
Alexandrie est située à l'extrémité d'un golfe et est entourée de plaines et de vastes déserts où il n'existe ni
montagne, ni aucun objet propre à servir de point de reconnaissance. Si ce n'était le feu dont il vient d'être
parlé, la majeure partie des vaisseaux qui se dirigent vers ce point s'égareraient dans leur route. On appelle
ce feu fanousa39.
Auprès de cette ville, on voit encore les deux obélisques. Ce sont deux pierres de forme quadrangulaire, et
plus minces à leur sommet qu'à leur base. La hauteur de l'un de ces obélisques est de 5 brasses ; et la
largeur de chacune des faces de la base, de 10 empans, ce qui donne un total de 40 empans de
circonférence. On y voit des inscriptions en caractères syriens. L'auteur du Livre des (p. 168) Merveilles
rapporte que ces obélisques ont été taillés dans la montagne de Badim, à l'ouest du pays d'Égypte. On lit sur
l'un d'eux ce qui suit : "Moi, Ya'mor ibn Chaddâd, j'ai bâti cette ville au temps où la décrépitude ne s'était pas
encore répandue, où la mort subite n'était pas connue, où des cheveux blancs ne s'étaient pas montrés ; à
une époque où les pierres étaient comme de l'argile, où les hommes ne savaient pas ce que c'est qu'un
maître. J'ai élevé les colonnes de la ville ; j'ai fait couler ses canaux ; j'ai planté ses arbres ; j'ai voulu
surpasser les rois qui y avaient résidé [avant moi] en y faisant construire des monuments admirables. J'ai
donc envoyé Tsabout ibn Morra, l'Adite et Micdâm ibn o'l-Camar ibn abi Righâl, le Tsamoudite, à la
montagne rouge de Bâdim. Ils en ont extrait deux pierres qu'ils ont apportées ici sur leur dos. Thabout (sic)
eut une côte brisée, et je prononçais le voeu que je rachèterai sa vie même au prix de celle de tous les
hommes de mon empire. Fatan ibn Djaroud, le Montacafite, m'érigea ces pierres pendant un jour de
bonheur." Cet obélisque se voit près d'un angle de la ville, du côté de l'Orient ; l'autre est dans l'intérieur de
la ville.
On dit que la salle d'audience de Salomon, fils de David qu'on voit au midi d'Alexandrie, fut construite par le
même Ya'mor ibn Chaddâd. D'autres en attribuent la construction à Salomon. Les colonnes et les arcades
de cet édifice subsistent encore de nos jours. Il forme un carré long ; à chaque extrémité sont seize
colonnes, et sur les deux (p. 169) côtés longitudinaux, soixante-sept ; près de l'angle septentrional est une
colonne, de très grandes dimensions portant un chapiteau et assise sur un entablement en marbre de forme
carrée, dont la circonférence est de 80 empans, chaque côté ayant 20 empans de largeur sur 80 de hauteur.
La circonférence de cette colonne est de 40 empans, et sa hauteur, depuis sa base jusqu'à son chapiteau,
est de 9 brasses. Ce chapiteau est sculpté, ciselé avec beaucoup d'art, et fixé d'une manière très solide. Du
reste, cette colonne est isolée, et il n'est personne, soit d'Alexandrie, soit à Miçr, qui sache pourquoi elle fut
mise en sa place isolément. Elle est de nos jours, très inclinée ; mais, d'après la solidité de sa construction
elle paraît à l'abri du danger de tomber.
Alexandrie fait partie de l’Égypte et c’est l’une des villes capitales de ce pays. »
p. 193 :
« On pêche à Alexandrie une espèce de poisson rayé dont le goût est agréable, et qui s'appelle al-Arous.
Celui qui mange de ce poisson cuit ou rôti, sans prendre en même temps du vin ou beaucoup de miel, est
tourmenté par des rêves impurs. »
37 Al-Idrīsī, La Première géographie de l’Occident, par H. Bresc, A. Nef, Paris, 1999.
Nef, A., « Al-Idrīsī : un complément d’enquête biographique », dans H. Bresc, E. Tixier du Mesnil (dir.),
Géographes et voyageurs au Moyen Âge, Nanterre, 2010, p. 53-66.
38 La suite de la phrase nous indique la valeur de cette mesure de longueur. L’empan étant égal à 22 ou
24 cm (l’espace qui se trouve entre les extrémités du pouce et du petit doigt écartés) et le rašāšī va de 66 à
72 cm. Note de O. V. Volkoff.
39 De l’arabe fanous, lanterne. Note de O. V. Volkoff.
- 30 - 31 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
YŪSUF B. AL-ŠAYḪ (1165/1166)
AL-ḤAǦǦĀǦ YŪSUF MUḤAMMAD AL-BALAWĪ
Yūsuf b. al-Šayḫ, Al-Ḥaǧǧāǧ Yūsuf Muḥammad al-Balawī, Kitāb alif bā’, Beyrouth, 1985.
Né à Malaga en 1132, Yūsuf b. al-Šayḫ reçoit une éducation très studieuse qu’il acquiert auprès de maîtres
mentionnés par son biographe Ibn al-‘Abbār40. Au cours de son passage à Alexandrie, il suit l’enseignement
d’Al-Silafī41, théologien le plus célèbre de son temps dans tout l’Islam. Il a des occupations très variées. Il
étudie par goût et enseigne seulement pour son entourage. Auteur de plusieurs livres, il compose surtout
des poésies. L’étude, l’enseignement et la rédaction de ses oeuvres ne l’empêchent pas de voyager. En
1164/1165, il entreprend un pèlerinage à La Mecque et, en 1195, il participe à des incursions du sultan
Al-Manṣūr, au Maroc. Son biographe nous informe également qu’il finance et construit de ses mains
25 mosquées, ainsi que plus de 50 puits.
Yūsuf b. al-Šayḫ rédige Kitāb alif bā’ au cours des trois dernières années de sa vie (m. en 1207). Craignant
que la mort ne l’empêche d’assurer l’éducation de son jeune fils né en 1195, il décide d’écrire un répertoire
encyclopédique de culture générale dans lequel il aborde l’arithmétique, la physique, la botanique, la
zoologie, l’astrologie, les religions, l’onomastique, la philologie.42
p 536-541 (tome II) :
« Je vais donc évoquer ce que je vis à Alexandrie à propos des merveilles. À partir de ces nouvelles, j’ai
établi ce tome pour distraire les esprits de la misère et divertir les âmes de la morosité. Chacun dépense
selon ce que lui donne le Seigneur. Je commencerai par ce qui fut cité par l’auteur du Livre des Conquêtes.
Il écrivit que lorsque ‘Amr b. al-‘Aṣ conquit Alexandrie, (ce dernier) écrivit à ‘Umar b. al-Ḫaṭāb – que Dieu soit
satisfait de lui ! – en ces termes : « j’ai pris une ville dont je ne décrirai que ce que j’ai acquis : 4000
constructions avec 4000 bains. » Il ajouta qu’il avait compté 12 000 épiceries qui vendent des légumes et
qu’il y a 40 000 Juifs qui paient la capitation. Il y a 400 000 lieux de distractions pour les rois. Tous les
Conseils contiennent des assemblées. On dit qu’il y avait à Alexandrie, parmi les bains comptés, 12 000
bains souterrains dont le plus petit se compose de 7000 pièces et chaque pièce est assez large pour une
assemblée. Tel est le paragraphe.
Quand à moi, à mon arrivée à Alexandrie en 561 [1165], un informateur me rapporta qu’il y avait 4000
mosquées intra-muros, mais d’après un autre il y en aurait 6000, et qu’à l’extérieur, il y avait 1000
mosquées. Alexandrie est maintenant plusieurs fois plus petite que ce qu’elle était au début quand elle fut
bâtie par Alexandre. De l’extérieur, à une distance d’environ un mille, j’observai à sa qibla une porte
immense au-dessus d’une construction de porte entourée de ruines qui envahissaient la chaussée. On dit
que ce lieu faisait partie autrefois de la ville.
(p. 537) En ce qui concerne son Phare, celui-ci est à une distance d’un mille ou plus de la ville, du côté sud.
Il s’élève sur une petite île dans l’eau. Une jetée fut construite sur l’eau pour relier cette île à la terre ferme,
longue de 600 coudées, voire plus, et large de 20 coudées. Sa hauteur est de 3 coudées au-dessus du
niveau de la mer. Quand la mer s’agite, l’eau recouvre ce passage, mais la mer est calme grâce à l’île et aux
pierres qui sont autour de ce lieu. Ainsi en y marchant, l’eau arrive jusqu’aux chevilles ou presque. Quand
l’eau se retire, on y marche à sec.
Le Phare s’élève à l’extrémité de l’île. L’édifice est un carré de 45 pas de côté. La mer couvre la plateforme
autour de cet édifice des côtés est et sud. Entre cette plateforme et le mur, il y a 12 coudées et sa hauteur à
partir de l’eau jusqu’à l’air en a autant. Néanmoins, [la plateforme] est plus large du côté de la mer, en ce
sens que la base de l’édifice, posée sur des pierres immergées, s’élève de la surface de la terre comme une
montagne en se rétrécissant. Il reste entre [la plateforme] et le mur du Phare la mesure susmentionnée.
Sa jointure et sa construction sont solides. On a coulé du plomb dans les scellés en fer pour retenir les
pierres ponces taillées qui sont plus longues et plus épaisses que le reste du Phare. Cette construction que
je viens de décrire est récente ; ce côté a été sapé puis a été reconstruit.
Sur le mur donnant sur la mer, du côté sud, il apparaît une écriture d’un tracé ancien. Je ne sais ce qu’elle
est, ce n’est pas écrit au calame, ce ne sont que des images et des formes en pierres dures et noires de
taille haute, qui ont été incrustées dans la pierre ponce que la mer et son air ont rongé. Les lettres sont
ressorties à cause de leur dureté. La hauteur du « alif » est plus grande qu’une coudée. La tête du « mim »
ressort de l’édifice comme l’orifice d’une grande marmite. La plupart de ces lettres sont ainsi semblables.
La porte du Phare est élevée du sol, une rampe d’une longueur d’environ 100 pas a été construite. Sous la
rampe se trouve une voûte d’arcs qui ressemble à un pont. Le cavalier pénètre sous ces arcs et en élevant
la main, il n’atteint pas leurs sommets. Ces arcs sont au nombre de 16, les premiers sont petits, puis tout en
avançant, ils s’élèvent jusqu’à toucher la porte, là où l’arc est le plus élevé.
Nous entrâmes par la porte et nous marchâmes environ 40 pas. Nous trouvâmes à notre gauche une porte
fermée, sans savoir ce qu’il y avait à l’intérieur. Nous marchâmes environ 60 pas et nous trouvâmes une
porte ouverte. Alors, nous passâmes d’une chambre à une autre jusqu’à la dix-huitième, sans compter le
couloir où nous marchions. Ces chambres communiquent les unes avec les autres. À ce moment-là, nous
nous aperçûmes que l’intérieur était inoccupé. Nous marchâmes 60 pas et nous comptâmes à gauche et à
droite du couloir 14 chambres. Nous marchâmes 24 pas et nous trouvâmes 17 chambres. Nous marchâmes
55 pas et nous terminâmes [la visite du] premier niveau. Là, il n’y a pas de marches mais un sol montant
légèrement qui tourne autour d’une roue (p. 538) immense. Vous trouvez à votre droite l’épaisseur d’un mur
dont je ne connais pas la mesure et à votre gauche la roue dans laquelle se trouvent les chambres
susmentionnées. Vous marchez comme dans un couloir, grand de 7 empans, surmonté d’un plafond de
plaques de pierres. Nous vîmes, quand nous montâmes, un cavalier qui descendait et un autre qui montait
jusqu’à ce qu’ils se rencontrassent sur le chemin sans qu’aucun des deux ne fût à l’étroit.
Après avoir fini (la visite du) premier niveau, nous prîmes sa mesure jusqu’au sol, à l’aide du cordeau ayant
au bout une pierre, et nous trouvâmes 31 brasses. Le parapet du mur mesurait à peu près 1 brasse.
Au milieu, s’érigeait un faḥl43 octogonal dont chaque côté a 10 pas. Entre celui-ci et le parapet, il y a 15
empans. L’épaisseur du parapet est de 7 empans ou 9. Je doute sur ce chiffre [qui figure dans] l’original au
moment où j’avais pris des notes là-bas. J’étais allé avec de l’encre, du papier et un cordeau pour ne rien
oublier. Comme c’est étrange ! Dieu vous crée et crée ce que vous faites. Je penche plutôt pour un 9.
Le sommet de ce niveau est plus étroit que sa base. Nous entrâmes à l’intérieur, nous marchâmes 15 pas et
nous trouvâmes 18 marches que nous montâmes. Puis nous arrivâmes au niveau médian, nous le
mesurâmes avec le cordeau et nous trouvâmes à partir de lui jusqu’au premier niveau 15 brasses.
Au milieu de cet espace, se tenait le dernier faḥl circulaire dont l’épaisseur est de 40 pas. Entre celui-ci et le
parapet, il y a 9,5 empans. Nous y entrâmes, nous montâmes 31 marches et nous arrivâmes au troisième
niveau. Nous mesurâmes à partir de lui jusqu’au niveau médian et (nous trouvâmes) 4 brasses. Au milieu, il
y avait une mosquée qui s’ouvrait sur quatre portes, en coupole. Elle s’élevait en plein air et (mesurait)
environ 3 brasses et son épaisseur était de 20 pas. Devant elle, il y avait un parapet dont l’épaisseur était de
2 empans. De ce parapet jusqu’à la mosquée, il y avait 5 empans.
Toutes les chambres dans lesquelles nous pénétrâmes, sauf dans la première qui est fermée et dans
laquelle on dit qu’il y a des lieux d’aération qui finissent dans la mer, sont au nombre de 67. La hauteur du
Phare à partir de ce calcul est de 53 brasses, du sol jusqu’à l’eau de la mer 5 brasses, et sous l’eau, ce qui
en est visible, il y a environ 1 brasse ou plus. Une pierre lancée du haut de l’édifice ne tombe pas sur le sol
avant d’avoir touché le mur en raison de sa base spacieuse et de son sommet étroit.
Il fut bâti là pour permettre aux voyageurs qui arrivent par mer de repérer la ville grâce à lui. Au sommet du
Phare, un feu est allumé pour que les marins ne s’égarent pas. Nous manquâmes de le voir, ainsi nous ne
pûmes entrer dans la rade de la ville. Notre pilote n’y était jamais entré auparavant. Nous laissâmes (le
Phare) derrière nous, puis le vent nous fit entrer dans un lieu qui n’avait pas de rade. Ensuite, après avoir
été au bord du péril, Dieu nous sauva et la terre de la ville nous apparut. Nous entrâmes dans la ville le
lendemain, nous fûmes en bonne santé. Que Dieu soit loué ! J’en ai fini avec la relation du Phare. Plus
étrange est celle de la colonne44 qui est en dehors de la ville en direction de la qibla à environ un mille, sur
un lieu élevé qui ressemble à une colline.
(p. 539) On dit que sur cette colline se trouve la mosquée de Sulaymān b. Dāwūd, que la paix soit sur eux.
Sa hauteur est de 223 pas et sa largeur est de 100 pas. Elle est entourée de 100 colonnes. Vers la qibla, il y
a 15 colonnes, et autant du côté sud. À l’est, il y en a 35 et autant du côté ouest. L’épaisseur de chaque
colonne est de 17 empans et sa hauteur est d’environ 50 empans. Entre 2 colonnes, il y a 18 empans.
L’épaisseur de la colonne fut mesurée avec le cordeau. Ensuite nous étendîmes le cordeau entre la colonne
et la suivante et nous trouvâmes à peu près la même chose, moins 1 empan environ. Les quatre colonnes
des angles furent sculptées dans la forme de deux colonnes avec un angle précis fait d’une seule pierre.
L’épaisseur de chacune de ces quatre colonnes est de 30 empans. Chaque colonne est de forme carrée à
sa base et de forme arrondie dans sa hauteur. L’apparence de la colonne est d’une seule couleur identique
aux colonnes. [La couleur] n’est pas un rouge foncé, mais tire légèrement vers le jaune. À chaque extrémité
des colonnes, il y a un sommet jaune circulaire dans l’épaisseur de la colonne sauf que le sommet est plus
large que la base. Cette mosquée en plein air ne possède pas de toit et il n’y en a jamais eu. Dieu seul sait !
La qibla de la mosquée possède un carrelage qui semble apparaître sur les colonnes, à l’exception des
colonnes susmentionnées. Ces colonnes ressemblent à celles de notre ville ou sont plus épaisses. On y a
construit un mihrab où prie quiconque s’y rendrait à pied parce que l’espace autour n’a plus de construction.
Le plus merveilleux est une colonne colossale qui se trouve devant l’alignement est, à l’intérieur de la
mosquée. Entre cette colonne et cet alignement, on mesure 20 coudées. La base carrée est d’une seule
pierre de la couleur susmentionnée. La hauteur de la base en plein air est de 16 empans et chaque côté
mesure 20 empans. À son sommet, il y a une autre base identique dans son apparence, sa largeur et sa
couleur. La moitié est carrée comme celle qui est dessous et l’autre moitié est circulaire comme celle qui est
sur elle. La hauteur de cette autre base en plein air est de 8 empans. Les jointures tiennent avec du plomb.
On a fait à la perfection le façonnage de son arrondi et on y a sculpté un carré d’une finition parfaite. Par
ailleurs, la colonne colossale est posée sur des bases dont l’épaisseur est de 38 empans. On ne connaît pas
sa hauteur, cependant les enfants y viennent et y lancent des pierres pour jouer à celui qui jettera la pierre le
plus haut. Je n’ai pas vu celui qui l’a atteint. Sur cette colonne, l’extrémité est composée d’une pierre qui tire
vers le jaune et dont le sommet est plus large ; elle y est posée comme une assiette. On a fait à la perfection
son sculpté et son ajour. Elle possède des branches au sommet qui regardent vers le sol et qui ressemblent
à des plantes desséchées, elle est parfaite à l’extrême. Elle est faite dans une pierre dure et elle est de
bonne facture. La colonne est d’une perfection sobre et pure. Je ne connais pas le sens de cette colonne
isolée dans ce lieu, elle ne se trouve pas au milieu et aucun indice [n’en présume] une autre. On ne sait pas
comment elle est venue là, ni comment elle a été érigée, il n’y a pas de colline aux alentours d’Alexandrie
qui soit proche d’elle. On dit que les Djinns (p. 540) réalisèrent tout ceci pour Sulaymān – que la paix soit sur
lui ! – ou bien que ce serait de l’époque de ‘Awūǧ et de ses compagnons. C’est une pierre qui restera pour
l’éternité. Dieu seul sait. Yūsuf dit : en 602 [1205], je me rappelai à Malaga – que Dieu la garde – d’une
anecdote sur cette colonne, après l’avoir vue il y a quarante ans, [que je tenais] d’un de mes amis pèlerins,
parmi les hommes de mérite, qui raconta qu’un homme de confiance lui raconta ceci : un lanceur à
Alexandrie commit un délit. Il se dirigea vers cette colonne, décocha une flèche, à laquelle était attaché un fil
solide, au-dessus d’elle. La flèche alla au-dessus de la colonne tandis que le fil resta à son sommet. Un bout
resta au sol, là où tomba la flèche, tandis que l’autre alla de l’autre côté à l’endroit d’où il tira. Alors il attacha
à ce bout un autre fil plus solide auquel il fixa un cordon et, au bout de celui-ci, il noua une corde solide. Puis
il tira le tout du côté où la flèche était tombée. Après quoi il fixa l’extrémité de la corde au bas de la colonne
et il s’y agrippa de l’autre côté jusqu’à parvenir à son sommet où il y avait une cavité semblable à un bassin,
remplie d’eau de pluie. Il y monta avec de la nourriture et y resta. Les gens rassemblés furent étonnés et ne
comprirent pas quel artifice fut utilisé pour escalader jusqu’à cet endroit. Le wālī qui fut mis au courant s’en
étonna et ordonna qu’on lui [le lanceur] pardonne. Le lanceur descendit tout assuré et leur expliqua l’artifice.
Tel est son exposé. Dieu seul sait.
(Digression sur Bagdad)
Le récit revient sur la suite des nouvelles. Dans l’alignement [du côté] maritime de la colonne45
susmentionnée, [se trouve] la porte de la mosquée qui est aussi une merveille. Son montant est d’une seule
pierre, sa façade, sur son côté droit quand vous y entrez comme sur son côté gauche, mesure 50 empans
de haut et 7 empans de large. Le bord de la pierre est de 4,5 empans. À son côté, sur votre droite, il y a un
autre montant fait d’une seule pierre comme le précédent. De même, sur la gauche, entre les deux
montants, on mesure au sol 30 empans. Sur les deux montants, il y a un linteau d’une seule pierre qui tient
le sommet des deux montants du côté de l’intérieur de la mosquée. Sur les deux autres montants qui se
trouvent après l’espace, hors de la mosquée, il y a également un autre linteau d’une seule pierre, mais
celui-ci est tombé et s’est cassé en trois morceaux. Le linteau cassé mesure 40 empans de long et
8 empans de large, son bord (p. 541) a également des moulures et des bas-reliefs comportant des rinceaux,
des fleurs de lys et des sculptures merveilleuses. Dans une des parties du linteau, il y a, de part et d’autre,
deux morceaux de bois sculptés, qui font l’émerveillement de ceux qui les voient ; [le linteau] est si poli que
lorsqu’on le tape du creux de la main ou avec une pierre, on entend un son étrange. Devant ceci, à 20 pas,
se tient un autre linteau en place, tandis que son pendant, de l’autre côté, est tombé et s’est cassé au
milieu ; sa longueur est de 55 empans et sa largeur comme son bord est de 8 empans. Il semblerait qu’il y
ait un mur intérieur devant la porte et sous celle-ci un immense vestibule, conservé à l’aide de la pierre
ponce, ressemblant à une immense maison ; à l’intérieur, on entre dans une galerie souterraine située sous
la mosquée. Je ne connais pas sa longueur ni où elle finit. On dit que toute la mosquée reposait sur des
maisons et de petits passages qui apparaissent à partir des colonnes arrachées qu’on a découpées pour en
faire des pierres de pavement et pour d’autres besoins. On a déplacé une grande quantité de pierres ponces
à partir de ces colonnes pour rénover le Phare susmentionné ainsi que sa jetée. La terre sur la butte
susmentionnée, à l’endroit où se trouve la mosquée citée, n’est pas naturelle, mais fut transportée là pour
recouvrir ce qui avait été construit ainsi que les bases des colonnes et des pierres ponces. Dieu seul sait !
Quand je regardai ces merveilles et ces monuments, je fus émerveillé. Je pensai alors à ces peuples qui
existaient avant nous, comme le peuple de ‘Ad, que définit ainsi la parole de Dieu-le-Puissant : « Ils sont
comme la souche vide d’un palmier ». Quand je vois le travail de cette colonne et les autres merveilles, je
me dis que le mérite qu’on leur attribue est peu. »46
- 32 - 35 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BENJAMIN DE TUDÈLE (1170-1171)
Tudèle, B. de, « Benjamin de Tudèle », dans H. Harboun (éd.), Les voyageurs juifs du Moyen Âge,
XIIe siècle, Aix-en-Provence, 1986.
Benjamin est un rabbin né à Tudèle en Navarre au commencement du XIIe siècle. On ne connaît pas ses
dates de naissance et de mort. Il entreprend un voyage en 1165-1166 et en revient en 1172. Il écrit sa
relation en 1178.47
p. 135-136 :
« À deux journées de là est Alexandrie ou No Amon construite solidement par Alexandre le Grand qui l’a
appelée de son nom. Les maisons, les palais, les murailles, tout y est joliment bâti.
Hors de la ville est l’école d'Aristote, précepteur d'Alexandre. C’est un bel et grand édifice où il y a une
vingtaine d’écoles séparées les unes des autres par des colonnes de marbre. On y venait du monde entier
pour étudier la science du philosophe Aristote.
La ville est construite sur une hauteur, sa partie basse est convexe, bâtie sur des ponts. Alexandre l’a
construite avec beaucoup de sagesse.
Ses rues sont droites, et pleines de boutiques. Elles sont si longues qu’on peut y marcher à une distance
d’un mille, de la Porte de Rachid à la Porte de la mer. Alexandre a construit une digue dans le port, dont la
longueur mesure un mille, au milieu de la mer. Sur la digue, il fit une grande tour appelée le phare, en
langue arabe : Manar Askandria. Au sommet de cette tour, il avait placé des miroirs en verre, d’où l’on
pouvait voir vingt journées d’éloignement tous les vaisseaux qui venaient de Grèce ou de l’Occident pour
faire la guerre ou pour nuire à la ville ; de sorte que, par ce moyen, ils étaient avertis de se sentir sur leur
garde.
Un jour, longtemps après la mort d’Alexandre, un vaisseau aborda, commandé par un capitaine grec nommé
Todoros versé en toute science. Les Grecs étaient, en ce temps-là, sous la domination de l’Égypte. Le
capitaine apporta un grand présent au roi d’Égypte : de l’argent, de l’or, des vêtements de soie. Il jeta l’ancre
devant le phare selon l’habitude des marchands qui s’y arrêtaient. Chaque jour, le gardien du phare et ses
serviteurs allaient manger chez le capitaine, de sorte que celui-ci, ayant gagné les bonnes grâces du gardien
du phare, allait et venait tous les jours librement chez lui. (p. 136) Un jour le capitaine organisa un festin en
l’honneur du gardien du phare et de ces gens et l’enivra tellement, lui et ses subordonnés, qu’ils se mirent
tous à dormir. Le capitaine et les marins se levèrent, montèrent au sommet de la tour, cassèrent les miroirs
et s’en allèrent le jour même. Depuis ce temps, les chrétiens vinrent avec des barques, de gros vaisseaux et
s’emparèrent des îles de la Crète et de Chypre, qui passèrent ainsi sous la domination des Grecs jusqu’à ce
jour.
Le phare est encore aujourd’hui un point de repère à tous les navigateurs. Tous ceux qui se rendent par mer
à Alexandrie, le voit sur une distance de cent milles. La nuit, le gardien allume une torche que les marins
peuvent voir de loin.
On vient à Alexandrie de tout l’empire des Iduméens (chrétiens), de Valence, de Lombardie, de Toscane, de
la Pouille, d’Amalfi, de Sicile, de Rakuphia, de Catalogne, d’Espagne, de la Calabre, de la Romagne, du
Khazar48, de Patzimakie49, de Hongrie, de Bulgarie, de Rakosie50, de Croatie, de Slovanie, du Roussillon,
d’Allemagne, de Saxe, du Danemark, d’Irlande, de Norvège, des Pays-bas, d’Écosse, d’Angleterre, du Pays
de Galles, de Flandre, de Normandie, de France, du Poitou, d’Anjou, de Bourgogne, de Maurienne51, de
Provence, de Gènes, de Pise, de Gascogne, de Navarre, d’Aragon. Pareillement aussi du côté de l’occident
musulman, il en vient de l’Andalousie, de l’Algarve52, de l’Afrique, et de l’Arabie. Il en vient aussi du côté des
Indes, de Savila53, et d’Abyssinie, de la Libye, du Yémen, de Sinéar (Mésopotamie) d’Al-Cham (Syrie), de
Grèce et de Turquie.
Les marchands indiens y apportent toutes sortes d’aromates, que les chrétiens leur achètent. La ville
abonde de marchands. Chaque nation y possède son propre comptoir.
Sur le bord de la mer, il y a un tombeau de marbre, sur lequel sont gravés toutes sortes d’oiseaux, toutes
sortes d’animaux et l’effigie du mort, le tout avec des inscriptions (p. 137) anciennes. Personne ne connaît
cette écriture. On dit qu’il s’agit vraisemblablement d’un roi ancien, avant le déluge. La longueur du tombeau
est de quinze empans, et la largeur de six.
Il y a à Alexandrie environ trois mille juifs. »
47Carmoly, E. et Lelewel, J., Notice historique de Benjamin de Tudèle, suivie de l'examen géographique de
ses voyages, Bruxelles, Leipzig, 1852, p. 6-9.
48 La Crimée. Toutes les notes de ce texte sont de O. V. Volkoff.
49 La Dacie (à peu près l’actuelle Roumanie).
50 Raguse en Croatie, actuellement Dubrovnik.
51 Partie de la Savoie connue lors de la conquête Burgonde au Ve s. sous le nom de Mauriana.
52 Algarve, province du Portugal.
53 En Somalie, au sud de Djibouti.
- 36 - 37 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-HARAWĪ (1174)
ABŪ L-ḤASAN `ALĪ B. ABĪ BAKR
Al-Harawī, Guide des lieux de pèlerinage, par J. Sourdel-Thomine, Damas, 1957.
Al-Harawī est un auteur syrien et célèbre ascète-pèlerin. Après une vie de voyages, il finit ses jours à Alep
auprès du souverain ayyubide Al-Malik al-Ẓahir Ġazī qui le tient en haute estime et lui fait bâtir une madrasa
du rite chaféite où il enseigne. Ce lieu abrite encore les restes de son tombeau. Ses biographes ne donnent
pas trop de détails sur sa formation et ses activités, mais on sait qu’il naît à Mossoul54 et qu’il quitte cette
ville pour mener une vie errante. Il se fait connaître comme prédicateur à Bagdad et Alep, et acquiert une
réputation de mystique. Son ouvrage est entrepris sur les instances d’un fonctionnaire de Bagdad. Il meurt à
Alep en 1215.55
Lorsqu’il est à Hébron, l’auteur donne la date de son voyage à Alexandrie.
p. 72 :
« Or à Alexandrie, en 570/1174, j’ai entendu le šayḫ Abū Ṭāhir Aḥmad b. Muḥammad as-Silafī56 rapporter
une anecdote ».
p. 110- 117 :
La marche frontière d’Alexandrie
« Là, le cimetière que l’on appelle Gabbana Wa‘la (?)57 avec la tombe d’al-Miqdād b. al-Aswad al-Kindī,
tombe que nous avons également visitée à Raqqa et dont il sera question plus loin, tandis qu’en réalité elle
se trouve à Médine.
À Alexandrie encore, la tombe du prophète Irmyā’ dans le souterrain (ad-dīmās), l’oratoire [du bureau] des
successions (masǧid al-Mawāriṯ) que l’on visite en pèlerinage, l’oratoire de Sāriya, et l’ancienne
Grande-mosquée que l’on dit avoir été fondée par les Compagnons.
Il s’y trouve plus d’oratoires et de sanctuaires que je n’en ai vu nulle part ailleurs. Ibn Munqiḏ m’ayant dit qu’il
y en avait douze mille, j’interrogeai à ce sujet le cadi-secrétaire qui m’affirma qu’al-Malik al-`Azīz `Uṯmān,
après enquête, en avait trouvé vingt mille. Moi-même ne les ai pas comptés et Dieu sait ce qu’il y a de vrai
dans cette affirmation.
Son système de canalisations est si merveilleux que, lors de la crue du Nil, la ville semble flotter comme un
flacon de cristal qui aurait été posé sur l’eau et qu’il n’y ait pas d’autre part de maison où ne pénètre, grâce à
la crue, l’eau dont elle a besoin. On marche à l’étage [des citernes], qui se trouvent au-dessous de la ville,
aussi bien que dans les rues ; ces étages [souterrains] sont au nombre de trois et construits à la semblance
d’un échiquier.
À Alexandrie également, le PHARE dont on dit qu’il se trouvait à l’intérieur de la ville : celle-ci avait en effet
sept grandes rues (maḥaǧǧāt), qui furent mangées par la mer au point qu’il n’en resta plus qu’une seule, et
elle s’étendait d’un endroit appelé Abu Sir jusqu’à Abu Qir ; on dit aussi que la tombe d’Alexandre est dans
le Phare avec celle d’Aristote et Dieu sait ce qu’il y a de vrai dans cette affirmation.
L’auteur de cet ouvrage, `Alī b. abī Bakr al-Harawī, dit : Certes on a compté le Phare d’Alexandrie au
nombre des merveilles lorsque s’y trouvait le miroir où, dit-on, se voyaient les barques mettant à la voile
depuis une distance de plusieurs jours de route, si bien que l’on se préparait à aller à leur rencontre. On
raconte aussi de ce miroir qu’il incendiait les navires et vraisemblablement de la manière suivante : le miroir
embrasait à distance lorsque les rayons du soleil y tombaient à l’aplomb et que la mer aidait à leur effet, car
les rayons du soleil reflétés par l’éclat du miroir, avec l’action jointe de la réverbération de la mer et de son
étincellement, peuvent sans aucun doute mettre le feu. Les dimensions du miroir auraient été de soixante
coudées, la hauteur du Phare, de trois cents, et Dieu sait la vérité.
En revanche le Phare ne fait plus aujourd’hui partie des merveilles, car ce n’est qu’une espèce de tour
dressée au bord de l’eau à la manière d’une vigie. Mais c’est bien dans la ville de Constantinople que se
trouvent les colonnes (al-manā’ir) vraiment extraordinaires. Il en est une, consolidée avec du plomb et du fer
et située dans l’Hippodrome (al-Buḍrum), c’est-à-dire le champ de courses (al-maydān), qui s’incline sur son
socle dans toutes les directions lorsque le vent souffle et qui broie les morceaux de poterie et les coquilles
de noix que les gens introduisent [à sa base] ; au même endroit s’en trouve une autre, faite de cuivre et
coulée d’une seule pièce, dans laquelle on ne peut rien faire entrer.
[Digression sur Constantinople]
Revenons aux lieux de pèlerinage et aux antiquités d’Alexandrie
Dans la grande rue (al-maḥaǧǧa) d’Alexandrie, en un lieu appelé al-Qamra (?), se trouve une colonne avec
une représentation d’oiseau, qui tourne en même temps que le soleil. À Alexandrie également, la « colonne
des colonnades », polie à la manière des pierres précieuses, et des colonnes qui l’entourent ; on dit que
c’est là le portique que les Grecs avaient bâti et auquel ils faisaient allusion en citant dans leurs écrits les
opinions des « Hommes du Portique » (Aṣḥrāb ar-Riwāq). Je mesurai moi-même cette colonne : le chiffre
exact m’échappe maintenant, mais je crois qu’il s’agissait de soixante coudées et Dieu sait la vérité ; il me
semble aussi que sa circonférence était de trente coudées et qu’il y avait au-dessous un socle cubique d’un
seul morceau de granit.
À Alexandrie également, la Porte Verte (al-Bāb al-Aḫḍar) que l’on visite, la mosquée de la Repentance et de
la Merci (masǧid at-Tawba wa-r-Raḥma), avec un important ribāṭ58, et la demeure d’Alexandre.
En dehors de la ville, l’église souterraine (kanīsat Asfal al-arḍ), d’une construction merveilleuse, et l’oratoire
du Sculpteur (masǧid an-Naḥḥāt) à côté duquel se situent les tombes de martyrs dont on ignore les noms.
À Alexandrie encore on connaît le poisson-torpille (ar-ra`ād) : quiconque le prend sent sa main agitée de
telles convulsions qu’il est obligé de le lâcher. »
54 Cette ville se trouvait à Arḍ al-Ǧazīra, au nord de l’Irak.
55 Sourdel-Thomine, J., « Al-Harawī al-Mawṣilī », EI2 III, Leyde, Paris, 1990, p. 182.
56 Au sujet de ce savant, voir la notice biographique de Yūsuf b. al-Šayḫ (1165/1166).
57 Il s’agit du cimetière également mentionné par Ibn Rušayd (1285), voyageur de ce corpus.
58 Chabbi, J., « Ribāṭ », EI2 VIII, Leyde, 1995, p. 510-524. Institution militaire et religieuse.
- 38 - 39 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GÉRARD BURCHARD (1175)
Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/4, Leyde, 1934.
L'évêque Burchard de Strasbourg est chargé d’une ambassade au Caire en 1175 par l'empereur allemand
Frédéric Barberousse auprès de Saladin.59
Voir le texte de Thetmar (1217).
Feuillet 886 recto :
« Enfin, je pénétrai dans le port d’Alexandrie, dans lequel port a été érigée une grande tour construite de
pierres, dans l’intention qu’elle indique le port aux navigateurs, parce que la terre d’Égypte est plate ; toute la
nuit, un feu brûle sur cette tour, pour montrer le port à ceux qui s’en approchent, pour qu’ils ne périssent pas.
Alexandrie est une ville remarquable, ornée de monuments, de vergers, peuplée d’une immense multitude,
habitée par des Sarrasins, des Juifs et des Chrétiens, qui se trouve régie par la puissance du roi de
Babylone. Le premier état de cette ville, comme le fait est visible dans ses ruines, fut d’une très grande
ampleur. Elle s’étendait, en effet, en long sur quatre milles, et, en largeur, sur un mille. Un bras, issu de
l’Euphrate, venait la baigner sur un de ses côtés, et la Grande Mer défendait son accès de l’autre côté.
Maintenant, cette ville, resserrée le long de la mer, s’étend sur un vaste territoire à partir de ce susdit bras du
Nil. Il faut aussi savoir que l’Euphrate et le Nil sont un seul et unique cours d’eau.
Dans Alexandrie, chaque race d’hommes observe en toute liberté les préceptes de sa loi. Cette ville est
extrêmement salubre, et j’y ai, en conséquence, trouvé un grand nombre de vieillards centenaires. Cette cité
est défendue par un mauvais mur et elle n’a pas de fossés. Il faut savoir que ce port dont nous venons de
parler acquitte en fait de droit de douane, chaque année, cinquante mille pièces d’or, lesquelles font plus de
huit mille marcs d’argent pur. Diverses races d’hommes fréquentent cette ville en y apportant les objets de
leur négoce. Cette ville n’a point d’eau douce, autre que celle qu’elle recueille dans ces citernes, en un seul
temps de l’année, par un aqueduc dérivé du Nil susdit.
Dans cette ville sont de nombreuses églises, parmi lesquelles l’église de saint Marc l’Évangéliste, qui est
située en dehors des murs de la ville neuve, sur le bord de la mer ; j’y ai vu dix-sept sarcophages, qui sont
remplis des ossements et du sang des martyrs, mais leurs noms sont ignorés. J’y ai vu aussi la chapelle
dans laquelle le dit Évangéliste rédigea son Évangile, où il subit le martyre, et le lieu de sa sépulture, d’où
son corps fut subrepticement enlevé par les Vénitiens. C’est dans cette église qu’est élu le Patriarche, qu’il
est sacré, et qu’il reçoit la sépulture lorsqu’il est mort. Cette communauté des Chrétiens a en effet un
Patriarche, qui relève de l’obédience de l’Église des Grecs.
Il y avait jadis dans cette même ville un très grand palais de Pharaon, qui était soutenu par d’immenses
colonnes de marbre, et dont on aperçoit encore aujourd’hui les ruines.
J’ai vu près d’Alexandrie que les eaux du Nil étaient amenées du lit où elles coulent à travers un petit espace
de terrain, dans un endroit où elles stagnent, et là, sans aucun travail ou artifice humain, elles se trouvent
converties, au bout d’un certain laps de temps, en un sel très pur et excellent. »60
59 Dopp, P.-H., « Le Caire vu par les voyageurs occidentaux au Moyen Âge »,BSRGE XXIII, juin 1950,
p. 123.
Rohricht, R., Geschilchte des Konigreiches Jerusalem, Amsterdam, 1966, p. 363.
60 Ce texte a également été traduit par Christian Cannuyer (Une description méconnue de l'Égypte au
XIIe siècle, Gottinger Miszellen Gottingen 70, 1984, p. 13-18.)
- 40 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
IBN JUBAYR (du 29 mars au 3 avril 1183)
ABŪ AL-ḤUSAYN MUḤAMMAD B. AḤMAD B. JUBAYR AL-KINĀNĪ
Charles-Dominique, P. (éd.), Voyageurs arabes, Ibn Faḍlān, Ibn Jubayr, Ibn Baṭṭūṭa et un auteur anonyme,
Paris, 1995.
Ibn Jubayr naît à Valence en 1145 ou peut-être à Jativa (à 60 km de Valence) l’année précédente. Son père
est secrétaire de chancellerie de la ville de Jativa. Ibn Jubayr ayant reçu une instruction complète, tant
scientifique que littéraire est alors employé comme secrétaire auprès du gouverneur almohade de Grenade.
On raconte que sous la pression du gouverneur, il boit sept coupes de vin et que, pour expier sa faute, il se
résout à entreprendre le pèlerinage à La Mecque. Il meurt lors d’un troisième pèlerinage en 1217, sur le
chemin du retour, à Alexandrie.61
p. 75-79 :
« Nous logeâmes à Alexandrie dans une hôtellerie dite des Dinandiers proche de la Savonnerie. »
Mois de dhû al-hijja de ladite année.
« Ce mois commença le dimanche, surlendemain de notre arrivée à Alexandrie. La première scène dont
nous fûmes témoins, le jour de notre arrivée, est celle de la montée à bord des douaniers, au nom du
gouverneur de la ville, pour inspecter toute la cargaison.
Tous les passagers musulmans, l’un après l’autre, comparurent : on enregistra leur nom, leur signalement et
leur pays d’origine. Chacun fut interrogé sur les marchandises qu’il transportait et les espèces qu’il
possédait, pour percevoir la zakât62, sans chercher à savoir si le délai d’une année s’était écoulé ou non,
depuis qu’il en était le détenteur. La plupart des passagers n’avaient entrepris ce voyage que pour accomplir
l’obligation du pèlerinage et n’avaient emporté que des provisions de route. Cependant, ils furent obligés de
payer la zakât sur ces provisions, sans qu’on cherche à savoir si un an s’était écoulé depuis leur acquisition.
On fit débarquer Ahmad ben Hassân, un des nôtres, pour lui demander des nouvelles du Maghreb et
l’interroger sur la cargaison du navire. On l’amena d’abord, sous bonne escorte chez le gouverneur, puis
chez le cadi, les agents de la douane, un groupe de gens de l’entourage du gouverneur ; chacun l’interrogea
et enregistra ses paroles. Enfin on le libéra. Puis on ordonna aux musulmans de débarquer leurs bagages et
les provisions qui leur restaient. Sur le rivage, ils trouvèrent des agents qui se chargeaient de les emmener à
la douane et de transporter tous leurs effets. Alors on les appela, un par un, chacun présenta ses bagages
dans la cohue. On les fouilla tous, tant ceux qui avaient quelque prix que ceux qui n’en avaient pas. On les
mêla les uns aux autres. On introduisit la main dans la ceinture pour y chercher ce qu’on aurait dissimulé.
On demanda de jurer qu’on avait rien d’autre que ce qu’on avait découvert. Au milieu de cette bousculade
disparurent beaucoup de bagages de par le jeu des mains de la cohue. Enfin, on libéra les musulmans
après cette séance terriblement humiliante et déshonorante. Nous demandons à dieu après ces épreuves de
nous rétribuer grandement !
Ce sont là, sûrement des choses qu’ignore le grand sultan Saladin, car s’il apprenait ces agissements, il les
ferait cesser, lui dont on connaît l’équité et la prédilection pour la bienveillance ! Que Dieu tienne compte aux
musulmans de cette terrible épreuve pour qu’ils puissent se voir restituer le zakât de la meilleure façon !
Nous n’avons trouvé dans le royaume de ce sultan rien de mal à mentionner autre que cet incident qui est le
fait, sûrement, des agents de la douane !
Quelques informations sur Alexandrie et ses monuments.
Tout d'abord, mentionnons l’agréable situation de la ville et sa grande étendue. Nous n'avons vu aucune
autre ville où les rues sont si vastes, les bâtiments si élevés, qui soit plus belle et plus vivante. Ses marchés
sont très animés.
Pour la structure de la ville, il est étonnant que les constructions souterraines soient aussi importantes que
celles qui sont en surface et aussi belles et solides ; ceci vient de ce que l’eau du Nil passe sous terre,
au-dessous de toutes les maisons et les rues. Les puits sont donc contigus les uns aux autres et
communiquent entre eux.
Nous avons vu à Alexandrie des piliers et des plaques de marbre si nombreux, si élevés, si larges et si
beaux qu’on aurait du mal à les imaginer. C’est au point qu’on trouve, dans certaines voies, des piliers qui
s’élèvent si nombreux qu’ils cachent le ciel ! On ne connaît ni la signification, ni l’origine de leur édification.
C’était, dit-on, sur eux que reposaient des édifices réservés aux philosophes et aux autorités de ce temps-là.
Dieu seul le sait ! Cela ressemblerait à des observatoires.
Parmi les merveilles de la ville, que nous avons vues, citons le Phare que Dieu – qu’Il est puissant et
majestueux – a édifié par l’intermédiaire de ceux qui furent assujettis à ce travail afin que cet édifice soit un
signe pour les hommes qui cherchent à connaître la vérité et un point de repère pour les voyageurs, car
sans lui ils ne pourraient se guider jusqu’à Alexandrie ; en effet, le phare est visible à plus de soixante-dix
milles. Il a été joliment et solidement construit, tant en longueur qu’en largeur, et il est si haut qu’il rivalise
avec le ciel. On est bien court pour le décrire, le regard ne peut l’embrasser en entier, on est impuissant à en
parler et le contempler exige un grand champ de vision. Nous mesurâmes un de ses côtés et nous
trouvâmes plus de cinquante brasses. La hauteur dépasserait, dit-on, cent cinquante tailles d’hommes. À
l’intérieur du Phare, le spectacle est extraordinaire : les escaliers et les couloirs sont si larges, le nombre des
pièces si grand que celui qui y circule et parcourt ses galeries s’y perd parfois. Bref, on est impuissant à en
parler. Que Dieu fasse qu’il soit gardé dans le territoire musulman et qu’il y soit conservé ! Au sommet, on
voit un oratoire qu’on dit être béni et dont les fidèles cherchent à gagner la bénédiction, en y priant. Nous y
montâmes, jeudi 5 dhû al-hijja, et nous y priâmes. Nous avons pu constater alors que sa construction était si
admirable qu’on est bien incapable de la décrire dans tous ses détails.
Citons parmi les vertus et les titres de gloire de cette ville dont l’honneur revient en réalité à son sultan, les
madrasas et les couvents qui s’y trouvent et qui sont réservés aux étudiants et aux dévots qui y affluent des
pays lointains. Chacun y trouve un logement, un maître qui lui enseigne la branche de la science qu’il désire
étudier et une pension pour subvenir à ses besoins. Le sultan se soucie tant de ses étrangers exceptionnels
qu’il a ordonné d’installer des bains dont ils se servent à l’occasion, d’instituer un hôpital où sont soignés
leurs malades et où fonctionnent des médecins qui les traitent et qui ont sous leurs ordres des serviteurs
chargés d’exécuter les prescriptions médicales et les régimes ordonnés par les médecins dans l’intérêt des
malades. Le sultan a aussi appointé des gens chargés de rendre visite aux patients qui ne se font pas
hospitaliser, surtout des étrangers, et de soumettre leur cas aux médecins afin qu’ils veillent à leur
traitement.
De même, le sultan a pris cette disposition qui est tout à fait en son honneur : il a attribué aux voyageurs
maghrébins deux pains par personne et par jour, quel qu’en soit le nombre, et a désigné pour les distribuer,
chaque jour, un homme de confiance agissant en son nom. Il lui arrive de répartir, pour un seul jour, deux
mille pains, ou plus, selon le nombre des voyageurs. Cette institution fonctionne continuellement. Pour
couvrir tous ces frais, le sultan a constitué des legs pieux, outre la zakât sur les métaux précieux qui est
réservée à cet usage. Il a, également, prescrit aux administrateurs de ces biens de puiser dans sa propre
cassette s’ils venaient à manquer de fonds. Les habitants de cette ville sont très aisés et très fortunés, car ils
ne sont soumis à aucun impôt. Le souverain ne tire aucun bénéfice de cette ville, sauf ceux des legs pieux
constitués en son nom ou bien de main-morte pour ses fondations (wakf 63), l’impôt de capitation versé par
les juifs et les chrétiens et occasionnellement la zakât sur les métaux précieux dont il perçoit les trois
huitièmes, le restant étant attribué aux fondations dont nous avons parlé. Le souverain qui a pris ces
louables dispositions et qui a prescrit ces règlements généreux disparu depuis longtemps, est Saladin Abû
Muzzafar Yûsuf ben Ayyûb – Que Dieu lui accorde conjointement Sa paix et Son assistance.
Un incident curieux arriva à ses étrangers : un homme qui désirait entrer en faveur auprès du Sultan, en lui
prodiguant des conseils, raconta au souverain que la plupart de ceux qui bénéficiaient de ce don en pains
n’en avaient nullement besoin pour subvenir car ils arrivaient avec des provisions suffisantes. La médisance
de ce conseiller faillit bien porter ses fruits ! Un jour, le sultan partit faire une tournée d’inspection, hors de la
ville. Or il rencontra un groupe de voyageurs qui avaient échappé à l’emprise du désert voisin de Tripoli et
qui étaient encore marqués par les affres de la soif et de la faim. Le sultan les interrogea sur le but de leur
voyage et s’enquit de leur aventure. Il apprit que ces hommes se rendaient en pèlerinage à la Maison sacrée
de Dieu, qu’ils avaient donc suivi la voie terrestre et avaient enduré les tourments du désert. Alors le sultan
dit : « Quand bien même ces malheureux, après avoir erré dans ce désert et avoir enduré tant de peines
seraient arrivés chacun avec leur poids d’or et d’argent, ils devraient bénéficier de ce don que nous avons
institué et non pas en être privés ! Il est stupéfiant que quelqu’un ait osé médire d’eux et voulu ainsi entrer
en notre faveur en nous suggérant d’abroger la mesure que nous avions prise purement pour l’amour de
Dieu –qu’Il est puissant et majestueux ! » On ne mesure plus les oeuvres pies de ce sultan, son désir de
justice et ses efforts pour défendre le territoire musulman.
Il est curieux que dans cette ville les gens ont les mêmes occupations, la nuit et le jour. C’est aussi la cité qui
possède le plus de mosquées, si bien que l’estimation qu’on en fait est imprécise : certains exagèrent le
nombre, d’autres le minorent, les premiers arrivent à douze mille, les seconds en comptent moins, sans
préciser, huit mille ou un autre chiffre. En vérité, les mosquées sont très nombreuses ; il y en a jusqu’à
quatre ou cinq au même endroit, et parfois, l’une est composée de plusieurs. Chacune a ses imams
appointés par le sultan : certains perçoivent cinq dinars égyptiens par mois, ce qui équivaut à dix dinars
numinides, d’autres perçoivent plus ou moins. C’est là une des faveurs du sultan. Il serait d’ailleurs trop long
de citer toutes les oeuvres pies de ce souverain parce qu’elles sont innombrables.
Nous quittâmes Alexandrie avec la bénédiction de Dieu – qu’Il soit exalté – et avec Son aide, dimanche
matin 8 dhû al-hijja (3 avril). »
p. 93-94 :
« Lorsque nous séjournions à Alexandrie, dans le mois indiqué plus haut, nous vîmes qu’une grande foule
s’était réunie pour assister au spectacle de captifs rûm qui entraient dans la ville, à dos de chameaux,
montés la face tournée vers la croupe. Les tambours et les trompettes retentissaient autour d’eux. Nous
demandâmes ce qui était arrivé à ces malheureux et on nous raconta leur histoire qui est digne de briser le
coeur de compassion et d’émotion.
Un groupe de chrétiens syriens s’était formé et avait construit des navires dans les localités que ces gens
détiennent sur la mer Rouge. Puis ils les avaient chargés, en pièces, sur des chameaux appartenant à des
Arabes voisins avec lesquels ils étaient convenus de la location. Lorsqu’ils étaient arrivés sur le rivage, ils
avaint cloué leurs navires, en avaient achevé l’assemblage et l’armature, les avaient lancés à la mer et y
avaient embarqué pour couper la route aux pèlerins. Ils parvinrent à la mer an-Na‘am et y brûlèrent près de
seize navires. Ayant atteint ‘Aydhâb, ils se saisirent d’un bateau qui arrivait de Judda chargé de pèlerins et,
à terre, d’une grande caravane qui arrivait de Qûs et se rendait à ‘Aydhâb. Ils massacrèrent tout le monde
sans épargner qui que ce fût. Ils se saisirent aussi de deux navires chargés de commerçants qui venaient du
Yémen. Ils mirent le feu sur le rivage à beaucoup de vivres qui étaient destinés à l’approvisionnement de La
Mekke et Médine –que Dieu leur conserve leur puissance ! Ils commirent des méfaits si horribles qu’on n’en
a jamais entendu de pareils en Islam. Aucun chrétien n’était parvenu jusqu’à ‘Aydhâb.
Parmi leurs méfaits les plus graves, citons celui-ci (on aimerait se boucher les oreilles pour ne pas l’entendre
tant il est horrible et atroce) : ces chrétiens étaient en effet résolus à pénétrer dans la ville du Prophète et à
retirer son corps du tombeau sacré. Ils en ébruitèrent la nouvelle et en parlèrent. Mais Dieu, par Son
intervention, les punit de leur impudence et de leur arrogance. Les chrétiens n’étaient plus qu’à un jour de
marche de Médine. Mais Dieu repoussa leur hostilité au moyen de navires affrétés à Misr et à Alexandrie,
sous les ordres du chambellan Lu’lu accompagné de courageux marins maghrébins. Ils atteignirent les
ennemis qui faillirent bien leur échapper, mais qui furent pris jusqu’au dernier. C’est là un signe de la
providence divine toute-puissante ! Les musulmans rejoignirent les chrétiens bien que ces derniers les
eussent devancés depuis longtemps, plus d’un mois et demi environ. Ils les massacrèrent, les firent
prisonniers ; ces captifs furent envoyés dans les différentes villes pour y être mis à mort. On en expédia à La
Mekke et à Médine. Dieu épargna donc, par Sa grâce, à l’islam et aux musulmans, une catastrophe.
Louange à Dieu, maître des mondes ! »
- 41 - 43 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
GUILLAUME DE TYR (avant 1184)
Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/4, Leyde, 1934.
Guillaume naît à Jérusalem vers 1130 et c’est sans doute dans cette ville qu’il meurt en 1186. Il passe de
longues années d’études en occident où il apprend les arts libéraux, le droit civil et le droit canon. Il suit les
principaux maîtres du temps en France et en Italie pendant presque vingt ans, de 1146 à 1165. À son retour,
il est fait chanoine d’Acre et devient archidiacre de Tyr en 1167. En 1175, il est élu archevêque de Tyr. C’est
à la demande du roi de Jérusalem qu’il écrit l’histoire de cette région.
On sait que Guillaume n’a pas visité Alexandrie, mais sa description est établie d’après des témoins
oculaires. Dans son prologue l’auteur écrit : « Ce que nous avons composé jusqu’à présent était l’Histoire
que nous avons recueillie autant que nous l’avons pu par la relation des autres, servis par une mémoire plus
pleine du temps d’autrefois – c’est pourquoi nous avons recherché la vérité, le contenu des événements,
l’année avec grande difficulté, semblable à ceux qui mendient les secours étrangers. Malgré cela, nous
avons mis par écrit un récit aussi fidèle que possible. Mais tout ce qui va suivre maintenant, nous l’avons vu
en partie de nos propres yeux, ou bien les hommes qui ont assisté eux-mêmes aux événements nous en ont
informé par une narration fidèle… ».64
feuillet 899 recto et verso :
« Syracon cependant ayant rallié tous ceux des siens qui avaient survécu, les réforma en un seul corps,
traversa le désert à l’insu des nôtres, et se rendit à Alexandrie : les habitants de cette ville la remirent
aussitôt entre ces mains. Dès que le roi eut reçu la première nouvelle de cet événement, il convoqua auprès
de lui les princes, le soudan et ses fils, et les nobles d’Égypte, et leur demanda avec sollicitude ce qu’il y
avait à faire ; On discuta longuement, ainsi qu’il arrive d’ordinaire dans l’incertitude d’une décision à
prendre ; et comme la ville d’Alexandrie n’a par elle-même aucune ressource en vivres et en grains, et ne se
nourrit que de ce qu’on lui apporte par eau des contrées supérieures de l’Égypte, on résolut d’établir une
flotte sur le fleuve, afin d’intercepter entièrement tous les transports qui pourraient être dirigés sur cette ville.
Après avoir fait ces dispositions, le Roi se rendit lui-même dans les environs, avec toute son armée, et
dressa son camp entre les lieux appelés Toroge et Demenehut : ce point est situé à huit milles d’Alexandrie ;
De là le roi envoyait des éclaireurs pour fouiller et faire évacuer tous les lieux voisins et même des points
plus éloignés dans le désert, afin que personne ne tentât de porter secours aux assiégés, ou pour empêcher
aussi ceux qui voudraient sortir de la ville au dehors solliciter l’assistance des étrangers.
Livre XIX ; t. III, p. 215-216.
« Alexandrie la dernière de toutes les villes d’Égypte, dans cette partie du pays qui fait face à la Libye et se
prolonge vers l’occident, est placée elle-même sur les confins du sol cultivé et du désert brûlant, si bien
qu’en dehors des murs de la ville, du côté du couchant, on ne voit qu’une vaste étendue de terres qui n’ont
jamais ressenti les bienfaits d’aucune culture. Elle fut fondée, selon les anciennes histoires par Alexandre le
Macédonien, fils de Philippe, et reçut de lui le nom qu’elle a porté depuis. Solin dit que son origine remonte à
la cent douzième olympiade, et au consulat de Lucius Papyrus, fils de Lucius, et de Caius Petilius, fils de
Caius. L’architecte Dinocrate dressa le plan de cette ville, et occupe, dans ses souvenirs, le second rang
après son fondateur. Elle est située non loin de l’une des embouchures du Nil, appelée par quelques-uns
Héracléotique, et par d’autres Canopique. Aujourd’hui cependant, le lieu qui a donné son nom à cette
embouchure du Nil, voisine de la ville, a perdu lui-même son antique dénomination, et est appelé Ressith.
Alexandrie est à cinq ou six milles de distance du lit du fleuve ; au temps ordinaire des crues, elles reçoit une
partie de ses eaux par quelques canaux qui les versent dans de vastes citernes, creusées tout exprès, où on
les conserve avec soin durant toute l’année pour l’usage des habitants. Une partie de ces eaux est dirigée,
autant qu’on peut en avoir besoin, vers les vergers qui se trouvent en dehors de la ville, et elles y arrivent
par des conduits souterrains. La position d’Alexandrie est des plus avantageuses pour le commerce. Elle a
deux ports séparés par une langue de terre excessivement étroite. En avant de cette chaussée naturelle, est
une tour d’une grande élévation, appelée Phare : Jules-César la fit construire, dit-on, pour le service de la
navigation, lorsqu’il y conduisit une colonie. On y apporte de la haute Égypte par le Nil une grande quantité
de denrées, et presque toutes les choses nécessaires à la vie.
Les productions inconnues à l’Égypte arrivent par mer à Alexandrie de toutes les contrées du monde, et y
sont toujours en abondance ; aussi dit-on qu’on y trouve toutes sortes d’objets utiles, plus qu’en tout autre
port de mer. Les deux Indes, le pays de Saba, l’Arabie, les deux Éthiopies, la Perse et toutes les provinces
environnantes, envoient dans la haute Égypte, par la mer Rouge, jusqu’à la ville nommée Aideb, située sur
le rivage de cette mer, par où tous ces peuples divers arrivent également vers nous, les aromates, les
perles, les trésors de l’Orient, et toutes les marchandises étrangères dont notre monde est privé : arrivées en
ce lieu, on les transporte sur le Nil, et elles descendent de là à Alexandrie. Aussi les peuples de l’Orient et
ceux de l’Occident se rencontrent-ils continuellement dans cette ville, qui est comme le grand marché des
deux mondes.
Elle a eu dans les temps anciens, comme dans les temps modernes, des titres nombreux à l’illustration. Le
bienheureux Marc, fils spirituel du prince des apôtres, envoyé par le ciel même auprès de cette ville, l’honora
de ses prédications ; les saints Pères Athanase et Cyrille y firent leur résidence, et y furent déposés dans
leurs glorieux tombeaux ; le patriarche d’Alexandrie avait le second rang dans la chrétienté et cette ville était
la vénérable métropole de l’Égypte, de la Libye, de la Pentapolite, et de plusieurs autres provinces. Toute la
flotte des armées alliées fut conduite devant ses murs ; on ferma l’accès des portes et toutes les autres
avenues, et il ne fut plus permis de s’approcher de la place.
Livre XIX ; t. III, p. 217-219.
Il y avait autour de la ville (Alexandrie) des vergers qui présentaient l’aspect le plus agréable, et
ressemblaient à de belles forêts bien boisées : ils étaient garnis d’arbres à fruits en plein rapport, et de
plantes utiles ; leur vue seule engageait les passants à les visiter de plus près, et lorsqu’ils y étaient entrés,
tout les invitait au repos : une grande partie de notre armée y alla aussi, d’abord pour y chercher le bois
nécessaire à la construction des machines, et y demeura ensuite dans la seule intention de nuire et de faire
un dommage considérable aux habitants ; bientôt les arbres aromatiques et propres à toutes sortes
d’usages furent coupés et renversés avec tout autant d’empressement qu’on avait pu, dans le principe, leur
prodiguer de soins et de travaux pour les faire prospérer. Le sol se trouve subitement rasé, il ne resta plus
aucun indice du coup d’oeil qu’il présentait auparavant, et dans la suite lorsque la paix fut rétablie, cette
destruction et le dommage que les habitants en éprouvèrent furent pour eux la perte la plus sensible et
l’événement dont ils se plaignirent le plus.
Livre XIX ; t. III, p. 220-221.
Tandis que ces événements se passaient dans les environs d’Alexandrie, Syracon parcourait toute la haute
Égypte. Arrivé à Chus, il voulut essayer de faire le siège de cette ville ; mais voyant qu’il lui faudrait trop de
temps pour s’en rendre maître, et jugeant en outre que des intérêts plus pressants le rappelaient auprès de
son neveu, il leva des sommes d’argent dans plusieurs villes, et se disposa à redescendre promptement
dans la basse Égypte avec l’armée qu’il traînait à sa suite. Il apprit en arrivant à Babylone, que le roi avait
remis la garde de la ville du Caire et du pont de bateaux à Hugues d’Ibelin.
Livre XIX ; t. III, p. 223.
Cette belle ville est dominée par une tour d’une grande hauteur, qu’on appelle le Phare, et sur laquelle on
allume des torches qui jettent une grande clarté et brillent comme un astre dans le ciel, afin de diriger au
milieu de la nuit la marche des navigateurs qui ne connaissent pas les localités. On ne peut en effet aborder
à Alexandrie que par une mer aveugle, pour ainsi dire, et semée de bas-fonds trompeurs et périlleux.
Instruits par les feux qui brûlent constamment au sommet du Phare et sont entretenus aux frais du trésor
public, les navigateurs échappent ainsi aux naufrages qui les menacent et dirigent heureusement leur
marche vers le port.
Livre XIX ; t. III, p. 227. »
64Zerner, M., « Guillaume de Tyr. Troisième tiers de XIIe siècle », dans D. Régnier-Bohler (éd.), Croisades et
pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XII-XVIe siècle, Paris, 1997, p. 500.
- 44 - 45 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACOB BEN NATANEL HA-COHEN (XIIe siècle)
Ben Natanel Ha-Cohen, J., « Jacob ben Natanel Ha-Cohen », dans E. N. Adler, Jewish travellers,
New Delhi, 1995.
Nous ignorons tout de ce voyageur d’après Joseph Shatzmiller65.
p. 93-94 :
« À Alexandrie je vis le collège du roi Alexandre. Il y a là trois cent soixante-cinq colonnes correspondant
aux jours de l'année solaire. Le pilier central est épais de trente paumes et a quatre coudées de longueur. Et
il y a là deux coffres, l'un en haut et l'autre en bas, et sur elles il y a une image carrée, représentant une
créature vivante, avec le visage d'un homme, le visage d'un aigle, le visage d'un lion, et le visage d'un
taureau. Là Alexandre était enseigné par son professeur Aristote.
Au bord de la mer se trouve une tour appelée en arabe Manara ; au sommet, ils mettent une lumière la nuit,
ainsi les bateaux ne s’égarent pas. Ce feu peut être vu jusqu’à Acre, en Afrique et en Provence. Ce phare
est si beau et large que deux chevaliers à cheval, côte à côte, peuvent le monter. Il y a une citerne
au-dessus de laquelle se trouve un front de mer.
Dans la maison d'un juif, il y a une statue de Bathia, la fille de Pharaon. La même statue est à Rameses,
dans la maison du Chazan. La longueur (p. 94) de la statue est de vingt cubits (coudées ?) : on y voit une
femme vêtue avec un panier sur sa tête dans lequel se trouve un petit garçon. Toute la pierre est noire. Le
roi ordonna qu’on devrait la mettre à l’extérieur et l’ériger dans la rue.
En une fois, l’eau monta et inonda presque toute l’Égypte ; les eaux atteignirent alors ses limites, puis
diminua. »66
65 Shatzmiller, J., « Récits de voyage hébraïques au Moyen Âge », dans D. Régnier-Bohler (éd.), Croisades
et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XII-XVIe siècle, Paris, 1997, p. 1289-1290.
66 Traduction : O. V. Volkoff, O. Sennoune.
- 46 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
13e siècle |
`ABD AL-LAṬĪF AL-BAĠDĀDĪ (1200)
MUWAFFAQ AL-DĪN ABŪ MUḤAMMAD B. YŪSUF
‘Abd al-Laṭīf al-Baġdādī, Relation de l’Égypte par Abd-Allatif, médecin arabe de Baghdad, par A.-I. Silvestre
de Sacy, Paris, 1810.
Également connu sous le nom d’Ibn al-Labbād, ‘Abd al-Laṭīf al-Baġdādī, savant aux connaissances
encyclopédiques, naît et meurt à Bagdad (1162-1163/1231-1232). Il y étudie la grammaire, le droit, les
traditions, etc. En 1189-1190, il se rend à Mossoul (Arḍ al-Ǧazīra, au nord de l’Iraq) pour y étudier la
philosophie, les sciences naturelles et l’alchimie. Ses voyages le mènent, entre autres, à Damas, à
Jérusalem et au Caire où Il est témoin de la famine et de la peste qui désolent l’Égypte dans les années
1200-1201. Il étudie presque tous les domaines des connaissances de l’époque. Son oeuvre renferme une
courte description de l’Égypte.67
Observations générales sur l’Égypte
p. 3 :
« … À Alexandrie et dans les lieux voisins, les pluies sont extrêmement abondantes. »
p. 5-6 :
« Ses habitants sont privés du vent d’est par la chaîne de montagnes qui ferme l’Égypte à l’orient, et que l’on
nomme Mokattam : cette montagne les empêche de jouir de ce vent bienfaisant ; et il est bien rare qu’ils
reçoivent le souffle du vent d’est pur, si ce n’est obliquement. Ce fut sans doute pour cette raison que les
anciens Égyptiens choisirent, pour la résidence de leurs rois, Memphis, et les lieux qui, comme Memphis,
sont les plus éloignés des montagnes orientales et les plus rapprochés de la chaîne occidentale. Par la
même raison, les Grecs choisirent la situation d’Alexandrie, et au contraire ils évitèrent celle de Fostat, parce
qu’elle est voisine du Mokattam. »
p. 31-32 :
« Au nombre des végétaux propres l’Égypte, est une pomme68 qui se trouve à Alexandrie, dans un jardin
nommé Bostan-alkita ; elle est très petite, d’un rouge foncé, d’une odeur au-dessus de tout ce qu’on peut
dire et supérieure à celle du musc. Cette espèce de pomme est très rare. »
p. 181 :
« J'ai vu à Alexandrie, sur le rivage de la mer, au milieu des édifices, deux obélisques plus grands que les
obélisques d'Aïn Shams, dont je viens de parler, mais inférieurs aux deux grands. »
p. 182-184 :
« J'ai vu à Alexandrie la colonne nommée Amoud-alsawari69. Elle est de granit, de cette pierre rouge,
tiquetée, qui est d'une extrême dureté. Cette colonne est d’une grosseur et d’une hauteur surprenantes : je
n’aurois pas de peine à croire qu’elle a soixante-dix coudées de haut ; son diamètre est de cinq coudées ;
elle est élevée sur une base très grande et proportionnée à ses dimensions. Sur le sommet de cette colonne
est un grand chapiteau, qui n’a pu être ainsi placé avec une juste précision sans une profonde connoissance
de la mécanique et de l’art d’élever de grands poids, et une extrême habileté dans la géométrie pratique. Un
homme digne de foi m’a assuré avoir mesuré la périphérie de cette colonne, et l’avoir trouvé de soixantequinze
empans de la grande mesure.
J'ai vu aussi sur les bords de la mer, du côté où elle avoisine les murailles de la ville, plus de quatre cents
colonnes brisées en deux ou trois parties, dont la pierre était pareille à celle dont est faite la colonne des
piliers, et qui paroissoient être, à celle-ci dans la proportion d'un tiers, ou d'un quart. Tous les habitants
d'Alexandrie, sans exception, assurent que ces colonnes étaient dressées autour de la colonne des piliers,
mais qu'un gouverneur d'Alexandrie, nommé Karadja, qui commandait dans cette ville pour Youssouf, fils
d'Ayyoub [Saladin], jugea à propos de renverser ces colonnes, de les briser et de les jeter sur les bords de la
mer, sous le prétexte de rompre l'effort des flots et de mettre ainsi les murailles de la ville à l'abri de leur
violence, ou d'empêcher les vaisseaux ennemis de mouiller contre les murs. C’étoit agir en enfant, ou en
homme qui ne sait pas distinguer le bien du mal.
J'ai vu pareillement, autour de la colonne des piliers, des restes assez considérables de ces colonnes, les
uns entiers, les autres brisés ; on pouvait juger encore par ces restes, que ces colonnes avaient été
couvertes d'un toit qu'elles soutenaient. Au-dessus de la colonne des piliers est une coupole supportée par
cette colonne. Je pense que cet édifice était le portique où enseignait Aristote, et après lui ses disciples ; et
que c'était là l'académie que fit construire Alexandre quand il bâtit cette ville, et où étoit placée la
bibliothèque que brûla Amrou ben-Alâs, avec la permission d’Omar.
Le phare d’Alexandrie est trop connu pour qu’il soit besoin d’en parler. Des écrivains exacts assurent qu’il a
deux cent cinquante coudées de hauteur.
J’ai lu une note écrite de la main d’un homme curieux et exact, qui portoit qu’il avoit mesuré la colonne des
piliers avec son chapiteau et sa base, et qu’il avoit trouvé leur hauteur au total de soixante-deux coudées et
un sixième ; que cette colonne est élevée sur un monticule haut de vingt-trois coudées et demie ; ce qui,
réuni à la hauteur de la colonne, donne en tout quatre-vingt-cinq coudées, et celle du chapiteau de sept
coudées et demie. Suivant la même note, ce même personnage avoit pris aussi les mesures du phare, et
avoit trouvé sa hauteur totale de cent trente-trois coudées : des trois étages dont il est formé, le premier, qui
est carré, a cent vingt-une coudée et demie ; le second est à huit pans et porte quatre-vingt-une coudées et
demie ; le troisième, qui est de forme circulaire, a trente-une coudées et demie. Au-dessus du phare s’élève
une chapelle qui a environ dix coudées de hauteur. »
p. 205 :
L’auteur cite un passage de Galien :
« Quiconque veut bien connoître de quelle manière les os sont disposés, ne sauroit mieux faire que d’aller à
Alexandrie, pour y voir les cadavres anciens que l’on y conserve. »
67 Stern, S. M., « ‘Abd al-Laṭīf al-Baghdādī », EI2 I, Leyde, Paris, 1991, p. 76.
68 « Il paroît que les pommiers dont parle ici Abd-allatif, étoient des arbres étrangers à l’Égypte, cultivés dans
un jardin particulier à Alexandrie. » Note de A.-I. Silvestre de Sacy.
69 La colonne des piliers.
- 47 - 48 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
THETMAR (1217)
Saint-Génois, J. de, Voyages faits en Terre-Sainte par Thetmar en 1217 et par Burchard de Strasbourg en
1175, 1189 ou 1225, Bruxelles, 1861.
Le texte de Gérard Burchard (1175), publié par Youssouf Kamal (voir ci-dessus), et celui de Thetmar (1217),
présenté dans l’édition de Jules de Saint-Génois, ont de grandes similitudes. Cependant, il convient
d’attribuer la paternité de ce récit à l’évêque Burchard (1175) puisque dans les manuscrits du XIIIe siècle,
Thetmar ne cite Alexandrie que pour donner la distance entre cette ville et Babylone (Fostat).
Remarque : le texte qui suit a faussement été attribué à Thetmar.
p. 53 :
« La ville d’Alexandrie
Alexandrie est une ville hors du commun par ses édifices, ses boulevards et la multitude innombrable de ses
portes. Elle est peuplée de Sarrasins, de Juifs et de Chrétiens ; elle est sous l'autorité du roi de Babylone. Le
premier état de cette ville, comme il appert de ses vestiges, a été immense. Elle s'étendait en effet sur
quatre milles en longueur, et en largeur, sur un mille. On sait qu'une dérivation de l'Euphrate la touchait sur
un côté, et que sur l'autre côté, la Grande Mer l'appuyait. Actuellement cette ville rétrécie du côté de la mer,
et elle est séparée par une grande plaine du bras du sus-dit Nil. Car il faut savoir qu'Euphrate et Nil ne sont
qu'un seul et même (cours) d'eau. Et dans Alexandrie chaque race d'hommes observe sa propre loi. Cette
ville est très saine : j'y ai en effet remarqué un grand nombre de vieillards. Cette ville a été fortifiée par une
muraille ordinaire, et est sans fossés. Il faut encore savoir que le sus-dit port d'Alexandrie fait rentrer
annuellement, à titre de péage, deux mille pièces d'or, qui font plus de sept mille marks d'argent pur. Une
gent cosmopolite peuple cette ville, avec ses marchandises. D'eau douce, cette ville n'a que celle du sus-dit
Nil, qu'elle recueille dans ses citernes au moyen d'un aqueduc70 une fois par an. Dans cette même ville se
trouvent plusieurs églises chrétiennes, au nombre desquelles l'église Saint-Marc l'Évangéliste, qui se situe
hors les murs de sa nouvelle enceinte, en surplomb sur la mer. Et j'y ai vu dix-sept memorials plein du sang
et des os de saints martyrs mais on ne connaît pas leurs noms. J'y ai aussi vu une chapelle dans laquelle ce
même évangéliste Marc rédigea son évangile et subit son martyre, ainsi que le lieu de sa sépulture. C'est
dans cette église que le patriarche est élu et sacré, et quand il meurt, c'est en ce même lieu qu'il est
enseveli. Car cette chrétienté a un patriarche particulier, qui obéit à l'église grecque. Dans cette même ville
se trouvait à une certaine époque le palais de Pharaon, érigé sur d'énormes colonnes de marbre dont les
vestiges sont encore visibles. De même, j’ai vu tout près d’Alexandrie où le Nil a l’habitude de déborder, et,
d’irriguer et de fertiliser l’Égypte entière parce que la pluie est rare. Or il commence à déborder au mois de
juin jusqu’à la fête de la Croix et à partir de cette date jusqu’à l’Épiphanie du Seigneur. Jamais l’eau ne va
vite en décroissant. »71
Remarque : le texte qui suit a faussement été attribué à Gérard de Burchard.
p. 59 :
« La ville d’Alexandrie
Alexandrie est une ville hors du commun, pleine de beaux édifices. De cette ville et de la situation de cette
province, Maître Thetmar fait un exposé. Et pour ma part, j'atteste que ce que cet homme là a publié est
vrai. »72
70 Ou "par adduction".
71 Traduction : G. Favrelle.
72 Traduction : G. Favrelle.
- 49 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JUDA HARIZI (vers 1218)
Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/4, Leyde, 1934.
Juda ben Solomon ben Hophni al-Harizi est un poète juif d’origine espagnole. Dans son ouvrage
« Tahkemoni » (Le Sage), il donne quelques notices sur ces voyages en Égypte et en Palestine. Ses dates
de naissance et de mort ne sont pas connues. D’après son récit, on sait qu’il se trouve à Jérusalem en
1218.73
Remarque : texte incomplet.
p. 935 verso :
« De là je pris la route de la mer vers les pays de l’Orient, où brille la gloire de l’Éternel, en premier lieu la
ville d’Iskandariya, où vivent des hommes de sagesse et de science, qui pratiquent beaucoup de
bienfaisance et qui remplissent les mains vides… De là je partis en bateau sur l’eau, et je passai par devant
Misrayim. »
73 Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/4, Leyde, 1934, p. 935 verso.
- 50 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHAU JU-KUA (avant 1278)
Chau Ju-Kua, Chau Ju-Kua : his work on the chinese and Arab Trade in the twelfth and thirteenth centuries,
par F. Hirth et W. W. Rockhill, Islamic World in Foreign Travel Accounts 73, Francfort-sur-le-Main, 1996.
L’auteur, d’origine chinoise, inspecteur du commerce maritime, est un membre de la famille impériale de la
grande dynastie Sung qui régne jusqu’en 1278. Son ouvrage, Les livres où l’on décrit les pays étrangers, est
mentionné vers 1297.74
p. 146 :
« The country of O-kon-t’o belongs to Wu-ssi-li (Egypt). According, in olden times a stranger, Tsu-ko-ni75 by
name, built on the shore of the sea a great tower under which the earth was dug out and two rooms were
made, well connected and very well secreted. In on vault was grain, in the other were arms. The tower was
two hundred chang high. Four horses abreast could ascend to two-thirds of its height. In the center of the
building was a great well connecting with the big river.
To protect it from surprise by troops of other lands, the whole country guarded this tower that warded off the
foes. In the upper and lower parts of it twenty thousand men could readily be stationed to guard, or to sally
forth to fight. On the summit there was a wondrous great mirror ; if war-ships of other countries made a
sudden attack, the mirror detected them beforehand, and the troops were ready in time for duty.
In recent years there came (to O-kon-t’o) a foreigner, who asked to be given work in the quard-house of the
tower ; he was employed to sprinkle and sweep. For years no one entertained any suspicion of him, when
suddenly one day he found an opportunity to steal the mirror and throw it into the sea, after which he made
off. »
74 Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, III/5, Leyde, 1935, p. 1052 verso.
Parias, L.-H. (dir.), Les explorateurs des pharaons à Paul-Émile Victor, Paris, 1958, p. 191.
75 Personnage identifié à Alexandre.
- 51 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
IBN RUŠAYD AL-FIHRĪ AL-SABTĪ (jusqu’au 31 août 1285)
ABĪ `ABD ALLĀH MUḤAMMAD B. `UMAR B. RUŠAYD AL-FIHRĪ AL-SABTĪ
Ibn Rušayd, Relation de voyage d’Ibn Rusayd. Alexandrie et Misr, Tunis, 1981. (En arabe)
Juriste et homme de lettres, Ibn Rušayd naît en 1259 à Ceuta où il étudie les sciences de la tradition et de la
grammaire. En 1285, il accomplit le pèlerinage, puis, en 1292-1293, il se rend dans le royaume naṣride pour
assumer les fonctions d’imam et de prêcheur dans la grande mosquée de Grenade. Plus tard, il y est
nommé cadi. Après l’assassinat de son protecteur, il gagne la cour des Mérinides où il dirige la prière dans la
vieille mosquée de Marrakech. Il meurt à Fès en 132176.
Dans son récit, Ibn Rušayd présente dix cheikhs d’Alexandrie : Ibn Sāṭir al-Būnī al-arābī, Ibn al-Tūnsī, Ibn
Manṣūr al-Hamazānī, Miṯqāl al-Ḥabašī, Ibn Manṣūr al-Anṣārī, Al-Makīn al-Asmar, Muḥammad b. Makīn
b. al-Ḫatīb, Al-Ḫazraǧī, Ibn Hilāl al-Tamīmī al-Qamāḥ, Al-Ġurāfī. Dans la traduction qui suit, nous nous
limiterons au passage concernant le premier personnage ainsi qu’à la partie décrivant les merveilles de la
ville.
Remarque : texte incomplet.
p. 7-12 :
Aussi nous rencontrâmes à la ville frontière d’Alexandrie Ǧamal al-Dīn Abū `Abd Allāh Muḥammad b. Abī
`Alī Ḥassān b. Abī Muḥammad `Abd al-Malik b. Muḥammad b. Sāṭir al-Būnī al-Šarābī al-Munṭabib. C’est un
cheikh de caractère hargneux, vaniteux et sans compréhension. Il a des certificats d’audition et des
autorisations à transmettre. Il m’a autorisé, moi et mes fils, à transmettre les livres qu’il enseignait, il a écrit
ceci de sa main. Il a écrit qu’il est né le 11 de ǧumādā 1er en 621 à la ville frontière d’Alexandrie. (p. 8) Il a
écouté la lecture du livre Al-Arba`īn al-buldāniyyaa de Silafī par le maître al-Ṣafrāwī, il a écouté le livre
Al-Ḫuli`iyyāt d’Ibn `Imād al-Harranī, à qui il a donné l’autorisation de transmettre (des écrits) à plusieurs
maîtres.
Parmi ceux qui lui donnèrent l’autorisation de transmettre tous les livres qu’ils avaient étudiés et qu’ils
avaient classifiés et tout ce qu’ils avaient écrits en vers et en prose, (on compte) : Abū al-Qāsim `Abd
al-Raḥmān b. `Abd al-Maǧīd b. Ismā`īl b. Ḥafṣ al-Ṣafrāwī, qui est né au mois de muḥarram 544.
De la même façon, il a été autorisé pour la même chose par Abū al-Faḍl Ǧa`far b. `Alī b. Abī al-Barakāt
Ǧa`far b. Yaḥya al-Ḥamadānī qui est né le 10 du mois de Ṣafar 546.
(p. 9) De la même façon, il a été autorisé pour la même chose par Muḥammad b. Abī al-Ma`ālī `Imād
b. Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Ḥarrānī. De la même façon, il a été autorisé pour la même chose par
Muḥammad b. `Abd Allāh b. Maḥmūd b. Muḥammad al-Ḥusaynī.
De la même façon, il a été autorisé pour la même chose par `Abd al-Wahhāb b. Ẓāfir b. `Alī connu sous le
nom de Ibn Rawāǧ et qui est né en 554.
Parmi ceux qui lui donnèrent l’autorisation et qui lui octroyèrent verbalement l’autorisation de transmettre,
(on compte) : Ḥassān b. Abī al-Qāsim b. Ḥassān b. Muḥammad b. `Abd al-Wāhad al-Ǧahnī et Abū `Abd
Allāh Muḥammad b. Ibrāhīm b. `Abd al-Raḥmān b. Muḥammad al-Anṣārī connu comme Al-Ǧirǧ al-Tilmsānī,
né en 564 à Tlemcen ; Abū al-Riḍā `Alī b. Zayd b. `Alī al-Basārsī, qui dit être né en 560 à Alexandrie ; Nāṣir
b. `Abd al-`Azīz b. Nāṣir b. `Abd al-`Azīz qui écrivit à Ibn Sāṭir en 624 et qui dit être né au mois de Ramaḍān
le Vénéré en 559 à la ville frontière d’Alexandrie ; `Abd al-`Azīz b. `Abd Allāh b. `Alī, né en 555 ; Abū
al-Manṣūr Ẓāfir b. Ṭahir Ẓāfir b. Ismā`īl b. al-Ḥakam (p. 10) b. Ibrāhīm b. Ḫalaf connu comme Ibn Šaḥm
al-Muṭarraz, qui dit être né en 554 à la ville frontière d’Alexandrie ; `Abd al-Raḥmān b. Muqarrab b. `Abd
al-Karīm b. al-Ḥasan b. Muqarrab al-Nuǧaybī, qui a mis par écrit (l’autorisation) le 25 de Šawwāl 629, `Abd
al-Ḫāliq b. Ṭarḫān al-Qurašī ; Ḥusayn b. Yūsuf b. al-Ḥasan al-Šaṭbī ; `Abd al-`Azīz b. `Abd al-Wahhāb
b. Ismā`īl b. `Awf né en 567 ; Muẓaffar b. `Abd al-Malik b. `Atīq ; `Abd al-Raḥmān b. Mākī b. al-Ḥāsib,
petit-fils d’al-Faqīh al-Ḥāfiẓ c’est-à-dire Al-Silafī ; Šuʿayb b. Yaḥya b. Aḥmad b. Muḥammad b. `Aṭiyya
al-Za`farānī ; `Abd al-Salām b. al-Ḥusayn b. `Abd al-Salām ; (p. 11) `Alī b. Muḫtār b. Naṣr al-`Amirī puis
al-Qāhirī ; Muḥammad b. `Umar b. Mālik b. al-Ma`āfirī, qui réside à Alexandrie et qui lui a écrit de sa main :
"moi pauvre serviteur, je suis né au début du mois de muḥarram en 548 dans la ville de Fès" ; Hiba Allāh
b. Muḥammad b. al-Ḥusayn b. Mufarraǧ b. Ḥātim al-Maqdisī. Ceci est ce que j’ai examiné au sujet des
maîtres qui lui ont donné des autorisations autographes. Que Dieu accorde à tous, sa miséricorde !
Moi Abū `Abd Allāh Muḥammad b. Abī `Alî al-Būnī al-Šarābī d’Alexandrie, j’ai lu devant lui et n’ai lu que ce
hadith car il n’avait pas envie de continuer. Je lui ai dit : Abū al-Qāsim al-Ṣafrāwī vous a rapporté
verbalement de Abū al-Ṭāhir al-Silafī al-Ḥāfiẓ, de Abū al-Ḥasan Ḥamd b. Ismā`īl b. Ḥamd al-Hamaḏānī
al-Zakī né à La Mecque en 497, de Abū Ṭālib Muḥammad b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Ġaylān al-Bazzār né
à Bagdad, de Abū Bakr Muḥammad b. `Abd Allāh b. Ibrāhīm al-Šāfi`ī, de Ibrāhīm b. Isḥāq al-Ḥarbī, de
Sulaymān b. Dāwūd al-Hāšimī (p. 12) de Ibrāhīm b. Sa`ad, de Ibn Šihāb, de Al-Qāsim et de `A’iša – que
Dieu soit satisfait d’elle ! – qui a dit : "Je me suis baignée avec Muḥammad en puisant l’eau dans le même
récipient, que la bénédiction et le salut soient sur lui."
Ce hadith est le premier du livre Al-Arba`īn al-Buldāniyya (Les quarante pays) de Ḥāfiẓ Abū Ṭāhir al-Silafī –
que Dieu lui accorde sa miséricorde !
[…]
(p. 92) Nous visitâmes à Alexandrie – que Dieu Tout Puissant la garde ! – le tombeau de l’imam ascète,
savant et dernier des grands mémorisateurs du Coran, Abī al-Tāhir al-Silafī, qui se trouve à l’intérieur [des
murs] près de la Porte verte ; son tombeau a une grande et haute coupole. Près de ce tombeau se trouve
celui de l’ascète, jurisconsulte, imam Abī Bakr al-Ṭurṭūšī, – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! Sur le
tombeau d’Al-Ṭurṭūšī est écrit : "l’imam ascète Abū Bakr Muḥammad b. al-Walīd al-Fihrī est mort au mois de
ǧumadā II 52077." Près du mur ouest, il y a le tombeau que l’on dit être celui de `Abd al-Raḥmān b. Hurmuz
al-A`raǧ – que Dieu lui accorde sa miséricorde !
J’ai lu – dans un abrégé qui a été extrait du livre Mašyaḫā du cheikh transmetteur et savant Abī `Abd al-Allāh
Muḥammad b. `Abd al-Raḥmān b. `Alī al-Tuǧībī al-Andalusī (p. 93), qui réside à Tlemcen, et sur lequel il y a
son écriture à la façon du maître Al-Silafī – ce qui suit à la lettre : "parmi ceux qui ont été ses étudiants à
Alexandrie, il y a le grand maître Abū `Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad al-Rāzī connu sous le nom d’Ibn
al-Ḥaṭṭāb, ce cheikh fait autorité, c’est un grand transmetteur ; ses chaînes de transmission remontent très
loin. Nos maîtres ont écouté (son savoir) devant lui à Alexandrie, ces mêmes maîtres qui nous ont transmis
les hadiths de Abī `Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad le susmentionné ; le cheikh guide, jurisconsulte, ascète
Abū Bakr Muḥammad b. al-Walīd al-Ṭurṭūšī de la doctrine malikite ; le cheikh Abū al-Ḥusayn Yaḥiya
b. `Ubayd b. Sa`āda al-Ǧublānī, transmetteur du jurisconsulte ascète Abī Bakr Muḥammad b. Ibrāhīm b.
al-Ḥasan al-Rāzī connu sous le nom d’Al-Ḥanīfī – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! – qui a étudié la
jurisprudence d’après l’école d’Abū Ḥanīfa – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! – et qui a accompli des
prodiges célèbres. Son tombeau, le tombeau d’Abī Bakr al-Ṭurṭūšī et le tombeau d’Abī `Abd Allāh al-Rāzī
al-Ḥaṭṭāb – que Dieu soit satisfait d’eux ! – se trouvent dans le cimetière de Wa`la qui se trouve dans les
murs d’Alexandrie près de la vieille mosquée de `Amr b. al-`Aṣ – que Dieu soit satisfait de lui !"
Notre cheikh Al-Ḥāfiẓ al-Silafī – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! – disait : "je n’ai jamais vu dans aucun
pays que j’ai visité un ensemble de trois tombes d’imams de trois doctrines différentes que dans le cimetière
de Wa‘la à Alexandrie." Les tombes de ces trois imams de trois doctrines différentes se trouvent côte-à-côte
dans ce cimetière susmentionné : le tombeau d’Ibn al-Ḫaṭṭāb al-Šāfi`ī, le tombeau d’Abī Bakr al-Ṭurṭūšī
(p. 94) al-mālikī et le tombeau d’Abī Bakr Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḥanīfī – que Dieu leur accorde sa
miséricorde ! Nous en avons fini avec ce qu’a rapporté Al-Tuǧībī – que Dieu lui accorde sa miséricorde !
Dans ce lieu dans lequel il décrit le tombeau d’Al-Ṭurṭūšī à Kūm Wa‘la se trouvent d’autres tombeaux. Mais
nous n’avons visité que le tombeau d’Abī Bakr al-Ṭurṭūšī car il n’y avait personne avec nous pour nous
renseigner sur les autres (tombeaux) qui étaient là avec lui. Que Dieu accorde sa miséricorde à
l’assemblée !
Avertissement important : l’imam Abū `Amr b. al-Ṣalāḥ – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! – dit :
"Quiconque descendant de Banū Ḥanīfa ou est adepte de la doctrine d’Abū Ḥanīfa s’appellent Ḥanafī."
Muḥammad b. Ṭāhir al-Maqdisī et beaucoup de traditionnistes faisaient la différence entre les deux et
disaient que la doctrine s’appelait Ḥanīfī. À propos d’une personne qui appartient à l’école, on dit "Ḥanīfī",
qui s’écrit avec un yā’. Je n’ai trouvé cela chez aucun grammairien sauf chez Abī Bakr b. al-Anbārī qui l’a
écrit dans son livre Al-Kāfī. Muḥammad b. Ṭāhir possède sur ce sujet un livre Al-Ansāb al-Muttafaqa. Les
propos d’Ibn al-Ṣalāḥ sont terminés – que Dieu lui accorde sa miséricorde !
Parmi les merveilles d’Alexandrie, il y a le phare que personne ne peut décrire. Celui qui essaie est
désorienté. Son intérieur est plus colossal que son extérieur. Il fait partie des merveilles construites et des
choses étranges du monde visible. Un de nos compagnons a pris ses mesures, le côté de la mer mesure
plus de 120 pas. Quelques personnes m’ont dit que l’on a pris sa hauteur avec un astrolabe. La base
mesure 60 tailles d’homme, le niveau médian mesure 40 tailles d’homme et le dernier niveau (p. 95) 20.
Dieu seul le sait.
Parmi les autres merveilles qui désorientent l’esprit en raison de leur hauteur et qui fatiguent les yeux de
celui qui regarde, il y a la colonne qui est connue comme étant la colonne des colonnes. Elle se trouve à
l’extérieur de la porte de la ville. Elle est dressée à partir d’une base et, à son sommet, il y a une autre base.
Quelques personnes ont mesuré sa hauteur en ma présence, nous avons trouvé 130 empans. J’ai pris moimême
la mesure de la base qui mesure 19 empans de chaque côté.
La lune du mois de ǧumādā II est apparue la nuit du dimanche quand nous étions à Alexandrie. Nous
partîmes d’Alexandrie en fin de matinée le samedi 28 de ǧumādā II78 vers Sudd al-Ḫalīǧ79. Ce lieu est connu
parmi eux comme étant Ṭalamšūš80 et se trouve à 40 milles d’Alexandrie. Nous arrivâmes le dimanche 29
quand la lune du mois de Raǧab I apparut le lundi – que Dieu nous en rende heureux ! – À cet endroit, nous
sollicitons la faveur de Dieu et qu’Il nous préserve de la difficulté ! Nous restâmes dans ce lieu jusqu’au
lendemain mardi, puis nous embarquâmes sur le Nil. Nous voyageâmes dans la félicité de Dieu et de sa
bénédiction. Nous arrivâmes à Miṣr dans la nuit du dimanche 7 du mois de Raǧab81 au crépuscule. Nous
passâmes la nuit au bord du Nil et nous débarquâmes le dimanche matin louant Dieu et le remerciant. »82
- 52 - 54 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
DEVISE DES CHEMINS DE BABILOINE (1289-1291)
Michelant, M. et Raynaud, G., Itinéraires à Jérusalem et descriptions de la Terre Sainte rédigés en français
aux XI, XII, XIII siècles, Genève, 1882.
L’auteur anonyme de ce manuscrit donne le relevé des forces dont disposent les infidèles, puis décrit avec
détails les diverses routes par lesquelles on peut pénétrer jusqu’au Caire. Deux routes conduisent
d’Alexandrie à Babylone (Le Caire). L’une appelée Ṭarīq al-Wasṭā (la route du milieu) traverse la partie
cultivée de la Moyenne-Égypte, l’autre portant le nom de Ṭarīq al-Ḥaǧīr (la route rocailleuse) côtoie le désert
de Libye.83
p. 250-251 :
« D’Alixandrie iusques en Babiloine sy a II chemins :
L’un est communaulment mult usé de marchans & d’autres gent qui vont d’Alixandrie en Babiloine. »
(Itinéraire de ville en ville)
« Item l’autre chemin qui part d’Alixandrie iusques à Babiloine, costeant au desert sanz peril d’aigues ne
passage de flum ; qui voudra monter au Caire & en Babiloine, & là l’ost de Babiloine peut legièrement passer
le flum, si veut avoir la bataille pour ce qu’il ont grant multitude de vaissaus. »
(Itinéraire de ville en ville)
83 Schefer, Ch., « Étude sur la Devise des chemins de Babiloine », AOL II, Paris, 1884, p. 89-101.
- 55 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-‘ABDARĪ (1289)
ABŪ MUḤAMMAD AL-‘ABDARĪ
Al-`Abdarī, Riḥla al-Maġribiyya, Damas, 1999.
Voyageur marocain dont les dates de naissance et de mort ne sont pas connues.84
p. 210-215 :
Évocation d’Alexandrie
Après avoir mémorisé la description de ce lieu, et lorsque nous avons vu que le paysage ressemble à cette
description, Dieu Tout Puissant nous a donné la grâce de quitter ce désert et d’arriver à la ville frontière
d’Alexandrie, cette ville bien munie et solide, ville au terrain étendu, aux fondements sûrs et aux belles
constructions.
(p. 211) Alexandrie ne fut jamais dégradée par le temps, elle n’a jamais témoigné de faiblesse à son égard,
n’a jamais perdu de sa valeur, ne serait-ce qu’un jour ou une heure. Elle résista à la force du temps comme
une héroïne. Elle résista à tous ses complots jusqu’à ce que ses sortilèges diminuèrent et disparurent. Elle
ne prêta oreille ni aux insultes ni aux mauvaises paroles [du temps]. Alexandrie se tient debout comme une
montagne gracieuse. Elle est haute à l’infini avec un cou droit. Elle étrangle l’infidélité et les infidèles en les
tenant par la gorge et en les transformant de l’état de bien-être à celui d’impur et de trouble. [L’infidélité et
les infidèles] tinrent compagnie à la tristesse comme la rosée à Al-Muḥalliq ; la nuit tomba sur eux suite à
une journée illuminée de bonheur. Le chagrin tomba sur [l’infidélité et les infidèles] et s’enflamma, alors [ces
derniers] devinrent les alliés du regret et dirent : “[cet état est un] substitut dont on ne peut se séparer”. C’est
une ville étendue, d’une bonne construction et d’une belle architecture. Elle dévoile un visage magnifique et
regarde d’un oeil romanesque. Elle a la bouche souriante comme une marguerite qui éclot, comme si
(p. 212) la personne d’Alexandre ne l’avait jamais quittée, comme on peut le voir dans les chefs-d’oeuvre
qu’[Alexandre] a construits et dirigés. Ceci est suffisant pour affirmer que cette ville est une merveille dont la
beauté cache et voile celle des autres villes. La perfection s’y acquitta comme il se devait. La description de
cette ville n’est plus nécessaire puisque les savants l’ont déjà décrite. Que d’encre a coulé sur des pages
blanches pour raconter sa splendeur exemplaire !
Parmi tout ce que j’ai vu de nouveau et d’original, c’est la qualité parfaite de ses portes. Les colonnes et les
seuils des portes excessivement hautes sont faits en pierre taillée. On est émerveillé par sa beauté et par sa
perfection. Toutes les colonnes de la porte sont faites d’une seule pierre ainsi que les seuils et les piédroits.
Le plus étonnant est la façon dont elles ont été posées là malgré leur taille immense. Le cours du temps n’a
rien changé à ces colonnes qui ne sont pas tombées en ruine et sont restées belles et splendides. Les
portes sont parfaitement consolidées, à l’intérieur et à l’extérieur, d’un habillage en fer dont la construction
est des plus précises, meilleures et parfaites.
La colonne des colonnes
Parmi les merveilles, j’ai vu une colonne de marbre qu’on aperçoit et qui est connue sous le nom de la
colonne des colonnes (ʿāmūd al-sawārī). C’est une pierre arrondie, très haute, d’un seul morceau, à la
mesure d’une tour haute. On aperçoit [la colonne] de loin, qui surgit d’une forêt de palmiers, [car cette
colonne est] plus haute que les palmiers. [La colonne] se dresse sur une pierre taillée carrée, grande comme
un mastaba immense ; sa hauteur mesure plus de deux brasses. (p. 213) On ne sait pas comment la
colonne fut érigée sur cette base. On ne sait pas non plus comment elle se maintient malgré les vents et les
tempêtes. Il est impossible de la faire bouger en aucune façon, d’autant plus que sa place est là.
Le phare d’Alexandrie
Quant au phare, les hommes ont écrit suffisamment à son sujet. J’y suis entré et je l’ai contemplé, je n’ai pu
arriver à son sommet qu’avec beaucoup de peine, bien que de l’extérieur il ne paraisse pas aussi haut. Il se
trouve à une distance de plus de trois milles en dehors de la ville, au nord, sur un tell. La mer l’entoure à l’est
et à l’ouest jusqu’à user ses pierres des deux côtés. Le phare est consolidé avec une pierre de construction
solide jusqu’au sommet. Il est encore plus résistant grâce aux grands mastabas solides dont les fondations
furent posées dans la mer. [Les fondations] dépassent le niveau de la mer de trois brasses environ.
La porte du phare est haute à partir du sol de quatre brasses environ. On a bâti des constructions sur son
côté sans qu’elles soient liées à lui. On a posé des planches sur lesquelles on marche jusqu’à la porte ; si on
les enlève, on n’y arrive pas. À l’intérieur, au-dessus de la porte, il y a un endroit spacieux pour la
surveillance de la porte où le gardien se tient et dort. À l’intérieur du phare, il y a de nombreuses pièces que
j’ai vues fermées. La largeur du couloir est de 6 empans et l’épaisseur du mur est de dix empans ; je l’ai
mesurée d’en haut. (p. 214) La largeur du phare d’un angle à un autre est de 140 empans. À son sommet, il
y a un grand ǧāmūr85 et un autre plus petit au-dessus, il y a une belle coupole à laquelle on accède par des
escaliers qui débouchent sur elle et dans laquelle se trouve un mihrab pour la prière.
D’Alexandrie au phare, il y a une terre ferme qui est rattachée au phare. La mer entoure cette terre ferme qui
est rattachée aux murs de la ville. On ne peut donc gagner le phare par la terre ferme qu’en venant
seulement de la ville. Sur cette terre ferme, se trouvent les cimetières d’Alexandrie qui comptent
d’innombrables mausolées et tombeaux d’oulémas et d’hommes pieux.
À propos de ce que les gens ont écrit sur la description d’Alexandrie et de son phare, et à propos des
merveilles qu’ils ont évoquées, leurs écrits sont de toute perfection et témoignent d’une très grande maîtrise
dans leur description. On n’en rajoutera pas sur la finesse de leur présentation. Cependant, maintenant,
c’est une ville dont l’apparence est meilleure que le fond. On voit en cette ville la perfection, mais elle est
comparable à un beau corps sans âme ou à une étoffe fine qui ne couvre personne, ou encore à un fourreau
sculpté d’une épée dont la lame qu’il abritait s’est cassée. La majeure partie de ses habitants n’est rien
d’autre que de la canaille et cherche à nuire gratuitement, ayant une mauvaise moralité et un goût amer. La
haine nourrit leurs coeurs, comme on nourrit les enfants. Le mal et la corruption ont remplacé le bien et la
bonté dans leurs coeurs. Le bienfaisant parmi eux est un verbe qui ne se conjugue pas, et l’étranger parmi
eux est un inconnu indéfinissable ; s’ils le voient, leurs visages deviennent plus sévères. (p. 215) Leurs
visages se transforment comme la monstruosité et la laideur transforment. Ils baragouinent des mots lancés
par les flèches des étrangers barbares. L’envie chez eux est comme un feu embrasé qui a abîmé leur
humeur et a changé leur teint. S’ils entendent que quelqu’un est honnête, c’est un jour de crise. Leur
ignorance les fait taire, ils préfèrent le silence. Si on les questionne, ils se taisent mais ce n’est pas par fierté
ou par humilité. Certains d’entre eux sont rongés par l’envie, leur silence est comme une inertie. Ils
réunissent toutes les descriptions qui enlaidissent et n’embellissent point. Ils s’accordent pour réduire la
mesure et le poids. Si une personne étrangère traite en affaires avec eux, elle ne reçoit que soupçon. Elle
est prise pour cible car chacun d’eux a une flèche qui tombe juste, jusqu’à ce que la personne en question
sorte les mains vides. On ne peut attendre d’eux ni bonté ni repentir ; ils n’ont pas de compassion ou d’esprit
de clan. Quand l’étranger traite avec eux, il n’ose leur demander de ne pas tricher. On se croit dans le plus
beau des pays car la ville possède des qualités pour ses choses anciennes et nouvelles. Mais les personnes
vertueuses dans cette ville sont si rares ; on en compte peu. C’est pour cette raison que [les personnes
vertueuses] se sont unies car elles ne peuvent s’entendre avec le reste. Les personnes vertueuses sont
étrangères parmi la population en toute manière et à tous les égards.
« L’hostilité des Alexandrins envers les pèlerins86
Le plus étrange est le fait qui révèle clairement le manque de religiosité [chez les Alexandrins] qui barrent la
route aux pèlerins et leur font boire de la mer le sel saumâtre de l’humiliation. [Les Alexandrins] font payer la
route [aux pèlerins], ainsi que les passages entre les montagnes. Ils cherchent de leurs mains leurs
richesses. Ils ordonnent de fouiller les femmes et les hommes. Je constatai cela le jour où nous arrivâmes, je
fus fortement surpris et à ce moment je voulus m’enfuir : c’était mon seul but. Quand la caravane arriva, une
bande de cavaliers – que Dieu ne protège pas leurs coeurs méprisables et ne donne aucune proie à leur
lion ! – vint ; ils mirent la main sur les pèlerins ; ils fouillèrent les hommes et les femmes, leur firent subir de
nombreuses injustices et goûter toutes sortes de mépris. Ensuite, ils les menacèrent. Je n’ai vu cette
coutume condamnable et ce trait de caractère blâmable dans aucun autre pays. Je n’ai vu chez personne
une sécheresse de coeur plus grande que chez eux. Ils ont peu d’esprit chevaleresque et de timidité, ils ne
tiennent pas compte de Dieu, Tout Puissant. Ils sont inhumains envers les musulmans. Que Dieu nous
garde de cette impuissance. S’Il le veut, le vicieux se corrigerait et celui qui sombre dans la torpeur se
ranimerait. À cette époque, quand je vis comment agissaient ces gens, je pensai que cette attitude était
récente jusqu’à ce que Nūr al-Dīn Abū ‘Abd Allāh b. Zīn al-Dīn Abī al-Ḥasan Yaḥyā b. al-Šayẖ Waǧīh al-Dīn
Abī ʿAlī Mansūr b. ‘Abd al-‘Azīz b. Ḥabāsa al-Iskandarī me racontât dans la madrasa de son grand-père une
histoire concernant le scandale de leurs ancêtres qui n’étaient pas pieux. Nūr al-Dīn me rapporta un épisode
de son livre dans lequel le pieux cheikh Abū al-`Abbās Aḥmad b. `Amr b. Muḥammad al-Sabtī al-Ḥimiarī, qui
était à la ville frontalière d’Alexandrie en 66287, rapporta ce que le cheikh al-Imām raconta au sujet d’Abū al-
Ḥusayn Muḥammad b. Aḥmad b. Jubayr al-Kanānī, lequel était à la ville frontalière d’Alexandrie en 61188 et
visita Alexandrie dans une grande caravane du Maghreb pour accomplir le pèlerinage. Le chef de la ville
ordonna qu’on les fouillât et qu’on cherchât ce qu’ils avaient entre les mains. On fouilla les hommes et les
femmes. On outragea la pudeur des femmes. Pas un seul ne resta sans être fouillé et n’était épargné. [Ibn
Jubayr] dit : “Lorsque ce groupe de cavaliers vint à moi, j’étais avec des femmes, alors je leur rappelai [aux
fouilleurs] de penser à Dieu en les avertissant ; mais ils ne firent aucun détour et ne prirent pas en compte
mes mots, ils me fouillèrent comme ils fouillèrent les autres. J’invoquai Dieu et j’écrivis ces vers pour
conseiller l’émir des musulmans Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf b. Ayyūb pour lui rappeler, au nom de Dieu, les droits
des musulmans, et le louer”. »89
Louanges
- 56 - 58 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
14e siècle |
MARIN SANUDO TORSELLO (avant 1318)
Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, IV/1, Leyde, 1936.
Marin Sanudo Torsello, (vers 1270-1343), noble vénitien, passe une grande partie de sa vie en Roumanie.
Entre 1318 et 1321, il écrit Liber Secretorum Fidelium Crucis (Le livre des secrets des fidèles de la croix),
véritable projet de croisade contre le sultan, après avoir accompli cinq voyages en Orient au cours desquels
il séjourne à Alexandrie.90
p. 1165 verso et p. 1166 recto :
« De cette tour de Bolcherium jusqu’à la ville d’Alexandrie, en naviguant dans le sud-ouest, on compte
18 milles.
De plus, la susdite Alexandrie est une grande et belle ville, qui possède une pointe de terre au delà de son
enceinte, dont les environs immédiats sont chaque jour inondés par les flots de la mer. Sur cette pointe de
terre s’élève une tour, que l’on appelle communément le Phare, à laquelle la ville d’Alexandrie est reconnue,
comme il est dit ci-dessus. Si un navigateur arrive de la haute mer, du côté de l’orient, ou du côté du
nord-est, ou encore du nord, il pourra apercevoir cedit Phare ; il en sera de même s’il vient du côté du
nord-ouest, et il apercevra ladite tour du Phare, comme suspendue dans un nuage.
Cette ville d’Alexandrie possède deux ports ; l’un, du côté de l’orient, qui est dominé par la susdite tour du
Phare. Si un navigateur veut venir dans ce port, il passera tout près d’un écueil que l’on appelle
communément Mémon, lequel se trouve à distance de cet écueil à la longueur d’une amarre, du côté du
sud, il y a un haut-fond, et il (p. 1166 recto) pourra également se tenir à plusieurs amarres du susdit écueil
de Mémon. L’autre port d’Alexandrie se trouve du côté de l’occident : l’entrée dans ce port est de la direction
de l’occident : si quelque navigateur veut entrer dans cedit port, il faut qu’il s’approche le plus près possible
du rivage de ce front de mer ; l’entrée de ce port se fait par des chenaux. »
90 Weiss, M., « Sanuto, Marin », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie Universelle ancienne
et moderne 40, Paris, 1825, p. 377-378.
- 59 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ABŪ L-FIDĀ (1318)
ISMĀ`ĪL B. `ALĪ MAḤMŪD B. MUḤAMMAD B. TAQĪ AL-DĪN `UMAR B. ŠĀHANṢĀH B. AYYŪB
Abū l-Fidā, Géographie d’Aboulféda, par M. Reinaud, Paris, 1848-1883.
Prince, historien et géographe syrien de la famille des Ayyubides (arrière-neveu du sultan Saladin) Abū
l-Fidā (1273-1331) assiste, à l’âge de douze ans, en compagnie de son père et de son cousin, au siège et à
la prise de Marqab en 1285. Il prend part également aux autres campagnes contre les croisés. En 1299,
lorsque la principauté ayyubide de Hama est supprimée, il demeure au service des gouverneurs mamelouks.
Puis, en 1310, il est nommé gouverneur de Hama. En 1318, il se rend en Égypte où il visite Alexandrie. En
1319-1320, il accompagne le sultan au pèlerinage de La Mecque et à son retour au Caire, il est
publiquement investi des insignes du sultanat et du titre d’al-Malik al-Mu’ayyad, ce qui lui confère une
suprématie sur tous les gouverneurs de Syrie. Il continue à jouir d’une grande réputation de mécène et
homme de lettres, ainsi que de l’amitié du sultan, jusqu’à sa mort à Hama.91
p. 139 (tome II) :
« Alexandrie se trouve au nord de l’Égypte, sur les bords de la mer Méditerranée. »
p. 144-145 (tome II) :
« Entre les monuments les plus curieux de l’Égypte était le phare d’Alexandrie, qui avait cent quatre-vingt
coudées de haut. Ce phare fut bâti pour servir de guide aux navires ; en effet, la côte d’Alexandrie est
basse ; on n’y aperçoit pas (de la mer) des montagnes, ni rien qui puisse servir de signal. Au haut du phare
était un miroir en fer de chine, dans lequel venaient se réfléchir les navires grecs (ce qui mettait le pays à
l’abri de toute surprise de leur part). En conséquence, les chrétiens usèrent d’artifice et enlevèrent le miroir.
Cet événement eut lieu dans le premier siècle de l’islamisme, sous le khalifat de Valyd, fils d’Abd-almalek.
(p. 145) Alexandrie se trouve dans une presqu'île de sables, entre le canal d'Alexandrie et la mer. La
longueur de la presqu'île est d'une demi-marche ; toute la presqu'île consiste en vignobles et en jardins. Le
sol est un sable fin, d'un aspect agréable. Le canal d'Alexandrie lequel vient du Nil, offre un coup d’oeil
enchanteur. En effet, il est encaissé, couvert de verdure sur ses deux rives, et entouré de jardins. C'est au
sujet de ce canal que Dhafer, surnommé Alhaddad, a fait les vers suivants :
Combien de fois il a offert, le soir, à tes yeux, un coup d’oeil qui répandait dans ton coeur la joie la plus vive !
C'est un jardin aussi doux qu'une joue couverte d'un léger duvet ; c'est un ruisseau où la main
rafraîchissante du vent du nord a laissé son empreinte.
Semblables à de jeunes beautés, les palmiers s'y montrent parés de leurs atours ; on prendrait les fruits dont
ils sont couverts pour les pierreries qui ornent le cou des belles.
p. 155 (tome II) :
« 8° Alexandrie.
D’après l’Athoual, 51e degré 54 minutes de longitude et 30e degré 58 minutes de latitude ; d’après le canoun,
52e degré de longitude et 30e degré 58 minutes de latitude ; d’après Ibn-Sayd, 51e degré 20 minutes de
longitude et 31e degré 31 minutes de latitude ; d’après le Resm, 51e degré 20 minutes de longitude et
31e degré 5 minutes de latitude.
Alexandrie se trouve dans le troisième climat, sur les bords de la mer Méditerranée. Là était le phare si
célèbre. On y remarque encore la colonne des colonnes (amoud-alseouâry) dont la hauteur est d'environ
quarante-trois coudées. Le phare s’élevait au milieu des eaux, et la mer l’entourait de toute part. Alexandrie
fut fondée par Alexandre ; c’est de là que lui est venu son nom. Son plan était celui d’un échiquier. C’était
une des villes les plus belles ; les rues étaient disposées en croix, et les étrangers n’étaient pas exposés à
s’y égarer.
Alexandrie est bâtie dans une presqu’île couverte de jardins et de lieux de divertissements ; mais le blé y est
transporté d'ailleurs ; aussi il ne s'y vend pas à bon marché. En effet, le territoire d'Alexandrie consiste en
lacs salés. La ville est entourée d'un mur de pierre et a quatre portes, savoir : la porte de Rosette, la porte de
Sadra et la porte de la mer ; quant à la quatrième porte, elle ne s'ouvre que le vendredi. »
L'auteur mentionne quelques détails sur le commerce de la ville.
(p. 201) « Thorré92… Il s’y fabrique du verre très-pur et des étoffes de laine qu’on transporte à Alexandrie. »
(p. 202) « Casr-Ahmed93… Les habitants exportent des chevaux à Alexandrie. »
(p. 307) « Le fleuve qui coule au midi (la Garonne) est remonté par les navires qui viennent de la mer
environnante avec de l’étain et du cuivre apportés de l’Angleterre et de l’Irlande ; de Toulouse, ces métaux
sont transportés à dos d’animaux à Narbonne, d’où on les expédie sur des navires francs à Alexandrie. »
(p. 134, tome II, 2e partie) « On remarque un golfe appelé Golfe de Maqri94, et que connaissent bien les
voyageurs. On en exporte du bois à Alexandrie et dans d’autres villes. »
91 Gibb, H. A. R., « Abū l-Fidā », EI2 I, Leyde, Paris, 1991, p. 122.
92 Peut-être anciennement Turris Tamalem, dans le Maghreb. Note de M. Reinaud.
93 Petit village du Maghreb. Note de O. V. Volkoff.
94 Le golfe où se décharge le fleuve Aqsou, l’ancien Glaucus. Note de O. V. Volkoff.
- 60 - 61 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
SYMON SEMEONIS (du 14 au 18 octobre 1323)
Deluz, C., « Le voyage de Symon Semeonis d’Irlande en Terre sainte. Symon Semeonis XIVe siècle », dans
D. Régnier-Bohler (éd.), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte,
XII-XVIe siècle, Paris, 1997.
Symon Semeonis est frère mineur du couvent de Clonnel, au sud de l’Irlande. Il fait le voyage en compagnie
de Hugues l’enlumineur.95
p. 972-980 :
« À notre départ de Candie, nous sommes passés devant Scarpanto et avons atteint la célèbre ville
d’Alexandrie, chère à tous les marchands, le jour de la sainte Calixte96 . Cette ville est en Égypte, distante de
Candie de cinq cents milles. À un mille de la ville se trouve le lieu du martyre de saint Marc l’Évangéliste,
patron de Venise. À l’intérieur de la ville, celui du martyre de la glorieuse vierge Catherine, marqué par deux
larges et hautes colonnes de pierre rouge entre lesquelles passe la grand-rue. Les anges portèrent dans
leurs mains le corps de la sainte sur le mont Sinaï qui, aux dires des habitants, est à treize jours de marche
d’Alexandrie.
Dès notre entrée dans le port, selon la coutume, quelques Sarrasins, fonctionnaires du port, montèrent à
bord. Puis il examinèrent soigneusement les marchandises et toute la cargaison du bateau et firent une liste
de tout ce qu’il contenait. Ils retournèrent en ville en emmenant les passagers avec eux, laissant deux
gardes à bord. Puis ils se rendirent auprès de l’émir de la cité, et nous parquèrent entre la première et la
seconde porte. Ils lui firent leur rapport, car aucun étranger ne peut entrer à Alexandrie ni en sortir, aucune
marchandise ne peut être introduite sans la permission et la présence de cet émir. Les gardes laissés dans
le bateau ne le quittèrent que quand il fut entièrement déchargé. Les fonctionnaires en usent ainsi avec
chaque bateau pour voir s’il ne contient pas quelque marchandise qui n’aurait pas été portée sur la liste du
premier inventaire. L’émir reçoit un tribut fixe pour tout ce qui est trouvé dans le navire et consigné dans les
listes et il doit en rendre compte au sultan.
À l’annonce de l’arrivée de notre bateau, l’émir comme c’est l’usage, envoya immédiatement au Caire par un
pigeon voyageur un message pour le sultan. À Alexandrie et dans tous les ports, on trouve ces pigeons, qui
sont élevés dans la citadelle du sultan au Caire où est leur pigeonnier et sont apportés dans des cages par
des courriers spéciaux jusqu’aux ports. Chaque fois que les gouverneurs veulent informer le sultan de
l’arrivée de chrétiens ou de tout autre nouvelle, ils lâchent un pigeon, avec une lettre attachée sous la
queue, et le pigeon ne s’arrête pas avant d’avoir retrouvé la citadelle d’où il a été apporté. On emmène les
pigeons élevés à la citadelle dans les ports, et vice versa. De la sorte le sultan est tenu informé presque
chaque jour de tout ce qui arrive d’important dans ses possessions et les émirs savent les mesures qu’il va
prendre.
Nous, les chrétiens, sommes restés entre les portes dont j’ai parlé du (p. 973) petit matin jusqu’au midi. Les
passants nous crachaient dessus, nous jetaient des pierres, nous injuriaient. Vers midi, selon l’usage, l’émir
arriva, accompagné d’une escorte importante armée d’épées et de bâtons. Il s’assit devant la porte et
ordonna que l’on pesât en sa présence toutes les marchandises qui devaient entrer dans la ville, et qu’on lui
présentât ceux qui désiraient entrer. Les marchands chrétiens et leurs consuls nous présentèrent ainsi que
d’autres. L’émir nous fit questionner par un interprète sur les raisons de notre venue en Égypte et ordonna
que l’on examinât nos livres et toutes nos affaires. Finalement, à la demande pressante du consul, il nous
autorisa à entrer.
En examinant nos affaires, ils virent des images du Crucifix, de la bienheureuse Vierge Marie et de saint
Jean l’Évangéliste que nous avions emportées pieusement d’Irlande. Ils se mirent à blasphémer, à cracher
sur elles et à crier des injures : « Ah ! ce sont des chiens, de vils porcs qui ne croient pas que Mahomet est
le prophète de Dieu, mais qui l’insultent continuellement dans leurs prédications et incitent les autres à faire
de même. Ils racontent des fables mensongères, disant que Dieu a un fils et que c’est Jésus, le fils de Maire. » Il y avait aussi des chrétiens renégats qui, par crainte de la cruauté des Sarrasins, criaient : « Qu’on
les chasse honteusement de la ville et qu’ils retournent dans les pays chrétiens, ou plutôt, idolâtres, d’où ils
viennent. » Ils parlaient ainsi pour plaire aux Sarrasins, mais beaucoup de ces renégats ne le sont que par
force et, dans leur coeur, ils restent fidèles au Seigneur Jésus. Quand le silence fut rétabli, nous avons
répondu : « Si Mahomet est vraiment prophète et seigneur, demeurez en paix avec lui et louez-le. Pour
nous, il n’y a qu’un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, engendré éternellement par Dieu et né de Marie
dans le temps. Nous sommes ses fils et non des espions ; nous voulons visiter pieusement son sépulcre
glorieux et, à genoux, l’embrasser de nos lèvres et l’arroser de nos larmes. »
Après tout cela l’émir ordonna expressément aux marchands de nous conduire au fondaco de Marseille et,
en chemin, nous avons été encore exposés aux injures de la populace. Nous sommes restés cinq jours dans
une chapelle avant d’obtenir un permis pour partir, car les Sarrasins n’aiment guère voir les pauvres
traverser le pays, surtout les frères mineurs, car ils ne peuvent tirer d’eux aucun argent.
À Alexandrie, chaque port chrétien a son fondaco et son consul. Le fondaco est un bâtiment élevé pour les
marchands d’une ville ou d’une région, par exemple, le fondaco de Gênes, le fondaco des Vénitiens, le
fondaco de Marseille, le fondaco des Catalans. Chaque marchand de cette ville ou région doit se rendre à ce
fondaco et y apporter les marchandises qu’il a avec lui, selon les ordres du consul. Ce consul est à la tête de
l’établissement et de tous ceux qui y habitent ; sans son accord et sa présence, aucun marchand de la ville
ou de la région qu’il représente ne peut entrer (p. 974) dans la ville ni y introduire ses marchandises. Il siège
avec l’émir devant la porte dont j’ai parlé plus haut et ne reçoit que les marchands et les marchandises de la
puissance qu’il représente. Il réquisitionne une certaine quantité de ces marchandises à l’arrivée et doit en
rendre compte au moment du départ.
Les Sarrasins agissent ainsi pour protéger avec le plus grand soin leur ville, particulièrement le vendredi où,
durant le temps de la prière, on interdit à tous les chrétiens, de quelque condition qu’ils soient, de sortir de
leurs maisons que les sarrasins ferment et verrouillent du dehors. Dès que la prière est finie, les chrétiens
sont libres de circuler dans la ville pour leurs affaires. Après la prière, quelques Sarrasins vont au cimetière
prier pour leurs morts, les autres se hâtent vers leurs occupations quotidiennes. Quelques-uns ne prient
jamais, ne vont jamais à l’église et travaillent comme si le vendredi était un jour ordinaire.
Les Sarrasins ne jeûnent à peu près jamais, sauf quand ils observent leur ramadan, les trente jours pendant
lesquels, selon eux, le Coran est descendu sur Mahomet. Ils jeûnent tout le jour, jusqu’à ce qu’ils
aperçoivent la première étoile, ils peuvent alors manger, boire et approcher leurs femmes jusqu’à ce que le
jour pointe et permette de distinguer un fil noir d’un fil blanc. Tels sont les préceptes qu’ils ont reçus de ce vil
porc, amateur de femmes, et qui sont contenus dans le Coran.
Ils appellent leurs églises ou oratoires keyentes97 ; ce ne sont pas des églises, mais des synagogues de
Satan. À l’extérieur de chacune on trouve un bassin d’eau dans lequel tous, sans exception, se lavent les
mains, les pieds, les jambes et le postérieur avant d’entrer. Chaque église a aussi une haute tour, comme un
clocher, entourée d’une plate-forme extérieure d’où, à certaines heures, un prêtre crie les louanges du
prophète Mahomet, ce porc immonde, et appelle le peuple à la prière. Entre autres choses, ils clament à
haute voix avec admiration qu’une nuit il s’est uni quatre-vingt-dix fois à neuf femmes. Ils considèrent cela
comme un grand et beau miracle. Ils disent aussi que si Mahomet aimait et désirait l’épouse d’un autre, elle
ne pouvait demeurait avec son mari, mais devait l’abandonner et se hâter sans délai vers la couche du
Prophète.
Ils respectent beaucoup leurs églises et les tiennent très propres. Aucun chrétien ou membre d’une autre
secte n’est autorisé à y pénétrer, sous peine de mort, à moins d’avoir renié le Christ, fils de Marie, et
reconnu Mahomet comme prophète et envoyé de Dieu. Ils tiennent le Christ pour (p. 975) un homme juste et
un très saint prophète, mais refusent qu’il ait souffert la Passion et soit Dieu. Ils ne veulent rien entendre sur
ce sujet et s’en tiennent à ce qui est écrit dans leur maudite loi, le Coran, sourate x : « Prenez bien soin de
ne rien dire d’injuste ou d’indigne concernant votre religion, ni rien de faux sur Dieu, par exemple que Jésus,
fils de Marie, était l’envoyé de Dieu, son Esprit et son Verbe, envoyé du ciel à Marie. Vous ne devez pas dire
non plus qu’il y a trois dieux, car Dieu est l’unique, sans fils, tout-puissant, à qui le ciel et la terre sont
soumis. Mais il ne faut pas nier l’existence du Christ, ni des anges qui sont au service de Dieu. »
Mahomet parle aussi dans le Coran des juifs, qu’il appelle meurtriers des prophètes : « Ils blasphèment
contre Marie en affirmant que son fils, envoyé de Dieu, a été mis à mort ; ils ont suspendu à la croix non pas
lui, mais quelqu’un qui lui ressemblait et Dieu dans son insondable sagesse l’a pris auprès de lui au ciel. »
Ces mécréants, qui nient la divinité et la Passion du Christ, le placent cependant au-dessus de Moïse et de
tous les autres prophètes, excepté Mahomet. Ils l’appellent Messiah Ebyn Meriam, mais jamais Ebyna Allāh,
c’est-à-dire, Fils de Dieu, car ils estiment impossible que Dieu ait eu un fils, puisqu’Il n’a ni femme ni
concubine et ne prend pas de plaisir avec elles.
En ce qui concerne les Paradis et la vie éternelle, ce qu’ils croient est contenu dans un livre intitulé La
Doctrine de Mahomet où il est dit :
« Le Paradis est pavé d’or et de pierres précieuses. Toutes sortes d’arbres fruitiers y poussent et des
rivières de lait, de miel et de vin y coulent. Un jour y dure mille ans et une année, quarante mille. Chaque
désir est immédiatement satisfait. » Les vêtements des élus sont de toutes couleurs, sauf le noir, réservé au
Prophète. Tous ont la taille d’Adam et la conservent ; ils ressemblent à Jésus-Christ. À leur entrée au
Paradis, on leur donne à manger le foie d’un poisson délicieux, allehbut98 , ainsi que les fruits des arbres et
l’eau des fleuves du Paradis. Tout ce qu’ils peuvent désirer leur est aussitôt apporté : ils ont du pain, du vin,
des viandes, mais aucune nourriture défendue, notamment la viande de porc qu’ils détestent. « Si la volupté
était absente de ce lieu, la béatitude ne serait pas complète. » Ils ont aussitôt tout ce qu’ils veulent, quand ils
le veulent, tout à volonté sans aucun délai ni obstacle. « Ceux qui auront eu des épouses fidèles les
retrouveront, les autres seront concubines ; il n’y aura que peu de servantes. » Tout ceci est déclaré par ce
porc de Mahomet, amateur de femmes.
(p. 976) Ces bandits de Sarrasins appellent les Occidentaux Francs, les Grecs Rumi et les Jacobites ou
chrétiens de la ceinture Nysrami, c’est-à-dire Nazaréens. Les moines sont appelés Ruben et les juifs Kelb,
c’est-à-dire chiens. Les juifs sont divisés en plusieurs sectes, certains, nommés en hébreu Rabanym,
observent la Loi selon les Gloses des maîtres ; d’autres, appelés Caraym, observent la Loi à la lettre ;
d’autres enfin, les Cusygym, n’observent pas du tout la Loi. Tous sont méprisés par les Sarrasins : comme
ailleurs, ils sont traités en captifs et, comme si Dieu les avait vendus, ils errent, sans loi et détestés de tous.
Les Jacobites pratiquent la circoncision et pensent que la grâce n’est pas donnée aux enfants lors du
baptême. Ils ne baptisent donc que les enfants en danger de mort, mais baptisent les adultes auxquels ils
donnent la communion au corps et au sang du Christ. Ils ne font le signe de croix qu’avec un seul doigt,
l’index. Beaucoup de leurs cérémonies ne suivent pas le rite de l’église romaine, mais pour les principaux
articles de la foi, ils partagent tout à fait nos croyances et le reconnaissent volontiers dans leurs discussions
avec nous en public comme en privé. Comme nous, ils sont en perpétuel débat avec les Grecs sur la
procession du Saint-Esprit. Ils jugent les Grecs infidèles et les blâment de célébrer l’Eucharistie avec du pain
fermenté. C’est pourquoi un prêtre jacobite ne célèbre jamais la messe sur un autel où a officié un prêtre
grec tant que l’autel n’a pas été consacré à nouveau. Comme ceux des Grecs, leurs prêtres se marient, mais
non les moines, qui suivent la règle de saint Macaire et sont très nombreux dans le désert où ils mènent une
vie d’une austérité presque inhumaine.
La messe que célèbrent les prêtres jacobites est très longue, selon un rite très différent de celui de l’église
romaine. Ils lisent l’épître et l’Évangile en deux langues, en égyptien, qui est pour eux comme le latin pour
nous et dont les lettres ressemblent beaucoup aux lettres grecques, puis en arabe, ou sarrasin, qui est une
langue gutturale, très voisine de l’hébreu. Ils consomment beaucoup de pain et de vin à la messe, car ils
sont toujours sept ou huit prêtres autour de l’autel, surtout les dimanches et jours de fête, avec au milieu
d’eux le patriarche, tel le Christ.
(p. 977) La cité d’Alexandrie est ceinte d’un double rempart, bien fortifiée de tours, de fossés d’un côté et de
machines de guerre. À l’intérieur, il y a deux collines de sable, assez hautes, où montent les habitants quand
ils veulent respirer l’air pur et contempler la mer. Ses portes sont soigneusement gardées, surtout celles qui
font face au port, les deux entre lesquelles on nous a détenus et une troisième par laquelle passe la route du
Caire. C’est une ville très riche où abondent les étoffes de soie précieuse, admirablement tissées de façon
variée, les tissus de lin, de coton, car tous sont fabriqués ici et vendus ensuite dans le monde entier par les
marchands. La ville est dans une plaine au-dessus du port, avec de splendides jardins et vergers. Des
cannes à sucre, des bananiers et toutes sortes d’arbres fruitiers la parent. Il n’est pas facile de la voir depuis
les navires en mer, puisqu’elle est dans une plaine et que toute l’Égypte est plate. Aussi, les habitants ont
construit, sur un rocher à l’entrée du port, une très haute tour carrée du haut de laquelle des vigiles dirigent
les navires vers le port. Entre la tour et la ville, il y a un immense cimetière où sont inhumés les habitants,
riches ou pauvres.
Dans cette ville, vivent des Sarrasins, des Grecs schismatiques, des juifs perfides. À l’exception des
chrétiens appelés Francs, tous sont vêtus de la même manière et ne se distinguent que par la couleur de la
pièce d’étoffe qu’ils portent autour de la tête. Les Sarrasins du peuple portent un vêtement de lin ou de
coton, les nobles sont vêtus de robes de soie et d’or qui ressemblent beaucoup à celles des frères mineurs,
surtout les manches, mais elles sont plus courtes et n’ont pas de capuchon. Ils ne portent en effet pas de
capuchon, mais ils entourent curieusement leur tête d’une toile blanche de lin ou de coton et ne couvrent
pas leur cou. Les juifs Rabanym portent une toile jaune ou écarlate pour être aisément reconnus, et les
chrétiens, sauf les Francs, une bleue ou rouge ; ces chrétiens portent la ceinture dont ils tirent leur nom ; elle
est de soie ou de lin.
Les Sarrasins ne portent pas de ceinture, mais une bande de toile qu’ils déroulent devant eux quand ils
prient. Les nobles et les chevaliers ont de larges ceintures, comme les dames, faites de soie, ornées d’or et
d’argent, dont ils sont très fiers. Ils ne portent pas de chaussures, mais leurs pantalons sont amples et
larges. Tous en portent, petits ou grands, un enfant d’un an comme un vieillard chenu et cela parce qu’ils se
lavent souvent les jambes et le postérieur. Car leur religion diabolique les oblige à faire cinq prières par jour,
sans trop élever la voix. Ils prient à mon avis avec grande dévotion, avec beaucoup d’inclinaisons et de
génuflexions sur leur toile, tournés vers le temple de Dieu selon eux, c’est-à-dire La Mecque. (p. 978) Cette
ville est en Orient, c’est là qu’Abraham a fondé le premier temple en l’honneur de Dieu et qu’il reçut de Dieu
l’ordre de sacrifier son fils Isaac, comme le dit le Coran, sourate II. Avant de prier, ils se lavent les mains, les
bras, les pieds et le postérieur, avec la certitude qu’ainsi leurs péchés sont pardonnés. S’ils se trouvent dans
le désert ou dans un lieu sans eau, ils répandent de la terre propre sur leur tête pour se purifier de leurs
fautes, comme il est écrit dans la sourate XI du Coran. Les Sarrasins n’ont pas de souliers, mais des
sandales rouges qui ne couvrent que le dessus du pied. Il n’y a que les chameliers, les ouvriers et les
pauvres qui portent des souliers semblables à ceux des enfants irlandais. Quant aux cavaliers, ils portent
des bottes rouges ou blanches qui montent jusqu’au genou.
On n’autorise pas les femmes à entrer dans les églises ou dans les lieux de prière. Elles sont cloîtrées à la
maison, à l’abri de toute possibilité de conversation futile, surtout les femmes nobles qui ne sont jamais
autorisées à sortir de chez elles, sauf pour une raison sérieuse. Elles sont vêtues de façon étrange et
étonnante. Toutes sont couvertes d’un manteau de lin ou de coton, plus blanc que neige, et voilées de telle
sorte qu’on peut à peine apercevoir leurs yeux à travers une très fine résille de soie noire. Toutes portent
des tuniques très courtes, s’arrêtant au-dessus du genou. Certaines sont de soie, d’autres de lin ou de
coton, tissées de différentes manières selon leur statut social. Elles portent toutes, notamment les femmes
nobles, des pantalons de soie précieuse tissée d’or qui leur descendent jusqu’aux chevilles, comme ceux
des cavaliers. On juge de la noblesse et de la richesse d’une femme d’après ses pantalons. Certaines
portent des sandales, d’autres des bottes rouges ou blanches, comme celles des cavaliers. Avec leurs
bottes et leurs pantalons, et leurs autres ornements, elles ressemblent tout à fait aux démons que l’on voit
jouer dans les jeux des clercs. Tout ceci est ordonné dans le Coran, sourate XXIII : « Que les femmes
pieuses couvrent leur visage et leur sexe. Cela est bien aux yeux de Dieu, qui connaît tous leurs actes. Que
les femmes couvrent leur cou et leur poitrine, qu’elles cachent leur beauté à tous, à moins que quelque
nécessité les oblige à se montrer, qu’elles cachent la beauté de leurs pieds quand elles marchent et ne se
montrent qu’à leurs maris, leurs parents, leurs fils, leurs frères, leurs neveux et leurs serviteurs.
Convertissez-vous à Dieu qui est bon pour vous. » Autour des chevilles et des bras, elles portent de gros
anneaux d’or ou d’argent où sont inscrits quelques mots de cette maudite loi qu’ils révèrent autant que nous
l’Évangile de saint Jean. Elles se teignent les ongles des mains et des pieds, elles portent des boucles
d’oreilles et certaines un anneau dans (p. 979) le nez, et elles sont très fières de tous ces ornements. Les
femmes schismatiques ou juives sont vêtues et parées de la même façon, si ce n’est que les femmes
schismatiques portent des bottes noires qui permettent de les reconnaître.
Alexandrie semble d’une beauté éclatante, mais ses rues sont étroites, petites, tortueuses, obscures, pleine
de poussière et de saletés et pas du tout pavées. On trouve en ville tout le nécessaire, sauf le vin qui est ici
très cher car les Sarrasins pratiquants n’en boivent jamais, au moins en public. En privé toutefois je les ai
vus boire à en être malades. Le Coran, dans la sourate IV traitant du vin, des échecs, des dés, et des autres
jeux de hasard, dit que c’est un très grand péché de boire et de jouer. La raison pour laquelle ce porc de
Mahomet a interdit le vin se trouve dans La Doctrine de Mahomet. Il y avait deux anges, Baroth et Maroth,
envoyés par Dieu sur terre pour gouverner et instruire le genre humain. Ils interdirent trois choses, tuer, juger
injustement, boire du vin. Au bout de quelque temps, ces deux anges parcoururent le monde entier et une
femme d’une très grande beauté vint les trouver. Elle était en procès avec son mari et invita les anges à
dîner pour qu’ils soutinssent sa cause. Ils acceptèrent. Elle apporta avec les plats des coupes de vin, leur en
offrit, insista pour qu’ils en prissent. Que dire de plus ? Vaincus par la malice de cette femme, ivres, ils
acceptèrent de révéler ce qu’elle leur demandait, que l’un lui apprît les paroles qui leur permettait de
descendre du ciel et l’autre celles qui leur permettaient d’y remonter. Quand elle les sut, elle monta aussitôt
au ciel. À son arrivée, Dieu fit son enquête et fit d’elle Lucifer, la plus belle des étoiles, comme elle avait été
la plus belle des femmes. Quant aux anges, Dieu les convoqua et leur demanda de choisir entre un
châtiment en ce monde, ou dans l’autre. Ils choisirent ce monde et furent jetés, tête la première, attachés à
des chaînes, dans le puits du diable où ils resteront jusqu’au jour du jugement. Voilà ce que raconte ce
faussaire, fils aîné du démon, Mahomet.
On trouve à Alexandrie le pain le meilleur et le plus blanc de toute la région. On vend quatorze beaux pains
pour un gros. Ici, le florin vaut vingt-deux gros vénitiens, le besant d’or, vingt-six, le double d’or, vingt-huit.
L’hyperpère, qui n’est pas d’or pur, vaut douze gros, une drachme et deux caroubes. Un gros de Venise vaut
vingt-deux caroubes, c’est une petite monnaie de cuivre ou de bronze. Deux milliers, qui ne valent rien
ailleurs, valent ici un gros.
(p. 980) Nous avons repris notre route le mercredi après la fête de saint Luc99 . Nous avons traversé, sous
les insultes de la populace, des jardins et des vergers magnifiques, pleins de hauts palmiers et d’arbres
fruitiers, et nous avons atteint, à un mille de la porte de la ville, le port où l’on s’embarque pour Babylone. »
- 62 - 66 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
ANTOINE DE CRÉMONE (1327-1330) (du 5 au 7 décembre)
Röhricht, R., « Antonius de Cremona, Itinerarium ad Sepulcrum Domini (1327-1330) », ZDPV XIII, 1890,
p. 153-174.
p. 163 :
« Je demeurai 35 jours à Damiette, d'où je partis la veille de la Saint André pour gagner Alexandrie où
j'arrivai le 5 du mois de décembre, c'est à dire (le jour de la) fête du saint abbé Saba. À Alexandrie, il y a une
très belle église de cet abbé Saba. À Alexandrie, je visitai les Pâtures bovines, où l'évangéliste Marc fut
traîné et martyrisé puis enseveli, et d'où il a été transporté à Venise. À Alexandrie je visitai l'endroit où fut
décapitée sainte Catherine. D'Alexandrie je partis le 7 décembre pour aller à Babylone. »100
100 Traduction : G. Favrelle.
- 67 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
ḪĀLID B. ‘ISA AL-BALAWĪ (février 1337 et septembre 1338)
Ḫālid b. ‘Isa al-Balawī, TāÏ al-mafriq fī tahlīyat `Ulamā’ al-mašriq, Fès, 1970.
Ḫālid b. ‘Isa al-Balawī (1313-1378) naît à Cantoria où il est cadi comme son père. Il débute son voyage en
1336 et arrive au Caire le 15 février 1337. On peut donc supposer qu’il se trouve à Alexandrie quelques
jours avant cette date. Il décrit Alexandrie à deux reprises, la première fois à l’aller et, la seconde, au retour,
du 20 au 28 septembre 1338.101
Remarque : traduction incomplète.
p. 198-200 (tome I) :
« Les commentateurs mentionnent d’après Abī b. Ka`b, selon la parole de Dieu dans le Coran, qu’Iram Ḏat
al-`Imād est Alexandrie car Alexandrie est la plus merveilleuse des villes, qui possède une construction
merveilleuse. L’auteur de La géographie mentionne qu’elle fut construite en trois cents ans ; que ses
habitants, durant soixante-dix ans, n’y circulaient de jour qu’avec les yeux couverts d’étoffes noires,
craignant de perdre la vue à cause de sa blancheur éclatante. Sur le phare d’Alexandrie se trouve un crabe
de marbre. Le phare repose sur quatre colonnes ; sa hauteur est de trois cents coudées. Les murs de la ville
et son enceinte sont de marbre. Il y a une coupole qui appartenait à un pharaon. Il y a le château de
Sulaymān qui s’est écroulé et ses ruines sont restées. Il y a une colonne qui tourne jusqu’à la fin des temps.
Auparavant, il y avait sur le phare un grand miroir que les sages construisirent ; on observait avec ce miroir
Constantinople et les pays de Rūm jusqu’à ce que (le phare) tombât suite à une ruse et personne ne put
l’empêcher. L’auteur finit ainsi.
Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est sa construction souterraine qui est comme celle du dessus, et même plus
antique et plus solide, parce que l’eau du Nil traverse toutes ses maisons et pénètre dans toutes les
conduites souterraines. Les puits communiquent ainsi entre eux et s’approvisionnent entre eux. J’ai examiné
à Alexandrie des colonnes de marbre et de nombreuses plaques tellement hautes, larges et belles qu’elles
sont inimaginables. Il est possible d’y trouver des colonnes (p. 199) qui témoignent de leur ancienneté mais
on ne connaît ni leur sens ni l’époque de leur érection. On dit que c’était, dans les temps anciens, les
bâtiments des philosophes et des gouverneurs – Dieu seul le sait. Ce qu’il y a de plus merveilleux et de plus
grand à Alexandrie, c’est la colonne des colonnes (ʿāmūd al-sawārī) qui se tient sur une base carrée. Je
comptai sur un de ses côtés plus de onze empans. J’ai lu dans quelques écrits que c’est la plus grande
colonne sur la surface de la terre et qu’elle repose sur un trésor parmi les trésors. Sa hauteur est de
quarante-neuf grandes coudées ; la grande coudée compte deux coudées. Elle ne bougerait pas de son
endroit même si une grande montagne tombait sur elle. Ce qu’il y a également d’extraordinaire à Alexandrie,
c’est son phare qui se trouve à l’extérieur et qui se dresse comme une grande tour dans le haut du ciel :
toute sa base est scellée avec du plomb et est faite de pierres sèches taillées. Ce phare, que Dieu le
puissant a fait ériger, par les mains de celui qui y a été destiné, comme une merveille pour ceux qui le
contempleront, rivalise avec le ciel dans sa grandeur et sa hauteur. Il est un guide pour les voyageurs qui
naviguent sur la mer jusqu’à la côte d’Alexandrie qu’on voit sur plus de soixante-dix milles. La largeur d’un
de ses quatre côtés est de plus de cinquante brasses. On mentionne que sa hauteur est de plus de cent
cinquante qāma-s. J’ai lu chez quelques auteurs de confiance le texte suivant : `Abd Allāh b. `Amr b. al-`Aṣ a
mentionné que que les merveilles du monde sont au nombre de quatre : le miroir du phare d’Alexandrie, au
dessous duquel les gens s’installaient pour voir ceux qui sont à Constantinople alors qu’ils sont séparés par
l’étendue de la mer ; [la seconde merveille est] un cheval de cuivre en Andalousie, avec ses pattes étendues
et ses sabots qui se touchent – derrière moi il n’y a plus de chemin et quiconque marchera sur cette terre
sera englouti par les fourmis ; (la troisième merveille) se trouve sur la terre de `Ad, il s’agit d’un phare en
cuivre surmonté d’un cavalier de cuivre – quand l’eau vient à tomber aux mois sacrés, les gens boivent,
irriguent et versent l’eau dans les citernes ; quand les mois sacrés finissent, l’eau cesse de couler, etc. ; (la
quatrième merveille est) un arbre de cuivre qui se trouve sur la terre de Rūm et sur lequel est perché un
étourneau de cuivre de couleur noire – à l’époque des olives, la couleur noire du cuivre devient jaune ; le
peuple de Rūm presse ce qui lui faut d’huile pour sa peau et ses lampes d’églises jusqu’à l’année suivante.
Ce que mentionna `Abd Allāh b. `Amr b. al-`Aṣ est une nouvelle célèbre qui se trouve dans les livres des
Sages.
Le miroir qui se trouvait sur le phare d’Alexandrie est de source sûre puisqu’il fut cité à plusieurs reprises,
mais le peuple de (p. 200) Rūm le détruisit, parce qu’il en avait peur. Cette ville possède de nombreuses
madrasas et mosquées que l’on ne peut décrire. Al-Hirawī102 mentionne dans quelques-unes de ces
oeuvres ; la ville d’Alexandrie contiendrait 12 000 mosquées. Abū al-Rabī` b. Sālim al-Kulā`ī mentionna dans
son livre Al-Iktifā’ que `Amr b. al-`Aṣ écrivit à `Umar ibn al-Ḫaṭāb – que Dieu soit satisfait de lui ! à l’époque
où il conquit Alexandrie, qu’après avoir conquis la ville, il ne put décrire ce qu’il y avait en elle mais ce qu’il
avait acquis (c’est-à-dire) 4 000 édifices avec 4 000 bains, 40 000 Juifs payant le droit de capitation et
400 costumes de rois. D’après Abī Qubayl, quand `Amr b. al-`Aṣ conquit Alexandrie, il y trouva 12 000
épiciers qui vendaient des légumes frais. (Fin)
(Passages sur les saints et les oulémas d’Alexandrie)
p. 28 (tome II) : du 20 au 28 septembre
« Nous arrivâmes à Alexandrie et nous y entrâmes le dimanche matin du 24 ṣafar103 susmentionné. Nous
descendîmes dans la madrasa connue pour sa science, lieu qui attire les âmes et excite les yeux. Les
bouches et les langues épiloguent sur sa beauté. J’ai hésité à savoir si je partais ou si je restais (à
Alexandrie) et si je retournais par la mer ou si j’y renonçais. L’être humain décide et le destin s’en moque.
Alors que le bateau d’Ibn Ḫalāṣ s’apprêtait pour le voyage jusqu’en Tunisie, on finissait le chargement
pendant que les gens embarquaient. Je me dis y monter comme les personnes y montaient était un
jugement sain, et je me convainquis que la mer était préférable (à la terre) en me disant qu’elle rapproche
les nations ; j’oubliai ainsi la peur de la mer et c’est le diable qui me la fit oublier. Je demandai l’aide de
Dieu-le-Puissant et nous embarquâmes, moi et mon frère Muḥammad, sur la rade du Phare le dimanche
après-midi du 2 rabī` al-Nabawī, jour béni, de l’année susmentionnée 38104. »105
101 Ḫālid b. ‘Isa al-Balawī, Tāǧ al-mafriq fī tahlīyat `Ulamā’ al-mašriq, Fès, 1970, p. 18-24.
102 Le traditioniste Muḥammad al-Mustawfī al-Hirawī (1005-1089) aurait établi une copie de cet ouvrage
composé par Muḥammad b. ‘Alī b. A‘ṯam Kūfā en 926.
103 Le 20 septembre.
104 C’est-à-dire 738 (28 septembre 1338).
105 Traduction : F. Naïm Rochdy, S. Renaud, O. Sennoune, H. Zyad.
- 68 - 69 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
LUDOLPH DE SUDHEIM (1336-1341)
Sudheim L. de, « Ludolph von Suchem’s. Description of the Holy Land », dans The Palestine Pilgrims’ Text
Society, vol. XII, Londres, 1897.
« L’auteur de cet itinéraire était curé de la paroisse de Sudheim, un village aujourd’hui disparu, près de
Büren en Westphalie. Il séjourna assez longtemps en Orient, de 1336 à 1441, où il accompagnait, sans
doute en tant que chapelain, un chevalier au service du roi d’Arménie. »106
p. 45-47 :
XXIV – The cities by the sea
« To return to my subject, one sails from Cyprus to some one of the cities by the sea, in either Egypt or
Syria. These cities are as follows : Alexandria, Tripoli, Beyrout, Byblium, Jaffa, Sidon, Tyre, Acre. Before
going any further I will say somewhat about these, that you may know them. They all have been given
different names to those which they bore of old, after the Holy Land has been lost and won so many times,
and therefore I will say a little about them, that you may know to whose lot these cities fell when the Holy
Land was won by the Christians. You must know that none of these cities are more than a day’s journey
distant from Cyprus. Now, Alexandria is the first seaside city of Egypt, and one of the best of the Soldan’s
cities. On one side it stands on the Nile, the river of Paradise, which falls into the sea close by it, and its other
side is on the sea. This city is exceeding beauteous and strong, and is fenced about with lofty towers and
walls (p. 46) which seem impregnable. It was once inhabited by the Christians, and is now by the Saracens,
and within it is exceeding clean, being all whitewashed, and in the corner of every street it has a fountain of
water running through pipes ; the city is carefully kept clean by watchmen, whose duty it is to see that no dirt
be cast into the streets or fountain by anybody. In this city the Soldan keeps mercenary soldiers and his
bodyguard, who guard the city and harbour. St. Mark the Evangelist was Patriarch in this city, and was
martyred there, and in succession to him there still remains a Christian Patriarch there. In this city there still
stands entire to this day a great and exceeding beauteous church, adorned in divers fashions with mosaic
work and marble, wherein at the request of the Venitians Divine service is celebrated everyday. Indeed,
many other churches are still standing in Alexandria at this day, and in them rest the bodies of many saints.
There are also many Christians and merchants living there. This city appears to the human eye to be
impregnable, and yet it could be easily taken. I do not care to say any more about this matter. This city,
which was of old called Alexandria, is now called Iscandria by its inhabitants. Near Alexandria is a place
where St. Katherine was beheaded, and from whence she was borne by angels to Mount Sinai, a distant of
about eighteen days’journey, and there are many holy places and places of prayer in that city. Not far from
Alexandria there is a village, all of whose inhabitants are Saracen workpeople, who weave mats wondrous
well in divers fashions and with most curious skill. In this place or village stands a fair little church, wherein is
a small grotto. In this grotto it is believed that St. John the Baptist was beheaded. The grotto is believed to
have been a prison, and is known because of the position of the place, which is on (p. 47) the border of
Egypt and Arabia. These same Saracen workpeople guard the grotto with the uttermost care and reverence,
lighting it with lamps and candels, and each one of them according to his means pays some especial
reverence to the church and grotto ; for they firmly believe and say that it has been proved by experience
that if they did not hold the church in such great respect, and were to leave it unlighted for one night, rats
would come forth from the ground and would pull to pieces and spoil all their matwork ; and they say that the
more respect a man shows for the church and grotto aforesaid, the better he succeeds in his work. This
place where the church now stands was of old called Metharonta in Arabic.
p. 78 : « Its people have two brazen columns with marks thereon. One of these they have set up in the
middle of the Nile near babylon, and the other in the Nile near Alexandria, and when the river rises so high
as to touch the marks on the columns, then there cannot be any scarcity for two years to come. Thereupon
the Egyptians lead waters of the Nile through ditches and channels and passages, and cause them to run about their land, their fields, woods, gardens, and orchards, which are then refreshed and watered
throughout, and when the land has been thus watered at night, the corn and grass will have grown more
than a hand’s breadth by morning. »
106 Deluz, C., « Le Chemin de la Terre sainte. Ludolph de Sudheim, XIVe siècle », dans D. Régnier-Bohler
(éd.), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XII-XVIe siècle, Paris, 1997,
p. 1029.
- 70 - 71 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
RODOLPHE DE FRAMEYNSPERG (1346)
Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, IV/2, Leyde, 1937.
p. 1234 :
« Quand l’on descend de Babylone par l’eau douce, on arrive à la ville d’Alexandrie, après cinq jours de
marche accomplis, laquelle ville a été placée dans l’angle formée par l’eau douce et par la mer ; cette ville
est plus grande en étendue que Ratisbonne ».
- 72 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
IBN BAṬṬŪṬA (1325 et 1349)
AMS AL-DĪN ABŪ `ABD ALLĀH MUḤAMMAD B. `ABD ALLĀH B. MUḤAMMAD B. IBRĀHĪM AL-LAWĀTĪ
AL-TANǦĪ
Charles-Dominique, P. (éd.), Voyageurs arabes, Ibn Faḍlān, Ibn Jubayr, Ibn Baṭṭūṭa et un auteur anonyme,
Paris, 1995.
Ibn Baṭṭūṭa, né à Tanger le 24 février 1304, se dit juriste en introduction de son ouvrage et, au cours de son
récit, on apprend qu’il appartient à une famille de cadis et de cheikhs. Il quitte sa ville natale le 14 juin 1325
pour se rendre en pèlerinage à La Mecque et n’en revient que le 8 novembre 1349. Outre les pays par
lesquels il passe pour se rendre aux Lieux Saints (Afrique du Nord, Libye, Égypte, Syrie et Hedjaz), il visite
l’Irak et la Perse en 1327, l’Arabie du Sud et l’Afrique Orientale en 1330-1331, l’Asie Mineure en 1332-1334,
la Russie méridionale et Constantinople en 1334. Il traverse ensuite l’Asie centrale pour se rendre en Inde
où il séjourne huit ans de 1334 à 1342. Par la suite, il rejoint la Chine après s’être fixé aux Maldives, pendant
deux ans, et après avoir visité la côte du Malabar, Ceylan, la côte de Coromandel, le Bengale et Sumatra.
Enfin revenu à Fès, il repart en voyage tout aussitôt, en Andalousie et au Mali en 1352. Dans l’intervalle de
ses grands voyages, Ibn Baṭṭūṭa accomplit six pèlerinages.
Il n’est l’auteur que d’un seul ouvrage, mais il n’en est ni l’instigateur, ni le rédacteur. C’est sur ordre du
souverain mérinide Abū ‘Inan qu’il dicte ses souvenirs à Ibn Ǧuzayy, secrétaire du prince. L’ouvrage est
achevé en 1356. Le titre est en prose rimée et assonance : Présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les
curiosités des villes et les merveilles des voyages (Tuḥfat al-nuẓẓār fī ġarā’ib al-amṣār wa-`aǧā’ib al-asfār).
L’ouvrage est connu généralement sous le nom de Riḥla (Relation de voyage).107
p. 383-388 :
« Le premier jour du mois de mois de jumâdâ al-ûla [5 avril 1325] nous parvînmes à – que Dieu la protège !
C'est un poste frontière bien gardé, un pays agréable, merveilleux, aux constructions solides. On y trouve
des édifices élégants et d’autres fortifiés, des monuments civiles et religieux. Ses demeures sont
somptueuses. Tout en elle est grâce. Ses édifices allient la grandeur à la perfection. Alexandrie est la perle
dont la splendeur éclate, la vierge qui se laisse voir dans l’éclat de sa parure, elle illumine l’Occident de sa
beauté, réunissant les mérites divers grâce à la place qu’elle occupe entre l’Orient et l’Occident. Chaque
merveille qu’elle abrite y brille et toutes les curiosités y aboutissent. Bien des auteurs l’ont décrite et ont été
prolixes à son endroit ; ils ont composé des ouvrages ayant pour sujets ses merveilles et ont montré ses
curiosités. Il suffit de se référer à l’ouvrage d’Abû `Ubayd al-Bakrî qui a pour titre Al-Masâlik pour en
connaître l’essentiel.
La ville d’Alexandrie a quatre portes : Bâb as-Sidra à laquelle aboutit la route du Maghreb, Bâb Rashîd [de
Rosette], Bâb al-Bahr [de la Mer], al-Bâb al-Akhdar [Verte] qui n’est ouverte que le vendredi pour que les
gens puissent aller visiter le cimetière. Alexandrie a un port important : je n’en ai pas vu de pareil dans le
monde si j’excepte Kûlam108 et Calicut en Inde109, le port des infidèles [Génois] à Sûdâq en Crimée et le port
de Zaytûn en Chine dont je parlerai plus loin.
Lors de ce voyage, je me rendis au Phare. Je constatai qu’une de ses façades était en ruine. C’est une
construction carrée et haute. La porte est surélevée par rapport au sol, elle se trouve en face d’une
construction de la même hauteur et entre les deux sont posées des planches qui servent de passerelle : si
on les ôte, on ne peut plus accéder à la porte du Phare. À l’intérieur de la porte, on voit une niche où se tient
le gardien. À l’intérieur du Phare, se trouvent de nombreuses salles. La largeur du couloir est de neuf
empans, l’épaisseur du mur de dix et la longueur de chaque face cent quarante. Le Phare est situé sur une
colline élevée, à une parasange d’Alexandrie, sur une langue de terre entourée de trois côtés par la mer qui
baigne le rempart de la ville. Le cimetière d’Alexandrie se trouve sur cette langue de terre contiguë au
Phare. J’ai de nouveau visité le Phare lorsque je suis revenu au Maghreb en 756 [1349]. J’ai constaté alors
qu’il était en si mauvais état qu’il était impossible d’accéder à la porte et d’entrer. Al-Malik an-Nâsir – que
Dieu lui accorde Sa miséricorde ! – avait entrepris d’édifier un Phare semblable au premier, en face de lui,
mais la mort l’empêcha de l’achever.
Parmi les merveilles d’Alexandrie, citons une colonne de marbre gigantesque qui se trouve à l’extérieur de la
ville et qui est appelée `amûd as-sawârî110. Elle est située dans une palmeraie dont elle se distingue par la
hauteur prodigieuse. Elle est d’une seule pièce, parfaitement taillée, érigée sur un piédestal carré en pierre
qui ressemble à un énorme rocher. On ne sait pas comment elle a été dressée là et par qui. Ibn Juzzay
ajoute qu’un de ses professeurs qui avait beaucoup voyagé lui avait raconté qu’un archer d’Alexandrie était
monté au faîte de la colonne avec son arc et son carquois et s’y était installé. La nouvelle se répandit et une
foule nombreuse accourut pour le voir. L’étonnement qu’il provoqua se prolongea. On ignorait comment il
avait grimpé sur le faîte de la colonne. Je pense, quant à moi, qu’il avait agi sous le coup de la peur et par
nécessité et qu’il avait réussi dans son entreprise à cause de la situation extraordinaire qu’il vivait. Voilà
comment il était monté sur cette colonne : il avait lancé une flèche à la pointe de laquelle il avait attaché une
longue ficelle nouée à une corde solide. La flèche était passée par-dessus le chapiteau et restée en travers,
puis était retombée du côté opposé, la corde étant donc au-dessus du chapiteau. Alors l’archer l’avait tirée
pour qu’elle reste au milieu du chapiteau à la place de la ficelle. Il l’avait alors fixée en terre par une
extrémité et s’était accroché à l’autre bout pour grimper. Puis il s’était installé sur le chapiteau et avait tiré la
corde qui avait été emportée par quelqu’un qui avait accompagné l’archer. Les gens ne comprirent pas
l’astuce et furent émerveillés par ce prodige.
Revenons au récit d’Ibn Battuta :
L’émir d’Alexandrie, à l’époque où je parvins dans la ville, se nommait Salah ad-dîn. S’y était installé le
souverain déchu d’Ifrîqiyyâ Zakariyyâ Abû Yahyâ ben Ahmad ben Abî Hafs, plus connu sous le nom
d’al-Lihyânî. Al-Malik an-Nâsir avait ordonné qu’on logeât ce souverain dans le palais royal d’Alexandrie et
lui allouât une pension de cent dirhams par jour. Cet homme avait avec lui ses enfants : `Abd al-Wâlid, Misrî
et Iskandarî, son chambellan Abû `Abd Allāh ben Yâsîn. C’est à Alexandrie que moururent al-Lihyânî et son
fils Iskandarî, tandis que son fils Misrî demeure encore dans cette ville.
Ibn Juzzay note qu’étrangement les noms des deux fils d’al- Lihyânî, Iskandarî et Misrî, laissaient réellement
présager de leur destinée : le premier mourut dans la ville ; quant au second, il vécut longtemps à Alexandrie
qui est une province égyptienne (Misr). `Abd al-Wâlid parcourut l’Andalousie, le Maghreb et l’Ifrîqiyya où il
mourut dans l’île de Djerba.
Parmi les savants d’Alexandrie, citons son cadi ‘Imâd ad-dîn al-Kindî, orateur éminent. Il se coiffait d’un
turban différent de ceux qu’on portait habituellement : je n’ai jamais vu, ni en Orient, ni en Occident, de
turban plus volumineux que le sien. J’ai aperçu, un jour, le cadi en question assis dans le mihrab111 ; son
turban remplissait presque toute la niche. Citons encore parmi ces savants Fakhr ad-dîn ar-Rîghî, lui aussi
cadi d’Alexandrie et qui était un savant distingué.
On raconte que le grand-père de Fakhr ad-dîn ar-Rîghî, originaire de la tribu de Rîgha, s’adonna à l’étude
des sciences religieuses puis se rendit au hedjâz. Ce faisant, un soir, il arriva à Alexandrie, un peu démuni. Il
ne voulut entrer dans la ville qu’après avoir entendu une parole de bon augure. Il se tint donc près de la
porte de la ville jusqu’à ce que tous les habitants fussent entrés. Vint le moment de fermer la porte, notre
homme restait, seul, à cet endroit. Le portier fut irrité qu’il ne se presse pas d’entrer et lui dit : « Entre,
cadi ! » « Cadi, je le serai si Dieu le veut », se dit-il. Il s’installa dans une madrasa où il récita le Coran avec
assiduité, imitant en cela les hommes vertueux. Sa réputation grandit, son nom fut connu, il se distingua par
son ascétisme et sa dévotion. Le roi d’Égypte eut vent de son histoire. Or il arriva qu’à cette époque le cadi
d’Alexandrie mourut ; il y avait un grand nombre de juristes et de savants qui briguaient, tous, la place ; seul,
notre homme n’avait aucune ambition. Le souverain lui envoya son investiture, soit le diplôme de magistrat.
L’agent de la poste le lui ayant remis, il ordonna à son serviteur de proclamer de par les rues de la ville que
tous les plaideurs devaient comparaître pour être jugés. Le nouveau cadi tint donc séance. Les juristes et
autres notables se réunirent chez l’un d’entre eux à qui ils pensaient que la magistrature ne pouvait
échapper. Ils délibérèrent pour demander au souverain de revoir son choix car la population n’en était pas
satisfaite. Assistait à cette réunion un astrologue subtil qui leur dit : « N’en faites rien ! J’ai examiné avec soin
et vérifié l’astre sous lequel le nouveau cadi a été nommé et il apparaît qu’il sera juge pendant quarante
ans. » Les savants renoncèrent donc à leur projet. La destinée du cadi fut telle que l’avait prédit l’astrologue.
Notre homme s’illustra pendant sa magistrature par son équité et son intégrité.
Citons parmi les savants d’Alexandrie : Wajîd ad-dîn as-Sanhâjî, un des cadis de la ville, illustre pour sa
science et sa vertu, Shams ad-dîn ibn at-Tinnînî, homme distingué bien connu. Citons parmi les gens pieux :
le cheikh Abû `Abd Allāh al-Fâsî, un des grands saints de l’islam. On raconte qu’il entendait la réponse
divine à ses salutations lorsqu’il priait. Citons aussi l’imam savant, ascète, humble et dévot, Khalîfa, qui avait
des révélations extatiques. Un de ses amis, homme de confiance, m’a raconté l’anecdote suivante : le
cheikh Khalîfa vit, dans son sommeil, l’Envoyé de Dieu qui lui dit : « Khalîfa, rends-nous visite.» Il partit donc
pour Médine où il se rendit à la noble Mosquée. Il y entra par la porte as-Salâm, salua la Mosquée et bénit le prophète. Puis il resta adossé à un pilier, la tête sur les genoux (on appelle cette position tarfiq chez les
soufis). Lorsqu’il releva la tête, il trouva quatre pains ronds, les vases pleins de lait et un plat de dattes. Il
partagea ce repas avec ses compagnons et repartit pour Alexandrie sans accomplir le pèlerinage, cette
année-là.
Citons encore parmi les savants, l’iman érudit, ascète, dévot, humble, Burhân ad-dîn al-A‘raj [le boiteux], un
des plus grands ascètes et des plus grands dévots qu’il m’a été donné de rencontrer pendant mon séjour à
Alexandrie et duquel j’ai été l’hôte pendant trois jours. Je fus introduit auprès de lui, une fois. Il me dit : « Je
constate que tu aimes voyager et parcourir le monde. » Je lui répondis qu’il disait vrai, alors qu’à cette
époque je n’avais pas encore songé à pénétrer les contrées lointaines d’Inde et de Chine. Il ajouta : « Il
faudra, si Dieu te le permet, rendre visite à mon frère Farîd ad-dîn en Inde, à mon autre frère Rukn ad-dîn
Zakariyyâ’ au Sind et à un autre encore Burhân ad-dîn en Chine. Lorsque tu les rencontreras, salue-les de
ma part. » Je m’étonnai de ce qu’il venait de me dire et j’eus envie d’aller visiter ces contrées. Je n’ai cessé,
par la suite, de parcourir le monde ; j’ai rencontré les trois frères et je les ai salués de la part de ce saint
homme. Quand je lui fis mes adieux, il me donna pour la route de l’argent que j’ai toujours gardé n’ayant pas
eu besoin de le dépenser, mais qui m’a été ravi par des Infidèles en Inde, sur mer, lorsque j’ai été pillé.
Citons aussi le Cheikh Yâkût al-Habashî, homme exceptionnel, disciple du saint Abû al-Hasan ash-Shâdhilî
connu pour ses miracles sublimes et son haut degré de sainteté.
Le cheikh Yâkût m’a raconté que le cheikh Abû al-`Abbâs al-Mursî l’avait informé de l’histoire suivante :
« Abû al-Hasan allait au pèlerinage tous les ans. Il prenait la route de la haute-Égypte et passait à La Mekke
le mois de rajab et les suivants jusqu’à la fin du pèlerinage. Il allait ensuite rendre visite au noble tombeau,
puis revenait chez lui par la voie terrestre. Une année, la dernière où il accomplit le pèlerinage, il dit à son
serviteur : "Prends une pioche, un couffin, des aromates et tout ce qui sert à ensevelir les morts." le serviteur
lui dit alors : "Pourquoi donc, mon maître ?" Et lui de rétorquer : "À Humaythirâ, tu verras bien. Humaythirâ
se trouve en haute Égypte dans le désert de `Aydhâb. Il y a là une source d’eau saumâtre et le pays est
infesté d’hyènes." Lorsque le saint et son serviteur furent parvenus à Humaythirâ, le cheikh fit ses ablutions,
pria deux rak`a et Dieu le rappela à lui à la dernière prosternation. Il a été enseveli là. J’ai visité son tombeau
qui est recouvert d’une pierre tumulaire sur laquelle sont écrits son nom et sa généalogie remontant jusqu’à
al-Hasan, fils de `Ali. »
(Litanies de Abû al-Hasan ash-Shâdhilî)
p. 390-391 :
« L’événement suivant se produisit à Alexandrie en 727112 (nous apprîmes la nouvelle alors que nous étions
à La Mekke –que Dieu l’honore !). Une querelle éclata entre les musulmans et les marchands chrétiens. Le
gouverneur d’Alexandrie, connu sous le nom de al-Karakî, protégea les chrétiens et ordonna aux
musulmans de se présenter entre les deux avant-murs de la porte de la ville et ferma les portes sur eux pour
les châtier. Mais la population désapprouva cet acte qu’elle considérait comme atroce ; elle brisa donc la
porte et se rua sur la demeure du gouverneur, qui se barricada et combattit les émeutiers du haut de sa
maison. Le gouverneur expédia des pigeons voyageurs à al-Mâlik an-Nâsir pour l’informer de la situation.
Celui-ci envoya un émir, connu sous le nom d’al-Jamâlî, suivi d’un deuxième du nom de Tûghân, homme
impitoyable, insensible et d’une piété suspecte : on prétendait qu’il adorait le soleil. Les deux hommes
entrèrent à Alexandrie, se saisirent des autorités de la ville et des marchands notables, comme Awlâd
al-Kûbak et autres, et leur extorquèrent des sommes considérables. On mit au cou du cadi `Imad ad-dîn un
carcan de fer. Puis les deux émirs firent exécuter trente-six hommes de la ville, les coupant en deux et les
crucifiant sur deux rangs ; cela se passa le vendredi. Les habitants de la ville selon leur coutume, allèrent
visiter les tombes après la prière et virent cette hécatombe. Grande fut leur consternation et leur affliction
décupla ! Au nombre de ces crucifiés se trouvait un marchand très estimé appelé Ibn Ruwâha. Il avait une
salle garnie d’armes et quand il y avait un danger ou un combat, il avait suffisamment d’armes pour équiper
cent à deux cents hommes. Il y avait d’ailleurs dans la ville des salles de ce genre chez un grand nombre
d’habitants. Ce fut la langue d’Ibn Ruwâha qui le perdit, car il avait dit aux deux émirs : « Je suis garant de
cette ville et chaque fois qu’il éclatera une émeute, qu’on me demande ! J’épargnerai ainsi au souverain de
verser des soldes aux soldats et aux hommes. » Les deux émirs n’apprécièrent pas cette déclaration et lui
dirent : « Tu ne cherches qu’à t’insurger contre le souverain ! » Ils le mirent donc à mort alors que son
dessein n’était que de prouver au souverain qu’il lui était dévoué et qu’il était à son service. C’est par là qu’il
périt !
Lorsque j’étais à Alexandrie, j’avais entendu parler du cheikh Abû `Abd Allāh al-Murshidî, homme pieux,
dévot, vivant en ermite, tirant sa substance du Trésor invisible de Dieu, un des grands saints illuminés. Il s’était retiré à Minya Banî Murshid dans une zâwiya où il vivait seul, sans serviteur, ni compagnon. Les émirs
et les vizirs allaient lui rendre visite et des gens de toutes les classes de la société le rencontraient, chaque
jour. Le saint personnage les nourrissait, car chacun désirait manger un de ses mets, un fruit, une pâtisserie,
et chacun obtenait ce qu’il désirait même si ce n’était pas l’époque où on trouvait ses denrées. Les juristes
venaient lui demander des emplois, al-Murshidî nommait et destituait. Toutes ces histoires se répandaient et
étaient répétées à l’envi. Al-Malik an-Nâsir se rendit plusieurs fois à sa zâwiya. »
p. 403 :
« On dit que le siège du savoir et de l’autorité était la ville de Manûf, située à un barîd de Fustât. Lorsque
Alexandrie fut construite, la population s’y transporta et la ville devint le siège de la science et de l’autorité
jusqu’à l’Islam, alors `Amr ben al-`Âs fonda la ville de Fustât, capitale de l’Égypte jusqu’à présent. »
p. 1001 :
« Je partis pour (…) Alexandrie où je constatai que l’épidémie de peste avait perdu de son acuité, après que
le nombre des victimes eut atteint mille quatre-vingts par jour113. »
- 73 - 76 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
NICCOLO DE POGGIBONSI (1349)
Bellorini, T. et Hoade, E., Fra Niccolo of Poggibonsi, A voyage beyond the seas (1346-1350), Publications of
the Studium Biblicum Franciscanum 2, Jérusalem, 1945.
Niccolo de Poggibonsi est un Franciscain de Toscane. Son ouvrage Libro d’Oltramare est le premier récit
d’un pèlerinage en Terre sainte en italien. Après sa mort, ce livre devient un guide pour les pèlerins. Il est
publié soixante-trois fois, entre les XVIe et XIXe siècles, anonymement ou sous le nom de Noé Bianco (1527),
voyageur de ce corpus.114
Un autre pèlerin, Gerolamo da Castelione (1486) reproduit le même passage que celui de Niccolo de
Poggibonsi à propos d’Alexandrie (voir infra).
« Chapitre CLXV. Description de la ville d’Alexandrie.
Alexandrie est une belle ville, encerclée d’un mur très haut ; elle possède à l’intérieur de beaux palais. La
ville, construite sur la mer, a un beau port et un fleuve qui découle du Paradis. Dans cette ville, il y a
beaucoup de maisons de marchands latins et d’autres nations. Cette ville est à trois mille milles de
Babylone, ville du Sultan, qui se trouve au bord dudit fleuve.
Chapitre CLXVI. La pierre sur laquelle saint Jean fut décapitée.
À Alexandrie, se trouve l’église de Saint-Jean-Baptiste et également la pierre sur laquelle il fut décapité qui
fut prise à la ville de Sebaste à Samarie et portée à cet endroit. Ici existe un miracle visible ; aucun Sarrasin
ne peut s’asseoir sur cette pierre. S’il s’assoit dessus, de très petites bêtes sauvages qui sortent de dessous
la pierre le recouvrent.
Chapitre CLXVII. L’endroit où sainte Catherine fut décapitée.
À côté de cette place citée, se trouvent les maisons qui appartenaient à la précieuse sainte Catherine, mais
l’amiral des Sarrasins vit là. En marchant tout droit dans cette rue, à gauche vous rencontrerez deux
colonnes de marbre devant un palais, entre lesquelles sainte Catherine fut décapitée. Là, une église fut
construite par les chrétiens, mais maintenant, l’endroit est occupé par deux Sarrasins. On dit qu’ici, il y a une
indulgence plénière.
Chapitre CLXVIII. L’endroit où saint Marc fut décapité.
Dans ladite rue se trouve l’église où saint Marc l’Évangéliste fut décapité. Cette belle et pieuse église est
tenue par les Grecs. Ici, on obtient une indulgence de VII ans et de LXX jours.
(p. 86) Chapitre CLXIX. À propos de saint Athanase.
À un demi-mille, hors d’Alexandrie, se trouve l’endroit où saint Athanase se sauva pour échapper à la furie
de l’Empereur Constantin pour la défense de notre foi catholique. Là, il composa le symbole saint de la foi
catholique qui commence par : Quicumque vult salvus esse.
Chapitre CLXIX. Comment je partis d’Alexandrie pour aller à Babylone.
Ayant visité ces endroits, nous partîmes d’Alexandrie ; nous allâmes par voie de terre à un demi-mille où
nous trouvâmes un port sur le Nil et là nous embarquâmes sur une giarma des Sarrasins et fîmes voile pour
le Caire de Babylone. »115
114 Bellorini, T. et Hoade, E., Fra Niccolo of Poggibonsi, A voyage beyond the seas (1346-1350), Publications
of the Studium Biblicum Franciscanum 2, Jérusalem, 1945, p. XXXI.
115 Traduction : archives Sauneron, Ifao.
- 77 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-NUWAYRĪ (1365-1368)
MUḤAMMAD B. AL-QĀSIM AL-ISKANDARĀNĪ AL-NUWAYRĪ
Muḥammad b. al-Qāsim al-Iskandarānī al-Nuwayrī, Kitāb al-Ilmām, par A. S. ‘Atiya, Haydarabad, 1970.
Al-Nuwayrī est un historien alexandrin dont les dates de naissance et de mort ne sont pas connues. Entre
1366 et 1374, il écrit une histoire de la ville en trois volumes, Kitāb al-Ilmām (Le livre de la connaissance),
dans le but de raconter la prise d’Alexandrie par le roi de Chypre, Pierre de Lusignan en octobre 1365.116
L’auteur n’est en aucun cas considéré comme un voyageur, mais plutôt comme un témoin oculaire de cet
événement.
p. 130-179 (tome II) :
« Comment le Chypriote mit la main sur Alexandrie, à l’aide de ceux qu’il a réunis de la nation des Chrétiens
de Rūmāniyya et autres faits et incidents »
Ainsi le remplaçant du sultan à la ville frontière d’Alexandrie est l’Émir Ḫalīl (p. 131) Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām
qui n’était pas présent à la ville frontière susmentionnée car il accomplissait le pèlerinage au Ḥiǧāz al-Šarīf.
Un délégué, l’émir Ǧunġurā, le remplaçait sur ordre de l’émir Al-Atābikī, qui se nommait Yulbuġa al-Ḫāsikī.
Quand Ǧunġurā entra dans Alexandrie, il vit les sentinelles de volontaires qui surveillaient le port
d’Alexandrie. Les sentinelles vinrent sur la péninsule avec leurs arches et leurs drapeaux de soie
déployés. Ils étaient équipés de javelots, des lances, des boucliers, des épées, des cottes de maille de
bonne qualité, des lames de fer, du naphte inflammable d’où sortent des flammes. Ils portaient des
vêtements de différentes couleurs qui ressemblaient à des fleurs de jardin. Quand Ǧunġurā les vit, il pleura
et dit : « ces gens sont le peuple du paradis pour leur sang-froid et pour leur combat pour l’amour de Dieu.
La vie est vraiment agréable grâce à la force de leur armée. Si les Chrétiens de Rūm venaient à Alexandrie,
ils ne pourraient rivaliser face à cette armée (p. 132) lourde qui aurait le dessus sur les chrétiens qu’on
tuerait et qu’on ferait captifs ». Ǧunġurā resta à Alexandrie de šawwāl 766 jusqu’au mois de muḥarram117
pour observer ces sentinelles dont chacune passait la nuit, une fois par semaine, à surveiller le port. Il est
probable que Ǧunġurā passa des nuits dans la pièce qui se trouve au-dessus de la porte de la mosquée du
cimetière Ṭaġiya. On posa devant Ǧunġurā deux fanaux ronds à la porte de la mosquée susmentionnée. Les
sentinelles des injecteurs de feu vinrent et lâchèrent le naphte pendant que Ǧunġurā regardait, par les
fenêtres de la pièce susmentionnée, les étincelles voler et les spirales tourbillonnantes de couleur feu : vert,
jaune, blanc et rouge. Ceci lui procura du plaisir, du soir au matin. Ǧunġurā jubila également en voyant ces
nombreuses personnes partout sur la côte, aussi bien des archers que des gens du peuple. Là, était installé
un marché avec toutes sortes de vivres où l’on achète, mange et boit l’eau – aussi bien celle qui coule que
de l’outre qui leur vient de la ville. Au lever du jour, les sentinelles qui ont passé leur nuit à surveiller (p. 133)
l’entrée de la ville avec zèle et persévérance, en grand nombre, s’alignaient. Les hommes et les femmes se
rassemblèrent pour regarder les troupes qui entraient et qui ressemblaient à des fleurs de jardin, vêtues des
plus beaux habits et de voile blanc. Les femmes leur firent des youyous de bienvenue quand elles les virent
de leurs yeux. À ce moment-là, les cornes firent un grand bruit, les tambours frappèrent et les flûtes
sifflèrent. Les drapeaux furent hissés, les encensoirs étaient remplis de parfum dont la fumée se dégageait.
Toutes les âmes s’épanouirent sous l’effet de cette odeur qui exhalait un parfum agréable. Les gens étaient
contents et joyeux en voyant cette armée victorieuse, pour qui tremblaient les rues et les maisons. Alors que
les gens respectaient cette tradition, vivant sereins dans leur ville frontière, n’ayant pas peur (p. 134) de
leurs ennemis, ne voyant jamais de choses odieuses, le roi de Chypre, le maudit, les surprit avec ses soldats
éparpillés et désunit les gens qui s’enfuirent vers les villes [environnantes]. Il entra calmement dans la ville le
vendredi 22 de muḥarram 767118, au moment où le Nil était répandu dans les villes. Le maudit avait
l’intention, à cette époque, d’empêcher l’aide depuis Miṣr à cause de l’éloignement de la route du côté de la
montagne. Le fourbe atteignit son but ce jour-là et le jour suivant. Il se renforça avec ses bateaux avant que
l’aide ne vînt. Il fut content de lui-même et de ses gains. S’il y avait eu des émirs plus puissants, le fourbe
n’aurait pas réussi à y prendre le prix d’une maille. Mais c’était écrit dans le livre et c’était la volonté de Dieu
qui était prédestinée.
Yazīd b. Ḥabīb raconte que `Amr b. al-‘Aṣ – que Dieu soit satisfait de lui ! – observa les maisons et les
édifices dont la construction était achevée quand il conquit Alexandrie. Il voulut y habiter et dit : ces maisons
nous suffisent. Il écrivit à `Umar b. al-Ḥaṭāb – que Dieu soit satisfait de lui ! – pour demander son
autorisation. `Umar dit à son messager : « Est-ce que l’eau me sépare des musulmans ? » Le messager
répondit : Oui, émir des fidèles, si le Nil est en crue. Puis, `Umar écrivit à `Amr : « Je ne veux pas que les
musulmans aillent dans les lieux où l’eau me sépare d’eux en hiver et en été, sauf s’ils deviennent
nombreux. Alors `Amr b. al-`Aṣ se déplaça d’Alexandrie à Miṣr. (p. 135) `Umar b. al-Ḥaṭāb – que Dieu soit
satisfait de lui ! – a fait ainsi car il eut peur pour les musulmans à cause de leur faible nombre à Alexandrie et
de son éloignement. Aussi, au moment de la crue du Nil, il serait difficile d’emprunter le chemin de la
montagne pour demander du secours. À cette époque, `Amr b. al-`Aṣ envoya à Alexandrie des tribus arabes
de Laḫm, de Ǧuḏam, de Kinda, de Azd, de Ḥaḍramūt, de Ḫūzā`a, de Mazā’ina, y habiter pour la garder. Les
Laḫm habitèrent dans le lieu connu comme étant Kūm al-Dikka, les Ǧuḏam habitèrent à Birka Ǧuḏam, Les
Kinda habitèrent à Barākil, les Azd habitèrent à Ḥāra al-Azdī, les Ḥaḍramūt habitèrent à Ḥāra al-Ḥaḍārima,
les Ḫūzā`a et les Mazā’ina habitèrent à côté de Būqīr, à l’est d’Alexandrie, à l’extérieur pour surveiller son
port. Les tribus susmentionnées habitèrent à l’extérieur d’Alexandrie et reçurent la mission de surveiller les
deux ports, est et ouest, sur la péninsule d’Alexandrie. Les descendants de ces tribus, jusqu’à maintenant en
(p. 136) 775 119, sont connus à Alexandrie comme tribus. On a des informations sur eux. On sait qu’ils ont
trente-trois chefs et sous le contrôle de chaque chef, il y a une assemblée de tribus. Ils ne se défont pas de
la façon de s’habiller des Arabes, ils laissent pendre les insignes de leurs tribus et portent des chemises à la
façon traditionnelle de leurs aïeux nomades (`Urbān). `Amr b. al-`Aṣ divisa ses compagnons pour le ribāṭ120
d’Alexandrie ; un quart surveillait les gens d’Alexandrie, l’autre quart surveillait sa côte. Tandis que la moitié
restait avec lui à Miṣr. Un quart surveillait les gens d’Alexandrie en particulier, six mois en été, et l’autre
quart, six mois en hiver. Fin. On en revient à l’évocation du Chypriote, à propos de sa venue à Alexandrie et
de sa victoire sur elle. Le mercredi 20 de muḥarram 767121, (p. 137) des navires apparurent sur la mer du
côté ouest et est. Les Alexandrins pensaient que c’était des marchands vénitiens et attendirent qu’ils
vinssent à eux avec leurs marchandises comme c’est la coutume chaque année. Les marchands
musulmans rapportaient du Yémen toutes sortes d’épices pour les vendre en échange de leurs
marchandises. Comme ils n’entrèrent pas au port, les gens passèrent la nuit à avoir une grande peur à
cause d’eux. Le jeudi matin, de nombreux navires arrivèrent et cherchèrent à s’approcher des côtes de la
péninsule ; ces navires avaient les voiles ouvertes comme des châteaux blancs. Les gens étaient sur la
grande route à cause de leur grand effroi. Leur ardeur s’accrut. Les bateaux s’approchèrent et la mer se
remplit de navires de toute part. Les navires percèrent la mer comme un tremblement de terre. Les navires
baissèrent leurs voiles devant la mer de Silsila, du côté de la porte Verte qui fut barricadée après cet
événement avec de la chaux et des pierres. Elle fut ouverte par la suite. On ajouta à cette porte Verte une
première, une deuxième et une troisième portes nouvelles. Ceci fut le jour de la bataille en 767122 dans la
wilāya 123 de l’émir Sayf al-Dīn al-Akaz (p. 138) à Alexandrie. J’évoquerai cette wilāya et ce qu’il y fit – si Dieu
le veut !
Je reprends, au moment où les navires de guerre jetèrent l’ancre devant la mer de Silsila et apparurent sur
la côte, et où les Alexandrins se préparèrent au combat, à la guerre et à la bataille. Les forteresses, qui sont
du côté de la mer et de la péninsule, se remplirent de nombreux lanceurs. Les gens se répandirent sur les
murs qui furent remplis de lanceurs. Une barque sortit des navires des Francs pour sonder le port au clair de
lune. Les musulmans lancèrent des flèches sur la barque qui s’échappa jusqu’à se coller aux navires.
À la tombée du jour, on alluma des lanternes sur les murs qui furent éclairés par la lumière. Les musulmans
parurent prêts sur les murs en se montrant alertes. Les ennemis étaient silencieux et ne bougèrent pas du
lieu où ils jetèrent l’ancre. Ces navires (p. 139) étaient joints les uns aux autres comme un petit ponton dans
la mer haute. Les musulmans sous-estimèrent cette situation et se dirent que ces ennemis ne pouvaient pas
entrer dans cette ville qui a des murs imprenables et des forteresses érigées solidement. Après le lever du
soleil, le vendredi, de nombreux musulmans se répandirent sur la côte de la péninsule. Parmi eux, certains
avaient leurs épées et leurs boucliers, certains avaient leurs flèches et leurs carquois, certains avaient leurs
lances et leurs poignards tandis que d’autres n’avaient que leurs vêtements. Quelques-uns portaient des
cottes de maille lamifiées. Quelques-uns étaient nus.
Les commerçants sortirent de la ville avec leurs étals, chaudrons et marmites remplis de nourriture qu’ils
vendirent aux gens de la péninsule, aux particuliers et au public, la veille du jeudi, pour gagner leur vie, en
portant la malédiction à tout moine et prêtre. (p. 140) Ils n’eurent pas peur des navires que l’on vit le
mercredi dans la mer et n’eurent pas peur des Francs qui réunirent leur flotte le jeudi. Ils en vinrent à
maudire le Chypriote comme on maudit l’iblis. Auparavant, ils avaient confiance et vendaient aux sentinelles
déjà évoquées. Mais certains vendeurs n’étaient pas contents quand le client réduisait d’une graine124 ou
deux, en revanche les vendeurs étaient contents quand ils l’emportaient d’une graine sur le client.
Poème
(p. 141) Les gens achetèrent aux vendeurs et mangèrent comme quand ils sortaient avec les sentinelles à
l’accoutumée. Pas un seul ne se rappelait de la flotte des Francs et aucun n’avait peur. Les canailles et la
plèbe injurièrent le Chypriote ouvertement et l’insultèrent de tous les mauvais mots. Le Chypriote les écouta
depuis son navire, mais resta silencieux. Tous les gens qui étaient avec lui s’abstinrent de prononcer le
moindre mot et tous étaient silencieux. On dit que le Chypriote envoya ses espions, depuis le haut de la
péninsule, la nuit, habillés du costume des musulmans arabes, et comme des diables, [les espions] se
mélangèrent aux musulmans pour les espionner et virent que les musulmans ne portaient pas l’habit de
guerre. (p. 142) Il paraît que [les espions] achetèrent de la nourriture qu’ils amenèrent au chef de la flotte de
Chypre en lui disant qu’il n’y avait pas un brave sur la péninsule ; que tous étaient sans l’habit de guerre,
qu’ils mangeaient, buvaient et que certains creusaient un trou dans le sable pour y dormir.
Avant le lever du soleil, le vendredi, les tribus vinrent de toute part et endroit ; ils entrèrent en tenue de
guerre. Les femmes regardèrent les navires des Francs depuis les sommets des collines qui sont à l’intérieur
des murs et qui ont une vue sur les cimetières. Les femmes firent des youyous aux membres des tribus pour
annoncer que les braves allaient arriver pour tuer les adorateurs de la croix ; alors qu’ils s’exerçaient sur
leurs chevaux sous les collines, ils défirent les rênes quand ils entendirent les youyous. Ils étaient nombreux
comme la pluie. Ils sortirent par la porte Verte et se rendirent sur la péninsule comme les criquets qui se
propagent. Chaque membre de l’armée était nu, chacun d’entre eux n’avait que son épée et sa lance, dans
l’intention soit de tuer, (p. 143) soit de blesser. Un Maghrébin et d’autres dirent à l’émir Ǧunġurā : « Ces
ennemis sont forts et les gens sortent de la ville frontière nus à cause de cette épreuve, mais c’est dans leur
intérêt de rentrer dans la ville, de se faire protéger par ses murs imprenables et de se battre depuis l’intérieur
des murs. Les ennemis s’imagineront alors que derrière ces murs chaque homme est comme un lion
courageux qui va infliger par ses flèches une forte [peine] jusqu’à l’arrivée des renforts de Miṣr. » C’est un
des sages du ribāṭ sur la péninsule pour lequel fut dépensée une grande somme en constructions entre les
cimetières pour loger les sentinelles de la Qā`a 125, qui dit : « Nous ne laisserons pas ces Francs, dont
chacun d’eux est un infâme joueur, fouler de leurs pieds la terre des cimetières. » [Les gens] dirent aussi
qu’ils avaient peur que les Francs détruisissent le ribāṭ s’ils descendaient sur la péninsule en grand nombre.
ʿAbd Allāh, le marchand maghrébin, dit (p. 144) à Ǧunġurā qu’il était dans l’intérêt des musulmans d’entrer
dans la ville. Les chefs des ribāṭ-s dirent : « Vous les Maghrébins vous avez détruit votre ville de Tripoli à
cause de sa prise par les Francs et vous voulez détruire les ribāṭ-s des musulmans en faisant entrer les
musulmans dans la ville, il n’y a pas de ruse chez vous, ni de dignité, mais nous leur interdirons de
descendre de leurs navires grâce au châtiment sans fin que nous leur infligerons au moyen de flèches. »
Deux ans après l’événement du Chypriote, le sultan Al-Malik al-Ašraf Ša`bān ordonna de détruire les ribāṭ-s
et les châteaux nouvellement construits sur la péninsule pour se préserver des ennemis qui viendraient y
trouver un refuge et de quoi boire à partir des citernes remplies d’eau de pluie. On détruisit donc ces ribāṭ-s
et ces châteaux. Si les musulmans avaient laissé la péninsule au Chypriote et avaient renforcé leurs murs et
tué les infidèles de derrière les murs, les musulmans auraient évité le meurtre, le pillage (p. 145) et la
captivité par le renforcement de leur ville frontière. Ils n’auraient pas été obligés de détruire leurs ribāṭ-s pour
le salut d’Alexandrie contre l’offense de la communauté chrétienne. Ceux qui ont eu peur pour leurs ribāṭ-s,
se les ont fait détruire et leurs maisons à l’intérieur de la ville se sont faites pillées. Ceci à cause de l’opinion
inexacte qui produisît cette catastrophe. Quand le destin arrive, c’est irréfutable. Si Dieu le veut, il exécute
cette sentence. Poème
Je reviens à l’émir Ǧunġurā qui se fia aux paroles des chefs des ribāṭ-s, n’écoutant pas ce que dit le
marchand maghrébin ʿAbd Allāh. La réponse de Ǧunġurā à ʿAbd Allāh le marchand susmentionné fut : « Je
ne laisserai pas un Franc arriver sur la côte au prix de me faire couper les veines et assassiner. » Si Dieu
veut être bienveillant (p. 146) avec ses serviteurs, il les inspire d’un bon discernement. Si Dieu les
abandonne, Il disperse leurs pensées. Les Francs surveillaient depuis leurs navires le comportement des
gens. Ils ne virent que des gens dévêtus. Alors ils convoitèrent les gens et avancèrent sur une corvette vers
eux. La sentinelle des Maghrébins descendit vers la corvette en nageant dans l’eau et attaqua ceux qui y
étaient en tuant, bataillant et s’affrontant. [Les Maghrébins] retinrent la corvette de leurs mains et
demandèrent aux injecteurs du feu de la brûler. Mais personne ne vint avec du feu faute d’ardeur et par
négligence et insouciance. Alors ils les précipitèrent, ils lancèrent donc sur la corvette un canon de feu
semblable au feu des alliés. Mais le feu tomba dans l’eau et s’éteignit. Ensuite, les Maghrébins et les gens
de la corvette s’affrontèrent avec leurs épées jusqu’à ce que fussent tués les Maghrébins dans cette bataille.
À ce moment-là, la corvette toucha la côte tandis qu’une autre la suivait et lançait des flèches. Quand les
deux corvettes touchèrent terre, les autres les suivirent entrant de toute part. Rapidement, les Francs
descendirent à terre de leurs navires avec leurs chevaux et leurs hommes, le vendredi au milieu de la
matinée. La cavalerie musulmane lança des flèches, devancée par l’infanterie munie de leurs boucliers et de
leurs épées. (p. 147) Quand les vendeurs de nourriture, dont chacun épiloguait sur une graine126 ou deux,
virent les Francs, ils abandonnèrent leur vaisselle et s’enfuirent pieds nus. Parmi eux, certains fuirent les
infidèles, et d’autres eurent la tête cassée par terre. Les Francs étaient vêtus de cottes de maille lamifiées
recouvertes de plaques de fer et portaient sur leurs têtes des casques scintillants. À leurs mains, ils tenaient
des épées tranchantes. Ils tirèrent à l’arc en continu. Ils hissèrent les drapeaux des croisés qui étaient
déployés. Ils lancèrent des flèches sur les musulmans. Les flèches tombèrent sur le peuple des croyants et
sur les chevaux des tribus qui s’enfuirent de tous côtés et endroits. Ils perdirent du côté de la muraille.
L’armée des musulmans perdit à cause de ces tribus vaincues et ne revint pas rencontrer les chiens de
Francs qui entrèrent en meurtriers dans la ville par les portes. Les Francs étaient vêtus de fer de la tête aux
pieds tandis que les musulmans étaient comme de la viande sur une planche de bois. Comment de la
viande peut-elle tuer (p. 148) le fer ? Comment celui qui est nu peut-il faire face à celui qui s’habille de cotte
de maille lamifiée ? Les musulmans perdirent et fuirent les infidèles.
Poème
Le peuple d’Alexandrie n’avait jamais vu ce qu’il a connu ; il n’avait jamais vu ça de tout temps. Les gens
tremblaient dans leurs coeurs, chacun avait son esprit dépouillé quand il vit les têtes voler et les chevaux
meurtriers. Les gens se bousculaient aux portes les uns les autres. Ils moururent en tous sens. Quelques
hommes actifs se maintinrent et se battirent jusqu’à tuer des Francs qu’il leur était possible de tuer avant de
tomber au champ. On dit que Muḥammad al-Šarīf le boucher attaqua les Francs avec un couperet de
boucherie, il brisa les os de quelques-uns en disant "Dieu est grand !" (p. 149) Il tua des infidèles jusqu’à ce
que de nombreux Francs viennent sur lui. Alors, il mourut sur la péninsule – que Dieu lui accorde sa
miséricorde ! Les jurisconsultes ont aperçu l’un d’eux, le Faqīh Muḥammad b. al-Ṭafāl, qui voulait se rendre
aux Francs avec son épée : « Tu vas mourir Faqīh Muḥammad. Il dit : « Je serai heureux d’être aux côtés du
prophète Muḥammad. Y a-t-il une meilleure mort que celle pendant le combat pour l’amour de Dieu pour être
au Paradis. » Il tomba au champ, il les combattit et [les Francs] le combattirent jusqu’à ce qu’on lui accordât
son acte de foi pour parachever sa félicité.
[…]
Je reviens à l’évocation des musulmans de la péninsule qui combattirent les Francs infidèles. (p. 150) Le
groupe des tireurs volontaires de la Qā`a de la Qarāfa fut assiégé dans le ribāṭ, qui se trouve à l’extérieur de
la porte de la Mer sur la péninsule, construit par le cheikh Abū `Abd Allāh Muḥammad b. Salām pour y
habiter et pour y prier. Ces constructions furent faites un an avant l’attaque. On dit qu’il dépensa pour ces
édifices 800 dinars. Quand les Francs devinrent plus nombreux autour du ribāṭ, les archers musulmans se
mirent à tirer leurs flèches depuis le sommet du ribāṭ sur les Francs. Ils en tuèrent quelques-uns. Lorsqu’ils
achevèrent leurs flèches, ils allèrent vers les moellons pour les détruire et lancèrent sur les Francs les
pierres des moellons jusqu’à les achever. Ils cessèrent alors de tirer. Les Francs cassèrent les barreaux du
ribāṭ susmentionné et y montèrent. Quand les Francs se retrouvèrent face à eux, les musulmans hurlèrent
tous : « Muḥammad ! » et se turent. Alors, on n’entendit plus de voix. `Abd Allāh b. al-Faqīh (p. 151) Abī
Bakr, le curateur de la mosquée Al-Qašmīrī, nous rapporta ce propos. Il était caché dans la citerne de la
mosquée susmentionnée. Les Francs les égorgèrent jusqu’au dernier avec leurs poignards. Leur sang coula
dans les gouttières du ribāṭ susmentionné comme coule la pluie. On dit que le nombre d’égorgés
musulmans, sur le toit du ribāṭ, était de plus de trente. Heureux ceux qui se donnent pour parachever leur
félicité.
Ceux qui étaient sortis d’Alexandrie pour fuir les Francs revinrent par les portes du continent. Je vais
raconter comment ils fuirent. Ils virent les morts gisants à terre dans la ville et à l’extérieur de la ville sur la
péninsule. Ils se dirigèrent vers le ribāṭ d’Ibn Salām susmentionné. Alors ils virent sous les gouttières
beaucoup de sang coagulé. Ils montèrent sur le toit du ribāṭ et trouvèrent les tireurs égorgés, mais heureux
au paradis et gagnants. On leur creusa à l’extérieur du ribāṭ une grande tombe et on les enterra dedans –
que Dieu leurs accorde sa miséricorde !
[…]
(p. 152) L’auteur dit – que Dieu lui pardonne ainsi qu’à ses parents et à l’ensemble des musulmans ! – que
le cheikh Al-Ṣāliḥ Aḥmad b. al-Našā’ī, cheikh des tireurs de la Qā`a de la Qarāfa d’Alexandrie, rapporta que
Muḥammad al-Ḫayaṭ, après être revenu de la ville de Chypre à Alexandrie avec ceux qui étaient prisonniers,
dit : « J’étais avec les tireurs musulmans sur le toit du ribāṭ d’Ibn Salām au moment où les Francs montèrent
et égorgèrent les tireurs. J’étais décontenancé par la peur. En raison de mon jeune âge, ils me laissèrent
vivant ainsi que Ḥusayn al-Bayyāʿ ; alors que les Francs étaient sur le point de l’égorger, ce dernier rit. Alors,
les Francs rirent avec lui et dirent : « Laissez-le, parce que le rire a remplacé sa peur ! ». Ils nous firent
prisonniers tous les deux. Ḥusayn en fut triste et pleura. Quand nous revînmes par la mer à Alexandrie avec
les prisonniers, Ḥusayn, à la vue d’Alexandrie, se leva sur ses jambes puis cria et s’évanouit. Nous le
retournâmes et le trouvâmes mort. En effet, il fut heureux de sortir de la terre des infidèles et fut joyeux
quand il aperçut la ville des musulmans. Il fait partie, grâce à la générosité de Dieu, des personnes joyeuses
au paradis.
[Hadith]
(p. 153) Je reviens au moment où le cheikh Muḥammad b. Salām vit ce qu’on fit à son ribāṭ, aux portes et
aux fenêtres en cuivre. Au moment où il vit les bris de lampes, le plafond de la salle brûlé ainsi que
l’assassinat des tireurs musulmans, il pleura en raison de ce qu’il voyait et dont il était témoin. Alors il
condamna à ce moment-là les fenêtres et les portes avec des pierres. Puis il le reconstruisit en 771127 à
l’identique de ce qu’il était alors. Mais il protégea le plafond de sa salle avec des pierres, et non pas avec du
bois, pour qu’il ne prît pas feu (p. 154) au cas où un évènement dût se produire. Cet homme, Muḥammad b.
Salām susmentionné, propriétaire de ce ribāṭ, est compté parmi les gens de Dieu pieux et charitables. On lui
attribue des aumônes de type courant aux saints et aux pauvres. Ses aumônes, privées et publiques, se
faisaient en argent et en moutons. Ils distribuaient plus de cent animaux à la fête du sacrifice. Il fournissait
en rangées de nattes la mosquée Al-Ġarbī d’Alexandrie. Dieu n’a pu que le récompenser du bien qu’il a fait.
La Qā`a de la Qarāfa, garde des tireurs volontaires, qui faisait partie de ses waqfs128, lui apporta une
rétribution dans la vie et dans la mort. Celui qui fait un lit, dort. Celui qui sème, récolte.
Poème
Les personnes charitables reçoivent de Dieu les bienfaits et augmentent [le nombre de] leurs points pour le
paradis. Imitez-les pour être comme elles. L’imitation de la générosité vaut pour votre salut. Fin.
J’en reviens à l’évocation des nouvelles d’Alexandrie et à l’émir Ǧunġurā. Il vit les gens fuir d’entre ses
mains, de derrière, de sa droite et de sa gauche, à cause des flèches des Francs. Ǧunġurā fut aussi touché
(p. 155) et son sang coula de la pointe de la flèche. Il regretta alors son désaccord à propos de ce qu’on lui
dit : « rentre [dans la ville] avec les gens pour se faire protéger par ses murs imprenables. Ils combattront les
Francs infidèles par leurs flèches à partir des trous des murs jusqu’à ce qu’arrive l’aide dans un temps
proche pour cesser la catastrophe des musulmans. » À ce moment-là, il se rendit compte qu’il ne fallait pas
sortir des portes, c’était en effet exact. Mais par ailleurs, on lui dit qu’il ne fallait pas entrer dans la ville.
C’était une cruelle agonie. Tous les gens s’enfuirent pour trouver refuge dans les villes d’Al-Baslaqūn,
d’Al-Karīwūn et dans d’autres villes proches et lointaines.
Ǧunġurā se dirigea vers le miṭraq, près de la maison du sultan, à l’ouest d’Alexandrie, à l’extérieur de ses
murs. Il nagea avec son cheval, suivi des musulmans. Il entra dans Alexandrie par la porte de Ḫawḫa. Il
arriva à la Maison du Trésor (Bayt al-Māl), prit ce qu’il trouva d’or et d’argent et sortit par la porte du
continent. Il ordonna aux marchands (p. 156) francs et à leurs consuls, qui étaient à peu près une
cinquantaine à résider à Alexandrie, de sortir avec lui par la porte du continent. Il les conduisit à Damanhūr
après avoir refusé de sortir avec la Ǧabaliya129 qui les surveillait. À ce moment-là, un des Ǧabaliya frappa le
cou d’un des Francs avec son sabre. Quand les Francs le virent, ils eurent peur qu’on frappât les leurs. Ils
obéirent et sortirent rapidement. La Ǧabaliya sortit avec les Francs qui étaient ligotés et se dirigèrent vers
Damanhūr ; elle était en train de sortir avec eux quand ils rencontrèrent les ennemis près de la muraille. Les
musulmans tirèrent des flèches depuis le sommet des murs, ainsi les ennemis ne purent arriver jusqu’à eux.
Ensuite, les Francs recoururent à un baril de bois, y mirent le feu en se dirigeant vers la porte de la Mer, et le
firent rouler au moyen des pointes de lances. Mais les flèches se succédèrent sur les Francs depuis le
sommet de la muraille. Quelques Francs furent tués ; alors ils hésitèrent sur ce qu’ils allaient faire. (p. 157)
C’est ainsi qu’ils abandonnèrent leur baril en feu loin de la Porte. Ils retournèrent vers le port est, ils virent
qu’il ne se trouvait personne sur la muraille de ce côté-là et qu’il n’y avait aucun fossé qui rendait difficile la
montée sur la muraille. Ils allèrent du côté de la porte de Dīwān et la brûlèrent. Ils entrèrent avec ce dont ils
disposaient ici, à savoir des échelles de bois assemblées avec lesquelles ils montèrent sur la muraille.
Quand les musulmans, qui étaient sur la muraille, les virent de loin, ils y montèrent, mais entre eux et les
Francs se trouvait une haute citadelle qu’ils ne purent atteindre. Alors ils s’enfuirent en demandant secours à
cause du grand nombre de Francs, et parce qu’ils constatèrent que les Francs possédaient la ville. Quelques
musulmans rattrapés furent tués et certains en réchappèrent en sortant par la porte du continent. Si la
muraille qui donne sur la mer avait été habitée d’hommes du côté de la porte de Dīwān et de celle de Ṣinā‘a,
Alexandrie aurait échappé aux Francs. Šams Al-Dīn b. Ġurāb, secrétaire, et Šams Al-Dīn b. Abī `Uḏayba, le
superviseur, dirent (p. 158) : « Fermez la porte de Dīwān qui donne sur la ville pour que les marchands ne
puissent pas transporter leurs marchandises de la porte de Dīwān à la ville car les droits portant sur les
marchandises seraient perdus. » Les portes furent fermées et les tireurs ne défendirent pas l’accès de ce
côté de la muraille ; ainsi les ennemis virent un endroit vide et entrèrent dans la ville par là. On dit qu’Ibn
Ġurāb, susmentionné, était en affaire avec le chef de Chypre à Alexandrie. Ce chef de Chypre vint à
Alexandrie avant l’attaque, habillé en marchand et Ibn Ġurāb, susmentionné, l’hébergea pendant un temps.
Le Chypriote se promenait parmi les Francs en ville, où il y avait des marchands pour s’approprier
[Alexandrie]. Il observa le comportement des gens. L’émir Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām, après être revenu du
Ḥiǧāz, en eut connaissance et coupa en deux Ibn Ġurāb qui fut suspendu à la porte de Rašīd. (p. 159) Si la
porte de Dīwān, qui donne sur la ville, avait été ouverte, les musulmans auraient combattu les Francs du
sommet de sa muraille et auraient trouvé à manger des fruits secs d’al-Šām, parce que les propriétaires de
ces marchandises les faisaient garder et en donnaient à manger aux combattants.
Comme le jugement de l’émir Ǧunġurā n’était pas juste, et comme Ibn Ġurāb et le superviseur fermèrent la
porte de Dīwān, les Francs prirent la ville. La ration [de nourriture] pour chaque individu de la ville frontière,
grand et petit, arriva à son terme. Certains parmi eux furent tués et d’autres furent prisonniers. Certains
furent saufs et d’autres furent blessés. Certains désertèrent après avoir abandonné leur armée et avoir été
dans le désarroi. Certains renoncèrent à leur patrie et s’expatrièrent. Certains s’agglutinèrent aux portes et
moururent. Certains s’appauvrirent et subirent la séparation. Comme il fut rapide de s’emparer de la ville
frontière ! Comme il fut rapide de marquer à la braise les coeurs de la population ! Les Francs ont conquis la
ville frontière le jour même où ils descendirent à terre de leurs navires. Ils ne tinrent pas le siège (p. 160)
deux jours. Les Francs prirent la ville aux musulmans en deux heures. On dit que le siège dans d’autres
villes et places fortes dura un an ou deux.
[…] 130
(p. 162) Les Alexandrins fuirent les Francs par les portes de Sidra, Zuhrī et Rašīd après un fort
encombrement. Parmi eux certains furent rattrapés par les Francs et furent tués à la porte de Sidra. Certains
furent prisonniers. Certains descendirent de la muraille avec des cordes dans l’agitation ; parmi eux certains
furent blessés et d’autres furent saufs. Les Francs montèrent sur la porte de Sidra et y plantèrent des croix.
Chaque musulman fut consterné et effrayé en voyant les Francs. La sortie des Alexandrins par les portes fut
tout à fait extraordinaire à cause de l’agglutination et de la mort de quelques-uns due à la forte bousculade.
À ce moment, la compassion quitta les coeurs. Ils sortirent par les portes par milliers en professant la
formule : « Il n’y a de Dieu que Dieu ». Les champs et les contrées furent remplis par les gens. Certains
pillèrent les tribus. Le prix [des marchandises] que les vendeurs apportaient des contrées augmenta ; ils
vendirent cher ce qui était bon marché. On finit par être (p. 163) soucieux de se procurer de la nourriture à
cause de la hausse [des prix].
Poème
Je reviens à ce qu’il advint lorsqu’il y a eu une hausse des prix parmi les Alexandrins qui fuirent (p. 164) les
chrétiens. Certains vendirent ce qu’ils avaient sur eux, chiffon ou chemise de bonne qualité. Certains
vendirent ce qui les réchauffait, manteaux et fourrures légères, parce qu’ils voulaient sortir de leur ville
rapidement. Certains n’avaient sur eux ni un dirham ni un soupçon [de dirham]. Ils abandonnèrent leurs
maisons en fermant les portes que les chiens de Francs cassèrent pour y faire bonne chère. Les Francs
saccagèrent les boutiques et les fondouks. Ils chargèrent sur les chameaux, les mulets, les ânes et
les chamelles ce qu’il y avait. Ensuite, ils tuèrent au hasard ceux qui se cachaient, grands et petits. Ils
coupèrent les jarrets des animaux, certains moururent et d’autres furent blessés. Ils brûlèrent les qaysāriyya
et les khans. Ils violèrent les femmes et les jeunes filles. Ces infidèles et violeurs détruisirent les lanternes
des grandes mosquées. Ils hissèrent le drapeau des croisés sur la muraille. Ils firent prisonniers les
hommes, les femmes, les esclaves et les enfants, et, ils tuèrent tous les cheikhs impotents ainsi que les
fous, les idiots et les vieillards. [Les choses] légères que l’on porte, comme l’or et la belle joaillerie,
tombèrent des gens lorsqu’ils sortirent par les portes de la ville (p. 165) à cause de la force de la bousculade
et de la forte demande à l’aide. Certains individus sortirent avec ce qu’ils avaient sur eux. Certains perdirent
tout ce qu’ils avaient sur eux dans cette terrible bousculade. Certains perdirent leur argent quand ils sortirent
par les portes. Chacun était dans le regret et le chagrin à cause de la perte.
On dit qu’un certain marchand étranger131 sortit par la porte de Rašīd avec une bourse dans laquelle il y
avait six mille dinars. À cause de la forte bousculade à la porte, la bourse tomba de ses mains après qu’il
l’eut tenue fortement sur lui. Mais il ne put se baisser pour la prendre du sol à cause de la forte bousculade
et de celui qui était derrière, qui le poussa. Mais il sortit de la porte sain et sauf, le coeur blessé à cause de la
perte de sa bourse. Ses sentiments se déchirèrent, il ne dormit pas et ne se reposa pas. Il s’abandonna à la
folie. Son esprit et son sens le quittèrent. Il cria au secours, mais personne ne l’aida. Son corps maigrit
jusqu’à ce que ses os soient comme une dépouille mortelle.
Poème
(p. 166) Les Francs firent à Alexandrie ce qui fut évoqué du sac après avoir détruit, brûlé et emprisonné à
partir du milieu de l’après-midi du vendredi jusqu’à la fin de la journée du samedi, le jour d’après. Ils
brûlèrent, entre autres, les boutiques du change entièrement, le marché aux puces à Ma`ārīǧ, les boutiques
près de la qaysāriyya des étrangers, à l’extérieur, du côté est, les boutiques de la rue Al-Murǧāniyīn et
quelques-uns de ses fondouks, le fondouk Al-Ṭabībāt, le fondouk Al-Ǧūkandār, le fondouk Al-Damāmīnī qui
est dans le souq Al-Ǧiwār, la wakāla du Lin devant la grande mosquée Al-Ǧuyūšī, près d’Al-`Aṭṭārīn dans le
souq des vendeurs de bois. Ils brûlèrent le parapet de la madrasa Ibn Ḥabāsa avec le plafond de l’īwān. Ils
détruisirent de tout côté et de toute part. Ils brûlèrent la porte de la madrasa Al-Faḫr, proche de la porte de
Rašīd. Les monstrueux détruisirent au feu quelques boutiques d’Al-Maḥaǧa.
Un cheikh qui habite à Al-Maḥaǧa me raconta : « J’étais caché en haut de ma maison dans un endroit où je
voyais à partir d’un petit trou. J’ai vu les Francs qui venaient dans la boutique dont (p. 167) la porte était
fermée. L’un des Francs traça sur la porte une ligne noire et, au-dessus, une ligne rouge ; il alimenta de feu
la ligne pour embraser la porte rapidement. On dit que les Francs avaient des anneaux de brûlots avec, à
l’intérieur, de l’huile, du goudron, de l’asphalte et du naphte. L’un d’eux posa un anneau sur la pointe de la
flèche de l’arc de son coéquipier. Il embrasa l’anneau de feu. Il tendit la corde de l’arc pour décocher la
flèche qui monta et se ficha au plafond pour embraser le bois rapidement. Celle-ci descendit à terre et brûla
tout ce qu’il y avait dans la maison que les Francs ne voulaient pas emporter. Ils firent ainsi pour outrager les
musulmans. Que Dieu maudisse tous les Francs !
[…]
(p. 171) Je reviens à ce que les Francs firent encore à Alexandrie. Les maudits brûlèrent le fondouk des
Catalans, le fondouk des Génois, le fondouk des Bananes et le fondouk des Marseillais. Ils brûlèrent les
noisettes et les marchandises, car après avoir pris les richesses d’Alexandrie, ils n’avaient plus de place
pour charger leurs navires.
Les Francs détruisirent encore les boutiques des marchands de cire et des vendeurs, après avoir saccagé
les qaysāriyya des bazars où ils cassèrent les pots, les marmites et les récipients. [Ces récipients], jetés à
terre, traînaient sur les voies ; l’huile, le miel, le beurre de conserve et autres se répandirent. Ils cassèrent
aussi les boutiques des orfèvres et prirent ce qu’il y avait d’argent et de joaillerie de la même manière qu’ils
avaient pris des boutiques du change ce qu’il y avait de dinars et de dirhams. Ils pillèrent aussi les tissus des
marchands égyptiens et d’al-Šām, emballés et prêts à voyager en Égypte et à al-Šām. Ils pillèrent aussi la
soie importée par les marchands étrangers et autres, à Alexandrie. Il y en avait plusieurs quintaux. Ils
pillèrent des maisons (p. 172) les richesses, les tissus, les joailleries, les couchages, les tapis, les cuivres,
etc. Ils prirent la porte du phare qui fut restaurée par l’émir Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām avant l’événement, sur les
fondations du roi Al-Manṣūr Qalāwūn, qui était inemployée. Ibn `Arrām avait fait autour de la porte une
fortification. Les Francs prirent aussi les fenêtres de la coupole du tombeau de l’émir Ṭaġīya qui était sur la
péninsule et brûlèrent les plafonds des ribāṭ-s. Les propriétaires eurent peur pour les ribāṭ-s des Francs qui
étaient descendus de leurs bateaux. Ces derniers cassèrent leurs lanternes ainsi que celles des lieux saints.
Ils abîmèrent les châteaux de la péninsule et ses cimetières. Ils cassèrent les colonnes de la coupole du
minbar du lieu de prière pendant l’Aïd. [Ils cassèrent] les deux colonnes de la coupole du tombeau de l’émir
Ṭaġīya et de l’émir Balāṭ, où était inscrite la date de leur mort et qui étaient décorées d’or (p. 173) et de
lapis-lazuli. Ils arrachèrent les deux anneaux de la porte de la madrasa Al-Ḫalāṣīya qui fut restaurée par Nūr
al-Dīn b. Ḫalāṣ, qui étaient de cuivre ajouré ; Nūr al-Dīn fit d’autres anneaux à la porte de la madrasa
quelques mois après l’événement. Ils y prirent les deux chaises de Raba`a qui étaient de cuivre
d’Andalousie ajouré et incrusté d’argent tout autour. On n’avait jamais vu pareille fabrication aussi belle et un
ajour aussi merveilleux et soigné. Ils laissèrent les parties d’Al-Raba`a, [composé] de trente parties, gisant
dans la Madrasa susmentionnée. Ils ne prirent aucune partie. Ils montèrent à la cellule de la madrasa
al-Nābulsīya et ils y trouvèrent Ǧamāl al-Dīn, fils de celui qui la construisit, qui se cachait des Francs. C’était
un vieux et maigre cheikh. Les Francs le jetèrent sur la tête depuis le sommet jusqu’au sol ; son cou se
cassa, il mourut martyr – que Dieu lui accorde sa miséricorde ! Ils tuèrent ceux qu’ils trouvèrent dans les
mosquées cathédrales et les mosquées. Ils firent un massacre à Alexandrie. Ils tuèrent les gens dans les
maisons, les bains, les rues et les khans. Les Francs sortirent avec leur butin d’Alexandrie jusqu’à leurs
navires sur des chamelles, des chevaux, des mulets et des ânes. Quand ils finirent le saccage et achevèrent
leur objectif dans la ville, ils frappèrent [les animaux] avec leurs lances et coupèrent les jarrets de leurs
épées. [Les animaux] innombrables, gisant sur la péninsule et en ville, (p. 174) moururent. Comme ils se
décomposaient, les musulmans les brûlèrent pour faire partir l’odeur. Ensuite, les Francs se retranchèrent
sur leurs navires après les avoir chargés de leur pillage. Il y avait plus de soixante-dix navires. Ils laissèrent
sur la côte les restes d’épices pour lesquelles ils ne trouvèrent pas de place. [Les épices] retournèrent aux
propriétaires qui trouvèrent une étiquette dessus et qui les prirent. Les navires des Francs prirent du poids à
cause de ce qu’ils contenaient. Alors ils jetèrent ce qu’ils avaient dans la mer, d’après ce qu’on dit, pour
alléger cette importante cargaison. Les plongeurs remontèrent les cuivres et autres dans les environs
d’Aboukir.
Sans la bienveillance de Dieu pour les musulmans qui brûlèrent la porte de Rašīd et la porte de Zuharī, les
Francs auraient possédé la ville et [les Alexandrins] auraient eu du mal à en finir avec les Francs comme il
en advint à Tripoli, située à l’ouest, et à Antakia, sur la côte turque. On en viendra dans ce livre à ce qui s’en
s’ensuivit, j’évoquerai la victoire des Francs sur ces deux villes – si Dieu-le-Puissant le veut !
Dieu fut bienveillant avec les musulmans ; les Francs ne connaissaient pas le château d’armes qui se trouve
à l’endroit connu à Alexandrie, à Al-Zarabīya. S’ils l’avaient connu, ils auraient brûlé l’ensemble de ce qu’il y
avait d’armes en stock de l’époque des rois antérieurs. Que Dieu accorde leur sa miséricorde ! [Les rois
antérieurs] avaient mis de nombreuses armes qu’on ne peut compter.
(p. 175) Abū al-`Abbās Aḥmad chef des tireurs de la Qā`a de la Qarāfa, poste de guet pour l’Arme de la
guerre sainte132 volontaire, mentionna qu’il se trouve 60 000 flèches dans une seule des pièces de la qā`a.
On dit qu’il y a de nombreuses qā`a-s et dans chaque qā`a il y a de nombreuses pièces. Dans chaque pièce,
il y a des milliers de flèches et d’autres choses comme des épées, des lances, des javelots, des boucliers,
des casques, des aigrettes, des cottes de maille, des mailles, des boucliers de peau de poisson, des
ceintures, des chemises sans manches, des avant-bras, des genouillères, des jambières133, des jambières
de fer, des arcs courbés, des ǧaraǧ134, des étriers, des drapeaux. Les qalams ne peuvent compter [ces
choses]. Il y avait aussi des pierres de soin, des pièces d’artillerie, du naphte, de la poudre, des pièges de
guerre et ses nombreuses tactiques. Si les Francs avaient été au courant, ils les auraient brûlés rapidement.
Mais il résulta une grande bienveillance de Dieu pour leur méconnaissance de ce lieu. Après être venus à sa
porte, [les Francs] crurent que c’était une des portes de la ville. Ils eurent peur de (p. 176) la casser et qu’il y
eut une embuscade qui les surprenne.
[…]
(p. 177) On revient à l’évocation de ce que les Francs brûlèrent encore à Alexandrie. Ils brûlèrent les portes
de la Mer, la première et la seconde, les trois portes de la porte Verte, les portes de Ḫawḫa, des machines à
lancer des pierres qui étaient dans les deux fabriques de l’est et de l’ouest. Les Alexandrins, au moment de
leur défaite, abîmèrent des galères qui étaient dans les fabriques de l’est pour que les Francs ne les prissent
pas. Mais quand les Francs les virent abîmées, ils les brûlèrent avec du feu. Les Francs brûlèrent l’Atelier du
Tissage (Dār al-Tirāz) et la Douane après avoir pris de l’Atelier du Tissage les fabrications les plus chères.
Ils brûlèrent aussi la citadelle de Ḍirġām135, ainsi que le lieu connu sous le nom de Kuds, qui étaient à
l’endroit des fabrications.
(p. 178) La période de séjour des Francs, à partir du moment où ils vinrent à Alexandrie et où ils gagnèrent
jusqu’au moment où le dernier d’entre eux partit, est de huit jours. Ils vinrent le jeudi 21 de muḥarram 767136
et le dernier des Francs partit le jeudi 28 du mois susmentionné137. La raison de leur séjour pendant ces
jours était d’observer depuis la mer l’aide qui viendrait de Miṣr. Ils étaient sur leurs navires et quand ils virent
l’armée arriver, ressemblant à des criquets, avec à leur tête l’émir Al-Atābikī, nommé Yulbuġa al-Ḫāsikī, ils
partirent.
Poème
(p. 179) On dit que les Francs prirent avec eux des prisonniers alexandrins, environ cinq mille individus, des
musulmans et des musulmanes, des juifs ḍimmī138 et des juives, des chrétiens ḍimmī et des chrétiennes,
des esclaves et des enfants. Dieu connaît leur nombre. Ils les dispersèrent sur la Terre de Rūmāniyya139. Ils
les réduisirent en esclavage après qu’ils eurent été libres. Leurs familles d’Alexandrie furent prises d’une
telle tristesse qu’il il n’y en eut pas davantage au-delà.
p. 86-88 (tome III) :
Al-Ašraf Ša`bān et la garde d’Alexandrie et de Damiette
Quand le sultan Al-Malik al-Ašraf Ša`bān fut informé de ce fait140, il envoya les émirs du Caire aux deux villes
frontières d’Alexandrie et de Damiette pour les défendre. Il eut peur que ce fut une ruse et un artifice contre
les pays musulmans. (p. 87) Asanbuġā b. al-Būbakrī et Qutlubuġā al-Mansūrī, l’émir connu [sous le nom de]
Al-Sīdī, cousin du sultan Al-Malik al-Ašraf Ša`bān, vinrent à Alexandrie. Arūs al-Baštakī, l’émir Ibn Tafar
Dūmar, l’émir Šaraf al-Dīn b. al-Azakšī, l’émir du frère de Atabġā Ǧalb et l’émir Mubārak al-Ṭazī vinrent aussi
à Alexandrie avec leurs armées et leurs mamelouks. Ils entrèrent à Alexandrie au début de Ḏī al-Qa`da
772141. Il y avait aussi les émirs qui sont sur place comme le roi des émirs Ṣalāḥ al-Dīn Ḫalīl b. `Arrām,
Timrāz et Biktamar al-`Alamī, qui sont émirs de Ḥāǧib ; ils avaient leurs armées et leurs mamelouks. Il y
avait d’autres chefs de fabriques, les tireurs volontaires de la Qā`a et les tribus implantées à l’extérieur de la
ville. À l’intérieur de la ville, il y avait aussi des milliers de gens d’Alexandrie et d’ailleurs qui résidaient à
Alexandrie et qui étaient prêts à la guerre. Tous demandaient à combattre car la victoire ne vient que de
Dieu. Il ne vint (p. 88) aucun chrétien à Alexandrie et à Damiette au moment où ils surent qu’il y avait
beaucoup de ribāṭ-s. En 775142, les Génois se déplacèrent à Chypre, s’en emparèrent et l’occupèrent après
avoir tué plusieurs de ses habitants. Les Génois firent sortir le prince de Chypre et l’exilèrent sur une des
îles.
p. 210-216 (tome III) :
Histoire de Jacob le Juif avec Pierre de Lusignan
Al-Šarīf Muḥammad al-Ḥusaynī raconta : « Jacob le Juif susmentionné me raconta : "Lorsque l’émir Ṣalāḥ
al-Dīn m’envoya au chef de Chypre, les Francs me fouillèrent et me ligotèrent. Les deux Francs marchèrent
à mes côtés avec deux épées dégainées ; un à ma droite et l’autre à ma gauche. Nous enjambâmes
quarante galères attachées l’une à l’autre. J’y vis des prisonniers d’Alexandrie, des musulmans, des juifs,
des chrétiens ḍimmī, des hommes, des femmes, des esclaves, des enfants et des gamins, jusqu’à arriver au
roi qui se tenait au bout des galères. Le roi était assis sous une grande tente qui avaient deux fenêtres
cousues par lesquelles on voyait la mer. À sa droite se tenait un moine et à sa gauche, un autre moine.
Quand [les deux Francs] me levèrent entre ses mains, le roi demanda qui j’étais. Ils dirent que j’étais un
messager qui venait de la part de l’émir Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām, remplaçant du sultan à Alexandrie. Le roi se
leva sur ces deux jambes à ce moment-là, les deux moines se levèrent aussi car c’étaient ses serviteurs.
Puis le roi s’assit ainsi que les deux moines." Jacob raconta que le roi lui dit (p. 211) de s’asseoir donc il
s’assit. Autour du roi, il y avait une assemblée de dames d’Alexandrie au beau visage. Le roi avait sur la tête
une couronne d’or avec un joyau étincelant. Il portait une étoffe précieuse ornée de boutons d’or et de perles
disposées en série. Il me dit : "Pourquoi es-tu venu ?" Je dis : "Le remplaçant du sultan vous dit que nous
avons quarante-huit marchands francs, donnez-nous les musulmans et nous vous donnons les Francs". Le
roi me dit : “Salue le remplaçant du sultan et que chacun d’eux m’écrive dans son écriture Rūmiyya143, nous
informant de son nom, du nom de son père et de sa mère et quel jour du mois de Rūmiyya il fut emprisonné.
Si [ces informations] sont vraies, on saura qu’ils sont en vie. Nous lui donnerons comme rançon les
prisonniers d’Alexandrie. Nous ne resterons que jusqu’à demain en milieu d’après-midi et puis nous
partirons." Le juif dit : “Je retournai pour informer le remplaçant du sultan de ce fait.” Au moment de
l’événement d’Alexandrie, les musulmans sortirent (p. 212) ces Francs en direction de Damanhūr. C’est
pourquoi, lorsqu’ils demandèrent [les prisonniers francs], ils n’arrivèrent pas. Les Francs qui étaient sur les
bateaux virent arriver l’armée de Miṣr, qui avançait comme des criquets qui se répandent. Ils ne restèrent
pas et levèrent le camp. »
L’entrée de Yulbuġa al-Ḫasikī à Alexandrie
Quand l’émir Al-Atābikī Yulbuġa al-Ḫasikī entra à Alexandrie, il vit et observa le changement de son état [qui
n’était que] destruction, incendie et morts gisants à l’extérieur et à l’intérieur [de la ville]. Il pleura sur ce qui
se produisit et sur ce qui arriva à son peuple pendant les jours de prospérité et de son règne. Il se reprocha
de ne pas avoir fait cas d’Alexandrie au moment où arrivèrent les navires de l’île de Chypre. Il ordonna, à ce
moment-là, à l’émir Ṣalāḥ al-Dīn d’enterrer les morts. Il les enterra. Yulbuġa al-Ḫasikī lui fournit l’argent pour
reconstruire ce qui avait été détruit. Il [Ṣalāḥ al-Dīn] s’appliqua à reconstruire Alexandrie. Il creusa un fossé
du côté de la muraille par où les Francs étaient arrivés à Alexandrie. Avant ça, il n’y en avait pas. Il le réalisa
rapidement. Ce nouveau fossé se trouve à l’intérieur de la muraille, à côté du lieu nommé Dār al-Ṣinā`a,
Dīwān al-Ḫamis et Maḥārī al-Aqniyya. Il fit aboutir [le nouveau fossé], avec le fossé originel, qui au début
était au bord de la mer de Silsila et de la porte Verte, jusqu’à la (p. 213) citadelle de Ḍirġām. Il ajouta [un
fossé] à partir de la citadelle susmentionnée jusqu’à la mer du port est comme dans les temps anciens,
quand la mer frappait la muraille jusqu’à la citadelle de Ḍirġām. C’est pour cette raison que les Anciens
avaient laissé ce lieu sans fossé. Ensuite, la mer s’était éloignée de la muraille et ce lieu était resté sans
fossé. La paix s’était installée et ils n’avaient plus eu peur. Les musulmans négligèrent ce lieu et le laissèrent
sans fossé. Le sort frappa pour longtemps ; il change les époques et renverse les États. Les musulmans
étaient en paix et en sécurité, ils n’avaient pas de souci et de malheur depuis longtemps. L’ennemi trouva
l’endroit sans fossé et sans beaucoup d’hommes comme il a été mentionné dans l’évocation de la porte de
Dīwān, pour laquelle on eut peur que les marchandises ne rentrent dans la ville sans droit. L’ennemi réussit
à entrer dans la ville à cause de cette porte fermée interdisant les combattants musulmans de monter sur
son mur de ce côté-là. L’ennemi fouilla dans les maisons et fit la fête.
La wilāya144 de Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām, gouverneur d’Alexandrie pour une seconde fois
L’émir Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām construisit au cours de son second gouvernement un fossé (p. 214) à l’ouest
de la muraille, dans un endroit connu comme étant le Miṭraq. Le fossé commence à la citadelle de la porte
Verte et finit à la citadelle qui se trouve à côté de la Maison du sultan et de la porte de Ḫawḫa. Il le fit arriver
au fossé autour d’Alexandrie du côté de la terre. Ainsi, il y avait un fossé, un miṭraq et une cachette pour que
l’entrée de l’aide des musulmans se fasse en secret. Il construisit un mur donnant sur la mer pour sortir
jusqu’à la péninsule à l’improviste au moment où la guerre des Francs viendrait. Ensuite, il construisit le
miṭraq est à côté de la Maison des Émirs. Ensuite, on coula des pierres dans le port ouest pour préserver les
bateaux musulmans. Il scella l’entrée des [pierres] englouties avec une chaîne colossale. Il fit aussi une grille
de fer pour la porte de Ṣinā`a, à l’ouest, du côté du Miṭraq susmentionné, pour que les tireurs sortent au port
et y entrent au moment de la guerre, afin que les portes d’Alexandrie restent fermées à ce moment-là. Si
l’ennemi devait surprendre les musulmans, ces derniers pourraient entrer [par la grille en fer] et les tireurs
postés sur la muraille protégeraient les musulmans jusqu’à ce que tous fussent entrés. Après que les
musulmans seraient entrés, on baisserait la grille de fer. Seuls les musulmans la lèveraient du haut de la
muraille avec une chaîne circulaire entourant une roue d’engrenage rendue nécessaire par sa lourdeur et sa
grosseur. La construction du miṭraq ouest (p. 215) et de la porte de la Grille en fer fut réalisée en 769145. On
en viendra par la suite, dans ce livre, à l’évocation de l’engloutissement des pierres dans le port de la mer de
Silsila et à l’histoire du creusement du nouveau fossé, qui domine l’ancien fossé, et comment on le creusa –
si Dieu le veut !
L’émir Ṣalāḥ al-Dīn b. `Arrām le susmentionné fit couler les pierres pour préserver les bateaux musulmans et
creusa le nouveau fossé, il construisit les deux miṭraq-s et rétablit ce qui fut détruit à Alexandrie. C’est lui qui
construisit les portes de la Mer, la première et la seconde, en remplacement des deux portes que les Francs
brûlèrent. Il construisit aussi les deux portes de Rašīd que les Alexandrins brûlèrent au moment de
l’événement pour que l’aide de Miṣr trouvât le lieu ouvert et qu’elle se dirigeât pour combattre les francs.
Aussi, les musulmans brûlèrent la porte de Zahra pour que l’aide entrât. Ensuite, l’émir Ṣalāḥ al-Dīn
construisit les portes de Dār al-Ṣinā`a à l’est et les portes de Dīwān, puis il ferma la porte Verte, la porte de
Ḫawḫa, la porte de Zuhrī et la porte d’Aqniyya. Il fit un bon travail pour avantager (p. 216) les musulmans.
Poème
Ensuite, l’émir Al-Atābikī Yulbuġa al-Ḫasikī demanda à l’émir Ṣalāḥ al-Dīn d’être le chef des Douanes à la
wilāya du Caire. Il nomma Sayf al-Dīn al-Akaz gouverneur d’Alexandrie, celui-ci y resta un an. Ensuite, il en
fut destitué. Il y fit alors revenir l’émir Ṣalāḥ al-Dīn l’année susmentionnée. Au temps de la wilāya d’Al-Akaz,
il réinstalla sur la porte Verte les trois portes qui avaient été bouchées avec des pierres et de la chaux le jour
de l’événement en 767146. »147
AL-NUWAYRĪ (1368)
Le passage suivant, traduit par Ét. Combe, fait partie également du texte d’al-Nuwayrī (Kitāb al-Ilmām,
tome V, p. 380-418 et tome VI, p. 1-19).
Combe, Ét., « Les Sultans Mamlouks Ashraf sha’ban et Ghauri à Alexandrie », BSAA 30-31, 1937, p. 34-48.
p. 37-42 :
« Arrivée à Alexandrie du Sultan Malik Ashraf Sha’ban, description de son entrée dans la ville, et autres
digressions inspirées au cours du récit :
Le Sultan Malik Ashraf Sha’ban, fils de Husain, fils de Malik Naçir fils de Malik Mançour Qalâwoun, arriva le
vendredi 4 djumâdâ I 770 (15 décembre 1368) dans la ville frontière d’Alexandrie, que Dieu la garde !
Il entra par la porte de Rosette, Bâb Rashîd, le matin du dit jour, précédé de fauconniers tenant des faucons,
des éperviers, des gerfauts et des orfraies, à la tête desquels se trouvait un faucon blanc valant son pesant
d’or. Ces oiseaux de proie étaient suivis par des léopards, dont les yeux ressemblaient à des tisons
enflammés… Puis venaient des tigres… Ayant passé la dite porte, le Sultan suivit la Grand’Rue, où s’étaient
réunis les hommes, les femmes et les esclaves pour le voir. Tous l’acclamèrent, les femmes poussant des
cris d’allégresse, émerveillés de sa jeunesse, de sa gentillesse et de sa beauté.
Le sultan montait un cheval blanc, dont les sabots foulaient les pièces de soie tendues par terre ; les émirs,
à pied, l’entouraient. Les hérauts criaient, les chanteurs frappaient les tambourins, les poètes déclamaient
leurs vers en s’accompagnant de leurs violes. Les flûtes faisaient entendre leurs sons mélodieux et les
oreilles étaient frappées par la beauté de la musique ; les corps, ravis à l’ouïe de ces mélodies, se
balançaient comme des branches. Tous les yeux étaient charmés par la vue de la beauté du souverain…
Des tshifta escortaient le sultan ; ce sont deux mamloûks blancs, montés sur des chevaux blancs, vêtus
d’une tunique de soie jaune à bordure d’or, et portant sur la tête des kafîya brochées d’or. Ils marchaient sur
le même rang, sans se dépasser d’une fraction de pas. Un homme à pied tenait les deux mains, au-dessus
de la tête du sultan, le dais, ghashîya, surmonté d’un oiseau d’or semblable à un pigeon, qu’il tournait à
droite et à gauche. Un autre, en avant du premier, portait une seconde ghashîya incrustée d’or. Sur le cou
du cheval du sultan était une barde en or, incrustée de pierres précieuses. Le souverain était vêtu d’une
tunique verte, fourrée d’hermine blanche. Derrière lui, on tenait en mains environ 50 montures royales, dont
le cou et la croupe étaient recouverts de housses brochées d’or, enrichies de pierres précieuses. Le sultan
avait alors moins de 16 ans et sa figure était belle comme la pleine lune.
Le cortège parcourut la Grand’Rue jusqu’à la mosquée Aboû‘l-Ashhab, où il obliqua, passa devant la
demeure d’Ibn al-Djabbâb, et continua jusqu’aux lavoirs des foulons et aux magasins pour l’exportation. Puis
il sortit par Bâb al-Bahr, la Porte de la Marine, qui est au bout de la ville. Face au Palais de Justice et à
l’Atelier de Tissage, Dâr al-Tirâz, on répandit devant le sultan des poignées de dinars, que les gens
ramassèrent. Continuant sa route, il passa la seconde, puis la troisième poterne de ladite Porte de la Marine,
et il vit alors la mer et le port où se trouvaient les vaisseaux des Francs. Ce jour-là, aucun négociant franc, ni
jeune étranger, ne resta en ville ; ils se réfugièrent tous sur les vaisseaux par crainte du sultan.
Le souverain contempla les forts et les tours des murailles qui longent la mer ; elles étaient ornées de toutes
sortes d’équipements d’armes et de boucliers ; des bannières de soie de diverses couleurs flottaient au vent,
ainsi que des étendards dont l’aspect réjouissait les yeux et tranquillisaient les âmes. Il examina ensuite
l’endroit où les ennemis avaient escaladé les murs, et il vit le nouveau fossé qui avait été aménagé par l’émir
Çalâh addîn Ibn ‘Arrâm là où cette escalade avait eu lieu. En effet, il n’y avait précédemment aucun fossé en
cet endroit et l’on pouvait arriver à pied jusqu’à toucher la muraille. Le Sultan examina aussi le fossé Ouest,
qui fut restauré alors, derrière la Porte Verte, Bâb al-Akhdar, et qui est connu sous le nom de mitraq. Puis il
entra en ville par cette dernière porte, et, continuant sa route, passa par le mausolée du pieux jurisconsulte,
le savant et très docte shaikh Aboû Bakr al-Turtoûshî ; de là, il se dirigea vers l’esplanade de la Djâmi
al-Gharbi, puis vers le Palais du Sultan, Dâr al-Sultan, qui en est voisin. Les rues regorgeaient de monde, et
tous l’acclamaient en formant des voeux à son adresse.
Après la prière du vendredi, le sultan sortit à cheval ; on ouvrit la première et la seconde poterne de la Porte
de la Marine. Son vizir Saif addîn al-Akiz, dont on a rapporté précédemment la nomination comme wâlî de la
ville, le conduisit entre les deux murs et l’accompagna à l’Atelier de Tissage, où le Sultan mit pied à terre. Il
entra dans le dit atelier, gravit les escaliers et arriva dans la salle où se trouvaient les métiers et les dépôts. Il
vit alors chaque ouvrier tissant sur son métier diverses belles étoffes et des habillements complets, de
couleurs variées, déjà pliés, à l’usage du harem du sultan.
Une personne m’a dit avoir connu à la Citadelle du Caire un mamloûk particulier du Sultan, qui lui a raconté
ce qui suit : Lorsque le souverain fut monté dans l’atelier, il ôta sa calotte, ses tuniques et se mit à l’aise. Il fit
le tour des métiers et, les examinant de près, passa la tête en-dessous pour se rendre compte de leur
mécanisme intérieur et voir comment les ouvriers pratiquaient leur tissage, jetaient et faisaient revenir leurs
navettes. Il leva ensuite la tête afin de voir au haut des métiers comment les jeunes porteurs soulevaient et
abaissaient le fils de la chaîne, maçadi, et de quelle manière on confectionnait les oiseaux, les dalât, les
bordures (shadharwân) et tout autre motif, au moyen de ces fils qui montaient et descendaient jusqu’à ce
que les oiseaux ou les autres dessins fussent terminés. Continuant sa tournée, en examinant chaque chose,
il se trouva devant un vieillard, d’âge fort avancé, qui travaillait sur son métier, oscillant de gauche et de
droite en passant ses navettes entre les fils de la chaîne ; il composait ainsi un tissu splendide, semblable
aux fleurs du printemps. « Courage, mon père ! lui dit-il ». Mais le vieillard ne leva vers le sultan ni la tête, ni
les yeux, et ne répondit même pas par quelque parole de salutation ; il resta tout à son travail, observant la
marche de sa navette. Le sultan fut surpris de son endurance au travail, malgré son grand âge, de sa sûreté
remarquable dans son art, comme aussi de son silence… Malik Ashraf exemina ensuite tout ce qu’il y avait
dans l’Atelier de Tissage comme ouvrages brochés, étoffes à dessins rayés, et vêtements de soie, brochés
d’or, entièrement achevés. Il en choisit quelques-uns pour les emporter avec lui et laissa le reste jusqu’à ce
que le travail fut complètement terminé.
Pendant cette visite, le sultan aperçut une grande jarre d’eau, sur laquelle était un gobelet de terre cuite
rouge, qui servait aux ouvriers de l’atelier à puiser l’eau dans ce zîr. Il le remplit de ses mains et en but. Le
shaikh Aboû ‘Abd-Allāh Muhammed, fils de Yoûsuf al-Baghdâdi, professeur dans ce tirâz, auquel j’ai
demandé, s’il était exact, comme on me l’avait dit, que le sultan avait rempli lui-même un gobelet en terre
cuite avec l’eau du zîr de l’atelier et en avait bu, me confirma le fait, en ajoutant : « Je l’ai vu de mes yeux
boire de la jarre en question, et les ouvriers se groupèrent même autour du gobelet, qu’ils appelèrent :
gobelet du sultan. Ils eurent alors l’habitude de dire : donne-moi à boire avec le gobelet du sultan. Et ce
gobelet acquis parmi eux une grande renommée ».
De là, Sha’bân, se rendit à l’arsenal, Dâr al çinâ‘a, où il vit des galères de combat et des manguenneaux
diaboliques ; on fit devant lui des exercices de tir qui lui plurent. Puis, il revint, entre les deux murailles
jusqu’à la Porte Verte, par où il entra dans la ville. Il continua sa route jusqu’au château d’armes, Qaçr al-
Silâh, qu’il visita, examinant les nombreuses armes qui avaient été emmagasinées dans les salles de
château sous les règnes précédents. Il donna alors l’ordre d’y construire une salle d’armes à laquelle on
donnerait son nom, comme on avait jadis donné les noms des souverains aux salles royales qu’ils avaient
créées. Cette salle fut en effet construite peu après sa visite et on y emmagasina une quantité énorme
d’armes de fer. Lorsque les Francs s’étaient emparés d’Alexandrie. Ils étaient parvenus, tant cavaliers que
fantassins, à la porte de ce qaçr, que Dieu protégea. Dans Sa mansuétude et Sa grâce, Il leur suggéra que
c’était une mosquée destinée à la prière et au culte des Musulmans ; ils s’abstinrent donc d’y pénétrer. Mais
s’ils avaient compris ce qu’était ce bâtiment, ils l’auraient certainement brûlé après en avoir emporté les
nombreux équipements et les armes solides…
Le sultan fit la prière de l’après-midi du vendredi dans la mosquée du château mentionné, puis il monta à
cheval et sortit de la ville par la Porte du Lotus, Bâb al-Sidra. Il se dirigea vers son camp, dressé à l’endroit
connu sous le nom de al-Sarîya, dans les environs à l’Est de la ville. Il y passa la nuit et la journée du
lendemain, le samedi. Les habitants hommes, femmes et esclaves, vinrent visiter son campement ; ils purent
entrer dans son pavillon de réception qui y était dressé. Cette tente était faite d’une splendide étoffe de
coton écru, d’une blancheur éclatante ; dressée très haut dans les airs, elle était ornée de diverses bandes
d’étoffes de couleur, et des tapis couvraient le sol. Le sultan se tenait un peu plus loin, dans une grande
tente nommée “la ronde”, al-mudawwara. Il laissa la foule admirer l’intérieur de son pavillon et contempler sa
beauté, sans les bousculer, ni les gêner ; tous étaient ravis aussi de voir sa belle figure.
Puis il partit de l’endroit nommé al-Sarîya, situé en dehors d’Alexandrie, dans la nuit du samedi soir, dont le
lendemain était le 6 djumâdâ I de l’année 770 (17 décembre 1368). La ville resta encore toute pavoisée
pendant deux jours après son départ.
Que Dieu lui accorde toujours la victoire et qu’Il fasse que, sous son règne, l’île de Chypre tombe aux mains
des Musulmans ! »
- 78 - 89 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
LIONARDO DI NICCOLO FRESCOBALDI (du 27 septembre au 5 octobre 1384)
Bellorini, T., Hoade, E., Bagati, B., Visit to the Holy places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by
Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6, Jérusalem, 1948.
Lionardo Frescobaldi voyage en compagnie de Giorgio Gucci et Simone Sigoli pour accomplir le pèlerinage
aux Lieux saints. Ces trois Florentins ont chacun écrit un récit de voyage. Lionardo Frescobaldi, le plus âgé,
est la personnalité la plus importante des trois, il appartient à une noble famille. En 1379, il est l’un des
20 Grands élus du peuple florentin. À son retour de voyage, il devient Majeur du château et, en 1390, il
obtient la seigneurie de Montepulciano, près de Florence. En 1398, il est ambassadeur du pape Boniface IX,
et, en 1405-1406, il combat vaillamment les Pisans.148
p. 37-42 :
« Ainsi avec un temps calme, nous allâmes jusqu’au port d’Alexandrie l’ancienne où nous arrivâmes durant
la nuit, au vingt-septième jour dudit mois de septembre.
Débarquement à Alexandrie
Par peur des Sarrasins, nous jetâmes l’ancre au large. Du coucher au lever, nous fûmes dans une telle
détresse que nous ne pouvions avoir (p. 38) plus en enfer. Le bateau fut tout le temps jeté sur le côté par les
vents, si bien qu’un côté allait en l’air et l’autre vers la terre, une fois en haut, une fois en bas, sans avoir
jamais un moment de repos et de répit. Au milieu de la journée, des fonctionnaires sarrasins du sultan
vinrent sur un bateau sarrasin. Ils étaient au nombre de vingt, des noirs et des blancs, à inspecter les
marchandises et les hommes à bord, sans rien écrire. Ils emportèrent, selon leur habitude, les voiles et le
gouvernail. Plus tard, les estimateurs du sultan ainsi que le consul des Français et des pèlerins vinrent avec
des bastagi, c’est-à-dire des porteurs, qui nous prirent, nous et nos bagages. Le 27 septembre, ils nous
conduisirent à l’intérieur du port d’Alexandrie et nous présentèrent à des fonctionnaires qui nous inscrivirent
et nous comptèrent comme des animaux, puis ils nous confièrent au susdit consul. Ils ont tout d’abord
cherché soigneusement, jusqu’à la peau, puis ils ont mis nos affaires dans la douane, les ont ouvert et
dénoué ; ils ont ensuite fouillé dans chacun de nos paquets et sacs. Sincèrement, je redoutais qu’ils ne
trouvent les six cents ducats que j’avais mis dans la ceinture du caleçon ; ils auraient été perdus et nous
aurions été traités plus durement. On leur paya deux pour cent sur l’argent en argent et en or et sur nos
affaires. On paya un ducat chacun comme tribut. Puis nous nous rendîmes avec ce consul dans sa maison
qui est très grande et bien située. Il est de France et son épouse est une chrétienne née en pays sarrasin ;
tous deux avaient moins d’une once de foi. Il nous assigna quatre chambres au-dessus d’une cour dans
lesquelles il y avait seulement le plancher. Chaque chambre contenait une grande cage, comme une cage à
poules, dans laquelle chacun y plaça son matelas pour dormir. Devant la sortie des chambres, il y avait une
voûte sur colonnes sans toit, large de cinq brasses, avec un parapet devant. Ceci tournait autour de la cour
comme dans un cloître de frères. La marchandise est gardée sous les chambres. Notre consul nous
demanda si nous souhaitions loger chez lui, nous répondîmes oui et nous tombâmes d’accord sur un prix. Il
nous emmena chez le consul des Vénitiens, des Catalans et des Génois, ainsi que chez Guido de‘ Ricci,
l’agent des Portinari. Nous avions des lettres de recommandation à remettre à tout le monde grâce
auxquelles nous fûmes bien reçus. Le matin, nous fûmes invités par chacun à dîner. Ces derniers nous
traitèrent avec opulence, faisant de grands efforts et nous accompagnant dans la ville comme si nous étions
des ambassadeurs.
La situation militaire à Alexandrie
(p. 39) Sache qu’aujourd’hui la ville d’Alexandrie n’est pas où elle était au temps de Pharaon, roi d’Égypte,
mais elle n’est pas loin d’elle. Nous étions dans la vieille Alexandrie et à l’endroit où saint Marc l’Évangéliste
fut décapité, là il y a une indulgence plénière. La nouvelle Alexandrie, que le roi de Chypre pris une fois
quand il était en croisade, est celle d’aujourd’hui. Il est vrai qu’après sa prise par les Sarrasins, elle fut bien
fortifiée, avec de beaux murs et des tours rondes ainsi que de bons fossés. Ils disent qu’entre les Sarrasins,
les juifs et les chrétiens renégats, on compte soixante mille âmes. Là, un amiral réside avec beaucoup
d’hommes armés pour garder la ville et le pays ; ils seraient rudes s’ils s’apercevaient que l’on regarde leur
forteresse. Ces derniers craignent les chrétiens, qu’ils appellent Francs, qui ne sont pas d’ici, bien que nous
soyons moins nombreux. Par contre, ils ne craignent pas les autres chrétiens. Le mot Franc vient de
Français parce que nous sommes tous appelés Français. Ces hommes armés, qui sont sous le
commandement de l’amiral, sont Tatares, Turcs, Arabes et certains Syriens. Mis à part certains caporaux, ils
ne portent pas d’armures sur le dos ou sur la tête, et rarement de cuirasse et de panziera. Comme coiffe, ils
portent un petit chapeau attaché avec une dentelle blanche de lin brodée selon la mode sarrasine. Certains
d’entre eux portent l’arc syrien et un sabre à la ceinture. Le sabre est comme une épée mais il est plus court
et est légèrement recourbé et sans pointe. Leurs chevaux ressemblent presque à ceux de Barbarie et sont
d’une seule taille ; ils sont de bons coureurs. Ils les gardent dans une stalle sans literie ou mangeoire. Il est
vrai qu’ils ont une couverture sur les côtés. Ils mettent la nourriture dans un sac et l’attache à la tête avec
deux cordes, ainsi la bouche peut être mise dedans ; c’est ainsi qu’ils leur donnent à manger.
Une audience avec al-Malek
À Alexandrie il y a un seigneur, qui représente le sultan, appelé Lamolech qui signifie autant que roi. Cet
homme loge dans la maison qui appartenait à (p. 40) la sainte Vierge Catherine et qui est autre que jadis, ce
dont nous parlerons plus bas. L'habitation de ce seigneur est très grande et, avant d'arriver au palais royal,
on trouve une porte très grande où nous vîmes une importante troupe de soldats. Notre consul parla, dans
leur langue, à l’un des caporaux : le seigneur a fait appelé les pèlerins ; ils sont là pour obéir à ses ordres.
Immédiatement, l’un d’entre eux s’en alla et tarda avant de revenir. Je ne sais pas où il alla, mais tout de
suite ils nous emmenèrent à l’intérieur d’une cour et nous conduisirent à une autre porte au bout de la cour
où il y avait une belle loggia dans laquelle beaucoup de barons et de courtisans y étaient. Ces derniers nous
reçurent joyeusement et certains qui se mêlèrent à nous, nous firent monter par une grande cage d’escalier.
En haut de cette cage d’escalier, il y a une porte qui mène à une grande salle. Tout en haut, était assis sur
du tissu de soie, les jambes croisées, le roi avec ses barons qui étaient debout devant lui. Un bon tiers de la
salle était décoré des plus beaux tissus et tapis, les plus beaux étaient accrochés sur les murs. Un autre
tiers de la salle avait des tapis moins splendides et n’était pas aussi bien décoré. Le tiers restant, près de la
porte de la salle par laquelle nous entrâmes, était rempli des plus belles nattes et des plus beaux joncs
marins. Avant d’entrer sur les nattes, nous devions nous agenouiller pour embrasser la main droite de
chacun. En atteignant les premiers tapis, nous devions faire de même, ainsi qu’aux autres sur lesquels fut
assis le seigneur. Par le biais de son interprète, le seigneur nous demanda beaucoup de choses sur nos
coutumes, nos modes et nos richesses, sur l’empire et la papauté. Il désirait savoir s’il était vrai que notre
empereur n’avait pas pris la couronne149, et si nous avions bien deux papes150, comme les personnes qui
furent là l’ont rapportées. Nous répondîmes que notre pouvoir, c’est le courage et la vertu ; quant à l’empire
et à la papauté, nous pensons à l’honneur de Dieu et à la Sainte Église ainsi qu’à notre devoir. Cet homme
ne nous questionna pas sans raison ; comme vous le verrez dans les traités du sultan quand nous parlerons
de sa situation, les païens n’étaient pas d’accord avec nous.
Visite d’Alexandrie
Nous quittâmes ledit seigneur et nous allâmes voir les coutumes de la ville, les lieux saints et les autres
richesses de ladite ville.
La nouvelle Alexandrie est sur la mer, comme on l'a dit, et elle est aussi grande que Florence. C’est une ville
commerçante, particulièrement en ce qui concerne les épices, le sucre, les tissus de soie, parce que d’un
côté, il y a la mer. Un canal venant du Nil coule près de là ; (p. 41) le Nil vient du Gibz151, qui vient du
Paradis Terrestre, va en Inde, comme nous le mentionnerons plus tard, et passe près de la mer Rouge. Par
mer et par le fleuve du Nil, font voile beaucoup de marchandises susdites qui viennent du sud par caravanes
sur des chameaux pour finir toutes à Alexandrie ou à Damas. Pour cette raison, cette ville est très
importante parce qu’elle n’est qu’à trois cents milles de la ville impériale du Caire dans laquelle réside le
sultan. Ils ont une coutume quand un citoyen bien établi meurt ; ils l’enterrent dans un cimetière qui se
trouve hors de la ville, dans un champ vers la vieille Alexandrie. Un grand nombre de citoyens
l’accompagnent selon la situation sociale de l’homme. S’il est riche, ils lui envoient beaucoup de porteurs
chargés de moutons vivants qu’ils sacrifient et qu’ils donnent aux pauvres et au clergé comme nourriture
pour [l’amour de] Dieu. Ainsi chacun donne l’aumône selon sa position et ses moyens. Ils ne souhaitent pas
trouver devant eux dans ces cortèges des chrétiens francs. S’ils en trouvaient, ils les traiteraient plus
rudement que d’autres chrétiens. À Alexandrie se trouve la prison dans laquelle sainte Catherine fut jetée ;
près de là, il y a deux colonnes sur lesquelles se trouvaient les roues de la martyre sainte Catherine, qui par
un miracle de Dieu se cassèrent dès qu’ils les touchèrent. Entre ces colonnes, elle fut décapitée. Il y a aussi
l’endroit où saint Jean fit pénitence. Il y a la pierre sur laquelle fut décapité saint Jean-Baptiste à Sébaste
dans la prison d’Hérode. À un demi-mille, hors d’Alexandrie, se trouve l’église de Saint-Athanase dans
laquelle il composa le « Quicumque vult salvus est etc152. » À Alexandrie, il y a beaucoup de différents
chrétiens, ainsi qu’au Caire et à Jérusalem, dont nous ferons mention plus tard. Les mosquées, c’est-à-dire
les églises des Sarrasins n’ont ni sculptures, ni peintures, et sont toutes blanchies et crépies à l'intérieur, et
[contiennent des ornements] en gypse. Sur leurs clochers, il n'y a pas de cloches, et on n'en trouve pas dans
toutes les [contrées] païennes. Toutefois, leur "chapelains" et leurs "prêtres" se tiennent sur les clochers le
jour et la nuit, criant quand c'est l'heure [de la prière] comme nous le faisons en sonnant [les cloches]. Ils
crient pour bénir Dieu et Mohammad en disant : croissez-vous et multipliez-vous et d’autres mots
malhonnêtes. Les Sarrasins font une grande fête le lundi ; ils disent que c’est un jour de sacrifice, mais les
autres jours ils s’abstiennent non pas de malhonnêteté mais de prière. Tôt le lundi, ils crient au sommet de
leurs mosquées pour que leurs prières puissent être entendues par Dieu et Muhammad, et, pour que les
gens aillent se laver aux bains. Vers midi, après s’être lavés, ils vont à la mosquée pour faire leurs prières
qui durent deux heures environ. Comme il a été dit, leurs mosquées sont toutes blanches à l’intérieur ; elles
sont décorées d’un grand nombre de lampes et ont toutes une (p. 42) cour au centre. Ils ne veulent pas que
les chrétiens y entrent ; celui qui entre, renie sa foi ou bien le fait en [sachant qu’il risque la] peine de mort.
Au moment de la prière, tous les chrétiens francs sont enfermés dans un logement appelé Cane153. Ce nom
vient du fait que nous sommes considérés comme des cani154. Quant aux autres chrétiens, ils ne sont pas
enfermés, mais restent dans leurs maisons jusqu'à ce qu'ils sortent de leurs mosquées. À Alexandrie, nous
passâmes notre temps à faire des visites, voir la noblesse de la terre, se reposer après les désagréments de
la mer, acheter des bandes de tissu de soie, de la même mesure que le Sépulcre, lesquelles sont bonnes
pour les femmes qui sont sur le point d’accoucher, et remplir notre baril de Malvoisie car nous devions
emporter du vin dans le désert. Ce fut dur à trouver car leur loi leur interdit de boire du vin. Ainsi, nous
devions nous en procurer par le consul des Vénitiens chez qui nous passâmes quelques jours. »155
- 90 - 92 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
GIORGIO GUCCI (du 27 septembre au 5 octobre 1384)
Bellorini, T., Hoade, E., Bagati, B., Visit to the Holy places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by
Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6, Jérusalem, 1948.
Giorgio Gucci appartient à une famille à la fois populaire et illustre de Florence où il est prieur en janvier et
février 1379. En 1383, il est envoyé comme ambassadeur à Rome. Nous savons par ailleurs qu’un certain
Agnolo Ricasoli devient évêque de Faenza grâce à Giorgio Gucci et qu’à son retour de voyage, notre pèlerin
se porte garant entre Pieruccio Malipieri et Cavalier Beltramo.156
Rappelons que Giorgio Gucci voyage en compagnie de Lionardo Frescobaldi et Simone Sigoli, également
auteurs d’une relation de voyage.
p. 94-96 :
« In Alexandria we found many notable things, as that city is very large in circuit and well full of houses ; and
a big number of people live in that city, and great business transactions go on there all the time, and there
are many Christians in the business, as Genovese, Venetians, Catalans, Aragonese, Provençals, Pisans,
Florentines, and their like from many other provinces. And the city has great wealth, and it is a city
over-abounding in everything and good things, as bread, meat, fish and fruit of every kind. Of the notable
things we found, first, where St Catherine was martyred in a street between two columns, which are
standing : and there beside one of the said columns the prison where St Catherine was detained. And
between the said two colums King Peter, son of King Hugh, king of Cyprus, to the honour of God and the
holy faith, had Mass said and the Body and Blood of Christ offered up, in the month of October in the year of
the Lord MCCCLXV ; when this king took the said city of Alexandria which he held for three days. Then the
majority of the Christians who were with him, and among others a Viscount of Turenne, a brother of Pope
Gregory XI, seeing themselves rich, and out of (p. 95) cowardice in fear of the big army of the Saracens,
against the which of the said king, abandoned him ; and so it returned into the hands of the Saracens. And
then where St John Chrysostomos did penance, which is a devout place : and great miracles done by him in
this place before his death are recorded here. And outside the said city gate of Alexandria, perhaps at half a
mile, between Old Alexandria and New Alexandria, – for the city of which we spoke first is called new
Alexandria, and Old Alexandria is where Alexandria was formerly about a mile from the new, and there live
villagers and peasants, who work the land, and it is on the sea, but near the sea – is where St Mark the
Evangelist was beheaded. And the Christians cannot go there, solely because the Saracens fear that a man
going there and seeing it would find means and ways by which the said city of Alexandria could be taken
from them by the Christians. So they are very suspicious and have always a big guard, and especially since
King Peter took it from them, as just said. In the said city resides the admiral representating the Sultan, who
is called Milcaramira, which being rendered is King of Kings, to whom we, and all pilgrims who pass that
way, presented ourselves, and we saw him and we talked, and great reverence must be done to him, that is,
we had to put off our shoes before reaching where he was, and kneel down bareheaded and kiss the earth.
We stayed in Alexandria eight days, that is, on Wednesday we arrived and the next we parted ; and in this
time we visited the said things and many more, too long to relate. And then we furnished ourselves with
biscuits and many other supplies we needed to take with us through the desert, because one must supply
one’s self with nearly everything in Alexandria. On the said Wednesday on the V day of October, about the
hour of terce, we left Alexandria with the interpreter whom we had to guide us as far as Cairo, and with
another Saracen who had our papers of presentation, for by skin and features we were noted : and this they
do for the security of Christians and pilgrims that they may not be killed on the way or robbed in any way.
And as they are represented on paper in number and features, so they must be (p. 96) presented in Cairo.
And you leave Alexandria by the gate that leads out towards Cairo.
Leaving Alexandria we headed for Cairo ; and in the said way you see much of the city and the walls of that
city, because it is entirely walled with good high walls, with frequent towers and good moats. And as we were
outside Alexandria with many camels to carry out victuals and supplies, we mounted our asses, because
there nobody rides a horse save men-at-arms and the courtiers. And we went to a port a mile or more from
Alexandria, and to this port come all the ships that come from Cairo, and from a certain places in Alexandria
by an artificial canal from XVI to XVIII braccia wide. And the canal is from L to LV miles long, and the water of
the said canal comes from the Nile or Caligine, where the said canal begins. Which canal supplies
Alexandria and all the country round with sweet water. There we, with all our supplies, put to sea to continue
our voyage to Cairo, going up the said canal at times by oar and at times towed : and the boatman are
Saracens. On this canal there is a great number of beautiful and fine gardens, with great quantities of the
most perfect fruits, as, oranges, cedars, limons, Adam’s apples, walnuts, dates, grapes, figs, pomegranates,
water melons, cassia and so of many kinds of fruit. And along the said canal and all around Alexandria there
are many suburbs and beautiful houses, after the Saracen fashion, where they dwell at times for holiday.
And they have one kind of fig tree, which they call Pharaoh’s fig, which produces eight times a year. »
156 Bellorini, T., Hoade, E., Bagati, B., Visit to the Holy places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by
Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6, Jérusalem, 1948, p. 3.
Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans P. Amat di
San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I, Rome,
1882-1884, p. 117.
- 93 - 94 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
SIMONE SIGOLI (du 27 septembre au 5 octobre 1384)
Bellorini, T., Hoade, E., Bagati, B., Visit to the Holy places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by
Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6, Jérusalem, 1948.
À propos de Simone Sigoli, nous savons seulement qu’il fait partie d’une ancienne famille noble. En 1365, il
apparaît comme garant pour un certain Gerio Jacobi.157 D’après Pietro Amat di San Filippo, Simone Sigoli se
dédierait au commerce en raison de ses citations sur le commerce et l’industrie en Orient.158
Rappelons que Simone Sigoli voyage en compagnie de Lionardo Frescobaldi et Giorgio Gucci, également
auteurs d’une relation de voyage.
p. 160-164 :
« Then you leave the island of Cyprus to the left : and as it pleased God, we made the port of Alexandria on
Tuesday evening at two o’clock of the night on September 27th. Then on Wednesday morning about the
third hour we landed. And before entering the city, we went to the customs, where the goods (p. 161) are
unloaded, and there we were in the presence of Saracen officials, and we were all thoroughly searched for
gold and silver money, on which there is a two per cent tax. And it is true that there is no fraud for they say :
hide as best you know how and I will search you as best I shall know how, and in this way you can deceive
and there is no penalty. From Alexandria to Modone by sea is 900 miles, or according to some a thousand.
Food at Alexandria
Now wishing to speak of the great dignity of Alexandria and of its customs and ways and of the many
victuals, and of how it is well placed and situated in every respect, we shall first speak of its size. I say that it
has a circumference of four miles, and it is much more long than wide, and it is a very attractive city and has
very beautiful and spacious streets ; and it trades in goods of every kind, and it abounds in victuals of all
kinds, meat, fruits of the world’s best, and especially very large pomegranates, which within are like the
blood of a he-goat and are as sugar. And so with pears, apples, plums, and other like fruits, very large water
melons, yellow within and with pips between red and yellow, and truly the tongue of man could not recount
their sweetness. Again there is a fruit on which our forefather Adam sinned, which fruit is called muse ; and
they are in colour like our cucumbers. It is true they are somewhat longer and a little thinner, and they are
delicate to the taste, very soft, and the taste is so different from our fruits that he who gets used to eating the
said fruit, enjoys it so much as to leave everything else. In this fruit is seen a very great wonder, for when you
divide it in any way, either by its lenght or by its breadth, whichever way you cut it, the crucifix is distinctly to
be seen inside : and in proof our company did it several times. And by many these are called Paradise
apples, and this must be the proper name. The tree that produces this fruit and the trunk are blood colour
and it is solid and delicate, and grows from four to five braccia ; its leaves are like those of our elecampane,
and are full four braccia long. And this trunk gives fruit once and no more, and then it dries up, and it throws
up another trunk which also dries up when it has borne fruit once, and so from year to year.
Then here is made the most beautiful bread and good, and cheaper at any time than at home ; white good
meat of the fattest calves for 20 pence of our money, mutton for 16 pence a pound of our money, and these
wethers (p. 162) are bigger than ours, and they have round tails, each weighting full 25 pounds ; some more
and some less, and inside they are very fat and white, and inside they have kidneys like our pigs, and they
are the finest meat in the world to eat. And when you go for meat to the butcher’s, he will give you boneless
meat, for such is the custom, and even if you buy it cooked from the cook, he too will give it boneless ; if
however you wish bone, you may have it ; and they cook it so cleanly, it is a great pleasure. Then in other
appointed places is sold horse, donkey and camel flesh, cooked and raw, and they are the whitest of meats.
And in poultry there is a very big market, far greater than at home and when you go to buy fowl, the
poultryman cuts their throats and thus he sells them, and if by your great misfortune you drew the neck of a
chiken or any other bird, instead of cutting it, you would be in danger of your life : or in truth, you would pay
50 gold florins or more a piece according to the good will you amy enjoy. There is also a very great supply of
quails, and if you go to the poultryman, he will show you several cages of live quails, and you amy choose
the fattest you like best at a cost of 6 pence of your money and the poultryman will even pluck them for you.
Then there is an enormous supply of sea fish of every kind, and it will cost you at the most 18 pence in our
money. And so there is a very great supply of victuals.
The inhabitants of Alexandria
The city, as is said by men worthly of credence, our Christians, has full 50 000 men-at-arms, counting
Saracens, Jews, Christians of the Girdle and Samaritans. These generations are distinguished in this way.
The Saracens wear on the head white bands, the Jews yellow bands, the Christians of the Girdle blue bands
and the Samaritans red bands. In Alexandria there are full three thousand men who wear nothing, except a
piece to cover nature, and this for the great heat of summer ; in winter all the Saracen women, big and small,
wear trousers, and they wear trousers down to the ground, so that of trousers they make stockings.
Also, when they go abroad they wear on the head a cotton mantle, and some a silk one, and nothing can be
seen of them except the eyes, so that if they pass their husbands a hundred times a day, they would never
recognize them. And for this reason those who can, never allow them go abroad, jealous lest they should
abuse their persons, since their law speaks naught but of eating (p. 163) and giving themselves to every
luxurious pleasure. Also our Moslem guide told me that there were very many women who wear breeches
and trousers which cost 400 ducats each, and even 500 ducats, so many are the pearls and precious stones
with which they are pleated. Then they wear chemises all worked in silk and gold and silver, so that they cost
200 gold ducats and more, and the said chemises reach to the knee and are very wide ; the sleeves,
reaching to the elbow, are a good braccio of our measure.
Alexandria lies on the sea and has a very beautiful and big port, such, indeed, that in the hands of the
Christians it would be far more beautiful. In Alexandria there are two artificial mounds made of bad earth and
of every sort of manure and sweepings, and upon each of these mounds there is a very strong tower and
one of these mounds is over a mile high and so the other. And when the King of Cyprus captured this place
all the Saracens fled up these mounds, and from one to the other is almost a mile. No Christian under pain of
death can ascend these mounds.
An Audience with the Admiral
When we were in Alexandria four days, the admiral of the land sent for the consul of the pilgrims, at whose
house we stopped, and told him that we should present ourselves before him, and we went and before we
got within twenty five braccia of the salon, we had to take off our shoes and go in our stockings ; and as we
entered we had to kneel and kiss the ground, and this we did three times.
The admiral was there at the head, and he sat upon a carpet with his legs under as tailors when sewing :
around him were many Saracens, all standing erect ; then they inquired from us what we were going to do,
and we replied that we were going to the Holy Sepulchre of Christ, and so he spent a little time with us. Then
at the end we asked of him the favour of being allowed to import a small barrel of wine and take it with us
freely ; he granted the favour, and for us it was good luck, for it is not their custom to grant such a favour
without very great expense.
Now we shall speak of the Caliph, that is the Pope, of the cardinals, and their bishop, of how they can take
wives and how many. All of them can and should take seven wives each, and so can and should each
Saracen. Now we shall speak of their bestial customs. It is said that when the husband does not like the wife,
he goes to their bishop and tells him this fact. The bishop (p. 164) sends for the wife ; and shortly they
separate ; he takes another wife, and she takes another husband and he returns her dowry. And if by chance
it happens that at the end of a certain time he wishes her again, he returns to the bishop and in short he acts
so that he will have her. And if it happens by chance that he parts with her three times, he can have her in
this way ; the bishop sends for three blind men of the city and they divert themselves with her for a whole
day ; and this way they have her back, and they do so because none should part from his wife so many
times. If it by chance happens that many times the wives go to complain that the husband does not go with
her as often as she wishes, at once the bishop sends for him, and finally she parts from him, if he does not
promise to do her will better and she is content ; and if she does not wish to go, she loses half her dowry,
and if she wishes to return to him up to a third time, she can, if really she will consort with the three blind men
for a day, and so she can return to him ; if over the third time it happens that part, never again can they come
together.
From Alexandria to Cairo
We departed from Alexandria on October 5, and went on asses for a mile, passing many very beautiful
gardens planted with all kinds of fruit trees, but especially date trees in which there is a bigger trade than we
do in acorns ; and there is a great abundance of pomegranates, and lemons, and trees which yield cassia,
and cedars and many other fruits, and there are many trunks of the fig trees of Pharaoh, which are very thick
and as high as oaks, and they produce figs seven times a year and each time they ripen. The leaves are
very small, and when it grows the fruit, it does not produce it among the leaves, but out on the branches, and
they are white, not too big, and of good taste. Then we entered a canal which is called Caligine, a mile and a
half from Alexandria and there we boarded a barque in very great and immeasurable heat, and we travelled
the said canal for a good 30 miles, leaving behind many towns. »
157 Bellorini, T., Hoade, E., Bagati, B., Visit to the Holy places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by
Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6, Jérusalem, 1948,
p. 3-4.
158 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 116.
- 95 - 97 -
Voyageurs à Alexandrie VIe -XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
THOMAS DE SWINBURNE (du 20 au 29 octobre 1392)
Hoade, E., Western pilgrims. The itineraries of fr. Simon Fitzsimons (1322-23), a certain Englishman
(1344-45), Thomas Brygg (1392), and notes on other Authors and Pilgrims, Publications of the Studium
Biblicum Franciscanum 18, Jérusalem, 1970.
Ce récit est rédigé par Thomas Brygg, écuyer ou chapelain de Thomas de Swinburne, personnage principal
de la narration. Le rédacteur raconte le voyage réalisé en Terre sainte en 1392 par le chevalier anglais
Thomas de Swinburne, châtelain de Guines, nommé par le roi Richard II. En 1404, Thomas de Swinburne
devient maire de Bordeaux, puis châtelain de Fronsac en 1408.159
p. 78 :
« Lundi 2 septembre, nous embarquâmes sur un galion appartenant aux marchands vénitiens qui allait à
Alexandrie où nous arrivâmes le dimanche 20 octobre et où nous restâmes 10 jours.
Il est à remarquer à Alexandrie deux colonnes de marbre entre lesquelles la Vierge sainte Catherine fut
martyrisée. À côté de ces colonnes se trouve la prison d’où son corps, après la décollation, fut transportée
par des anges au Mont Sinaï et fut posée là par leur soin. Dans cette ville se trouve une ancienne chapelle
fondée en l’honneur de saint Jean-Baptiste dans un quartier où des Sarrasins fabriquent des paniers en
feuilles de palmier. Là, une chose merveilleuse apparaît clairement : chaque jour les fabricants de paniers
paient pour l’huile à brûler des lampes de ladite chapelle, mais la nuit suivante les murs s’écroulent et
détruisent leurs paniers qui ne souffrent d’aucun incident pendant qu’ils paient. Pour cette raison, ladite
chapelle est communément appelée Saint-Jean-Baptiste des Paniers.
Non loin, hors des portes de la ville, au sud, se trouve la plus belle colonne de marbre, très haute, à côté de
laquelle saint Marc l’Évangéliste fut décapité. »160
159 Riant, P. É. D., « Voyage en Terre Sainte d’un maire de Bordeaux au XIVe siècle », AOL II, Paris, 1884,
p. 378-388.
160 Traduction : O. Sennoune.
- 98 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
NICOLAS DE MARTONI (du 25 juillet au 9 août 1394)
Legrand, L., « Relation de pèlerinage de Nicolas de Martoni (1394-1395) », ROL III, 1894, p. 566-669.
Nicolas de Martoni est notaire dans la ville de Carinola, dans la Terre du Labour, au nord de Naples, où son
frère est archidiacre.161
p. 586-592 :
« Alexandrie
Le vendredi 25 juillet, à trois heures, nous arrivâmes au port d’Alexandrie, où nous trouvâmes dix navires ; à
peine étions-nous arrivés que survinrent quatre Sarrasins avec des pigeons ; ayant appris de nous d’où
venaient les bateaux et quelle était leur cargaison, l’un d’entre eux rédigea aussitôt une petite lettre qu’il
attacha aux ailes d’un pigeon ; ces pigeons furent libérés et ils volèrent d’abord jusqu’à la maison de l’émir
d’Alexandrie, puis jusqu’au Caire, où se trouvait le Sultan. C’est ainsi que procèdent les Sarrasins pour
chaque vaisseau d’une certaine taille qui arrive à ce port d’Alexandrie, et c’est ainsi que j’ai moi-même,
Notaire Nicolas, vu faire bien souvent, tandis que nous étions dans ce même port, quand arrivaient des
bateaux.
Les ports d’Alexandrie
La cité d’Alexandrie a deux ports de mer, l’un où se trouvent tous les bateaux chrétiens ; c’est un grand port,
de forme (p. 587) circulaire, à ce qu’il m’a paru, long de trois milles, et éloigné d’un jet de pierre de la porte
de la ville.
Il y a un autre port de l’autre côté, en direction du Sud, où les vaisseaux chrétiens ne peuvent pénétrer ; là
se trouvent les bateaux des Sarrasins. La raison en est que c’est par ce port que le roi de Chypre prit la ville,
et l’on m’a montré jusqu’où ce roi de Chypre et sa troupe ont détruit la cité. Il m’a paru que le huitième de la
ville avait été détruit.
Les portes d’Alexandrie
Les portes de cette ville par où passent les Chrétiens sont de grande taille. Je pense que l’entrée est large
de deux cannes, et haute de trois. Toutes les grandes portes sont revêtues de plaques de fer. À l’intérieur de
cette porte se trouve une herse de haute taille, tournant sur elle-même, jusqu’à une seconde porte distante
de la première de bien huit cannes ; les battants sont semblables, recouverts de fer.
Les gardiens des portes. Sous la herse susmentionnée, et entre ces deux portes, se trouvent un grand
nombre de gardiens en armes, tout autour, et lorsqu’un Chrétien passe, ces gardiens l’arrêtent aussitôt, et le
fouillent soigneusement sur tout le corps, pour voir s’il porte sur lui de l’or ; car les pèlerins paient, pour
chaque centaine de Ducats qu’il fait entrer dans Alexandrie, deux ducats. Les marchands paient sur dix
ducats, un ducat, et chaque fois qu’un Chrétien pénètre par cette porte, il est fouillé autant de fois jusqu’à
ses braies.
Les fondiques d’Alexandrie
Dans cette ville se trouvent les fondiques des Chrétiens, à savoir du royaume d’Italie, des Génois, des
Vénitiens, des Catalans, et des autres royaumes chrétiens du monde ; dans chaque fondique est un consul
qui a la responsabilité des voyageurs de son pays arrivant à Alexandrie, et qui doit entendre leurs
problèmes.
Races et vêtements des habitants
À Alexandrie, il y a des hommes appartenant à trois races différentes, les Sarrasins, qui sont vêtus de
chemises faites d’une pièce de lin blanc, et portent sur la tête (p. 588) un turban fait d’une pièce de lin blanc
enroulé plusieurs fois, qui ressemble à (?) ; on dit qu’il y en a de 50 et même quelques-uns de 60 brasses !
L’habit des Juifs. Il y a des juifs qui vont vêtus des mêmes habits blancs, et sont coiffés de même sorte, mais
avec des turbans de couleur jaune.
L’habit des Chrétiens de la ceinture. Il y a les Chrétiens de la ceinture qui vont vêtus des mêmes habits, et
sont coiffés de même sorte, mais leurs turbans sont bleus. Ce sont de bons Chrétiens, qui croient en Dieu le
Père, au Fils et au Saint Esprit, et les adorent tous trois ; ils croient en la bienheureuse et glorieuse Vierge
Marie, et aux autres saints. Certains d’entre eux viennent des Indes ; ils ont la même foi ; et ont des églises
à eux, peintes par eux avec des images de saints et de saintes et dans lesquelles ils célèbrent la messe à
leur façon.
Raison de la différence des turbans. Cette différence de couleur des turbans remonte au jour où Alexandrie
fut prise par le roi de Chypre évoqué plus haut ; les Juifs et les Chrétiens de la ceinture étaient coiffés et
vêtus à la façon des Chrétiens ; aussi les Sarrasins veulent-ils pouvoir reconnaître d’eux-mêmes les deux
races juive et chrétienne.
Grandeur de la ville et abondance de la population
Alexandrie est plus grande que Naples, selon l’avis général, mais elle n’a pas en général de belles
demeures. Elle est si peuplée que cela ne se peut écrire ; à toute heure du jour, les rues sont à ce point
encombrées de monde, que l’on ne peut remuer un pied sans heurter quelqu’un ou être soi-même basculé.
Les rues
Les rues sont très longues, et toujours aussi pleines de gens, certaines ont trois milles, d’autres deux,
d’autres un seul, et il s’y trouve toute sorte de gens (?). Parmi d’autres rues, il en est où l’on vend des tissus
(?) d’or et de soie, couverts par dessus par des tables travaillées (?), sur un mille de longueur ; et il y a un si
grand nombre de ces tissus que tout l’or d’un royaume suffirait à peine à les acheter.
La prison de sainte Catherine
Dans cette ville, se trouve la prison où sainte Catherine fut enfermée ; elle ressemble à une petite chambre ;
il y a là deux grandes et grosses colonnes, à droite (p. 589) et à gauche de la rue, auxquelles sainte
Catherine fut attachée et fustigée ; dans cette prison il y a un petit puits d’où l’ange de Dieu et de N. S.
Jésus Christ apportait sa nourriture à la vierge bienheureuse ; sur ce puits, on raconte un grand miracle ;
maintes fois on a fermé ce puits et on l’a muré avec des briques ; mais on l’a toujours retrouvé ouvert.
Vin et fruits
Il y a à Alexandrie des raisins excellents ; les figues et les autres ne sont pas bons ; les Sarrasins ne boivent
pas de vin, et ne veulent pas qu’aucun Chrétien en fasse entrer la moindre goutte dans la ville ; mais l’émir a
autorisé aimablement les consuls à acheter un tonneau chacun chaque année ; le vin est fort cher. Le
consul de Gaète m’a dit que la (?) de vin de Candie coûtait 4 onces.
Les vêtements des femmes
Les femmes sarrasines portent une chemise blanche, et, par dessus la tête, un petit capuchon fait d’une
pièce de lin blanc, qui leur couvre tout le visage à l’exception des yeux.
Les Sarrasins, hommes autant que femmes, sont pour la plupart noirs, et certains bruns ; sur cent, je pense
qu’il n’en est pas dix de blancs.
Les murs de la ville
Les murs de la ville sont beaux, semés de tours sur le pourtour, et des barbacanes ; sur nombre de ces
tours sont des machines de guerre (vricols). À l’intérieur de la ville, sur toute la surface, poussent
d’innombrables palmiers – dattiers – d’une hauteur moyenne, qui produisent des fruits en abondance.
Mais lors de notre séjour, à la dernière semaine de juillet de la seconde indiction, les fruits de ces dattiers
n’étaient pas encore bons, ni mûrs pour être consommés.
Les collines d’Alexandrie
À Alexandrie il y a deux collines élevées artificiellement, avec les ordures et les déchets des murs et des
maisons, distantes l’une de l’autre de deux milles, dont l’une, plus haute que la colline de St. Archangello de
Calino, porte au sommet une tour ; comme la colline s’accroît des ordures et déchets, cette tour monte elle
aussi en construction. Elle a été construite pour servir de repères, pour que les marins puissent trouver et
reconnaître Alexandrie de loin en mer, parce que cette ville est bâtie sur le plat, et très bas.
Départ d’Alexandrie
Le dimanche 9 (p. 590) août, après le déjeuner, nous quittâmes Alexandrie avec 54 Flamands ; parmi eux se
trouvaient 4 hommes d’armes, dont l’un, qui était seigneur terrien, avait 20 domestiques à son compte ;
parmi eux aussi se trouvaient quelques nobles ; tous étaient de beaux jeunes gens, dont aucun n’avait plus
de trente ans. Ayant versé 34 ducats, un pour chacun de nous, nous nous réunîmes tous devant la porte
appelée El Pepe, et nous sortîmes pleins de crainte et de trouble, nous demandant si nous serions fouillés à
cause de notre argent, de fait qu’aucune somme d’argent ne peut entrer dans Alexandrie sans qu’on acquit
deux pour cent.
Ce même jour nous arrivâmes à ce petit cours d’eau appelé Lac Calese qui coule à un mille et demi
d’Alexandrie.
De la nature du canal Calese
Voici ce qu’est ce canal appelé Calese : c’est une branche du grand fleuve appelé le Tigre ; ce bras se
détache chaque année du grand fleuve qui passe non loin du Caire, au début du mois d’août ; quand vient
son premier flot, ce n’est que de l’eau en petite quantité ; puis il s’accroît chaque jour d’une coudée, et
quand il y a de l’eau en quantité suffisante, elle continue son chemin par certains canaux ; à travers ces
canaux, elle coupe jusqu’à Alexandrie, où toutes les citernes s’emplissent de cette eau ; quand une citerne
est pleine, l’eau va sous terre, jusqu’à une autre, de la même façon que s’emplissent les puits de la ville de
Théan. Quand toutes les citernes sont pleines, cette eau se retire, et elle suffit à Alexandrie pour une année
entière. C’est la meilleure eau qu’on puisse boire. À vrai dire, mes compagnons et moi-même, le notaire
Nicolas, en avons bu une telle quantité pendant les 17 jours de notre séjour à Alexandrie, à toute heure du
jour, que je crois bien qu’elle nous eût tués, en raison de la chaleur intense, si cela avait été de l’eau de
Carinole ou de Théan.
Mais à peine l’avions-nous bue qu’elle était éliminée par la transpiration. Nous mêlions au vin que nous
buvions trois parties d’eau, du fait que (p. 591) c’était un grand vin de Candie et qu’il était cher : on exigeait
couramment un tareno pour un coup de vin.
Citernes et champs d’Alexandrie
Comment elles s’emplissent et ils sont irrigués. Quand les citernes sont pleines, cette même eau irrigue tous
les champs d’Alexandrie, en passant par des conduits et des canaux ; tous les champs sont noyés, et l’eau
s’élève au-dessus d’eux d’une canne, tantôt plus, tantôt moins, selon que les lieux sont hauts et bas. L’eau
stagne sur ces champs pendant 40 jours, puis se retire, et les Sarrasins ensemencent leurs champs.
Notre attente auprès du Calese
Nous sommes restés auprès de ce canal Calese du dimanche au mardi 11 août, et nous passâmes de
mauvais jours et de mauvaises nuits, attendant la lettre de l’émir d’Alexandrie annonçant notre arrivée à
l’émir du Caire, et nous demandant si nous aurions cette lettre, vu son iniquité – car c’est un homme
spécialement cynique, haï de tous les Alexandrins et de tous ceux qui dépendent de lui.
Départ sur le Calese
Ce mardi donc, notre turchiusmagnus qui nous conduisit vers Sainte-Catherine, et s’appelait Santaache, vint
avec la lettre de l’émir ; nous entrâmes en ce canal, avec nos affaires, nous dirigeant vers le Caire sur ce
canal avec trois petites barques.
Les jardins
Sur trois milles, de part et d’autre du canal nous trouvâmes de grands jardins de dattiers, de cassiers et
d’autres fruits, avec de nombreuses maisons de fonctionnaires Sarrasins au bord du canal ; il y avait une
telle quantité de dattiers qu’on se serait cru au bois de Saint-Laurent, sur la route de Capoue.
La nature du Calese
Il y a de l’eau pendant 6 mois dans ce canal appelé Calese, puis il s’assèche et ne coule plus jusqu’au mois
d’août suivant, et ce qui a été décrit se reproduit de la même façon chaque année. Les Sarrasins disent que
cette eau du canal vient du paradis terrestre, et c’est pour cela qu’elle est bonne.
Les habitations sur le canal
Tout au long de ce jour, nous trouvâmes au bord du canal des habitations dispersées, (p. 592) parmi elles,
des maisons couvertes de coupoles semblables à des culs de fours, concaves par en dessous, où habitent
les Sarrasins. Tout ce jour, nous avons trouvé un grand nombre de garçons et de filles près du rivage du
canal, demandant du pain en leur langue, car ils sont pauvres. »162
- 99 - 101 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune |
OGIER VIII, SEIGNEUR D’ANGLURE (du 13 au 21 décembre 1395)
Ogier VIII (seigneur d’Anglure), Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d’Anglure, par F. Bonnardot et
A. Longnon, Paris, 1878.
Ogier VIII (vers 1360-1412) devient, à la mort de son père, seigneur d’Anglure (Marne) en 1383, mais sans
posséder le domaine qui constitue le douaire de sa mère qui se remarie. En 1385, Ogier VIII accompagne
l’armée royale destinée à châtier les Gantois. Les détails de sa biographie font part de lettres de rémission
reçues en 1391 au sujet du viol d’une jeune femme, commis en 1385. En considération de ses services et
de ceux de ses ancêtres, il obtient grâce. En 1395, Ogier VIII décide d’accomplir le pèlerinage en Terre
sainte en compagnie, entre autres, de son beau-père, Simon de Sarrebruck. Ils partent d’Anglure le 13 juillet
1395 et arrivent à Venise le 9 août où ils y séjournent trois semaines. Après avoir visité la Terre sainte, ils
arrivent à Alexandrie le 13 décembre pour s’embarquer le 21 du même mois. Sur le chemin du retour, une
tempête les jette sur les côtes de Chypre. Ayant été accueillis à Nicosie par le roi, ils sont retardés par la
mort de Simon de Sarrebruck qui est pris de fièvre et meurt le 18 janvier 1396. Le récit de son pèlerinage a
probablement été écrit par le secrétaire ou le chapelain d’Ogier.163
p. 77-79 :
279. Cedit soir mesmes partismes de Babiloine en nostredicte barque pour venir en Alixandre aval le flun du
Nil, et avalasmes tout par devant une partie du Caire sur cedit flun. En avant le chemy du Caire en
Alixandre, a si tresbel pays que c'est merveille, plentureux et plain de beaux jardins et d'arbres; et moult y a
de village et de grosses villes come Foua, ou nous fusmes le samedi ensuivant, XIe jour de decembre, et
puis passasmes par une autre ville que l'en appelle Corion.
280. Nous arrivasmes près de la cité d’Alixandre en Egipte le lundi ensuivant, XIIIe jour de decembre, a ung
petit village qui est près d’Alixandre environ deux petites lieues françoises. Illec fut chargié tout nostre
cariage sur les chamoix du Soudam pour le porter jusques a la cité. Si entrasmes avec le chamoix cedit jour
mesmes a heure, et fusmes tresbien serchés a entrer dedans a la porte, pour savoir combien nous portiens
d’argent et d’autres choses.
281. Dedans la cité d’Alixendre est le lieu ouquel la vierge saincte Katherine ot la teste coppée, et de celle
place elle fut portée par les sains anges au commendement de Nostre Seigneur ou hault de la montaigne de
Sinaÿ, comme dit est devant.
282. Dedans celledicte cité d’Alixendre a une grande rue, la plus belle rue et la plus large de toute la cité,
laquelle est appelée la rue Saint-Marc, car en icelle rue fut martiriziés saint Marc, le glorieux patron de
Veniciens. (p. 78)
283. En celle mesmes rue est le lieu ou la chartre estoit en laquelle madame saincte Katherine estoit mise
en prison.
284. En celle mesmes rue est le lieu et la place ou les roes furent drecées pour detranchier le corps de la
vierge saincte Katherine, et illec sont encor les IIII pilliers de pierre de marbre sur quoy lesdictes roes furent
drecées.
285. Item, sachiés que en celledicte cité d’Alixendre a plusieurs belles demorances sont appelées
« fondiques ». Et y a grant quantité d’icelles demorances, comme le fondique des Genevoix, le fondique
de[s] Castellains ou Arragonnois, le fondique des Chippriens, des Napolitains, des Enconnitains, des
Marciliains ou Marcelle, des Candiens et des Nerbonnois. Et en icellui fondique de Nerbonne fusmes nous
haubergez nous tous pelerins ; et en nul des autres fondiques ne peulent estre herbergez les pelerins, pour
ce que en icellui fondique a official de par le Soudan, lequel est chrestien, et scet combien il doit rendre au
Soudan de treu pour chascun an, et scet combien il doit avoir de chascun chrestian qui entre en Alixendre
puisqu’il soit pelerin. Et est appelez icellui official « consulle », de Nerbonne et des pelerins.
286. De l’un des costés d’Alixendrie sont les plus beaux et les plus grans jardins que l’en puist veoir, et de
l’autre part est la marine.
287. Alixendre est grande et belle cité, et si est tres-bien (p. 79) fermée de bons et haulx murs et de
tresgrosses tours bien defenssables et belles portes et fortes. On y fine bien de bon vin es fondiques dessus
dits.
163 Ogier VIII (seigneur d’Anglure), Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d’Anglure, par F. Bonnardot
et A. Longnon, Paris, 1878, p. XLV-LI.
164 Ce texte a fait l’objet d’une nouvelle publication : Martoni, N. de et Anglure, O. d’., Vers Jérusalem :
Itinéraires croisés au XIVe siècle. Nicolas de Martoni, Ogier d’Anglure, par M. Tarayre, N. Chareyron, Paris,
2008.
- 102 - 103 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANONYME DE TORTOSA (1395)
Epalza, M. de, Dos textos moriscos bilingues (arabe y castellano) de viajes a Oriente (1395 y 1407-1412),
HespTam XX-XXI, 1982-1983, p. 25-112.
F° 341v, F° 342r :
« Ensuite, de ce port cité165, nous embarquâmes sur un grand navire des Chrétiens. En invoquant Dieu,
nous arrivâmes à Alexandrie au bout de quinze jours. C’est une ville bien située avec des rues spacieuses.
Ce que nous admirâmes le plus, ce sont les constructions souterraines, qui sont comme celles du dessus,
par lesquelles l’eau du Nil pénètre dans toutes les maisons pour transformer l’eau des puits en une douce
saveur. Il y a de nombreuses madrasas et mosquées.
Le plus étrange que nous vîmes est la colonne des colonnes qui est haute ; elle se trouve dans la partie
haute. On ne connaît pas sa signification, ni la raison pour laquelle elle fut érigée. On rapporte à son propos
que dans les temps anciens, c’était une construction pour les philosophes et on déclare que c’était pour
l’observation. Dieu sait mieux que personne.
(F° 342r) Ensuite, nous partîmes par voie de terre au village qui se trouve dans la vallée du fleuve le Nil, que
l’on nomme Fuwwa où nous voyageâmes sur le Nil. »166
165 Tunis
166 Traduction : O. Sennoune, H. Zyad.
- 104 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
15e siècle |
EMMANUEL PILOTI (entre 1396 et 1422)
Piloti, E., L’Égypte au commencement du XVe siècle d’après le Traité d’Emmanuel Piloti de Crète (1422), par
P.-H. Dopp, Le Caire, 1950.
Piloti, E., Traité d’Emmanuel Piloti sur le passage en Terre Sainte (1420), par P.-H. Dopp, Louvain, Paris,
1958.
Régnier-Bohler, D., « Traité sur le passage en Terre sainte. Emmanuel Piloti XVe siècle », dans
D. Régnier-Bohler (éd.), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte,
XII-XVIe siècle, Paris, 1997.
Emmanuel Piloti est un marchand vénitien né en Crète en 1371. Entre 1396 et 1422, il vit en Égypte pour
faire le commerce de produits vénitiens : draps, velours, soies, Malvoisie (vin doux de Crète). Au cours de
cette période, il remplit, entre autres, la charge de consul de Gênes à Alexandrie. Témoin du règne de
plusieurs sultans depuis Barqūq jusqu’à Barsbay, il compose sur l’Égypte un traité considérable dont
l’original commencé en 1420 est perdu. Toutefois, on conserve une traduction française faite par l’auteur en
1441 lors de sa retraite en Italie.167
Remarque : Nous nous sommes servis de trois publications afin de présenter ce texte de la façon la plus
complète. Les deux premières éditions sont de Pierre-Herman Dopp et la troisème de Danielle
Régnier-Bohler. Les paragraphes commençant par D1 (publication de 1950) et D2 (publication de 1958) sont
en moyen français, tandis que ceux commençant par R (publication de 1997) sont en français moderne.
R (p. 1245) XXXVIII Importance des Bédouins et d’Alexandrie pour la vie de l’Égypte
La domination des Bédouins sur le pays commence au Caire et va jusqu’à Alexandrie. Cette cité
d’Alexandrie se maintient et vit par le passage des Bédouins : tout d’abord pour les farines et céréales, les
oies, les volailles et toutes sortes de viande de boucherie, boeufs, moutons, et toutes autres sortes de
denrées. Les bédouins font vivre cette ville. Et quand ils sont en guerre et que les chemins sont coupés, la
cité d’Alexandrie est en grande détresse […]. Les Bédouins alors ravagent tout ce qui pousse au pays. C’est
qu’ils transportent toutes les choses qui leur sont nécessaires, sans lesquelles ils ne peuvent vivre. Ces
biens, ce sont d’abord les draps de laine, puis les tissages de Barbarie pour se vêtir, et ensuite, pour leur
consommation, l’huile, le miel, le savon, les noix, les noisettes, les amandes, les châtaignes, les raisins secs,
beaucoup de petits raisins, l’argent d’orfèverie et de nombreux autres produits nécessaires à leur pays ; ce
sont des biens qu’ils achètent, et ils donnent en échange des produits apportés de leur pays, qui ne
pourraient se vendre autrement. Ainsi il n’est pas possible et d’aucune manière que le pays des Bédouins
puisse vivre sans la ville d’Alexandrie, ni la ville d’Alexandrie sans le pays des Bédouins.
R XXXVIX Sympathie des Bédouins pour les chrétiens d’Occident. Leurs mauvaises dispositions à l’égard du
sultan
La nation des Bédouins est plus proche que nulle autre nation païenne de ce que veulent les chrétiens.
Souvent nous étions en train de nous entretenir au sujet des mauvais traitements que leur inflige le sultan,
(p. 1246) comme aux marchands chrétiens. Et ils disaient : « Où est la grande armée des chrétiens
d’Occident, et pourquoi ne veulent-ils pas attaquer la ville d’Alexandrie et libérer tous ces gens des mains du
mauvais sultan ? Et pourquoi ne se rendent-ils pas maîtres d’une si noble ville, la tête et la clé du Caire et du
reste du pays ? » […] Et les Bédouins rapportaient les propos de leurs grands maîtres : « Si nous remettions
nos femmes et nos enfants entre vos mains, pour votre sûreté au sein de cette ville, nous voudrions vivre et
mourir avec vous comme il est juste de le faire, car nous ne pouvons plus supporter les cruautés exercées
contre nous ». Et pour cette raison, seigneurs chrétiens, ne doutez pas que si les chrétiens étaient maîtres
de la ville d’Alexandrie, en peu de temps les Bédouins seraient à leurs côtés pour précipiter
l’anéantissement du sultan, car les seigneurs du Caire ont l’habitude de leur donner des coups de bâton sur
la chair nue pour tirer des ducats de la main du peuple du pays, et il leur est interdit de monter des chevaux,
ils n’ont droit qu’aux ânes.
R (p. 1248) XLII Situation d’Alexandrie. Son approvisionnement en eau douce
Mes seigneurs, la ville d’Alexandrie est édifiée à trente-cinq milles du fleuve, et elle se trouve en lieu sec. Et
celui qui l’édifia le fit dans l’espoir de permettre au secours d’arriver par la voie du fleuve ; il décida que dans
la campagne, du fleuve jusqu’aux murs d’Alexandrie, on creuserait la terre à la force des bras, et il fit creuser
un canal assez large pour que les bateaux, petits et grands, puissent aller du fleuve à Alexandrie, et
retourner au fleuve chargés de toutes les marchandises souhaitables. Du fleuve jusqu’à Alexandrie, on
compte trente-cinq milles.
La ville d’Alexandrie est en lieu sec, et il n’y a que des puits d’eau salée. Mais chaque demeure se trouve
construite sur une crypte dans laquelle se trouve une citerne qui s’emplit d’eau. Ainsi tous les ans, lors de la
crue, grâce au fossé creusé à la force des bras comme il est dit plus haut – ce fossé s’appelle Caliz – par
lequel les eaux parviennent (p. 1249) jusqu’auprès des murs d’Alexandrie. Il y a un passage où se trouve
une bouche pourvue de baguettes de fer, et les eaux entrent par les conduits jusqu’aux puits de la ville. Par
la vertu des eaux nouvelles, ceux-ci se remplissent d’eau douce, de la qualité des eaux du fleuve. Je vous
dis que dans toutes les maisons il y a une citerne, et au bout de la maison il y a des puits dont on tire de
l’eau à l’aide de seaux, grâce aux bras des innombrables paysans du pays. Les citernes de la ville se
remplissent de la manière que j’ai décrite. Voici comment la ville d’Alexandrie s’est maintenue et se maintient
toujours. Et si elle tombe au pouvoir des chrétiens, elle se pourvoira d’eau par de nombreuses autres
façons, parce que Dieu le Tout-Puissant y veillera par Sa grâce et Sa miséricorde.
Dans la ville d’Alexandrie, il y a dix citernes de la grandeur d’une grande place, dans des cryptes et sur des
colonnes, lesquelles sont nommées citernes du sultan, et celles-ci se remplissent et restent remplies comme
réserves, par crainte d’une événement défavorable qui pourrait survenir du fait des chrétiens d’Occident. Au
bout d’un certain temps, on les vide, et on les remplit à nouveau. Ces citernes, si Dieu le veut, seront là pour
servir la chrétienté.
D2 (p. 90) LV Manufactures de soie et de toile à Alexandrie. Décadence de ces industries.
Par la information que je eulx de personnes pratiques, eulx que ancienement laboroyent en Alexandrie .lxxx.
mille teliers de soye et de lin. Mais à le présent, pource que la terre est déshabitée, (p. 91) se labeure à
petite quantité. Ilz y font draps de soye, desquelx bosoigne qu’ilz fornissent la court du Cayre ; et le
demorant le mandent par mer en Barbarie, en Tune, en Surie et en Turquie, nonobstant que à Damasque se
labeure draps de soye à grant quantité.
R (p. 1253) LVI Dépeuplement d’Alexandrie
À cause du mauvais exercice du pouvoir par les seigneurs du Caire en ce pays, Alexandrie, qui est pourtant
la bouche et la clé de leur condition, est dépeuplée et abandonnée, bien qu’elle soit une belle ville remplie
de belles demeures et qu’il s’y trouve de belles oeuvres de marbre. Mais comme ses citoyens l’ont quittée et
abandonnée, j’ai vu lorsque j’y étais, que pour l’une de ces demeures valant trois ou quatre mille ducats, on
ne donnerait pas quatre cents ducats à l’heure présente. Et ceux qui les achètent maintenant ne les
achètent pour nulle autre raison que d’enlever les beaux objets en marbre et autres oeuvres qui s’y trouvent,
qu’ils transportent par mer, sur une germe, pour les placer dans les maisons du Caire. Ainsi Alexandrie peut
se dire dépeuplée et abandonnée par les païens. Elle le restera jusqu’à ce que les chrétiens viennent la
conquérir, y demeurer et lui rendre sa condition première. Que le béni Jésus-Christ vous en donne la grâce.
R LVII Produits naturels dans les environs d’Alexandrie
La ville d’Alexandrie est environnée de jardins, dans lesquels se trouvent de nobles habitations et de beaux
palais. Et il y pousse toutes sortes de fruits, qui se mangent avant leur maturité : figues, amandes, raisins,
ainsi que des pastèques. Quasiment tout au long de l’année, on trouve des fruits frais en grande quantité, si
bien que jamais on en manque, tels des citrons à l’écorce fine en abondance ; il n’en est pas de meilleurs au
monde, on n’en a nulle part de si grandes quantités. Et tous les ans on les met dans de grands récipients,
avec un brouet, et l’on fait plus de (p. 1254) cent cinquante tonneaux – parfois plus, parfois moins – qu’on
envoie pour une part à Venise, pour une autre à Constantinople, et parfois en Flandre.
Cette ville d’Alexandrie abonde tant en citrons qu’il en reste une grande quantité dans les jardins, car ils ne
peuvent être vendus. Les citrons mis en brouet vaudront trois ou quatre ducats le tonneau. Dans les jardins
d’Alexandrie pousse le canafistolle, appelé « cassia », qui ne se trouve en aucune autre région d’Orient, et
qui est transporté à Venise et vers les autres pays d’Occident. Ce canafistolle provient des jardins qui
appartiennent au sultan, et les fonctionnaires du sultan le vendent à Alexandrie. Dans la campagne du Delta
poussent des câpres de trois sortes, qui sont les meilleures que l’on puisse trouver. Les Bédouins d’Égypte
les cueillent, ainsi que les villageois, au mois de mars. Ils en font des bottes à Alexandrie et les vendent
sans peine, et on les transporte à Venise, à Constantinople, en Occident, et parfois en Flandre.
R (p. 1255) LIX Fertilité de l’Égypte qui a souvent approvisionné la Syrie lors de disettes dans ce pays.
Importance vitale du port d’Alexandrie à ce point de vue
Les conditions du Caire, pour ce qui concerne l’alimentation, montrent que le pays d’Égypte est plantureux
et fécond, d’abord en céréales et légumes de toutes sortes, en animaux de boucherie de toutes sortes,
volailles et oies, et en toutes sortes de denrées dont on a parlé plus haut, en si grande quantité que les
habitants peuvent continuellement apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin, au-dehors de leur pays.
Souvent les habitants de Syrie ont reçu d’eux des céréales ainsi que d’autres denrées. Pour cela il faut
passer par Alexandrie. C’est pourquoi, si la ville d’Alexandrie échappait au sultan, il serait nécessaire de
négocier avec les chrétiens, si ceux-ci étaient maîtres d’Alexandrie.
D2 (p. 112) LXVIII Droits exorbitants prélevés sur les marchandises à Alexandrie par le sultan (Barsbey).
Omnipotence de ce sultan
O seigneurs crestiens, je dis que lez marchans d’Indie lezquelx se partent de leurs hostelz avecques lez
leurs navilz ; et par terre et par mer avecques grans périlz, lezquelx marchans sont du bout du monde vers
Lavant ; et quant Dieu leur donne grâce qu’ilz joingent en Alexandrie, ils sont moult contemps. Et ainssi
samblablement ceulx de Ponent, qui viennent du bout du monde de ladicte Ponent, et viennent par terre et
par mer, en grans périlz de mer et aussi de corsaires ; et quant Dieu leur donne la grâce qu’ilz peuvent
joingere en Alexandrie avecques leurs marchandises, et qu’ilz treuvent lez aultres nations de marchans et se
peuvent congrégher ensamble, ilz sont moult joyeulx et rendent grâce à Dieu. Puis treuvent ce trèsmavais
souldain, lequel met la main aulsdictes marchandises et leur lève leur bonne aventure et profilz, aussi bien
de Sarrasins, comme de crestiens. Et veu qu’ilz ne peuvent faire aultre chose, il besoigne qu’ilz se taisent et
ayent pacience.
O seigneurs crestiens, veullons savoir quel seigneur est et de quel nation est cestui souldain qu’ilz appellent
seigneur naturel, sans lequel il me samble que lez crestiens de Ponent, ne aussi tous lez payens de Lavant
ne peuvent vivre sans cestui, et lequel est seigneur de si trèsnoble pays. Il est de nation bestielle, et a la foy
de bestes (p. 113) et selonc mon samblant, il raigne, triumphe, gouverne et commande, et tous ses
commandemens sont obéys ; et ses commandemens passent par le Ponent parmy toute la puissance de
crestienté et aussi en Lavant parmy toute la puissance dez poyens. Et si ne peuvent vivre crestiens ne
payens que ne besoigne estre souget à luy et à son pays, pour l’amour des grans traffitz qu’il besoigne que
nous faisons en son dit pays. Et ce est raison prouvée sans aulcunes contradictions.
R (p. 1257) LXXII Alexandrie, bouche nécessaire à la vie de l’Égypte
Seigneurs chrétiens, Le Caire, avec tout l’intérieur du pays d’Égypte, peut se comparer à la forme, à la
manière et à l’apparence d’une créature qui vit par la bouche. Si vous lui obstruez la bouche, cette créature
étouffera et perdra la vie. Et ainsi, seigneurs chrétiens, Le Caire peut lui être comparé : la ville d’Alexandrie
est la bouche même qui fournit les aliments et la vie au Caire ainsi qu’au reste du pays d’Égypte et qui
exporte et charge sur les navires vers les pays du Ponant, Le Caire ne pourrait résister pour rien au monde
et serait à peu près comme une personne emprisonnée, et bien vite le lieu serait aride et sec. Bien vite, si
cela leur était possible, les gens chercheraient un accord selon les termes de celui qui serait maître de la
ville d’Alexandrie, afin que les marchandises entrent et sortent du pays de la manière accoutumée, et afin
que la population nombreuse de l’Égypte puisse subsister.
R (p. 1258) LXXV Moyens de conquérir Alexandrie : armer secrètement une flotte. Nécessité du secret,
illustrée par la légende de Barberousse au Caire
Seigneurs chrétiens, si l’on veut s’emparer de la ville d’Alexandrie, il est nécessaire de passer par l’école de
ceux qui se nomment marins, seigneurs et maîtres de la mer, et de voir comment ils peuvent, par leur
compétence et secrètement, aborder et conquérir la ville, car ils le savent et ont le pouvoir de le faire. Cette
conquête sera la résurrection de la chrétienté, (p. 1259) et de cette conquête viendra un grand bien pour les
chrétiens. Et pour cette raison, tous les seigneurs chrétiens devraient souhaiter être de ceux qui mèneront à
bien cette conquête, pour la gloire de Dieu et de la renommée éternelle en ce monde.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire, pour tout dessein des chrétiens, que les choses se passent
secrètement. Et je vous en donnerai un bel exemple : il s’agit de l’empereur Barberousse qui s’en alla
jusqu’au Caire, déguisé sous l’apparence d’un homme pauvre pour n’être pas reconnu, afin d’acquérir une
bonne et parfaite information sur le pays, avec l’intention d’ordonner à son retour les préparatifs pour la
conquête de Jérusalem, pour le bien et la protection de la religion chrétienne.
Il arriva que le pape, ou l’un de ses prélats, écrivit au sultan une lettre pour lui révéler comment l’empereur
s’était rendu dans son pays, et pis encore, on lui fit savoir comment la personne de l’empereur était
déguisée, de sorte que le sultan usa de ruse et s’empara de lui. Le sultan le menaça de mort, et pour
l’affliger plus encore, lui montra la lettre qui lui avait été envoyée par le pape de Rome. Ils eurent ensemble
beaucoup d’entretiens et pour finir se concertèrent. Pour susciter les divisions entre les chrétiens et
provoquer une effusion de sang, et pour que l’empereur eût la possibilité de se venger de ce qui avait été
fait, le sultan le laissa partir. Quand le pape apprit la décision de l’empereur, il s’enfuit de Rome et fut ensuite
retrouvé à Venise, dans un monastère de la Charité, où il exerçait les fonctions de cuisinier. Quand il fut
reconnu, la seigneurie de Venise le reçut, et on lui rendit tous les honneurs qu’il méritait.
À cette époque, l’empereur rassembla une grande flotte de galères pour affronter les Vénitiens et prendre le
pape. La seigneurie de Venise en fit de même et rassembla beaucoup de galères, qui sortirent de Venise
pour affronter l’armée de l’empereur. L’affrontement eut lieu, le combat fut étonnant. La victoire, pour finir,
revint aux Vénitiens ; ils prirent le fils de l’empereur, qui était capitaine de l’armée. Ainsi l’empereur vint à
Venise et se réconcilia avec le pape. La seigneurie de Venise reçut de grands honneurs du pape. Cette
histoire est peinte dans la salle neuve de Venise, et c’est une oeuvre très belle à voire qui représente le
déroulement de ces faits.
Ainsi seigneurs chrétiens, le seigneur et messager de Dieu qui voudra se lancer dans une telle entreprise
doit y réfléchir, s’entourer de bons conseillers, et mener les choses aussi secrètement que possible, jusqu’au
moment où il plaira à Dieu que l’assaut soit mené. Puis on fera sonner toutes les cloches de la chrétienté et
on organisera de grandes processions (p. 1260) pour l’honneur de Dieu. C’est la voie qu’il faut prendre pour
préserver la chrétienté.
R LXXVII Deuxième condition indispensable au succès : l’unité du commandement entre les mains d’une
seule nation, à laquelle on donnera le gouvernement d’Alexandrie après la conquête
Seigneurs chrétiens, la conquête d’Alexandrie exige qu’un grand puissant, célèbre et aimé de tous les
princes et seigneurs de la chrétienté, se mettent à agir comme un messager de Dieu pour faire aboutir une
conquête. Celle-ci doit être menée et mise en oeuvre de façon secrète, et il importe qu’elle en soit menée
que par une seule nation, soumise à l’obéissance et aux ordres de ses chefs. Pour de nombreuses raisons
tout à fait justifiées, on voit que la ville d’Alexandrie est de telle nature que toutes les nations des chrétiens et
toutes les nations des païens ne peuvent subsister sans elle. Ainsi, seigneurs chrétiens, enfuyant tout
scandale et tout différend (p. 1261) et en préservant la bonne et sainte intention, il faut que cette ville soit
laissée au pouvoir du grand seigneur qui l’aura conquise. Il importe tous soient en bon accord pour la
préserver et la gouverner, comme la ville et le bien du grand seigneur dont on a parlé, et tout ceci dans le
but de donner aux chrétiens et aux païens la possibilité de bien vivre et longuement, en jouissant de cette
ville, dans la paix, sous la domination d’un seul seigneur. Si elle se trouvait sous la domination de plus d’un
seigneur, le scandale et le différend pourraient bien vite survenir, et la terre serait perdue. C’est ce qui arriva
pour la ville d’Acre : dans la mesure où elle était entre les mains de plusieurs nations chrétiennes, elle fut
perdue deux fois à cause de leurs différends. La dernière fois que les païens la prirent, ils décidèrent de la
ravager et de la raser jusqu’à ses fondations, comme elle se trouve jusqu’à l’heure présente. Il faut donc
prendre en compte les événements passés, lesquels nous expliquent les choses à venir. Mais j’exprime ici
l’espoir qu’il n’en sera pas ainsi d’Alexandrie.
R (p. 1261) LXXVIII Prospérité assurée d’Alexandrie après la conquête
Si c’était la volonté de Dieu qu’Alexandrie tombât sous la domination des chrétiens, elle pourrait s’organiser
et accroître son renom. Et la raison en est que lorsque Alexandrie sera devenue terre chrétienne, toutes les
nations chrétiennes s’y rendront pour vendre leurs marchandises et en rapporter des épices, et elles seront
en sécurité comme dans leur propre demeure et ne seront pas sous la domination des païens. Si cet
événement juste et honorable devait s’accomplir, toutes les caravanes des épices souhaiteraient parvenir là
où seraient les chrétiens acheteurs d’épices. Et ainsi Damas serait abandonnée de tous les marchands
chrétiens et des païens et ne vaudrait plus grand-chose dans le domaine des marchandises. De la sorte,
Alexandrie, ville célèbre et noble, port de mer conquis par les chrétiens, mériterait la renommée et la
prospérité en ce monde, d’où il résulterait qu’en cette ville les païens se convertiraient à la sainte foi du
Christ. Et autrefois Famagouste, qui est au bout de l’île de Chypre, du côté du Levant – de Beyrouth et de
Tripoli en Palestine, il y a une distance de cent soixante milles –, on pratiquerait le commerce pour toute la
nation des chrétiens d’Occident. Ainsi toutes les caravanes chargées d’épices arrivaient à Beyrouth et à
Tripoli de Syrie, et de là, avec leurs navires, les cotons et autres marchandises qui proviennent de Syrie, tout
cela était transporté sur leurs navires à Famagouste, pourvue d’une enceinte et d’un port. Il y a là une place
très grande, ainsi qu’une rue longue avec des loges magnifiques de toutes les nations de chrétiens
d’Occident. La plus belle est celle des Pisans, et aujourd’hui encore, au temps présent, elles sont en bon
état.
R (p. 1262) LXXXII Mesures qu’il faudrait prendre pour favoriser la prospérité d’Alexandrie sous les chrétiens :
renouveler l’interdiction du trafic direct des chrétiens avec les ports sarrasins
Quand il plaira à Dieu qu’Alexandrie se trouve entre les mains d’un seigneur chrétien, celui-ci devra aller tout
de suite veiller à l’approvisionnement qui se faisait à Famagouste, et encore plus soigneusement que cela
n’était le cas à Famagouste. Et la première chose serait que le pape de Rome prononçât l’excommunication
expresse contre les chrétiens, lesquels pour une raison ou une autre, iraient en Terre sainte, afin qu’aucun
d’entre eux ne put apporter ni échanger des épices de la Terre sainte – d’aucun lieu ni d’aucune région, ni
des mains des chrétiens ni de celles des païens – pour les emporter en Occident, si ce n’est de la ville
d’Alexandrie ; et la même peine serait infligée à celui qui chargerait du coton et d’autres marchandises
provenant des régions de Syrie. Cette mesure aurait pour effet que toutes les nations païennes auraient
l’occasion de prendre des dispositions contre le sultan, afin d’avoir la voie assurée et libre vers la ville
d’Alexandrie, et de pouvoir fréquenter les chrétiens, et en terre chrétienne, là où régneraient le droit et la
justice ; ils apprendraient ainsi à connaître la foi chrétienne. Mais après que les seigneurs chrétiens auront
fait connaissance des habitants de l’Inde, et également des païens qui sont les seigneurs des îles et des
lieux qui produisent les épices, ils veilleront à mille bonnes dispositions afin de pouvoir venir à Alexandrie en
toute sécurité et pour toujours, avec leurs épices, comme s’ils étaient dans leur propre demeure ; et je vous
assure qu’ils ont sans cesse adressé et adressent à Dieu leur prière pour qu’Alexandrie soit entre les mains
des chrétiens.
D2 (p. 134) LXXXVI Commerce d’Alexandrie avec les pays étrangers. Premièrement : avec Tunis, Tripoli et
les états barbaresques
Jusques yci avons dénoté lez raisons et conditions du Cayre et de Babilonne, lesquelx sont hédifiez en leux
désers, entre deux mers. Et de l’une part vers Lavant, là où sont lez ysoles et mers là où naissent lez
espices, lezquelles lez conduissent par mer avecques leurs navilz au Cayre ; et la segonde mer si est la mer
de Ponent, qui est soubz crestiens, et une part soubz payens, lequel pays tous navigent avecques leurs
galées et naves et marchandise au port et cité d’Alexandrie ; et de là se mettent au Cayre, et si s’espandent
par le pays d’Egipte. Et pour tant donrons commencement, et premiers du pays dez poyens qui vont en
Alexandrie. Premièrement le pays du roy de Tune et de la Barbarie, Tripoli et tous celluy pays, en tant que
chescun an viennent de celle (p. 135) de Barbarie en Alexandrie .viij. ou .x. naves de .iiij.C. per fin à .viij.C.
bottes l’une, chargie de marchandise. Et la majeur part sont chargie de olio en jarre, couvertures blanches
de laine une trèsgrant quantité en balles, dezquelles couvertes, avecque une d’icelle ung Arrabois se la met
entour de luy sus sa chair nue, sans aultre vestir, et avecques celle si le descent en terre et dorme dessus
de nuyt. Après portet cire, olive en jarre couverte et olio, et cebibo ou vrayement raisins de quaresme.
Ancores chargent de petis esclaves noires .M. ou .M. et .v.C. ou .ij.M. chescun an, de temps environ de .x.
ans l’ung, et tous lez font devenir payens, pourquoy crestiens ne sèvent achetter. Et aussi beaucop d’aultres
marchandises menues. Et quant lezdictes naves de Barbarie joingent au port d’Alexandrie, deschargent
leurs marchandises en terre, et ne lez peuvent lever de là se premièrement ilz ne payent lez drois de la
doana, qui est .xviij. pour cent. Et puis, eschargie ladicte nave, demeurent tout l’iver en Alexandrie, et vont
vendant et achettant, et si font leurs besoinges. Et aulx temps noveaulx, commensant du premier jour d’avril
jusques au .xv. jour dudit mois, et puis se mettent tous en ordre, et si se partent et chargent de beaucop
manières de marchandises, lezquelles sont principalement d’une trèsgrant valeur. Et sont lezdictes
marchandises cestes : lins, cottons, espices comme povre, lacq, incense, archende et aultres espices ;
lezquelles espices de là lez espandent vers Ponent jusques ès pors de Cathologne. Ancores (p. 136) draps
de soye, toile de lin grosses et subtilles, et joyaulx comme balais robins, perles de contes et de toutes
choses pour trèsgrant valeur. Lezquelles naves ont de costune de tousjours venir audis pors d’Alexandrie
vers la fin de september, et de se partir au temps nouveaulx, comme du mois d’avril ; et tousjours se lièvent
tous ensamble de conserve, pour doubte qu’ilz ont de corsaires. Et si ne porroit vivre le pays de Barbarie
sans la cité d’Alexandrie par nesune manière du monde : pourquoy lez choses qui naissent en leur pays, n’a
aultre voye de lez conserver se non par la voye d’Alexandrie, et semblablement lez choses qui sont
nécessaire et besoings en leur pays, convient qu’ilz lez ayent par la voye d’Alexandrie.
D1 50. Marchandises de Syrie.
Et des parties de la Surie, comme de Baructi, Tripoli et de Lallicza, se chargent naves sur lezquelles se
chargent savons, soyes cebibo ou vrayment roisins de quaresme, rosa egrosa avantageuse, et toutes ces
choses se conduissent avecques lezdictes naves en Alexandrie.
D1 51. Marchandises d’Asie Mineure (Turquie d’Asie). Incident contemporain de l’auteur : une galère turque
capturée par un corsaire catalan.
De Sathalia et Candiloro, qui est pays de la Turquie et confine avecque le pays de Surie, qui sont terre de
mer, et vient de leur pays et respont ès lieux de mer, et premiers : soye, cire, saffran, susumani, tappedi,
laine soubtile, esclaves et esclavectes, galle, miel et des aultres marchandises. Et tout se chargent sus
grosses gallées, car ilz sèvent faire èsdis lieux galées à la mesure apportées de galées de Vénissians qui
vont à voyage de Flanders. Et avecques celles galées apportent toutes leurs marchandises en Alexandrie.
Par tel manière que l’une de leurs galées rencontrarent Misser Incoteres Catelain qui s’en alloit en
courssegue avecques deux de ses galées, et si rencontrarent ladicte galée et furent ès mains et firent
grande battaille. Mais alla fin ledit Misser Incoteres prinst celle galée avecques. C. et .l. Turs, entre
marchans et esclaves, qui venoyent estre portés au souldain, et avecques toutes marchandises, par tel
manière que ladicte galée fust estimée de valeurs de .l. M. ducas.
Audit lieu de Sathalia, pour estre boscages et flumes qui respont en mer, ilz ont ligname de toutes raisons
pour faire naves et galées infinites. Ancores audit lieu de Sathalia se charge naves et galées de ligname de
toute raison, et si se portent en Alexandrie et à Damiata ; duquel ligname le souldain fait faire ses galées
pour guerroyer crestiens. Ancore dudit lieu de Sathalia ne saille galées armées qui vont contre crestiens.
Esdis lieux viennent les crestiens de Ponent, lezquelx sont marengons et sèvent faire les galées en manière
de crestiens, et si prisent Turs et ne prisent leur art ; et si vont multiplicant à dompmage et à ruyne de
crestienté. Et après, dudit lieu se tiret pegola, aultrement poix, à grant quantité, et si se portent en Alexandrie
et à Damiata.
À partir de Sathalia se va sus par la rivière du pays de Turquie, et passés l’isole de Rode et de Bochar, le
canal de Rode, et prendre la volta par la rivière, s’en va à Pallatia et aultres lieux de Turquie, parmi l’isole de
Sio à .xviij. milles, laquel ysole de Sio est de Genevois. Et auquel lieu de la Pallatia et aultres lieux entour se
chargent cestes marchandises comme dessus lez naves : c’est assavoir cebibo noires, qui sont roisins de
quaresme, saffran, cire, susumani, galla, couvertures par balles, sclavi et sclave, cuirs tins en rouge. Fautres
de laine, miel, et de aultres menues marchandises. Et tout se portent au port et cité d’Alexandrie ; et aulcune
fois, avecques petis navilz, en Damiata par la bouche du flume, perque non y a port senon que le flume qui
descent du Cayre. De la Pallatia fine en Brusia, laquel est terre principal de la Turquie, a .viij. journées.
D1 52. Marchandises de Turquie d’Europe (Grétie).
Quant la Turquie fust de crestiens, le siège de l’empereur si estoit en la cité de Brusia, comme à présent il
est à Constantinopoli. Et le grant seigneur de la Turquie se retrahist pour son estance in sus la Grétie, en la
cité d’Andrinopoli, qui est près de Constantinoble environ à .vj. journées. Et semblablement print Ghalipoli,
qui est sus la rivière de l’estroit de Romania. Auquel lieu arrivet moult marchandises, et premièrement
esclaves crestiens, marters, vars, zebbelins, armelins, cire, saffran, susumani, galla, cuirame adoubbé pour
cordouuanniers, et des aultres marchandises. Et tout se charget sur naves de crestiens et de payens, et de
lieux en lieux vont tant qu’il viennent au port et cité d’Alexandrie.
À Constantinoble viennent de toutes marchandises, et viennent par la bouche de la mer Majeur, comme de
Latane, Gaffa, Trapexonda, et ancores de la Turquie et de la Grétie. Et premiers : soye, martres, vars,
zebbelini, armelinz, rami en piatines, saffran, cire, cuirs adoubbés. Et de telles marchandises se chargent sur
naves, et vient droit par la scala et se portent au port et cité d’Alexandrie.
De Saloniqui qui est magnifique cité, et si est sus la rive de la mer dessus la Grétie – et si l’eurent lez
Venissians de l’empereur ; et depuis celle occupation de la guerre du duc de Milan, Venissians l’ont perdue,
et est allé soubz lez Turs, lequel avecque toute sa puissance et avecque la personne combatist pour l’avoir
– de laquel cité tousjours s’en tiret plomp, cire, miel. Et si le mandet par navilz en Candie, et de là au port et
cité d’Alexandrie.
D1 53. Le commerce des esclaves à Gaffa.
La cité de Gaffa est de Genevois, et si est voisine et circondée du pays payens comme de Tartres, de
Cercassi et de Rossi et d’aultres nations poyens. Jusques à celles pars le souldain du Cayre mande ses
facteurs et fait achatter esclaves, lezquelx n’ont nesune aultre voye de monter en mer se non que en la cité
de Gaffa. Et quant ilz viennent mennés audit lieu de ceulx ytelz exclaves, Genevois gouverneurs dudit lieu
font demander se ilz veullent estre crestiens ou poyens : et ceulx qui disent voloir estre crestiens, les
retiennent ; et ceulx lezquelx respondent voloir estre poyen, lessent aller, et demeurent en la liberté du
facteur du souldain, lequel lez vient à chargier sur naves de trèsfaulx et trèsmavais crestiens, et lez
apportent en Alexandrie, ou vrayment à Damiata, et de là au Cayre. Et se ne fust la nécessité que Genevois
ont de la cité d’Alexandrie, ilz ne lasseroyent passer nesuns desdis esclaves.
D1 54. Marchandises de Flandre.
De la Flandre fameuse et gentil s’en tirent draps de laine une trèsgrande quantité et d’une trèsgrant valeur.
Après s’en tiret ambre, estain, vers, et beaucop d’aultres marchandises par menus ; lezquelles
marchandises se chargent sur naves et sur galées, et viennent de pors en pors infin au port et cité
d’Alexandrie.
D1 55. Marchandises de Séville.
De Sibilia si s’en tiret olio en jarres une trèsgrant quantité ; et plus s’en soloit tirer au temps passé qui ne se
fait au présent. Ancores s’en tiret vermeillons, verdegris, asur, argent vifz, et tout ytelles marchandises ; et
avecques naves se portet au port et cité d’Alexandrie.
D1 56. De Majorque.
De l’isole de Majorque s’en tire olio en jarres, et labourage de pierres, et grans pos de pierre, et si se vent de
.xij. à .xv. ducas le pitier plain ; laquelle marchandisez se portent avecques naves au pors et cité
d’Alexandrie.
D1 57. De Sicile.
De l’isole de Cicilia s’en tire mellaci, qui sont colladure de sucre, et si la mettet en petis vaseaulx comme
carteles. En après s’en tire fromage et beure, et toutes ytelles marchandises se charge sur nave et si se
portent en Alexandrie.
D1 58. De Catalogne.
De Cathelogne et de Barselonne s’en tire moult de marchandise. Premièrement draps de laine de trois
manières : barsolonois, cathelanois et perpignan ; coral à grant quantité en casses et pour trèsgrant valeur ;
miel de trois sortes : minchinese, cantara et catalanois ; cebibo, amandels, noisectes, coffolo, herbe de
bamo. Et toutes telles marchandises se portet en Alexandrie avecques lez leurs naves et galées. Et quant le
souldain a guerre contre Cathalains, il fa faire ung commandement par son pays que nesune personne ne
soit si hardis qu’il ose porter marchandises de Cathalains en son pays ; et qui l’apporteroit lez perderoit, et
se seroit du souldain. Et en ceste manière moult de marchans estraignes lez portent, de quoy et pour quoy
en sont desfais et désers ; et ce est la plus grant guerre que le souldain puisse faire à Cathalains. Et aussi il
commande que ilz ne puissent chargier marchandise que naist en son dit pays, ne la porter en Alexandrie ne
en Damasque.
D1 59. De Gênes.
De Genua, ou vrayment de sa rivière, se charge noisettes qui s’appellent noisettes de Vintemille
avantageuses, et si se portent sur naves de Genevois en Alexandrie. Lesquelles naves viennent de
Flandres, et viennent par les escales, de lieux en lieux, comme en Sebile, Cicilie, réaume de Naples, et puis
viennent à l’isole de Sio que est leur, lequel est pas de marchans, et là deschargent, et chargent des aultres
marchandises ainsi comme ilz treuvent leur partis. Et puis se partent, et aucune fois se présentent en Rode,
et puis tout droit s’en vont en Alexandrie, et là fenissent toute la charge de leurs naves ; et rechargent dez
espices.
D1 60. De Venise.
De Venise, là que par la voye d’Allamagne se porte al fondigo des Almans or en verges pour ung trèsgrant
valoir ; et tout se met alla Sicca, c’est assavoir alla monoye, et en font faire ducas ; dezquelx ducas pou s’en
consument par aultre voye se non qu’ilz sont portés en Alexandrie et au Cayre. En après est portés de
Venise argent en platine, une trèsgrant valeur, de quoy une part se met alla monoye, et une part en platines,
et si se portet en Alexandrie. A Venise se labeure draps d’or et de soye, velus de toutes manières, draps de
laines (et aussi en vient de Flandres), et labeurs d’argent, savon, labeur de cristal. Ancores de Flandres se
porte ambre, estain, varri ; de Lombardia, saffran, miel ; de Bologne, castaignes ; et d’aultres beaucops de
marchandises de divers pars. Et ainsi le fondic ont de toutes marchandises, et se portent en Alexandrie
avecques naves. Et au bout de l’an vont lez leurs galées et chargent espices et lez apportent à Venise pour
une trèsgrant valeur ; et celle se consument par la voye d’Allamaigne, et par la voye de Flandre et
Aquemort, et par la Lombardie et Ytalie petite part s’en consument. Et cessi est la voye et la manière que
Venise vit avecque le souldain. Et est comme chose esforssée pourquoy la leur terre ne porroit vivre sans
ceulx pays…
D1 61. D’Istrie et de Dalmatie. De Corfou.
De Ystria et de la Sclavenie, qui est de Venitians, ne s’en tire se non soye en petite quantité ; aussi du coral,
et se le mettent in casse, lequel pesche en les eaues de Ragouse, et celluy se charge quasi sur lez galées
venissiannes ; et si se portent en Alexandrie.
De l’ysole de Corfu, qui est de Venissians, se charge miel en bottettes beaucop, et cire ; lezquellez choses
se conduissent par terre en Albanie et en Grétie, qui est desoubz Turs ; et tout sur les galées de Venissians
se portent en Alexandrie.
D1 62. De Morée.
Le pays de la Morée, qui est soubz lez trois frères de l’empereur de Constantinoble, et volte .vj.C. milles et
est circondée de mer, et si se entre par une bouche qui s’apellet l’Exemili, que jà fust murée, et les Turs
rompirent les murailles. Ouquel pays sont trois lieux avecques trois évesques, comme Modon, Coron et
Napuli de Romaigne, qui sont de Venitians, et tous lez trois lieux sont sur la rive de la mer. Et pource que
oudit pays naissent olio beaucop, miel, cire, figue, lezquelles choses comme olio en bottes et miel en
bottettes, tout se conduisent à Modon et à Coron, et de là, avecque naves et galées, tout se portent en
Alexandrie. Dessus ledit pays est l’archeveschié de Patras qui est une magnifique chose, mais les Grès l’ont
conquesté.
D1 63. De l’Eubée.
À l’ysole de Negriponte qui est de Venissians si se conduisent de la Grétie qui confine avecque ledit
Negriponte, et lezquelx pays sont soubz Turs, et s’en tire miel, cire, plonc petite quantité. Et tout se porte en
Alexandrie.
D1 64. De l’île de Chio, et de Palatiya.
De l’isole de Sio, qui est de Genevois, en laquel ysole naist mastici que ne s’en treuve en nesune part du
monde plus que là. Et se est pour la puissance et virtu du saint corps Misser Sain Sidro lequel est en ledit
ysole. Et lequel mastici se mande la plus part en Alexandrie, et le demorant à Damasque et aulx aultres lieux
de crestiens et de poyens. Et ay veu en mon temps en Alexandrie vendre la casse .C. ducas.
Ladicte ysole de Sio confine avecque la Turquie. A .xviij. mille, que aultres lieux, est Palatia, terre de marine,
là que navilz de Genevois traffiguent avecques draps, savon, estain, plonc et aultre simillante marchandise.
Et de là en tirent cire, saffran, susumanni, galle, tappedi, cuirs rouges, et aultres similles marchandises. Et la
conduisent à Sio, là où ilz chargent sur lez leurs grandes naves. Et tout se portent en Alexandrie, que par
aultre voye ne porroyent despachier.
D1 65. De Rhodes.
De l’isole de Rode s’en tire aulcune petite quantité de miel trèsbon, et si se met en jarres ; lequel sur naves
se mande en Alexandrie. Ancores lez citoyens de Rodes solloyent aller avecques leurs naves à Signe, que
prindrent Venissians, et là chargioyent ligname de chescune sorte, et les conduisoyent en Alexandrie. Et
ancores avecques lezdictes naves alloyent en Turquie, et là chargioyent ligname d’ung aultre sorte ; et tout
se conduisoyent en Alexandrie. Mais depuis pou de temps en sà les seigneurs de Rode ont pourveu par
telle manière que leurs dis citoyens ne font plus telle marchandise. J’ay veu citoyens de Rode de telle
marchandise venir en trèsgrande ricesse, et depuis, euls et leurz enfans, retournez en grant miserie et
poverte, et eulx et lez leurs enfans finir leur vie au beau hospital.
D1 66. Des îles de l’Archipel.
De l’isole de l’Archepielagho, comme de l’isole de Sainctorin, s’en tire mielx trèsfins ; et des aultres ysoles
s’en tire mielx ; et le mettent en bottes. Après, de celle dicte ysole s’en tire une bonne sorte de fromage. Et
toute celle marchandise passe par l’isole de Crède, et de là avecques naves se mande en Alexandrie.
D1 67. De Chypre.
De l’isole de Cipre s’en tire pour ung trèsgrant valeur et une trèsgrande quantité de zambelotti. Et tous, ou
voir la plus grant part, avecques naves, ou vrayment par la voye de Rode, viennent estre mandés en
Alexandrie, et de là au Cayre… Après s’en tire laine soubtile, qui vault .xxx. ducas et plus le sacq ; et
mellassi, qui est comme colladure de sucre. Et toutes choses se portent en Alexandrie.
D1 68. De l’île de Crète.
De l’isole de Crede, là où naisse malvasie, s’en tire grant quantité de miels en bottettes, cire, fromage ; et
tout avecques navilz se portent en Alexandrie. Et de mon temps ay veu consumer en Alexandrie et Damiata
plus de .ij.M. bottes de malvasia ; mais depuis que le souldain prinst l’isole de Cipre, … il a restreint lez pas
de consumer la malvasia…
R (p. 1264) CVI Alexandrie est le marché de rencontre de l’Occident et de l’Orient
Saint-Père, depuis ce premier jour béni où arrivant de Florence je vins m’incliner au pied de Votre Sainteté,
mon but essentiel et premier – au moyen d’une parole et d’écrits incessants, et jusqu’au jour présent – a
toujours été la conquête d’Alexandrie. C’est de là que viennent et c’est là que se rendent les chrétiens des
mers d’Occident, et elle apparaît comme une fontaine d’or et d’argent et de toutes les autres marchandises
et tous les biens nécessaires au pays d’Égypte.
Ce pays est quasiment désert, car il n’y pleut jamais. L’arrivée des chrétiens à Alexandrie est l’occasion pour
les marchands du pays d’Inde d’arriver avec leurs navires chargés d’épices et d’autres biens de valeur,
joyaux, rubis, diamants, perles de prix et toutes autres choses précieuses – et ceci par mer et par terre –, qui
sont transportées à Alexandrie. Les marchands atteignent là le but espéré, pour lequel ils ont quitté leurs
demeures, tout comme font les marchands chrétiens qui viennent des mers d’Occident vers Alexandrie. Ils
s’y trouvent tous rassemblés, vendent et achètent comme ils ont toujours eu coutume de le faire. Mais en
vérité, si les chrétiens des mers d’Occident ne se mettaient pas en mouvement et ne venaient pas à
Alexandrie, les marchands de l’Inde n’auraient pas de raison de se rendre à Alexandrie. Et comme il n’y
aurait plus (p. 1265) de mouvement de part et d’autre, le sultan du Caire n’aurait et ne pourrait avoir ni de
force ni de bien qui vaudrait un seul marc de Venise.
Comme la cité du Caire est édifiée entre deux mers, si ces deux mers ne communiquaient pas, Le Caire ne
vaudrait pas grand-chose et serait comme un désert abandonné et dépeuplé. Mais le tort des chrétiens qui
se rendent en ces lieux – à savoir les chrétiens qui viennent des mers d’Occident –, c’est de venir avec leur
entourage et de leur avoir comme bon leur semble, et ils sont soumis au sultan qui fait d’eux et de leurs
biens ce qu’il lui plaît, en se moquant de la foi chrétienne et en causant de grands torts à la chrétienté. Ainsi
les droits de douane importants et les contraintes qui pèsent sur le marché des épices font qu’elles coûtent
le double de ce qu’elles coûteraient. Et tout ceci se fait aux dépens des citoyens de Flandre, d’Allemagne,
de Hongrie, et de tous les autres pays chrétiens.
R CVII L’interdiction prononcée anciennement par les papes contre le commerce des chrétiens avec
Alexandrie ne saurait tenir. Importance vitale de ce commerce pour les pays chrétiens
Saint-Père, j’apprends de la bouche de Votre Sainteté que vous ne laissez aucun chrétien se rendre, en
aucune manière, à Alexandrie. Si ce qui est noté dans ce présent livre est vrai, cette mesure a beaucoup nui
à la chrétienté. Cependant, Saint-Père, à ceci je réponds qu’il n’est pas possible que les chrétiens obéissent
à Votre Sainteté en ne se rendant pas à Alexandrie et dans les autres parties de Terre sainte. La raison en
est que ces pays sont si féconds, et si bien pourvus par la nature, qu’ils sont très utiles au peuple chrétien et
qu’ils l’aident à vivre. Et ainsi, si les chrétiens tombent dans ce péché, la faute n’en revient pas à eux,
comme on pourrait le dire, car Alexandrie, dès les temps antiques, était sous la domination chrétienne. Et
pour l’heure présente, elle attend de le redevenir.
R CVIII Mais il faut qu’Alexandrie devienne chrétienne. L’or de la papauté devrait être utilisé à cette fin, au
lieu de servir à soutenir des luttes fratricides contre les chrétiens
Saint-Père, voici dix ans que je ramène constamment à votre mémoire la conquête de la ville d’Alexandrie, à
l’aide des raisons que je consigne dans ce livre. Cette conquête serait le début, le moyen et le but à
atteindre pour la conquête de Jérusalem, et pour en être maître jusqu’à la fin du (p. 1266) monde. Plus
jamais les chrétiens n’auraient à traverser des terres païennes, mais il serait en terre chrétienne et la ville
d’Alexandrie serait aux chrétiens. Ce serait le lieu où l’on trouverait toutes les nations chrétiennes, lesquels
ne peuvent vivre ni subsister, en particulier ceux qui ont besoin de marchandises, sans cette ville et sans la
grâce de Dieu. Cette fois, on pourrait dire que la roue a tourné en faveur des chrétiens. Comme aucune
nation païenne ne peut vivre sans la ville d’Alexandrie, et comme tous sont contraints de se procurer les
biens qui leur sont nécessaires, ils viendraient à Alexandrie qui serait entre les mains des chrétiens, tout
comme par le passé les chrétiens se rendaient vers cette ville qui étaient entre les mains des païens.
Et pour cette raison, Saint-Père, Votre Sainteté depuis sa jeunesse jusqu’au jour présent a toujours
témoigné du désir de conquérir Jérusalem. Pourtant, si depuis que vous êtes pape vous vous y étiez
attaché, si vous aviez mis de côté une somme d’or, c’est-à-dire chaque mois un peu d’or dans une cassette,
environ cinq mille ducats – ce qui aurait été une petite réserve prise sur quelque bénéfice ecclésiastique –,
vous auriez alimenté le désir que Votre Sainteté éprouvait. En dix ans, vous vous seriez trouvé en
possession de deux cent mille ducats, lesquels auraient suffi à conquérir Alexandrie, le vieux Caire et
Jérusalem, et un peu de temps. Il est connu, par une information qui m’a été transmise, qu’en dix ans la
Chambre apostolique ainsi que les autres domaines de l’État temporel de la chrétienté ont reçu plus de deux
millions de ducats ; et jusqu’à présent tous ont été jeté à la mer. Pourquoi ? Dans le passé les papes ont mis
ces sommes de côté, et Votre Sainteté a pris la même disposition. Et pourtant Dieu a ordonné la condition
de la chrétienté de sorte que sur le plan temporel il ne lui est rien resté, et tout ceci a été permis par Dieu.
Pour la raison suivante : les rentrées de l’Église de Rome, qui doivent se dépenser dans la lutte contre les
païens en secouant la foi chrétienne, sont dépensées en hommes de guerre que l’on paie, pour ruiner la
condition de la chrétienté et créer la discorde entre les chrétiens, de sorte qu’ils ont amenés à s’entretuer.
D2 (p. 165) CXI Les consuls des nations d’Occident à Alexandrie
Père Saint, antiquement, quant lez seigneurs crestiens de Ponent (p. 166) vollurent entrer ou pays du
souldain du Cayre, toutes nations de crestiens mandarent leurs ambassadeurs en la présence du souldain,
et là se accordarent de toutes lez leurs occasions, avecques pactes que chescune nation deust tenir ung
sien conseilliers en Alexandrie, lezquelx eussent de la doane d’Alexandrie, pour chescun an, .ij.C. ducas, et
fondigue pour leur demeur. Et tous marchans de chescune nation ont leur (p. 167) conseilliers, et ainsi fust
tousjours observé. Et que chescun desdis conseilliers eust à gouverner et à régier tous marchans de sa
nation, pour attendre et despachier devant le souldain et de tous aultres ses officiers, affin que ne leur soit
fait tort nesun ; et que eussent chescun ung de ceulx conseillers son jour député pour chescune semaine
pour povoir tirer et avoir ses marchandises de la doana. Et ainsi tousjours fust observé et observent. Et dist
le souldain que : « Toutes conventions et patz que je fais avecques vous, seigneurs crestiens, d’avoir lez
vostres conseilliers, est pour obéyr et garder de toutes scandels et division qui peust entrevenir, et affin que
tous lezdis conseilliers ayent occasion de temps en temps de scripvere et de manifester aulx seigneurs du
Ponent la bonne compagnie que je vous fais ». Et en (p. 168) ceste forme et patz crestien ont usé en
Alexandrie et à Damasque. Et par occasion des conseilliers, le pays venoit estre conservé, pourquoy les ung
conseilliers escripvoyent bien à leurs seigneurs, et lez aultres mieulx, qui estoit fame du souldain entre
crestien.
R (p. 1267) CXV Alexandrie conquise deviendrait comme une seconde Rome et un foyer de conversion des
Sarrasins
Saint-Père, moyennant la grâce de Dieu le Tout-Puissant, avec les raisons bien fondées que j’ai consignées
dans ce livre, et pour d’autres multiples raisons, plus nombreuses qu’on ne pourrait dire, la conquête de la
ville d’Alexandrie doit permettre de relever la situation de la chrétienté et de la glorifier dans un grand
triomphe. Et cette ville sera appelée la Rome nouvelle, comme s’appelait Constantinople. Dans cette ville se
tiendront ensuite les grandes discussions de la foi chrétienne contre celle des païens, et au terme de tous
ces débats, les païens éclairés par la lumière de la vérité se convertiront et se soumettront à la sainte foi de
Jésus-Christ.
R CXIX Les forces qu’il faudrait pour attaquer Alexandrie. La route à suivre
Pour conquérir la ville d’Alexandrie, on a besoin de dix navires de sept tonneaux ; sur chaque navire, il faut
deux cents arbalétriers et cent marins, ces derniers possédant leurs armes et arbalètes comme les
arbalétriers. Ensuite, vingt galères et dix petites galères, et trente barques de la dimension des barques de
peottes168, qui naviguent à l’aide de huit rames. Chacune d’elles porterait quatre arbalétriers et deux
bombardelles169 pour embarcations. Cette flotte, avec la proportion de trois barques pour un navire, serait
composée de trente barques, avec vingt barques auprès des galères. Au moment où il serait besoin, cette
flotte pourrait apparaître composée de cent vingt voiles. La dernière escale de cette armée sera le port de
Palocacastro170, où se trouve le cap Sidero de l’île de Crète, du côté de l’orient, et de là elle devra faire voile
vers le cap Salmone qui est proche, et de là, au nom du Saint-Esprit, prendre la mer entre la Crète et
l’Égypte. De là jusqu’au port d’Alexandrie il y a quatre cent et un milles. Ce parcours se fera du 1er jusqu’au
10 septembre, époque favorable pour traverser ces régions maritimes en quatre ou cinq jours. Il faut garder
à l’esprit qu’à la vue d’Alexandrie, les cent vingt voiles devront se montrer toutes ensemble, afin de
provoquer une plus grande frayeur chez les habitants du pays. Cette nouvelle parviendra au Caire, non qu’il
y a cent vingt voiles : comme ils en ont l’habitude, ils diront qu’il y en a plus de deux cents ! Et cette nouvelle
provoquera une grande confusion parmi les gens du sultan. Il s’en trouvera peu pour lui obéir à ce moment,
car tout le peuple dira que cette flotte arrive à cause (p. 1269) des torts que le mauvais gouvernement du
sultan a fait subir aux chrétiens. Et le peuple sera monté contre lui.
R CXX On ne manquera pas d’eau douce à Alexandrie
À Alexandrie, il pleut en hiver tout comme sur l’île de Crète, à Rhodes et à Chypre. Et les terrasses des
demeures sont plates, et les eaux de pluie coulent par un canal qui est prévu à cet effet et elles sont dirigées
vers les citernes. Chaque terrasse correspond à une demeure, et chaque demeure a sa citerne. Les
réserves sont mesurées, et ainsi l’eau se répand dans les citernes. Ainsi avec quatre grosse galères on peut
se rendre jusqu’à la bouche du fleuve à Rosette, car en deux journées elles reviendront avec mille tonneaux.
Elles peuvent se décharger dans la ville d’Alexandrie et les vider dans les citernes. Tout ceci montre bien
qu’on ne manquera pas d’eau. Mais je le dis pour ceux qui ne sont pas informés et qui ne parlent que par
ouï-dire – et non d’après leur propre expérience – et qui penseraient qu’Alexandrie pourrait manquer d’eau.
Pour ce qui me concerne, je ne parle pas par ouï-dire, mais à cause de ce que j’ai vu durant les nombreuses
années que j’ai passées dans cette ville d’Alexandrie. Et je me souviens qu’au mois de septembre, nous
nous en remettions à Dieu pour pouvoir travailler la terre, et grâce à la grande crue du fleuve, tous les puits
d’eau salée se remplissent d’eau douce, et les citernes des demeures habitées sont pleines. Les autres
demeures qui ne sont pas habitées peuvent également se pourvoir, quelles que soient les dispositions du
sultan, sans qu’il puisse s’y opposer. Par ce moyen très sûr on aura de l’eau pour dix ans. En peu de temps
on pourra trouver un accord avec les Bédouins, et ainsi les chrétiens seront maîtres du fleuve et de toute la
terre.
R CXXI Manière d’aborder la plage d’Alexandrie
Pour la raison qu’au port d’Alexandrie navires et galères ne peuvent aborder – il s’agit en effet d’une plage –,
je rappelle que le lieu où navires et galères peuvent aborder n’est pas très éloigné. Et comme les préparatifs
auront prévu dix galiotes, des chaloupes de navires et autres embarcations, qui atteindront le nombre de
quatre-vingt-dix, bien vite les hommes d’armes avec tout ce qui leur sera nécessaire seront à terre ; tous
(p. 1270) seront rapidement prêts pour l’assaut final de conquérir les lieux. Sans aucun doute, les gens du
pays ne seront pas préparés à se défendre, et ils abandonneront plutôt leur terre. Et même s’ils voulaient se
défendre, ils ne pourraient le faire contre de telles forces. De même, ils ne pourraient recevoir aucune aide
du Caire avant huit jours ou davantage.
D2 (p. 179) CXXIX Données topographiques pour l’attaque de la ville. Saison la plus favorable à l’entreprise
Le premier voye d’entrer en Alexandrie si est la porte de la premier doane de mer, que à cops de une
anteline et force de bras de (p. 180) galios se gettera la porte par terre. Et en celluy lieu meismes lez murs
de la doana ne sont pas quatre pas de hault ; et, ayant eschieles faites de bois, et prestement lez dressier,
et escaler et entrer dedans, sans demorance. Et comme serez171 dedans, paser à la segonde doane, là où
que se peut aller, et entrer par deux voyes en la terre. Et premièrement en celle segonde doane, si a une
muraille loinge de magasins, (p. 181) et sont en nombre xxx, qui sont en mains de marchans crestiens, là où
ils tiennent les leurs marchandises soutilles jusques à tant que ils lez veuillent tirer de la doane ; lezquelx
magasins sont conjoinctz avecque ung aultre mur de la terre, pou hault. Et de l’autre part de la muraille, par
dedans, si est ung grant fondigue que par autrefois ils demouroyent Genevois, mais depuis est demouré en
main de Sarrasins ; lequel fondigue je l’ay eu en mon gouvernement. Et du costé de dedans si est ung aultre
face de magasins beaucop, conjointz avecque ledit mur. Et moy ayant magasins dedans la doane, et veyant
et cognoissant le partit, moy, avecques mes propres mains et avecque ung mien verlet, rompîme le mur qui
estoit entre lez magasins de la doane et mon fondigue, par telle manière que je entrove et yssoye beaucop
de marchandise d’aultres et miennes qui ne payoyent aulcuns commerquio. Et lesdictes marchandises
estoyent cestes : velus, soye, draps d’or, ambre, saffran. Et par cete première voye se peut entrer dedans la
terre, et de présent est chief de magasins de la doane. Segondement, si est une porte de pou de puissance,
par laquelle se tire toute lez marchandises de la doane, et si se mettent hors en ung petit champt. Et près de
là a une aultre porte, et rompue celle, vous voz trouverés dedans la terre devant le premier fondigue de
Vénissians. Et aussi la porte de yssir de la doane et l’autre porte de entrer en la terre, à cop de haches
subbitement seront gectées par terre.
Ancore dessus la première porte de la doane, premier de mer, si est l’arsenail, qui a une porte que à cops
d’une anteline et force de bras des jonnes compaignons de galées la getteront par terre ; et ainsi se entrera
dedans. Et puis si est à rompre une aultre porte, que seullement de donner cops de piés, yra par terre. Et
puis vous trouverés entre deux portes, qui est une large place : enver la terre trouverés la porte du fondigo là
où sont lez magasins là où les marchans tiennent la malvaseya. Et là est ung mur de la terre vieille et
aruyné, et se peut esbatre avecque ung rième de galée, che prestement yra par terre ; et (p. 182)
subbitement se entrera en la terre. Et y a une voye large à main destre ; et en l’entrée si est le fondigo
d’Anchontans, et à la main senestre est le fondigo de Napole et de Gayecta. Et par toutes ces voyes et
aultres beaucoup, se aura la terre. Plus sus si est la porte principale de la terre : si est ung grant tour à
voltes qui respont à la mer sur la spagia que crestiens entrent et yssent et tirent lez espices, et dessus celle
porte si est une trèsgrant tour à voltes qui deffent celle porte. Et du temps que le roy Perrin, qui fust roy de
Cipre, conquesta Alexandrie, trouva manière de bouter le feu ; et tant fust le grant chaleur du feu et de la
fumière, que ceulx de dessus abandonnarent la terre. Et l’aultre jour séquent, lez portes qui sont couvertes
de fers, jectarent par terre ; et subbitement furent jectés beaucop de pavais par dessus par celle porte ; et
lez gens entrarent dedans, et eurent la terre. Et environ celle heure meismes lez gens (p. 183) estoyent
entrés par la voye de la doane dedans la terre, et la tindrent trois jours, et si la misrent à sacqueman. Puis
l’abandonnarent, pourquoy ilz n’estoyent pas puissant de la povoir soustenir. Et pour tant, non pas par une
voye, mais par plusieurs se achellera, si se aura ladicte cité subbitement.
D2 (p. 183) CXXIII Saison la plus favorable à l’entreprise
Au mois de septembre attendons en Dieu que aurons la terre d’Alexandrie, qui est au temps que le flume est
creu, est au temps que le flume est creu, et sez sarme, par la voye du Calis, viennent jusques aulx murs de
la terre. Et pour ce, en celluy temps, vont seurement et font bon marchié de noli, et tout le pays de meust
comme ilz feroyent à une foire, et viennent en Alexandrie. Et premièrement, toutes les espices, ou vrayment
la pluspart qui sont au Cayre, se amainent en Alexandrie, qui sont d’une trèsgrant valeur. Après se porte
tous lins, cotons, sucre, formens, farine, ligommes de toutes raisons, et de toutes choses à grant quantité. Et
si se fornisse la terre, après toutes choses de vivre, de marchandises. Et pour ce que Dieu vodra que la terre
se aura de tous biens.
R CXXIV (p. 1270) Curieuses recommandations de l’auteur au sujet des moyens de propagande chrétienne
après la conquête
Comme cette ville d’Alexandrie est l’objet d’une très importante entreprise, il faut se procurer de grandes
cloches et les placer dans les tours et clochers de leurs mosquées, pour rassurer les Sarrasins qui resteront,
après ce jour-là, dans les environs d’Alexandrie. Comme il y a à Alexandrie sept églises chrétiennes, il sera
bon d’amener, avec l’armée, des moines et serviteurs de Dieu qui puissent dire l’office dans ces églises. Et il
faudra organiser de grandes processions chaque jour à travers la ville, pour rendre grâces à Dieu le béni,
pour tous les bienfaits dont Il nous aura comblés, et pour cette raison les Sarrasins ne manqueront pas de
venir de leur propre gré en ces lieux. Ils verront nos coutumes, et ainsi commenceront-ils à aimer les
chrétiens.
R CXXV Prospérité assurée d’Alexandrie après la conquête. Les familles chrétiennes pourront s’y établir
Seigneurs chrétiens, soyez assurés que lorsqu’il plaira à Dieu le Béni qu’Alexandrie se trouve aux mains des
chrétiens, en l’espace de deux ou trois ans elle sera peuplée et habitée de toutes les nations chrétiennes.
Tous viendront avec leurs femmes et enfants, car la terre est féconde, et toutes les nations chrétiennes et
toutes les nations païennes peuvent trouver là leur subsistance. Or on ne le pourrait sans cette cité. Au
temps où je vivais à Alexandrie, tous les jours chaque nation chrétienne adressait de grandes prières à Dieu
pour demander qu’Alexandrie tombât en la domination des chrétiens. C’est pourquoi ces gens viendraient
aussitôt, (p. 1271) amenant leurs femmes et enfants, et ils y habiteraient et finiraient leurs jours dans cette
ville. Aussitôt que le peuple d’Occident aura témoigné là de tous ses efforts, ils auront plus grand désir de s’y
rendre et de pouvoir lutter contre les païens.
R CXXVII (p. 1272) La prise d’Alexandrie sera un grand pas vers la réalisation de ce projet
Seigneurs chrétiens, pour s’engager dans cette entreprise. Il faut être animé d’espoir : de nombreuses fois,
nous avons eu des discussions avec les Sarrasins, en leur disant que leur religion pouvait faire l’objet d’un
débat face à la nôtre. Ils ne cessent de donner le tort aux chrétiens, mais si les chrétiens obtiennent le
pouvoir à Alexandrie, sans aucun doute ils attendront de voir comment les événements se dérouleront. Ainsi
le plan sera mené à terme, et il y aura des débats, afin que Dieu pourvoie au bien des chrétiens. Si la ville
du Caire, qui est la Rome des païens et qui s’appelle la Sainte Porte de la foi païenne, était convertie, et si
elle acceptait dans l’obéissance la foi chrétienne, les autres païens suivraient : la vérité serait alors reconnue
comme la lumière et la certitude pour toutes les créatures.
R CXXVIII Modération à observer après la conquête. Les moulins d’Alexandrie
Il faut envisager qu’à l’arrivée de l’armée à Alexandrie, il sera difficile d’éviter que la terre ne soit mise à sac
pour ce qui concerne les épices et autres marchandises et tout ce qui s’y trouvera ; assurément il faudra
ordonner qu’il ne soit fait aucun mal, qu’il ne soit causé aucun désagrément aux Sarrasins, aussi bien
hommes que femmes, et qu’on leur accorde des marques d’honneur et de respect. C’est la façon de
réconforter et de rassurer tous les gens du pays, elle adoucira leurs esprits et leurs coeurs, et ils mettront à
éprouver amour et affection pour la qualité de la chrétienté. Et je vous rappelle que le peuple d’Égypte est
d’une nature pure et sans malice ; les gens sont crédules, et c’est en toute pureté qu’ils observent la foi
bestiale de Mahomet, jusqu’à ce que Dieu leur fasse connaître la lumière de la vérité.
Je vous rappelle que dans la ville d’Alexandrie il y a beaucoup de moulins à blé, qui sont mis en mouvement
par un cheval, et ainsi se fait la mouture, bien que peu les utilisent. Pourtant si besoin est, il serait facile de
les mettre en route.
R CXXX (p. 1273) Plainte du consul des Vénitiens au sultan Faradj vers 1404 contre les émirs d’Alexandrie.
Noble réponse du sultan
En l’an 1404, je me trouvais au Caire avec monseigneur Andrea Justinian, consul des Vénitiens, qui avait
longuement séjourné en Tartarie et en parlait la langue. Comme il se trouvait en la présence du Sultan, il prit
la parole :
« Seigneur sultan, votre pays vous vient de Dieu, comme pour tous les païens, tous les chrétiens et toutes
les créatures que Dieu a créées en ce monde. Et nous les Vénitiens, dans nos demeures, nous sommes les
maîtres comme l’ont été nos prédécesseurs, tout comme vos émirs qui sont devant vous. Et nous avons
quitté Venise avec des navires et des galères, avec des hommes et des marchandises, nous avons traversé
les périls de la mer et des corsaires, et nous sommes venus dans votre pays pour vendre et acheter, comme
Dieu le veut. Mais en votre terre d’Alexandrie, nous sommes mal traités et pressurés par deux émirs et trois
fonctionnaires. Pourtant nous supportons cela avec patience, et aussi longtemps que nous le pourrons. Mais
quand nous ne le pourrons plus, nous quitterons votre pays. Plus tard, avec les forces de Dieu, nous
reviendrons dans votre pays et y pénétrerons. Alors nous serons reconnus et appréciés ! »
Alors le sultan se tourna vers ses émirs et après s’être brièvement entretenu avec eux, il vint trouver le
consul :
« Ta réputation est celle d’un homme sage et bien d’expérience du monde. Cette fois pourtant tu manques
de sagesse, et tu te lamentes des mauvais traitements de mes fonctionnaires. Voici ma réponse : si mes
fonctionnaires t’ont mal traité, tu aurais dû envoyer vers moi un messager, et aussitôt et sans délai on t’aurait
rendu justice. Ensuite tu dis que mon (p. 1274) pays dépend de Dieu, comme tous les païens et les
chrétiens, et comme toutes les autres créatures. Sur ce point je réponds que je ne puis et ne veux autre
chose, sinon que mon pays dépende de Dieu, qu’il s’agisse de païens et de chrétiens et de toutes autres
créatures. Tu dis qu’à cause des mauvais traitements que t’ont infligés les fonctionnaires de mon pays, tu
veux t’en aller et partir, et qu’après quelque temps, avec les forces que Dieu vous donnera, vous retournerez
dans mon pays : sur ce point ultime je réponds que je fais peu de cas de toute votre force, de celle des
Vénitiens et de celle de toute la chrétienté, et elle m’importe autant qu’une paire de souliers percés. Et parce
que vous chrétiens, vous êtes divisés dans votre foi, je crois pour ma part en un seul Dieu du ciel et de la
terre. Vous avez deux papes, et la moitié des chrétiens croit en un pape, l’autre moitié en l’autre. Votre
pouvoir est divisé en deux, il ne peut rien contre les païens. Comme nous, païens, croyons en un seul et vrai
Dieu du ciel et de la terre, nous avons un seul calife qui nous tient lieu de pape, à qui tous les païens
obéissent. C’est pourquoi Dieu nous a donné l’épée et la force pour attaquer et détruire les chrétiens. » sur
cette réponse, nous quittâmes le sultan Melequenasar, fils de Barquoquo.
D2 (p. 190-196) CXXXI Vaine entreprise de Boucicaut contre Alexandrie en 1403
Pource que lez choses passées monstrent et enseignent lez choses qui sont à venir, et pour ce sont à
dénoter. Notifiant que, en l’an .M.iiij.C. et .iij., Misser Boussicart, qui estoit de France, estant gouverneur de
Gênes, avecque une armée de .x. naves avecques personnes .ij.C. et .l. pour nave, et avecques .viij. galées,
se parti de Gênes. Et des aultres lieux de Genevois en Lavant eust environ de .vj. gallées, qui fust sont
somme .xiiij. galées. Avecques lezdictes naves se trova en Rodes, et pource que la vois de son partement
de Gênes estoit pour guerroyer l’isole de Cipre, avecque lezquelx Genevois estoyent en guerre. Mais estant
Misser Boussicart en Rode, par le moyen du Grant Maistre de Rode furent d’acort avecque le roy, et firent la
paix, donnant aulcune gages de valeur et certe quantité de ducas en Famagosta ; et là confermarent ladicte
paix. Mais vrayement le premier mouvement de Misser Boussicart d’avoir pris l’entreprise de celle armée
fust pour voloir donner le cop à la cité d’Alexandrie. Mais pource que, premier que Misser Bossicart se
trovasse en Rode, desgià par la voye dez maulvais crestiens le souldain fust avisé comment ladicte armée
devoit donner le cop à Alexandrie, par tel façon que marchans, c’est assavoir quarante Genevois qui
estoyent en Alexandrie, furent retenus au pors. Et lez aultres nations de crestiens marchans, de jour en jour
se partoyent par la voye de mer avecque naves ; et Sarrasins simillement se partoyent par la voye de terre
avecque leurs biens, et abandonnoyent Alexandrie. En après, les fossés de la terre du côté de la mer, qui
estoyent plain de fangz, avecque grant sollicitudine furent nettoyés et deudiés, par tel façon et manière que
la mer entroit dedans par la voye du port vielle, et ainsi emplirent tous lez fossés. Et beaucop d’aultres
provisions furent faites à réparation pour seurté de la terre. Et après faisoyent de gran gardes de jour et de
nuit. Et pourquoy, joincte Misser Bossicart à Rode, et sachant toutes choses et comme le souldain fust avisé
de son venir et dez provisions qu’il faisoit, et à celle foys Misser Bossicart délibéra et manda en Alexandrie
une nave avecque deux imbassadeurs, affin de tirer hors le souspect de la mente du souldain. Lezquelx
imbassadeurs, joinct qu’ilz furent au port d’Alexandrie, dirent voloir practiquer et confermer la paix de
Genevois contre le souldain ; laquelle practique voloyent pactiquer hors d’Alexandrie et en lieu de seurté
delle personne, c’est assavoir... De quoy, estant avisé le souldain de tel imbassarie et de son intention,
subbitement manda en Alexandrie ung imbassadeur avecque ung trouchement, qui est cristien renoyé, et
avoit noin Pierre. Lequel imbassadeur alla hors de la terre, et sur la rive de la mer se acostarent cez
imbassadeurs, et si se mirent à parlement, et tous aultres gens sarrasins se tenoyent large d’eulx. Par tel
manière que tel practique et parlement dura .xxx. jours. Et voyant l’embassadeur du souldain qu’il ne povoit
venir à nesune conclusion, il se andona que se estoit pratique pour enganer le souldain, et donna congié à
ladicte imbassiata, laquel se ne partirent et retornarent à Rode. Et moy, qui me trova estre en Alexandrie, et
doubtant plus que jamais de l’armée de Genevois, je me pourvei par moyen d’argent, et si m’en allai
demourer au Cayre. Et en ceste espace, estant Misser Bossicart à Rode, il vint à pacti avecques lez
seigneurs de la Religion de Rode, avecque ladicte armée, à conquester Sathalie, qui estoit terre de Turs,
parmi l’isole de Cipre. Et conquestant ladicte terre et donnant le dominio à la Religion de Rode, la Religion
estoit obligié de li donner .xl. mille ducas. Et ainsi Misser Bossicart se parti avecque ladicte armée, et si s’en
alla à Sathalia, et là mist sez gens en terre. Et devant que sez gens acostassent à terre, il vint tant de
multitudine de Turs que Misser Bossicart se retraist, et avecque grant travaille et péril : que à grant poine ses
gens complirent de monter en naves ne en galées, que jà Turs estoyent joinct alla rive de la mer avecque
grant puissance. Et eurent grant grâce de Dieu de povoir estre monté sans dompmage. En tel manière que,
quant Misser Bossicart fust monté en galée, délibéra et si commenda que lez .x. naves se deussent partir et
aller près d’Alexandrie à .l. milles, et là aller voultoyant par manière que d’Alexandrie non se peust avoir
veue d’eux ; et qu’il s’en yroit à Famagosta avecque lez galées pour effermer le pays, pour recouvrer et
reçoivre lez gages et l’argent, et puis retourneroit en Alexandrie pour retrouverse avecque lezdictes naves.
De quoy subbitement lez pourveurs dirent – lezquelx estoyent Misser Jehan Oultremarin, Misser Luc del
Fiasque, Misser Antoine Regie, Misser Andrée Nomelin – respondirent et dirent : « Monseigneur, comment
avés-vous partis ceste armée en deux pars ? Vous l’avés deffaite, et si ne vauldra plus riens ». De que,
subbitement Misser Bossicart se conturba grandement, disant que ilz doivent faire son commandement sans
demeur. Et ainsi lezdictes naves se levèrent. Et estant près d’Alexandrie à .l. milles, pour le courant des
eaues et pour lez grans vents qui estoyent – pourquoy c’estoit ou mois d’auost – lezdictes naves ne se
peurent soubstenir : elles vindrent près d’Alexandrie à belle force à moins de .xv. milles, par manière que
d’Alexandrie venoyent à estre veues comme ellez alloyent voltigent et rendoyent lez voultes. Pourquoy
subbitement l’armirail d’Alexandrie manda sez messages au souldain, en lui avisant comment l’armée de
Genevois estoit joincte. Pourquoy le souldain commanda ung certain armiral avecque .iiij. M. chevaulx qu’il
deussent aller en Alexandrie. Par tel manière que lezdis armiraulx respondirent que l’armée de Genevois
non estoit venue, mais que il voloit mander en Alexandrie pour lez mettre en prison. Et à ceste destention et
suspect les jours passoyent. De quoy, à voutegier des naves dessus Alexandrie, lez chevaulx de naves se
mouvoyent, lezquelx vennoyent à estre boutés en mer, et la courrent lez boutoit dessus le plaige
d’Alexandrie. De quoy, veant l’armirail d’Alexandrie que du Caire ne venoit secours, croyoit que l’armée fust
joincte ; et à celle fois l’armirail fist taillier environ de .xxv. piés, du genoulx en jus, desdis chevaulx, et si le
manda au Caire au souldain. Lezquelx piés furent mandés avecques personnes à chevaul par terre,
mostrans et manifestans que l’armée estoit joincte. Et voyant lez ferradures des chevaulx faitez à la manière
de Ponent, et à celle fois tous creyrent que ladicte armée estoit joincte. Par tel manière que subbitement lez
armiraulx qui estoyent escrips avecques .iiij.M. chevaulx se vindrent en point, et furent chargiés sus environ
.C. cerme, et subbitement partirent. Et en après, le souldain manda ung grant marchant d’espice, qui estoit
moult practiques avecques marchans crestiens, et portoit .v.C.M. ducas, lezquelx manda avecque une
barque : que, se Genevois volloyent acort ne convention de neuf du souldain, qu’il feist tout ce que Genevois
voilsissent. Et pource que ledit marchant me portoit grant amour, il me confortoit que je deusse aller avecque
li en Alexandrie. Et ainsi monta sus sa cerme et partime. Et estoit au temps que le flume estoit cressu, et
allâmes per fin lez murs d’Alexandrie avecque ladicte cerme. Et dischargiarent lez chevaulx celle nuit, et la
matin entrarent en la terre ; et trouvâme que le jour devant, que l’armée estoit partie, et la terre demors en
grant paix. Et subbitement lez crestiens par mer, et par terre poyens, par espace de trois mois, la terre fust
rimplie et en plus grant triumphe et fais de marchandise qu’elle fust jamais. Et ainsi finist l’entreprise de
Misser Bossicart.
D2 (p. 201) CXXXIV Qu’il ne serait pourtant pas difficile de prendre Alexandrie
Pour la première foys que misser Bossicart ariva à Rode, si se trova avecques lez x naves et avecques lez
xiiij galées, ouquel nombre estoit aussi la galée de Rode. Et se il fust allé tout droit en Alexandrie, ils eust
prins la terre avecque trèsgrant avoir et avecque son très grant honnour, et aussi de toute la crestienté. De
quoy il fist tout le contraire, qui li a esté une trèsgrant charge, et aussi de toute la crestienté. Priant à Dieu
qu’il ne pourvoye pour l’avenir, en vous recordant que, pour pou de mouvement peut venir soccours de gens
qu’il ne passassent plus de viij jours. Mais quant Dieu permectera que crestiens ayent le dominie de la terre,
et entrevenisse puis que toute la puissance du Caire venist, il seroit de la prisier, en lieu de batailles, pas
ung denier, pourquoy ils ne vaillent, ne scèvent, ne peuvent.
D2 (p. 226) CLIV. Dans le Levant, Damas rivalise de prospérité avec Alexandrie. Mais qu’Alexandrie vienne à
appartenir aux Chrétiens, et elle supplantera entièrement Damas
Ou pays de crestiens sont nomées par fame .ij. terres principales de grans fais de marchandises, comme
oultremontains la ville de Bruges, et en Ytalie la cité de Venise. Et ou pays de poyens sont .ij. terres
principalles fameuses et de grans fais de marchandises, comme (p. 227) est la cité d’Alexandrie et la cité de
Damasque. Mais promettre à Dieu que la cité d’Alexandrie voise en domination de seigneurs crestiens, la
cité de Damasque sera ennullée, pource que lez marchans crestiens yront à Alexandrie, qui sera terre de
crestiens et là où marchans crestiens de toute nation se troveront. Et aussi toute nation poyennes marchans
yront là avecque lez personnes et avecques lez leurs marchandises. Et par ceste raison vrayes, Alexandrie
seulle sera la royne de tout marchans et de toutes marchandises de crestiens et de poyens.
D2 (p. 227) CLV Plan d’un ouvrage de défense d’Alexandrie par le moyen de fossés inondés
La cité d’Alexandrie gire environ …172 milles, et est plus longe que large. Et l’ung de costez fiert en mer, et
aussi sez fossez plain de mer ; et l’aultre costé, de terre, est sus fossés. Lezquelx fossez se porroyent
guaster, et maistres porroyent caver le terren si bas et si large que la mer entreroit d’ung des bouts de
Ponent et si respondroit à l’aultre bout dedans la mer : par tel manière que, si fait euvre venant ensamble, se
feroit que la cité d’Alexandrie demeureroit une ysole, et porroit passer entour une galée. Et tant seroit
puissant celle cité que puissance de crestiens ne de poyens ne seroit suffucient de la povoir conquester, se
non que se fust de leur volenté, c’est assavoir ceulx qui l’avroyent en gouvernement. Et pour ce, concludant,
jusques à tant que la cité (p. 228) d’Alexandrie a à estre en puissance de crestiens, sera la relevation de
l’estat de la foy crestienne – estant tousjours voloir de Dieu. »
- 105 - 119 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FELICE BRANCACCI (19 au 31 août 1422)
Catellaci, D., « Diario di Felice Brancacci ambasciatore con Carlo Federighi al Cairo per il commune di
Firenze (1422) », Archivio Storico Italiano VIII/4, 1881, p. 157-188 ; p. 326-334.
Par un décret de 1422, le ministère reçoit de la Seigneurie de Florence le pouvoir de nommer deux
ambassadeurs aux pays d’Orient afin d’obtenir du Sultan d’Égypte les mêmes droits et facilités de commerce
que les autres États italiens. Deux importants citoyens sont élus pour une ambassade auprès du sultan
Barsbay : Carlo di Francesco Federighi, docteur en droit, et Felice di Michele Brancacci, qui tous deux
remplissent de hautes charges dans la république de Florence. Ces derniers viennent demander pour
Florence les mêmes droits commerciaux que ceux que le sultan accorde à Gênes et à Venise, ainsi que
l’usage légal du florin d’or de Florence dans les États du sultan au même titre que le ducat vénitien, ce qu’ils
obtiennent.173
p. 165-169 :
« Le 17 août, après la neuvième heure, nous partîmes de Rhodes, au nom de Dieu, et prîmes le chemin
pour Alexandrie. Le 19, à vingt heures, nous atteignîmes Alexandrie ; arrivés là, une barque de l’émir vint à
notre rencontre ; et craignant que nous ne fussions des voyageurs catalans, ils ne voulurent pas nous
accoster, mais retournèrent en arrière ; une grande foule se rassemblait au port à pied et à cheval, parmi
lesquels se trouvaient l’émir et le cadi de la douane ; finalement nous envoyâmes à terre Antonio Minerbetti
et notre Turciman qui nous obtinrent l’assurance de pouvoir débarquer. C’est ce que nous fîmes. On nous
envoya des chevaux et de nombreux accompagnateurs. La première personne que nous rencontrâmes,
entre les deux ports fut le cadi de la douane, à qui nous fîmes une visite et qui nous accueillit très bien. Puis
nous allâmes voir l’émir, auquel nous fîmes part de notre mission et à qui nous consignâmes les lettres de
créance. Il nous fit bon accueil et nous bûmes avec lui un excellent sirop. Nous prîmes, ensuite congé de
lui ; il nous fit accompagner jusqu’à une maison destinée aux ambassadeurs, où il n’était même pas
nécessaire de fermer les portes. Nous descendîmes là, et commençâmes à nous préparer le mieux possible.
Le soir l’émir nous envoya du pain, du raisin, des melons et des bananes ; nous dînâmes de cela et nous
bûmes de l’eau.
Le 20, mille Mores et trafiquants vinrent nous voir, nous demandant tous des pourboires qui pour une raison
qui pour une autre ; finalement suivant le conseil de quelques Italiens, nous nous débarrassâmes de la
majorité de ces gens, moyennant beaucoup de ducats, car même celui qui vient simplement nous dire
“L’émir vous salue” demande par la suite un ducat. A la neuvième heure environ l’émir nous envoya un
cadeau, c’est-à-dire 5 moutons, 50 poulets, un panier de pain et un panier de bananes ; nous donnâmes aux
porteurs trois ducats, mais ils ne furent pas satisfaits.
(p. 166) Entre-Temps, nous apprîmes que les Consuls vénitiens et génois avaient reçu l’ordre de partir au
Caire, à cause des dégâts que les Catalans avaient causés au Sultan, lequel avait proclamé qu’il ne voulait
plus qu’aucun Franc n’habitât sur ses terres s’il ne lui assurait pas la paix sur mer. Telles furent donc les
dernières nouvelles, pendant que les Génois et les Vénitiens commençaient les préparatifs du départ. C’est
ainsi que nous décidâmes de ne débarquer aucune marchandise jusqu’à nouvelle information ; nous
décidâmes aussi de ne pas renvoyer les navires avant que nous parvînt du Caire le permis de nous rendre
auprès du Sultan, ou qu’il nous fût refusé.
Le 21 vinrent jusqu’à nous mille autres quêteurs, et même l’émir voulait son cadeau qu’il ne nous sembla
pas devoir lui donner tant que nous ne nous étions pas présentés au Sultan ; même celui qui était venu nous
réclamer le cadeau voulut être payé. Il arriva à un tel degré de malhonnêteté que, comme nous refusions de
lui donner le pourboire, ayant l’impression de gaspiller de l’argent, vu la situation du pays, – car si nous
avions accompli notre mandat nous aurions été en danger de vie –, il nous répondit qu’il nous aurait
empêchés de recevoir l’eau et le pain. C’est pourquoi, ce jour-là, nous prîmes le temps de réfléchir et
aussitôt nous demandâmes au cadi de la douane, ami d’Antonio Minerbetti et ami aussi des marchands, de
nous conseiller à ce sujet. Il se montra très gêné, et très sagement il nous conseilla de le faire, offrant des
étoffes et des draps qui lui appartenaient. Le même soir, pour décharger les propriétaires des navires de
toute obligation, nous leur fûmes parvenir l’ordre pour le bien et l’honneur de notre ville, de ne pas quitter le
port d’Alexandrie, à moins de le leur préciser, malgré les instructions reçues précédemment. Ils nous
répondirent que cela n’était pas suffisant – et qu’ils voulaient que nous et les marchands prîmes sur nous la
charge de les préserver de tout danger.
Le 22, comme on nous l’avait conseillé, nous coupâmes environ le quart d’une pièce d’étoffe blanche, le
quart d’une verte, et aussi à nos frais nous achetâmes de Nani Guci une pièce de drap de soie verte que
nous partageâmes en deux, et nous envoyâmes comme cadeau à l’émir cette moitié et le reste des tissus.
Lorsque ces présents furent amenés à la première porte où se trouvait son Diuda, celui-ci dit qu’il voulait voir
ce que nous offrions à l’émir, car si ce n’était pas assez consistant, il refusait de le lui présenter. Nous
refusâmes plusieurs fois ; mais à la fin, il fut nécessaire de lui montrer. Lorsqu’il le vit, il dit que cela n’aurait
même pas été suffisant à son propre lieutenant, et il ne voulut pas le recevoir, il renvoya les porteurs en leur
parlant très brutalement. Un peu plus tard d’autres personnes vinrent chez nous pour essayer de nous
mettre d’accord et parlèrent à Antonio Minerbetti et non pas à nous. Parmi ces gens, il y avait le consul de
Constantinople : ils disaient que nous devions donner 500 ducats, mais, à la fin, ils se limitèrent à demander
une pièce tissée en laine de chameau en plus des autres choses. Antonio refusa tout ceci, et on alla aussitôt
chez le cadi lui soumettre le problème ; il en fut très irrité et dit qu’il serait aller lui parler pour lui faire des
reproches. Pourtant nous étions sûrs qu’ils étaient d’accord.
(p. 167) Ce même jour, nous envoyâmes quelqu’un aux propriétaires des navires leur promettre ce qu’ils
avaient demandé ; ils en furent satisfaits.
À tout moment nous faisions attention de ne pas avoir de contact avec aucun chrétien, et très volontiers
nous serions partis et retournés à Rhodes.
Le 23, tôt le matin, un consul de Constantinople et d’autres Mores vinrent nous prier de donner quelque
chose de plus à l’émir afin qu’il ne se fâchât pas avec nous, et nous dire que le cadi de la douane nous le
conseillait et nous le refaisait dire, et qu’il voulait bien nous servir d’intermédiaire.
À la fin, nous décidâmes, pour le mieux, qu’il interviendrait ; mais comme 20 ou 25 ducats en plus ne
suffisaient pas et qu’il était très difficile de conclure ce marché, ils nous envoyèrent un gardien qui, à la porte,
empêchait tout homme du navire ou d’ailleurs de rentrer chez nous et de laisser sortir quelqu’un de notre
suite. Nous demeurâmes ainsi prisonniers jusqu’aux vêpres. Par la suite, une nouvelle autorisation permit
que ceux de notre suite puissent sortir deux par deux. Ils allèrent alors chez le cadi qui décréta qu’en plus
des choses que nous avions envoyées, nous ajoutions cette demie pièce de drap de soie que nous avions
gardée. C’est ce que nous fîmes. Pour nous aider, il la changea et la remplaça avec autant de drap vert et
noir, et en plus donna à l’intermédiaire six ducats de sa bourse. Le cadeau fut présenté à l’émir qui, lorsqu’il
le vit, fit mauvaise mine et dit qu’il était horrible, et si l’intermédiaire présent, dans lequel il avait confiance, ne
lui avait pas vanté le cadeau, il l’aurait probablement renvoyé. A la fin, il l’accepta sans donner un sou au
porteur et donna l’ordre de retirer le gardien qu’il avait de nouveau envoyé nous contrôler. Mais le gardien
voulut un ducat, et le messager venu pour le faire partir en réclama un demi. À partir de ce moment-là les
Vénitiens et les autres purent nous rendre visite. Nous fûmes tellement désolés et bouleversés par toutes
ces histoires que plus d’une fois nous eûmes la tentation de partir à l’improviste et secrètement, de remonter
sur le navire et retourner à Rhodes. Nous supportâmes tout cela parce que nous avions des ordres très
stricts, et nous nous préparâmes à rester au Caire comme otages, vu leur avidité insatiable de recevoir des
pourboires.
Le 24 nous demeurâmes à la maison, mais il survint un incident hors de l’ordinaire ; en effet, deux marins
furent trouvés dans la ville, sur une colline dont l’accès est interdit à tout chrétien. Un des deux fut fait
prisonnier et l’autre se réfugia sur le navire. Ils nous amenèrent le prisonnier les mains liées, avec grande
violence et colère ; ils disaient qu’ils voulaient son camarade et qu’il fallait envoyer quelqu’un le chercher sur
le navire, sans cela ils auraient fait... etc. Entre-temps, quelqu’un dans un coin nous chuchota que pour 25
ducats nous aurions pu le récupérer ; mais comme nous avions déjà compris leur façon de faire, nous
déclarâmes qu’ils pouvaient l’emmener et que si cela leur faisait plaisir, ils pouvaient aussi le prendre. À la
fin, pour en finir, nous le rachetâmes pour moins d’un ducat ; mais avant de nous le rendre, ils le frappèrent
méchamment avec des bâtons.
Nous passâmes le 25 à ne rien faire.
Le 26 nous décidâmes de renvoyer des galères, même si la réponse n’était pas parvenue au Caire, car on
disait que les Vénitiens avaient signé l’accord, et nous avions l’impression de faire dépenser trop d’argent à
la Commune. Mais nous ne pûmes décharger nos bagages ni ceux des marchands, car la nuit était tombée.
C’est pourquoi ils renvoyèrent le départ (p. 168) au lendemain matin - que Dieu leur assure un bon et sauf
voyage. Et ce soir même, le cadi de la douane nous informa que le messager était revenu du Caire, que le
Sultan avait beaucoup apprécié notre arrivée et que même sans les accords avec les Vénitiens et les
Génois il avait été plus souple par amitié pour nous, qu’il nous envoyait ses amitiés et qu’il nous aurait tout
de suite envoyé son Turciman et une germe.
Le même jour nous donnâmes l’ordre aux propriétaires des navires de faire retour par la voie la plus directe,
sans attaquer les Turcs ou autres orientaux.
Le 27, comme il faisait mauvais temps, les navires ne purent partir. Et ce jour-là les Vénitiens et les Génois
revinrent du Caire en ayant signé l’accord suivant ; ils pouvaient rester comme auparavant, à condition de ne
pas importer dans son domaine des marchandises catalanes et s’ils en avaient, ils devaient les renfermer
dans leurs comptoirs ; ils devaient se tenir ainsi de façon à lui assurer la paix avec les Catalans et ils
devaient le dédommager des dégâts subis. Tout cela leur coûta de nombreux ducats en pourboire. Ce
jour-là, certains d’entre eux vinrent nous rendre visite.
Le 28 le consul des Génois, c’est-à-dire M. Bartolomeo Lomellino vint nous rendre visite ; nous lui
demandâmes des renseignements concernant les choses du pays ; il nous parla très aimablement, nous
rassura, et nous donna même des conseils. Entre autres choses, il nous dit qu’en plus des présents que
nous apportions au sultan, nous avions intérêt à offrir un cadeau au Dindar, au Chatibisser et au
Anatarchasso, car c’étaient des officiers importants dont nous aurions eu grand besoin ; il lui semblait, du
moins, que la valeur d’environ 400 ducats convenait à chacun d’entre eux. C’est ce que nous avions fait
pour les autres, mais on avait donné un peu plus à l’un, un peu moins à l’autre. Il nous avertit que si nous ne
le faisions pas, cela nous aurait causé des ennuis et il ajouta que nous aurions été obligés de faire
beaucoup d’autres donations. Cela nous effraya énormément, parce que nous n’avions pas les moyens de
le faire et en plus nous n’avions pas mission de pouvoir tant dépenser.
Ce même jour vint aussi nous rendre visite Gabriello Cattani, ami de notre communauté, nous répétant à
peu près les mêmes paroles que M. Bartolomeo ; c’est pourquoi nous écrivîmes de nouveaux aux consuls
de la (p. 169) marine en leur expliquant tout ceci.
Ce jour-là un des Turcimans du sultan vint nous voir ; il était venu du Caire avec les consuls Vénitiens et
Génois ; il nous rassura de la part du sultan en nous disant que notre venue lui était chère ; il nous
recommandait de ne pas trop croire aux Turcimans, en ce qui concerne les pourboires, car il est dans leur
nature de toujours demander de grosses sommes pour plaire aux seigneurs. Cet homme se montra très
soucieux de nos affaires. Nous fûmes étonnés de ce qu’il disait, car nous ne lui avions rien demandé et nous
craignions que ses paroles n’eussent caché quelque ruse ; néanmoins nous le remerciâmes, et nous nous
fiâmes à lui.
Le 29, deux messagers vinrent nous dire, de la part de l’émir qu’il désirait, pour nous honorer, envoyer un
des siens avec nous au Caire, et le cadi de la douane voulait en envoyer un autre à nos frais ; nous
refusâmes disant que nous n’en avions pas besoin, étant donné que nous n’avions pas seulement un
Turciman du sultan mais deux pour nous accompagner. Nous nous débarrassâmes enfin d’eux et leur
donnâmes dix ducats. À la 23e heure environ, nous nous mîmes à cheval ; le consul était avec nous pour
nous accompagner jusqu’à la porte, mais lorsque nous fûmes à cheval, notre Turciman nous annonça qu’il
fallait que le consul vînt jusqu’au Caire, et que cela était indispensable. Nous fûmes étonnés, car le consul
avait tout à fait décidé de ne pas venir. Devant ce différend, nous allâmes demander conseil au cadi, et de
nouveau il s’agissait de donner un pourboire au Turciman pour éviter au consul de venir au Caire ; arrivés
enfin chez le cadi, nous le trouvâmes avec le Dindar de l’émir, qui nous en voulait énormément, parce que
nous n’avions pas voulu lui donner trois cannes d’étoffe qu’il réclamait : et de toute cette histoire, c’était lui le
responsable.
C’est ainsi que vint l’heure du dîner, et sans rien nous dire ils nous abandonnèrent là, et eux allèrent dîner.
Vers une heure et demie le consul se libéra moyennant 15 ducats ; le cadi, contre notre grès, donna en
notre présence trois cannes d’étoffe au Dindar, disant que si nous ne voulions pas les lui rendre, il les payait
volontiers lui-même. C’est à cette heure que nous sortîmes d’Alexandrie et allâmes au port, à une distance
d’environ 3 milles. Là nous trouvâmes une germe que le sultan nous avait envoyée, et nous dûmes en
prendre une autre seulement pour transporter les Turcimans qui en raison de leur jeûne, ne voulaient pas se
mêler à nous. Ce qui nous coûta 12 ducats. Depuis le moment que nous montâmes à cheval jusqu’au
moment où nous descendîmes sur la germe, nous fûmes entourés de mille mendiants dont nous nous
débarrassâmes, les mains sur la figure, en essayant de dépenser le moins possible, en nous faisant tirer le
long du canal. »174
173 Almagià, R., L’opera degli Italiani per la conoscenza dell’Egitto e per il suo risorgimento civile ed
economico, t. I, Rome, 1926, p. 115.
174 Traduction : N. Sauneron, C. Burri (archives Sauneron, Ifao).
- 120 - 122 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GHILLEBERT DE LANNOY (1422)
Lannoy, G. de, OEuvres de Ghillebert de Lannoy : voyageur, diplomate et moraliste, par Ch. Potvin et
J.-Ch. Houzeau, Louvain, 1878.
Messire Ghillebert de Lannoy (1386-1462) est le type personnifié du chevalier errant du Moyen Âge dont
toute la vie ne fut qu’un long périple. En 1420, les rois de France, d’Angleterre et le duc de Bourgogne,
Philippe le Bon, lui demandent secrètement de se rendre en Orient pour examiner les chances de succès
d’une nouvelle croisade contre les Sarrasins. Parti de l’Écluse le 4 mai 1421, Ghillebert de Lannoy, traverse
la Prusse, la Pologne, la Russie, la Hongrie, la Valachie, la Moldavie, la Tartarie, certaines îles de la
Méditerranée, et la Judée – essayant de pressentir en route les Princes chrétiens dont le concours pourrait
être utile – avant de débarquer à Alexandrie. Accompagné seulement de deux autres gentilshommes
flamands, il arrive au Caire où il est reçu comme ambassadeur du roi de France. Dans ce récit, il donne des
détails sur l’administration et l’état militaire de l’Égypte. Préoccupé de renseigner complètement ses
mandants sur les forces et les ressources dont les Sarrasins pourraient éventuellement disposer, en cas
d’attaque, il s’enfonce dans l’intérieur du pays, côtoie la Mer Rouge durant onze jours et consacre deux
semaines à la descente du Nil.175
p. 99-110 :
« Cy après s'ensieut la visitacion de la cité d'Alexandrie et de la situacion d'icelle
Item, est à sçavoir, à l'arriver par mer en Alexandrie, au plus cler temps qu'il soit, on ne voit les terres que de
(p. 100) vingt à vingt cincq milles loings, au plus loing, pour les terres d'Égipte qui sont sy basses et sy
plaines, et voit on plus tost la ville que les terres pour deux montaignes de terre qui sont dedens la fermeté
d'icelle, qui en donnent la cognoissance, dont la plus haulte des deux est séant à la dextre à l'arriver, au plus
près des murs par dedens sur le viel port, et est gresle et quarré à fasçon d'un dyamant. Sur laquelle, y a
une tourette de la garde qui descoeuvre toute la ville, les pors et la circuitté autour. Et l'autre siet à l'arriver à
main senestre, au bout de la ville par dedens, allant vers le Kaire, et n'est pas si haulte, mais est plus grosse
et est beslongue sur la dévalée176, au plus hault de laquelle il y a ung moustier177 de Sarrasins, nommé
Mousquaye, si s'étent petitement ; et peut peu descouvrir. Item, à l'arriver, dix milles parfont178 en la mer,
loings de la ville, est le fons de vingt à vingt cincq braches179 de (p. 101) parfont. Et y a là pour tous gros
navires bons fons, venant de là jusques à la bouche du port nouvel ; auquel nouvel port les Cristiens et
toutes autres nations ont usance de arriver pour marchandise, et non au viel.
La visitacion du viel port d'Alexandrie, en Égipte
Il est a sçavoir que en Alexandrie a deux pors, c'est a sçavoir, le viel et le nouvel. Et demeure le viel à
l'arriver à main dextre du nouvel, et viennent tous deux iceulz pors batre aux murs de la ville. Et y a, en
manière d'une langue de terre, environ d'une mille de largue entre iceulz deux pors dessusdis. Item, dedens
le viel port, n'ose entrer nulle navire de Cristiens, ne nul Cristiens, par dedens la ville, ne par dehors, ne l'ose
approuchier depuis environ soixante ans, qui fut l'an vingt et deux, ouquel an le roy Pierre de Cyppre la print
par ce lieu là, pourquoy on (p. 102) peut ymaginer que ce lieu là est le plus avantaigieux. Item, trouvay par
informacion, non pas que je aye esté dedens, que le viel port est plat et n'y peut entrer plus gros navire que
de deux cens bottes180, gallées plattes181, fustes182 et petites navires ; et est bien large environ de une mille,
et est plat et dangereux, fors à ung canal, qui est à l'arriver à main dextre, au plus près des terres. Et siet
icelle entrée parmy le vent de west-zuut-west, et par où peut enter seurement la navire dessusditte. Item, est
ledit viel port de fasçon beslong183, et est grant environ de sept milles de tour, ad ce que on peut clèrement
veoir à l'oeul184 et est dedens sceur185 pour tous vens186, sy non pour ung gros vent de west-zuut-west. Et
vient icelui port batre aux murs de la ville à une moult grosse tour noeufe où le soudan se loge quant il vient
en la ville d'Alexandrie. Item, ou lieu où icelui viel port vient batre aux murs de la ville, il n'y a autre fossé que
la mer, et n'y a que le seul mur de la ville, et tout cecy se peut vëoir par exemple. Item, n'est point fermé de
chaienne, ne d'autre chose, ledit viel port.
La visitacion du nouvel port de la cité d'Alexandrie
(p. 103) Item, ou port nouvel arrive tout le navire, qui vient en Alexandrie, et est l'entrée d'icelui de sept à dix
braches187 de parfont et environ une mille de large, et siet parmy noot-noord. Et est tout ledit port grant
environ de six milles de tour, et est de fasçon un peu beslong188, et vient la mer batre dedens icelui port
ainsy que on y entre à main senestre, au mur de la ville, ouquel lieu l'eaue est moult plate, comme il samble,
et semée de grosses pierres, et là ne ose approchier nulle navire de Cristiens. Item, à l'environ de ce lieu là,
par dedens les murs de la ville, joignant là, y a au long du mur une alée189 qui est comme chastel, où
demeure l'admiral de Alexandrie. Et en ce lieu là où la mer bat au mur, il n'y a nul fossé ne autre fermeté que
le mur premier. Item, depuis l'entrée du port, à mesure que on va plus avant dedens, amendrist le fons190, et
ne peut gros navire aprouchier la terre ne la ville dedens, (p. 104) plus près que à demy mille. Et en ce lieu
là, communément ancrent les nefz et y est le fons environ de deux braches de parfont, et de là en avant
jusques en terre y fait moult plat. Et y a oudit port plusieurs lieux sy plas que la terre y appert en aucuns
lieux dehors191 mais qui a bon pillot il y a deux lieux où il fait bon pour sourdre192 gros navires. Et n'y peut
nuire autre vent que noord et noord-ost, et encores par très grosse fortune, et pou193 advient que nul vent y
face dommaige. Item, à l'entrée dudit port, à chascun lez194, sur la terre ferme qui le clot, il y a assis une
mousquaie de Sarrasins, dont l'une est habitée et l'autre non, et tout cecy se monstre plus vivement par
l'exemple qui y est fait. Item, depuis celui lieu où la mer laisse à batre au mur, en montant à main dextre
jusques à la grant porte de la ville, estant sur ledit port en terre ferme, il y a ung fossé cuirié195, droit à plomb,
large environ de cinquante piez, plain d'eaue et ne samble guaires parfont. Item, d'icelle porte, montant à
main dextre encore plus amont, jusques à une tour cornière196, où la mer du viel port vient batre, il y a
brayes197 dessoubz les grans murs et deux paires de fossez, dont le premier vers la mer n'est gaires parfont,
et n'y a point d'eaue. Et l'autre, joingnant les murs, est cuiriez à plomb comme le premier dessusdit. Et y a
de la dessusditte grant porte à laditte tour cornière, au long du mur, bien cincq grosses tours, que198
quarrées, que rondes, (p. 105) sans la porte, ne sans laditte tour cornière. Item, n'est celluy nouvel port point
fermé de chayenne199, ne d'autre chose. Item, entre le nouvel port et le viel, il y a, environ une mille devant
la ville, en la mer, ung lieu qui fait la closture de deux pors, lequel est plain de mousquaies et là est
armeurière des Sarrasins, lequel lieu seroit bien avantaigeux à y dreschier et assir200 pour trais201 et autres
habillemens202. Item, est Alexandrie très grosse et grant ville en païs plain, assise d'un costé sur les deux
ports dessusdis, sur la mer, et très bien emparée, très bien fermée tout autour de hault murs. Et y a grant
fuison203 de tours espessement assises, que quarrées, que rondes, toutes à terrasse. Item, au dessus des
grans murs, il y a tout autour brayes et tourelles espessement assises. Et y a en oultre fossez cuiriez de
machonnerie à plomb204 par tout entour, en tout les lieux cy dessus exceptez, et n'y a point d'eaue en iceux,
mais samblent larges de cincquante à soixante piez, et parfons de vingt quatre à trente. Item, est laditte ville
assise en terre ferme, bonne à miner205, et sont tous les murs, tours, brayes et les maisons de la ville de
blanche pierre206, et défroyans207, non par croye208. Item, est laditte ville creuse toute par dessoubz toutes
les rues et les maisons. Et y a (p. 106) conduiz dedens terre machonnez209 par arches, par où les puis de la
ville sont abeuvrez de la rivière du Nyl, une fois l'an. Et, se ainsy n'estoit, ilz ne auroient point d'eaue fresche
en la ville, car pou y pleut ou néant210, et n'y a puis ne fontaines naturelles en la ville. Item, à trente milles
près d'illecq, partant d'un villaige, nommé le Hathse211, sur le Nyl, il y naist une fosse faitte à la main qui vient
à une mille près de la ville au long des murs et va chëoir212 dedans la mer du port viel, par laquelle, tous les
ans en la fin d'aoust ou par tout le mois de septembre, la rivière du Nyl qui en ce temps là croist
habondamment, vient remplir tous les puis de la ville pour ung an, et les puis de dehors, dont les gardins
sont arrousez. Et y a parmy zuut-west, à une mille près de la rivière dessusditte, ung greil de fer oudit fossé,
où commencent les conduits, par où l'eaue ditte vient en la ville, et s'ainsy n'estoit comme dit est devant, ilz
mourroient de fain213 et de soif en la ville, car il n'y pleut point, et n'y a ne puis, ne fontaines naturelles, fors
seullement quatre grandes cisternes pour eaue, se mestier estoit. -Item, sont grant partie des murs ouvrez
par arches par dedens, non pas emplis. Et y a allées dessus pour deux hommes aller de front, et ne (p. 107)
samblent point lesdits murs espés parmy les alées, plus hault de sept piez, et par bas, entre les arches, plus
hault de quatre ou de cincq piez, et les créniaulx d'amont dessus les allées plus hault de deux et demy,
lesquelz créniaulz de toute la ville sur tours, sur murs et sur brayes, sont tous fais à demy rons. Et n'y a par
dessus les murs, par dedens la ville, comme il samble à vëoir, nulles terres ne dicques214, dont ilz puissent
estre fortiffiez que de eulz mesmes -Item, samblent les tours à vëoir parmy les arches moult peu espèsses,
comme vray est ; car bien le ay sceu par informacion. Et n'y a murs, ne tours qui chose du monde tenissent
contre gros canons. -Item, est la ville très longue de ost à west, et estroitte de zuut à noord. Et peut avoir
environ six milles de tour et est moult peuplée de maisons très haultes, toutes faites dessus à terraces, et
sont moult gastées et moult dechëues215, espécialement es rues foraines216 et envers le viel port, où elles
sont toutes wides et désemparées. Et pour ceste chose en partie, n'y laisse on point aler aucuns Cristiens,
et sont les rues meschantes et estroittes, excepté deux ou trois grans rues où leurs marchiez de leurs vivres
sont. -Item, en icelles grans rues, on y voit assez de gens, mais par toutes les autres rues foraines, on n'y
voit comme nulluy, et est ainsy comme despoeuplée et allée au néant. Item, nul Cristien ne ose approuchier
les deux montaignes qui sont par dedens la ville. Item, sur ledit port nouvel, y a trois portes, c'est à sçavoir,
toutes à main senestre, ainsy que on descent, (p. 108) dont l'une par où on entre, est une petite porte,
nommée le Douaire, qui ne se oeuvre que trois fois la sepmaine, et par icelle font entrer toutes leurs
marchandises, excepté le vin qui entre par la grant porte commune. Item, est l'autre porte plus à main droitte
ensieuvant et est là le chennal où on met les galées quant il en y a, et les fault tirer par terre environ le trait
d'un arcbalestre sur la terre. Item, pour l'heure que je y fus, il n'y avoit nulles gallées, ne fustes de guerre.
Item, encore plus à main dextre, il y a une autre grant porte commune par où communément tout homme
passe. Et par celle porte, de lez les murs, il a assis ung très grant couillart217, et est icelle porte grande et
double de deux tours toutes quarrées. Et, en entrant en icelle, on va entre deux haulz murs le trait d'un arcq
et passe on deux autres portes, dont l'une se ferme chascun jour, avant qu'on soit au fort de la ville. Item, il y
a encore de l'autre bende218 de la ville deux autres portes, ouvertes chascun jour, l'une parmy zuut-ost, qui
va aux fossés et aux gardins, et l'autre parmy est-noord-ost, qui va vers Alexandrie la vielle219, (p. 109) et
vers le Kaire. Et par celle porte ne laisse on passer nul Cristien, ne sçay se c'est pour la grosse montagne
qui est là près. – Item, sont icelles deux portes moult belles, à doubles tours quarrées. Item, y a en hault, sur
les terasses de pluisieurs tours qui sont autour de la ville, des couillars, tous dreschiez, et en y a encore dix
en pluisieurs tours entour. Item, ay sceu par informacion qu'il y a assez foison d'arcbalestriers de
Rommaigne220 et assez de petits canons dedens la ville, mais non mie nulz gros, mais y a grant nombre
d'arcbalestriers. – Item, à l'autre lez de la ville, à l'opposite de la terre qui est entre les deux pors, y sont les
murs de la ville longs et drois221, et les tours y sont grandes, mais loings sont l'une de l'autre, et au long de
iceulz murs, au trait d'un arcbalestre, sont toutes montaignes de terre, et oultre sont gardins222, et palmiers à
l'environ de la ville. Item, n'y a en toute la ville nulle place où on se puist recoeullier et est toute plaine de
maisons sy non sur les deux montaignes. Item, y a pluisieurs marchans Cristiens dedens la ville qui là
demeurent, en espécial Venissiens, Gênenois et Catelans ; qui y ont leurs fontèques, comme maisons
grandes et belles, et les enferme on là dedens et tous les cristiens, chascune nuyt de haulte heure, et, les
matins, les laissent les Sarrasins dehors de bonne (p. 110) heure, et pareillement sont enfermez tous les
vendredis de l'an, deux ou trois heures le jour, c'est à sçavoir à midy quant ils font leur grant oroison. Et y a
autres couchiers d'Ancône, de Naples, de Marseille, de Palermes et de Constantinoble, mais à présent n'y a
nulz marchans. Item, y a une maison plaine de viel harnas223 de Cristiens, et tout le nouvel que on donne au
Soudan ou qu'il gaigne sur les Cristiens, est là mis. »
- 123 - 126 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇAIS ANONYME (entre 1419-1425)
Français anonyme, Un pèlerinage en Terre sainte et au Sinaï au XVe siècle, par H. Moranvillé, Paris, 1905.
Attribué faussement à Claude de Mirebel qui n’est en réalité qu’un des nombreux propriétaires du manuscrit,
l’auteur de cette relation demeure inconnu. Celui-ci ne nous donne que quelques vagues détails sur sa
personne, aucun renseignement sur la date de son pèlerinage, ni sur les personnes qui l’auraient
accompagné. Labib Mahfouz propose de l’identifier à Monbert de Albin, qui visite le Sinaï en 1431, et dont le
nom a été relevé en 1935 par Rabino dans le réfectoire du monastère de Sainte-Catherine.224
p. 32-33 :
« Item, de là qui veult aller en Allixandrie pour aller plus tost et à son ayse que sur les asnes ne sur les
chameaulx, on peult monter sur barques et descendre sur la riviere contre bas ; dont au descendre voist on
le tiercenal où le soldain tient ses gallées, où en veismes maintes et plusieurs aultres vaisseaulx. Lors
descend l’en par la riviere deux journées ou bien près ; et lors convient descendre en ung villaige duquel ne
me souvient pas-bien le nom et là demourer celle nuit et louer asnes pour chevaulchier jusqu’en Allixandrie.
Et de cedit villaige se fault partir en esté après mynuit pour le grant chault qu’il y fait.
Et quant on est en Allixandrie dix mille près, il fault par une très molle et penible sablonniere passer ; puis
vait on à Allixandrie logier. Sy doit chascun pellerin estre certain que à l’entrée de la cité, au portail, il sera
jusques à ses secretes parties serchiez, ou au moins à noz très grans desplaisirs le fusmes nous par la
coustume de cellui temps. Puis fusmes envoyez logier à Fondigo des Venissiens ; et là les marchans
Venissiens et aultres, quant ilz scevent les pellerins venus, que quelque part que ilz soient, les viennent
festoyer. Et l’andemain que les pellerins sont aucun peu reposez, ilz les maynnent veoir la cité et les choses
à nous merveilleuses, especialement la prison où madame sainte Katerine fust mise et là où elle devoit estre
martiriée, quant les angelz, par le voulloir de Dieu, firent rompre et detrenchier les renes ; et puis les
maynnent aux deux collomnes sur le lieu propement où elle fina ses glorieux jours par avoir sa teste
trenchée. Puis les maynent veoir le pallaix et les très fortes murailles doubles moult garnies de très grosses
tours. Aultre chose ne veismes que à escripre facent, fors que les villennies que ces faulx mastins nous
disoient et eussent par tout fait, se ilz eussent osé ne peu.
En celle cité de Allixandrie, telle ordonnance y est que pour quelque feste que les Sarrazins ayent, tant
grande leur soit, et les gardes apperchoivent quelconcque nave, gallée ou quelque aultre vaisseau que ce
soit, incontinent les gardes du port cincq ou six de eulx leur vont au devant savoir qui est le patron, comment
il a nom et dont ilz sont et quelle marchandise ilz maynnent, ains qu’ilz puissent entrer dedens le port. Et
quant ilz ont la reponce eue, ilz escripvent deux lettres l’une comme l’autlre et les lyent sur deux coullons,
tant qu’ilz peuent voller, ilz vont l’un au Soldain et l’aultre à l’amiral : par lesquelx coullons, en très peu de
heure, ilz scevent les venues des vaisseaulx, aussy l’eure et le jour. Laquelle chose des coullons est bien
forte à croire ; toutesfoiz l’afferment les marchans chrestiens.
Item, est assavoir que en ladicte cité de Allixandrie fault tant demourer que quelque navire ou vaissel
Crestien y viengne, sy par adventure le navire n’y est pour eulx en retourner ; mais il n’est gaires que de
plusieurs pars n’y en viengne dont les plus portent pellerins qui descendent à Jaffe pour la descendue de
jherusalem ; Et quant ilz sont là descendus entre tant qu’ilz font en la Terre leurs pellerinaiges, les gallées
vont maintesfois deschargier en Allixandrie où il n’y a par mer que trois cens milles, passant devant
Damyette et devant Acre et descendre qui veult à Bal Barut, qui est le droit milieu de Jaffe à Allixandrie, et là
attendre les aultres pellerins. »
224 Mahfouz, L., Pèlerins et voyageurs au Mont Sinai, Ifao, Le Caire, 1961, p. 48-51.
- 127 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN SCHILTBERGER (1425)
Schiltberger, J., The Bondage and travels of Johann Schiltberger, a native of Bavaria, in Europe, Asia, and
Africa, 1396-1427, par J. Buchan Telfer, Londres, 1879.
Johann Schiltberger (1381-1440 ?), né à Hollern (entre Munich et Freising), est fait prisonnier à la bataille de
Nicopolis en 1396. Le sultan Bayzid le prend à son service de 1396 à 1402. Pendant ce temps, il
accompagne les troupes ottomanes en Asie Mineure et en Égypte. Il passe ensuite au service de Tamerlan.
En 1427, il rentre chez lui où il devient chambellan du Duc Albert III.225
p.62-64 :
« Alexandrie est une belle ville qui mesure près de sept milles “welsch” de long et trois de large. L’eau du Nil
se jette dans la mer. La ville n’a pas d’autre eau à boire que celle-ci. On la conduit dans les citernes de la
ville. Beaucoup de marchands de Venise et de Gênes, en Italie, viennent par mer. Ceux de Gênes ont leurs
propres magasins à Alexandrie, de même que ceux de Venise. À l’heure des vêpres, à Alexandrie, les
étrangers sont obligés de rentrer dans leurs magasins et de ne plus se promener dans la ville ; c’est
absolument interdit. Un païen vient verrouiller les magasins et emporte les clés avec lui jusqu’au lendemain
matin, où il les rouvre à nouveau. Ils agissent ainsi de peur que les étrangers ne s’emparent de la ville,
comme le roi de Chypre le fit une fois. Près du port d’Alexandrie il y a une belle tour haute. Il n’y a pas
longtemps, on voyait encore sur cette tour un miroir, dans lequel on pouvait voir d’Alexandrie à Chypre ceux
qui étaient en mer. D’Alexandrie, on voyait également dans ce miroir, tout ce qui entrait et sortait du port et
tout ce qui s’y passait. À cause de ce miroir, le roi de Chypre, se trouvant en guerre avec Alexandrie à cette
époque, ne pouvait rien faire contre la ville. Alors un prêtre vint au roi de Chypre, lui demandant ce qu’il
obtiendrait s’il brisait le miroir. Le roi répliqua qu’il lui donnerait n’importe quel évêché qu’il désirerait dans
son pays, s’il y parvenait. Le prêtre alla voir le pape à Rome et lui dit qu’il voulait aller à Alexandrie pour
casser le miroir, mais à condition qu’il l’autorisait à abjurer sa foi chrétienne. Il lui donna la permission de la
renier en parole mais non pas en actes et ni avec le coeur. Le prêtre agit ainsi par égard pour la foi
chrétienne parce que les païens causaient de gros ennuis aux Chrétiens sur mer. Le prêtre partit de Rome à
Alexandrie et se convertit à la foi des païens. Il apprit leur écriture et devint un prêtre païen. Il fut leur
prédicateur, leur enseigna la foi païenne contre la foi chrétienne. Ils l’honorèrent et le vénérèrent
grandement parce qu’il avait été un prêtre chrétien. On lui faisait beaucoup confiance, ainsi on lui demanda
quel temple il désirait dans la ville pour lui donner à vie. À l’intérieur de la tour sur laquelle se trouvait le
miroir, il y avait notamment un temple qu’il demanda à vie. On lui donna avec les clés qui permettaient
d’accéder au miroir. Il y était depuis neuf ans lorsqu’il proposa au roi de Chypre de venir avec ses galères. Il
briserait le miroir qui était en son pouvoir, après quoi on lui enverrait une galère pour s’enfuir. Alors un matin,
de bonne heure, arrivèrent de nombreuses galères et il brisa le miroir en donnant trois coups avec un grand
marteau. Le peuple dans la ville s’effraya du bruit du miroir et se leva pour courir à la tour. On l’encercla de
telle sorte, que le prêtre ne put s’enfuir. D’une fenêtre de la tour, il se jeta dans la mer et mourut. Peu après,
le roi de Chypre, puissamment armé, arriva, conquit la ville d’Alexandrie et l’occupe pendant trois jours. Puis
le sultan marcha contre lui et le roi de Chypre ne put lui résister. Le roi de Chypre incendia alors la ville,
captura le peuple et l’emmena avec lui ainsi que les femmes, les enfants et tout ce qu’ils possédaient. »226
225 Schiltberger, J., The Bondage and travels of Johann Schiltberger, a native of Bavaria, in Europe, Asia,
and Africa, 1396-1427, par J. Buchan Telfer, Londres, 1879, p. xv-xxix.
226 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 128 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GRAFEN VON KATZENELLENBOGEN (du 11 septembre au ? 1434)
Katzenellenbogen, G. von, « Grafen von Katzenellenbogen », dans H. Meisner et R. Röhricht, Deutsche
Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Berlin, 1880.
p. 350-351 :
« Item le jour de la nativité de la Vierge (7 septembre), nous partîmes par bateau de Candie pour
Alexandrie ; entre ces deux ports on compte 600 milles. Nous arrivâmes à Alexandrie le vendredi avant
l’Exaltation de la Sainte Croix (11 septembre).
Item à Alexandrie, il existe une cavité dans un mur, là où sainte Catherine fut enfermée, ainsi que deux
colonnes de pierre ; sur ces colonnes se trouvait la pierre ronde sur laquelle sainte Catherine fut décapitée,
juste avant la cavité.
Item saint Marc fut flagellé à Alexandrie tout au long d’une ruelle et il y fut martyrisé et mis à mort.
Item saint Jean l’Aumônier fut aussi mis à mort à Alexandrie et martyrisé.
Item saint Pierre fut patriarche à Alexandrie où il fut martyrisé et mis à mort.
Item nous payâmes 150 ducats à la douane d’Alexandrie pour 10 personnes, soit 15 ducats par
personnes. »227
227 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 129 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CYRIAQUE D’ANCÔNE (1412-1435)
Cyriaque d’Ancône, Kyriaci Anconitani Itinerarium, Florence, 1742.
Le marchand Cyriaque d’Ancône ou Cyriaque de’Pizzicolli est un humaniste fasciné par l’antiquité. Il naît à
Ancône vers 1391 et meurt à Crémone vers 1455. De 1412 à 1454, il voyage sans cesse dans tout le
territoire byzantin. À partir de 1424, il tient un journal détaillé écrit en latin : Antiquarum Rerum Commentaria
renfermant ses déplacements, les personnes qu’il rencontre (Jean VIII Paléologue, des potentats, des
lettrés), les endroits et les monuments qu’il prend la peine de dessiner. Les inscriptions grecques et latines
qu’il retranscrit sont pour la plupart les plus anciennes et les seuls témoins que l’on conserve. Il dessine les
pyramides et les inscriptions en caractères démotiques. Dans tous ces domaines, il collectionne des objets.
De ce volumineux journal, seule une petite partie a survécu. À ces archives, on peut ajouter les documents
envoyés à diverses personnes, qui représentent la plus grande partie de ce qui a été conservé. Ses voyages
furent compilés dans une relation Itinerarium dédicassé en 1441 au pape Eugène IV.228
49-50 :
« Puis de là, en passant le long de l’immense Libye, nous arrivâmes enfin à la célèbre Alexandrie, capitale
d’Égypte. Nous vîmes les restes du phare antique [qui fut] très haut, nous examinâmes les murailles de la
célèbre ville, les très grandes portes et de très nombreux restes épars qui se trouvent aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur des murs. Mais nous vîmes surtout, près du palais de Ptolémée, le prodigieux obélisque
numide qui fut jadis transporté de Thèbes par Philadelphe. Nous vîmes, hors-les-murs de la ville, près de la
Porte du Poivre, une très grande colonne que (p. 50) le peuple appelle aujourd’hui par erreur Pompéienne,
mais nous pensons qu’il s’agit plus probablement d’une oeuvre du roi Alexandre. D’après une ancienne
épigramme, nous savons que le noble architecte Dinocrate l’érigea sur pied.
Ensuite, de là nous nous rendîmes au Caire, ville très opulente et agréable. En longeant le canal de Trajan,
nous allâmes jusqu’au bord du large Nil. Contre le cours du fleuve, en neuf jours, nous arrivâmes au grand
Palais du Premier Sultan. »229
228 McCormick, M., « Cyriacus of Ancona », Oxford Dictionary of Byzantium 1, Oxford, 1991, p. 571.
Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans P. Amat di
San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I, Rome,
1882-1884, p. 127-131.
229 Traduction : P. Pontier.
- 130 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ḪALĪL AL-ḌĀHIRĪ (1434-1436)
Ḫalīl al-Ḍāhirī, Khalîl Eḍ-Ḍhâhiry, Kitāb Zubdat Kachf al-Mamālīk. Tableau politique et administratif de
l’Égypte, de la Syrie et du Ḥidjaz sous la domination des sultans Mamloûks du XIIIe au XVe siècle, par
P. Ravaisse, Paris, 1894.
Ḫalīl al-Ḍāhirī (1391/1410-1469) est gouverneur d’Alexandrie de 1434 à 1436, date à laquelle il est
révoqué.230
La traduction établie par Jean-Michel de Venture de Paradis (1739-1799) n’a pas été retenue en raison du
caractère trop ancien de la translittération des mots arabes ainsi que de l’orthographe.231 De même, comme
l’a souligné Maurice Gaudefroy-Demombynes, la traduction de l’orientaliste s’éloigne parfois du récit de Ḫalīl
al-Ḍāhirī.232 La nouvelle traduction, présentée ci-dessous, s’appuie en priorité sur le texte original édité par
Paul Ravaisse.
p. 39-41 :
« Chapitre sur l’évocation du poste frontière d’Alexandrie
C’est le plus sublime et le plus grand des postes frontières de l’Islam. Il comprend deux murailles solides
pourvues de nombreuses tours entourées d’un fossé où l’eau coule de la mer Méditerranée, en temps de
nécessité. Il y a de nombreuses portes solides dont chacune comprend trois portes de fer. Au sommet des
tours, il y a des lances pierres et des machines de guerre. En temps voulu, (p. 40) on accroche une lanterne
à tous les créneaux. Ce poste frontière est construit avec soin. Au-dessus de chaque tour, il y a des
drapeaux, des tambours et des cornes que les gardiens brandissent en temps voulu. Cette ville est installée
sur des piliers, certains la comparent à un échiquier parce que l’ensemble de ses rues et de ses ruelles
s’entrecoupent.
Dans ce poste frontière, un château d’armes est rempli d’un nombre si prodigieux de matériels de guerre
que tout le peuple des maisons égyptiennes peut venir se revêtir de cuirasse.
On raconte dans L’Histoire d’Al-Hirawī233 que le poste frontière susmentionné est pourvu de douze mille
qiblas, de belles mosquées et madrasas en marbre et décorées. Il nous faudrait beaucoup de temps pour
les commenter et les décrire. Dans ce poste frontière se trouve un lieu connu comme étant la maison du
sultan composé de pièces spacieuses, des merveilles du monde, dont la plus grande renferme le trône du
roi. On dit qu’on ne peut construire une maison aussi grande que celle-ci. Les premiers fondements en
furent jetés par Al-Mūqawqis ; elle fut ensuite agrandie par Ǧawhar al-Mū’tafikī, puis par Ṣalāḥ al-Dīn
b. al-Ayyūb, et enfin par le roi Al-Nāṣir Faraǧ b. Barqūq. Il ne serait pas possible de décrire les colonnes de
marbre coloré et les salles décorées, les lieux peints et dorés et les beaux jardins. Cette maison donne sur
la mer Méditerranée et seuls les sultans y habitaient de sorte qu’elle reste toujours fermée. Je demandai à
sa dignité auguste Al-Malik al-Ašraf d’y habiter quand j’étais remplaçant du sultanat auguste dans le poste
frontière. Il me répondit oui et me maria avec la soeur de son épouse (la plus charmante de toutes les
femmes) Ǧilbān – que Dieu leur accorde sa miséricorde ! Avant cela, il n’accorda cette faveur à aucun
remplaçant du poste frontière. Il installa dans le grand pavillon des tentures qu’on ne peut décrire. Parmi
toutes ces richesses, il y avait sept sofas de couleurs différentes et des choses merveilleuses sur lesquelles
je ne m’étendrai pas. Au milieu du poste frontière, se trouve un canal étendu qui vient du Nil et qui se jette
dans la mer Méditerranée ; il arrose l’ensemble du poste frontière et ses vergers dont la distance mesure un
jour de marche (p. 41) pour un bon cavalier entre son début et sa fin. Dans ce poste frontière, on fait des
tissus magnifiques qu’on ne trouve nulle part ailleurs, ainsi que des choses uniques. Pour décrire ces
choses, il faudrait beaucoup d’encyclopédies. J’ai entendu une anecdote qu’il me plaît d’évoquer. On
raconte qu’au poste frontière, un marchand nommé Al-Kuwayk construisit une madrasa en son nom qui est
célèbre maintenant234. Il ne dépensa pour cette madrasa que le revenu d’un seul jour. Or, les gens savent
que le revenu du poste frontière pour la Douane auguste, (qui vient) de toute part, est de mille dinars. Il y a
des consuls qui sont les chefs des Francs. Chaque communauté a un chef. À chaque fois qu’il se passe
quelque chose dans une de leurs communautés qui déshonore l’Islam, on fait appel à ce chef. À l’extérieur
de la ville il y a une colonne à laquelle on a donné le nom d’Al-Ṣawārī, merveille des merveilles du monde
pour sa hauteur. Les voyageurs de la mer voient la colonne depuis une distance de deux jours. Son
diamètre mesure seize brasses. On raconte qu’une personne monta sur cette colonne et découvrit
l’ensemble. Cette colonne est tout à fait merveilleuse. Dans le poste frontière, il y a des tombeaux et des
lieux saints. Je ne m’étendrai pas sur ces descriptions. Parmi ces tombeaux, il y a le tombeau de Daniel –
que la paix soit sur lui ! – de Ǧābar al-Anṣārī, d’Ibn al-Ḥāǧib al-Mālikī, d’Abī Bakr al-Ṭurṭūšī, d’Abī al-`Abbas
al-Mursī, de Yaqūt al-`Aršī, de `Abd al-Rāsī, de Qāsam al-Qabārī, d’Abī Fatḥ al-Wāṣiṭī et d’autres hommes
bons ainsi que des lieux saints. En ce qui concerne l’aménagement du poste frontière, ses routes, ses
gardiens et tout ce qui lui convient sont des merveilles. Les gens du monde entier y viennent par terre et par
mer, y apportent des marchandises et en emportent. Alexandre Ḏū al-Qarnayn construisit le phare qui était
une des merveilles du monde d’où l’on voyait les bateaux qui venaient des pays des Francs, mais
maintenant il est en ruine. »235
230 Aḥmad `Abd al-Rāziq, « Les gouverneurs d’Alexandrie au temps des Mamlûks », AnIsl 18, 1982, p. 148.
232 Ḫalīl al-Ḍāhirī, La Zubda Kachf al Mamālik, de Khalil az-Zāhiri : traduction inédite de Venture de Paradis,
par J. Gaulmier, Beyrouth, 1950, p. 58-61.
233 Gaudefroy-Demombynes, M., « Jean Gaulmier. La Zubda Kachf al-Mamālik », dans Syria 28/1, 1951,
p. 147-148.
233 Le traditioniste Muḥammad al-Mustawfī al-Hirawī (1005-1089) aurait établi une copie de cet ouvrage
composé par Muḥammad b. ‘Alī b. A‘ṯam Kūfā en 926.
234 Sublet, J., « `Abd al-Laṭīf al-Takrītī et la famille des Banū Kuwayk, marchands kārimī », Arabica IX/2,
1962, p. 193-196. Cette madrasa fut construite au début du XIVe siècle par le marchand yéménite
Al-Kuwayk.
235 Traduction : T. Daghsen, S. Renaud, O. Sennoune, H. Zyad.
- 131 - 132 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PERO TAFUR (1437)
Tafur, P., Andanças e viajes de un hidalgo español : Pero Tafur, 1436-39, par M. Jiménez de la Espada,
Madrid, 1995.
Pero Tafur (1410/1484 ?), né à Cordoue, occupe le poste de magistrat. Il vient en Égypte comme
ambassadeur. Le roi de Chypre Janus III lui confie une mission auprès du sultan du Caire ; il doit remettre
des lettres ainsi que 200 ducats au sultan Barsbay.236
p. 52 :
« À Alexandrie on trouve du lin en abondance dont on fait une toile excellente. »
p. 71 :
« Arrivé à l’endroit où les deux bras se séparent, je laissai à ma droite le bras qui conduit à Damiette, que
j’avais déjà visitée, et descendis l’autre (bras) jusqu’à un endroit situé à proximité d’Alexandrie et qui
s’appelle Rosette. De là je me rendis à Alexandrie. C’est une ville très importante où je passai trois jours et
fus émerveillé à la vue des maisons vénérables où sainte Catherine naquit et fut martyrisée. Il s’y trouve
aussi une voûte (couverte) sous laquelle se trouve, dit-on la roue sur laquelle on l’étendit. Cette ville est un
grand port maritime et une très importante place de commerce où les chrétiens chargent et déchargent (des
marchandises).
Après avoir vu la ville à fond je me rendis à Damiette par voie de terre, mais je n’y trouvai pas le bateau que
le roi de Chypre avait mis à ma disposition. »237
236 Izeddin, « Deux voyageurs du XVe siècle en Turquie : Bertrandon de la Broquière et Pero Tafur »,
JournAs CCXXXIX, 1951, p. 167-174.
237 Traduction : P. Bleser (archives Sauneron, Ifao).
- 133 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AMBASSADEUR DU SULTAN DE GRENADE (1440)
Ambassadeur du sultan de Grenade, Sifāra sīyasīya min Ġarnāta ilā Al-Qāhira fī al-qarn al-tāsi‘ al-higrī (844),
par ‘Abd al-‘Azīz al-Ahwānī, Le Caire, 1954.
Muḥammad b. Naṣr serait le sultan de Grenade à cette date.238
p. 101-102 :
« À Alexandrie
Nous arrivâmes à Alexandrie – que Dieu la protège ! – jeudi après-midi du mois de raǧab susmentionné239.
Nous remercions Dieu d’être arrivés sains et saufs. Le vendredi matin, le second jour, nous y entrâmes et
nous nous dirigeâmes vers celui que nous connaissions, c’est-à-dire le wālī d’Alexandrie qui s’appelait
Ṣanbaġā al-Ṭayārī, un des émirs turcs – que Dieu leur vienne en aide ! Il nous donna de nombreux grands
chevaux, nous n’en connaissions pas d’autres de cette stature, ils étaient de belle forme et portaient un
uniforme complet. En effet, on fabrique dans cette ville des arçons de selle d’argent pur plaqué d’or d’une
parfaite exécution et d’une belle ornementation. Puis ils mettent, à l’endroit de la monture où on s’assoit, un
brocart coloré. Ils couvrent la croupe du cheval de tentures en soie dorée qui enchantent la vue. Ils nous
apportèrent ces chevaux que nous montâmes quand nous débarquâmes sur le rivage. Puis nous entrâmes
pour saluer l’émir d’Alexandrie la susmentionnée, appelé le roi des émirs, ainsi que tous ceux qui se
rendaient à la forteresse.
Nous entrâmes chez l’émir qui nous fit un bon accueil quand nous le saluâmes. Selon leur coutume, il
commanda des boissons aux invités, aux visiteurs et aux hôtes. Ils arrivèrent avec des marmites de verre
pur contenant du sucre fondu avec de l’eau de rose qui réveille les âmes et qui anime les coeurs. Ils burent
et nous bûmes. Puis il ordonna que nous restassions et nous hébergea. Nous sortîmes pour la prière du
vendredi. Le samedi, nous fîmes apporter tous les colis d’affaires que nous avions. Ensuite, nous nous
reposâmes et Dieu le Puissant nous soulagea de la fatigue de la mer et de sa frayeur. Je remercie Dieu.
(L’émir) nous invita huit jours dans la plus grande félicité et dans les conditions les meilleures. On nous
apporta aux repas du midi et du soir des mets variés dont nous ne connaissions pas l’égal, ainsi que des
douceurs variées et des boissons jusqu’au départ pour Le Caire – que Dieu le protège ! Nous louâmes des
chameaux que nous chargeâmes de tout ce que nous avions, affaires et choses lourdes. L’émir
susmentionné nous prêta un de ses serviteurs qui s’occupa de notre approvisionnement sur le chemin et de
nous introduire (auprès des gens). Nous partîmes avant midi, le jeudi 13 de raǧab240 susmentionné, pour
Rosette, et nous y arrivâmes en fin d’après-midi le jour d’après, le vendredi. Nous y restâmes deux jours
pour préparer notre voyage sur le Nil. Nous louâmes un des bateaux du Nil et nous chargeâmes toutes nos
affaires.
(p. 102) Nous partîmes le dimanche matin, le 16 de raǧab susmentionné, pour la ville de Fuwwa. Nous y
arrivâmes le lundi soir 18 de raǧab. Nous y restâmes jusqu’à mardi et nous partîmes le soir pour Le Caire –
que Dieu le protège ! »241
238 Ambassadeur du sultan de Grenade, Sifāra sīyasīya min Ġarnāta ilā Al-Qāhira fī al-qarn al-tāsi‘
al-higrī (844), par `Abd al-`Azīz al-Ahwānī, Le Caire, 1954, p. 113-118.
239 Il arrive le 6 de raǧab 844 (jeudi 1er décembre 1440). Plus loin, on apprend qu’il séjourne 8 jours à
Alexandrie et qu’il part pour le Caire le 13 de raǧab.
240 Jeudi 8 décembre 1440.
241 Traduction : O. Sennoune, H. Zyad.
- 134 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS VON DER GRUBEN (1440)
Diesbach, M. von Hg., « Hans von der Grubens Reise und Pilgerbuch 1435-1467 », Archiv des historischen
Vereins des Kantons Bern 14, 1896, p. 95-151.
p. 146-148 :
Comment les seigneurs, après être retournés au Caire décidèrent de partir pour Alexandrie
« Ainsi nous fûmes très heureux quand nous retournâmes au Caire et décidâmes de partir par la suite pour
Alexandrie. Ainsi nous acquîmes du Sultan une escorte et partîmes sur l’eau du Nil en compagnie de
l’escorte du Sultan. Ceci nous avait coûté très cher. Lorsque nous fûmes sur l’eau, nous vîmes les gros vers
qui entrent habituellement dans l’eau du Nil et que l’on nomme dans l’Escriture Cocodili (Crocodile). Quand
nous arrivâmes à Alexandrie, nous dûmes payer à l’amiral supérieur une grosse douane et fûmes très mal
reçus et traités par les païens. Là, nous demeurâmes 34 jours et attendions tous les jours le moment où
devait arriver la galère venant de Venise. Lorsqu’elle arriva, nous fûmes follement heureux par son arrivée et
nous payâmes une somme d’argent pour partir à Venise.
Ce que les seigneurs visitèrent dans la ville d’Alexandrie
Alexandrie est une ville grande et puissante, et un des plus grands ports de tout le monde païen. Dans cette
ville, on voit le lieu où se trouvait la prison dans laquelle fut retenue captive la sainte Vierge Catherine qui
refusait d’adorer les idoles, selon la légende. Dans ce lieu se trouvaient la roue et tous les instruments qui
ont servi à la torture de la sainte Vierge Catherine. Là aussi, eu lieu le grand miracle du feu et de la grêle qui
détruisit la roue, et la grêle abattit tant de païens, selon ce que la légende de sainte Catherine contient en
outre. Là il y a absolution 7 ans et 40 jours.
À côté, il y a l’endroit où la sainte Vierge Catherine s’agenouilla et se recommanda à Dieu Tout Puissant, elle
eut la tête tranchée sur l’ordre du roi. Là également, les anges prirent son saint corps et le transportèrent sur
le mont Sinaï. Là il y a absolution 7 ans et 40 jours.
À proximité de la ville se trouve également la colonne sur laquelle se tenait l’idole que la sainte Vierge
refusait d’adorer.
Dans la ville d’Alexandrie il y a aussi une longue ruelle au centre de la ville qui se nomme ruelle de saint
Marc ; dans cette ruelle fut martyrisé et traîné saint Marc l’Évangéliste, selon la légende.
Finis et Laus deo
Comme nous avions visité les Lieux-Saints ci-dessus décrits et que les galères se trouvaient prêtes et
voulaient retourner à Venise, les païens apprirent que nous voulions quitter la ville ; ils nous firent alors
beaucoup d’ennuis parce que nous ne leur donnâmes pas l’argent qu’ils réclamaient et nous partîmes très
contrariés et arrivâmes au bateau avec beaucoup de peine et d’effort, ce qui serait trop long à décrire ; nous
partîmes au nom de Dieu et arrivâmes à Venise. »242
242 Traduction : F. Hassous (archives Sauneron, Ifao).
- 135 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ABĪ AL-ḤASAN ‘ALĪ AL-QALṢĀDĪ AL-ANDALUSĪ (1447)
Abī al-Ḥasan ‘Alī al-Qalṣādī al-Andalusī, Riḥlat al-Qalṣādī, Tunis, 1978.
Né à Basta en Andalousie en 1412 (ou avant), al-Qalṣādī al-Andalusī est jurisconsulte et savant. Il
entreprend son voyage en 1436 et s’installe, à son retour, à Grenade où il écrit cette relation de voyage. En
1483, il quitte Grenade pour Baja (Tunisie) où il meurt assassiné en 1486.243
p. 124-125 :
« Nous arrivâmes au poste frontière d’Alexandrie au début du mois de ǧumādā II244, après de grandes
épreuves que les calames et les encriers se trouvent perplexes pour les décrire, jusqu’à ce que chacun se
résigne à la volonté de Dieu. Chacun clamait son état dans sa langue. (Je me noie, pourquoi ai-je peur
d’être mouillé ?)
(p. 125) Nous sommes entrés dans la ville et nous y sommes restés pour nous reposer de la fatigue du
voyage. Nous y passâmes un séjour agréable. Nous rendîmes visite à quelques anciens et hommes saints.
Description d’Alexandrie.
C’est la plus belle ville du pays par son agencement et sa construction. Ses murs sont faits de pierres
blanches taillées et toutes ses rues sont ordonnées et spacieuses, ce qui témoigne d’un plan judicieux. Les
constructions souterraines sont bien faites. L’eau pénètre dans ses entrailles. Mais elle est en ruine, la
plupart de ses bâtiments ont disparu. Elle est en grande partie insalubre. Les visages des gens sont toujours
jaunes. Si quelqu’un y passe un ou deux jours, il se sent faible et sent son corps maigrir, ceci est dû à son
eau. Dieu seul le sait !
Parmi les merveilles qui y sont, il y a la colonne qui se trouve hors de la porte de Sidra. Elle se tient sur un
des côtés d’une base carrée mesurant vingt empans et est posée sur elle.
Nous sommes partis de là par le fleuve du Nil le 8 ǧumādā II 245. »246
243 Abī al-Ḥasan ‘Alī al-Qalṣādī al-Andalusī, Riḥlat al-Qalṣādī, Tunis, 1978, p. 30-39.
244 14 août 1447.
245 21 août 1447.
246 Traduction : S. Renaud, O. Sennoune, H. Zyad.
- 136 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JÖRG VON EHINGEN (1454)
Ehingen, J. von, The diary of Jörg von Ehingen in 1454, par M. Letts, Londres, 1929.
Jörg von Ehingen naît à Hohenentringen en 1428. Jeune, il sert le duc Sigismond de Tyrol avant de
s’attacher au duc Albert d’Autriche, duc de Carinthia, frère de l’empereur Frédéric III. Jörg assiste avec son
maître, à Prague, au couronnement de Ladislaus Postumus, roi de Bohème. C’est là qu’il reçoit le titre de
chevalier. Par la suite, son père l’envoie avec quelques chevaliers visiter Jérusalem et combattre les Turcs à
Rhodes. Jörg reste presque un an à Rhodes, mais il ne voit aucun signe des Turcs. Il continue sa route vers
le Sinaï où il visite le monastère de Sainte-Catherine. À Damas, lui et ses compagnons sont capturés par les
Arabes. Il est relâché après le paiement d’une rançon de 30 ducats. De là, il voyage à Alexandrie puis à
Chypre où il est bien reçu par le roi Janus III. En 1454 ou 1455, il retourne à Venise. Après cette date, il se
rend dans les différentes cours de France, d’Espagne et du Portugal pour offrir ses services de chevalier. Il
meurt en 1508.247
p. 25 :
« Nous partîmes donc pour Alexandrie où fut martyrisée sainte Catherine, c’est un port de mer bien gardé
par de nombreux soldats et mamelouks. Là aussi coule le grand Nil qui passe à Babylone, traverse l’Égypte
et se jette dans la mer. Nous embarquâmes donc et nous partîmes pour le royaume de Chypre. »248
247 Ehingen, J., The diary of Jörg von Ehingen in 1454, par M. Letts, Londres, 1929, p. 3-12.
248 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 137 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GABRIELE CAPODILISTA (1458)
Capodilista, G. et Santo Brasca, Viaggio in Terra santa, di Santo Brasca, 1480, con l’Itinerario di Gabriele
Capodilista, 1485, Milan, 1966.
Gabriele Capodilista est un noble de Padoue. Comme il l’affirme dans son itinéraire, il occupe la charge de
préteur (juge) à Pérouse249.
Le récit de Gabriele Capodilista fut repris par Santo Brasca en 1480 (voir infra).
p. 235 :
« On revient ensuite au Nil, et parcourant en barque cent autres milles, on arrive à Alexandrie, cité du
Sultan, belle et marchande, située au bord de la mer Méditerranée, où furent décapités saint Marc
l’Évangéliste et la vierge sainte Catherine, dont le corps glorieux fut ensuite transporté par les anges sur le
mont Sinaï. De là on va à Damiette, dernier lieu de ce pèlerinage, où fut lapidé le prophète saint Jérémie,
parce qu’il annonçait la captivité des Juifs, et c’est là qu’ils furent jugés pour leurs péchés. Certains disent
qu’il fut lapidé en un lieu près de Damiette appelé Campera. »250
249 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 151-152.
250 Traduction : N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 138 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANSELME ADORNO (juillet 1470)
Adorno, A., Itinéraire d'Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), par J. Heers, G. de Groer, Paris,
1995.
Anselme Adorno (1424/1483), chevalier de Corthuy en Flandre, est flamand d’origine génoise. Il accomplit
un pèlerinage en Égypte et en Terre sainte avec un groupe de Brugeois. Il est accompagné de son fils Jean,
futur chanoine de Saint-Pierre de Lille, qui a rédigé la relation de ce voyage. Jean Adorno, pendant son
séjour au Caire, signe au nom de son maître Philippe le Bon – qui l’a chargé d'une importante mission
diplomatique et commerciale – un traité de commerce, le premier de l'espèce entre ces deux pays.
Anselme Adorno joue un rôle actif dans la vie politique de sa cité où il est bourgmestre. Mais en 1477, il est
contraint à l’exil et se réfugie en Écosse où il sert le souverain. Il meurt assassiné en 1483.251
p. 159-175 :
« Alexandrie a deux grands ports pour les navires. Le premier, le plus grand et le plus sûr, est interdit aux
flottes des chrétiens sous peine de confiscation des navires et de toutes leurs marchandises. Quant au
second, où mouillent les navires chrétiens, son accès est très périlleux. (p. 161) Nous courûmes nousmêmes
en y entrant un grave danger, sans subir toutefois de grands dommages. À trois reprises notre
navire toucha le fond avec une telle violence que, sous le choc et la secousse, nous, qui nous tenions
debout sur le pont, tombâmes sans rien comprendre sinon que le navire allait s’ouvrir et se briser en
plusieurs morceaux. L’entrée ou la passe est en effet très étroite et resserrée, ce qui rend l’accès du port
difficile et ceci en raison des édifices antiques, aujourd’hui en ruines, dont certains font saillie à la surface
tandis que d’autres sont cachés sous l’eau. Autrefois, en effet, quand la cité était florissante, le port était
entouré de murailles, de forteresses et de grands bâtiments. Il n’avait qu’une seule entrée. C’est pourquoi
ces édifices maintenant démolis font courir à ceux qui entrent à Alexandrie les plus grands dangers.
Entre les deux ports s’étend à travers la mer une sorte de digue, sur laquelle ont été construites de
nombreuses mosquées ou églises ainsi que des tours, munies de bombardes, qui protègent les ports.
Ce port est la principale échelle d’Égypte et de Syrie. Nous y trouvâmes plusieurs grandes flottes
chrétiennes et une grande flotte turque dont les marins fêtaient joyeusement, en signe de victoire et de
triomphe, la prise de Nègrepont qu’ils venaient d’apprendre. Peu après notre arrivée, des officiers de l’émirgouverneur
de la cité montèrent à bord et s’informèrent de la nature de notre cargaison et du nom du patron
du navire. Le scribe du bord rédigea la réponse et leur remit une liste des marchandises. Ils attachèrent
aussitôt ces lettres sous les ailes de deux pigeons qui volèrent immédiatement vers la maison de l’émir pour
lui communiquer ces nouvelles. Après avoir lu les lettres et avoir pris connaissance de leur contenu, l’émir
les fit attacher de nouveau sans perdre un instant sous les ailes d’autres pigeons qui volèrent vers le sultan,
dans la très grande cité du Caire, distante de cinq jours au moins d’Alexandrie. Il faut admirer sans réserves
les moeurs de ces pigeons.
Alexandrie
(p. 163) Alexandrie est une ville remarquable, fondée autrefois par Alexandre le Grand. Les Maures
l’appellent Scandaria, du mot scander qui, dans leur langue signifie Alexandre. Située au bord de la mer, à
l’entrée de l’Égypte, elle a de très larges murailles, hautes et épaisses, garnies de tours nombreuses, larges
mais peu élevées. Les portes de la cité, sont doubles ; on ne les franchit pas tout droit mais par un passage
en chicane. Nous n’avons pas vu de ville mieux fortifiée qu’Alexandrie. Quand on la regarde du navire, son
aspect extérieur est magnifique parce que l’on découvre la beauté de ses murs et de ses portes, les
multiples tours de ses églises qui sont très élevées, ainsi que deux petites collines très hautes, mais de
faible largeur, plus semblables à des tours qu’à des montagnes ; situées près des murailles du côté de la
mer, elles ont été formées par l’apport continuel d’immondices que les habitants déposent sur ces lieux. Sur
l’une de ces murailles se dresse une petite tour d’où l’on peut surveiller l’arrivée des navires. À l’intérieur,
Alexandrie n’est plus aujourd’hui aussi belle qu’elle le paraît de l’extérieur. Mais ses ruines et sa décadence
portent encore témoignage de sa grande puissance et de sa beauté d’autrefois. Elle a subi à plusieurs
reprises des dommages et de très grands malheurs ; récemment encore elle a été détruite et rasée par un
roi de Chypre. Il reste cependant quelques rues pleines de beaux édifices et de belles maisons et nous
avons vu certaines d’entre elles, en particulier la maison de l’émir, devant la porte de laquelle se trouve une
petite, mais très jolie église. Derrière cette maison se dresse une très haute pierre quadrangulaire semblable
à une assez haute tour ; de nombreux caractères antiques, que nous n’avons pas su déchiffrer, y sont
gravés. Elle rappelle en tout la pierre haute que l’on appelle l’Aiguille, érigée derrière Saint-Pierre de Rome,
près du Campo Santo.
(p. 165) Nous avons vu également une autre demeure très belle qui a été celle d’un noble personnage,
autrefois sultan du pays. Elle est située dans la rue la plus grande et la plus longue de la cité, dite rue
Saint-Marc, car saint Marc y fut traîné par des chevaux d’un bout à l’autre. Cette rue très longue est ornée
vers son milieu d’un grand nombre de beaux édifices. Au début d’une rue collatérale, non loin de la
résidence de l’ancien sultan, se dressent les deux colonnes de sainte Catherine appuyées de part et d’autre
de la rue aux maisons ou plutôt à moitié prises dans celle-ci. Elles sont en marbre veiné de rouge, hautes de
douze pas environ. Dans la même petite rue, près des colonnes, se trouve la prison où sainte Catherine fut
incarcérée. C’est un lieu exigu, bas, voûté, assez peu profond, dont un des murs est percé d’une ouverture
que les Maures n’ont jamais pu boucher, de même qu’ils ont échoué dans leurs efforts pour déplacer les
deux colonnes.
Il y a en outre dans cette cité une église chrétienne, appelée Saint-Sabas, où résident trois ou quatre frères
calogers grecs du même ordre que ceux de Sainte-Catherine. Ils mènent une vie de dévotion et leur église
est vénérée. Du côté gauche, près du choeur, se trouve une image de la bienheureuse Vierge que l’on dit
avoir été peinte par saint Luc. Dans cette ville habitent des chrétiens schismatiques établis en Égypte et en
Syrie depuis l’Antiquité. Ils ont les moeurs et la langue des Maures et ne se distinguent en rien de ceux-ci,
sauf par la coiffure, car ils portent sur la tête des bandes d’étoffes bleues ou couleur de ciel. Ils n’oseraient
pas mettre ordinairement des tuniques blanches et celles qu’ils portent sont bleues. Ces chrétiens, que l’on
appelle les chrétiens de la ceinture ont de nombreuses églises dans la ville et notamment l’église
Saint-Marc.
De nombreux juifs habitent également Alexandrie. Ils portent des (p. 167) pièces d’étoffe ou turbans jaunes
ou citrons. On les rencontre, comme les chrétiens de la ceinture, dans tous les territoires du sultan et ils sont
soumis à un tribut.
Aucune des villes asiatiques ou orientales n’a un commerce d’épices plus actif qu’Alexandrie car de très
nombreuses épices y arrivent en provenance de l’Inde, d’où elles sont acheminées par bateaux jusqu’aux
cités de Djedda, La Mecque ou Touzzim, ports de la mer Rouge. De là elles sont transportées à dos de
chameau jusqu’à Alexandrie ou Damas. Pendant que nous étions à Alexandrie, arriva, entre autres, une
caravane de vingt mille chameaux chargés d’épices, parce qu’un navire était venu de l’Inde avec une
cargaison d’épices d’une valeur de cent mille milliers de ducats. Un seul en effet de ces navires indiens
transporte un chargement plus important que trois de nos plus grands navires.
Des marchands de nombreuses nations possèdent à Alexandrie leurs fondouks et comptoirs : les Génois
dont le fondouk est très beau et grand, les Vénitiens qui sont très nombreux, une soixantaine, les Florentins,
les Catalans, les Ancônitains. Chaque fondouk a sa chapelle. Les fondouks des Sarrasins sont aussi très
nombreux, notamment ceux des Turcs qui font ici un grand commerce et ceux des marchands barbares tels
que les Perses, Tartares et autres peuples.
Presque toute la cité est bâtie sur des citernes. Sa richesse est donc beaucoup plus grande sous terre qu’en
surface. C’est par ce moyen que les habitants peuvent conserver en permanence dans ces citernes, pour
tous leurs besoins et leur boisson, de l’eau douce provenant du cours du Nil. Le pays, en effet, est
sablonneux et sec, dépourvu de sources et il n’y pleut guère. Nous avons vu trois ou quatre de ces citernes
d’une très grande profondeur, aux très précieuses colonnes de marbre, surmontées de doubles voûtes aux
arêtes en croix faites de pierre de marbre.
(p. 169) À l’extérieur de la cité, à la portée d’une forte baliste, s’élève une grande colonne haute d’un jet de
pierre. Jamais nous n’en avons vu de plus grande d’un seul bloc. On dit que le corps d’Alexandre le Grand
fut déposé en son sommet. On voit parfaitement la colonne d’un navire à l’ancre dans le port, c’est-à-dire de
l’autre bout de la cité. Il y a d’un côté de cette colonne une petite église et de l’autre une quantité ou une
multitude d’arbres à dattes.
Pendant notre séjour dans cette ville il y eut une disette de blé et de tous les vivres en même temps. On
trouve dans ce pays des moutons d’assez bonne qualité, mais peu nombreux et des chèvres aux très
longues et très larges oreilles. En raison de la disette, on consommait de la viande de chameau et
nous-mêmes, nous en mangeâmes sans le savoir. Il n’y a pas beaucoup de fruits, en Égypte, mais ceux qui
y croissent sont parfaits. Les raisins sont très bons, à très gros grains et grosses grappes, les figues
excellentes, mais petites, les melons délicieux, de couleur blanche. Il y a également des fruits d’un autre
genre, semblables aux melons, mais en général ronds, dont l’écorce extérieure est verte ou verte et blanche,
et la chair à l’intérieur blanche. Quand les fruits sont parfaits, comme près du Nil, on fait de cette chair une
liqueur douce ; les graines au-dedans ressemblent à des graines de melon. Ces fruits sont appelés tantôt
dares, tantôt pastèques, ailleurs encore comme en Grèce auguru. Le pays produit aussi des muses, fruits
que nous avons préférés à tous les autres qui poussent dans les pays très chauds. Ils ressemblent dans leur
enveloppe à des pommes allongées tendant à se recourber comme des petits concombres qui parfois sont
courbes. Quelle que soit la façon dont on coupe ces muses, on trouve toujours à l’intérieur le dessin d’une
croix, c’est pourquoi certains disent que ce sont les fruits de paradis. Les arbres sur lesquels elles poussent
ne sont pas très hauts mais ont des feuilles très longues et larges, très légères et très vertes ; certaines
d’entre elles dépassent en longueur une aune arabe et en largeur un quart d’aune. On trouve aussi
beaucoup de palmiers dattiers qui poussent bien dans ce pays sablonneux et sec, de la casse fistuleuse,
des câpres, les meilleurs et les plus grands du monde, qui ne croissent pas dans les arbres, mais sur de
petits arbustes dans les champs et même parfois sur de vieux murs.
(p. 171) Nous avons vu à Alexandrie beaucoup d’autruches et leurs oeufs et aussi de nombreuses gazelles,
des ânes, les plus grands du monde, que les Maures importants de la ville utilisent à la place de chevaux. Ils
ne peuvent, en effet, monter en ville ni chevaux ni juments, mais uniquement des mulets ou des ânes. Seuls
les mamelouks, dont nous parlerons ci-dessous dans le chapitre consacré au sultan, montent chevaux et
juments en signe de la prééminence et de la souveraineté royales. Quant aux chrétiens et aux juifs, ils
n’auraient pas le droit de monter en ville ni chevaux, ni mulets, ni ânes. Il y a donc à Alexandrie des ânes
plus magnifiquement harnachés et scellés qu’ailleurs, recouverts de couvertures richement ornées.
La ville n’est pas très peuplée, du moins quant au menu peuple et aux artisans, car presque tous les
habitants sont de riches marchands. Le costume masculin ressemble à celui de Tunis, mais les hommes
sont ici plus raffinés dans leur mise et portent sur la tête des turbans plus volumineux ou enroulés en plis
plus gros. Tous ont des vêtements longs jusqu’aux pieds, en soie, en camelot, en drap ou en lin, chacun
selon sa condition.
Les femmes sont beaucoup plus recherchées et soignées dans leur mise qu’à Tunis. Elles ont sur la tête
une sorte de tambourin, orné de soie et de pierres précieuses, ou d’or, ou d’autres matières, suivant la
condition de celle qui le porte, mais lorsqu’elles sortent de leurs maisons, elles se couvrent la tête et tout le
corps d’une faille ou manteau de lin très blanc. Sous ces capes, elles ont des vêtements longs jusqu’aux
pieds et très ornés et beaucoup de pierres précieuses autour de la tête. Nous l’avons vu plusieurs fois sur
les places et les lieux publics où elles viennent acheter des bijoux, car elles entrouvraient leurs capes et
manteaux pour que nous puissions les voir. Elles viennent en effet en ces lieux, comme les femmes de chez
nous, pour voir et être vues. Leurs visages sont couverts d’une pièce de lin très fin ou de soie percée de
deux ouvertures correspondant aux yeux afin de leur permettre de voir. Sur les jambes elles portent des
pantalons de lin parfois très précieux et de petites guêtres en cuir parfumé qui vont jusqu’aux genoux,
comme en ont les Catalanes, les Portugais ou les Espagnols. Aux pieds elles ont des pantoufles dorées ou
des galoches peintes. Elles sont très élégantes et soignées dans leur façon de se chausser et de se couvrir
la jambe. Les paysannes et les femmes de la campagne ne portent pas ces tambourins sur la tête ni ces
manteaux de lin, mais un grand pan d’étoffe qui descend beaucoup plus bas que leur visage mais n’est pas
plus large que celui-ci. Il est aussi percé de deux ouvertures correspondant aux yeux, par lesquelles elles
(p. 173) regardent. Par derrière, vers les oreilles, ce pan d’étoffe a deux attaches en bronze, en fer ou en
argent, semblables aux anses de nos amphores ; elles servent à retenir le voile en arrière, et par-dessus, du
sommet de la tête à la ceinture, pendant les cheveux très noirs retenus par une chaîne de fer ou d’un autre
métal, cuivre et quelquefois aussi argent, faite de petits anneaux ronds. Cette mode nous a paru très
étonnante, car nous n’en avons jamais vu de semblable, et difficile à décrire en raison de son étrangeté. Elle
est commune à toute l’Égypte et à la Syrie et j’ai su qu’elle était très ancienne, qu’elle remontait au temps
des Juifs et n’avait jamais été modifiée dans ce pays. Ce n’est pas un signe de légèreté mais de grande
constance et de sérieux.
Il est difficile et malaisé d’entrer dans la ville ou d’en sortir car les gardes des portes demandent à ceux qui
arrivent et à ceux qui partent qui ils sont, leur qualité, ce qu’ils transportent, ce qu’ils emportent aussi avec
eux. Bien plus, ils dépouillent avec zèle les gens de leurs vêtements afin de voir s’ils ont sur eux quelque
objet frappé d’une taxe ou d’un tonlieu. Il n’est rien qui, à l’entrée, ne soit passible d’un droit et même sur les
sommes d’argent que l’on apporte il faut payer deux pour cent. Toutefois, grâce à Dieu, nous entrâmes sans
que les gardes ne s’y opposent. Ils pensaient peut-être que nous étions Génois et nous restâmes dans la
ville dix ou douze jours sans que personne nous prenne pour des pèlerins. Cependant, dès que l’émir et les
autres officiers de la cité apprirent que nous n’étions pas des Génois, mais des pèlerins, car il nous était
nécessaire de faire savoir si nous voulions aller plus loin, nous fûmes convoqués par l’émir qui nous
demanda une grosse somme d’argent pour nous délivrer un sauf-conduit. Quand nous lui déclarâmes que
nous ne pouvions donner une telle somme en raison de notre pauvreté et que nous fîmes appel à sa
bienveillance, sans laquelle nous ne pourrions effectuer le voyage projeté, il donna aussitôt aux gardes des
portes l’ordre de ne pas nous laisser sortir de la cité, par crainte de ne pas nous revoir. Il nous contraignit
donc par la force à lui donner la somme demandée.
D’autres officiers nous rongeaient les os jusqu’à la moelle, nous tourmentant sans cesse, et nous
importunant de leurs demandes. À toute heure, pour ne pas dire à tout instant, survenaient de nouveaux
officiers, tant vrais que faux, aux demandes d’argent desquels il fallait s’opposer. Il semblait nécessaire
d’extorquer de l’argent aux chrétiens, qu’ils considéraient comme des ennemis. C’est pourquoi, nous nous
efforçâmes de quitter cette cité aussi tôt et aussi vite que nous le pûmes, car à mesure que le temps passait
nos tourments, nos tribulations et nos misères augmentaient. Je conseille donc à tous de s’éloigner le plus
rapidement possible, je ne dirai pas de cette ville, mais de cette race maudite. Nulle part ailleurs nous
n’avons subi autant d’exactions qu’ici et nous en aurions subi bien davantage si nous n’avions eu pour nous
(p. 175) défendre et nous soutenir des marchands génois et vénitiens sur le conseil desquels nous avons
poursuivi notre route. »
- 139 - 142 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
RHÉNAN ANONYME (1472)
Conrady, L., Vier rheinische Palaestina-Pilgerschriften des XIV., XV. und XVI. Jahrhunderts, aus den
Quellen mitgeteilt und bearbeitet, Wiesbaden, 1882.
p. 167-168 :
« Item au bord de la mer s’étend la ville d’Alexandrie où il y a beaucoup d’églises chrétiennes. Item parmi
elles il faut citer l’église Saint-Georges où vécut Jean l’Aumônier, patriarche d’Alexandrie. Item, l’église
Saint-Saba où il fut abbé. C’est dans cette ville d’Alexandrie que fut écartelée sainte Catherine et l’on voit
encore deux colonnes entre lesquelles étaient les roues, près de la se trouve le cachot où sainte Catherine
resta douze jours sans manger ni boire. Item, à l’extérieur de la ville se dresse une colonne très haute au
sommet de laquelle était l’idole que Maxence adorait avec son peuple en présence de sainte Catherine, et il
voulut l’amener à faire de même. Item, près de là se trouve l’église Saint-Marc, c’est à cet endroit qu’il fut
décapité et c’est là que passe le chemin le long duquel il fut traîné par des chevaux jusqu’au lieu appelé
Bucculi, à l’extérieur de la ville. Item, saint Jean l’Aumônier fut patriarche de cette ville d’Alexandrie, il y fit
des miracles et il y mourut. Item, dans cette ville il y eut beaucoup de martyres. »252
252 Traduction : G. Hurseaux (archives S. Sauneron, Ifao).
- 143 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN THUCHER (du 8 novembre 1479 au 31 janvier 1480)
Thucher, J., « Johann Thucher », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Membre du petit conseil de la ville de Nuremberg, Johann Thucher (1428-1491) en devient le maire à son
retour de pèlerinage en Terre sainte en 1480. Au cours de ce voyage, il est accompagné de Balthasar, duc
de Mecklembourg, et de deux chevaliers de Nuremberg dont Sebald Rieter. À Jérusalem, il devient chevalier
de la tombe sainte.253
p. 56b-61b :
« Le lundi huit novembre, nous continuâmes à marcher vers les portes d’Alexandrie. On compte de Rosette
jusqu’à cette ville, par voie de terre, soixante milles italiens. Il est également possible de passer du Nil dans
la mer et de naviguer jusqu’à Alexandrie, comme le font les païens, mais aucun chrétien ne peut aller plus
loin que Rosette. Lorsque nous arrivâmes à la porte d’Alexandrie, nous envoyâmes notre guide Ali chercher
un autre guide pour qu’il nous rejoigne à la porte. Là, nous fûmes retenus avec nos bagages et nous fûmes
soigneusement fouillés pour vérifier si nous n’avions pas de pierres précieuses ainsi que des objets que
nous aurions achetés au Caire. À la porte d’Alexandrie, on doit donner dix pour cent sur toutes sortes de
marchandises qui rentrent (p. 57a) et autant sur celles qui sortent. Bien que nous n’en eussions pas
beaucoup, nous dûmes payer cinq ducats et demi, et plus tard, dans la ville, chaque pèlerin dut payer cinq
ducats ; les domestiques en sont exemptés. C’est là que vont les cinq ducats des pèlerins, ils en sont très
avides, comme il est mentionné à un endroit au sujet des dépenses de voyage. Après être arrivés, nous
fûmes présentés. Moi Hans Thucher, je possédais plusieurs lettres de recommandation pour les
commerçants vénitiens qui me connaissaient bien. Ils nous hébergèrent dans le grand fondique, c’est-à-dire
leur auberge, ils nous donnèrent une chambre et furent bien aimables. Chacun de nous paya quatre ducats
par mois pour la pension et deux pour chacun de nos domestiques. Ils nous envoyèrent quotidiennement
notre repas dans notre chambre et nous traitèrent fort bien pour notre argent.
Nous voyageâmes de Jérusalem à Sainte-Catherine par le chemin que l’on prend d’habitude ; je l’estime à
peu près aussi long que de Nuremberg à Rome. Mais le retour de Sainte-Catherine à Alexandrie par le Caire
n’est pas aussi long.
À Alexandrie, Monsieur Otto Spiegel et moi-même, Hans Thucher, reçûmes d’un païen un coup de couteau
à pain dans la gorge et nous fûmes tous deux jetés en prison. Nous y étions depuis un quart d’heure, quand
les gentilshommes de Venise, chez lesquels nous logions, l’apprirent et nous firent libérer. Lorsque nous
étions en prison, il y avait une autre personne avec de grandes chaînes (p. 57b) au cou. On nous dit à son
sujet qu’on le couperait en deux par le milieu, parce qu’il avait prêché contre leur religion. C’était un grand
prêtre ou évêque d’une de leurs églises qu’on appelle Katti [copte]. Il avait un Pater noster dans la main et y
priait constamment. Plus tard, on l’expédia au Caire chez le sultan avec une grande chaîne au cou. Nous ne
savons pas ce qui lui arriva par la suite. Lorsque nous étions sur la galère de Venise à Jérusalem, la pluie
nous surprit comme je l’ai déjà mentionné ; depuis, il n’y eut plus de pluie jusqu’au dix-sept novembre à
Alexandrie, ce jour-là il plut pendant une heure. Ce fut la première pluie en cinq mois.
Alexandrie a une fois et demie la taille de Nuremberg. Jadis, la ville fut splendide, mais, maintenant à peine
un dixième est peuplé. Elle fut souvent détruite. Dans les constructions, on peut voir partout qu’elle fut
splendide, mais, maintenant tout est détruit et ruiné. Quatre-vingts ans auparavant, elle fut conquise, détruite
et ruinée par un roi de Chypre, appelé Jacobus, qui ne la tint que quatre jours. Il pilla la ville, emporta
quelques païens et remonta à bord de son bateau pour retourner dans son royaume. La ville possède de
bonnes murailles et fortifications garnies de tours rondes de défense à la manière des chrétiens. C’est aussi
la ville la plus forte qui existe chez les païens. Les chrétiens l’ont construite autrefois et l’ont gouvernée. Les
fossés du côté de la terre sont étroits et ne sont pas solides.
Elle est actuellement gouvernée par deux puissants (p. 58a) Mamelouks, mis en place par le sultan, un
Amireyo et un Diodar, dont un doit toujours être à Alexandrie. Chacun possède sa propre résidence et son
château où ils tiennent une cour magnifique.
Il y a deux collines hautes à Alexandrie. Sur la plus haute se trouve une tour carrée de laquelle on voit loin
dans la mer. Elle est habitée par quelqu’un qui surveille constamment les bateaux, les galères ou les navires
arrivant à la ville. Aussitôt qu’il voit venir sur la mer une ou plusieurs voiles, il court chez l’Amireyo pour lui
indiquer combien de voiles il a vu. Il hisse autant de drapeaux afin qu’on sache dans la ville combien de
voiles arrivent. L’autre colline, située au centre de la ville, est la colline des païens ; aucun chrétien ne doit y
aller.
Après lui avoir mentionné les voiles, l’Amireyo possède plusieurs pigeons en cage qu’il fait expédier sur des
bateaux ou barques pour aller à la rencontre des bateaux. On demande à qui appartient le bateau et quels
commerçants se trouvent à bord ; tout cela est écrit sur un bout de papier que l’on attache sous l’aile des
deux pigeons, puis on les laisse s’envoler. Ensuite les pigeons retournent chez l’Amireyo dans le château ;
celui-ci prend les messages et s’informe sur les bateaux et les marchandises qui arrivent. Je vis ces pigeons
alors qu’on les emmenait vers la mer. Lorsqu’il y a des nouvelles à Alexandrie, on dit que l’Amireyo a des
pigeons qu’il envoie au Caire chez le sultan.
La ville est bien fortifiée du côté de la mer. Cette année, le sultan du nom de (p. 58b) Qait Bay fit construire
un château fort dans la mer à un mille et demi-italien de la ville, avec une grande et forte muraille, et entouré
de seize solides tours. Dans ce château, le sultan a placé un châtelain ou un commandant qui en a la
charge. Aucun chrétien ne peut entrer dans le château sans autorisation. Tous les bateaux qui entrent dans
le port doivent en signe d’hommage baisser les voiles, ou tirer quelques salves face au château.
Aux alentours de la ville d’Alexandrie, il y a un grand nombre de jardins plaisants dans lesquels poussent
une grande quantité de fruits, des oranges, des dattes, des limons, des canéficiers, des citrons, des figues et
des bananes ; mais, on ne trouve ni pommes, ni poires. En revanche on trouve des mustij qui sont des
pommes d’Adam ; on dit que c’est avec ces pommes qu’Adam enfreignit la loi. Ces arbres sont étranges,
leurs feuilles mesurent quinze à seize pieds de long sur deux de large et l’apparence extérieure des
pommes ressemble aux cumeri de Venise. Elles poussent en grappe sur l’arbre ; il y en a parfois dix, quinze
ou vingt dans une grappe. C’est un fruit assez sucré, beaucoup plus sucré que les figues et possède à
l’extérieur une peau tendre. On les pèle comme les figues fraîches, si on coupe un mustij en deux, ou
chaque fois que l’on en coupe une tranche, on voit dans chaque tranche un crucifix. Il pousse beaucoup de
ces mustij au Caire ; ce sont les vraies pommes d’Adam. Dans ces jardins se trouvent aussi (p. 59a) de jolis
pavillons que nous avons visités en compagnie des commerçants. Dans cette ville, l’époque la plus agréable
se situe aux alentours de Noël. On y trouve également beaucoup de grives blanches que l’on attrape en
grande quantité au moyen de filets ; on les attire au sol en leur donnant seulement des dattes. Près
d’Alexandrie, on trouve beaucoup d’autruches dont les nombreux oeufs sont apportés en ville par les Arabes
pour y être vendus ; ils sont très bons à manger. On y trouve aussi beaucoup de léopards que les Arabes
savent capturer, puis les amènent en ville pour les vendre.
Ci-après suivent les lieux saints que nous avons visités à Alexandrie
Tout d’abord nous avons visité la prison dans laquelle sainte Catherine fut emprisonnée douze jours sans
nourriture corporelle. C’est une petite grotte à côté de laquelle habite un païen qui en a les clés ; il l’ouvre
aux pèlerins et aux chrétiens qui le désirent pour la somme d’un Modim, dont vingt-cinq font un Ducat. Près
de cette prison s’élèvent deux colonnes de marbre rouge, distantes d’environ douze pas l’une de l’autre. Là,
se trouvait la roue dentée sur laquelle sainte Catherine fut martyrisée.
Dans la ville d’Alexandrie se trouve l’église de Saint-Saba où sainte Catherine y habita avant son martyre.
Dans cette église se trouve le tableau de la Vierge Marie que l’évangéliste saint Luc peignit d’après nature.
Cette église (p. 59b) appartient aux Grecs. À l’extérieur de la ville, s’élevaient également deux grandes
colonnes de marbre rouge dont l’une est tombée à terre. Là, fut tranchée la tête de sainte Catherine. On dit
que ce lieu occupa jadis le centre de la ville. Dans la ville se trouve l’église Saint-Marc qui appartient aux
Jacobites. Saint Marc y habita. Un jour, alors qu’il célébrait la messe de Pâques, les païens lui mirent une
corde autour du cou et le traînèrent ainsi à travers la ville en direction de la mer à un endroit appelé jadis
Bubuch jusqu’à une église où il fut martyrisé puis enterré chrétiennement. Il y a également dans la ville
l’église Saint-Michel qui appartient aux Jacobites. À cet endroit, on y enterre généralement les commerçants
chrétiens. À Alexandrie, fut également martyrisé et enterré saint Jean l’Aumônier, comme le dit la légende.
Le mercredi vingt-neuf décembre, la galère de Trafigo sur laquelle Nito de Pesero fut capitaine et Andoro
Coro, le patron, arriva à Alexandrie. Cette galère attendit que les quatre galères des Vénitiens finissaient
leur chargement pour pouvoir charger, pendant un jour, des épices. Le jour suivant le navire de Laroda avait
également des épices à charger. Les quatre galères vénitiennes ne devaient pas rester plus de (p. 60a)
vingt-deux jours pour charger, le temps que leur concession les autorise. Ensuite ils devaient partir et ne
pouvaient plus rien charger. Ils devaient faire voile dès que le premier vent se levait.
Le jeudi treize janvier, on vit, de bonne heure, arriver les quatre galères vénitiennes ; trois mouillèrent à
l’heure des vêpres et la quatrième, sur laquelle fut le capitaine, arriva seulement une heure après, au
coucher du soleil. On commença à compter les jours autorisés pour le chargement, au nombre de
vingt-deux, à partir du quatorze janvier.
Ce même jour, une galère arriva de bonne heure de Constantinople sans rames, avec à bord uniquement
des passagers Turcs dont certains étaient des commerçants. La galère appartenait à Andrea Condertini de
Venise qui devait, avec celle-ci, affréter des pèlerins jusqu’à Jérusalem. Mais comme il n’y eut pas de
pèlerins, il loua donc la galère.
Le samedi 15 janvier, Monsieur Otto Spiegel, Sebald Ritter et moi-même, Hans Thucher, étions d’accord
pour embarquer avec nos deux domestiques sur la galère de Trafigo parce que nous espérâmes et eûmes
le sentiment qu’elle arriverait avant les autres à Venise, bien que cette galère fût chargée un jour après les
autres. Cette galère qui était venue avec les quatre autres de Venise n’était plus sous l’ordre du capitaine,
ainsi, elle n’était pas obligée de (p. 60b) les attendre car cette dernière avait son propre capitaine. Nous
embarquâmes avec le patron, nous dûmes donner, tous les cinq, pour la traversée douze ducats et pour la
nourriture, par personne et par jour, quatre Groschens, et pour notre domestique Polo, deux Groschens par
jour. Ce dernier devait manger avec les autres domestiques. Un ducat fait vingt-quatre Groschens. De plus,
nous dûmes chercher nous-mêmes un endroit où dormir sur la galère car le patron exigeait soixante ducats
par place sans les frais de fret ou de passage. Par conséquent nous préférâmes lui verser les douze ducats ;
ainsi nous trouvâmes à la proue du bateau un endroit, ceux de Moraton et de Calafon, qui signifient
charpentier et matelot. Nous dûmes leur donner seize ducats pour cet emplacement ; là nous y installâmes
un coffre et nous eûmes à peine de la place pour dormir. Cette année-là, les places, dans toutes les galères,
furent petites et chères car on chargeait beaucoup d’épices qui valent à Venise quinze ducats par Cheli ; le
Cheli pèse trois ou quatre cargaisons de poivre. On donne comme fret ou frais de transport pour le poivre,
son pesant à Venise, soit dix ducats pour mille livres de poids petit ; pour le gingembre, dix ducats pour mille
et pour la cannelle, onze ducats pour mille livres. Le fret peut monter jusqu’à quinze ducats.
À Alexandrie, nous fûmes enfermés avec les commerçants pendant deux jours et trois nuits dans deux
fontigo, c’est-à-dire (p. 61a) dans les maisons de commerce. Le troisième jour, on conduisit tous les
commerçants à la prison de la Douana, qui est la maison de la douane ; là on les enferma à cause du poivre
du sultan qu’on avait l’habitude de leur acheter chaque année. Ils devaient acheter le sport de poivre à
quatre-vingt-dix ducats qui valait six mois auparavant cinquante. Mais s’ils voulaient être exemptés, ils
devaient acheter le sport au prix de soixante-dix ducats ; le sultan en avait deux cent dix. Le consul de
Venise achète ce poivre par deux, huit ou dix sports qu’il revend alors ; ce qu’il perd est calculé en Chotino,
c’est-à-dire en frais et on l’ajoute aux marchandises venant de Venise à Alexandrie en plus des autres frais
qu’ils ont eu l’année précédente. Ainsi cette année, on comptait comme Chotino deux ducats deux tiers de
cent en pièce d’argent comptant sur toutes les marchandises qui arrivaient de Venise comme il a déjà été
dit. La totalité de ce qui est rentré l’année précédente s’élevait entre sept ou huit mille ducats de frais. Le
sultan étant lui-même à Alexandrie cette année-là, les marchands lui offrirent des présents d’une valeur
d’environ deux mille ducats ; ils firent également beaucoup de présents au grand Amireyo et au Diodaro. Sur
ces frais, on paye également le consul à qui l’on verse douze cents ducats par an. Ces comptes (p. 61b)
sont calculés chaque année dans les Chotino, c’est-à-dire les frais.
On nous a conseillé à Alexandrie de nous rendre sur la galère sans nos bagages car si on nous voyait
ouvertement, chacun aurait été taxé de dix ou douze ducats. Ainsi nous embarquâmes nos bagages
séparément sur la galère de sorte que le tout nous coûta à peine deux ducats. On nous avertit également
qu’il fallait être à bord neuf ou dix jours avant le départ de la galère car il arrivait fréquemment des troubles et
des accidents qui pouvaient retenir les commerçants et les faire taxer. Par conséquent le lundi trente et un
janvier, avant la chandeleur, nous embarquâmes secrètement sans nous faire voir à bord de la galère
Trafigo et nous ne revîmes plus à terre par la suite. »254
253 Mummenhoff, E., « Thucher, Hans », NDB 22, Berlin, 2005, p. 611.
254 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 144 - 146 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SEBALD RIETER (du 8 novembre 1479 au 31 janvier 1480)
Meisner, H. et Röhricht, R., « Das reisebuch der Familie Rieter », Literarischer Verein 68, Stuttgart, 1884.
Sebald Rieter est originaire de Nuremberg où il siége au conseil de la ville. On sait également qu’il séjourne
dans la cour du duc de Bavière.
Il voyage en compagnie de Johann Thucher, pèlerin précédent.
p. 124-125 / 132-133 / 145 :
Ce que nous vîmes et rencontrâmes à Alexandrie, et ce qui nous arriva lors de notre séjour
« Idem le 11 novembre, jour de saint Martin, alors que Monsieur Otto Spiegel et Hans Thucher se
promenaient au bord de la mer devant la porte d’Alexandrie, ils rencontrèrent le fils du châtelain
accompagné de trois ou quatre autres païens qui voulaient leur arracher leurs sacs et leurs bagues. Mais
comme ils se défendaient, ils furent sévèrement battus et maltraités. Hans reçut de la part du fils du
châtelain un coup de couteau dans le cou. Ils furent ensuite conduits par les païens chez l’Amyrey et furent
accusés de s’être trop approchés du château dans le but de le visiter. Ceci n’était pas vrai, ils se
promenaient seulement à l’endroit habituellement fréquenté par les chrétiens. Cependant l’Amyrey crut les
païens et les deux chrétiens furent conduits en prison. La nouvelle arriva au fondique des Vénitiens ; les
consuls et les marchands se rendirent aussitôt auprès de l’Amyrey qui avant toute négociation fit libérer les
deux chrétiens. Ces derniers étaient seulement restés un quart d’heure en prison. Toutefois ils durent payer
plus tard six ducats, somme promise aux serviteurs de l’Amyrey par les marchands pour les libérer au plus
tôt. Par la suite l’Amyrey (p. 125) fit battre le fils du châtelain et les autres païens de cinquante coups de
bâtons.
(p. 132) Idem le dimanche six février, au lever du soleil, se termina pour les quatre galères venues
dernièrement de Venise, la période de la Muda255, c’est-à-dire les vingt-deux jours autorisés à partir de leur
arrivée au port d’Alexandrie. Idem le sept février se termina la Muda pour la galère de Trafiggo sur laquelle
nous étions. Le huit février se termina la Muda du bateau appelé la Navy de Rata. Après l’expiration de la
Muda, les navires quittent aussitôt leur mouillage pour aller à côté du nouveau château que le sultan avait
fait construire cette année-là, appelé le château du pharaon. Aucune galère, aucun navire ne doivent
charger des épices après l’expiration de la Muda, sous peine de punition.
Idem le mercredi neuf février, jour de sainte Apollonie, on mit les voiles à deux heures du matin, à savoir 5
galères et un navire, venant tous de Venise, chargés d’épices, ainsi qu’un navire d’Ancône. Nous quittâmes
donc le port d’Alexandrie au nom de Dieu, de Marie et de sainte Catherine, cette fois-ci par un beau temps
et (p. 133) un vent favorable. »
(p. 145) « Idem, lorsque nous voulûmes aller à Alexandrie nous dûmes nous procurer chez le drogman du
Caire deux lettres pour lesquelles nous payâmes un ducat. Idem, pour Aly, qu'il nous envoya pour nous
accompagner, nous sept payâmes 6 ducats, ce qui fait pour ma part et la demie part de Polo un ducat sept
medins. Idem nous les cinq pèlerins dûmes payer sous la porte d'Alexandrie d'abord un ducat pour huit
perroquets, plus un ducat pour nous tous, et trois ducats pour nos achats au Caire que nous avions avec
nous et qu'ils estimèrent à une valeur de trente ducats, bien qu'il n'y eut rien qui dut être taxé, plus un ducat
de pourboire aux serviteurs sous la porte, ce qui fait pour ma part et pour la demie part de Polo deux ducats
et quatre medins. Idem, chacun de nous trois dut donner au drogman à Alexandrie un ducat, sans compter
les domestiques ; de ces cinq ducats un appartient au dyadery, un au kettebeser, un au neckewitz, un au
gardien, un au zadady, un au seigneur du port, un au seigneur de la mer, un au drogman. Idem, nous trois
dûmes aussi payer trois ducats au consul des Catalans et un ducat à son domestique, ce qui est l'usage,
parce que le consul des Catalans se porte garant pour tous les Ultramontais venant à Alexandrie. »256
255 Ce mot signifie période en arabe.
256 Taduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 147 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SANTO BRASCA (1480)
Capodilista, G. et Santo Brasca, Viaggio in Terra santa, di Santo Brasca, 1480, con l’Itinerario di Gabriele
Capodilista, 1458, Milan, 1966.
Santo Brasca, gentilhomme de Milan, homme de lettres et poète, est également chancelier ducal des
Sforza.257
La relation de Santo Brasca, qui aurait voyagé en 1480, reprend celle de Gabriele Capodilista datée de 1458
(voir supra).
p. 144 :
« Continuant par bateau quelques autres cent mille, on arrive à Alexandrie, ville du sultan, belle et
marchande, placée au bord de la Méditerranée où ont été décapités saint Marc l’Evangéliste et la sainte
Vierge Catherine, nommé plus haut. Puis on va à Damiette dernier lieu de pèlerinage où fut décapité le
prophète saint Jérémie, car il avait annoncé que les Juifs auraient été mis en captivité à cause de leurs
péchés. »258
257 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 167-168.
258 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 148 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MESHULLAM BEN R. MENAHEM (juin 1481)
Ben R. Menahem, M., « Meshullam ben R. Menahem », dans E. N. Adler, Jewish travellers, New Delhi,
1995.
Riche marchand juif de Florence, Ben R. Menahem prend le bateau à Palerme en 1481. Il débarque à
Alexandrie avant d’arriver au Caire le 14 juin.259
p. 157-163 :
« Le mercredi 6 juin, nous atteignîmes notre destination, Alexandrie, mais comme notre pilote était mort
dans la bataille, et que le capitaine était blessé et alité, nous fûmes obligés de nommer capitaine un des
matelots, et lorsqu’on pénétra dans le port, le bateau s’échoua et fut sur le point de faire naufrage. Il y eut un
grand cri dans le bateau et les Génois sortirent d’Alexandrie, dans une autre galée, pour nous aider ; ils
jetèrent l’ancre et après avoir attaché notre bateau au leur avec des cordes, ils voulurent le tirer ; les
matelots donnèrent une forte traction et la corde de halage de la galée se brisa, bien qu’elle fût solide et
aussi épaisse que mon bras. Finalement après beaucoup (p. 158) d’ennuis, ils le désensablèrent et nous
nous arrêtâmes à environ un mille d’Alexandrie, parce que la côte d’Alexandrie est bordée d’écueils et les
grands bateaux ne peuvent pas s’approcher ; mais Dieu nous aida et nous sauva cette fois car nous avions
été en grand danger.
Le même jour, je débarquai à Alexandrie. À droite, elle est dans une vallée, et elle possède des tours
séparées par la mer ; et il y avait une galée comme celle de Rome, mais pas aussi grande. Lorsqu’on entre
à Alexandrie, on trouve un beau fort avec 22 tourelles et un mur épais de dix coudées entre chaque tour. Il
les entoure comme une couronne d'un côté de la ville. Ils auraient pu placer la forteresse sur une île, mais le
sultan ne veut pas le faire, parce qu'il y a maintenant une approche cachée de la ville. Je n'ai jamais vu une
aussi belle forteresse ; elle n’a que trois ans. Huit cents mameluks y dorment chaque nuit, parce que telle est
la loi. Les mameluks portent un bonnet rouge sur leurs têtes et tiennent un bâton en main. Près de la
forteresse, il y a vingt mosquées. Lorsque nous arrivâmes à la porte ils nous retinrent et trouvèrent de
l’argent sur nous, bien qu’il se trouvât sous la plante de nos pieds. Ils en prirent environ dix pour cent. Aussi,
ils trouvèrent sur moi de l’argent que je n’avais pas déclaré, mais me rendirent le solde. Les Juifs ne paient
rien pour la marchandise, mais les Gentils paient dix pour cent. Il est impossible d’échapper à la taxe parce
qu’ils fouillent tout le monde, aussi bien les Juifs que les femmes.
Je me renseignai sur les coutumes d’Alexandrie et leur mode de vie ; je trouvai en tout point que leurs
manières étaient extraordinaires. Les femmes peuvent voir, mais ne sont pas vues, parce qu’elles portent
sur leurs visages un voile noir qui a des petits trous ; elles portent sur leurs têtes un turban de mousseline,
brodé et orné, plié plusieurs fois, au-dessus duquel, un voile blanc va jusqu’aux chevilles et recouvre leur
corps.
Les Ismaélites portent des vêtements en coton (p. 159) et passent leur temps assis sur des tapis ou des
nattes de paille ; ils circulent jambes et pieds nus, et portent seulement un vêtement en coton, avec une
ceinture, qui va jusqu’à la moitié de la cuisse. Les femmes portent des pantalons et les épouses des Turcs
vont chez le coiffeur une fois par semaine. Quant aux hommes, ils ne portent pas de pantalons, ne coupent
pas leurs cheveux, mais se rasent la tête avec un rasoir, sans la laver sinon avec un peu d’eau.
Lorsqu’un homme épouse une femme, il lui donne une dot et à partir de ce moment, il est seulement obligé
de lui donner à manger et à boire, mais il ne l’habille pas car elle doit le faire avec son propre argent ;
lorsqu’elle a un enfant, elle est tenue de les nourrir, et quand elle attend un enfant, il ne doit pas la toucher.
C'est pourquoi ils épousent vingt-trois femmes et certains d'entre eux ont vingt fils et filles nés tous dans une
seule année.
Tout le monde se déplace à dos d'âne ou de mulet, car personne, même pas un musulman, ne peut aller à
cheval, sauf les mameluks.
Leurs ânes sont très beaux et forts, et ils portent comme ornements des soldi et des bardili de valeur. Je vis
un Bardili d’âne qui coûtait plus de deux mille ducats, fait de pierres précieuses et de diamants, avec une
frange en or qu’ils avaient mis dessus et surtout sur la partie frontale du bardili qui était sur le front de l’âne.
Les Ismaélites sont comme des dromadaires et des boeufs : comme le dromadaire qui n’est jamais chaussé,
ils vont nus pieds. Le dromadaire s’accroupit et mange par terre : ils s’accroupissent également et mangent
par terre, sans nappe, seulement avec du cuir rouge. Le dromadaire dort avec son harnais : ils dorment
également par terre et s’accroupissent avec leurs vêtements et ne se déshabillent jamais le soir.
Les Juifs font comme les Ismaélites dans toutes les terres et les provinces du sultan. Ils n’ont ni lit, ni table,
ni chaise et ni lampe, mais ils mangent, boivent et dorment toujours par terre et tout leur travail se fait sur le
sol.
Alexandrie est aussi grande que Florence. Elle est bien bâtie, les murailles de la ville sont hautes et belles,
mais toute la ville est (p. 160) très sèche et a plus de ruines que de bâtiments. Les maisons sont belles, et
dans chaque maison, on trouve une cour pavée de pierres blanches, avec un arbre, et, au milieu, une
citerne. Chaque maison a deux citernes ; une pour l'eau nouvelle, l'autre pour la vieille eau, car le Nil monte
chaque année au mois d'août et pourvoit en eau toute Alexandrie. Les étangs et les citernes se remplissent
aussi d'eau.
Les fruits d'Alexandrie sont très bons et bon marché ; le pain, la viande et toute sorte de volaille sont très
bon marché mais le bois est très cher, ainsi que l'huile. Le vin et le miel sont très chers, car ils ont à payer
une lourde taxe, environ vingt-quatre pour cent. Le lin d'Alexandrie est de bonne qualité, et, leurs vêtements
de lin sont bons et pas chers.
Il ne pleut jamais à Alexandrie, seulement très peu. Les fruits mûrissent et croissent très vite parce qu’il y a
beaucoup de rosée. Au cours de ma vie, je n’ai jamais vu autant de rosée. Elle ressemble à la pluie, mais
lorsque le soleil apparaît, elle s’évapore.
La volaille est bon marché parce que les oeufs sont couvés dans des fours. Ils réchauffent les fours, y
mettent du fumier de bétail et de cheval et y placent 1000 à 2000 oeufs. À la suite de cela, en trois semaines
environ, ils obtiennent des poussins vivants et de la volaille en quantité infinie.
Durant les mois de juin, juillet et août, l’air est très mauvais à Alexandrie à cause d’un mauvais vent appelé
borea qui se déchaîne à cette époque et qui attaque les gens comme la peste noire – Que Dieu nous en
préserve ! – ou les rend aveugles. Durant cinq ou six mois, ils ne peuvent rien voir du tout. C’est pour cette
raison qu’on voit beaucoup de gens à Alexandrie qui ont les yeux malades. À cette saison, les personnes
aisées de la ville se rendent à d’autres endroits, mais ne restent pas à Alexandrie. En particulier, les
étrangers qui ne sont pas habitués à ce (p. 161) climat peuvent en être atteints et meurent surtout au cours
de ces trois mois. Il est très mauvais de manger des fruits durant cette saison.
Alexandrie est en ruine en ce moment car le roi de Chypre lui fit la guerre, s’empara d’elle et y régna
pendant trois ans. Ensuite, le sultan, roi d’Égypte, le combattit, l’attaqua, brûla la ville et captura le roi de
Chypre. Ce dernier devait payer au roi d’Égypte un tribut de 10 000 dinars chaque année. Ainsi, le roi
d’Égypte lui permit de retourner à Chypre. Il continua à payer ce tribut jusqu’à la prise de Chypre par les
Vénitiens. Depuis ce temps, le sultan reçut ledit tribut du roi vénitien de Chypre chaque année. L’intention du
sultan fut donc d’aider le roi de Chypre ; il envoya dire au roi de la part de son fils, de lui donner sa fille, afin
que les hommes de Chypre ne se rebellent pas contre lui et continuent à payer un tribut. Les Vénitiens
acceptèrent et paient avec des monnaies qui portent l’effigie de la fille du roi qui réside hors de chypre. C’est
la vérité, cela m’a été rapporté par le Gran Maestro de l’Ordre qui agit pour la princesse à Alexandrie.
Les Juifs d’Alexandrie. J’ajouterai à la fin de ce récit, mais ce n’est pas important qu’il y a à Alexandrie
environ soixante familles juives, seulement des Rabbinites260, mais pas des Karaïtes, ni des Samaritains. Ils
s'habillent comme les Ismaélites. Ils ne portent pas de chaussures, mais s’asseyent par terre, et entrent
dans les synagogues sans chaussures et sans pantalons.
Il y a quelques juifs qui se rappellent du temps où il y avait 4.000 familles juives, mais ils sont devenus de
moins en moins nombreux, comme les taureaux de sacrifice des tabernacles. Ils ont deux synagogues, une
grande et l'autre petite. Tous les Juifs attestent que (p. 162) la plus petite fut bâtie par Élie le Prophète où il
avait l'habitude d'y prier. Et il y a là une arche, et une chaise à côté. À l'intérieur brûle toujours une flamme.
La synagogue a deux bedeaux, il s’agit de R. Joseph Ben Baruch et de R. Halifa qui se sont nommés
eux-mêmes bedeaux de la synagogue. Ces derniers me dirent qu’en 1455, à la veille du jour du jeûne de
l’expiation, on les avait laissés passé la nuit à la synagogue avec deux autres personnes ; la nuit, ils virent
tous à minuit quelqu’un qui ressemblait à un vieil homme qui était assis sur la chaire. Ils décidèrent d’aller
humblement devant lui pour lui demander quelque chose tout en s’inclinant. Lorsqu’ils s’approchèrent pour
l’aborder, ils levèrent les yeux et virent qu’il n’y était plus ; Dieu l’avait repris. Ils me racontèrent les autres
merveilles qu’ils avaient vues dans la synagogue. De mes yeux, je vis le manuscrit des vingt-quatre livres de
la Bible sur parchemin, en quatre volumes, avec une très grande écriture plus belle que toutes celles que je
n’ai jamais vu ; ainsi qu’un rouleau de parchemin de la loi écrit et signé par Ezra le Scribe qui le laissa
comme un legs à la synagogue d’Élie le Prophète. Ils [les bedeaux] prononcèrent une malédiction contre
celui qui l’enlèverait de la synagogue. Je vis également d’autres manuscrits dans cette synagogue.
À Alexandrie, je vis quatre grands fondaks, l'un pour les Francs, l'autre pour les Génois et leur consul, et
deux pour les Vénitiens et leur consul. Ils sont tous sur le côté droit d'une rue quand on approche
d'Alexandrie, et en face d'eux, au milieu, est le grand fondak des Ismaélites.
Je vis aussi l’amiral qui avait un pigeon ; à chaque fois qu’il voulait envoyer un message au sultan, il mettait
la lettre dans le bec du pigeon ou bien il l’attachait. Le pigeon l’emmenait à Misr (Le Caire) jusqu’à la fenêtre
de la demeure du sultan ; là, il y avait toujours un homme qui attendait. Même si on peut en douter, ceci est
la vérité.
(p. 163) À Alexandrie, tous les Gentils paient treize ducats pour entrer dans la ville, et ne peuvent en sortir à
moins de payer. Les juifs ne paient rien, mais chaque juif doit obtenir la permission de l'émir s'il veut quitter
la ville pour l’étranger. Ils voyagent dans de grandes caravanes. »261
Les voyageurs s’en vont à dos d’ânes jusqu’à Rosette, escortés d’un mameluk.
259 Dopp, P.-H., « Le Caire vu par les voyageurs occidentaux du Moyen-âge », BSGE XXVI, 1953, p. 112.
260 Partisans du rabbinisme, c’est-à-dire de l’enseignement des deux grands docteurs Hillel et Schamaï.
Note de O. V. Volkoff.
261 Traduction : S. Fadl (archives Sauneron, Ifao).
- 149 - 151 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BERNARD DE BREYDENBACH (du 23 octobre au 15 novembre 1483)
Breydenbach, B. de, Les saintes pérégrinations, par F. Larrivaz, Le Caire, 1904.
Bernard de Breydenbach est fils d’un chevalier de Hessen. À partir de 1450, il est membre du conseil
religieux et, en 1484, il devient doyen de l’église de Mayence. Il meurt en 1497.262
p. 66-78 :
« Arrivés au sommet d'une colline, nous pûmes contempler la glorieuse ville d'Alexandrie, enveloppée d'un
côté par la mer, de l'autre toute entourée de délicieux jardins très fertiles. Le sol assez productif, lorsqu’il est
arrosé des eaux du Nil, nourrit des bananiers aux fruits succulents, tels que nous en avions vus en
abondance dans le jardin de baume ; on y trouve d’autres fruits variés comme l’orange, la datte, la cannelle,
le citron et la figue. On ne trouve ni poires ni pommes. Il y a dans ces jardins de splendides pavillons et on y
chasse les oiseaux appelés merles d’une blancheur éclatante parfaite. On y trouve encore des léopards ; les
Arabes les prennent tout petits et les vendent un ducat pièce. Dès que nous fûmes arrivés à la ville, les
sarrasins fermèrent la porte par laquelle nous voulions entrer et nous forcèrent à marcher à pied le long des
fossés de la ville. Ainsi par un long circuit très pénible nous arrivâmes à une autre porte où se tenait un cruel
percepteur qui exigea une grosse somme pour le passage des hommes, des chameaux et des ânes. Après
avoir payé ce tribut, nous entrâmes par cette première porte grande et haute, armée de serrures et nous
pensions gagner paisiblement un logis. Nous marchions entre les hautes murailles fortifiées, quand nous
aboutîmes à une autre grande porte de fer ; il y avait là plusieurs sarrasins ; et comme nous nous efforcions
d’entrer avec nos montures, ils nous chassèrent à coup de bâtons ; bientôt même les gardiens de la
première porte accourant après avoir fermé celle-ci avec des barres et des serrures, vinrent fermant la
seconde porte et nous tinrent ainsi enfermés entre les deux portes, entourés de très hautes murailles et de
tours. Nous nous assîmes pour manger notre pain cuit sous la cendre et boire une eau fort chère et fort rare.
Nous ne pûmes encore cette fois avoir autre chose.
Pendant cette nuit plusieurs de nos pèlerins, montant sur le mur extérieur, purent voir les fossés de
l’enceinte fortifiée ; ils affirmaient qu’ils n’avaient jamais vu une ville aussi belle, ni si (p. 67) bien protégée de
beaux remparts, de murailles puissantes et élevées, de tours bien bâties. L’intérieur toutefois n’a pas
l’aspect d’une ville, on dirait un monceau de pierres ruineux et désolé. Dès qu’il fit jour, on ouvrit les portes
pour introduire notre trucheman d’Alexandrie et nous lui envoyâmes un messager pour qu’il vint nous faire
entrer dans la ville le plus tôt possible. À son arrivée, nous lui remîmes la lettre que nous avions reçue du
sultan, et qui devait être montrée aux gardiens de la porte ; ceux-ci après l’avoir reçue en baisèrent avec
respect le sceau et la lurent. Après cette lecture, à commencer par les pèlerins du plus haut rang, ils nous
déshabillèrent les uns après les autres pour faire leurs perquisitions ; c’est ainsi que le premier de tous les
seigneurs, Jean de Solms, fut dépouillé de ses habits et visité, puis tous les autres à la suite. Tout ce qu’ils
trouvèrent d’argent et de choses précieuses dans nos paniers et nos sacs, ils le mirent à part, puis quand
tout fut bien visité, ils exigèrent une somme proportionnelle à la valeur des objets. Ils exemptèrent de tout
tribut les clercs et les religieux, leur permettant de passer sans rien payer. Sur tout ce qui entre ou sort de la
ville on prend le dix pour cent, et l’on ne fait grâce à personne. Introduits en ville nous demeurâmes
stupéfaits de ne voir de toutes parts que des ruines lamentables ; nous ne pouvions revenir de notre
étonnement en voyant des murailles si belles et si fortes entourer une ville si pauvre. On nous conduisit à
l’hôtel du roi de Sicile qui est le fondique des Catalans ; nous (p. 68) y fûmes accueillis avec courtoisie et
bienveillance par son hôte qu’on appelle consul de la nation catalane ; on nous donna des chambres et nous
y déposâmes nos bagages. Le fondique est une vaste maison où se trouvent les marchands et les
entrepôts, ainsi que le lieu du marché. Bien qu’il y ait deux fondiques pour les Vénitiens à Alexandrie et un
pour les Génois, toutefois depuis longtemps les pèlerins ont pris l’habitude de descendre à celui des
Catalans, car ils sont alors protégés par le consul de ce fondique auquel le truchement d’Alexandrie prête
son appui. Après qu’ils eurent arrangé leurs affaires, les pèlerins nobles furent présentés par le trucheman
lui-même à l’amiral ou préfet de la ville. L’amiral les reçut en amis, leur adressa des paroles de
bienveillance ; après avoir demandé le nom de chacun, il le fit écrire sur un registre et les congédia.
Quelques uns des nôtres s’arrangèrent avec le consul des Catalans pour partager sa table et furent ses
commensaux ; on y fit maigre chair et l’on but fort peu ; mais les service fut fait dans de la vaisselle d’argent.
Les autres avec Monsieur de Solms restèrent dans leur chambre et ils purent boire et manger suivant leur
bon plaisir.
Le lendemain qui était le 25 octobre comme nous venions d’entendre la Messe dans la chapelle de l’hôtel
indiqué plus haut et dont l’aumônier était un prêtre de l’ordre des Frères Prêcheurs, voilà qu’une clameur et
un tumulte bruyant du peuple retenti du côté de la mer. Effrayés nous montons au sommet de la maison
pour voir ce qu’il en était. Nous aperçûmes dans le port des fustes, des grips263 avec des vaisseaux armés
qui abordaient, ébranlant les airs du fracas de leurs bombardes, de l’éclat de leurs trompettes et des cris des
matelots. C’était des sarrasins qui conduisaient un personnage très important d’Afrique à la Mecque pour
visiter en pèlerin le tombeau de Mahomet. Pendant qu’ils étaient en mer ces mêmes sarrasins s’étaient
emparés d’un vaisseau qui renfermait treize chrétiens ; ils s’étaient partagés les dépouilles et allaient vendre
les chrétiens à Alexandrie. Les (p. 69) mammeluks et les habitants allèrent au-devant d’eux dès qu’ils
débarquèrent ; ils les reçurent en grande pompe et les introduisirent dans la ville avec leur butin au milieu
des acclamations.
Le 26 octobre, vingt-deuxième dimanche après l’octave de la Trinité, après avoir entendu la Messe et pris
notre repas, nous restâmes à nous reposer au logis. Nous ne pouvions pas sortir en sûreté ; le trucheman
d’Alexandrie à qui nous n’avions pas encore payé la somme due, ne nous avait pas procuré la garde qu’il
nous devait. Dès que nous eûmes payé cette somme assez ronde, il nous conduisit le lendemain à la porte
de la ville qui mène à la mer ; il nous présenta aux gardiens et nous obtint la liberté d’entrer et de sortir
chaque fois que nous voudrions.
Le jour suivant, fête des Saints Simon et Jude, après la célébration de la Messe, on nous conduisit à
l’endroit où il y avait et où il y a encore une prison, dans laquelle l’illustre martyre sainte Catherine,
dépouillée et exposée à la piqûre des scorpions, (p. 70) resta douze jours sans boire ni manger ; on l’avait
enfermée pour lui faire subir l’épreuve de la faim, mais le Seigneur lui servit de la nourriture par le ministère
d’une colombe. Dans cette prison la reine et le soldat Porphyre virent autour de Catherine une armée
d’anges qui la consolaient, l’animant à souffrir le martyre, comme porte sa légende. À force de prières nous
pûmes entrer dans cette prison ; sur le devant étaient deux colonnes de marbre assez élevées, séparées
entre elles par un espace de 12 pieds ; c’est sur ces colonnes que reposaient d’horribles roues de torture
destinées à couper et broyer le corps de la glorieuse vierge ; mais à sa prière ces machines furent brisées et
4000 païens périrent sous leurs débris. C’est à cette même place que s’étaient réunis de diverses provinces,
les cinquante rhéteurs initiés à toutes les sciences, mandés pour lutter en présence de l’empereur avec
Catherine. La (p. 71) grâce répandue sur les lèvres de la vierge lui assura une telle victoire qu’ils restèrent
tous sans réponse et s’écrièrent tout haut qu’ils voulaient se convertir au christianisme. Pris d’un accès de
rage l’empereur ordonna de les faire brûler ; mais le feu n’atteignit pas leurs vêtements ; ils furent préservés
et beaucoup de témoins crurent encore au Christ.
De la prison de Sainte Catherine nous nous dirigeâmes vers l’endroit où l’on suppose que s’élevait le palais
d’Alexandre le Grand ; comme témoignage et souvenir il y a là une colonne monolithe précieuse, d’une
hauteur et d’un volume étonnants ; l’extrémité se termine en pointe et de loin on la prendrait pour une tour.
Elle est de couleur rougeâtre et porte beaucoup d’inscriptions en caractères qu’on croit être ceux des
anciens. Elle est beaucoup plus grande et plus élevée que la colonne qui s’élève à Rome près de Saint
Pierre et que l’on dit avoir été autrefois placée à côté de celle-ci, puis transportée d’Alexandrie à Rome. Il y a
aussi en dehors de la ville une autre colonne très haute que l’on appelle de Pompée, parce que Pompée l’a
fait élever à sa mémoire ; nous l’avons vue également à notre entrée.
Du palais d’Alexandre nous allâmes vers une église dite de Saint-Sabba. Elle a été bâtie sur l’emplacement
où vivait Sainte Catherine avant son martyre, pendant son séjour à la cour du roi. À la mort de Costus dont
elle était la fille unique elle administrait sa famille. Des moines grecs desservent cette église.
On montre encore hors des murs, la place où la martyre du Christ Catherine fut décapitée. Il y a là deux
grandes colonnes en marbre, élevées pour perpétuer ce souvenir. C’est de là que son saint corps fut
transporté par les mains des anges sur la montagne du Sinaï. Au temps du martyre de cette pieuse vierge,
cet endroit se trouvait dans l’intérieur de la ville qui était alors beaucoup plus vaste et plus belle que
maintenant. On visite encore dans Alexandrie une église dite de Saint-Marc tenue par les Jacobites ; elle est
construite sur l’emplacement habité jadis, dit-on, par saint Marc et où il célébra souvent les divins (p. 72)
offices. Bien que par humilité il se fût coupé le pouce pour rester impropre au sacerdoce, toutefois par la
providence divine et l’autorité de Pierre il avait été ordonné évêque d’Alexandrie. Là, un jour de Pâques,
pendant qu’il célébrait la Messe, il fut attaché à une corde et il se laissa traîner par la ville, sans cesser de
rendre grâce à Dieu. Enfermé dans une prison, il fut réconforté par la visite de Jésus-Christ et de ses anges,
puis le lendemain comme on le traînait encore par la ville avec une corde, il s’écria : Seigneur, je remets
mon âme entre vos mains, et rendit ainsi l’âme à son Créateur. Des hommes pieux lui donnèrent d’abord la
sépulture en cet endroit et plus tard son corps fut transporté à Venise. Dans une autre église des Jacobites,
dite de Saint Michel, se (p. 73) trouve le lieu de sépulture des pèlerins chrétiens. Pendant notre séjour dans
Alexandrie, le Seigneur Jean, comte de Solms, seigneur de Mützenberg, le plus noble et le plus jeune dans
notre groupe de pèlerins, étant mort des suites de la dysenterie, après avoir reçu, très dévotement tous les
sacrements, fut enterré dans cette église. Sa mort et son passage à l’éternité furent pour nous un grand
chagrin et un grand deuil.
On montre encore à Alexandrie le lieu où saint Jean l’aumônier, autrefois patriarche d’Alexandrie, subit le
martyre, en confessant la vrai foi, comme on le voit dans sa légende. Il y a aussi dans les quatre fondiques
des chrétiens de belles chapelles, bien ornées, avec des chapelains latins, soit prêtres séculiers soit
religieux ; nous les avons souvent visitées. Pendant les jours que nous passâmes à Alexandrie, un très
grand nombre de vaisseaux, galiotes et fustes abordèrent et il y eut force pillage. Comme il y avait de graves
inimitiés et de furieuses querelles entre Venise et Naples, les Vénitiens pillèrent un vaisseau de transport
napolitain qui gagnait Alexandrie. Pendant ces mêmes jours arriva une galiote chrétienne qui venait
d'au-delà des mers ; elle avait à bord quelques Allemands qui déclarèrent n'avoir rien d’autre sur leur galiote
que des avelines264 pour une somme de dix mille ducats ; ces fruits ne se trouvent pas en Orient et on les y
vend fort cher ; on prétend même que dans ces pays-ci les avelines peuvent se conserver au-delà de cent
ans sans se flétrir, sans se gâter, à l'abri des vers ; chez nous, on ne pourrait ainsi les préserver au-delà
d'une année. Pendant notre séjour encore les Alexandrins qui rôdaient sur mer voyant aborder un navire
étranger fondirent sur lui, s’en saisirent, l’amenèrent au port et, comme des pirates, (p. 74) se partagèrent le
butin. En effet si les vaisseaux qui arrivent à Alexandrie ne sont pas puissamment armés, les Alexandrins les
pillent avant qu’ils abordent ; mais s’ils peuvent gagner le port, ils sont en sûreté tant qu’ils y séjournent. Les
sarrasins exercent une extrême vigilance pour garder leur port ; continuellement portés sur les deux
montagnes artificielles qui sont dans l’intérieur de la ville pour surveiller la mer, ils informent l’amiral de
toutes les voiles qu’ils aperçoivent au large. Celui-ci dépêche alors sur le champ une barque rapide qui va
s’enquérir de la condition de ceux qui approchent. Et ici, bien que mon récit paraisse incroyable, il n’est que
l’expression de la réalité. L’amiral a toujours chez lui des pigeons apprivoisés et dressés à revenir toujours
au palais de l’amiral où qu’on les conduise. Les matelots, envoyés au-devant des vaisseaux qui arrivent,
prennent donc avec eux deux ou trois de ces pigeons et les emmènent en mer jusqu’au lieu où ils peuvent
facilement se renseigner, alors ils attachent au cou du pigeon un billet contenant ce qu’il importe de savoir et
ils le lâchent. Ce pigeon volant à toute aile jusqu’à la table de l’amiral, lui porte ainsi tous les renseignements
sur ceux qui avancent. S’il est nécessaire de faire connaître encore quelque chose à l’amiral, on lâche un
second ou même un troisième pigeon, et ainsi, longtemps avant que les vaisseaux arrivent au port, l’amiral
est renseigné. On dit même qu’il a des pigeons qu’il envoie au sultan jusqu’au Caire, si par hasard quelque
chose d’imprévu ou de difficile survient et dont il doive aussitôt l’avertir. Si les mariniers envoyés par l’amiral
ne peuvent pas reconnaître les conditions des navires, ils le font savoir à l’amiral par le moyen des pigeons
et celui-ci expédie aussitôt des fustes armées avec ordre de donner l’assaut, de dépouiller, de piller ceux qui
arrivent ; et c’est ce qu’ils font à moins qu’ils ne se trouvent en face de plus forts, comme nous l’avons dit
plus haut.
Le 29, circulant à travers la ville, nous examinâmes particulièrement les fondiques ; ils étaient encombrés de
marchandises, à l'exception de celui des Catalans où il n’y avait qu’un féroce (p. 75) léopard attaché, et où
les sarrasins et chrétiens mangeaient et buvaient sans distinction. Le fondique des Génois, une grande et
belle maison, avait beaucoup de marchands et une grande quantité de choses précieuses. Nous visitâmes
les deux fondiques des Vénitiens ; en outre des marchandises précieuses qui s’y trouvaient, nous vîmes de
grandes autruches qui se promenaient et mangeaient le fer qu’on leur jetait. Les Vénitiens élevaient aussi un
porc ; c’est le seul et unique que nous ayons vu dans ces pays d’outre-mer. Les sarrasins ont cet animal en
plus grande horreur encore que les juifs ; ils ne laisseraient certainement pas vivre celui-là si à la prière des
Vénitiens, le sultan ne lui eût accordé la vie. Nous pénétrâmes dans le fondique des Turcs, où les
marchands faisaient grand tapage, nous visitâmes aussi ceux des Maures, des Ethiopiens, des Tartares où
entre autres choses, nous vîmes les choses les plus nobles vendues au plus vil prix, je veux dire des
hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants et de fillettes, des femmes même portant des
enfants à la mamelle. Tous attendaient leur tour sur le marché. Ils sont traités ignoblement et d’une manière
tout à fait inhumaine par les acheteurs qui veulent voir s’ils sont sains ou malades, forts ou chétifs. On
dépouille les jeunes filles, on les fait courir, sauter et c’est ainsi qu’on examine leurs défauts, etc. Chaque
nuit tous les fondiques sont fermés par les sarrasins et personne ne doit entrer ni sortir ; de même aux jours
où ils se réunissent dans les mosquées (p. 76) et aux époques de leurs grandes fêtes ; il n’y a pas dans
Alexandrie maisons plus belles et plus ornées que ces fondiques. Après cette visite nous nous approchâmes
de la mer où il y avait un grand tumulte autour de marchands qui chargeaient des aromates dans des sacs.
Toutes les fois qu’on transporte ces aromates, à dos de chameaux, des fondiques au port, des douaniers
placés sur le bord de mer vident les sacs pour s’assurer qu’il n’y a rien de précieux caché avec les aromates.
Pendant ce travail, des pauvres et des indigents en grand nombre accourent pour recueillir à la dérobée ce
qui tombe des mains des chargeurs et s’en vont ensuite se placer le long d’une rue pour le vendre.
Le 30 octobre, deux galiotes vénitiennes venant d’Afrique, galiotes qu’on appelle de Thrace, abordèrent à
Alexandrie pour charger les substances aromatiques comme quatre autres déjà prêtes. Ce même jour nous
commençâmes à traiter avec les patrons des galiotes pour notre retour et, sans contredit, assurément ils se
montrèrent plus durs que les sarrasins. Sachant qu’il nous fallait partir avec eux, ils exigeaient un passage
extraordinaire. Aussi arriva-t-il qu’il se forma différents groupes parmi les pèlerins, les uns s’entendirent avec
un patron, d’autres avec un autre et s’arrangèrent seuls. Pour nous nous préférâmes être sur la galiote du
maître capitaine et du consul des Vénitiens dont le patron était maître Sébastien Contireni ; le Seigneur
Jean, archidiacre de Transylvanie hongrois et le frère Félix de l’ordre des Prêcheurs, lecteur à Ulm, étaient
avec nous. Le contrat conclu, nous séjournâmes encore plusieurs jours à Alexandrie forcés et bien malgré
nous, attendant le départ des galiotes. C’est pendant ce temps que mourut, comme je l’ai dit, le Seigneur de
Solms. Nous lui fîmes les funérailles qu’il convenait, et nous le pleurâmes tous beaucoup. (p. 77) Il trépassa
dans la nuit même qui précédait la fête de tous les Saints. Après sa mort, nous montâmes, sur la galiote où
nous avions pris passage, ne rentrant plus à Alexandrie, du moins pour séjourner ; nous dormions à bord et
prenions nos repas avec le patron. Nous espérions en effet, qu’en montant à bord huit ou dix jours avant le
départ des galiotes, nous pourrions nous embarquer sans être aperçus. Nous apportâmes donc nos effets
peu à peu et par parties évitant d’attirer l’attention. À chaque douane et pour chaque personne et effet les
sarrasins exigent un impôt de dix pour cent. Or, il y a trois bureaux de douane entre la mer et la ville ; le
premier près de la porte basse qui conduit à la ville, le second non loin du premier près de la porte
extérieure qui conduit à la mer le long des remparts et le troisième sur le bord de la mer. À chaque poste, les
officiers du sultan examinent avec soin le monde, entrant comme sortant et surtout les marchands et leurs
marchandises. Grâce au trucheman d’Alexandrie à qui j’avançais bon nombre de ducats, j’obtins que mes
effets passeraient sans être visités.
Le 3 novembre, sur l’ordre du Capitan notre galiote fut menée au large le long du fort neuf, puis tous les
vaisseaux ayant terminé leurs préparatifs et tous nos compagnons de pèlerinage qui restaient encore en
ville ayant gagné leurs embarcations respectives, on se groupa à un signal parti de notre galiote amarrée
près du fort neuf. Cette forteresse est assurément belle, puissante ; elle ferme le port et le défend.
Malheureusement ce port est plein d’écueils ; au milieu de ces écueils on a construit un mur de défense
garni de tours qui va jusqu’à la mer et c’est à l’extrémité de ces écueils et de ce mur que s’élève le fort dont
j’ai parlé. Il a été construit par le sultan actuel d’après les plans et par les soins d’un certain mammeluk
allemand natif d’Oppenheim, diocèse de Mayence. Depuis longtemps ce dernier a laissé le paganisme pour
revenir au sein de la Sainte Mère l’Eglise et il (p. 78) possède d’immenses richesses. Aucun navire ne peut
passer sans faire le salut au sultan ; et il lui faut ramener ses voiles. Comme nous dûmes stationner quinze
jours à cet endroit attendant à chaque instant le départ des galiotes, les heures nous parurent bien longues
et l’ennui bien lourd. Pendant ce temps les patrons des navires eurent à subir pas mal de vexations, et
supporter bien des dommages ; un d’entre eux fut même gravement blessé par les sarrasins qui ne nous
quittèrent qu’au large. Il y avait aussi désaccord entre les patrons, les uns voulant partir, les autres voulant
rester encore et si le maître Capitan ne s’était interposé comme médiateur, ils se seraient séparés. Il résista
en effet et défendit qu’on partît sans que tous sans exception fussent prêts.
Donc le 15 novembre tout étant disposé pour le départ, au souffle d’un bon vent les vaisseaux laissant leurs
amarres, les ancres sont levées, les voiles déployées, et nous sortons du port laissant derrière nous
Alexandrie. Bientôt le rivage se dérobe à notre vue et le lendemain matin nous n’apercevions plus aucune
terre, partout c’était la mer comme horizon. »
262 Fuchs, R., « Breidenbach, Bernhard von », NDB 2, Berlin, 1955, p. 571.
263 Fuste est une sorte de bâtiment long et de bas bord qui va à voiles et à rames. Grip est un petit bâtiment
pour aller en course. Note de F. Larrivaz.
264 Noisettes.
- 152 - 155 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PAUL WALTHER (du 24 octobre au 9 novembre 1483)
Walther, P., Itinerarium in Terra Sancta, par M. Sollweck, Tubingen, 1892.
p. 239-250 :
« De Rosette à Alexandrie
Enfin, vers neuf heures, nous arrivâmes au port du Nil, et là nous déchargeâmes tous nos bagages du
bateau sur le rivage. Le matelot, un affreux païen, garda diverses choses des seigneurs pèlerins refusant de
les rendre, si on ne lui donnait pas un second salaire pour les bagages disant : “Mais je n’ai reçu que le prix
des personnes que j’ai conduit, et non pas les bagages”. Le traître ! après avoir discuté longtemps, il fallut
finalement lui donner cinq médines, pour qu’il décharge les bagages du bateau.
De cette heure jusqu’à 10 heures, les seigneurs (pèlerins) eurent beaucoup de mal à trouver les chameaux ;
et, ayant fait un marché pour nous conduire jusqu’à Alexandrie, les Arabes se jetèrent sur nos bagages,
chacun voulant avoir sa part et la porter sur son chameau ; ils se frappèrent les uns les autres, et nous nous
trouvâmes à nouveau dans un plus grand péril.
La paix revenue, nous reprîmes notre route. Dans le port il n’y avait pas assez d’ânes pour nous porter tous,
il fallut donc aller à pied, comtes et hommes, avec beaucoup de fatigue, sans manger ni boire, pendant trois
milles allemands.
Vers deux heures de l’après-midi, nous croisâmes sur la route, un groupe d’au moins soixante chameaux du
seigneur le Soldan, dont les serviteurs dirent qu’ils avaient le droit de conduire les bagages des pèlerins ; ils
se ruèrent avec fureur sur nos chameaux, en déchargèrent les bagages, et s’entre frappèrent à nouveau ; ce
nouveau danger était pire que le précédent.
À la fin, pour avoir la paix, les seigneurs pèlerins donnèrent un demi-ducat aux serviteurs du Soldan ; ainsi
ils s’en allèrent, et ayant rechargé nos premiers chameaux, nous marchâmes en paix jusqu’à Alexandrie.
Nous étions à un mille de la ville, quand le seigneur Vernadus, comte, voulut que je montasse sur un
chameau qui me conduisit pour un médine. Étant monté et ayant parcouru douze pas, l’Arabe me demanda
lui aussi un médine, je lui dis que le seigneur le lui donnerait près de la porte. Toutefois, il ne voulut pas
attendre, mais l’avoir aussitôt ; comme je ne l’avais pas, et que le seigneur était en avant, il fit s’agenouiller
le chameau et je dus descendre, sans pouvoir me consoler. De plus, le chemin que je n’avais pas fait, entre
ma montée et ma descente du chameau, il me fallut le refaire avec beaucoup de fatigue en courant derrière
les autres.
Aux portes d’Alexandrie
Vers le coucher du soleil, nous arrivâmes au pied des portes d’Alexandrie, et là, ils nous enfermèrent entre
la porte qui était derrière nous, et celle qui était devant nous. Là, nous ne pûmes acheter que du pain et des
dattes, et nous restâmes captifs toute la nuit.
Douane d’Alexandrie
Au matin au 6e jour avant la saint Simon et Jude265, les portes s’ouvrirent, et des chameaux entrèrent, plus
de 150, chargés de diverses marchandises. Après leur passage, les douaniers qui demeurent en
permanence à ces portes commencèrent à s’occuper des pèlerins.
Ils appelèrent d’abord les personnes, l’une après l’autre, à l’intérieur des portes ; ils les dévêtirent de leurs
habits de dessus, et les fouillèrent soigneusement, de la tête jusqu’à l’anus, pour trouver des ducats et de
l’or ; ils ne prélèvent rien sur les autres monnaies.
Ayant fouillé ainsi chacun de fond en comble, des serviteurs sortirent pour vérifier les bagages, ils les
ouvrirent et cherchèrent soigneusement. Ils prirent tout ce qu’ils trouvèrent de marchandises et d’or, et ne
consentirent à ne le rendre qu’après avoir payer des droits. Mais nous, les frères mineurs, ils nous laissèrent
passer librement, sans fouiller nos affaires ni rien en retenir.
Les fondiques
Après être tous entrés dans la ville, ils nous conduisirent avec nos bagages au fondique, c’est-à-dire à la
maison des Catalans, ou marchands de Catalogne. Là, chaque groupe ayant reçu un point de station et des
chambres, je pris une collation, et j’allai avec mon compagnon au fondique des Vénitiens. Je me dirigeai
vers le consul, c’est-à-dire le maître de tous les marchands vénitiens, pour lui demander humblement que sa
magnificence veuille bien, avec miséricorde, faire l’aumône aux pauvres frères de Terre Sainte que nous
étions, autant ici que pour le voyage en mer jusqu’à Venise. Il répondit avec bonté, disant “Mes frères, nous
devons pourvoir à toutes vos demandes. Aussi vous recevrai-je volontiers chez moi, et vous prendrez vos
repas chez moi. Je vous trouverai aussi un bateau”. Nous accueillîmes ces paroles humblement, d’un coeur
reconnaissant. Ce jour même, nous entrâmes au fondique avec nos bagages. Nous demeurâmes dans la
maison du consul, dans la chambre de son chapelain, et, grâce à Dieu, nous fûmes bien fournis de toutes
sortes de victuailles.
La ville d’Alexandrie
Item Alexandrie est une assez grande cité qui est pourvue de hautes et fortes murailles avec de nombreuses
tours de défenses très grosses, des portes très fortes et riches, de belles mosquées avec des minarets de
très haute taille qui rendent la cité très belle . Mais au-dedans, la ville est détruite et désolée, et chaque jour
une maison s’effondre sur une autre maison, de sorte que le centre de la ville est inhabité et désert. S’il n’y
avait pas là les marchands venus d’autres pays, à ce qu’on m’a dit, en trois ou quatre ans, il n’y aurait plus
une seule maison intacte. Personne n’y construit plus rien.
À Alexandrie, il y a quatre maisons de marchands chrétiens catholiques : les Vénitiens ont deux maisons, les
seigneurs Génois une maison, et les seigneurs Catalans une maison. Dans ces maisons demeurent, de
façon continue, sans compter les serviteurs, 150 marchands qui travaillent dans des marchandises variées,
apportées de diverses parties du monde, autant d’Orient que d’Occident.
Autruches
Dans le plus grand fondique des Vénitiens, quatre autruches sont gardées habituellement dans la cour ; là
j’ai pu constater que l’autruche avale du fer. En effet, en présence de mon compagnon, j’ai donné un assez
gros clou, de la taille d’un doigt ; l’autruche l’a aussitôt englouti, regardant mes mains pour voir si j’en avais
d’autre !
Porc
Dans cette même cour, on nourrit un porc, qui tourne autour de la cour. Les Sarrasins et les Juifs ne
mangent pas de viande de porc et n’ont pas l’habitude d’avoir des porcs sur leurs terres, donc peu ont déjà
vu un porc et savent ce qu’est cette bête, ainsi, les personnes qui entraient dans la ville d’Alexandrie
venaient à cette cour pour voir ce porc. Quelques-uns avaient peur de lui et n’osaient s’en approcher, ils
crachaient vers sa direction. Quelquefois le porc courait vers eux en grognant, et tous fuyaient en criant et
en le maudissant. J’ai souvent vu le porc courir après les Sarrasins et les Juifs, en grand nombre, et cela m’a
fait le plus grand plaisir.
Animaux étranges
Dans cette même cour, les marchands nourrissent plusieurs singes, babouins, guenons, oiseaux de diverses
espèces, et un grand nombre d’autres curiosités ; il en est de même dans les autres cours des marchands.
Dans la ville, entre les habitants, ils s’arrêtent pour voir de semblables animaux, lions, ours, singes, guenons
et beaucoup d’oiseaux extraordinaires.
Noisettes
À l’époque où j’étais à Alexandrie, c’est-à-dire l’année 1483, il vint un marchand du royaume de Naples avec
un grand navire, que j’ai vu de mes yeux, portant pour tout chargement des noisettes pour mille ducats. Ses
serviteurs, dont certains étaient Allemands, me dirent que leur maître les vendrait bien pour quatre mille
ducats. Ils ajoutèrent : si quelqu’un avait une même charge de noix de plus grande taille, il les vendrait
aussitôt pour huit mille ducats
Les églises
À Alexandrie, il y a quatre églises des chrétiens entre les mains des Grecs. L’une est en l’honneur de saint
Marc l’évangéliste, qui fut ici le premier évêque ; elle fut jadis une église cathédrale, mais elle est très exiguë
et petite. Une autre est l’église Saint-Michel ; c’est là qu’on enterre les chrétiens catholiques, aussi bien les
pèlerins que les marchands. Nous sommes allés dans ces deux églises. Une troisième est l’église de l’abbé
saint Saba ; c’est là, dit-on, qu’il y a un portrait reproduisant la forme et l’aspect de la bienheureuse Vierge,
que Saint Luc aurait peint, mais nous n’y avons pas été admis et nous l’avons pas vu. La quatrième église
est celle de Sainte-Catherine, où nous ne sommes pas non plus entrés.
D’autre part dans les cours des marchands, il y a de bonnes chapelles très convenables, avec chacune un
chapelain, qui dit l’office selon la mode de la cour romaine ; c’est là que les marchands entendent l’office
divin.
Item, à Alexandrie est l’endroit où la bienheureuse Catherine fut martyrisée, et à l’extérieur de la porte, au
sud, se dresse une colonne, c’est là, disent certains, qu’elle a été décapitée. Nous n’avons pas vu ce lieu,
parce que des Maures ont leur cimetière, et ne permettent pas à des chrétiens de s’y rendre.
À l’intérieur de la ville, dans une rue publique, se dressent de hautes colonnes, sur lesquelles fut posée une
roue à rayons ; le seigneur la détruisit d’un éclair en sa toute puissance. Nous y sommes allés et nous les
avons touchés.
Près de là est un lieu, qui est une prison où sainte Catherine fut enfermée ; c’est là que la reine lui rendit
visite ; nous y avons été aussi.
Obélisque
À Alexandrie encore, pratiquement à l’extrémité de la ville, se trouve debout une merveilleuse colonne, qu’on
appelle « aiguille », comme celle de Rome, qui est d’une merveilleuse longueur. Des écussons des anciens
païens y sont sculptés.
Captifs chrétiens
Item, le second jour, qui était la veille de saint Simon et Jude266, une petite nave arriva de Cilicie avec des
matelots chrétiens. Apprenant la nouvelle, les païens barbares qui étaient à Alexandrie, sortirent à leur
rencontre avec des bâtons ; ils les prirent, les dépouillèrent et les déshabillèrent. Ils amenèrent ces chrétiens
à Alexandrie avec des chaînes attachées à leur cou en les traînant misérablement à travers toute la
populace dans un grand désordre et vacarme. Ils les enfermèrent en prison dans la joie et en faisant la fête.
Item le quatrième jour [29 octobre] arriva une autre nave de Gênes, avec plusieurs chrétiens. Ils allèrent de
même à leur rencontre, les prirent et les dépouillèrent. Les uns liés aux autres par le cou à des chaînes et
menés au milieu d’un grand désordre, le corps nu, je les vis entrer tous dans la ville. Tous ces malheureux
resteront liés à ces chaînes toute leur vie, ils seront esclaves et travailleront pour les païens, et ils seront
sustentés de nourriture et de boisson comme des chiens, à moins qu’ils soient rachetés à grand prix par leur
pays.
Maladie et mort de Jean de Solms
Item, le jour de la saint Simon et Jude267, le généreux seigneur Jean comte de Solms commença à souffrir
du ventre, avec un flux mêlé de sang, et la veille de la Toussaint268, vers 4 heures, il me fit appeler. Étant
venu et l’ayant vu, je lui conseillai de me confier ses péchés, disant : « J’espère que le Seigneur vous
donnera la grâce de retrouver la santé, parce que la maladie de l’âme est assez souvent la cause de la
maladie du corps ». Il accepta de plein gré, et demanda la confession avec humilité, et il raconta sa vie en
confession alors, avec raison et de façon parfaite.
Ayant achevé de se confesser, je l’interrogeai sur sa maladie, lui demandant de me dire la vérité sur son
mal. Il dit : « Je ne ressens de douleur ni à la tête, ni à la poitrine, mais je ressens un malaise seulement au
ventre, sous le nombril ; j’espère seulement que je vais aller mieux ». Je lui disais : « Généreux seigneur !
Puisque vous avez fait votre confession, et par la grâce de Dieu, vous avez maintenant pris vos dispositions
pour ce qui concerne votre âme, disposez aussi et mettez ordre à votre testament, aussi bien ici qu’ailleurs
dans votre domaine. Cela est de toute nécessité ! ». Il répondit : « Volontiers, et je me souviendrai des pères
du mont Sion » ; et il ajouta : « Allez et appelez-moi le seigneur Bernard de Breydenbach et le seigneur
Philippe de Bichen ! ». Je me levai aussitôt et je le quittai. J’allai les retrouver pour leur exposer son
intention ; ces derniers vinrent le trouver sans tarder. Mais ils ressortirent aussitôt et je ne sais pas ce qu’ils
firent ; rien n’apparut cependant qui ressemble à la préparation d’un testament. Je crois pourtant que peutêtre
en raison d’une amélioration de son état, ils avaient remis ce soin au lendemain. Et comme je voulais
rentrer à mon hôtel, ces dits seigneurs et leurs serviteurs me demandèrent de rester ou de revenir avec mon
compagnon et de rester avec eux, ce que nous fîmes. Au retour, nous les trouvâmes de bonne humeur en
train de manger et le seigneur couché dans son lit se portait bien. Finalement chacun se mit à sa place,
dans sa chambre, et je me trouvais le plus proche de lui. Jean, le cuisinier, et le serviteur Eckhart voulurent
prendre la première veille tandis que moi-même et mon compagnon prirent la seconde.
Vers neuf heures, il commença à se remuer avec une certaine agitation ; nous nous levâmes tous aussitôt
pour l’exhorter très fidèlement dans la foi catholique et à la passion du Christ. Lui cependant répondait
toujours avec dévotion et avec toute sa raison, disant qu’il voulait demeurer fermement dans la foi comme
un bon chrétien. Vers dix heures, il perdit la parole, mais garda conscience jusqu’à la fin. Puis il se fatigua
avec d’abondantes sueurs, les mains et les pieds glacés. Vers onze heures, il commença à rendre
abondamment des éléments noirs ; et nous l’exhortions vigoureusement à nouveau dans la foi et par la
Passion du Christ, je lui demandai alors un signe : il me regarda et remua sa tête. Puis je commençai à dire
le « Profiscere » et d’autres prières qu’ordonne la sainte mère l’église à propos des mourants. Je lui donnai
un cierge dans sa main, j’attirai à nouveau son attention, et à nouveau il comprit et déplaça sa tête. Alors je
commençai aussitôt à dire le psaume : In te Domine speravi, avec Gloria Patria, et enfin jusqu’au vers : In
manus tuas commendo spiritum meum Gloire soit rendue au père… Heureusement, sans qu’il fit aucun
geste, sa sainte âme quitta son corps et partit au paradis céleste ou sans aucun doute au purgatoire des
saintes âmes. En fait, nous ne pouvions pas lui donner d’autres sacrements ; à cause de ses vomissements,
il ne pouvait prendre le sacrement de l’Eucharistie, et l’autre élément de l’extrême-onction, nous ne pouvions
l’avoir. Mais il n’est pas douteux qu’il a pleinement reçu le bénéfice des sacrements en présence de Dieu ;
car au cours de ce pèlerinage, lui-même avait fait auparavant par deux fois une brève confession et avait
communié une fois à Jérusalem et une fois à Sainte-Catherine. De tous les pèlerins, il n’y en avait aucun si
désireux d’entendre la messe, d’être aspergé d’eau bénite et de sel béni, et bien plus même, il frappa
souvent à ma porte pour me demander de bénir le vin pour l’amour de saint Jean, ce que je fit.
Item, le lendemain, fête de la Toussaint, les seigneurs susnommés organisèrent pour lui une sépulture
honorable et pieuse à l’église de Saint-Michel ; là les prêtres et les pèlerins étant réunis, la messe fut
prononcée, les répons furent chantés avec les autres prières, et il fut porté dévotement à la tombe qui avait
été préparée à l’arrière de l’église, près du mur. Ainsi sa sainte âme, sans doute, ainsi qu’il faut le croire
pieusement, selon tous les indices, fut conduite par l’ange Michel au paradis céleste ou au purgatoire des
âmes saintes. Ainsi ce saint corps fut digne d’être enseveli dans l’église de Saint-Michel où il repose
maintenant en paix.
Santons
Item, dans cette rue et dans d’autres, j’ai vu certaines personnes, les plus misérables qui se puissent
imaginer, être totalement nues, sexe inclus, se promenant dans la foule. J’ai été fort étonné et j’ai interrogé
avec insistance pour savoir qui ils étaient. De la bouche de nombreux chrétiens dignes de foi et de Juifs
avisés, j’ai entendu dire que c’étaient des religieux, ou des saints sarrasins, qui ne possédaient rien qui leur
appartînt, mais allaient ici et là, quémandant leur subsistance dans diverses maisons.
Ils sont de deux genres : les uns sont considérés comme saints et hommes de religion par les Sarrasins ; ce
furent de grands ribauds ; et plus grands sont les forfaits qu’ils ont accomplis avant de se convertir dans la
religion, d’autant plus saints ils les considèrent.
Les autres sont dits saints, parce qu’ils ont été conçus dans le ventre de leur mère pendant le pèlerinage à
La Mecque ; à leur naissance, on les tient pour saints. C’est pour cela que les épouses s’efforcent autant
qu’elles le peuvent de s’unir à leurs maris pendant le pèlerinage, pour qu’elles puissent mettre au monde un
homme saint comme Mahomet.
De tels hommes commencent à rejeter toute pudeur, à se promener tout nu, disant qu’ils ont retrouvé
l’innocence des enfants, qui ne rougissent pas, comme dans leur première innocence naturelle. On dit de
ces saints qu’ils ont la liberté d’entrer dans les maisons des épouses des Sarrasins et d’y commettre des
forfaits sans nombre : je les ai vu moi-même marcher dans les rues sans aucune honte.
Item, le jour de la saint Léonard269, après le déjeuner, je décidai avec mon compagnon de sortir et de rendre
visite au patron et à son bateau sur lequel nous allions naviguer ; arrivés à la partie extérieure de la ville,
nous trouvâmes le patron qui nous adressa aimablement la parole disant : « Mes pères ! je vous emmènerai
volontiers et vous procurerai aussi bien la nourriture qu’un bon emplacement sur mon bateau. Priez
seulement Dieu pour moi ! ».
Mésaventure au Port Neuf
Ensuite nous allâmes jusqu’au rivage de la mer, mais nous ne pûmes monter sur la galée. Mon compagnon
me dit alors : « Allons voir le château neuf », qui avait été fait huit ans plus tôt par un renégat. Ayant fait ce
château très beau et très puissant, au bord du port de mer, avec des tours et de solides défenses, ce maître
recueillit une grande fortune, puis il revint au sein de la sainte Mère l’Église Catholique. Mon compagnon
voulut à tout prix voir ce château ; je tentai vivement de l’en dissuader. Il me répondit avec colère : « Allons !
moi je sais parler aux Maures ; ils ne nous feront rien ! » Nous allâmes donc le long du rivage de la mer
jusqu’à une large avenue qui mène au château. Au bord de la route apparurent une mosquée et des tombes
des Sarrasins. Voyant cela, je dis à nouveau à mon compagnon : « Il n’est pas permis d’aller plus loin parce
qu’il y a ici des tombes de Maures ». Mais lui ne voulut pas s’arrêter. Je lui dis encore : « Soyez en sûr, nous
le regretterons ! ». Il n’en eut cure et marcha un peu devant moi ; moi je suivais en grognant. Vint alors un
Éthiopien noir, qui ramassa de grosses pierres sur son bras ; courant à toute vitesse contre mon compagnon
comme un chien enragé, il le cribla de pierres et l’atteignit avec une grosse pierre au flanc, à une côte ; puis
une seconde fois tout de suite après au haut de la cuisse.
Alors mon compagnon commença à riposter tandis que le Maure appelait d’autres Maures. Comme l’un
d’eux accourait, je m’enfuis et criai à mon compagnon : « Sauve-toi ! sauve-toi vite ! tu ne gagneras rien,
mais tu les excites davantage contre nous ». À nouveau, l’Éthiopien avait lancé une grosse pierre à la tête
de mon compagnon ; s’il n’avait détourné le coup avec ses mains, je crois qu’il serait mort sur l’heure. Il se
mit aussitôt à fuir derrière moi et avec un visage exsangue, complètement fou, il commença à se plaindre et
à être malade de sa blessure au flanc et à la côte, au point que le médecin et moi-même craignons qu’il ne
meurt cette nuit-là ; il prit la précaution de se confesser pour la dernière fois et resta malade plusieurs jours.
Départ d’Alexandrie
Item, le neuf novembre, qui était un dimanche, ayant dit l’office, pris notre déjeuner et fait nos adieux à notre
hôte généreux, le seigneur consul Andrea de Capriel, ainsi qu’à nos amis, nous quittâmes le fondique avec
un âne portant nos bagages.
Douane de la sortie
Quand nous arrivâmes à la première porte de la ville, les Maures commencèrent à nous retenir en exigeant
de nous un demi-ducat ; à la fin, cependant, ils reçurent un médine. Mais à la seconde porte, à nouveau, un
autre se jeta sur nous et nous retint longtemps ; finalement il nous laissa aller lui aussi pour un médine.
Arrivant sur le rivage, une fois de plus, d’autres Maures vinrent en courant vers nous, précipitèrent avec
fureur nos bagages à terre, et réclamèrent un ducat et demi. Là nous discutâmes longtemps ; à la fin ils
reçurent deux médines et nous laissèrent aller ; ceux-là, c’est un marchand qui les paya.
À bord
C’est ainsi, avec bien de la peine, que nous montâmes sur la galée de Maître Marcus de Lardano. Le patron
nous attribua une bonne place sur la galée où nous fûmes tranquilles, car la galée était chargée à l’extrême,
si l’on compare à d’autres galées encombrées de nombreux marchands et de marchandises.
Sur cette galée nous fûmes tous quasi prisonniers jusqu’au 14 de ce mois, c’est-à-dire pendant cinq jours.
Car les Maures retinrent un patron de galée de commerce et les autres galées n’osaient partir sans avoir
toutes reçu des Maures le congé et le droit de partir. Certains disaient que finalement les Maures avaient
retenu ce patron et l’avaient mis en prison jusqu’à ce qu’il s’acquitte des dettes qu’il avait contractées.
Certains dirent que le capitaine en charge des galées avait nommé un autre patron de cette galée. Etait-ce
vrai, je ne sais pas. Nous étions tous en grand danger et craignions que les Maures ne saisissent l’occasion
pour s’en prendre à l’ensemble des galées et nous retenir.
Départ en mer
Item, le 14 novembre, nous commençâmes à naviguer à la rame car le vent n’était pas favorable. Le
lendemain, c’est-à-dire le samedi suivant la saint Martin270, le seigneur, dans sa grâce spéciale à notre
égard, nous donna un vent très fort qui se maintint jusqu’au quatrième jour c’est-à-dire cinq jours durant.
Pendant ces cinq jours, nous parcourûmes dans de très bonnes conditions tout le chemin de mer jusqu’à
Candie, distance que parfois les marins mettent vingt jours à franchir. »271
- 156 - 160 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FÉLIX FABRI (du 23 octobre au 14 novembre 1483)
Fabri, F., Voyage en Égypte de Félix Fabri, 1483, par J. Masson, Ifao, Le Caire 1975.272
Le frère Félix Schmidt naît à Zurich vers 1434-35 et meurt en 1502. Ce prédicateur faisant partie de l'ordre
des frères prêcheurs latinise son nom en Fabri. Il accomplit deux pèlerinages ; le premier, d’avril à novembre
1480, et le second, d’avril 1483 à janvier 1484. Lors de ce second voyage, présenté ici, il accompagne
Johann Truchsess avec une douzaine de nobles allemands. Après avoir visité la Terre sainte, il se rend au
Sinaï dans le couvent de Sainte-Catherine, puis passe par le Caire avant d’atteindre Alexandrie.273
p. [655]-[726] (tome II) :
Entrée des pèlerins a Alexandrie, comment ils furent retenus enfermés et captifs entre les portes et
maltraités et ennuyés.
« Nous traversâmes la plaine de sel en grande hâte, de façon à parvenir plus rapidement à Alexandrie pour
y manger et boire quelque chose. Ayant pénétré par une saillie les hauteurs qui nous faisaient face, nous
parvînmes, par une voie encaissée jusqu’à la fin de ces hauteurs. Nous aperçûmes là de grandes et très
anciennes ruines de murailles qui s’étendaient en long et en large et qui nous disaient qu’autrefois s’était
dressée là l’antique Alexandrie. Nous aperçûmes également devant nous la glorieuse cité d’Alexandrie,
entourée pour une grande partie par la mer et bordée pour une autre partie de jardins et vergers merveilleux,
parmi lesquels se dressaient des palmiers si élevés et si nombreux, qu’on eût dit une forêt de pins. La terre
près d’Alexandrie est, grâce au Nil, d’une rare fécondité, et tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie
humaine s’y trouve, comme on le verra, en abondance.
Le délicat accueil d’Alexandrie
Tout en progressant, alors que déjà nous approchions de la ville, nos chameliers et âniers, indignés, nous
obligèrent à descendre de chameau et d’âne, déclarant qu’il était contre le droit de cette noble cité qu’un
Chrétien y pénètre assis sur un chameau, un cheval ou un âne. Nous marchâmes donc avec les bêtes vers
la porte de la ville qui était en face de nous, et la plus proche, mais lorsque les gardiens des portes nous
aperçûrent, ils se précipitèrent sur nous avec des bâtons et des fouets, fermant la porte derrière eux et
déclarant que cette porte était ouverte pour les indigènes, les Sarrasins notables et les ministres de
Mahomet, et en aucune façon, pour les chiens et les dévots du Christ. Ils déclaraient donc à nos chameliers
qu’ils devaient nous conduire en suivant les fossés jusqu’à l’autre porte de la ville, là où les étrangers sont
visés et examinés afin de savoir s’ils sont dignes ou non d’être introduits. Nous fîmes donc par un long
chemin le tour de la ville, anxieux et tristes, sachant qu’à nouveau nous aurions à souffrir et à être maltraités.
Quelques jeunes Sarrasins qui se livraient ensemble à leurs jeux d’enfants devant la première porte,
abandonnèrent leurs jeux en nous voyant, et, courant après nous en se moquant, se mirent à nous jeter des
pierres. Tandis que nous les chassions à notre tour avec des pierres, ils se mirent à nous bombarder avec
force de leurs frondes, nous obligeant à regarder, non où nous mettions les pieds, mais en l’air, pour éviter
les jets de pierres. D’autres encore, courant sur les remparts de la ville, nous insultaient du haut de la
muraille, nous envoyant une pluie de pierres. Jamais encore nous n’avions été aussi mal accueillis, comme
nous le fûmes à Alexandrie. Nous dûmes tourner longtemps, avec une telle fatigue et nous trouvant dans un
tel état d’épuisement que nous ne pouvions presque plus marcher, épuisés d’inanition et souffrant de mille
manières.
Nous arrivâmes pourtant, enfin, à une porte, large, haute, flanquée de tours, de défenses étonnantes, et
munie de verrous de fer. D’une porte à l’autre, elle formait une quadruple entrée, et la porte antérieure était
de fer comme celle de l’intérieur. Il y avait aussi entre les deux portes, au-dessus d’un fossé, une passerelle
mobile qui pouvait être enlevée. Devant la porte se tenait un percepteur avec un fouet ; il n’exigea qu’un
léger impôt pour nos bêtes, mais sans violence ; il n’exigea rien de nous, nous réservant à d’autres. L’impôt
payé nous passâmes la première porte par la passerelle, avec joie, pensant, pour avoir contenté le premier,
avoir échappé à la main des percepteurs. Le soleil s’était déjà couché, nous pensions que les percepteurs
n’étaient donc plus là, et que nous pourrions ainsi entrer en cachette dans la ville. Nous avions en effet,
durant tout notre voyage, entendu dire des choses terribles à propos des percepteurs préposés aux portes
d’Alexandrie.
La double enceinte d’Alexandrie
La passerelle du fossé franchie, nous parvînmes à une grande porte de fer, près de laquelle des Sarrasins
montaient la garde, en armes. Ils ne nous disaient rien, ni en bien ni en mal, ils ne nous interdisaient pas
l’entrée, au contraire ils nous enjoignirent tous ensemble de pénétrer au-dedans, puis, une fois que tous
ceux de notre groupe furent entrés, ils fermèrent la porte, et une fois fermée ils nous ordonnèrent de
poursuivre notre chemin. Après cette porte, il y a une voie incurvée entre de très hautes murailles et des
tours, qui conduit jusqu’à la porte de fer de l’intérieur qui ouvre sur la ville. Lorsque nous y parvînmes, nous
y trouvâmes de nombreux hommes d’armes, et comme nous voulions entrer, ils nous repoussèrent avec des
bâtons et des fouets ; puis, ayant fermé les portes derrière eux, ils nous ordonnèrent de décharger les bêtes.
Une fois les bagages déposés, ils rouvrirent la porte extérieure, firent sortir nos chameliers avec les
chameaux, les âniers avec les ânes, et tous les autres, sauf les pèlerins et Halliu le substitut du Trucheman ;
et ils nous enfermèrent entre les deux portes de fer avec nos affaires en nous déclarant que le lendemain,
une fois nos affaires examinées et l’impôt payé, on nous laisserait entrer.
Campement entre les deux enceintes d’Alexandrie
Nous étions donc ainsi enfermés par des portes de fer, des verrous et des chaînes de fer, et des murs très
hauts. Me revint alors à l’esprit la cité inhumaine de dieux infernaux dont Virgile a dépeint toute l’horreur en
vers nombreux, à laquelle les poètes ont attribué Pluton pour roi, elle qui avait pour gardien le chien à trois
têtes, Cerbère, qui dévorait tout avec une voracité inouïe, et qu’on disait à trois têtes parce qu’il était bruyant
par ses aboiements, habitué à mordre à tout propos, et infatigable quand il vous saisissait. Ce chien ne
laissait entrer rien de bon ni de juste, d’où le vers : « Les lois divines interdisent à l’homme pur de franchir ce
seuil de scélératesse ».
Nous craignions très fort ce chien dont la voracité signifie la cupidité, et, l’habitude de mordre, la colère.
Nous savions que nous n’étions enfermés pour aucune autre raison que celle de la cupidité des Sarrasins
qui nous déchirerait.
Puisque nous étions enfermés de toutes parts, nous mîmes un peu d’ordre dans nos affaires, mais notre
épuisement se rappelait à nous, et nous nous sentions tomber d’inanition. Or, nous ne pouvions réussir à
avaler les pains que nous avions tirés de nos sacs, ni même les casser avec nos dents, car nous n’avions
pas d’eau à boire. Poussés par la nécessité, nous allâmes jusqu’à la porte intérieure qui mène à la ville et à
coups de pierres, nous frappâmes de toutes nos forces. Le premier qui accourut fut ce chien funeste d’Halliu
qui était avec nous et qui nous reprocha avec véhémence le bruit que nous faisions, mais nous n’en tînmes
pas compte. Nous avions espoir dans l’humanité de ces Alexandrins, et qu’ils ne nous laisseraient pas
tomber d’épuisement ce qui n’aurait pas tardé à se passer. Aux coups donnés, accoururent quelques
personnes qui habitaient près de la porte et qui s’informèrent de la raison de ces coups. Nous le leur
expliquâmes et leur fîmes passer quelques madins par l’espace qui existait entre les battants de la porte et
le sol ou le seuil, leur demandant de nous apporter de l’eau et du pain. L’espace entre le seuil et les battants
était en effet tel que nous pûmes faire passer des amphores et des fiasques. Ayant accepté l’argent et les
amphores, ces indigènes nous apportèrent des pains, mais chauds, qui venaient d’être pris au four, des
amphores d’eau et une corbeille avec des dattes, fruits des palmiers. Nous nous assîmes donc ; chacun
reçut une part des choses offertes, et nous reprîmes des forces sans être pour autant rassasiés. Nous étions
affamés comme des chiens, altérés comme des cerfs, et par les mets signalés ci-dessus, nous avions plus
excité notre appétit que nous ne l’avions apaisé. Nous étions cependant reconnaissants de la pitié des
indigènes et encore plus reconnaissants pour ce délassement et pour cet endroit de repos.
Nous étions en effet enfermés dans l’endroit le plus sûr, et il était propre. Nous ne pouvions ni sortir, ni
entrer ; personne ne pouvait parvenir jusqu’à nous. Sur la droite pourtant, près de la porte intérieure, une
petite porte avait été laissée ouverte ; elle donnait entrée dans un espace, à l’intérieur, entre la haute
muraille intérieure de la cité, et celle de l’extérieur qui s’élève des fossés. Dans les limites de cet espace
nous pouvions circuler sur une longue distance à l’intérieur de chacun des deux murs, regarder à travers les
meurtrières dans les fossés, et monter au sommet du mur extérieur jusqu’aux créneaux et quelques tours,
ce que je fis. Je crois que l’usage de cet endroit à découvert nous avait été laissé pour nous éviter
d’accomplir nos nécessités dans le passage commun entre les deux portes. La nuit étant déjà venue, nous
prîmes place pour nous reposer et nous dormîmes tranquillement, sans personne pour nous tracasser du
haut des tours ou des murailles, et nous regagnâmes cette nuit-là, en dormant, ce que nous avions perdu
les nuits précédentes sur le Nil, en veillant.
Perquisition des pèlerins à la porte d’Alexandrie et leur entrée dans la ville
Le vingt-quatre Octobre : Préparatifs pour la fouille de la douane
Le 24, au lever du jour, nous regroupâmes nos affaires, et préparâmes sacs et corbeilles, et nos affaires à
l’intérieur, de façon à ce que ceux qui nous fouilleraient ne puissent rien trouver de précieux à la surface de
tous ces bagages. Les pèlerins qui avaient de l’argent se demandèrent comment le faire passer sans que
les percepteurs s’en aperçoivent, et c’est ainsi que l’un d’eux déposa plus de cent ducats dans mon
amphore, amphore que je devais emporter jusqu’en ville ; d’autres en introduisirent dans des pains ; d’autres
dans la doublure de leurs vêtements, dans des endroits insoupçonnables ; d’autres en mirent dans un flacon
dans lequel nous transportions de l’huile ; d’autres dans du beurre ; d’autres dans du fromage ; tous
s’efforçant ainsi d’en cacher de diverses manières, car sur toute chose qui entre ou sort d’Alexandrie, les
percepteurs exigent un dinar croisé d’impôt et de droit de péage. Quant à moi, j’étais libre de ces soucis car
depuis peu je n’avais plus d’argent, les objets précieux d’or et d’argent sous forme d’anneaux, de petites
croix et de médailles que je portais avec moi dans une bourse, je les cachais avec la bourse elle-même dans
un sac de farine d’avoine, l’introduisant dans la farine pour qu’elle ne soit pas trouvée.
Selon la Summa Hostiensis, nous ne commettions pas de péché en cachant nos affaires car nous n’étions
sujets ni des Sarrasins, ni de leurs lois, ni de leurs institutions. Nous ne leur avions rien juré, ni promis, et
cette terre elle-même, qui est nôtre, ils l’occupent par la force sans aucun droit. Nous ne leur devions donc
absolument rien.
Cependant Halliu nous voyant occupés à cacher des affaires nous conseilla d’ouvrir corbeilles et sacs et de
dénouer tout ce qui était lié, car les percepteurs ouvrent et fendent à coups de couteaux tout ce qui est trop
bien fermé ou noué ; et comme nous lui disions que nous étions porteurs d’une lettre de libre passage de la
part du roi Sultan d’Egypte, ce vaurien éclata de rire, nous affirmant que même si le Sultan avait été là
personnellement, nous ne serions pas pour autant entrés dans la ville sans avoir été fouillés. Il nous
conseilla même de cacher cette lettre de peur que les percepteurs n’y trouvent un prétexte de plus pour
nous fouiller de façon plus pointilleuse. Nous dénouâmes donc tout ce qui était lié, et étalâmes tout au grand
jour de façon à ce que la fouille puisse s’accomplir plus rapidement et sans difficultés – sauf bijoux et argent
que nous avions cachés.
Fouille des commerçants
Depuis peu, déjà, le soleil s’était levé, et ceux qui désiraient entrer avec des chameaux chargés, menaient
grand tapage et criaient devant la porte extérieure. Les gardiens des portes arrivèrent enfin avec les
hommes de l’octroi et les percepteurs ; mais en débouchant sur nous, ils déblayèrent le chemin de toutes
nos affaires, et firent entrer les chameaux qui se trouvaient devant la porte. Ils firent baraquer tous les
chameaux, et ayant jeté les sacs à bas ils fouillèrent tout, y compris les chameliers, leurs coreligionnaires, et,
sous nos yeux, ils firent se déshabiller les Sarrasins, Egyptiens et Maures pour chercher s’ils n’introduisaient
pas quelque chose en fraude. Il y avait plus de quatre-vingt-dix chameaux, et il se passa du temps avant que
tout n’ait été inspecté.
Le Trucheman d’Alexandrie
Le Trucheman survint enfin d’Alexandrie ; il se nommait Schambeck ; c’était un personnage imposant, noir,
vigoureux et de haute taille, d’apparence assez emporté, Mamelouk influent, sachant parfaitement parler
l’Italien. Il nous salua cordialement, et embrassa chacun, selon leur coutume, ce en quoi il s’ouvrit le chemin
de nos coeurs et nous mîmes en lui tout notre espoir. Nous lui montrâmes donc la lettre du Sultan ; il fut
d’avis de la montrer aux inspecteurs. Il nous consola également au sujet de la fouille en nous disant qu’il
insisterait auprès de ces Seigneurs afin qu’ils ne nous traitent pas de façon déshonnête. On nous avait dit en
effet qu’on cherchait des pierres précieuses jusque dans les parties secrètes du corps. Néanmoins, il nous
encouragea à nous montrer patients, en nous déclarant que l’on observait dans cette cité, jusqu’à
maintenant, l’antique façon de procéder de la ville d’Athènes. Quiconque voulait pénétrer dans Athènes,
devait se faire insulter en paroles et en actions, par les Anciens, assis à la porte, maltraiter jusqu’à recevoir
même des coups ; les gens patients étaient alors admis, tandis que les impatients étaient repoussés, après
avoir été bien humiliés. Ici, de même. Tous ceux qui entrent sont fouillés et plus particulièrement ceux qui
manifestent leur impatience et qui sont parfois contraints de s’en retourner dépouillés de tout.
Fouille des pèlerins
Lorsque tous les chameaux eurent passé, ces Seigneurs s’assirent près de la porte intérieure, sous la tour
de cette porte. Schambeck prit alors avec lui quelques-uns des pèlerins parmi les plus anciens, et s’étant
introduit avec eux auprès des Seigneurs, il leur présenta la lettre du Seigneur Sultan. Ceux qui reçurent la
lettre l’embrassèrent avec beaucoup de respect et la lurent. Une fois la lettre lue avec soin, quelques-uns
d’entre eux sortirent dans notre direction ; ils soulevèrent tout d’abord sacs et paniers un à un, en estimant le
poids, puis ils se livrèrent à leur enquête sans insister, mais plutôt par manière d’acquit. Ils n’ouvrirent même
pas tout ce qui était lié, mais agirent rapidement. Une fois les bagages inspectés, ils s’assirent sous la porte
et nous appelant l’un après l’autre ils opérèrent la fouille de nos vêtements et de nos bourses, mettant à part
tout ce qui était argent et or. Ils ne déshabillèrent cependant totalement aucun d’entre nous. Lorsque ce fut
mon tour de m’approcher, voyant que j’étais prêtre, ils ne me firent rien ; ils n’ouvrirent même pas la bourse
que je portais ostensiblement à la ceinture, mais ils me laissèrent aller sans me fouiller, comme un pauvre ;
ce qu’en fait, j’étais. Ils firent de même pour les frères mineurs. C’est ainsi que cette tempête se passa dans
la paix. Il me semblait en fait, qu’il leur était aussi pénible de faire leur fouille, que nous-mêmes d’avoir à la
supporter. Puis ils restituèrent son argent à chacun, recevant ensuite l’impôt fixé. Ils réclamèrent pour
chacun des hommes huit madins qu’ils ne perçurent cependant pas de nos religieux et prêtres ; ils ne
prennent en effet aucun impôt du clergé même chrétien.
Nous étions heureux de n’avoir pas été fouillés trop méticuleusement, car nous possédions de nombreux
objets de valeur, en or et en argent, des pierres précieuses, des pièces de soie et du baume, toutes choses
pour lesquelles ils auraient exigé un tribut important. Si nous avions été des commerçants nous n’en serions
pas sortis ainsi ; ils les dépouillent en effet jusqu’à la peau, et ce qui est inhumain, et honteux même à dire,
ils cherchent jusque dans le derrière, dans la bouche et les oreilles, l’or et les pierres précieuses qui
pourraient y être cachés.
Entrée dans une ville en ruines : Alexandrie la Grande !
Notre affaire terminée, Schambeck pénétra dans la ville et nous apporta des chameaux et des ânes, pour
nous et nos affaires. Quant à nous, ayant rassemblé nos bagages, nous chargeâmes les bêtes et
pénétrâmes en ville. De toutes parts nous n’aperçûmes que de misérables ruines ; nous demeurâmes
stupéfaits, nous étonnant que des murailles si solides et si belles n’entourassent qu’une cité tellement en
ruines.
Visite au préfet d’Alexandrie
Par une longue ruelle nous gagnâmes la grande résidence du Seigneur Préfet de la ville, Mamelouk très
puissant, le Trucheman nous conduisant pour une entrevue. C’est en effet la coutume que tous les étrangers
soient tout d’abord présentés personnellement au Préfet. Le Préfet, vieillard vénérable et bien dans son rôle,
sortit en effet nous saluer et nous ayant considérés attentivement un à un, il nous donna licence de gagner
notre résidence. Ce genre d’homme est capable d’un seul coup d’oeil de se faire une idée étonnante d’un
homme ; sur ce point ils sont des juges éminents comme on le verra au folio 121. Ensuite, de ce palais, nous
prîmes encore une longue ruelle et parvînmes à la résidence du roi de Sicile, dans laquelle les commerçants
catalans ont leurs marchandises et leurs chambres ; c’est en effet le fontique des Catalans et l’hospice de
tous les pèlerins chrétiens à moins que par une faveur particulière les Vénitiens et les Génois n’acceptent de
leur donner hospitalité dans leurs fontiques.
Au fontique des Catalans
Entrés avec nos affaires dans le fontique, ou cour de la maison, le Seigneur, patron de la maison, consul de
Catalogne, vint au-devant de nous et nous reçut familièrement ; les siens accoururent même pour nous aider
à décharger nos bêtes. Nous étions heureux au plus haut degré, du fait que nous étions parvenus à
nouveau dans la maison d’un chrétien ; il y avait tellement de jours que nous n’avions pu trouver hospice
chez un chrétien qu’il nous semblait nous trouver dans les frontières de votre pays. Nous priâmes donc le
patron de bien vouloir faire faire pour nous provision de vivres et de boissons, et nous lui expliquâmes notre
faim, notre soif et notre épuisement. Il remonta aussitôt chez lui et nous fit préparer un repas.
Cependant le Trucheman Schambeck nous interdit de ressortir de la maison ce jour-là, nous déclarant qu’il
allait revenir le lendemain et qu’il ferait alors compte de tout avec nous. Nous remerciâmes également Halliu,
le substitut du Trucheman du Caire, et fûmes obligés de donner une bonne somme de madins à cet infidèle,
ce mauvais homme qui ne nous avait été utile en rien, qui, au contraire, n’avait été que le délateur de notre
argent et qu’un protecteur infidèle ; car, pour ne citer qu’une de ses nombreuses infidélités, un chevalier lui
avait confié en secret et de bonne foi, devant la ville d’Alexandrie, une médaille en or de St. Christophe,
craignant l’énormité de l’impôt pour un tel poids d’or ; or lorsque nous fûmes parvenus à la maison, il refusa
de restituer son dépôt au chevalier, tant que celui-ci ne lui aurait pas donné la somme d’argent qu’il lui
réclamait. Si le chevalier voulait récupérer son or, il lui fallait le racheter à un prix supérieur à celui qu’il aurait
dû payer à l’octroi. Ainsi donc ces deux Truchemans, Schambeck et Halliu, quittèrent la maison, et nous,
nous montâmes dans une belle salle à manger et y trouvâmes table prête, et la maîtresse de maison, une
chrétienne, avec toute la domesticité. Nous nous assîmes donc à table et nous eûmes un déjeuner
fastueux ; nous bûmes du vin dans des gobelets d’or et d’argent et nous nous restaurâmes agréablement.
Le déjeuner achevé nous nous mîmes d’accord avec le maître de maison sur le prix à lui fournir pour les
déjeuners et les dîners, aussi longtemps qui puisse se prolonger notre séjour chez lui, et l’accord établi il
nous fit faire le tour de la maison qui était spacieuse et possédait de nombreux logis. Il nous donna des logis
distincts conformément à notre division en trois groupes de pèlerins. Tout cela avait été prévu dès avant
notre arrivée grâce à ce chevalier qui avait quitté le Caire avant nous, comme on l’avait dit auparavant au
folio 91.
Ayant reçu notre logement nous descendîmes dans la cour et transportâmes notre matériel dans les logis.
Je me trouvais, durant ce travail, en péril de mort, mais de par la protection divine, j’en sortis sain et sauf.
J’étais près des bagages et je me préparais à mettre de côté les affaires de notre groupe, car toutes les
choses gisaient mêlées en un seul tas. Or nous avions un grand panier dans lequel se trouvaient des
ustensiles très lourds ; et ce panier était si lourd que je ne pouvais le soulever de terre. Je m’attaquais donc
à ce panier et le sortis du tas en la tirant à terre, courbé et en reculant ; comme il était lourd, j’y mis toute ma
force, et accélérai autant que je le pus en reculant, sans pouvoir regarder derrière moi où j’allais. Tout en
tirant ainsi le panier, une clameur énorme s’éleva des étages supérieurs de la maison, là où se tenaient les
autres et d’où ils regardaient. Ils criaient : « Frère, sauve-toi ! sauve-toi ! » Mes compagnons d’en bas
criaient aussi en me disant de faire attention et de me sauver et vite. À leurs cris, je m’arrêtai interdit sur
place, tandis que tous ceux qui criaient me suppliaient avec violence de fuir. Me retournant, je regardai
derrière moi et me trouvai côte à côte avec un léopard sauvage et cruel, attaché à une chaîne, les yeux
brillants et les griffes affilées ; ce que voyant je m’écartai de lui d’un bond. Tous les familiers de la maison
étaient étonnés de l’inhabituelle douceur de cette bête indomptée, et ils me congratulèrent de ce qu’elle ne
m’avait pas bondi dessus, vu que mes arrières étaient à portée de ses pattes antérieures. Si elle avait lacéré
mon dos de ses griffes acérées, elle m’eût mis en charpie, et si même elle n’avait fait que me blesser
légèrement de ses griffes, mes plaies se seraient infectées, car elle possède des griffes et des dents
vénéneuses et sa morsure est pestilentielle. Au sujet de cette bête et de sa férocité, voyez ci-dessus au folio
93. Heureux donc d’être sain et sauf, j’achevai le travail commencé avec plus de prudence. J’ai vu, par la
suite, cette bête souvent furieuse au point que j’ai craint qu’elle ne rompe ses chaînes. Un jour, une autruche
qui se trouvait dans la cour, cherchant sans méfiance sa nourriture s’en était approchée ; la bête, d’un coup
de patte, lui arracha une aile avec un gros morceau de chair, car c’était une grande autruche.
Visite de commerçants vénitiens
Entre-temps des chrétiens qui étaient arrivés sur la flotte vénitienne et qui étaient dans le port d’Alexandrie,
ayant entendu parler de notre arrivée, nous apportèrent, de leurs navires, des bouteilles de vin et autres ;
nous vidâmes quelques chopines avec eux puis nous discutâmes du retour des galères. Ils nous
conduisirent tout en haut de la maison qui était si élevée que nous pûmes survoler toute la ville du regard et
découvrir la flotte stationnée en mer, et à la vue de laquelle nous fûmes remplis de joie autant que si nous
avions aperçu quelque cité de notre patrie ; un peu comme se réjouirait celui qui habite une terre étrangère
qu’il n’aime pas, et qui aperçoit le cheval ou le véhicule qui doit le reconduire jusqu’au lieu aimé de son pays
natal. Ce jour-là, une joie singulière me fut accordée ; tandis que j’étais tout en haut de la maison et que je
regardais en bas dans la cour, deux frères de l’Ordre des prêcheurs entrèrent. À leur vue je me sentis tout
entier envahi par la joie. Je descendis aussitôt à leur rencontre et nous nous saluâmes mutuellement avec
beaucoup de charité. Ils étaient chapelains d’honneur, amenés par des commerçants. L’un d’eux frère
Wilhemn de Sicile veillait en qualité de chapelain sur les hommes de notre maison ; l’autre frère Jean de
Gênes s’occupait des chrétiens au fontique des Génois. Ils étaient tous deux homme expérimentés, et
m’apportèrent beaucoup de consolations durant mon séjour à Alexandrie. Ils me conduisirent jusqu’à la
chapelle de la maison qui était bien tenue et bien munie, en me déclarant que je pourrais y célébrer et prier
à loisir ; ils me montrèrent dans un coin caché la clef de l’église, etc.
Le soir était venu ; nous prîmes notre souper aux chandelles, dans la joie, en compagnie de Monsieur le
Consul, puis nous nous retirâmes pour nous reposer dans nos logis et nous endormîmes dans les lits que
nous avions emportés avec nous depuis Jérusalem. Ainsi s’écoula cette journée.
Le vingt-cinq Octobre.
Le 25, fête de Crispin et Crispinien, nous nous préparâmes, et la cloche sonnée, nous célébrâmes et
écoutâmes les messes dans la chapelle de la maison. Nous étions contents d’avoir trouvé un lieu
convenable pour l’Office divin.
Un navire chrétien capturé en mer
Aussitôt après les messes, avant même de descendre de la chapelle, nous entendîmes des bruits de
bombardes, des sons de trompettes, des éclats de tambours, et les cris d’une foule trépignante. C’était le
signe de l’arrivée d’un grand Seigneur sur un navire, par mer. C’est avec une telle solennité, en effet, qu’ils
ont coutume ici d’accueillir les navires des grands. Toute la domesticité de la maison s’élança donc audehors,
en direction de la mer, pour voir le spectacle. Quant à nous qui étions captifs, nous montâmes tout
en haut et tournâmes nos regards vers la mer, vers le port. Des grippes, des fustes et des barques pleines
de Sarrasins élégants se dirigeaient vers le port, et c’était leur entrée qui motivait tout cela. Il s’agissait en
fait d’un important Sarrasin qui arrivait de la Libye d’Afrique, et le préfet d’Alexandrie avait envoyé des
navires avec des gens armés au-devant de lui, pour l’accueillir honorablement, soit parce qu’il était pèlerin
du sépulcre de Mahomet et que partout on reçoit ceux qui y vont avec honneur, soit également parce qu’il
amenait avec lui un butin convoité saisi en mer. Ce Sarrasin avec les siens, naviguant en haute mer, s’était
en effet emparé d’un navire avec treize chrétiens, et ayant partagé leurs affaires entre ses hommes, ils
amenaient les chrétiens à Alexandrie pour les y vendre. Ils convoquaient donc tout le peuple de la cité au
spectacle par les cris dont on vient de parler. Lorsqu’ils descendirent des navires, à terre, ils lièrent
ensemble avec des cordes et des cordages ces pauvres chrétiens ; tout le groupe fit passer devant lui ces
malheureux captifs, et, entra joyeusement dans la ville ; ils formaient par contre, pour les Chrétiens, un
spectacle lugubre, et une raison de crainte, d’affliction et de tristesse. Ils les conduisirent ainsi jusqu’au
fontique des Tartares, où ils les exposèrent à la vente et où ils les vendirent. Après cela nous prîmes notre
déjeuner et mangeâmes tristement, compatissant aux malheurs de nos frères.
Le tribut à payer à Schambeck, le Trucheman d’Alexandrie
Après le déjeuner Schambeck arriva et nous ayant réunis, il nous fit lecture de son registre, pour le paiement
du tribut, pour le sauf-conduit, et la liberté de déambuler en ville. Il demandait de chaque pèlerin treize
ducats. En entendant cette somme nous fûmes stupéfaits et lui déclarâmes que dans les mémoires des
pèlerins qui étaient là avant nous, nous n’avions pas vu plus de six ducats par personne. Pourquoi voulait-il
donc nous surcharger davantage ? Il répondit : « Vos mémoires, dit-il, je n’en ai cure, je m’en tiendrai aux
instructions de mon registre. Pensez donc, sans plus discuter, à me payer, et prenez garde à ne pas sortir
de cette maison sans mon intermédiaire. Si vous faites le contraire vous ne vous en porterez pas bien ».
Ceci dit, il nous quitta. C’était un homme taciturne, ne cherchant pas la dispute, mais têtu, et nous
soupçonnions Tanguardin du Caire, de l’avoir corrompu par ses lettres, le poussant à nous écorcher – ce qui
se passa en fait. Halliu, lui-même, nous avait poussés en avant et perdus. En soi, ce Schambeck fut un
homme juste n’envenimant pas les choses et nous protégeant fidèlement. Nous demeurâmes donc encore
ce jour-là dans l’hospice, mais nous n’eûmes à souffrir d’aucune privation, ni de vin, ni d’aucune chose
nécessaire.
Dimanche vingt-six Octobre : Journée de repos
Le 26, qui était le 22e dimanche après celui de la Trinité, nous célébrâmes les messes et nous passâmes
dans la tranquillité ce jour consacré à la dévotion. Le déjeuner achevé, nous demeurâmes dans des coins
ombragés, à cause de l’ardeur intense du soleil, car bien qu’à cette époque ce soit chez nous quasi l’hiver,
ici les journées étaient encore très chaudes, comme jamais elles ne parviennent à l’être chez nous, même
en été.
Le commerce des noisettes, de Amalfi
Au jour baissant, nous entendîmes à nouveau le son des trompettes et l’éclatement des bombardes
indiquant l’arrivée d’autres navires. Nous montâmes donc sur la terrasse et vîmes une grande galée
chrétienne entrer au port. Nous envoyâmes donc un esclave de la maison à la mer se renseigner d’où venait
cette galère et quelles marchandises elle apportait. L’esclave revint en déclarant que ce navire venait de la
Campanie qui est limitrophe de l’Apulie et de l’Italie, et n’avait pour toute marchandise que des avelines que
nous appelons des noisettes. La galée en était remplie. Si les noisettes poussent en Campanie en grande
quantité, au point qu’on les appelle abellanes, de Ellana, village de Campanie, elles ne croissent pas dans
les régions orientales à cause de la sécheresse et de la chaleur du sol. Elles ne poussent que dans les
endroits humides, froids et maigres, et c’est pourquoi on les exporte de la Campanie vers la Syrie et
l’Egypte, comme marchandise exotique et précieuse. Le jour suivant nous demandâmes à un Teuton qui
était venu par la même galée, et qui était galiote à quel prix on pouvait estimer ces noisettes en vrac. Il
répondit qu’il ne se croyait pas très expérimenté, mais que le patron de la galée espérait en recevoir
plusieurs milliers de ducats. Je n’ose pas écrire le nombre des milliers de ducats que cet esclave nous
spécifia, de façon précise. Ces noisettes sont très chères en Orient, et les Orientaux aiment beaucoup en
manger, comme d’un mets précieux et très sain pour eux ; alors que chez nous elles ne sont ni précieuses ni
même bonnes pour la santé ; on les donne aux enfants comme manière d’amusement et on les considère
comme un produit non cultivé au même titre que les glands. Il est vrai que ces marchandises une fois
apportées en Orient y acquièrent des qualités autres que celles qu’elles possèdent chez nous. Chez nous, si
on les conserve plus d’un an, elles se corrompent, se gâtent ou pourrissent, et deviennent immangeables.
Une fois apportées en Orient, elles se conservent toujours, même un siècle durant, sans défaut, et elles
deviennent donc saines et précieuses. C’est pourquoi les commerçants amalfitains de Amalfi, ville d’Apulie,
furent, croit-on, les premiers à apporter par voie de mer des noisettes en Egypte et en Syrie, au titre de
marchandises exotiques, que l’Orient ne connaissait pas encore, pour en tirer un gain ; et cela, longtemps
avant le temps des Latins, à l’époque où le royaume de Jérusalem était encore aux mains des païens. C’est
grâce à ces denrées que les Amalfitains obtinrent la protection et l’aide des maîtres de cette région. À
l’époque où les Latins ne possédaient encore aucun endroit à Jérusalem où puissent être reçus les pèlerins,
ces commerçants obtinrent du roi d’Égypte la permission de construire une demeure à l’endroit de leur choix
dans la sainte cité ; et c’est ainsi qu’ils construisirent devant le portail de l’Eglise de la résurrection du
Seigneur, un monastère en l’honneur de la Vierge Marie. Ils y établirent un abbé et des moines latins, et
parce que la chose avait été faite par des Latins, ils nommèrent l’endroit Sainte Marie du Latium. Telle est la
faveur que les Chrétiens obtinrent avec des noisettes (Voyez à ce propos la 1re Partie, folio 268a).
Le vingt-sept Octobre : Ce que vit F. Fabri, et ce qu’il lui advint, en lisant son bréviaire sous le porche du
fontique
Le 27 qui est la vigile de Simon et Judes apôtres, je me levai le matin pour réciter mon Office, je descendis
dans la cour et sous la voûte qui est à l’entrée de la porte de la maison, je m’assis pour prier. La porte de la
maison était encore close. Ce sont des Sarrasins qui l’ouvrent et la ferment, du dehors, à leur gré, comme
d’ailleurs toutes les autres maisons des Chrétiens dont ce sont eux qui possèdent les clés, et non les
habitants chrétiens. On fait la même chose partout où il y a des commerçants vénitiens. Ils ferment toute
maison dans laquelle il y a des Chrétiens, durant les heures de la nuit afin que personne ne puisse y entrer
ou en sortir, pour les garantir des mauvais coups nocturnes. Tandis que j’étais assis, arriva un portier
sarrasin qui ayant repoussé le verrou et les barres ouvrit les deux battants et s’en alla. Je me levai donc et
m’assis sous la porte, regardant les passants.
En moi-même j’étais stupéfait de la diversité des hommes qui passaient en tous sens ; j’aperçus en effet de
nombreux chrétiens, orientaux et occidentaux, des Juifs, des Samaritains, des Sarrasins, des Mamelouks,
des deux sexes au milieu desquels s’efforçait de passer un jeune barbier que j’avais connu auparavant à
Venise. En le voyant, je l’appelai en italien : « O barbarero, veza ! » ce qu’entendant, il vint. ‘Et oui ! lui dis-je,
camarade, me voici chez toi, et tu vas me laver la tête et me faire la barbe et ma tonsure monacale. Hélas !
je suis détenu avec les autres par le Trucheman, pour dette impayée ». Ce à quoi le jeune répondit
« Puisqu’il est encore tôt et que les Sarrasins ne sont pas levés, venez avec moi avant que le Trucheman ne
sorte de sa maison, vous serez rasé, nettoyé et, la tête refaite vous reviendrez chez vous ». Comme
j’hésitais encore, il me dit : « Que craignez-vous ? Vous n’avez prêté aucun serment, venez donc avec
moi ». Ainsi convaincu, je me levai et allai avec lui à travers la place jusqu’au grand fontique des Vénitiens
où je fus lavé et rasé à mon gré. Tandis que je revenais vers la maison, je me trouvai face à Schambeck, le
Trucheman, à la vue duquel, terrifié, je voulus m’éloigner en changeant de ruelle. Tandis que j’y pensais, il
me rappela en langue sarrasine, criant : « Thali, ihali ; christiane », ce qui signifie « Viens, viens chrétien ».
Tout tremblant, j’allai donc à lui, mais je repris espoir lorsque cet homme avisé, sans aucune passion, me dit
doucement en italien de retourner à la maison et de dire aux pèlerins qu’il avait l’intention de venir après le
déjeuner, pour percevoir l’argent qui lui était dû, et qu’il faudrait bien lui donner, sous peine d’être jetés dans
les prisons publiques où il serait exigé par la torture. Je répondis à et homme : « Seigneur, ce que tu
ordonnes, je le dirai à mes Seigneurs, les pèlerins, mais je te jure, par mon Seigneur crucifié, que pauvre
frère et prêtre, je n’ai pas d’argent personnel, et ce que j’avais, est consommé depuis peu ; je ne vis donc
que grâce à la bonté des Seigneurs pèlerins ; une fois rentré au pays natal qui est bien loin d’ici, au-delà de
la mer et des montagnes, je rembourserai ce qu’ils auront dépensé pour moi ». Me considérant alors avec
bonté il me dit en italien : « Startu proeto non paga ingenti », ce qui signifie : si tu es prêtre tu n’auras rien à
payer, comme s’il avait dit : « De toi, il n’est pas question puisque tu es prêtre, car les prêtres qu’ils soient
riches ou pauvres, ne payent pas les impôts ; je n’exigerai rien de toi, mais les gens du monde devront
payer ». Je remerciai l’homme et tout joyeux m’en revins à la maison où je trouvai encore les pèlerins
endormis.
J’avais toujours pensé que j’aurais été obligé de verser la somme tout comme les autres, et j’avais déjà parlé
avec quelques Seigneurs pèlerins de la possibilité de m’avancer de l’argent. Il n’était pas évident pour moi
que les prêtres chrétiens aient joui de libertés spéciales chez les païens. Lorsque donc les Seigneurs
pèlerins se levèrent, je leur dis comment j’avais rencontré maître Schambeck, ce qu’il m’avait dit et comment
il m’avait déclaré que je pouvais me considérer libéré, vu mon sacerdoce. Entendant cela, les Seigneurs me
félicitèrent, mais pour ce qui les concernait ils se lamentèrent d’avoir à verser une telle somme. Aussi
quelques-uns furent-ils d’avis d’en référer à l’Amiral, préfet de la cité ; mais le Consul, notre patron et notre
hôte, déclara qu’on ne pouvait rien entreprendre contre Schambeck qui était considéré par tout le monde
comme un homme honnête et aimé comme tel, et que si nous l’offensions, nous serions mal vus à
Alexandrie. C’est donc ainsi que les Seigneurs se résignèrent à payer. Et en effet, après le déjeuner, le
Trucheman arriva et réclama de chacun une somme identique, du pauvre comme du riche, du pauvre
bougre comme du noble, les prêtres exceptés. Il laissait en effet partir librement celui qui montrait par sa
tonsure et son habit les signes de son sacerdoce. On lit en effet au ch. 47 de la Genèse, qu’au temps de la
famine, le Pharaon acheta aux Egyptiens toutes leurs terres en échange des vivres qu’il leur distribuait, et
que durant cette même famine, il les réduisit tous en servitude. Il accorda cependant aux prêtres ce qui leur
était nécessaire de façon à ce qu’ils ne se trouvent ni privés ni dépouillés de leurs propriétés ou de leur
liberté. Le Seigneur révélait ainsi, déclare Gratien (XXIII, a, VIII, quamvis etc.) que les prêtres quelle que soit
leur nationalité doivent être de condition libre.
Tout homme de Dieu est dispensé de taxes en Égypte, et cela depuis le temps des Anciens Égyptiens
Comme je l’ai signalé plus haut, on doit savoir que c’est chez les Égyptiens – à ce qu’enseignent les livres
des païens – que furent, en premier, institués des prêtres affectés au culte des dieux. Cela eut lieu ainsi, à
ce qu’on trouve chez Diodore Lib. 1 cap. 2 des Histoires anciennes : Osiris, homme remarquable par son
génie, fils de Jupiter et de Junon, et, Isis, femme d’une grande ingéniosité, alors qu’ils régnaient en Égypte,
dans des temps très anciens, plus de dix mille ans avant Alexandre de Grand, - à ce que rapportent les
légendes – firent ériger des temples et des statues d’or à leurs parents, Jupiter et Junon, apprirent au peuple
à les vénérer, et amenèrent ce peuple qui vivait auparavant comme des primitifs, à une grande humanité.
Eux, les premiers, ils inventèrent la culture du froment, de l’orge, du vin et de la cervoise, et enseignèrent
l’écriture et la lecture. C’est pourquoi d’ailleurs le peuple leur conféra les honneurs divins ; Osiris était,
disaient-ils, le soleil, et Isis la lune. À la suite de cela, Osiris fut mis à mort par son frère Typhon, et son corps
fut partagé en vingt-quatre parties. Isis hérita du royaume, recueillit les membres dispersés d’Osiris, les
disposa dans leur ordre premier, les déposa dans un sépulcre d’or très précieux ; elle convoqua alors des
hommes dignes et institua le sacerdoce pour le service d’Osiris. Pour les rendre plus empressés à ce culte,
elle leur concéda le tiers de ses propriétés foncières pour les offices des dieux. Par la suite, ils attribuèrent à
Isis après sa mort, comme de son vivant, les honneurs divins. Ces prêtres menaient une vie religieuse
extraordinaire.
Le stoïcien Chérémon raconte à leur sujet – comme on le trouve dans les règles du Bienheureux Jérôme
108, « mésestimant toutes les affaires et les soucis du monde, ils étaient toujours dans le temple,
contemplaient la nature des choses, la course et le déroulement des astres, ne se mêlaient jamais aux
femmes, ni à leurs parents ou proches, ne voyaient même pas leurs enfants, et dès qu’ils commençaient à
se consacrer au culte divin, ils s’abstenaient pour toujours de viandes et de vin, en vue d’acquérir la subtilité
de l’esprit, et surtout pour éviter tout appétit charnel qui se nourrit de ces mets et de cette boisson. Ils ne
mangeaient pas non plus de pain pour ne pas s’alourdir l’estomac et si parfois ils en mangeaient ils
pressaient alors de l’hysope écrasée dans leur nourriture pour faciliter par sa chaleur la digestion. Ils ne
connaissaient l’huile que dans les légumes, et encore ne l’utilisaient-ils qu’en petite quantité, pour atténuer la
nausée et l’âcreté du goût, quant aux oeufs et au lait ils les évitaient comme les viandes. Leur lit était fait de
tiges de palmiers ».
Ils avaient en horreur une couche moelleuse et ne dormaient que sur un lit jonché de gattilier pour
sauvegarder leur continence, comme on le verra plus loin au folio 199. À cause de tout cela les prêtres
étaient chers au coeur du peuple qui les nourrissait sur les revenus du fisc commun, ne les chargeait
d’aucune affaire de ce monde, car en fait ils usaient de ce monde, ignorés de tous, toujours appliqués à
l’étude de la sagesse, toujours occupés à leurs cérémonies religieuses.
Je crois qu’il n’y eut jamais ou qu’il n’y a pas de peuple sous le ciel, qui, hélas, traite ses prêtres aussi
indignement que le peuple chrétien ; ils seraient capables de les traiter encore beaucoup plus mal, s’ils le
pouvaient ou l’osaient. La condition sacerdotale est grande et puissante ; on ne peut les charger comme on
veut des affaires de ce monde, et néanmoins les peuples chrétiens ne les en imposent pas moins, exigeant
d’eux octrois, droit de péage, offrandes volontaires et contributions, nonobstant les lourdes
excommunications et censures portées en tels cas. (Extraits de Coen c. et in L. VI, et en multiples endroits
dans les canons et les lois). Mais s’il était permis de confesser la vérité, il faudrait dire qu’il est étonnant que
les laïcs chrétiens ne massacrent pas leurs prêtres, étant donné la scélératesse de la vie et la corruption des
moeurs de ces derniers.
Il n’en était pas ainsi chez les anciens Égyptiens qui avaient le souci de s’exposer aux plus grands dangers
en faveur de leurs prêtres. On lit en effet au c. 1 de Diodore que Bocharus, célèbre roi d’Égypte, alors qu’il
recevait souvent en songe des oracles des dieux, apprit qu’il serait privé de son trône, s’il ne mettait pas à
mort tous les prêtres de l’Égypte, et, qu’eux vivants, il ne pourrait mener qu’une vie misérable tant qu’il ne
passerait pas, lui et les siens, au milieu des cadavres de ceux qui devaient être mis à mort. Ayant donc
rassemblé tous les prêtres il leur révéla l’oracle des dieux, déclarant qu’il se refusait, tant qu’il demeurerait
en Égypte, à tramer la perte d’un seul homme, et qu’il préférait quitter l’Égypte, pur de tout crime accompli,
et abandonner sa vie au destin, plutôt que de jouir d’un trône, souillé par un carnage impie. Ayant
abandonné son trône aux Égyptiens il émigra ainsi en Ethiopie.
Première visite au port d’Alexandrie
Lorsque Schambeck eut empoché l’argent, il monta sur son cheval et nous ordonna de le suivre. Il nous
conduisit donc dehors à la porte de la mer qui mène au port des Chrétiens, là où étaient nos navires ; il nous
présenta aux portiers, aux percepteurs, aux contrôleurs et aux douaniers, leur annonçant que nous avions
payé le tribut, que nous avions un sauf-conduit du Seigneur Sultan, et qu’ils devaient donc nous laisser
librement sortir vers les navires et rentrer, en vue des exigences de nos affaires. Les hommes, des Anciens,
qui étaient assis là, nous considérèrent attentivement pour pouvoir nous reconnaître par la suite, tout en
déclarant qu’ils n’avaient aucune intention de nous interdire la sortie ou la rentrée, mais qu’ils ne pouvaient
nous laisser aller et venir sans nous fouiller, de peur que nous ne fassions sortir ou que nous n’importions
quelque chose soumis à l’impôt. Ils inspectent et fouillent en effet tous les étrangers, soit Chrétiens, soit
Sarrasins, tant à la sortie qu’à l’entrée, et ne laissent emporter aucun argent, mais ils le mettent de côté
jusqu’au retour de celui à qui il appartient. Il est vrai qu’ils ne cherchent qu’assez superficiellement. Je fis
moi-même sortir sous ma cape bien des choses qu’ils ne trouvèrent pas, même après m’avoir fouillé, et
souvent même ils laissent passer sans aucune investigation. Lorsqu’ils nous eurent fouillés nous sortîmes
avec Schambeck jusqu’à la mer, et, après avoir regardé les navires, il nous ramena à la porte, où à nouveau
l’on nous fouilla, et cela fait, nous revînmes à notre cour. Schambeck nous donna également licence de
circuler par la cité dans les rues publiques, de pénétrer dans les fontiques, les marchés et les ruelles des
cuisiniers, mais il nous interdit de sortir par une autre porte que la porte de la mer, de pénétrer dans les
venelles, de nous arrêter dans les coins en ruines, et d’oser sous aucun prétexte, monter sur la colline de la
garde de la ville. Nous ayant donné ces règles, il s’en alla, et cette journée prit fin.
Le vingt-huit Octobre : Pèlerinage aux lieux saints de Ste. Catherine
Le 28 qui est la fête des Apôtres Simon et Judes, après avoir écouté la messe, nous fîmes venir
Schambeck, le priant de bien vouloir nous conduire sur le lieu du martyre de Ste. Catherine et aux églises
des Chrétiens. Nous quittâmes donc la maison en compagnie de Schambeck, par une longue rue dans
laquelle de nombreux artisans étaient assis au travail, et parvînmes à une place sur laquelle se dressait une
curieuse petite maison, fermée ; c’était la prison de la bienheureuse vierge Catherine, dans laquelle on
l’avait gardée recluse durant douze jours sans nourriture ni boisson humaines. Elle s’y nourrissait d’un
aliment angélique, et ce lieu obscur se trouvait rempli d’une clarté céleste, à ce que l’on trouve dans la
légende de Ste. Catherine. Après leur avoir donné quelques madins, des Sarrasins nous ouvrirent cette
prison, et étant entrés nous nous prosternâmes et gagnâmes les indulgences. Sortant ensuite, nous
revînmes sur la place et contemplâmes attentivement cet endroit, car c’est sur cette place, croit-on, que la
vierge sacrée avait été frappée de verges. C’est là aussi qu’avaient été dressées ces deux roues horribles,
sur lesquelles la vierge glorieuse devait être mise en pièces ; mais elles furent détruites par les anges. Ces
deux roues de bois étaient suspendues à deux colonnes de marbre sur lesquelles on les faisait tourner. Ces
deux colonnes sont encore là aujourd’hui, sur une éminence au-dessus de la muraille, situées à douze pas
l’une de l’autre. Après avoir vu cet endroit, nous allâmes à l’extérieur de la ville, à l’endroit de la décollation
de la Vierge, et là nous nous prosternâmes sur le sol, et nous baisâmes le lieu de sa passion, nous
rappelant là, sur place, comment du lait, au lieu du sang, avait coulé du cou de sa tête tranchée, comment
elle avait prié à l’intention de ses bourreaux, et comment, tout à coup enlevée d’ici par les anges, elle avait
été transportée au Mont Sinaï. On croit également que c’est à cet endroit que les cinquante rhéteurs que
Ste. Catherine avait convertis, précipités dans les flammes, en sortirent sans avoir été brûlés, pour gagner
directement le ciel ; que l’épouse de l’empereur Maxence, convertie, fut torturée et décapitée ; que Porphyre
avec deux cents soldats, et beaucoup d’autres saints, furent, croit-on, martyrisés sur ce même lieu, par des
tyrans. Il y a à cet endroit deux colonnes de marbre dont l’une est écroulée ; c’est un lieu vénéré tant par les
Chrétiens que par les païens. Non loin de là, se dresse une grande et haute colonne, à l’endroit où Ptolémée
décapita Pompée le romain en opposition à César ; on l’appelle aujourd’hui la colonne de Pompée.
Au Césaréum d’Alexandrie. Un obélisque
Ayant vu tout cela, nous rentrâmes en ville, et, par de nombreuses ruines misérables, et des coins
dépeuplés de la cité, nous parvînmes à un endroit défiguré par les ruines, et où, dit-on, se trouvait autrefois
le palais des empereurs, et où, rapporte-t-on, a habité Alexandre le Grand, fondateur de la ville. À cet endroit
se dresse aujourd’hui une colonne remarquable et très belle, d’un seul bloc de pierre, mais d’une hauteur et
d’une taille étonnantes, taillée dans du marbre rouge. Son sommet est pointu, si bien que pour ceux qui la
regardent de loin, elle ressemble à une tour, très haute et murée ; elle est quadrangulaire et, sur les parois
sont sculptées des images de bêtes qui volent et de bêtes qui marchent et des images d’instruments
artisanaux, depuis le haut jusqu’en bas. Personne jusqu’à maintenant ne peut savoir ce que signifient ces
images. Certains affirment cependant de façon indubitable, qu’autrefois les Anciens dessinaient leur écriture
avec de tels caractères, et qu’il s’agit là d’écriture. Eusèbe rapporte en effet dans sa Préparation
évangélique qu’autrefois les lettres des Ethiopiens étaient des images d’animaux, de membres et
d’instruments artisanaux et que ces images signifiaient non des lettres, mais un sens, une intention, ainsi
l’épervier la vitesse, le crocodile le mal, l’oeil la vigilance. On trouve encore aujourd’hui des gens simples ne
sachant ni lire ni écrire, mais qui savent cependant indiquer leur intention par des caractères dessinés et qui
lisent ou écrivent comme avec une écriture véritable. J’ai connu un frère convers de notre Ordre qui ne
savait ni lire ni écrire, il dessinait cependant tous les sermons qu’il entendait grâce à des images, et les lisait
ainsi comme s’il les avait transcrits en lettres. Cette colonne est beaucoup plus grande que celle qui est à
Rome à la sortie de l’église Saint Pierre et dont quelques auteurs disent qu’elle aurait été autrefois ici et
qu’elle aurait été transportée à Rome. Cette colonne est si haute qu’elle semble à ceux qui sont en mer et
qui n’en savent rien n’être qu’une tour murée.
Nous avions déjà vu, ici, et ailleurs, en particulier au Caire, de ces immenses colonnes d’une seule pièce
que les anciens appelaient Colosses ou Obélisques, tels Pline, dans son Natur. Histor. Lib. 36, c. 9 et
Diodore dans ses Histoires diverses des anciens. Ces noms signifient colonnes et représentations
consacrées au soleil ; on raconte à leur sujet des histoires étonnantes. On rapporte en effet qu’au moment
d’ériger cet obélisque, alors que les maîtres d’oeuvre craignaient que les machines ne suffisent pas au poids,
pour augmenter encore l’enjeu de la difficulté le roi fit lier son fils au sommet afin que l’intérêt que les
manoeuvres au cabestan portaient au fils profita à la pierre. La difficulté était en effet plus grande pour ériger,
charrier et dresser la pierre que pour la tailler. Certains racontent qu’il fut transporté par l’architecte Satyrus,
depuis sa cavité en Phénicie, sur une embarcation qui le mena jusqu’au Nil.
On n’arrive pas à imaginer par quels moyens, radeaux ou navires, de si énormes masses pouvaient être
transportées même par mer jusqu’à Rome. Les maîtres d’art modernes en voyant ces obélisques stupéfiants
dont le déplacement, l’érection et le transport dépassent l’imagination, déclarent qu’ils ont dû être faits par
oeuvre de fusion, mais dont le secret lui-même demeure caché aux modernes. Par quels moyens ont-ils pu
être faits, dans des temps si anciens ? je ne peux le deviner pas plus que Pline et Diodore qui pensent qu’ils
n’ont pu qu’être détachés de hautes montagnes ou de rochers en surplomb, à la façon dont Sémiramis
découpa sa pierre, (cf. supra folio 50 a).
C’est dans les environs de ces lieux impériaux qu’eut lieu, croit-on, la discussion entre Ste. Catherine et les
rhéteurs ; c’est le lieu où l’on éprouvait les saints martyrs. Non loin de cet endroit, nous parvînmes à une
église vétuste qui est dite de Ste. Catherine, sur le lieu où se dressait, dit-on, la demeure du roi Costus, et où
aurait habité la jeune Catherine après la mort de son père, et dans laquelle elle aurait reçu la foi. Ensuite
nous poursuivîmes notre chemin jusqu’à l’église de Saint Sabba, abbé, à laquelle est accolé un monastère
de caloyers de rite grec. Ils déclarent que c’est là que Ste. Catherine fut instruite de la foi et baptisée. Je
pense qu’il y eut jadis également en cet endroit le temple admirable de Sérapis dont il est question dans
l’histoire ecclésiastique L. II ch. 24. une des merveilles du monde que Théophile, évêque d’Alexandrie,
purifia par la suite de ses ignominies et qu’il consacra sous le titre de Basilique en l’honneur de saint
Jean-Baptiste, et dans laquelle il déposa le chef de ce même précurseur, qui lui avait été envoyé de
Jérusalem – selon ce que dit Bède le Vénérable.
Visite de la Cathédrale St. Marc des Jacobites
De là, nous passâmes ensuite à l’église de St. Marc l’évangéliste, près de laquelle résident les chrétiens
jacobites. C’est là que St. Marc eut sa demeure, qu’il convertit Alexandrie à la foi du Christ et qu’il avait
coutume de célébrer la messe. Ordonné évêque, il fut le premier à occuper le siège d’Alexandrie. C’est
durant son séjour en Italie qu’il rédigea son Évangile, mais c’est ici, qu’administrant et s’acquittant de sa
fonction d’évêque, il transmit la règle de la vraie religion et de la perfection. L’histoire ecclésiastique L. II
ch. 16 a de nombreuses pages à ce sujet. Cassien, in Coll. Patrum, L. II, dans les premières pages, déclare :
C’est de St. Marc qui fut le premier Pontife d’Alexandrie, que les moines éprouvés dans la foi reçurent leur
règle de vie. Ils ne s’en tenaient pas seulement à ces normes fondamentales que l’on trouve au livre des
Actes des Apôtres, ils accumulèrent encore bien d’autres règles plus parfaites et plus sublimes. Après avoir
reçu leurs règles de ce saint Apôtre, ils se répandirent à travers les lieux d’Égypte et de Thébaïde, et le
désert se peupla de moines. Nous priâmes plus particulièrement en ce lieu, comme réunis autour de la
source de la religion et de la vie spirituelle. Autrefois cette église était église patriarcale et le corps du
Bienheureux Marc l’Evangéliste y reposait. Tout a disparu, le corps de St. Marc a été transféré à Venise et la
foi catholique a disparu. Nous passâmes ensuite à une autre église qui est une église appartenant aux
jacobites, et qui s’intitule église Saint Michel. Nous y invoquâmes le patronage du Saint Archange. Dans
cette même église se trouve la sépulture des Latins, quand il arrive à l’un d’eux de mourir à Alexandrie,
comme cela arrivera. De là nous nous dirigeâmes vers le lieu de la passion de Saint Jean l’aumônier, qui fut
également évêque d’Alexandrie, et qui accomplit des merveilles durant sa vie.
Ensuite nous arrivâmes au premier fontique des Vénitiens, et y étant entrés nous y visitâmes une chapelle
gracieusement décorée pour y prier Dieu. Puis une fois sortis, nous allâmes également au fontique des
Génois et nous y trouvâmes une très belle et vaste chapelle dans laquelle nous fîmes monter nos louanges
vers Dieu. Rentrés ensuite à la maison, au fontique des Catalans, où se trouvait notre hospice, nous y
visitâmes également la chapelle pour y achever cette procession, puis nous passâmes à table pour prendre
notre déjeuner.
Seconde visite au port d’Alexandrie
Après avoir déjeuné, nous sortîmes à nouveau en direction de la mer, hors de la ville. Nous fûmes fouillés
sous la porte – Faisions-nous sortir quelque chose ? – Or tandis que nous étions sur le rivage un navire
aborda avec des Mamelouks en armes. Le préfet de la ville les avait envoyés pour s’attaquer à quelque
navire que des vigiles avaient aperçu de loin en mer. Mais tandis qu’ils s’approchaient du navire qui arrivait,
ces Chrétiens leur envoyèrent des bombardes si bien qu’ils avaient pris la fuite en direction du port. Un
chrétien s’approcha de nous, nous demandant si nous savions pourquoi ces Sarrasins en armes étaient si
tristes en descendant à terre. Comme nous lui disions que non ; il nous raconta l’événement ci-dessus
mentionné. Peu après, le navire devant lequel les Sarrasins avaient pris la fuite fit son entrée dans le port.
Derrière ce navire, venaient deux autres navires, l’un appartenant à des Vénitiens, l’autre à des Génois,
mais le navire vénitien s’était emparé et avait pillé le génois, au nom des guerres entre les Vénitiens et le
duc de Ferrare que les Génois soutenaient contre les Vénitiens. Ainsi en mer, personne ne peut être sûr
vis-à-vis de l’autre. Tout navire qui peut en piller un autre, l’attaque. Les Sarrasins d’Alexandrie ont donc
toujours des navires dehors prêts à attaquer les Chrétiens, et ceux-ci ne sont tranquilles à leur sujet que
lorsqu’ils arrivent dans le port de la cité. Chaque jour on entend près de la mer des nouvelles de combats
maritimes et de bateaux pillés.
Le vingt-neuf Octobre : La maladie du Comte de Solms, et la visite des Fontiques d’Alexandrie
Le 29 Octobre durant la nuit, une terrible dysenterie commença à faire souffrir Maître Johan Comte de
Solms. Il s’en trouva complètement anéanti comme on le verra. Après avoir écouté la messe et pris notre
déjeuner, nous décidâmes de faire le tour de tous les fontiques des commerçants, des institutions, ou
maisons des négociants des différentes nations et d’y regarder comment s’y traitaient les affaires. Un
fontique est une maison d’où les denrées s’écoulent vers les autres contrées, comme l’eau de la source. Il y
a beaucoup de ces fontiques à Alexandrie, de même que parfois d’un petit coin de terre jaillissent de
nombreuses sources. Chaque fontique a un patron appartenant au pays avec lequel se fait le commerce des
marchandises, - et ce patron est nommé Consul. Ces Consuls des fontiques sont des gens puissants. C’est
à chacun d’eux que revient de consulter, de réduire les taxes des marchandises, de pourvoir à son fontique,
de maintenir la paix et, ensemble avec les autres consuls, de promouvoir par leurs conseils le commerce de
l’Etat.
Nous nous décidâmes donc en premier lieu à regarder les marchandises et la disposition de notre fontique
des Catalans. Mais à cette époque-là il n’y avait que peu de marchandises et de marchands. Le fontique
possède pourtant une grande cour, avec de nombreuses chambres tout autour, comme un monastère. La
raison pour laquelle personne n’y venait plus était que les Catalans sont les pirates de la mer, ils ont infesté
la mer. Ils avaient pillé les uns, avaient troublé des gens puissants qu’ils craignaient et c’est pourquoi ils
n’osaient plus en ce moment-là se risquer en mer, et pourquoi leur maison était vide.
Sortant ensuite du fontique des Catalans, nous passâmes au fontique des Génois. C’est une vaste et belle
maison avec une grande cour, à côté de laquelle il y a un jardin planté de multiples plantes rares. Dans ce
fontique nous aperçûmes de nombreux commerçants, d’énormes tas de marchandises, et de nombreux
animaux que nous ne connaissions pas et qui le parcouraient. Une fois sortis, nous entrâmes dans le
premier fontique des Vénitiens ; nous le trouvâmes tellement rempli et regorgeant de sacs et de corbeilles
de marchandises qu’il n’y avait à peu près plus de place pour y circuler, quoique la cour fût vaste et que les
chambres fussent nombreuses. Il y avait là huit autruches et deux gazelles, comme de jeunes faons de
cerfs, dont nous avions aperçu un certain nombre au désert. Des hommes, notables Vénitiens, siégeaient là
dans cette maison, en compagnie de puissants Sarrasins, discutant de leurs marchés. Après être sortis,
nous entrâmes dans le second fontique des Vénitiens, plus grand que le premier, et dans lequel il y avait
une quantité stupéfiante de marchandises diverses, tant celles qu’ils avaient importées de nos régions que
celles qu’ils voulaient exporter d’ici. Outre les marchandises, nous y aperçûmes de nombreux animaux
étranges, de jeunes lionceaux, des léopards, des singes de différentes espèces, des autruches, des
perroquets blancs très beaux, des tout rouges, d’autres rouges avec des taches blanches, et beaucoup
d’autres verts, communs. À propos des perroquets, j’en ai parlé plus haut au folio 73.
Le cochon des Vénitiens
Nous aperçûmes, entre autres, une bête, qui pour nous est domestique, mais qui pour les Sarrasins est une
horreur. Se promenait en effet dans la cour un gros porc – ce dont nous nous étonnâmes beaucoup, car les
Sarrasins ont une haine mortelle pour les porcs et ils les ont en abomination, tout comme les Juifs. Ils ne
peuvent jamais supporter de porcs avec eux, et c’est pourquoi durant tout notre voyage nous n’en avions vu
aucun si ce n’est celui-ci. On nous expliqua que les Vénitiens avaient payé très cher au Sultan un
sauf-conduit pour ce porc, autrement les Sarrasins ne l’auraient pas laissé vivre ; bien plus, à cause du porc
ils auraient démoli la maison. Ce porc passe ici pour une munificence quelconque des grands de Venise. Et
en fait, s’ils n’étaient pas munificents et craints par les Sarrasins eux-mêmes, ils n’auraient pas pu faire cela.
Les Sarrasins évitent plus cette maison, à cause du porc que s’il y avait là un chien enragé. Or ce qui est
mémorable de la part d’une bête tellement primitive, c’est que dès qu’elle sent, – est-ce par instinct ou par
perception, je n’en sais rien, – la présence d’un Sarrasin dans la cour, aussitôt et même si elle était en train
de se rouler dans la fange, elle se précipite en grognant à la recherche de son adversaire ; si celui-ci ne
prend pas la fuite ou n’est pas protégé par un chrétien, elle lui fait subir sa vindicte, soit qu’elle lui arrache
ses habits, soit qu’elle le morde cruellement. Un chien ne serait pas aussi rapide à sentir la présence d’un
étranger, que ce cochon un Sarrasin, alors qu’il ne prête aucune attention à un chrétien, fût-il étranger. J’y
suis entré moi-même maintes fois ; il n’a pas senti ma présence ou bien n’y a pas prêté attention, alors qu’à
l’entrée d’un Sarrasin, il devient fou. En fait il monte la garde dans la cour exactement comme un chien, et
c’est peut-être pour cette raison qu’ils le nourrissent, à moins que ce ne soit à l’imitation des anciens
commerçants de Rome qui nourrissaient un porc chaque année, et le sacrifiaient une fois engraissé, aux
jeux de la déesse de Mai, dite Maïa, qui était fille d’Atlas, soeur de Mercure et femme de Jupiter, et dont le
mois de Mai a reçu son nom, comme le dit l’orateur Cornélius. Pour ma part je crois plutôt qu’ils nourrissent
ce porc pour marquer leur munificence et leur puissance, comme s’ils faisaient cela pour outrager les
Sarrasins.
La puissance des comptoirs vénitiens à Alexandrie
Les Vénitiens sont en effet, plus que les autres Chrétiens, puissants chez les Sarrasins ; nous seulement ils
ne les craignent pas, mais ils les corrigent. Dans cette cour, j’ai vu, une fois, le fait suivant : Un Sarrasin était
debout près des tas de marchandises : les esclaves et les gardiens, craignant un vol, lui demandaient de
s’éloigner des tas ; il refusa, et ils se disputèrent longtemps avec lui. Le maître, un gentilhomme Vénitien
survint par hasard, et voyant l’effronterie du Sarrasin, il le frappa à la tête d’un coup de poing si fort que
l’autre s’écroula à terre ; une fois à terre il continua à le frapper à coups de pied et il le chassa du fontique
ainsi, d’une façon déshonorante, sans prêter aucune attention aux Sarrasins spectateurs de la scène. Un
autre chrétien aurait fait cela, fût-il prince ou roi, il aurait été mis en prison. Nous aperçûmes là de nombreux
puissants Vénitiens négociant avec des Sarrasins.
Sortis après avoir vu ce fontique nous allâmes au fontique constantinopolitain des Turcs, nous y aperçûmes
diverses marchandises, et des Turcs, hauts de taille, d’aspect vénérable et grave.
Le Fontique des Tartares. Marché aux esclaves
Puis ayant poussé jusqu’au fontique des Tartares nous y entrâmes. Nous y trouvâmes en vérité les
marchandises les plus précieuses et qui pourtant se vendaient à vil prix. Ces marchandises étaient des
créatures de Dieu, douées de raison, faites à l’image de Dieu, plus de soixante êtres humains des deux
sexes qui étaient là mis en vente à vil prix. Beaucoup d’acheteurs indigènes les entouraient, et discutaient
de la vente d’hommes que le Christ avait rachetés de sa précieuse mort. Nous restâmes un certain temps
sur ce sinistre marché et vîmes ce lamentable, ou plutôt cet horrible maniement d’hommes. Car lorsque
quelqu’un veut acheter un homme, mâle ou femelle, il entre ici et examine ceux qui sont exposés à la vente,
pour voir s’il en trouve un qui lui plaise. Ils ont pour cet examen, un coup d’oeil et une expérience
extraordinaires. Il n’y a pas un médecin ou un naturaliste qui puisse leur être comparé dans la connaissance
de la constitution et de l’état d’un homme. Dès qu’ils regardent le visage de quelqu’un, ils savent
immédiatement quels sont sa valeur, son instruction ou son rang ; s’il s’agit d’un enfant ils savent dès qu’ils
le regardent à quoi il peut être bon. Ils ont aussi une habileté telle pour découvrir l’état et le caractère des
chevaux, qu’ils semblent avoir acquis le degré maximum dans la connaissance des sciences naturelles. Ils
sont en effet capables de discerner immédiatement, à partir d’un seul et unique élément, tous les défauts et
qualités d’un individu, à quoi il peut être utile, son âge et sa valeur. Ils n’ont par ailleurs aucune notion des
sciences spéculatives de la nature. Ils ne se posent aucune question sur l’âme ou ses facultés, ses passions
et ses dispositions, et ne se demandent pas comment elle a pu être infusée dans le corps ou unie à lui. Mais
quant à ce qui a été dit plus haut, ils l’emportent sur tous les naturalistes ou les médecins, tant en ce qui
concerne l’examen des animaux que des hommes.
Lorsque quelqu’un voulant acheter un homme, en a trouvé un qui lui plaît, il tend le bras vers les corps
entassés et fait sortir la femelle ou le mâle qui lui plaît, puis il éprouve de diverses façons celui qu’il se
propose d’acheter. Il lui parle et écoute ses réponses pour voir s’il est intelligent. Il lui examine les yeux ; les
a-t-il bons ? en bon état ? entend-il bien ? Il le palpe, puis il lui fait ôter ses vêtements, observant tous les
membres ; il note en même temps à quel point il est prude, à quel point timide, à quel point joyeux ou triste,
à quel point il est sain et en bonne santé. Ici, - que j’ai de honte à le dire ! – les parties honteuses
masculines comme féminines sont palpées devant tout le monde et montrées clairement. Nus, ils sont
également obligés, frappés à coups de fouets, de s’avancer devant tout le monde, de courir, de marcher, de
sauter, de façon à ce qu’apparaisse clairement s’ils sont infirmes ou sains, mâles ou femelles, vierges ou
déflorées. Et s’ils en voient quelques-uns rougir de confusion, ils s’acharnent davantage sur eux, les
poussant, les frappant de verges, les souffletant pour ainsi les obliger à faire ce que spontanément ils
rougiraient de faire devant tous les autres.
Une fois l’homme bien examiné, l’acheteur et le vendeur se réunissent, et l’homme que le vendeur offre pour
quinze ducats, l’acheteur n’en offre que cinq, alléguant un défaut de l’homme, soit purement corporel, soit de
caractère, et longtemps ils discutent des défauts de l’esclave exposé à la vente, comme chez nous l’on fait
avec les chevaux. Tandis que celui-ci cherche à acheter un homme et à l’emmener avec lui, un cri et des
pleurs s’élèvent dans l’entassement des êtres exposés à la vente, car il arrive que l’enfant qui est mis en
vente ait là sa mère également mise en vente ou des frères. On met en effet ici en vente le fils sous les yeux
de sa mère en pleurs ; on met ici en vente la mère à la honte et au dépit de son fils ; ici, sous les yeux de
l’époux rougissant, on se joue de l’épouse comme d’une courtisane, et elle passe aux mains d’un autre
homme ; ici l’enfant est arraché au sein de sa mère, et la mère bouleversée jusqu’au plus profond d’ellemême
est séparée de lui. Cela est vrai de la première mise en vente, lorsque des Chrétiens ont été enlevés
dans quelque ville ou bourg chrétien, ou lorsque des contrées chrétiennes ont été complètement
dépeuplées. Mais en fait, ceux qui sont conduits à la foire d’Alexandrie pour y être mis en vente, ont la
plupart du temps été déjà plusieurs fois vendus, et c’est pourquoi ceux-là sont parfois heureux de se trouver
être remis en vente, ils sourient à l’entrée des nouveaux venus qui désirent acheter ; ils se montrent affables
et doux pour mieux plaire aux acheteurs, surtout si précédemment ils ont eu à durement souffrir.
Avidité des Infidèles à posséder des esclaves
Il existe une passion inouïe de posséder ses propres hommes achetés, chez tous les Sarrasins, les Turcs et
les autres infidèles, et c’est une opinion universellement répandue chez tous que quiconque aura été
capable de posséder un ou une esclave ne connaîtra plus jamais l’indigence. Cette opinion ne les induit pas
en erreur, car je tiens pour certain qu’à cause de cela la malédiction de Dieu pénètre dans la demeure avec
l’homme acheté, en sorte que frustrés de tout espoir de félicité éternelle, ils jouissent de la félicité ici-bas, car
dès lors une telle insatiabilité travaille leur coeur que lorsqu’ils sont en possession d’un ou d’une esclave, leur
coeur est aussitôt tout entier dévoré par le désir d’en posséder un second, et ainsi de suite, du second au
troisième, du troisième au quatrième, et ainsi la faute croissant, la concupiscence s’étend jusqu’à l’infini, au
point qu’on trouve des fermes entières composées d’esclaves des deux sexes. Un serviteur et une servante
sont unis par le mariage pour constituer une famille, de façon à ce que, par les fils et les filles qui leur
naissent, il puisse en quelque sorte être donné satisfaction à leur insatiable désir.
Il n’y a, pour ainsi dire, pas une maison dans toute l’Égypte, la Syrie et la Turquie dans laquelle on ne trouve
pas un homme acheté. Or ils ont beau se multiplier, jamais cependant leur valeur ou leur prix ne décroît ; il
augmente plutôt toujours. Dès lors l’habileté de ces marchands s’exerce tout entière à concevoir comment
ne pas laisser diminuer le prix et la valeur de leur marchandise face à l’abondance, mais plutôt à la faire
augmenter. Les Turcs, voisins des Chrétiens, envahissent souvent les terres de ces derniers, non par haine
de la croix et de la foi, non pour s’emparer de l’or ou de l’argent, mais pour faire la chasse à l’homme et les
emmener en servitude. Lorsqu’ils envahissent à l’improviste des fermes, ils emportent non seulement les
adultes, mais encore les bébés non encore sevrés, qu’ils trouvent abandonnés par leurs parents en fuite ; ils
les emportent dans des sacs, et les nourrissent avec grand soin.
La dure condition sociale des esclaves
Mais autant est grande l’avidité des maîtres à posséder des esclaves autant est grand le désir des esclaves
de s’échapper de leurs mains. Aucun autre sujet entre eux, aucune pensée, aucune discussion, autre que
comment et où fuir et pouvoir s’évader. Aussi, lorsque leurs maîtres flairent ou soupçonnent quelque chose
ils commencent aussitôt par leur refuser trop d’alimentation de façon à les empêcher de se préparer, grâce
aux surplus, un viatique pour la fuite. Beaucoup prennent en fait la fuite, mais sans jamais réussir à s’évader
complètement, et lorsqu’on les retrouve et qu’on les ramène, la misère redouble pour eux. S’ils prennent la
fuite une seconde fois et qu’on les ramène, il n’y a plus pour eux de grâce ; ils sont battus sans aucune pitié,
torturés et mutilés. S’ils persévèrent toujours à vouloir fuir, on les vend ou bien on leur coupe toute possibilité
de fuite par des moyens divers. Certains maîtres les laissent mourir en les privant de nourriture, de boisson,
et de vêtements ; d’autres leur mettent un bloc de fer aux pieds ; d’autres leur passent une chaîne au cou ;
d’autres les rendent inutiles ou difformes en leur coupant les oreilles et le nez, et ainsi facilement
reconnaissables ; d’autres enfin mettent cruellement à mort par le glaive ceux qu’on rattrape. Un grand
nombre, en fuite, se réfugient dans des lieux inhabités, et errant par les montagnes et les déserts y meurent
de faim et de soif, ou – ce qui est pire – accablés par un trop dur service ou par la misère, condamnés pour
une fuite manquée, ils s’arrachent à la vie en se frappant eux-mêmes, ou en se pendant, ou se perdent
eux-mêmes en se jetant de haut, ou en se noyant.
Ce sont là faits quotidiens dans les lieux où l’homme s’approprie l’homme comme il le ferait d’une bête. J’en
ai moi-même été témoin de mes propres yeux dans notre hospice d’Alexandrie. Notre hôte, le consul, avait
acheté une Éthiopienne avec d’autres esclaves qu’il possédait. Cette Éthiopienne, reprise un jour pour
quelque faute par sa maîtresse, perdit patience devant la réprimande et fit front aux observations de sa
maîtresse qui ordonna qu’elle soit soumise au fouet. Mais elle s’entêta, et le bourreau, saisissant un bâton
se mit à la frapper de toutes ses forces comme sur un âne. L’ayant jetée à terre il la foulait aux pieds, sans
pourtant réussir à vaincre sa résistance et sa révolte. Rendant les coups, crachant, tirant la langue, elle
poussait à bout son bourreau. Difficilement maîtrisée enfin, elle s’abandonna à une fureur atroce, lorsqu’elle
se retrouva ligotée, mugissant comme un boeuf, se déchirant elle-même à coups de dents, se frappant la
tête contre la terre et les murs, se jetant à terre sur la tête à plusieurs reprises, du haut de l’escabeau sur
lequel elle avait été liée, et cherchant par tous les moyens à se tuer. Ensuite elle s’en prit à sa maîtresse, la
couvrit des pires accusations et lança des injures absolument infâmes contre le consul lui-même. Elle était
tellement égarée par la colère qu’elle en blasphémait Dieu et en bénissait Mahomet : elle criait qu’elle allait
se faire musulmane, ce qu’elle aurait fait si elle n’avait été liée de tous ses membres ; puis, en fin de
comptes, elle resta prostrée comme morte des heures durant, jusqu’à ce que sa crise se fût calmée. Un
homme devenu esclave en arrive à de telles souffrances qu’il perd le goût de vivre et cherche la mort par
tous les moyens. Dans ce fontique des Tartares nous nous trouvâmes donc frappés d’une grande
compassion pour tous ces malheureux offerts à l’achat.
Outre les fontiques ci-dessus nommés, il en existe, croit-on, plusieurs autres dans lesquels nous n’avons
pas été.
À propos d’un lieu honteux et comment nous y parvînmes. Un lupanar à Alexandrie
Ayant poursuivi notre chemin, nous parvînmes en un lieu, partout infâme, que sans violer l’honnêteté je ne
peux nommer ; mais l’injustice et la honte faites au nom du Christ, ainsi que la dérision envers la foi
catholique et l’opprobre pour les fidèles, m’obligent à en parler clairement, bien qu’avec pitié et en faisant
appel à la pieuse interprétation des lecteurs. Nous parvînmes, dis-je, en suivant une des rues publiques de
la cité, jusqu’à un lieu où, devant la porte de la maison, étaient assises des femmes fort belles, parées de
tous les ornements de la luxure, et qui étaient – ô misère – toutes chrétiennes ! courtisanes attrayantes,
prostituées par les plus abominables des entremetteurs chrétiens, exposées publiquement au choix de tous,
Juifs, Samaritains, Sarrasins, Mamelouks, Tartares et chrétiens éhontés. Ces pauvrettes étaient en effet de
terres chrétiennes, certaines de France, d’autres d’Espagne, de Calabre, d’Italie, d’autres et c’était la
majorité étaient de Catalogne, d’autres de Gênes, de Padoue, de Trévise et de Venise, filles sans aucun
doute de bonne souche, séduites par leurs intempérances, et menées ainsi jusqu’à la gueule de l’enfer. Du
fait même, en effet, qu’elles se mêlent avec des infidèles elles sont excommuniées par le canon 28,9,1. si
quis etc. C’est pourquoi, pour éviter cet embarras et l’abus d’unions si dépravées, il a été statué que dans
les régions chrétiennes, les Juifs doivent porter un insigne distinctif, pour éviter à une femme publique
d’accueillir un Juif, pensant qu’il s’agit d’un Chrétien. Ce décret a été, récemment encore renouvelé durant le
dernier Synode de Mayence, sous la présidence du Cardinal de St. Pierre aux liens, maître Nicolas de Cues
et confirmé par de lourdes peines. Selon les lois, les entremetteurs qui prostituent des femmes avec des
fidèles, et en reçoivent un salaire, sont passibles de la peine de mort. De quelle peine sont donc passibles
ces archi-entremetteurs qui prostituent des filles de Chrétiens avec des infidèles pour en retirer un gain ?
Que le sage en juge ! Nous savons aussi, par la loi, que le mariage en diversité de religions est prohibé et
interdit (Exod. 34, Deut. E, et dans le Canon cité plus haut au chap. Des Juifs, etc. (Prends garde, chrétien !)
Si donc un chrétien pèche gravement en abandonnant sa fille en mariage à un Juif ou à un Sarrasin,
combien pèche plus gravement celui qui livre la fille d’un autre à tous, pour en recevoir le salaire de la
prostitution ?
Ce scandale, à aucun prix, pour aucune raison, ni les Juifs, ni les Sarrasins ne l’accepteraient à savoir
qu’une Juive ou une Sarrasine soit offerte à des chrétiens. Bien plus, ils observent encore aujourd’hui cette
loi du Lévitique 19 qui dit : « Ne prostitue pas ta fille ; ainsi le pays ne sera pas contaminé et rendu tout
entier incestueux ». Ils ne supportent pas, à propos de leurs filles, que l’une d’entre elles devienne
courtisane, observant en cela Deut. 23 « Il n’y aura pas de prostituée parmi les filles d’Israël, ni de prostituée
parmi les fils d’Israël ». Et pour cette raison, il semble que ce qui est mentionné au ch. 16 d’Ezéchiel,
s’applique à l’Eglise, ou plutôt aux enfants perdus de cette Eglise, lorsqu’en plusieurs autres choses, il dit :
« Tu t’es bâti une maison de débauche, tu t’es fait une maison de prostitution sur toutes les places
publiques, tu as souillé ta beauté, tu as forniqué avec les fils des Égyptiens ». Ces places publiques, ce sont
les villes païennes, qui n’ont personne dans les lieux de prostitution, si ce n’est des Chrétiennes. J’ai
entendu dire en effet, qu’au Caire il existe un vaste lupanar, plein de Chrétiennes, de même à Damas, à
Beyrouth et à Tripoli, comme à Alexandrie et à Constantinople. Cela défigure de façon absolument
épouvantable toute la grâce de l’Église ; les hommes exposés à la vente au marché sont en quelque sorte
infiniment préférables à ces pauvrettes prostituées, au prix où elles le sont. Aucune d’entre elles en effet ne
peut être introduite dans la ville sans payer 30 ducats, comptant, dès la porte ; et de même, aucune d’entre
elles ne peut ensuite ressortir sans avoir à payer de nouveau la même somme. Il faut donc que la
malheureuse gagne d’abord, à ce métier abominable, 85 florins uniquement pour payer son droit de péage,
sans compter ses propres dépenses et son entremetteur qui, lui aussi, se nourrit du salaire de la prostitution
en vue duquel il l’a débauchée.
Les Sarrasins sur ce point valent donc mieux que les Chrétiens car les lupanars dans leurs villes ne sont pas
alimentés par leurs filles. Il est vrai aussi que sur ce même point ils sont bien pires vu qu’ils possèdent des
maisons spéciales pour éphèbes, d’une intolérable impureté, et qu’ils vont jusqu’à entrer par-ci, par-là, dans
des étables à bestiaux, de par la permission de Mahomet.
Pour en revenir à notre sujet, nous n’étions pas venus exprès à cette maison ci-dessus évoquée ; ce n’est
que chemin faisant que nous l’avions aperçue. En nous voyant, quelques filles se mirent à rougir, d’autres
pleuraient, d’autres nous priaient de les enlever de là et nous expliquaient leur misère, d’autres étaient tout
heureuses disant qu’elles allaient s’en retourner avec nous, d’autres nous suppliaient de prier Dieu pour
elles. Ayant donc échangé avec elles quelques brefs propos dans la rue même, nous poursuivîmes notre
chemin vers d’autres buts.
Troisième visite au port d’Alexandrie
Après avoir visité lieux et fontiques à l’intérieur de la ville, nous poursuivîmes jusqu’à l’extérieur et nous
aperçûmes au bord de la mer, des commerçants autour des navires. En passant la porte, les gardiens nous
fouillèrent à nouveau, comme ils l’avaient déjà fait plusieurs fois auparavant, puis nous ayant laissés, nous
arrivâmes jusqu’à la mer. Nous y trouvâmes une grande agitation. De nouveau, en effet, des navires
venaient d’arriver ; on chargeait d’autres navires de sacs de marchandises, et le rivage était couvert de sacs.
Bien que tous les sacs eussent déjà été remplis de leurs marchandises au fontique et pesés en présence
des fonctionnaires sarrasins, puis fouillés sous la porte de la ville, une dernière fois cependant, au moment
même de les monter à bord des navires, on vidait encore à terre tout ce qui se trouvait dans les sacs, pour
vérifier ce qui avait été apporté. Là, tout autour, il y avait donc grand travail, et de plus, beaucoup de gens
qui accouraient. Ils font en effet les sacs très grands, cinq pieds de large et quinze ou plus de long, et, tandis
qu’on les vide, une multitude de pauvres, de femmes, d’enfants, d’Arabes et d’Africains accourent et
s’emparent de tout ce qu’ils réussissent à voler. Ils cherchent sur le sable des gingembres, des clous de
girofle, de la cannelle et des moscatelles et ils vendent à bon marché sous la porte, ce qu’ils ont trouvé.
C’est pourquoi certains marchands les suivent, et leur rachètent ce qu’ils ont volé ou trouvé. J’ai vu parfois
plus de cinq cents de ces mendiants ou voleurs accourir ici pour chercher et voler des marchandises ; c’est
pourquoi quand ils commencent à se montrer trop importuns, certains marchands ont à leur service un
Mamelouk qui, à grands cris, se met à frapper les pauvres de son bâton et à les écarter à grands coups des
tas de marchandises, courant après eux au loin, et frappant sans pitié, indifféremment, vieux, femmes
enceintes et enfants, leur tapant dessus comme sur des bêtes, inattentif aux cris, aux gémissements et aux
lamentations dont le ciel est rempli. J’ai souvent assisté à de telles cruautés. À côté des sacs, outre ceux qui
travaillent, il y a également de nombreux gardiens qui surveillent les mains de tous ceux qui sont là à
l’entour. Une fois les marchandises passées à la fouille on les remet dans les sacs et on les charge sur des
barques qui les emportent jusqu’aux galées. Comme nous avions un certain temps devant nous, nous fîmes
venir une barque et naviguâmes jusqu’à la flotte pour y voir les galées sur lesquelles nous devions revenir
jusqu’à notre pays. Ayant vu les galées nous revînmes à la rame jusqu’au rivage. Entrés en ville nous fûmes
à nouveau fouillés sous la porte. Sous la porte intérieure se tenait un Soqui, prêtre sarrasin, hurlant et criant
pour inviter le peuple à la prière du soir. Nous rentrâmes donc dans notre maison pour nous reposer.
Arrivée des navires pour la traversée
Le trente Octobre : Nos navires sont arrivés
Le 30, à l’aurore, nous entendîmes du bruit du côté de la mer et nous comprîmes que quelques navires
étaient arrivés. Nous espérions que ce serait les navires que les Vénitiens disaient attendre, et avant
l’arrivée desquels ils ne pourraient partir, et nous-mêmes ne pouvions établir un accord avec eux. Aussitôt
donc que la messe fut finie, nous gagnâmes la mer. Comme nous l’espérions, nous découvrîmes que les
navires attendus étaient arrivés en provenance de bases africaines. Revenus à la maison, nous eûmes donc
durant le déjeuner une conversation avec le consul. Comment nous convenait-il d’établir le contact avec les
patrons des navires ? Nous convenait-il mieux de demeurer tous ensemble sur un même navire, ou bien sur
trois navires, répartis selon nos trois groupes ? Ce à quoi le consul nous répondit que nous ne pourrions
jamais être tous ensemble sur une même galée, à cause de la quantité de marchandises dont se trouverait
chargé n’importe quel navire, et que nous ne pourrions que difficilement trouver place sur trois galées. Il
nous conseilla de nous mettre en quête, chacun, de son propre navire, et d’établir le meilleur contrat
possible, car nous aurions à faire face à des patrons très durs pour le contrat.
Choix d’une galée
Le déjeuner fini, nous allâmes donc au fontique des Vénitiens et discutâmes avec les patrons des galées de
notre traversée, du prix et du coût de la navigation ; mais nous les trouvâmes âpres au gain, abusifs dans
leurs exigences sur le prix de la navigation plus que les Sarrasins ou les Arabes. Certains demandaient en
effet de chaque pèlerin cinquante ducats. Et comme nous nous montrions réticents à accepter un tel prix, un
autre patron nous déclara de façon arrogante que pour sa part il n’accepterait pas moins de cent ducats par
homme. Il se moquait ainsi de nous et nous humiliait. Cependant, malgré cette exigence abusive, les
Seigneurs du premier groupe firent contrat avec Maître Sébastien Contarini, patron d’une galée de la flotte
principale, sur laquelle le Consul d’Alexandrie avec son fils et le capitaine de la flotte voulaient accomplir la
traversée, ainsi qu’un grand nombre de nobles citoyens vénitiens. L’accord fut dur à cause de l’énormité du
prix du passage, et pourtant ils le conclurent en raison de Maître Johan comte de Solms qui était gravement
malade et réclamait inlassablement à grands cris qu’on le transportât sur une galée, sur laquelle il estimait
qu’il retrouverait sa santé. Les Seigneurs des deux autres groupes étaient assez mécontents de la
conclusion de cette convention, car ils craignaient de se trouver eux aussi obligés de donner un prix aussi
fort.
Cependant, l’accord une fois conclu, Maître Bernhard de Braitenbach, doyen de l’église de Mayence, voulut
se rendre sur la galée avec laquelle nous avions pris engagement pour y préparer une place pour Maître, le
Comte, qui était souffrant, et il me demanda de l’accompagner. Nous fîmes donc rames tous deux jusqu’à la
galée, examinâmes l’endroit propre à son séjour et le préparâmes. Cette galée me plut énormément. Il me
semblait n’en avoir jamais vu de plus belle. Elle était neuve, de grande dimension, très bien meublée et
aménagée ; les servants y étaient aimables, et le capitaine de la flotte qui y résidait, était un homme sage et
bon. En voyant cela j’en vins à soupirer ardemment de prendre, moi aussi, place sur cette halée avec les
Messieurs du premier groupe, et j’exposai mon désir à Maître Bernhard, tout en me lamentant sur
l’incapacité où je me trouvais de pouvoir faire face à la dépense. Cet homme vénérable me consola avec
bonté, tant pour mon désir que pour mon incapacité à payer. Une fois sortis de la galée, il me conduisit à
grands pas jusqu’au fontique des Vénitiens, auprès de Maître Sébastien, le patron de sa galée, et,
intercédant en ma faveur, comme pour un pauvre, il finit par obtenir que je puisse accomplir la traversée sur
cette galée ; en plus de cela, il sortit douze ducats qu’il me donna pour couvrir mes dépenses, me
demandant de prier Dieu pour lui et pour les siens et de m’employer sur le bateau à consoler maître le
Comte, malade, et de prendre en charge ses besoins spirituels. Le premier groupe en effet n’avait pas de
prêtre. Cette grande bonté à mon égard, alors que j’étais dans la gêne et le besoin, c’est cet homme
vénérable et bon qui en fit montre, en sa libéralité et magnificence, le noble Maître Bernhard de Braitenbach,
alors camérier de l’église métropole de Mayence, depuis lors doyen très digne de cette même église, et pour
lequel je prie Dieu, l’implorant qu’Il daigne lui rendre son bienfait ici-bas et dans la vie future.
Pourvu d’une place sur la galée, je rentrai donc tout joyeux à la maison rejoindre mes compagnons qui,
lorsqu’ils apprirent que j’allai me séparer d’eux, manifestèrent évidemment leur tristesse, mais, ayant
entendu de ma bouche le soutien qui m’avait été alloué, ils ne purent que me congratuler. Et à l’heure même
je sortis de nouveau en compagnie de Maître Johan, l’archidiacre de Transylvanie, afin de pourvoir
également pour lui à sa traversée. Nous nous entretînmes avec Maître Sébastien Contarini, qui l’accepta sur
sa galée, comme il l’avait fait pour moi, ce dont je fus très content, car depuis Venise jusqu’à ce moment
nous avions toujours été des inséparables. Même pour le groupe de pèlerins de Sainte Catherine, il ne s’y
était joint que poussé et encouragé par moi, comme on le voit à la 1re Partie, folio 221 b.
Par la suite, les autres pèlerins pourvurent également à leur traversée, et nous nous trouvâmes répartis
entre quatre navires. Huit pèlerins prirent place sur la galée de Maître Sébastien Contarini : tous les
compagnons du premier groupe et moi-même avec Maître Johan du troisième groupe ; les quatre autres du
troisième groupe prirent place sur la galée de Maître Bernardin Contarini. Les deux frères mineurs, le Père
Paul et le frère Thomas furent reçus sur la galée de Maître Marc de Jordan ; les pèlerins du second groupe
prirent place sur la galée de Maître André de Jordan. Toute cette répartition ne s’opéra pas sans grandes
discussions et querelles, dont il est inutile de faire mention. Il s’avérera à l’usage que personne ne fut mieux
pourvu que les huit premiers ; les autres eurent beaucoup à souffrir, comme la suite le prouvera.
Installation des pèlerins sur les navires, et comment je fis achat de rameaux de palmes à mes risques et
périls
Le trente-et-un Octobre
Le trente et unième et dernier jour du mois d’Octobre, vigile de la Toussaint, les messes célébrées, nous
commençâmes à prendre nos dispositions pour nous transférer sur les navires. Nous fîmes achat de tout ce
que nous savions devoir nous être nécessaire pour la traversée de mer. Ce même jour je fis achat de
rameaux de palmiers, plus de soixante, en vue du jour des palmes. Ce ne fut qu’à grand péril que j’en fis
l’achat, à grand souci que je leur fis passer la mer, et à grandes dépenses et peines que je parvins à les faire
transporter jusqu’au territoire d’Ulm. Pourquoi leur acquisition fut si périlleuse, en voici la raison ! Je passais
par le marché et je vis de nombreuses corbeilles tressées avec des feuilles et des tiges de palmiers, mais ne
pus trouver aucun rameau. Je demandai donc par signes à un fabricant de paniers s’il avait chez lui des
rameaux de palmiers. Il me comprit, et se levant de la porte de sa boutique et quittant son négoce, il me
conduisit tout au long d’une ruelle. Je commençai alors à me demander avec crainte si ce Sarrasin ne tentait
pas d’abuser de moi, lui fis signe que je voulais revenir sur mes pas, et m’éloignai de lui. L’homme voyant
cela, se montra tout troublé et affligé, me tenant tout un long discours en langue sarrasine à laquelle je ne
comprenais rien, et levant les yeux au ciel comme s’il prenait Dieu à témoin par serment de ce que j’étais
avec lui en toute sécurité ; puis il me prit par le bras m’entraînant et me tenant de façon à m’empêcher de
fuir. Après un long parcours de ruelles nous parvînmes chez lui. C’était une maison belle et grande ; pavée
de carreaux de marbre poli, et aux murs revêtus de marbre. J’admirai qu’un vendeur de paniers pût
posséder un tel palais. Il me fit alors monter jusqu’à l’étage supérieur de la maison, dans une vaste chambre
qui était pleine de rameaux de palmiers, et il me laissa libre de choisir ceux qui me plaisaient. Je fis donc le
choix que je voulus et lui en payai le prix, tandis que ses femmes se tenaient dans l’embrasure de la pièce
voisine, cachées derrière une courtine, et regardaient en cachette. Ayant lié les palmes je les chargeai sur
mes épaules et descendis. Le Sarrasin voulait venir avec moi par déférence, mais je refusai croyant
connaître mon chemin. Je circulais alors longtemps, entrais par cette rue, sortais par cette autre, et me
perdis tant et si bien que j’ignorai bientôt totalement de quel côté j’aurais dû me diriger ; et de plus, ce coin
de la ville n’était pas très fréquenté. Je rencontrai finalement un jeune Sarrasin auquel je ne pus dire que :
« Ô Sarrasin, le fontique Catalan ! ». Le jeune homme comprit cependant aussitôt que je m’étais perdu et
que je cherchais le fontique des Catalans. Il se saisit de la partie avant de mon scapulaire et me conduisit
ainsi à grands cris, chants et rires à travers les rues jusqu’au susdit fontique. J’eus à supporter bien des
moqueries tout au long du chemin, mais ni désagrément ni coup, et en fait je n’en avais cure, étant trop
heureux et reconnaissant de me trouver ainsi reconduit. C’est ainsi que je portai ces rameaux jusqu’à notre
chambre. Je me fis confectionner une corbeille à leur taille, et c’est ainsi que j’eus de nombreux soucis et
peines avec eux, plus, peut-être même, que ceux qu’aurait pu avoir un commerçant avec des marchandises
précieuses qu’il aurait eu à transporter jusqu’à terre par voie maritime. C’est avec cette histoire que s’achève
le septième traité de toute notre pérégrination. Avant d’entreprendre le huitième, je décrirai Alexandrie et
toute l’Égypte.
La trace de la ville d’Alexandrie depuis l’antiquité et ce qu’il en est maintenant dans les temps présents. La
fondation d’Alexandrie par Alexandre le Grand
Ce qu’est aujourd’hui la ville d’Alexandrie est assez clair par ce qui précède, mais autrefois c’était la plus
grande ville de l’Egypte. En trois cent vingt avant Jésus-Christ, elle avait été construite par Alexandre le
Grand, le Macédonien, en un laps de temps de dix-sept jours ; elle avait été fondée avec des murailles de
six mille pieds, dont le dessin avait la forme d’une chlamyde ; les flancs qui s’étendaient en largeur pour
l’entourer avaient une largeur d’environ trente stades. Elle était tout entière coupée de rues par lesquelles on
pouvait circuler à cheval ou en char, et de deux voies plus larges qui s’étendaient sur plus d’un arpent et qui
se coupaient l’une l’autre par le milieu, à angle droit. Elle était protégée de tous côtés, comme le dit
Josèphe, par un désert infranchissable, une mer sans port d’attache possible, par des fleuves, et par des
marais touffus. Il est vrai qu’avant Alexandre le Grand, il existait là, sur ce même lieu, une autre ville,
appelée Noo, comme le mentionne St. Jérôme dans sa Vie et mort de Ste. Paula. Alexandre l’abattit et en
reconstruisit une autre nouvelle, magnifique qui possédait de nombreux palais couvrant une grande partie de
la ville. Chacun de ses rois la décorait en effet à sa guise de quelque nouvel ornement monumental et les
nobles l’embellissaient d’autres édifices remarquables. C’est dans l’un de ces monuments merveilleux que
fut déposé le corps d’Alexandre le Grand dans une nacelle d’or que par la suite un roi de Syrie déroba. Des
admirables temples consacrés aux idoles qui y avaient été construits, nous traiterons par la suite dans la
description de l’Égypte, mais l’on peut déjà cependant en prendre connaissance dans l’histoire
ecclésiastique au Livre II c. 31 et suivants.
Situation géographique de la ville d’Alexandrie et son alimentation en eau
Cette ville est la métropole de toute l’Égypte, sise dans la région qui regarde la Libye dans la direction de
l’Afrique, à la limite de la culture du sol, au point qu’au-delà des fortifications de la ville, du côté du coucher
du soleil, s’étend à l’infini un immense désert. Elle n’est pas très éloignée non plus de l’embouchure du Nil,
au point qu’à l’époque de la crue habituelle une partie du fleuve s’écoule en ville, ce qui permet à ses
habitants de conserver le passage des eaux dans de vastes citernes, et des réservoirs souterrains durant
toute l’année, pour leur usage. Toutes les superstructures de la ville reposent en effet sur des voûtes et des
arcades profondément enfoncées dans le sol ; et c’est à travers ces passages souterrains que s’écoule l’eau
du Nil. Ils n’ont pas d’autre eau potable, et pour ceux qui n’y sont pas habitués, elle est malsaine et donne
des fièvres ; presque tous les galiotes de la flotte furent en effet atteints de fièvre à cause de l’eau qu’ils
buvaient sans mesure durant les grosses chaleurs.
Les deux ports d’Alexandrie et son phare
Cette ville est admirablement située pour tout ce qui a trait au commerce. Elle a deux ports distincts, séparés
par une étroite langue de terre, au bout de laquelle se dresse une tour d’une hauteur extraordinaire. On
raconte qu’elle fut édifiée par Jules César, et les gens la nomment Fareglan, comme d’ailleurs l’ensemble du
port y compris la langue de terre et les édifices qui s’y trouvent.
Le port le plus ancien (le premier port) est destiné à l’attache des navires des Chrétiens. Le second pour les
navires des infidèles. La langue qui sépare les deux ports l’un de l’autre supporte un double mur bien
construit avec seize tours, et à la pointe, ou au bout de la langue vers la haute mer se dresse la tour de
César, tel un château et une place forte, qu’un des récents Sultans a agrandi et restauré de façon admirable
convaincu par un renégat chrétien que l’on dit avoir été originaire de Oppenheim, et qui fut l’architecte de cet
ouvrage. L’ouvrage terminé il disparut secrètement et réintégra le sein de l’Église. Certains estiment que
Jules (César) aurait fondé cette tour en mer, à l’endroit où une table du soleil, en or, de toute beauté aurait
été découverte par des pêcheurs. Jérôme en fait mention dans son Épître à Paulin, vers la fin du 1er chapitre
et Valérius Maximus, au Livre IV. Des pêcheurs tirant en effet une drague en mer, un quidam passant sur le
rivage acheta le lancé. Le filet retiré, ils en sortirent une table d’or de grand poids. Une controverse s’éleva
alors entre les pêcheurs et celui qui avait acheté le lancé du filet ; ceux-ci déclarant n’avoir vendu que ce
qu’ils avaient capturé de poissons, l’autre affirmant avoir acheté, guidé par la fortune. Étant donné la
situation, vu la nouveauté du cas et l’importance de la valeur pécuniaire en jeu, l’affaire fut portée à la
connaissance de tout le peuple de la ville, et l’on décida de consulter l’Apollon de Delphes pour savoir à qui
la table devrait être adjugée. Celui-ci répondit qu’elle devrait être donnée à celui dont la sagesse
l’emporterait sur tous les autres. Ils l’envoyèrent donc au sage de Milet qui ne se considérant pas plus digne
qu’un autre l’envoya à Bias. Bias à Pittacus ; celui-ci sans désemparer, à un autre, et ainsi de suite à chacun
des sept sages de la planète jusqu’à ce qu’elle parvînt en dernier lieu à Solon qui jouissait de la réputation
de la plus grande sagesse. Et celui-ci envoya cette table au temple d’Apollon. D’autres auteurs prétendent
que cette même table aurait été trouvée dans une autre région de la mer, dans l’île de Choa, dont au folio
155 voyez de medicis.
Cette tour que les Sarrasins nomment maintenant Fareglan, les anciens la nommaient Pharum ou Farum ce
qui se prononce de la même façon, soit en grec Pharos ce qui signifie la même chose. C’est la plus haute
tour à Alexandrie, et c’était une des sept merveilles du monde. Elle se dressait en effet sur quatre grands
crabes de verre qui reposaient sur le fond à vingt pieds sous l’eau de la mer, et sur lesquels elle avait été
construite, édifiée en énormes blocs de pierre, jusqu’en haut. À son sommet un feu ardent brillait toujours,
qui, brillant au loin sur la mer, indiquait le port aux navigateurs durant la nuit, comme le mentionne le
Catholicum sous la rubrique Pharos, à la lette F. Tous les savants du monde admiraient cet ouvrage, se
demandant comment de si grands crabes avaient pu être fabriqués en verre, comment on avait pu les
transporter sans les briser, comment les fondations posées par-dessus n’avaient pas glissé, comment le
ciment avait pu prendre sous l’eau, et comment une telle masse ne pulvérisait pas le verre. C’est à cause de
cette tour Pharos que les rois d’Égypte ont été appelés Pharaons ; bien plus, toute l’Égypte, à cause d’elle
est parfois appelée Pharaon. La tour s’étant effondrée avec le cours du temps, lorsque Jules vint à
Alexandrie contre Pompée et qu’il l’eut décapité, il édifia celle qui se dresse aujourd’hui, en la faisant
construire sur le même emplacement, en sorte qu’il y ait deux ports de mer. Ces deux ports de mer sont
toujours pleins de navires en provenance de l’Orient et de l’Occident, car Alexandrie reçoit des régions
supérieures de l’Égypte, par la vallée du Nil, toutes sortes d’aliments en abondance, et la richesse lui est
apportée des régions au-delà de la mer par la navigation.
Le commerce à Alexandrie
De toutes parts, de l’Inde, de Saba, de l’Arabie et de l’Ethiopie, de la Perse, de la Médie, et des contrées
avoisinantes, toutes espèces d’aromates, de pierres précieuses, de joyaux, de richesses de l’Orient et de
marchandises exotiques dont notre monde manque, sont transportées à travers la mer Rouge. C’est la route
de ces nations vers chez nous. Elles sont transportées jusqu’à cette ville des régions méridionales de
l’Égypte nommée Ardech, ou Thor et qui est située sur la rive même de cette mer. De là, par chameaux elles
sont acheminées jusqu’au Nil et descendues par le fleuve jusqu’à Alexandrie. C’est ainsi donc qu’a lieu à cet
endroit une telle affluence de peuples, Orientaux et Occidentaux, et que cette même ville est un marché
ouvert pour les deux mondes. Les marchands se sont en effet divisés le monde de la façon suivante : tous
les Occidentaux des régions transalpines, depuis l’océan britannique et au-delà viennent faire leur négoce
en Italie, jusqu’à l’entrée de la mer Méditerranée, Gênes, Venise et autres lieux, mais ne poussent pas plus
loin. Les Italiens, quant à eux, se sont saisis de la mer Méditerranée et font leur négoce à travers ses îles,
jusqu’à Constantinople et les autres contrées maritimes de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, jusque de
l’autre côté de la mer sans oser s’aventurer plus loin pour y faire commerce ; les ports lointains les plus
souvent cités sont Beyrouth, Tripoli et Alexandrie. Quant aux Grecs, Cappadociens, Arméniens, Syriens,
Palestiniens, Arabes et Égyptiens et Libyens, ils font négoce sur les rivages de la mer, à travers leurs vastes
contrées jusqu’à Ardech, ou Thor, au pied du Mont Sinaï ; c’est là qu’ils prennent aux Indiens les épices
aromatiques, de là qu’ils les transportent vers leurs pays, et les Égyptiens en gorgent Alexandrie. Quant aux
Indiens, nous ignorons de quelles étendues de terre ils jouissent pour leur négoce. Nous savons cependant
que tous les ports de mer s’enrichissent de leurs marchandises, et que les Indiens occupent la limite de la
terre habitable du côté de l’Orient. Des esclaves qu’un Sultan avait en effet envoyé pour explorer les origines
du Nil, cheminèrent durant trois ans jusqu’au-delà de l’Inde et déclarèrent en revenant, qu’au-delà de l’Inde il
n’y avait aucune population, rien qu’une terre inhabitée, où l’ardeur du soleil était telle qu’ils n’avaient pas pu
la supporter et n’avaient pu réussir à aller au-delà de la vallée du Nil à cause de la chaleur brûlante. Les
navires en provenance de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe mouillent donc à ce port d’Alexandrie, mais les
navires de l’océan Indien ne peuvent y parvenir comme on l’a expliqué plus haut au folio 61.
Les fortifications de la ville d’Alexandrie
C’est à cause de cette arrivée quotidienne de navires que la ville est protégée de murailles formidables, de
tours et de postes de garde. À l’intérieur de la ville elle-même il y a deux hautes collines formées d’un
amoncellement de terre, non par la nature mais accumulée artificiellement par l’industrie et le travail
humains. Sur chaque colline se dresse une haute tour fortifiée, du haut desquelles on peut observer de loin
sur la mer l’approche des navires. Dès qu’un navire est aperçu, un signal est donné par les gardes des
murailles, afin d’en avertir le capitaine ou l’Amiral, préfet de la ville. Celui-ci prévenu de l’arrivée d’un ou de
plusieurs navires, donne l’ordre d’apprêter une barque rapide et d’enfermer à fond de cale quatre ou cinq
pigeons de son pigeonnier. Ceux qui partent en mission de reconnaissance les emportent avec eux dans la
barque, et ils s’élancent au-devant des navires en approche ; ils décrivent ce dont il s’agit et renvoient les
pigeons à leur maître avec un billet. Le préfet prend alors ses dispositions selon le contenu de la nouvelle
reçue, ou bien il reste tranquille ou bien il s’agite, et envoie d’autres bateaux si les navires aperçus sont
armés. À propos de ces pigeons-voyageurs, voyez plus haut au folio 85 a. En aucune région de ses terres
ou de son royaume le Sultan ne possède une garde égale à celle d’Alexandrie. Plus qu’ailleurs en effet ils y
craignent l’invasion des Chrétiens, et c’est pourquoi généralement le préfet d’Alexandrie est un homme de
guerre avisé, à qui revient, selon le cours normal des choses, le sultanat après la mort du roi.
Cette ville a connu de nombreuses batailles importantes. Les Romains la ruinèrent autrefois, mais
l’empereur Trajan la reconstruisit. L’an du Seigneur 1230, Pierre, frère du roi de Chypre, de nationalité
française, ayant armé une flotte, l’attaqua avec les Catalans et les Francs, la démembra, y mit le feu, et en
emporta un très riche butin. Elle ne s’en remit pas par la suite, et c’est pourquoi elle n’est aujourd’hui qu’une
cité désolée ; chaque jour les maisons s’y écroulent les unes après les autres, et ce ne sont que de
misérables ruines à l’intérieur de fortifications imposantes, la population y est peu nombreuse. À part les
mosquées, les maisons des Mamelouks et des dirigeants, et les fontiques des commerçants, elle est à peu
près déserte, et des maisons encore debout demeurent même sans habitants.
L’histoire religieuse d’Alexandrie
Cette cité, depuis le temps de St. Marc, l’évangéliste qui y fut le premier évêque, jusqu’à l’époque où les
Sarrasins s’en emparèrent, fut un gouffre d’homme saints, remarquables par leur savoir et leurs vertus dont
il faudra dire quelque chose par la suite. Elle fut pour ainsi dire l’origine de la religion, mais elle fut aussi
l’origine de la désolation pour la foi. Au temps de Mahomet en effet, des troubles éclatèrent à Alexandrie
entre la population et des commerçants grecs, et la population d’Alexandrie, contre eux, fit appel à l’aide de
Mahomet. Celui-ci les délivra des Grecs, les soumit à son autorité, et fit disparaître la foi au Christ. Le
Patriarche d’Alexandrie, Dioscore, fut en effet le premier chef de l’Eglise à s’accorder avec Mahomet et à se
soumettre à sa loi ; entraînant ainsi à leur perte son Patriarcat et toute l’Égypte, et la contamination des
autres parties du monde. Il y aurait à ce sujet un long traité à écrire pour celui que la chose tenterait. Cela
suffit pour Alexandrie. »
- 161 - 179 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS WERLI VON ZIMBER (du 23 octobre au 14 novembre 1483)
Zimber, H. W. von, « Hans Werli von Zimber », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Le texte qui suit est une version abrégée du récit de Félix Fabri (1483).
p. 177-180 bis :
« Le chemin bifurqua vers la droite et nous passâmes au pied de collines verdoyantes. Sur notre gauche
s’étendait une vaste plaine. Elle est recouverte d’eau quand le Nil déborde et quand il se retire, il laisse une
couche de sel. C’est pourquoi on aurait dit qu’il avait neigé car elle en était toute blanche. C’est un sel de
bonne qualité que l’on emploie dans tout le pays. Là, nous vîmes aussi beaucoup de vieux murs, comme si
c’était une ville détruite. Alexandrie était si grande qu’elle venait jusque-là.
Comment les pèlerins arrivèrent à Alexandrie
Quittant la plaine de sel, nous arrivâmes devant une montagne où il y avait beaucoup de jardins et d’arbres.
Un chemin creux la traversait, nous le prîmes jusqu’à une colline sur laquelle nous montâmes. Alors nous
aperçûmes la noble ville d’Alexandrie entourée d’un côté par la grande mer et de l’autre par de magnifiques
vergers où poussent tant de palmiers que l’on croirait une épaisse forêt de sapins. La campagne autour
d’Alexandrie est très fertile et l’on y trouve tous les produits qui existent au monde. Comme nous
approchions de la ville, les chameliers nous firent descendre des chameaux et des ânes en nous disant que
d’habitude les Chrétiens n’entraient pas dans la ville sur leur monture. Nous arrivâmes à une porte que les
païens fermèrent devant nous en nous montrant le fossé qui faisait le tour jusqu’à une autre porte. Nous le
contournâmes donc, poursuivis par les enfants qui nous jetaient des pierres ; comme ils avaient des frondes,
ils pouvaient lancer fort et loin. En outre, derrière les créneaux, des païens nous injuriaient en nous jetant
des pierres. Nulle part nous ne fûmes aussi mal accueillis qu’à Alexandrie.
Après avoir fait un grand tour, nous nous trouvâmes devant une porte magnifique où se tenait un païen avec
un mousquet ; avant d’entrer, nous dûmes lui payer la douane pour les chameaux et les ânes. Il n’exigea
rien pour nous car cela devait être fait plus tard. Une fois la douane payée, nous passâmes par une grande
et solide porte pourvue de battants de fer, de hautes tours et d’échauguettes. Nous nous engageâmes dans
un tournant entre de hauts murs pour arriver devant une autre grande porte de fer qui ouvrait sur la ville ;
elle était gardée par des Sarrasins armés d’arcs et de mousquets, qui nous repoussèrent. Ils firent
s’agenouiller les chameaux entre les deux portes, jetèrent à terre toutes nos affaires, chassèrent les
chameaux et les ânes par la première porte qu’ils verrouillèrent soigneusement. Ensuite ils repartirent sous
l’autre porte vers la ville et nous enfermèrent avec nos affaires entre les deux portes en nous disant que
nous devions rester là jusqu’au lendemain pour nous fouiller et nous taxer car le soleil allait se coucher et on
ne pouvait pas s’occuper de nous le soir. D’une pierre, nous frappâmes la porte, en nous plaignant que nous
(p. 177 bis) n’avions pas mangé depuis longtemps. Nous demandâmes aux païens de nous donner de l’eau
et du pain que nous paierons le double. Alors l’un d’eux nous apporta une corbeille avec des dattes fraîches
et du pain chaud du four ainsi que de l’eau. Nous lui donnâmes l’argent et nous mangeâmes ces vivres ainsi
que ce que nous avions dans nos sacs. Nous nous sentions bien et tranquilles dans notre prison car
personne ne pouvait venir nous y importuner. Les pèlerins qui n’arrivaient pas à dormir entre les fortifications
montèrent au clair de lune sur les murailles extérieures, sur les échauguettes et les donjons. Ils furent
émerveillés par les hautes tours, les murailles épaisses et les larges fossés.
Le vingt-quatrième jour d’octobre, à l’aube, nous rassemblâmes nos affaires, nous cachâmes les objets
précieux et l’argent là où nous étions sûrs qu’ils n’iraient pas les chercher et nous fermâmes bien nos sacs et
nos paniers. Les pèlerins, qui avaient beaucoup d’objets de valeur et d’argent, imaginèrent une foule de
choses. Certains les cachèrent dans les cruches, d’autres dans le pain, d’autres les cousirent dans leurs
vêtements. Je n’avais pas ces soucis car ma bourse était vide. Quelques-uns avaient des gobelets plein de
baume, ils les enfouirent dans les pots de graisse. Comme nous arrangions ainsi nos affaires, le trucheman
Ali nous dit qu’il serait préférable d’ouvrir les sacs et les paniers, et, de tout étaler quand ces messieurs de la
douane arriveraient. Tout devait être ouvert car s’ils voyaient un sac bien fermé, ils le fouilleraient d’autant
plus. Donc nous ouvrîmes et nous étalâmes tout. Lorsque le soleil fut levé, les païens arrivèrent, ouvrirent
les deux portes et laissèrent entrer de nombreux chameaux chargés d’épices qui avaient attendu devant la
porte extérieure. Ils fouillèrent les chameliers si soigneusement en notre présence que nous pensâmes :
« s’il en était ainsi des païens, qu’adviendra-t-il de nous, pauvres chrétiens ? » À ce moment-là arriva vers
nous un mamelouk noir plein de zèle nous disant qu’il était le trucheman des Chrétiens à Alexandrie. Il se
comporta très aimablement et sans flatterie. Nous lui donnâmes la lettre du sultan selon laquelle il ne fallait
pas nous fouiller et nous lui demandâmes de nous aider. Il répondit ainsi : « on vous fouillera mais je
demanderai à ces messieurs de vous traiter avec bienveillance ». Lorsque les païens de la douane furent
sous la voûte de la porte intérieure, le trucheman, dont le nom était Schambeck, leur donna la lettre. Ils la
prirent, embrassèrent le sceau du sultan et la lurent. Ceci fait, ils appelèrent mon seigneur et frère, le comte
Jean de Solms, lui enlevèrent manteau et tunique, ne lui laissant que son pourpoint, puis ils le fouillèrent
partout où ils pensaient trouver de l’argent ou des pierres précieuses. Ils inspectèrent ensuite ses poches,
prirent l’argent qu’ils trouvèrent et l’ajoutèrent à un petit tas d’anneaux et de chaînes d’or qu’il avait sur lui et
le laissèrent partir. Ils firent de même avec les seigneurs Ferdinand von Werna et Maximus von
Rappenstein, avec tous les chevaliers ainsi qu’avec moi et les deux frères déchaussés. Mais ils ne
s’occupèrent pas beaucoup de nous autres moines. J’avais une grande bourse, ils la palpèrent mais ne
l’ouvrirent pas. Je tenais une cruche d’eau qu’un chevalier m’avait donné à porter et dans laquelle se trouvait
une centaine de ducats, ils ne l’examinèrent pas. Après nous avoir tous fouillés, ils allèrent inspecter les
paniers et les sacs mais ils ne s’y attardèrent pas.
Quand tout fut fini, ils appelèrent les seigneurs sur lesquels ils avaient trouvé de l’or, de l’argent et des
pierres précieuses. Ils estimèrent ce que chacun possédait et ils prélevèrent une taxe peu élevée. Ensuite,
ils rendirent à chacun ce qui lui appartenait à un liard près et fixèrent une taxe globale pour chaque
personne sur ce que nous avions dans les paniers et dans les sacs. La taxe ne se montait pas à beaucoup ;
à nous autres moines, ils nous en firent cadeau. Nous en fûmes donc quittes à bon compte, était-ce en
raison de la lettre du sultan, je n’en sais rien. Nous entrâmes avec notre équipement dans la ville dont le
délabrement était lamentable. Nous étions étonnés de voir qu’une ville avec de telles murailles et de belles
tours magnifiques pouvait être aussi misérables et abandonnées. Nous arrivâmes à la maison du roi de
Sicile où réside le consul de Catalogne, hôte des Allemands et Chrétiens. Il nous accueillit cordialement et
nous donna des chambres où nous portâmes nos bagages. Nous avions terminé quand l’émir, ou capitaine
d’Alexandrie nous envoya le trucheman afin de faire venir chez lui tous les pèlerins nobles. Il les reçut avec
beaucoup d’honneurs, les examina sérieusement et les fit reconduire. Ensuite nous nous mîmes d’accord
avec le consul pour prendre pension chez lui, toutefois le comte Jean de Solms et ses serviteurs avaient un
régime particulier. Nous mangeâmes et nous bûmes, contents d’être chez les Chrétiens.
Après le repas, le trucheman vint nous dire que nous ne devions sortir de la maison que sous son escorte,
autrement les gens nous feraient subir maintes tracasseries dans la rue. Contre un paiement, il nous
assurerait également le libre accès à la mer jusqu’aux galères ; (p. 178) il exigea de nous treize ducats par
personne. Comme il nous semblait qu’il en demandait davantage à nous qu’à d’autres pèlerins, nous ne lui
donnâmes aucune réponse et nous ne sortîmes pas. Cependant nous pouvions aller en haut de la maison
d’où nous apercevions, au-delà de la ville, la mer et les galères vénitiennes où nous brûlions d’envie d’aller.
La maison était vaste ; beaucoup de gens, Chrétiens, païens et Juifs allaient et venaient.
Le vingt-cinquième jour, nous assistâmes à la messe dans la chapelle de la maison où un frère sicilien, de
mon ordre, était chapelain. Après la messe, nous entendîmes une grande clameur et des coups de
mousquet en mer. Nous montâmes sur la terrasse et nous vîmes beaucoup de bateaux de corsaires avec
des païens armés qui entraient au port. C’était un grand seigneur de Barbarie en Afrique qui fut accueilli par
les mamelouks d’Alexandrie. Il se rendait en pèlerinage à La Mecque sur le tombeau de Mahomet. Lui et ses
gens avaient capturé en mer un petit bateau contenant treize Chrétiens qu’ils voulaient vendre à Alexandrie.
Ils en faisaient une grande fête, ils poussaient devant eux les Chrétiens enchaînés, à travers la ville. Ceci
nous emplit de pitié, nous et tous les autres Chrétiens.
Le vingt-sixième jour d’octobre, un dimanche, je dis la messe dans la chapelle. Après la messe et le repas,
les marins des galères vénitiennes vinrent nous vendre du vin. Ce jour-là, un grand bateau arriva de la
chrétienté. Il était plein de noisettes, on estimait à notre grand étonnement qu’il y en avait pour plus de dix
mille ducats. Les noisettes ne poussent pas en Orient et les païens les aiment beaucoup, elles sont pour eux
une friandise coûteuse. Par ailleurs, en traversant la mer elles acquièrent la propriété de ne pas sécher, de
ne pas devenir véreuses ou huileuses comme chez nous quand on les a depuis un an. Là-bas elles peuvent
se conserver pendant cent ans. Le vingt-septième jour, je me levai de bonne heure selon mon habitude et je
fis ma prière. Ensuite je me mis à aller et venir dans la maison pensant qu’il ne m’arriverait rien si j’allais au
marché en ville. Je me persuadai donc moi-même et je me rendis au marché au milieu des païens ; je me
promenai en les regardant quand j’arrivai par hasard devant une boutique où était assis Schambeck, le
trucheman. Je sursautai et, tout apeuré, je lui fis un grand salut espérant ainsi qu’il serait bien disposé
envers moi et qu’il ne me tiendrait pas rigueur d’être sorti sans lui. Il m’appela et il me dit en italien : « rentre
et dis aux pèlerins que je viendrai après le repas chercher les treize ducats que chacun me doit ». Je le priai
alors en italien comme je pouvais, d’être généreux envers moi car j’avais tout dépensé et je n’avais plus
d’argent. Il répondit : « ti sei prete e non pagerai niente », c’est-à-dire « tu es religieux et prêtre, donc tu n’as
rien à payer, tu ne me dois rien ». Je l’en remerciai beaucoup et je rentrai rapporter la nouvelle aux pèlerins
ainsi qu’il me l’avait ordonné. L’après-midi, il vint avec son registre où étaient inscrits treize ducats, sauf pour
les moines, dont on ne prenait rien, et les prêtres séculiers qui payaient la moitié. Les seigneurs durent donc
payer treize ducats alors qu’auparavant les droits étaient de cinq ducats. Nous en étions très surpris, mais
on nous dit que Tanguardin, le trucheman du Caire, avait écrit que nous étions de grands seigneurs fortunés
qui ne regardaient pas à la dépense, donc que l’on pouvait fixer pour nous une taxe élevée. Quand
Schambeck fut payé, il nous fit sortir par la porte de la ville qui menait à la mer vers les galères, et il dit aux
gardes que nous avions payé et qu’ils devaient nous laisser entrer et sortir à notre grès.
Le vingt-huitième jour, fête des saints Simon et Jude, après que nous eûmes dit la messe et mangé, le
trucheman nous conduisit par une longue rue jusqu’à l’endroit où sainte Catherine avait été enfermée dans
un cachot douze jours et douze nuits sans manger et boire alors que Porphyre et l’impératrice voyaient et
entendaient le choeur des anges près de la vierge. Le cachot existe encore et nous nous y glissâmes en
invoquant la sainte. Devant le cachot se dressent deux grandes colonnes de marbre, distantes de douze pas
l’une de l’autre, sur lesquelles se trouvaient les roues garnies de pointes qui devaient déchirer le corps de
sainte Catherine, mais les anges du ciel brisèrent les roues et sauvèrent la sainte de ce supplice.
L’empereur la fit alors mener hors de la ville pour la décapiter. Nous allâmes également voir ce lieu où se
dressent deux colonnes de marbre rouge dont l’une est renversée. Les anges vinrent là prendre le corps et
la tête qu’ils transportèrent à travers les airs sur le mont Sinaï où nous étions, il y a aujourd’hui trente-cinq
jours.
Ensuite, nous visitâmes, en ville, une église appelée Saint-Sabba. Elle appartient à des moines grecs
caloyers et elle est située là où sainte Catherine avait vécu avant son martyre ; elle n’est pas loin de son
cachot et près de là se trouve également l’emplacement où furent brûlés les cinquante notables convertis
par sainte Catherine. De là nous nous rendîmes à Saint-Marc, église tenue (p. 178 bis) par les Jacobites.
C’est à cet endroit que vécut saint Marc l’Évangéliste quand il était évêque à Alexandrie et qu’il célébra la
messe. C’est de là qu’il fut traîné par une corde à travers la ville jusqu’à la mer pour y être martyrisé. Nous
arrivâmes dans une autre église appelée Saint-Michel, elle appartient aussi aux Jacobites et on y enterre les
Chrétiens et les pèlerins qui meurent à Alexandrie. On nous montra aussi le lieu où saint Jean l’Aumônier fut
supplicié.
Nous vîmes également les quatre fondiques, c’est-à-dire les quatre comptoirs des Chrétiens où quatre belles
chapelles de notre rite avec des chapelains chrétiens s’y trouvent. Les Vénitiens en ont deux, les Génois
une et les Catalans une. Nous nous rendîmes ensuite à l’endroit où se dressait autrefois le palais de
l’empereur Alexandre le Grand. On y voit une colonne carrée et pointue faite d’un seul bloc de pierre rouge
et très haute comme une tour. Les inscriptions gravées ne sont rien d’autre que des haches, des houes, des
couteaux, des pelles, des chiens, des oies, des oiseaux et autres choses simples. On pense que des lettres
antiques étaient représentées par de tels signes. Cette colonne est beaucoup plus haute que celle qui est à
Rome derrière la basilique Saint-Pierre ; elle est appelée « l’aiguille » et qui, dit-on, se serait dressée près de
celle d’Alexandrie et aurait été amenée à Rome par Alexandre le Grand. Nous vîmes beaucoup de belles
mosquées un peu partout dans la ville ainsi que des restes de bâtiments en marbre qui témoignaient de la
splendeur du passé. Ensuite, nous rentrâmes. Ce même jour les pèlerins virent arriver en mer un bateau
chargé de marchandises, le capitaine d’Alexandrie voulut le faire capturer mais les chrétiens se défendirent
avec tant d’acharnement que les païens durent regagner Alexandrie. Nous en rîmes beaucoup et nous leur
dîmes qu’ils étaient courageux et forts en face des gens quand ils sont nus, mais lâches et faibles quand ils
sont armés. Le soir le même bateau réussit à entrer dans le port, il était sauvé car les païens peuvent piller
les bateaux quand ils sont en haute mer mais dès qu’ils sont dans le port, ils sont en sécurité. Cette nuit-là,
un bateau vénitien et un bateau génois entrèrent au port, les Vénitiens avaient pillé les Génois lors de la
guerre entre les Vénitiens et le duc de Ferrare. C’est également cette nuit-là que Monsieur Jean, comte de
Solms, tomba malade.
Le vingt-neuvième jour d’octobre, nous allâmes en ville visiter les comptoirs et ce qui s’y vendait car à
Alexandrie, il n’y a de beau que les comptoirs et les maisons des mamelouks ainsi que les mosquées. Nous
sortîmes au comptoir des Génois. C’est une belle maison avec une jolie chapelle et un jardin d’agrément où
poussent des plantes étranges. Il s’y trouve beaucoup de riches marchands génois qui ont un chapelain de
l’ordre des Prédicateurs. Nous allâmes dans le petit comptoir des Vénitiens. Dans la cour, il y avait
beaucoup de grandes balles et de sacs qui devaient être exportés, six autruches et de jeunes gazelles y
couraient, beaucoup de marchands entraient et sortaient. Nous visitâmes ensuite le grand comptoir des
Vénitiens où régnait une grande activité, des marchandises arrivaient et partaient continuellement, un
commerce important s’y faisait. Il ressemble à un monastère et dans la cour, nous vîmes une grande
quantité de cuivre qu’ils importent de nos pays. Il s’y trouvait également un cochon que nous n‘avions jamais
vu de ce côté de la mer car les païens et les Sarrasins n’aiment pas ces animaux et n’en mangent pas la
viande, tout comme les Juifs. Il leur est désagréable de voir là le cochon aller et venir mais les Vénitiens ont
obtenu du sultan l’autorisation de le conserver, peut-être pour ennuyer les païens, car lorsque le cochon en
voit un dans la cour, il court derrière lui, grogne, gémit et ne le quitte pas jusqu’à ce qu’il sorte. Les païens en
ont honte et ne reviennent plus.
Dans la cour, nous aperçûmes aussi beaucoup d’autruches et un perroquet blanc comme neige, d’une
grande valeur, son prix dépasse de beaucoup 50 ducats. L’oiseau savait parler l’italien d’une manière
étonnante. Il y avait en outre deux léopards enchaînés. Nous allâmes ensuite au comptoir des Turcs où des
marchandises étaient sans cesse chargées et déchargées, des gens imposants et graves s’y trouvaient,
c’étaient des marchands turcs. Nous nous rendîmes ensuite au comptoir des Maures, où se trouvaient des
quantités de choses étranges, puis au comptoir des Tartares où l’on vendait des choses magnifiques à un
prix minime. Il y avait là une trentaine de garçons et des filles attendant d’être vendues. Nous regardâmes
un long moment comment cette vente se faisait. Quand un inconnu se tient là, ceux que l’on veut vendre
l’observent, pensant qu’il est là pour acheter. Quand un acheteur arrive, il regarde les enfants et sort du
groupe celui qui lui plaît, il l’examine, le déshabille (p. 179) et remarque s’il a honte, s’il est triste ou s’il est
content. Ensuite, il le cingle d’une petite baguette pour voir s’il se comporte courageusement ; il lui donne à
manger pour constater s’il dévore avec gloutonnerie, il le regarde dans les yeux, lui souffle dans les oreilles,
lui parle sérieusement et gaiement. Il l’observe ainsi en tout et offre un prix dans la mesure où il lui plaît. Les
païens sont de grands connaisseurs, ils voient tout de suite à qui ils ont affaire. Je suis souvent resté seul
dans la cour à regarder ce commerce lamentable. Après avoir visité les comptoirs, nous traversâmes le
marché où l’on vendait de tout, surtout des aliments, et nous nous dirigeâmes vers la porte pour aller au
bord de la mer mais, arrivés là, les païens nous fouillèrent pour voir si nous avions des marchandises sur
nous et ils le firent toutes les fois que nous entrions et sortions. Je fus fouillé plus de huit fois sous la porte
par les païens mais ils me laissèrent quelquefois passer sans rien faire car j’entrais et je sortais parfois dix
fois par jour. Ils fouillaient également les grands gentilhommes de Venise et de Gênes, les marins et même
les païens. Après avoir été fouillés, nous nous rendîmes au bord de la mer où tout était sans dessus
dessous. Les marchands apportant des marchandises de la ville devaient ouvrir et vider leurs sacs sur le
rivage, afin de vérifier s’ils ne chargeaient rien d’autre que ce qu’ils avaient acheté. Plus de six cent
mandiants arabes miséreux entouraient les monceaux de gingembre, de clous de girofle, de noix de
muscade, etc., pour essayer d’en voler. Ils portaient de petits sacs pleins de ce qu’ils avaient trouvé et
chapardé. Il fallait être sur ses gardes et de temps en temps, les marchands demandaient à un mamelouk
de chasser les mandiants. Une fois j’en vis un qui les faisait avancer devant lui comme des cochons en les
frappant avec un bâton, si impitoyablement, comme si c’était du bétail que j’en eus pitié.
Nous retournâmes ensuite en ville et nous fûmes de nouveau fouillés. Nous arrivâmes au comptoir des
Catalans où nous logions. Dans la cour, il n’y avait pas beaucoup d’allées et venues de marchands mais elle
était grande et belle. Un léopard y était attaché et il déchirait tout ce qui était à sa portée. Dans la maison
une Mauresque avait désobéi à la maîtresse et je la vis être battue à coup de poing, à coups de bâton et à
coup de pied de telle sorte qu’un boeuf ou un cheval n’aurait pu le supporter mais elle, personne ne pouvait
la maîtriser, elle griffait, mordait, déchirait, crachait, tirait la langue, saignait de toutes parts, blasphémait le
nom de Dieu, louait Mahomet, se mordait les mains et les bras comme si elle avait perdu l’esprit, mais c’était
seulement une crise de colère. On dut lui tirer les pieds et les mains, et, la laisser étendue sur le sol. De ma
vie je ne rencontrerai quelqu’un de plus dur et de plus méchant que la Mauresque.
Le trentième jour d’octobre, deux autres galères vénitiennes appelées Trafico arrivèrent d’Afrique ; nous
fûmes très contents. Le jour même, nous nous mîmes à négocier avec les patrons pour louer nos places et
partir. Ils étaient cependant bien plus durs et inflexibles envers nous que les païens car ils savaient que nous
étions obligés de partir avec eux. Ils exigèrent cinquante ducats par personne, certains même davantage ; ils
n’agirent vraiment pas d’une manière convenable avec nous. Étant donné ce prix élevé, ce fut la faute des
patrons si chaque pèlerin dut essayer de trouver une place au meilleur marché possible. Ainsi nous dûmes
nous séparer et nous ne fûmes pas tous ensemble sur le même bateau car celui qui trouvait un patron
complaisant, il louait chez lui, et il y avait six galères. Pour moi c’était difficile car il ne me restait que très peu
d’argent, c’est pourquoi je ne me dépêchai pas de louer. Ce même jour, j’allai avec Monsieur Bernhardt von
Breitenbach dans sa galère où il avait loué des places pour son maître, le comte Jean de Solms, et sa suite,
ce qui faisait donc six pèlerins. C’était une belle galère toute neuve et spacieuse sur laquelle se trouvaient le
capitaine de la ville, le consul d’Alexandrie et de nombreux gentilhommes de Venise, Monsieur Sébastian
Conterin en était le patron.
Quand nous retournâmes en ville, j’allai au grand comptoir des Vénitiens voir Monsieur Sébastian Conterin,
patron de la galère, et je pris pension sur son bateau. C’était un homme très complaisant. Quand Monsieur
Hans Unger, mon compagnon, entendit cela, il loua sa place également chez lui. J’en fus très heureux car
c’était un compagnon excellent. Nous fûmes donc séparés les uns des autres, ceux du premier groupe,
Monsieur Hans Lazino de Hongrie et moi Félix, nous étions dans le premier bateau, celui où était le
capitaine avec la noblesse. Ceux du deuxième groupe étaient avec un patron appelé Andrea de Lordan. Les
deux frères déchaussés étaient avec Marco de Lordan. Ceux du troisième groupe avec Bernardino Conterin.
Le louage se fit au milieu des querelles et de discussions dont je préfère ne pas en parler.
Le trente et unième jour d’octobre, veille de la Toussaint, Monsieur Bernhardt von Breitenbach me prêta de
l’argent pour me permettre de retraverser la mer. Il ne voulait pas être remboursé et me le donna au nom de
Dieu qui le lui rendrait dans l’autre monde. Alors j’allai en ville et j’achetai chez un Sarrazin plus de cinquante
palmes et je fis faire un panier afin de les transporter. Le soir, le médecin des marchands examina le comte
Jean de Solms qui était très malade mais conscient ; il nous dit qu’il ne passerait pas la nuit. Le comte se
confessa avec recueillement à son confesseur, le Révérend Père Paul ainsi qu’il l’avait déjà fait à Jérusalem.
Il voulait recevoir les Saints sacrements le lendemain matin, mais Dieu en décida autrement.
Le premier jour du mois de novembre est la Toussaint. Peu de temps après minuit, Monsieur Jean, comte de
Solms, décéda entre les mains de son confesseur et en présence de ses serviteurs ainsi que de beaucoup
de pèlerins en prières. Nous l’enveloppâmes d’un linceul, nous le mîmes en bière et nous le transportâmes
dans la chapelle de la maison. Dès que le jour parut, nous célébrâmes plusieurs messes pour le repos de
son âme. Ensuite, nous demandâmes au consul de Catalogne, notre hôte, comment et où nous devions
l’enterrer. Il nous répondit que nous ne pouvions le faire sans l’autorisation de l’Armiregio, capitaine
d’Alexandrie. Nous envoyâmes le consul chez le Mamelouk pour obtenir l’autorisation d’enterrer notre mort
et il nous le donna. Nous aurions aimé porter nous-mêmes notre cher défunt à l’église Saint-Michel, mais
deux païens sarrasins vinrent nous dire que c’était leur tâche et ils ne voulurent pas nous laisser faire. Ils
prirent le défunt ; tous les seigneurs, les pèlerins ainsi que tous les prêtres latins d’Alexandrie,
l’accompagnèrent. Je marchais devant le corps et lisait la messe des morts dans mon missel quand un
païen s’approcha de moi et me cracha au visage, cela m’en coula sur la bouche. Nous arrivâmes à l’église
Saint-Michel, nous célébrâmes une messe et ensuite les Jacobites soulevèrent une grande dalle sous
laquelle se trouvait un tombeau magnifique. Chantant les cantiques de circonstance, nous y mîmes notre
cher défunt au milieu des pleurs et de la tristesse de tous les pèlerins. Ensuite nous rentrâmes.
L’enterrement avait coûté quatorze ducats que l’on avait dû donner de côté et d’autre. Ce jour-là plusieurs
pèlerins partirent d’Alexandrie avec leurs bagages, embarquèrent sur leur galère et ne revinrent plus en ville.
Le deuxième jour de novembre était le jour des morts. Après la messe et le repas, Monsieur Johan,
chapelain du roi de Hongrie et moi, nous allâmes nous promener dans Alexandrie et nous visitâmes bien la
ville. Les autres pèlerins embarquèrent sur leur galère. Alexandrie est une grande ville, même pas un
dixième en est habité et la plus grande partie tombe en ruines. Du côté de la mer, la ville est bien fortifiée,
maintenant plus qu’autrefois, car le sultan Kathubee vient de faire construire un bâtiment magnifique qui va
de la ville jusqu’en mer. D’après ce que l’on nous dit, il avait été conseillé par un mamelouk allemand
d’Oppenheim qui, actuellement, n’est plus dans le pays. Il fit construire un château sur les rochers en mer,
qui se trouvent à l’entrée du port très accidenté. Il est situé à un grand mille italien ou plus de la ville et, du
château, une muraille double avec seize tours traverse la mer jusqu’au rivage vers la ville. Un gouverneur y
réside et quand des bateaux entrent dans le port, ils doivent ramener les voiles devant le château pour lui
faire honneur et le saluer ; si les marins ne le font pas, les gens du château tirent sur eux. On ne laisse
aucun chrétien pénétrer dans le château. On ne nous laisse pas non plus monter sur les collines qui sont
dans la ville car, au port, ils nous craignent beaucoup.
Dans la ville, il y a deux hautes collines artificielles faites de mains d’hommes. De leur sommet, on voit très
bien la mer et un garde y est toujours en faction afin de voir ce qui arrive. Dès que les voiles sont en vue, sur
la tour qui est sur la colline, il met autant de fanions qu’il aperçoit de voiles afin qu’en ville on en soit informé.
Quand le capitaine apprend que des bateaux étrangers arrivent, il y envoie, dans une embarcation,
quelques-uns de ses hommes portant une cage avec trois ou quatre pigeons. Ceux-ci sont habitués à
regagner leur point de départ lorsqu’on les lâche, aussi loin qu’on puisse les avoir emmenés. Lorsque les
hommes apprennent une nouvelle que le capitaine doit savoir, ils écrivent un message, l’attachent sur un
pigeon qu’ils lâchent et qui retourne chez le capitaine. S’ils apprennent encore quelque chose, ils lâchent un
autre pigeon et le capitaine agit en conséquence. Parfois il envoie les mêmes pigeons au Caire qui lui
rapportent rapidement d’autres nouvelles.
Le capitaine d’Alexandrie est très estimé (p. 180) de tous les mamelouks et quand un sultan meurt, il n’est
pas loin du trône. Nous visitâmes donc la ville d’Alexandrie, c’est une noble ville dans laquelle Philadelphe,
le roi d’Égypte, possédait une bibliothèque de cinquante mille livres. C’est là qu’existait aussi l’école des
soixante-douze traducteurs et interprètes de la Bible. Il y avait beaucoup de saints évêques et patriarches
car c’est l’un des quatre patriarcats de la chrétienté. C’est là que fut martyrisée sainte Catherine ainsi que
des milliers de martyrs avant et après elle. Le troisième jour de novembre, le capitaine de notre galère la fit
avancer jusqu’au nouveau château. Voyant cela, nous pensâmes qu’il voulait partir. Nous louâmes
beaucoup d’ânes sur lesquels nous chargeâmes tout ce qu’avaient acheté le défunt comte de Solms,
Monsieur Bernhard von Breitenbach, Monsieur Philips von Bichen, Monsieur Hans Knauss, l’interprète,
Henke, le cuisinier de Monsieur de Solms et Eckhart son écuyer ainsi que toutes les affaires de Monsieur
Hans, chapelain du roi de Hongrie et les miennes. Je n’avais certes pas grand-chose, mais une seule
personne ne pouvait pas tout porter, rien que les palmes étaient déjà très lourdes. En outre, l’écuyer du
défunt comte de Solms avait caché, dessous, les épées qu’il avait achetées car les païens ne laissent sortir
du pays ni épées ni arcs, ni autres armes qu’ils prennent. Cela terminé, nous demandâmes à Schambeck,
notre trucheman, de nous accompagner afin de ne pas être fouillés aux trois douanes par lesquelles il fallait
passer avant d’arriver à la mer.
Lorsque nous fûmes prêts, Monsieur Hans Unger et moi, nous allâmes faire les comptes avec le consul qui
était le maître de maison. Comme l’un de nous lui devait encore trois ducats, je lui demandai de se montrer
généreux et il me fit cadeau des trois ducats au nom de Dieu. Nous quittâmes la maison avec toutes nos
affaires et, lorsque nous arrivâmes à la première porte, les douaniers accoururent et jetèrent à terre les sacs
et les paniers. Ils voulaient en couper les cordes, mais le trucheman leur jura qu’ils ne contenaient pas de
marchandises et il leur donna quelques médins de notre part. Ils nous laissèrent passer et nous arrivâmes à
la porte de fer. Les douaniers firent comme les précédents et nous leur donnâmes également des pourboires
pour pouvoir passer. Nous arrivâmes enfin à la mer où nous déchargeâmes les ânes. Lorsque nous eûmes
fait un tas de toutes nos affaires, les douaniers païens méchants et rusés accoururent et se mirent à fouiller.
Ce qu’il ne pouvait ouvrir tout de suite, ils le coupaient. Voyant cela, je sortis du tas ce qui m’appartenait et je
m’assis dessus. Sur ce arriva un jeune douanier qui voulait me fouiller, je lui dis que j’étais prêtre et enlevai
ma calotte pour lui montrer ma tonsure. Jusqu’à présent j’avais voyagé à travers l’Égypte sans être fouillé et
je lui jurai par le Christ sur la croix que je n’avais pas de marchandises. À ces mots, il ne s’occupa plus de
moi. L’écuyer du comte de Solms dut payer beaucoup pour les autres choses. Toute cette opération dura
longtemps et se fit au milieu de discussions interminables. Il était déjà tard quand, le soir, nous louâmes une
barque. Nous y chargeâmes nos affaires, nous embarquâmes et nous rejoignîmes les galères.
Sur le bateau, Monsieur Hans Unger et moi n’avions pas encore de place. On y était à l’étroit car il contenait
beaucoup de gens et de marchandises. Nous devions donc passer la nuit, à la proue, assis sur nos affaires,
les marins se firent prier longtemps mais finirent par accepter de nous laisser là. Les autres pèlerins de notre
bateau, Monsieur von Breitenbach et la suite du comte de Solms avaient loué cher une place près du
Calipha dans le réduit de la proue d’où l’on ramène les voiles pendant les tempêtes. Ils avaient si peu de
place que nous ne pouvions rester avec eux.
Le quatrième jour de novembre, dès l’aube, mon compagnon Monsieur Hans Lazino de Hongrie et moi, nous
allâmes de la proue à la poupe, c’est-à-dire de l’avant à l’arrière du bateau, là où logeaient le consul, le
capitaine et le patron. Nous attendîmes devant la dunette où ils dormaient. Dès qu’ils furent levés, nous
allâmes trouver le patron et nous lui demandâmes de nous donner un recoin pour nous loger sur la galère et
de nous indiquer où l’on pouvait manger. Le patron appela le comete, les deux gardiens du bateau,
l’écrivain, et leur ordonna de nous chercher une place en bas dans la carène afin d’y mettre nos affaires et
d’y dormir. Ils nous trouvèrent un réduit spacieux et calme au fond sur les sacs d’épices, contre la paroi de la
cale où l’on ne pouvait voir clair qu’avec des bougies. En outre le plafond était tellement bas que de l’échelle
aux sacs, nous devions marcher à genoux dans l’obscurité sur une distance de près de dix toises. Nous en
étions très mécontents, mais nous nous rendîmes bien vite compte que nous avions la meilleure place de
toute la galère. Nous y transportâmes nos affaires et le garçon de cale, qui logeait près de nous, nous
adressa la parole et nous promit de nous rendre tous les services (p. 180 bis) qu’il pouvait à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, ainsi il nous alluma une bougie, nous apporta du vin et du pain, et, il prit une
planche de la paroi pour nous présenter ce dont nous avions besoin. Il était vraiment très serviable. Nous
avions donc notre réduit, alors nous nous mîmes à ranger, clouer et accrocher nos affaires comme nous le
voulions et nous installâmes notre lit sur les sacs de gingembre. Ceci terminé, nous prîmes une barque pour
nous rendre à Alexandrie, nous mangeâmes chez les cuisiniers païens, nous achetâmes du pain, des
bougies, des cruches et ce qu’il fallait dans notre réduit puis nous allâmes à la maison où nous étions pour
prendre congé des messieurs et des dames. Nous y vîmes des fillettes païennes exécuter une danse
comme je n’en ai jamais vu de ma vie et, si Dieu le veut, que j’espère ne plus jamais revoir. Je n’aime pas y
penser et encore moins en parler. En regardant ces fillettes, nous comprîmes à quel point étaient débauchés
les pères qui apprenaient ces danses impudiques à leurs filles. Ensuite nous regardâmes la galère où nous
prîmes notre premier repas du soir avec le patron, il fit dresser une table dans la carène près de l’échelle où
il y avait de la lumière et de l’air et c’est là que nous mangeâmes toujours quand nous fûmes en mer. Nous
étions très satisfaits de ne pas devoir monter dans la dunette avec ces messieurs car nous vivions aussi
bien qu’eux.
Le cinquième jour de novembre au matin, nous étions malades car toute la nuit le vent avait soufflé avec
violence et le bateau amarré n’avait fait que tanguer et craquer. Nous restâmes donc toute la journée à bord
mais deux autres pèlerins d’un autre bateau étaient partis à terre et étaient sans escorte dans un cimetière
païen au bord de la mer dans lequel on leur jeta des pierres, l’un d’eux fut même sérieusement touché.
Le sixième jour, j’avais l’intention d’aller dire encore une fois la messe à Alexandrie et j’attendais une barque
sur l’échelle qui descend de la poupe jusqu’à la mer. Deux jeunes Maures païens arrivèrent à ce moment, je
m’assis avec eux et partis en ville dire la messe. Après cela j’allai acheter ce qu’il me fallait. Je me promenai
dans le marché accompagné de Hans Knauss, l’interprète, quand Schambeck, le trucheman, vint vers nous
étonné de nous voir là. Il nous dit que notre sauf-conduit était expiré depuis longtemps et il nous conseilla de
rester à l’avenir sur la galère car si quelque chose da fâcheux nous arrivait en ville, personne de s’occuperait
de nous. Nous montâmes donc dans une barque pour regagner la galère et nous n’allâmes plus à
Alexandrie.
Le septième jour, les marins approchèrent les autres galères de la nôtre. Le vent était bon, mais les
marchands n’étaient pas encore prêts.
Le huitième jour de novembre, nos compagnons des autres galères vinrent nous voir, visitèrent notre
installation et nous passâmes la journée ensemble.
Le neuvième jour était un dimanche. Je serais bien allé en ville pour dire la messe, mais je ne devais plus
m’y risquer. Ce jour-là plusieurs patrons furent emprisonnés à Alexandrie par les païens à cause de leurs
agissements.
Le dixième jour, le vent fut contraire toute la journée et lorsque la nuit tomba, les marins recouvrirent la
galère d’une grande toile, allumèrent des flambeaux et se mirent à jouer de la trompette et du chalumeau, à
danser et à chanter. Tout le monde assista à cette fête qu’ils faisaient pour la saint Martin dont c’était la
veille.
Le onze novembre, fête de saint Martin, un bon vent se leva, les marins se mirent à appareiller et hissèrent
la grande voile jusqu’à la hune. Puis ils allèrent à terre chercher de l’eau, ce qui indiquait que nous allions
bientôt partir, nous en étions très heureux car nous en avions assez de rester là.
Le douzième jour, le patron et le consul auraient aimé partir, mais le capitaine voulait attendre que toutes les
galères fussent prêtes. Or un patron se trouvait chez le chirurgien car il avait été blessé par un païen au
cours d’une rixe et il y avait encore des choses à faire sur une autre galère. Ils étaient donc très occupés. Ce
soir-là, une barque avec des sarrasins païens vint près de notre bateau, quelques marins y descendirent
avec des cruches de vin ; ils rirent et s’amusèrent ensemble, mangeant et buvant. Cela se faisait presque
chaque soir dès que la nuit tombait car, pendant le jour, les païens ne peuvent pas boire de vin.
Le treizième jour, une tempête éclata en mer si bien que les marins durent ramener la grande voile qu’ils
avaient hissé et renforcer les ancres. Ce même soir un orfèvre italien arriva avec une personne de la ville qui
troubla tout le bateau ; certains étaient heureux, mais la plupart en furent mécontents car ils craignaient que
cette personne ne fût la cause de désagrément. Si certains même avaient su qu’elle serait à bord, ils ne se
seraient pas embarqués sur ce bateau. Ce passager était une fille que l’orfèvre avait pris de la maison de
tolérance où il l’avait peut-être mise, cela je ne le sais pas, et qu’il voulait ramener à Venise d’où elle venait.
Il était raisonnable et calme ainsi que la fille. Ils furent logés dans un endroit particulier pour ne déranger
personne. Ils avaient été acceptés à bord du bateau à condition de bien se tenir. Si les chefs apprenaient
que les marins se conduisaient mal et si des querelles éclataient à cause d’eux, ils devraient descendre à
terre, même si c’était en Turquie. La pauvre fille passa ainsi des heures bien ennuyeuses en mer et, lorsque
tout le monde descendit aux escales, elle ne bougeait pas de sa place. Sa bonne conduite lui attira les
faveurs de chacun.
Du voyage en mer d’Alexandrie à Venise et en Allemagne
Le quatorzième jour de novembre, les marins de toutes les galères se mirent à appareiller. Ils remontèrent
les barques, hissèrent les voiles et levèrent les ancres, il ne manquait plus qu’un bon vent. À la neuvième
heure du matin, un vent léger se leva. Comme il n’était pas assez fort pour gonfler les voiles, les marins
durent ramer et nous sortîmes du port, laissant Alexandrie derrière nous. Lorsque le soleil se coucha, le vent
devint meilleur et il nous poussa vers le large au loin de la côte. »274
- 180 - 186 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN VON SOLMS (1483)
Solms, J. von, « Johann von Solms », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Le pèlerin Johann von Solms, comte et seigneur de Mützenberg, voyage en compagnie de Bernard de
Breydenbach, Paul Walther et Félix Fabri. Il meurt à Alexandrie après avoir accompli le pèlerinage en Terre
sainte. Les récits des voyageurs susmentionnés racontent longuement les circonstances de sa mort et son
inhumation dans le cimetière de l’église de Saint-Michel. Étrangement, ce récit publié au nom de Johann von
Solms raconte sa propre mort à Alexandrie et son départ à partir de cette ville à bord d’une galère !
p. 25-28 :
« …Nous nous hâtâmes pour arriver à Alexandrie et vîmes en route beaucoup de vieilles constructions
comme si une grande ville avait existé là jadis. Nous arrivâmes alors sur une petite colline, d’où nous vîmes
toute la ville d’Alexandrie, qui fut jadis puissante et grande, bordée d’un côté par la grande mer, de l’autre
par une contrée plaisante et fertile, arrosée par les eaux du Nil lorsqu’il déborde et rendue ainsi fertile. C’est
ainsi que des fruits exquis et rares y poussent, en particulier les pommes, appelées « musi », que nous
avions déjà vues dans le jardin de baume, ainsi que les oranges, les dattes et les figues, etc., mais pas de
poires ni de pommes. De belles maisons ou habitations de plaisance sont construites dans ces jardins. On y
attrape aussi des oiseaux rares, en particulier des grives blanches et beaucoup d’autres gibiers étranges
appelé léopard dont il est possible d’acheter un petit pour un ducat.
Alors que nous arrivions à la ville, les Sarrasins fermèrent la porte extérieure par laquelle nous espérions
entrer, et nous dûmes donc contourner toute la ville à pied, un chemin long et pénible, jusqu’à l’autre porte,
où nous trouvâmes un douanier assis, peu clément, demandant des taxes pour les hommes et les animaux.
Après avoir payé et avoir passé la première haute et grande porte en fer, nous pensions poursuivre en paix
jusqu’à notre auberge. Mais en arrivant entre les hautes et puissantes murailles à la dernière grande porte
en fer, nous trouvâmes rassemblés beaucoup de Sarrasins avec des masures, qui nous forcèrent à nous
arrêter et qui fermaient la première et la seconde porte, de sorte que nous dûmes rester entre les deux toute
la nuit, au milieu des hautes murailles et des tours, et patienter avec du pain sec et un peu d’eau. Cette
même nuit, certains des nobles, qui étaient avec nous, montèrent sur le mur extérieur et regardèrent les
fossés et les tours et d’autres fortifications etc. Et ils dirent ensuite que jamais ils n’avaient vu de ville si bien
protégée de l’extérieur que celle-ci. À l’intérieur cependant ce n’est pas une ville mais plutôt un tas de
cailloux, plein de vieilles constructions ruinées et elle est en grande partie déserte. Au matin lorsque la porte
s’ouvrit, nous envoyâmes un messager dans la ville auprès de notre guide ou interprète qui y habitait, lui
demandant de venir immédiatement et de nous conduire dans la ville. Lorsqu’il arriva nous lui remîmes une
lettre obtenue à grands frais par le sultan et stipulant qu’on devait nous laisser avec nos hommes et nos
biens, entrer et sortir d’Alexandrie librement et sans être taxés. Cette lettre fut lue par les hommes et les
douaniers assis à la porte, après qu’ils en eurent baisé le sceau avec un grand respect. Ensuite ils
commencèrent avec les premiers et plus nobles des pèlerins, les dévêtirent l’un après l’autre et les
fouillèrent soigneusement un à un ; et ce qu’ils trouvèrent en argent ou en autres biens dans les sacs ou
paniers ou sur eux-mêmes, ils le mettaient en un tas. Après avoir estimé le tout, chaque chose selon sa
valeur, ils en prélevèrent la douane. C’est une douane bien lourde car on doit payer le dixième (pfennig) de
tout ce que l’on fait sortir ou rentrer ; mais les prêtres peuvent entrer ou sortir sans payer de taxes. Après
cela, nous arrivâmes dans la ville et nous vîmes partout tant de vieilles constructions ruinées et si peu de
maisons neuves, bien construites, qu’il nous parut étrange qu’une muraille tellement belle et solide entourée
une ville si pauvre et si ruinée à l’intérieur. On nous conduisit alors dans une maison du roi de Sicile,
appelée le fondique des Catalans où nous y fûmes bien reçus. Les pèlerins chrétiens sont généralement
hébergés à cet endroit, bien qu’il y ait aussi plusieurs autres fondiques à Alexandrie ; les Vénitiens en
possèdent deux et les Génois un. Un fondique n’est pas autre chose qu’une grande maison, appelée chez
nous maison de commerce, dans laquelle les marchands logent avec leur marchandise et font du négoce ;
le responsable de ces fondiques s’appelle consul, auquel titre, on ajoute la provenance, comme consul
vénitien, génois ou catalan, etc. Aussitôt après avoir mis nos bagages dans cette maison, on manda les
pèlerins nobles et on les fit conduire, par l’interprète ou le guide d’Alexandrie, devant l’Admiraldi (qui est le
responsable de la ville), nommé par le sultan pour gouverner la ville. Il les reçut toutefois avec bienveillance,
s’enquérant du nom de chacun et le faisant inscrire dans un registre ; puis il les congédia. Après cela,
plusieurs d’entre nous convinrent avec le consul des Catalans de manger et boire avec lui, plusieurs autres
restèrent dans les pièces du seigneur de Solms et se firent préparer les repas à leur guise.
Le vingt-cinq octobre, dans la chapelle, après avoir entendu la messe qu’un prêtre de l’ordre des
prédicateurs avait la charge de célébrer dans cette maison, il y eut un grand vacarme et affluence sur la mer.
Beaucoup de Sarrasins avaient abordé avec différents bateaux : des fustes, des grips et des armates,
remplissant l’air (p. 26) du fracas de leurs armes, tous accompagnant un riche et puissant sarrasin venant
d’Afrique et qui voulait partir vers La Mecque pour visiter la tombe de Mahomet. Ces Sarrasins avaient volé
et capturé en mer un bateau dans lequel se trouvaient treize chrétiens et beaucoup de marchandises qui
furent toutes saisies et les personnes furent vendues à Alexandrie. Lorsque ces Sarrasins furent à terre, tous
les citoyens et les mamelouks allèrent à leur rencontre, parés de leurs armes et armures ; ils les reçurent
avec beaucoup d’honneur et rentrèrent à la ville avec le butin mentionné et en faisant grand vacarme de
bruit.
Le vingt-six octobre était un dimanche ; après avoir entendu la messe, nous dûmes rester toute la journée
dans la maison jusqu’à ce nous eûmes acheté très cher à l’interprète d’Alexandrie un droit de passage.
Après quoi, le lendemain, c’était le vingt-sept du mois mentionné, ce guide nous conduisit à la porte de la
ville du côté de la mer et nous présenta aux hommes qui étaient assis là et nous donna le pouvoir d’entrer et
de sortir à notre guise.
Le vingt-huit octobre, qui était le jour de saint Simon et Jude, après avoir entendu la messe, nous fûmes
conduits à la prison de sainte Catherine dans laquelle, avant son martyre et sa mort, la noble et Sainte
vierge resta enfermée douze jours sans nourriture, ni boisson terrestres, pour qu’elle meure de faim, mais
Dieu la nourrit par l’intermédiaire d’un pigeon, comme l’indique sa légende. Dans cette prison, la reine et le
chevalier Porphirius, après avoir vu une légion d’anges auprès de sainte Catherine, qui la réconfortaient et la
soutenaient furent convertis par sainte Catherine à la foi chrétienne avec deux cents hommes, serviteurs du
chevalier, comme on peut le lire longuement dans la légende. Après de grandes prières, on nous laissa
entrer dans cette prison et nous vîmes deux colonnes en marbre (situées) à douze pas l’une de l’autre, sur
lesquelles étaient fixées et posées les roues terribles avec lesquelles la Sainte vierge aurait dû être déchirée
et coupée en petits morceaux. Mais lorsqu’elle appela Dieu et l’implora, les roues se brisèrent en tuant près
de quatre mille païens. Au même endroit, furent également brûlés, mais sans que leurs vêtements soient
endommagés, les cheveux et les corps des cinquante sages que l’empereur Maxentius avait fait venir de
pays lointains pour disputer avec sainte saint Catherine. Mais remplie par Dieu d’une grâce et sagesse
extraordinaires, cette dernière triompha d’eux et les confondit de sorte qu’ils ne purent plus lui répondre et
qu’ils se convertissent, etc.
De là nous arrivâmes à l’endroit où se trouvait jadis le palais, maintenant ruiné, d’Alexandre le Grand. Mais
pour le signaler et en conserver la mémoire, il y a là encore une très haute et grande colonne épaisse à tête
pointue, taillée dans une seule pierre, et semblable de loin à une haute tour. Sa couleur est rouge et
beaucoup de caractères y sont inscrits ; elle est plus grande et plus haute que la colonne ayant été jadis à
Alexandrie à côté de celle-ci, qui fut transportée de là à Rome, et qui se dresse encore aujourd’hui à
Saint-Pierre de Rome.
Il y a aussi une autre très haute colonne à l’extérieur de la ville d’Alexandrie qu’on appelle Pompeianam
parce que Pompée la fit faire à sa mémoire ; on dit que sa tête serait à l’intérieur.
De là nous arrivâmes à une église, construite à l’endroit où sainte Catherine avait habité jadis dans un palais
royal et où elle régna après son père le roi Costi. Dans cette église vivent des moines grecs. Mais le lieu et
l’endroit où sainte Catherine fut décapitée est actuellement en dehors de la ville d’Alexandrie. Deux grandes
colonnes en marbre y furent érigées jadis à sa mémoire. L’endroit se trouvait jadis au moment de sa mort à
l’intérieur de la ville d’Alexandrie, qui était à l’époque plus grande, plus étendue et plus puissante
qu’aujourd’hui.
Il y a aussi une église à Alexandrie, appelée Saint-Marc, habitée par des Jacobites, construite à l’endroit où
saint Marc habita jadis et où il remplit sa charge divine. Bien qu’il se soit lui-même coupé un doigt par
humilité pour ne pas devenir prêtre, il fut pourtant ordonné prêtre et évêque d’Alexandrie par la volonté et la
décision divine et par la puissance de saint Pierre. À la fin, alors qu’il prêchait et officiait à cet endroit un jour
de Pâques, on entoura son cou d’une corde par laquelle il fut tiré à travers la ville d’Alexandrie, pendant qu’il
louait et remerciait Dieu. Ensuite il fut jeté en prison où il fut réconforté et consolé par Jésus-Christ et ses
saints anges qui lui apparurent. Lorsque par la suite il fut de nouveau traîné à travers la ville avec une corde
autour du cou, il dit avec grande patience : « Seigneur, je remets mon âme entre tes mains ». Ainsi il rendit
l’âme à son créateur. Alors son corps fut d’abord dignement enterré dans cette église par les autres
chrétiens, mais ensuite il fut emmené à Venise.
Il y a encore une autre église à Alexandrie, appelée Saint-Michel, dans laquelle habitent aussi des Jacobites.
Dans cette église se trouvent les tombes des pèlerins chrétiens qui meurent à Alexandrie. Dans cette même
église fut enterré aussi, avec la plus grande peine et douleur de nous tous, notre compagnon le noble et
honoré seigneur, monsieur Jean comte de Solms et seigneur de Mützenberg, le plus jeune et le plus noble
parmi nous. Après une grande et grave maladie qu’il supporta patiemment, après s’être confessé et après
avoir reçu tous les sacrements, (p. 27) Dieu le (seigneur) tout puissant le rappela à lui de cette vallée de
larmes dans l’éternelle joie céleste. Que Dieu le (seigneur) tout puissant lui soit clément et miséricordieux.
On nous montra aussi à Alexandrie l’endroit et le lieu où saint Jean appelé le grand aumônier, qui fut jadis
patriarche d’Alexandrie, souffrit mort et martyre à cause de la foi chrétienne, comme raconte sa légende.
Dans les quatre fondiques des marchands chrétiens d’Alexandrie, fondiques déjà mentionnés, il y a de
belles chapelles, bien décorées, avec des chapelains et des prêtres latins, et dans lesquelles nous
entendîmes souvent la messe.
Pendant la période où nous étions à Alexandrie, beaucoup de bateaux et de galères mouillèrent au port et il
y eut de nombreux actes de piraterie sur la mer ; en particulier les Vénitiens, qui étaient à l’époque en guerre
contre le roi de Naples, pillèrent et saisirent un grand bateau arrivé de Naples chargé de beaucoup de
marchandises. Il arriva aussi une galère plein de chrétiens qui habitaient au-delà de la mer et dans laquelle
se trouvaient plusieurs Allemands qui nous racontèrent qu’ils ne transportaient rien d’autre dans la galère
que des noisettes, estimées à dix mille ducats, lesquelles noisettes ne poussent pas en Orient et par
conséquent y valent cher ; et il nous fut dit qu’elles pourraient même y être stockées sans se gâter ou
devenir véreuses comme elles le font chez nous au bout d’un an. Ces mêmes jours, des Alexandrins,
naviguant sur la mer, prirent également un bateau étranger qui voulait entrer dans le port. Après l’avoir
attaqué et capturé ou saisi, ils se distribuèrent le butin comme des pirates. Il semble alors que si les bateaux,
qui veulent mouiller à Alexandrie, ne sont pas bien équipés en armes et en hommes, ils se font piller dans le
port. Mais aussitôt arrivés dans le port, ils sont en sécurité pendant le mouillage, car les Sarrasins protègent
le port avec grand soin. À cet effet il y a pour la surveillance, à l’intérieur de la ville, deux collines faites de
main d’hommes, d’où la vue s’étend loin sur la mer et aussitôt que l’on aperçoit les voiles, on l’annonce à
l’Amitaldo, ou plus haut fonctionnaire, qui envoie un bateau rapide pour s’informer de la qualité et de l’origine
du patron ainsi que des autres (personnes) qui se trouvent à bord. Bien que ce que je vais raconter
maintenant paraisse mensonger, il en est pourtant ainsi en vérité. Cet Admiraldus a continuellement auprès
de lui quelques pigeons apprivoisés qui sont habitués, peu importe où on les envoie, à retourner toujours
dans la résidence de l’Admiraldus. Les bateliers ainsi envoyés dans les bateaux rapides en emmènent donc
deux ou trois (pigeons) dans un panier et après avoir pris tous les renseignements, ils écrivent une note, la
mettent au cou d’un pigeon et le laissent s’envoler. Il s’envole alors tout droit jusqu’à l’Admiraldo et lui porte
le message. Mais si après l’envol du premier pigeon survient un fait digne d’en informer l’Admiraldo, on
envoie l’autre pigeon de la même façon avec une note et le troisième etc. si besoin est. Ainsi l’Admiraldus
sait longtemps avant que les bateaux n’arrivent dans le port, d’où ils viennent, et qui s’y trouve etc. On nous
dit aussi que ce même Admiraldus possèderait plusieurs autres pigeons qu’il enverrait de temps en temps
jusqu’au Caire, lorsqu’il aurait des informations importantes pour le sultan. Mais si les bateliers, envoyés par
l’Admiraldo comme mentionné ci-dessus, ne peuvent avoir les renseignements de la part de ceux qui
arrivent, parce que ceux-ci ne veulent pas les donner, ils en informent, par l’intermédiaire d’un pigeon,
l’Admiraldo qui envoie aussitôt beaucoup de princes armés avec l’ordre d’attaquer et de piller le bateau ; ce
qu’ils n’hésitent pas à faire, à moins que ceux qui arrivent soient plus forts comme mentionné auparavant.
Le vingt-neuf octobre, nous nous promenâmes dans la ville d’Alexandrie pour visiter en particulier les
marchandises dans les fondiques, qui étaient tous remplis de grandes richesses, excepté seulement le
fondique des Catalans, notre auberge, dans laquelle il n’y avait qu’un féroce léopard enchaîné. Dans cette
maison, on rencontre souvent aussi les chrétiens et les Sarrasins qui mangent et boivent ensemble.
Là-dedans nous vîmes se promener plusieurs oiseaux appelés autruches, qui mangeaient du fer quand on
leur en jetait. Les Vénitiens élèvent aussi un cochon dans leur cour, qui est le seul que nous vîmes jamais
de l’autre côté de la mer, car les Sarrasins haïssent les cochons bien plus que les Juifs. Certes, ils n’auraient
pas laissé non plus vivre celui-ci dans la cour, si les Vénitiens n’avaient pas obtenu du sultan, en le priant
instamment de pouvoir le garder. Les Turcs ont aussi un fondique à Alexandrie ainsi que les Maures et les
Tartares dans lesquels, lorsque nous les visitâmes, il y avait quantité de marchandises et grand commerce.
Mais ce qui nous était pénible à voir c’était les gens qu’on vendait pour des sommes minimes et modiques,
hommes et femmes, garçons et filles et en particulier plusieurs femmes qui avaient encore des enfants au
sein. Tous, avant d’être vendus, étaient examinés pour voir s’ils étaient sains ou malades, forts ou faibles.
Les filles se faisaient honteusement dévêtir et les garçons étaient forcés de sauter et de courir ; de cette
manière, on cherchait soigneusement s’ils avaient ou non un défaut quelconque. (p. 28) Tous les fondiques
des chrétiens sont fermés de l’extérieur chaque nuit par les Sarrasins afin que personne ne puisse ni entrer
ni sortir et (on les ferme) également chaque fois que les Sarrasins se rassemblent dans leurs mosquées ou
à des fêtes particulièrement importantes. Après avoir tout visité dans la ville, nous sortîmes jusqu’à la mer où
il y avait grand monde autour des marchands qui remplissaient des sacs d’épices et d’aromates. En effet,
lorsque, à dos de chameaux, on emmène les épices des fondiques jusqu’à la mer, les fonctionnaires
sarrasins sont toujours présents. Ils vident les sacs dans d’autres récipients et cherchent si l’on ne sort pas,
sans les dédouaner, d’autres objets précieux cachés sous les épices. Quand on manipule les épices,
beaucoup de pauvres gens affluent, volent et vendent aussitôt ce qui se perd par le fait de vider et de
remplir.
Le 30 octobre, dernier jour du mois, arrivèrent d’Afrique deux autres galères vénitiennes, appelées galères
de Traffico, qui devaient également être chargées d’épices, comme les quatre qui étaient déjà chargées. Le
même jour nous conclûmes le marché, pour notre retour, avec les patrons des galères et nous les
trouvâmes plus durs avec nous que les Sarrasins. Parce qu’ils savaient que nous devions partir avec eux ils
demandaient des sommes exagérées, et ainsi arriva-t-il que nous nous séparâmes, certains prirent l’une des
galères, les autres une autre. Moi-même avec ma suite et l’honorable Monsieur Johan, chanoine et
archidiacre de Transylvanie en Hongrie, et le frère Félix, maître-lecteur de l’ordre des prédicateurs d’Ulm,
nous nous engageâmes avec Monsieur Sébastien Contereni, un patron, sur la galère duquel voulait voyager
aussi le commandant et consul des Vénitiens à Alexandrie. Après ce contrat, nous demeurâmes encore de
nombreux jours à Alexandrie, à notre grand mécontentement, à attendre que les galères se préparent et se
disposent à partir. Pendant ce temps, le seigneur de Solms, comme déjà mentionné, quitta ce monde, et
nous lui témoignâmes la fidélité qui lui était due, en le soutenant dans sa maladie et en l’enterrant après sa
mort comme sa noblesse et ses vertus le méritaient. Que Dieu le tout puissant soit clément et miséricordieux
avec son âme. Ce seigneur mourut en chrétien le soir de la Toussaint avec une grande piété et résignation
chrétienne pourvu des sacrements. Après son décès, nous quittâmes Alexandrie et nous allâmes avec nos
compagnons dans la galère retenue auparavant et nous restâmes auprès du patron dans la galère où
désormais nous mangeâmes, bûmes et dormîmes. Il nous avait été recommandé d’embarquer secrètement
huit ou dix jours avant le départ de la galère et de ne pas sortir nos bagages (de la ville) tous à la fois, mais
de les porter petit à petit, jour après jour à la galère, car les Sarrasins font très attention aux personnes et
aux marchandises qui passent la douane, ils les taxent lourdement aussi bien à la porte intérieure qu’à la
porte extérieure et à la mer.
Le trente et un novembre, sur l’ordre du commandant, notre galère fut amenée à la hauteur du nouveau
château, car tous les bateaux étaient maintenant prêts à partir. Alors tous les pèlerins, nos compagnons, qui
étaient encore dans la ville, embarquèrent chacun sur sa galère, qui toutes selon l’ordre et la consigne
(reçus) devaient suivre notre galère et s’arrêter près du château. Ce dernier est un château magnifique et
solide qui renferme le port et le protège. Autour du port il y a beaucoup de rochers qui assurent sa sécurité
et sur lesquels s’appuie une forte muraille qui va de la ville jusqu’à la mer. À l’extrémité de ces rochers et de
la muraille, dans la mer, se trouve le château mentionné ci-dessus qui fut construit par le sultan actuel,
suivant le conseil et la sagesse d’un mamelouk, un Allemand d’Oppenheim, une ville sur le Rhin, située
entre Mayence et Worms. Ce mamelouk a depuis longtemps quitté les païens et est revenu à la foi
chrétienne, riche et bienheureux. Dans ce port, aucun bateau ne peut entrer sans baisser les voiles en vue
du château en signe de révérence envers le sultan. À cet endroit, à côté du château, les galères mouillèrent
quatorze jours, aussi nous nous ennuyâmes et fûmes de mauvaise humeur. Pendant ce temps-là les
patrons des galères et certains d’entre nous qui retournèrent en ville furent maltraités par les Sarrasins et
certains furent même blessés. En plus, il y eut de la discorde entre les patrons car quelques-uns voulaient
partir, d’autres rester plus longtemps. Mais le commandant intervint et ordonna qu’aucune galère ne parte
avant que toutes les galères et que tous les bateaux ne soient prêts.
Le quinze du même mois, lorsque tous les bateaux furent prêts et le vent favorable, nous levâmes l’ancre,
hissâmes les voiles et quittâmes le port d’Alexandrie. Bientôt la ville et le pays disparurent à nos yeux car
étant poussé par un vent puissant, nous arrivâmes rapidement en haute mer et plus particulièrement notre
galère qui était à la tête de toutes les autres. Peu de jours après, nous dûmes de nouveau manger des
biscottes et (ce qui nous parut étonnant en mer) on nous donna des poissons, appelés esturgeons, venant
du Danube. Mais comme le Danube coule aussi à travers la Turquie, les Turcs amènent ces poissons dans
ces pays, à Alexandrie et au Caire etc. et là les patrons en commandent pour leurs galères. Nous
naviguâmes d’Alexandrie vers la mer appelée Carpaticum en passant par la mer appelée Icarium. »275
275 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 187 - 190 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOOS VAN GHISTELE (1483)
Ghistele, van J., Le voyage en Égypte de Joos van Ghistele, 1482-1483, par R. Bauwens-Préaux, Ifao,
Le Caire, 1976.
Né vers 1446 dans l'une des grandes familles de Flandre, Joos van Ghistele entre au service de Charles le
Téméraire qui le fait chevalier. Après la mort tragique de ce dernier, en 1477, il revient à Gand où il est élu
échevin. Entre les années 1481 et 1486, il accomplit le pèlerinage à Jérusalem et envisage également de se
rendre dans le pays du Prêtre-Jean (Éthiopie), mais ce souhait reste à l’état de projet. À son retour, il est à
nouveau élu échevin. En 1492, il occupe les fonctions de grand-bailli de Gand et devient conseiller et
chambellan de Maximilien de Habsbourg. Cette relation est rédigée par le chapelain Amboise Zeebout, qui
n’a pas participé au voyage, d’après les notes et les récits de Joos van Ghistele et Van Quisthout.276
p. [111]-[130] :
Chapitre 34
Comment ils partirent de Damiette pour aller à Alexandrie et de la situation de cette ville
« Ils arrivèrent à Alexandrie qu’on appelle aussi « Conopicum » ou « Rijschijd ». Cette ville a de très belles
murailles, tours et portes, de sorte que de l'extérieur c'est une belle chose à voir. Elle est beaucoup plus
longue que large, et elle s'étend sur toute sa longueur au bord de la mer. Elle a de doubles murailles
construites en fausses braies. Séparées l'une de l'autre d'environ cinq décamètres, se dressent de grosses
et grandes tours bâties en pierre blanches.
La température est très mauvaise dans les environs, si bien que quelqu’un qui y arriverait, y resterait
quelque temps et ne prendrait pas garde, surtout au froid, deviendrait facilement malade, car il y fait très
chaud et parfois si froid que c’en est fort étonnant. Il y pleut également si fort que l’on peut à peine marcher
dans les rues, mais la pluie ne dure pas longtemps et ne pénètre pas loin dans l’intérieur du pays où le ciel
est serein.
Cette ville est entourée de sable sec sauf le long de la mer et de la Barbarie où on ne voit que des marais
dans lesquels vivent de grandes quantités d’oiseaux.
Un peu plus vers la droite, sur la côte, à environ cinq milles d’Alexandrie se trouve appelée « la Tour
d’Arabie » où on monte toujours la garde. C’est là dit-on, que la belle Blanchefleur fut enfermée pour être
offerte à un sultan d’Égypte à cause de sa beauté277 . Un jeune homme qui l’aimait, appelé Floris, la
rechercha jusque-là et fit tant qu’il arriva dans sa chambre, dans cette tour au moyen d’un panier plein de
roses dans lequel il fut monté et à cause duquel il leur arriva par la suite beaucoup de souffrance et de
chagrin, ainsi qu’on peut le lire avec plus de détails, dans leur histoire.
Aux alentours de cette ville poussent plus de câpriers que partout ailleurs dans cette région, ils ressemblent
assez aux groseilliers et se développent en largeur, comme le fait le pourpier. Les fruits sont les câpres, qui
ont de petites semences jaunes comme les chrysanthèmes, mais il faut les cueillir avant qu’ils soient mûrs.
Arrivés donc à Alexandrie, ils trouvèrent deux doubles portes s'ouvrant en sens inverse et qui sont gardées
de près : on demande à chacun qui il est ; d'où il vient et ce qu'il apporte, et chacun doit donner là un
centième de sa fortune et un dixième de tous ses autres biens. Toutes les lettres qu'on a sur soi sont
portées au seigneur de la ville qui les examine. Cela se passe ainsi car cette ville est une ville marchande,
située sur la côte, qui forme frontière et qui fourmille de riches marchands venus de toutes les nations,
comme des Turcs, des Barbares, des Espagnols, des Génois, des Vénitiens, des Italiens, des Catalans, des
Abyssins, des Tartares, des Persans, des idolâtres, des Arabes et de toutes autres nations imaginables ;
mais en vérité, il vaut mieux penser que cette manière d’agir est due davantage à l’avidité qu’à autre chose,
car la visite d’Alexandrie représente pour le seigneur de l’endroit une source inestimable de revenus.
La plupart de ces nations ont chacune leur propre maison que l’on appelle là : « Fondigoes ». Les Vénitiens
en ont deux car ils y sont très nombreux. C’est là que nos voyageurs logèrent avec les marchands qui y
avaient leur logis. Ceux-ci les traitèrent si bien qu’ils ne purent rien payer durant tout le temps qu’ils y
passèrent. Ces fondiques ont une forme assez carrée et ressemblent très fort aux « khans », logis qu'on a
décrit précédemment, mais à l'intérieur ils sont différemment conçus, avec des allées et des étages, deux ou
trois l'un sur l'autre, avec des chambres tout autour où logent les marchands ; les étages inférieurs sont de
simples voûtes qui s'appuient chacune sur elle-même et où chaque marchand enferme ses marchandises.
Ces endroits sont appelés là magasins. Au milieu se trouve un emplacement où les marchands apportent,
échangent, emballent ou déballent leurs marchandises. Chaque soir, lorsqu'il commence à faire sombre, les
serviteurs de l'émir et seigneur de la ville viennent fermer tous les fondiques, afin que les marchands ne
soient pas maltraités par les païens.
Quant à l'aspect de la ville, elle semble très belle et très riche de l'extérieur, mais à l'intérieur elle n'est en
grande partie qu'une pauvre chose, car sur dix maisons, à peine six tiennent debout, sauf dans la rue
Saint-Marc, qui traverse la ville de part en part, et aussi dans quelques rues qui mènent aux portes de la
ville. Ces rues sont fort peuplées et ont de belles et riches maisons.
Mais cette ville a un grand défaut, car elle est dépourvue d’eau pure, à l’exception de l’eau de pluie,
recueillie par les citernes, ou l’eau des conduites qui coule partout sous la ville. Cette eau vient d’un canal en
provenance d’un bras du Nil qui passe à Rosette. Ce canal n’est pas alimenté en eau pour que des bateaux
y naviguent, sauf lorsque le fleuve est en crue. Ce canal n’arrive qu’à une lieue de la ville et l’eau y est donc
amenée par un grand nombre de conduites qui traversent le sous-sol de la ville et partout, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville, on a construit de grands puits carrés où celui qui le veut peut puiser de
l’eau. Par ces puits, on nettoie les conduites chaque année, car sinon ces dernières seraient aussitôt sales
et remplies de sable et si ces conduites n’étaient pas entretenues, il faudrait aussitôt abandonner la ville.
Ils virent également dans cette ville le sultan "Mayetto"278 , dont on a parlé précédemment, qui tenait fort bien
son rang et qui passait ses loisirs parmi les oiseaux de proie ; les gerfauts, les laniers et de nombreux
faucons et pèlerins. Pour les soigner, il paie cinquante ou soixante hommes, mais ils chassent peu devant le
fleuve ; c'est-à-dire qu'ils chassent peu le héron, mais ils chassent plutôt dans les champs les bêtes
sauvages dont il y a là abondance. Ces fauconniers ne pratiquent pas la pipée, ne font pas de bruits, ou ne
crient pas comme chez nous, mais ils ont de petits tambours aux flancs sur lesquels ils frappent en faisant
beaucoup de bruit, ce qui est très étrange et très agréable à voir et à entendre.
Chapitre 35
Comment ils durent marchander le prix qu’ils payèrent par tête à Alexandrie et d’autres histoires
Dès leur arrivée à Alexandrie et quoiqu’ils fussent accompagnés de marchands habitant la ville, nos
voyageurs furent appelés, en tant que marchands, par l’interprète de cette ville, appelé « Jennibeey », un
mameluk. Celui-ci leur demanda d’où ils venaient et où ils voulaient aller. Ils répondirent qu’ils venaient de
Candie et qu’ils venaient faire quelques achats. Là-dessus, il répliqua que c’était faux, qu’ils venaient de
Jérusalem et du Caire, il leur dit aussi combien de temps ils étaient restés dans ces villes et qu’il désirait cinq
ducats par personne pour son droit ; mais entre-temps ils parlèrent des marchands avec qui ils étaient venus
et d’autres choses, de telles sorte qu’il se contenta finalement de deux ducats, en laissant tomber le droit au
seigneur. Et s’ils continuaient à se conduire comme des marchands sans être reconnus, lui-même se tairait
volontiers, dit-il, mais s’ils étaient reconnus, cela leur coûterait dix fois plus cher. Pendant qu’ils étaient dans
cette ville, il arriva une chose triste à voir. De Barbarie vinrent dix fustes et deux belles galères, remplies
d’hommes d’armes appartenant au roi de Tunis, avec à leur tête un grand seigneur de ce roi, qui voulait aller
à La Mecque, où Mahomet fut enterré. Ils avaient fait prisonnier en pleine mer, en dehors du port
d’Alexandrie, un petit bateau chrétien qui arrivait de Sicile avec du blé et d’autres marchandises, et, cet
exploit accompli, ils débarquèrent à Alexandrie où on leur fit fête et leur offrit bonne chère. Le seigneur du
château et presque toute la population allèrent à leur rencontre et les menèrent ainsi en triomphe à l’intérieur
de la ville, tout en criant, chantant, jouant de la trompette, tant et si bien que l’on n’entendait ni ne voyait plus
rien. Tous les compagnons de guerre, les pirates et les autres marchaient en tête, avec leurs épées et leurs
boucliers, tout en se battant et en sautant, selon la coutume de ce pays. Les archers suivaient en ordre,
derrière eux venaient les seigneurs du bateau, ainsi que les seigneurs de la ville, avec leurs mameluks et
derrière venaient enfin les prisonniers, au nombre de vingt-trois, attachés l’un à l’autre par une grosse
chaîne au cou. Les soldats et les enfants les frappaient tellement que ce spectacle faisait pitié à tout le
monde. Ils traversèrent ainsi, au son des trompettes toute la ville pour qu’on puisse bien les voir. Le seigneur
et d’autres hommes d’armes furent menés à la cour du seigneur de la ville. Quelques prisonniers furent,
d’après ce que l’on raconte, tués, et les autres furent emmenés en Barbarie. Nos pèlerins, ainsi que d’autres
marchands, firent de leur mieux pour en acheter quelques-uns, mais cela ne réussit pas.
Chapitre 36
Des églises, endroits et choses que l’on voit à Alexandrie, ainsi que des pigeons qui portent des lettres
Pendant qu’ils séjournaient à Alexandrie, on les emmena visiter la ville. Et en allant à la porte de
« Rousette », ils rencontrèrent d’abord une église appelée Saint-Saba qui se trouvait à main gauche dans la
rue, c’était une fort belle bâtisse qui ressemblait à un couvent grec. Au milieu il y a une sorte de chaire
maçonnée en pierre, à laquelle on accède des deux côtés par huit marches. Cette chaire est si haute qu’un
homme peut passer debout en dessous. Elle est couverte tout autour de plaques de marbre blanc. C’est là
qu’il chante l’Évangile et que se déroulent beaucoup d’autres services religieux, suivant leurs rites. Le choeur
est fermé, suivant l’usage grec, et à gauche du choeur, il y a une chapelle avec un autel. À main gauche
dans cette chapelle pend une statue de Marie peinte jusque sous les épaules, c’est une des statues faites
par saint Luc, comme on le dit de la statue de « Sardenay »279 et de celle qui est à Rome. Elle est peinte en
couleur brune, qui ressemble à la couleur de la chair, car un peu de rouge perce à travers le brun, le nez est
long, le menton a une fossette et quelques petites fossettes creusent également les joues, la bouche est
petite, les lèvres sont rouge cerise, les yeux sont noirs et l'expression du visage est assez noble, telle est
donc l'apparence de cette statue.
À l’endroit où se trouve cette église, la pure sainte Catherine pleura quelque temps lorsqu’elle vint de
Chypre, après la mort de son père.
De cet endroit, on les mena vers la rue de Saint-Marc, la plus belle de toute la ville et le long de laquelle le
saint évangéliste saint Marc fut traîné, attaché à la queue d’un cheval, jusqu’à l’extérieur de la porte qui
mène à Rosette, jusqu’à un endroit où se trouve l’église construite en l’honneur du saint chevalier saint
Georges. Là, le saint évangéliste fut décapité et transporté ensuite à Venise, d’après ce qu’on raconte.
Arrivés environ au milieu de cette rue, dans une petite rue de traverse, à gauche, ils virent le cachot dans
lequel sainte Catherine fut emprisonnée.
C'est une petite pièce voûtée où on loge à présent diverses bêtes. À droite en entrant, derrière la porte, il y a
un trou dans le mur, on ne peut pas le fermer en le maçonnant d’après les dires des chrétiens. Il semble que
c’était jadis une porte qui a été maintenant entièrement maçonnée à l’exception de ce trou. On raconte que
c’est par ce trou que sainte Catherine prêchait souvent le peuple et répandait la parole de Dieu. Juste
devant cette prison se dressent deux colonnes de marbre, chacune d'un côté de cette petite rue, elles ont
quelques petites taches rouges et ont sensiblement la couleur de la pierre qui se trouve à Jérusalem à
l'endroit où Saint Matthias fut choisi comme apôtre, après que Judas se fut pendu. Ces colonnes ont une
hauteur d'environ six brasses. Elles semblent avoir été maçonnées à moitié dans le mur de cette maison et à
moitié en dehors. C'est à ces colonnes, dit-on, que furent attachées les roues avec lesquelles la sainte
vierge Catherine aurait été martyrisée, elle y fut décapitée, et portée par les anges de là jusqu'au mont Sinaï
où son corps fut ensuite trouvé et amené à l'endroit où on le visite aujourd'hui, ainsi qu'on va le décrire
ci-après plus longuement.
On raconte aussi que les païens ont souvent essayé d’enlever les colonnes mais ils n’y sont jamais
parvenus, car ils furent chaque fois retenus par de telles entraves qu’ils les laissèrent à leur place et n’y
touchèrent plus. Quoi que d’aucuns disent qu’elle fut décapitée à cet endroit, d’autres cependant prétendent
que le supplice eut lieu en dehors de la ville, là où se trouvent encore deux belles colonnes.
Dans cette même rue, que l’on appelle le grand « Besaer280 » de Saint-Marc, il y a encore une autre église,
construite en l’honneur de saint Marc, à l’endroit où il habita et où il fut prisonnier, le jour de Pâques, alors
qu’il disait la messe. Il fut ensuite traîné par terre, une corde au cou, tout le long de cette rue, jusqu’à
l’endroit où il fut décapité et enterré jusqu’à ce que son corps fût transporté à Venise.
Cette église est tenue par des chrétiens jacobites.
Ensuite nos voyageurs furent conduits à une autre église encore, dédiée à saint Michel, également tenue
par les mêmes chrétiens. Ils y virent le tombeau du comte Jean de Solms qui était arrivé là en venant de
Jérusalem et du monastère de Sainte-Catherine et du Caire avec d’autres nobles, pour retourner chez lui à
bord de galères d’Alexandrie et de « Trasigo » qui étaient là en ce moment ; parmi ces seigneurs, il y avait
Bernard van Breydenbach, Philippe van Bicken, Maxime Smasmus Van Koppelsteyn, Fernand van
Mernawe, Jaspar van Bulach, Joris Marcx, Nicolas de Groote, Henri van Schwenberg, Zegemont van
Marszbach, Pierre Velsch, Jean Basinus, un jacobin et deux moines franciscains appelés Thomas et Paul.
Nos voyageurs connaissaient ces deux derniers car ils les avaient souvent rencontrés à Jérusalem.
On leur montra également un endroit où se trouvaient beaucoup d’édifices plus vieux encore et délabrés. Il y
avait là une pierre carrée, de couleur rouge, si haute qu’un bon lanceur pourrait à peine lancer sa fronde
par-dessus. La base de cette pierre est assez large et le sommet est pointu. Sur tous les côtés sont gravés
d’étranges animaux, des oiseaux et d’autres figures qui tiennent lieu de lettres, si bien que personne ne peut
les lire à présent, tout comme ceux qu’on peut voir dans les grandes pyramides et les vieilles chapelles de
l’autre côté du Nil. Cette pierre ressemble beaucoup à celle qui se trouve à Matarièh281 ; il en existe trois
semblables dans le pays, à savoir les deux précitées et une troisième à Constantinople282 pour montrer
l’étendue de sa puissance. On lit des histoires analogues au sujet d’Alexandre, de Jules César, d’Hercule et
de biens d’autres princes célèbres.
Dans cette ville il y a deux hautes collines, faites avec grand labeur et grand art. Sur l’une se trouve une
grande tour carrée où l’on monte toujours la garde, et lorsque les veilleurs aperçoivent des bateaux, ils font
des signes à l’aide de petits drapeaux qu’ils élèvent et indiquent ainsi leur nombre et leur pays d’origine.
Dans cette ville ainsi que dans d'autres endroits en Egypte, on a recours à un moyen très étonnant, et c'est
le suivant. Les grands seigneurs, les marchands et d'autres encore ont généralement tous les pigeons
apprivoisés qu'ils envoient porter des lettres et qui reviennent ensuite à l'endroit d'où ils sont partis.
De cette façon, dès que les marchands aperçoivent des signes envoyés par les veilleurs, ils vont aussitôt
trouver le seigneur de la ville et lui demandent de bien vouloir leur prêter une de ses barques à rames pour
aller à la rencontre de ces bateaux et les saluer courtoisement.
Dès qu'ils ont la permission, ils mettent des hommes dans la barque et rament vers les grands bateaux qui
sont encore loin en pleine mer, et ils emmènent avec eux un des pigeons apprivoisés. Arrivés aux bateaux,
ils s'informent des marchandises que ceux-ci apportent et ils écrivent aussitôt une petite lettre qu'ils
suspendent au cou du pigeon ou sous son aile et le laissent s'envoler ; le pigeon revient aussitôt à la maison
où il a été élevé. Les marchands, qui l'attendent, l'attrapent et examinent la lettre, et s'ils pensent que cela
peut leur être utile, ils prennent aussitôt un autre pigeon et le font voler vers le Caire ou vers Damiette pour
avertir leurs collègues de l'arrivée des marchandises et pour qu'ils soient sur leur garde. De même les
seigneurs s'envoient l'un l'autre des pigeons dès qu'ils en ont besoin. Il y a là énormément de pigeons qui
sont utilisés pour les messages courts et rapides, mais quoique diverses personnes aient des pigeons,
personne ne peut les faire voler avec des lettres sans la permission du seigneur de la ville.
Chapitre 37
De diverses curiosités situées en dehors d’Alexandrie
Lorsqu'un Chrétien vient pour la première fois à Alexandrie et veut aller se promener en dehors de la ville, il
doit donner pour ce premier voyage un demi-ducat, et ensuite il peut sortir aussi souvent qu'il veut, sauf les
pèlerins, car ceux-ci ne peuvent sortir sans la permission du seigneur de la ville.
Et, une fois à l'extérieur du côté de la mer, les chrétiens ne peuvent pas non plus dépasser certaines limites
vers la gauche, qui sont d'ailleurs indiquées, étant donné qu'on ne veut pas que soient vues la ville et
l'étendue de sable située entre la mer et la ville car il suffirait de peu de chose pour transformer cette
étendue de sable en île, en la coupant du continent, et ensuite il suffirait d'en faire une place-forte dirigée
contre la ville.
Mais en tout cas, il est permis d’aller jusqu’au vieux château, qui est un bâtiment très solide avec une grosse
et forte tour, mais pas plus loin. Et, plus loin, en direction de la mer, à environ six ou sept portées de trait, le
sultan actuel a fait construire un nouveau et beau château, appelé « Le Ferrelon ». Ce château est situé de
façon presque semblable à la manière néerlandaise, si bien que de là on peut bombarder tous les navires
qui se trouvent dans le port. Il a toujours un capitaine propre qui ne dépend pas du seigneur de la ville.
On a construit des murs qui touchent presque au vieux château, avec de solides tours, séparées l’une de
l’autre par quinze ou seize décamètres. Cette promenade est très belle, particulièrement lorsqu’arrivent des
navires étrangers, elle permet aussi de voir à quelle nationalité appartiennent ces étrangers.
Sur l'étendue de sable dont on vient de parler, il y a un moulin-à-vent, en pierre blanche, comme on en voit
beaucoup en Artois, mais en Égypte, c'est une curiosité car on n'en trouve pas un dans tout le pays.
De l’autre côté d’Alexandrie et à environ une portée de trait des portes se dresse, sur une colline de sable,
une colonne faite d’une seule pierre, très grande et extraordinairement haute si bien qu’un bon frondeur ne
pourrait lancer une pierre au-dessus ; cette colonne est si grosse que six brasses suffiraient à peine à en
faire le tour. Au sommet et à la base, elle a un double pied. Elle s’appelle la colonne de Pompée, parce que
sa tête et les cendres de son corps, amenées par un de ses chevaliers appelé Putrecordus283 , y furent
déposées.
On raconte aussi que sur cette colonne se trouvait une idole qui tomba par terre et se brisa sous l’effet de la
prière de la chaste et cultivée sainte Catherine. Celle-ci surpassait en connaissances tous les docteurs et
femmes savantes qui ont jamais existé, comme la fille de « Tiri »284 , la mère de « Dionisii »285 ,
« Calpurina »286 , « Siterea »287 , « Ithobertina » ou « Lesbia »288 , « Sappho »289 , « Centona »290 , qui a écrit en
remployant des vers de Virgile, « Aresia », encore appelée « Androgenes », « Gaeya » qui parle bien,
« Forne », « Angeriona » la doctoresse291 , la nymphe « Carmentis »292 , que l’on appelle « Nicostrata », qui
inventa la première l’alphabet latin, « Minerve » qui inventa les chiffres et la manière de tisser les draps,
« Noema », soeur de « Tubals » et de Cérès, et encore bien d’autres qu’il serait trop d’énumérer ici et qui ne
surpassèrent pas en connaissances la chaste vierge sainte Catherine. »
Chapitre 38.
De divers endroits qu'ils visitèrent après avoir quitté Alexandrie et en retournant au Caire
Après que nos voyageurs eurent séjourné quelques jours dans cette ville et eurent fait bonne chère, ils
demandèrent aux commerçants avec qui ils étaient venus des conseils afin de pouvoir retourner au Caire et
terminer leur voyage. Les commerçants les leur donnèrent volontiers et ils prêtèrent un de leurs serviteurs
qui connaissait bien la langue (du pays).
Après avoir fait leurs bagages et pris congé, ils franchirent les portes de la ville, et, laissant à main droite la
colonne de Pompée, ils prirent le chemin vers la gauche en direction de la mer. Ils arrivèrent ainsi à une
montagne de sable, pas très haute, qui s'étend sur cinq ou six milles et sur laquelle on ne voit que de grands
tas d'édifices en ruines, extraordinairement grands et gros. Le long de ce chemin qui mène à Rosette se
trouve une espèce de fortification presque remplie de sable et sur laquelle il y a de grandes et grosses
fondations de murs. On raconte que là s'élevait jadis la plus vieille ville d'Alexandrie, que le roi Alexandre fit
construire d'après une de ses villes situées en Macédoine et appelée Pella, par une personne appelée
"Demoratus", ainsi que Vitruve en parle in Prologo primi libri de Architectura. C'était la capitale de toute
l'Égypte, où résidèrent divers rois, tous appelés Ptolémée.
À cet endroit se trouvait une des bibliothèques les plus célèbres, elle contenait des ouvrages sur toutes les
sciences, écrits dans toutes les langues connues à ce moment dans le monde entier. Mais à l'époque où les
Romains prirent la ville, ainsi qu'on peut le lire chez les divers savants, la bibliothèque fut brûlée et pillée de
fond en comble.
On dit aussi que dans cette vieille ville existait une île appelée "Farus", sur laquelle se trouvait une tour, le
long de la côte et où on montait toujours la garde. Cette tour reposait sur quatre voûtes de verre qui
semblaient la soutenir à elles seules. Certains disent que c'est le roi Ptolémée Philadelphe qui la fit
construire, d'autres disent que c'est Alexandre. Et c'est l'une des sept merveilles du monde dont parlent les
savants et, plus longuement Pline.
Après avoir parlé ici d'Alexandrie, il faut dire qu'il y a dans le monde, il est vrai, beaucoup de villes appelées
Alexandrie, comme Alexandrie en Égypte dont on a parlé maintenant : il y a une autre Alexandrie en Asie,
près de l'endroit où se trouvait jadis la grande et célèbre ville de Troie et une troisième en Scythie sur le
fleuve "Tanays", qui séparait l'Europe et l'Asie, ainsi que le raconte plus en détail Quint-Curce et Justin.
À cet endroit se trouve encore, lorsqu'il a beaucoup plu et que la terre est un peu ouverte, beaucoup de
vieilles pièces qui n'ont plus de valeur, de beaux camées, des cornalines et d'autres pierres sculptées en
diverses figures faite par une femme appelée "Marsia" qui surpassait dans cet art tout le monde et dont on
parle beaucoup dans divers livres. Les gens de l'endroit en apportent chaque jour beaucoup à Alexandrie et
les y vendent très bon marché.
Après voir dépassé cet endroit, on arrive à un beau plateau, si égal qu'on pourrait rouler jusqu'à son
sommet, et qui s'étend sur environ six milles.
Ensuite ils descendirent vers la gauche et arrivèrent tout de suite à la mer qu'on longe pendant dix milles
jusqu'à une ville appelée Rosette, en laissant à gauche la mer et à droite un grand massif de sable plein de
dattiers. Après avoir dépassé ce massif, ils laissèrent la mer à main droite et continuèrent ainsi à avancer
jusqu'à la ville de Rosette, qui est un bel endroit habité, mais qui n'a ni portes ni murs. »
- 191 - 195 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO EL CRUZADO (1483)
El Cruzado, A., Misterios o estaciones de Jerusalem y de toda la tierra Sancta, Séville, 1515.
Antonio el Cruzado, frère des ordres mineurs, est originaire de Séville.293
Non paginé
« De la ciudad de Alexandria
La ciudad de Alexandria es ciudad imperial y fue de las ciudades solennes del mundo, es esta ciudad
florecio mucho la cristiandad y fue cabeça y sumdamnero de los santos padres de Egypto segun que se lee
en viris patru ca aun agora e delrredor del aquesta dicha ciudad ay ciertos monesterios en el torno y circuyto
della al modo del bivir de los antiguos padres. En esta ciudad fue derramada mucha sangre y rpianos294
confessando la ley de rpo295 : entre los quales en esta ciudad es una calle que traviessa la ciudad por medio
de las solennes calles cue pueden ser en ciudad del mundo la qual se llama la calle del san marcos : en
esta calle fue sant marcos evangelista apedreado : y junto a esta calle esta la carcel en que fue ecarcelada
santa catalina : la qual oy en dia los moros tienen cerrada : y un moro tiene la llave y ha cuidado de abrir la
cava y cuando los rpianos296 assi pegrinos como navegantes que vienen a esta dicha ciudad y quieren
entrar a visitar esta bendita carcel : y reciben del cada uno algun tributo no es cosa de terminada : saluo
cada uno como se conviene con el dicho moro. Alla puerta de esta dicha carcel son dos colunas o marmoles
bien solennes en grossura y en altura : son puestos a manera de horca en los quales fueron puestas las
ruedas de las navajas : y esto es quasi en medio de la ciudad : y por que a questa ciudad es toda de
terrados : o a manera de açoteas : assi que toda la gente tambien se passean por encima de las casas
como por encima de la tierra : y porque esta era muger y de rato valer y saber dieron orden que este
instrumento o suplicio fuesse en medio de la ciudad porque todas las mugeres assi viejas como moças
recibiessen castigo en una tan cruel muerte como ordenavan dar a esta senora : assi que las dichas colunas
senore avan todas las casas de la ciudad. E porque he avido proposito de no entender en este breve tratado
saluo de las cosas spirituales no quiero mas decir de aquesta ciudad : della yo podria decir muchas cosas ;
no solamente desta mas y otras ciudades de Egypto que son en tierra santa. »
293 Garcia-Romeral, C., Diccionario de viajeros españoles desde la edad media a 1970, Madrid, 2004, p. 57.
294 On doit lire cristianos.
295 On doit lire cristo.
296 On doit lire cristianos.
- 196 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANCESCO SURIANO (1481-1484)
Suriano, F., Il trattato di Terra Santa e dell’ Oriente di Frate Francesco Suriano, Missionario e viaggiatore del
secolo XV (Siria, Palestina, Arabia, Egitto, Abissinia, ecc.), par G. Golubovich, Milan, 1900.
Le Vénitien Francisco Suriano (1450-1529) voyage tout d’abord comme marchand, avant de devenir moine
de l’ordre des observantins de saint François en 1475. Ce récit est écrit à la demande d’une religieuse du
couvent de Sainte-Lucie à Foligno. Plus tard, en 1514-1515, il devient émissaire du pape pour les Maronites
et supérieur d’un couvent en Ombrie en 1528-1529.297
p. 17-18 :
Chapitre IX
« Dépense des pèlerins qui vont à Alexandrie et de là à Jérusalem.
Tout d’abord : à l’émir de la ville : 6 ducats
Au Nader de la ville : 3 ducats
Au Grand Diodar : un demi-ducat
Au Nachibeger : un ducat
Au Luelli : un ducat
Au Nachib : un ducat
Au secrétaire de l’émir : un ducat
Aux colombiers, gardiens de la porte : un ducat
Au scrivan de la porte intérieure : un ducat
Au Turciman du Sultan : un ducat
Au Meseto de la marine : un ducat
Au Macademo de Dachtum : quatre gros
Aux protonotari de la marine : cinq gros
Au fontegar (gardien du comptoir) : deux gros
Pour le sauf-conduit, quand ils le demandent : un ducat
Lorsque les pèlerins partent au Caire ils donnent tous ensemble aux différentes personnes c’est-à-dire au
Nachi, au Bezes, au Grand Diodar, aux assistants de l’émir, sept ducats.
Au Mamelouk qui les accompagne jusqu’au Caire, cinq ducats.
Au grand Turciman du Sultan, en rentrant au Caire, chaque pèlerin paye cinq ducats.
Lorsqu’ils passent par la porte de la marine à Alexandrie, ils sont inspectés et s’ils transportent de l’argent,
ils doivent payer un ducat pour cent. »
p. 182-183 :
« De ce fleuve, on envoie l’eau à Alexandrie par un très grand canal creusé à main d’hommes. C’est sur ce
canal, au moment de cette inondation, que les germes des Mores et les barques vont et viennent
transportant les marchandises du Caire ; cette eau alimente la ville toute l’année. Et il est extraordinaire de
voir l’allégresse et la joie de tous les Alexandrins, lorsque arrive cette eau. A ce moment-là, on attrape
beaucoup de crocodiles. »
p. 186-188 »
Chapitre CXXXIV
Commencent les pèlerinages de la ville d’Alexandrie d’Égypte
« Il y a, dans la ville d’Alexandrie, l’église Saint-Georges, qui fut d’abord la maison où naquit saint-Jean
l’Aumônier.
Item, l’église de Saint-Sabas
Item, l’endroit où fut martyrisée sainte Catherine, vierge et martyre, là il y a une indulgence plénière.
Item, la prison où elle demeura douze jours ; près de cette prison il y a deux colonnes ; là Maxence déposa
les roues pour le martyriser.
Item, près des murs de la ville, à l’extérieur, il y a une très grande colonne, au-dessous de laquelle se
trouvait autrefois l’idole que Maxence faisait adorer ; là on montre l’endroit où se tenait sainte Catherine
lorsqu’elle reprochait à Maxence sa stupidité.
Item, à l’église de Saint-Marc l’Evangéliste, où il fut décapité et enseveli.
Item, une longue et large rue, qui passe au milieu de la ville, appelée Brecholi, tout au long de laquelle saint
Marc fut traîné, attaché à la queue d’un cheval, jusqu’au milieu où il fut martyrisé, par des endroits escarpés
et rocheux.
Chapitre CXXXV
De la grande et noble ville d’Alexandrie
La ville d’Alexandrie est grande ; elle a un pourtour de six milles et demi. Elle est entourée de murailles et de
braies jusqu’à nos jours. Bien qu’autrefois elle ait été une ville de premier plan et très célèbre, de nos jours
c’est une ville en ruine et peu habitée ; si ce n’était en raison de la quantité de marchandises qui y
parviennent et pour être le port de la ville du Caire, elle serait totalement inhabitée à cause de son climat
désastreux. Cette ville, jusqu’à nos jours, est agrémentée de nombreux jardins, possède des fruits en
abondance, mais il n’y a pas de vigne ni de grenades. Il y a très peu de viande, une assez grande quantité
d’oiseaux, peu de blé, mais beaucoup de riz et les meilleurs câpres du monde.
Dans cette ville, qui est très ancienne, ont été martyrisés plusieurs saints. Cette ville est à quatre-vingt-dix
milles du Caire et à une journée de Rosette, une des embouchures où le Nil se jette dans la mer
Méditerranée. Il y a dans cette ville un château où habite l’émir de la ville. Dans la cour du château, il y a une
aiguille, comme celle de Saint-Pierre de Rome, mais plus belle car elle est entièrement gravée de figures en
relief. Cette ville a deux ports : l’un s’appelle le vieux-port qui est grand et en sécurité, là on ne laisse entrer
aucun navire chrétien. L’autre port est grand et assez sûr, le sultan y a fait faire une entrée très fortifiée qui
est comme une forteresse du port, en un lieu appelé Faviglione ou plutôt Pharion, où anciennement une
lanterne y était allumée chaque nuit pour la sécurité et la sauvegarde des navires qui y arrivaient. On
apercevait sa lumière en haute mer. On faisait ainsi car toute l’Égypte est bien plus basse que la mer et il
était facile de périr. Pour la sécurité, les marins se dirigent à l’aide d’une sonde (ou bolide) : autant de pas
mesure la profondeur, autant de milles ils sont éloignés de la terre. Mais depuis la construction de ce
bâtiment, les navires chrétiens n’y rentrent plus car ils ne pourraient plus en sortir comme ils le veulent.
Dans cette ville, chaque nation chrétienne a son Fontego, l’endroit où sont les marchands. Les Vénitiens qui
commercent plus que les autres ont deux Fontichi, un grand et un petit.
Je pourrais raconter beaucoup plus de choses sur cette ville car j’y suis allé plusieurs fois entre mille quatre
cent soixante-deux, date de mon premier voyage, et mille cinq cent trois. Lorsque je fus gardien la première
fois au mont Sion, je me rendis à Alexandrie pour prêcher le carême, du temps de Aluvise Rimondi, le
Magnifique, très digne consul de l’Illustrissime Seigneurie de Venise. »298
297 Bellorini, T., Hoade, E., Bagatti, B., Fra Francesco Suriano. Treatise on the Holy Land, Publications of the
Studium Biblicum Franciscanum 8, Jérusalem, 1949, p. 1-11.
Schur, N., Jerusalem in pilgrims and travellers’s accounts, a thematic bibliography of western christian
itineraries, 1300-1917, Jérusalem, 1980, p. 150.
298 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 197 - 198 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GEROLAMO DE CASTELIONE (1486)
Castelione, G. de, Trattato della parte ultra mare zioe Terra Santa, Milan, 1491.
Le frère Gerolamo de Castelione est natif de Milan.299 Comme il a été spécifié, ce pèlerin reproduit la relation
de Niccolo de Poggibonsi (1349). Se référer à la notice de ce dernier auteur.
p. 33b-34b :
Chapitre 131. De la noble ville d’Alexandrie
« La ville d’Alexandrie est belle ; elle est située au bord de la mer. De superbes et hautes murailles
entourent la ville. À l’intérieur de la ville se trouvent de splendides maisons et de beaux palais. Au flanc de la
ville se trouve un port magnifique ; là coule un fleuve majestueux, lequel prend sa source au paradis
terrestre ; il s’appelle Nil. La ville possède de beaux entrepôts de marchandises, tenus par des chrétiens et
autres nations. Elle est à une distance de trois cents milles de la ville du Sultan, Le Caire. Et c’est toujours
par ledit fleuve que l’on y parvient. Une série de sanctuaires se trouve dans la ville.
Chapitre 132. De la pierre sur laquelle fut tranchée la tête de saint Jean-Baptiste et où furent décapités
sainte Catherine et saint Marc.
Dans la ville d’Alexandrie, il y a une église de Saint-Jean-Baptiste dans laquelle se trouve une pierre sur
laquelle fut tranchée la tête de saint Jean-Baptiste. Cette pierre fut transférée de la ville de Sébaste au lieu
susdit. Aucun Sarrasin ne peut y accéder et ceci par miracle divin. À proximité de cette pierre se trouve
l’endroit ou plutôt la maison où habita sainte Catherine. Cette maison est actuellement habitée par un amiral
des Sarrasins. En parcourant cette rue, on tourne à main gauche. Là se trouvent deux colonnes près d’un
palais. C’est ici que fut décapitée la vénérable sainte Catherine. À cet endroit fut bâtie une église en
l’honneur de sainte Catherine. À présent, des Sarrasins y habitent. À cet endroit, on obtient une indulgence
en rémission de ses péchés. Dans ladite rue il y a une église où se trouve l’endroit où fut décapité saint Marc
l’Evangéliste. Là on a une indulgence de 7 ans.
Chapitre 133. Comment je suis allé au Caire de Babylone.
À un demi-mille, hors de la ville, se trouve l’endroit où se réfugia saint Athanase lorsqu’il fut recherché sous
le règne de l’Empereur Constantin. C’est là qu’il fit cette profession de foi : “Quicumque...”. Ici on a une
indulgence de 7 ans.
Je partis d’Alexandrie après avoir visité ces lieux saints. À un demi-mille de distance se trouve un fleuve,
appelé Nil, qui descend du paradis terrestre. Là je m’embarquai sur une petite barque appelé « djerme »
appartenant à des Sarrasins et nous fîmes voile vers la grande cité du Caire de Babylone. »300
299 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 170-173.
300 Traduction : S. Sauneron (archives
300 Traduction : S. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 199 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
OBADIAH JARÉ DE BERTINORO (1488)
Jaré de Bertinoro, O., « Obadiah Jaré de Bertinoro », dans E. N. Adler, Jewish travellers, New Delhi, 1995.
Le rabbin Obadiah Jaré de Bertinoro est originaire du Nord de l’Italie et émigre en Palestine en 1487. Il est
considéré comme un grand savant. Son récit se compose d’une série de trois lettres dans lesquelles ses
voyages sont mentionnés. Il semble avoir vécu à Jérusalem jusqu’à sa mort aux environs de 1500.301
p. 220-223 :
« Nous arrivâmes à Alexandrie, le 14 Shebat, fatigués et épuisés. Là Dieu nous favorisa aux yeux d’un
homme généreux, très aimé même des arabes nommé R. Moses Grosso, le guide des Vénitiens. Il vînt à
notre rencontre et nous délivra des Arabes qui demeuraient à l’entrée de la ville et qui pillaient les Juifs
étrangers pour leur plaisir. Il m’emmena chez lui et c’est là que je dus habiter durant mon séjour à
Alexandrie ; je lus avec lui un livre sur la Cabbale qu’il possédait, car il chérissait cette science. Ainsi
pendant cette lecture, je lui plus, je gagnai son estime et nous liâmes amitié.
Le jour du Sabbat, il donna un dîner où il invita le Shepardi qui était venu avec moi, ses deux fils étaient
aussi déjà présents lorsqu’il m’introduisit dans la salle à manger.
Le déroulement du repas traditionnel du Sabbat chez les Juifs se passe de la façon suivante dans tous les
pays arabes. Ils s’asseyent en cercle sur un tapis, le serveur se tient à côté des convives ; toutes sortes de
fruits de saison sont posés sur ce napperon. Alors, l’hôte prend un verre de vin, prononce la bénédiction de
la sanctification (Kiddush) et le vide complètement. Puis le serveur prend le verre de l’hôte pour le proposer,
toujours rempli, à toute l’assemblée afin que chacun le vide successivement. Ensuite, l’hôte prend deux ou
trois fruits, en mange, et boit un second (p. 221) verre de vin pendant que les invités prononcent : « Santé et
Vie ». Quiconque est assis à côté de lui prend un fruit et le serveur lui remplit un second verre en lui disant :
« À votre plaisir », l’assemblée se joint à lui en prononçant : « Santé et vie » et on continue ainsi à tour de
rôle. Puis une seconde variété de fruit est distribuée avec un autre verre rempli ; on continue ainsi jusqu’à ce
que chacun ait vidé au moins six ou sept verres. Parfois, ils boivent même en sentant des fleurs fournies à
cette occasion ; ces fleurs sont les dudaim que Rashi traduit en arabe par jasmin ; c’est une plante qui
produit uniquement des blossoms d’un parfum délicieux et rafraîchissant. Le vin est exceptionnellement fort,
surtout à Jérusalem où on le boit non-mélangé. Lorsque tout le monde en a bu en abondance, on apporte un
grand plat de viande, chacun tend sa main, prend ce qu’il veut et mange vite, car ils ne sont pas très gros
mangeurs. R. Moses nous offrit des sucreries, du gingembre frais, des dattes, du raisin, des amandes et des
douceurs aux graines de coriandre. Un verre de vin est bu avec chaque sorte. Ensuite, suivit un vin de raisin
très bon, puis du vin blanc de Crète et de nouveau du vin local. Je bus avec eux, ce qui m’égaya.
Dans le pays des Arabes, il y a une autre coutume. Ils vont tous au bain le vendredi, puis, à leur retour les
femmes leur servent du vin qu’ils boivent en grande quantité. Ensuite, on annonce le dîner. On mange
quand il fait encore jour, avant la tombée de la nuit. Puis tout le monde se rend à la synagogue proprement
et soigneusement vêtu. On commence par réciter des psaumes puis par exprimer sa reconnaissance à Dieu.
La prière du soir s’achève deux heures après le crépuscule. Une fois qu’on rentre à la maison, on répète le
Kiddush, on ne mange qu’un morceau de pain de la taille d’une olive, et on demande grâce à Dieu après le
repas.
[Dans tout ce territoire, la prière du mincha est lu en privé le vendredi, sauf à Jérusalem, où les Ashkenazis
(Allemands) (p. 222) ont cessé d’utiliser cette coutume ; la prière du mincha et du soir sont dites avec
Minyan autant qu’avec nous. Ils mangent la nuit. La prière du soir ne commence que lorsque les étoiles sont
visibles. Dans ces endroits, le Sabbat est plus strictement tenu qu’ailleurs. Personne ne quitte sa maison
pendant le Sabbat, sauf pour aller à la synagogue ou au Beth Hamidrash (Maison de l’Étude). Il faut
mentionner que personne n’allume de feu pendant le Sabbat ou n’a une lumière qui a été rallumée même
par un Gentil. Tous ceux qui sont capables de lire les Saintes Écritures lisent toute la journée après avoir
cuvé leur vin.]302
À Alexandrie, il y a environ vingt-cinq familles [juives] et deux vieilles synagogues. L'une est très grande et
un peu endommagée, l'autre est plus petite. La plupart des personnes prient dans la petite [synagogue]
parce qu'elle porte le nom du prophète Elie ; on dit que ce dernier apparut une fois dans l’angle sud-est où
une lumière brûle constamment à présent. On dit qu’il réapparut à un vieil homme, il y a vingt ans. Dieu sait
la vérité ! Dans tous les pays arabes, aucun homme ne pénètre dans une synagogue avec des chaussures
aux pieds ; même en payant une visite, les chaussures doivent rester à l’extérieur, à la porte. Tout le monde
s’asseoit par terre sur des nattes ou des tapis.
Alexandrie est une grande ville entourée de murs et encerclée par la mer, bien que les deux-tiers soient
maintenant détruits et que beaucoup de maisons soient inhabitées. Les cours des maisons habitées sont
pavées de mosaïques ; des pêchers et des dattiers y sont au milieu. Toutes les maisons sont grandes et
belles, mais les habitants sont peu nombreux, à cause de l'atmosphère malsaine qui règne ici depuis
beaucoup d’années. On dit que ceux qui ne sont pas habitués à l’air, et qui restent longtemps, meurent ou
du moins tombent malades. La plupart des habitants ont des maladies d'yeux.
Les marchands viennent de toutes parts ; à présent, il y a quatre consuls : (p. 223) de Venise, de Gênes, de
Catalogne et d’Ancône. Les marchands de toutes les nations doivent traiter avec eux. Les chrétiens sont
obligés de s'enfermer dans leurs maisons tous les soirs. Les Arabes ferment les rues de l'extérieur et les
rouvrent de nouveau chaque matin. Il en est de même vendredi, de midi au soir : pendant que les Arabes
sont dans leurs maisons de prières, les chrétiens doivent rester dans leurs maisons, et celui qui est vu dans
la rue, ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il est maltraité.
Le roi d’Égypte reçoit une somme d’argent importante grâce aux taxes sur les marchandises qui viennent à
Alexandrie ; la taxe est très haute. On doit même verser deux pour cent sur la monnaie qu’on apporte. Quant
à moi, avec l’aide de Dieu, je n’étais pas obligé de payer un droit d’entrer pour mon argent. Les
contrebandiers ne subissent pas de peine spéciale de la part des douaniers égyptiens. »303
301 Shatzmiller, J., « Obadiah de Bertinoro », dans D. Regnier-Bohler, Croisades et pèlerinages. Récits,
chroniques et voyages en Terre Sainte, XII-XVIe siècle, Paris, 1997, p. 1358.
302 Ce paragraphe entre crochets est absent dans les éditions antérieures. Traduction : O. Sennoune.
303 Traduction : S. Fadel (archives Sauneron, Ifao).
- 200 - 201 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FLORENTIN ANONYME (du 19 au 22 juillet 1489)
Florentin anonyme, Illustrazioni in un anonimo viaggiatore del secolo XV, par G. Mariti, Livourne, 1785.
Prêtre voyageant avec un compagnon.
p. 11-15 :
« Giunti in Alessandria furono condotti davanti l’Almiraldo, o sia Governatore della Città, il quale aveva una
gran Guardia di Mamalucchi, i quali ognuno sa che erano in origine Schiavi Cristiani allevati da piccoli
ragazzi nella religione Maomettana, ed i quali ascendevano poi secondo la loro abilità, e talento alle
maggiori cariche del regno, per cui il governo dell’ Egitto si disse poi il Governo deu Mamalucchi.
L’Almiraldo volle intendere da loro chi erano, ed in sua presenza fece aprire le lettere che seco avevano, e le
fece poi leggere per vedere, e intendere se le medesime contenevano niente di sospetto.
Furono poi licenziati, e con certi Fiorentini che Mercanzie se ne andarono al Fondaco dei Castelani, ove
furono molto bene accolti. I Veneziani, i Genovesi, e gli Anconetani similmente avevano in Alessandria i loro
Fondachi, e i loro respettivi consoli. Chi non vi aveva console se ne stava, come segue anche
presentemente in tutto il Levante, sotto la protezione di quel console a cui è raccomandata la sua Nazione, o
in mancanza di cio si mette sotto quella Protezione, che piu gli fa comodo.
La parola Fondaco della quale si serve qui il nostro Scrittore esprime quei luoghi ove abitavano i Mercanti
Cristiani per ragione di traffico, e dove erano i magazzini delle loro mercanzie, e le botteghe loro.
Mercatorum officina, cosi spiega questa voce il Muratori nelle sue Antichità Italiane, dove molto
aggiustatamente releva esser questa una voce Araba che significa bottega di Mercante ; ed il Gollio presso
lo stesso Muratori osservo, che l’Arabo Fondaqon est publicum Mercatorum hospitium, ubi cum suis
Mercibus versantur.
Soggiugne il nostro Anonimo che tali Fondachi erano fatti a guisa di Casseri. Questa che è altresi una voce
Araba, osserva lo stesso Muratori che a noi su trasportata dagli Arabi, e che significa presso di loro castello,
fortificazione, e presso gli stessi nostri Istorici Fiorentini non manco tal voce per esprimere la cosa stessa,
ma voce pero sempre originaria Araba.
È verissimo poi che tali Fondachi che si osservano tuttavi nelle città del Levante sono ordinariamente
fabbriche riqudrate, e tutte rinchiuse da un muro castellano, e nelle quali si entra soltanto per une, o due
porte, o piu secondo il bisogno, e l’estensione di tali luoghi ; e le quali la notte stanno serrate. Al presente
pero si chiamano piu comunemente tali fabbriche colla denominazione di Kan, o Campo.
È un privilegio particolare che il Governo del Gran Signore accorda alle Nazioni Cristiane di avere i loro Kan,
ove se vogliono stanno riunite tutte le Nazioni Europee, e dove stando la notte serrati sono anche piu sicuri
da qualunque attentato, quantunque non venga loro proibito di uscire tutte le volte che vogliono, e a
qualunque ora.
Nel tempo che i Principi Latini furono Padroni della costa della Soria usavano pure tali Fondachi, ed allora
ciascuna Nazione Cristiana vi aveva il proprio Fondaco, ove esercitavano anche giurisdizione, e dove
ciascheduno si governava colle proprie Leggi, il che fu poi appunto una delle causa per cui nel 1291 persero
i Latini la Città di Acri, mentre disuniti di leggi, e di costumi era impossibile che piu potessero sostenersi in
quelle Parti contro le forze riunite del Soldano Egiziano Melec-Seraf.
Il Fiorentino sbarco pure il regalo che andava al Soldano di Egitto, ed era questa una Lettiera riposta in piu
casse.
S’intende dal nostro Viaggiatore che in Alessandria le monete pagavano all’entrare due per cento, dazio
singolare, ed assai grave.
Parti poi di Alessandria per andare al Cairo il di 22 di Luglio 1489. Per uscire di Alessandria gli bisognava
pagare Ducati tredici, ma egli ne fu esente mediante l’essere in compagnia del Fiorentino che passava al
Cairo col regalo. »
- 202 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
WOLF VON ZÜLNHART (décembre 1495)
Zülnhart, W. von, Reise Zülnharts nach Jerusalem, 1495, Augsburg, Stadtbibliothek Augsburg, 4° cod. Aug.
93.
Non paginé :
« Au lever du jour, nous partîmes sur des montures jusqu’à Alexandrie et nous y arrivâmes aux alentours de
midi. Lorsque nous arrivâmes devant la porte, on laissa entrer les Mamelouks, quand à moi, on ne voulait
pas me laisser entrer par la même porte. Je devais passer par une autre [en étant] accompagné d’un jeune
garçon qui devait me montrer le chemin jusqu’à l’autre porte. Je donnai un madon au jeune garçon afin qu’il
me montra le chemin jusqu’à la porte. Mais dès que le jeune garçon obtint le madon, il se sauva. Je longeai
la muraille tout seul sur ma monture jusque devant la porte. Arrivé à la porte, je dus descendre du mulet et
l’on m’emmena. Une fois à terre, j’ai dû ouvrir mon sac et mes bagages ; j’ai dû laisser fouiller toutes mes
affaires. Quand ils finirent de fouiller toutes mes affaires, je dus me déshabiller et ils me fouillèrent partout ;
ils trouvèrent sur moi plusieurs choses pour lesquelles j’ai dû donner un ducat. De plus, ils me volèrent aussi
un autre ducat et je dus leur donner encore X autres madon. Quand ils me fouillèrent, ils trouvèrent sur moi
II lettres que m’avait données le truzelman du sultan que je devais remettre, à Alexandrie, à deux
commerçants de Venise dans le petit fontico. Muni de ces lettres, ils me conduisirent devant l’armazy
d’Alexandrie ; toutes les lettres trouvées sur quelqu’un sont décachetées et lues par l’armazy. Ainsi, je
devais aussi me présenter devant lui avec les lettres, mais l’armazy n’était pas là jusqu’à la nuit. Quand
l’armazy arriva, je dus donner à quelqu’un un madon pour qu’il aille chercher un truzelman qui lit les lettres.
Quand il lut les lettres, ils m’amenèrent dans le petit fontico des Vénitiens, et là, les mêmes commerçants
m’hébergèrent et m’accueillirent de façon agréable et honnête.
À Alexandrie, il y a IIII fondiques, les Vénitiens en ont deux, un grand et un petit ; dans le grand ils ont une
église et un prêtre qui lit la messe presque tous les jours. Par ailleurs, il y en a encore deux autres, celui des
Génois et celui des Catalans.
À Alexandrie il y a II colonnes304 qui sont faites de marbre rouge, grandes et élevées. Sur les colonnes, se
trouvait la roue où sainte Catherine fut jadis martyrisée, et à côté, se trouve la prison où il fut enfermé. À
Alexandrie il existe aussi une église du nom de Saint-Saba ; à l’intérieur se trouve une image très pieuse de
la Vierge peinte par saint Luc. Les commerçants se rendent tous les matins dans cette église. Dans la ville il
y a aussi une église du nom de Saint-Marc. Devant la ville, au dehors, au bord de la mer, il y a une église qui
s’appelle aussi Saint-Marc, c’est là qu’il fut tué. Derrière le grand fontico des Vénitiens, se trouve le lieu où
saint Marc fut capturé et depuis ce lieu-là, il fut traîné jusqu’à l’église devant la ville. À Alexandrie, il y a aussi
une grande maison où se trouve un cloître ; sainte Catherine y aurait habité. C’était un grand bâtiment avec
des murs épais et forts.
Devant la ville au bord de la mer, vers le ponant, il y a la porte de la Mer, c’est là que les navires déchargent.
C’est une très belle porte, à cet endroit précis, la ville est très belle grâce à ces murailles. Au bord de la ville
devant la ville, il y a un beau château, d’où ils peuvent défendre et attaquer la Porte de la Mer. De l’autre
côté du château et de la ville, il y a une autre Porte de la Mer, là, aucun Chrétien n’a le droit d’y aller ou de
décharger parce qu’un présage des païens affirment que les Chrétiens prendraient la ville à cet endroit.
Alexandrie est une ville très ancienne et très grande, mais très ruinée ; maintenant la ville n’est plus jolie.
À Alexandrie, il y a deux montagnes dans la ville et aucun Chrétien n’a le droit d’y monter ; sur une des
deux, vers la mer, il y a une tour où on monte la garde et sur l’autre il n’y a rien. Les deux sont hautes.
Dans la ville, il y a aussi une pierre haute et pointue, à proximité de l’église Saint-Marc devant la ville, qui
s’appelle aiguille de pharaon, comme il y en a une aussi au Caire derrière le jardin de Balsam.
Il y a aussi une église qui s’appelle Saint-Michel.
Nous quittâmes Alexandrie, le samedi à midi sur un bateau. Dans mon groupe, il y avait un Vénitien et un
Napolitain accompagnés de deux valets. Ainsi nous naviguâmes avec un bon vent jusqu’à lundi midi ; nous
arrivâmes à Rhodes avant Noël, le 22 du mois. »305
304 Dans le texte allemand, on lit Schulen (écoles) qui doit être pris pour Säulen (colonnes).
305 Traduction : K. Machinek.
- 203 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ARNOLD VON HARFF (1497)
Harff, A. von, The Pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy, Syria, Egypt, Arabia, Ethiopia,
Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, 1496-1499, par M. Letts, New York, 1990.
Arnold von Harff (1471-1505), originaire du Rhin inférieur, est chancelier au service du duc de Jülich. À l’âge
de 27 ans, il accomplit un voyage qui dure trois ans. Son périple sort du cadre du simple pèlerinage. Il part
de Cologne en direction d’Alexandrie, puis, avant de visiter la Terre sainte, il remonte le Nil, l’Éthiopie pour
se rendre jusqu’à Madagascar. 306
p. 92-96 :
« Item de ce port nous naviguâmes en six jours par un vent favorable jusqu’à Alexandrie. Itemalors que
nous nous approchions de la ville d'Alexandrie et que nous nous trouvions à trente milles italiens, le
gouverneur d’Alexandrie, qu’on appelle Armereyo, nous envoya une délégation. L’Armereyo est choisi parmi
les Mamelouks (qui sont les renégats chrétiens) et il est envoyé chaque année par le Sultan du Caire à
Alexandrie pour gouverner la ville. Item il nous fit inspecter et nous demander qui nous étions et ce que nous
voulions. Nous répondîmes que nous étions Vénitiens et que nous transportions de la marchandise.
Immédiatement les païens de l’Armereyo notèrent ces paroles sur une petite lettre qu’ils fixèrent sous l’aile
des pigeons apprivoisés, qu’ils avaient apporté dans une corbeille et les laissèrent s’envoler. L’oiseau fut
aussitôt dans le palais de l’Armereyo, apportant à ce dernier le message le renseignant sur nos personnes
et sur les marchandises que nous avions chargées. Il fit connaître ces renseignements immédiatement au
Sultan et à ce qu’on me dit de la même façon, c’est-à-dire à l’aide de pigeons volant entre d’Alexandrie et le
Caire, où le Sultan tient sa cour, ce que pourtant je n’ai pas vu de mes propres yeux.
Item lorsque nous arrivâmes dans le port d’Alexandrie, qui est très vaste, nous passâmes en bateau devant
un château fort qui se trouve dans la mer. Il a un double mur qui va du château jusqu’à la terre ferme tandis
qu’il est flanqué de seize tours bien solides et fut construit récemment par Qayt Bay, le père du jeune sultan.
En passant devant le château nous devions baisser notre grande voile en signe de respect pour ce château.
On tira alors à partir de ce dernier mainte salve en signe de respect pour (p. 93) les Vénitiens ; nous en
fîmes de même à partir de notre bateau. Item que nous eûmes jeté l’ancre dans le port d’Alexandrie,
personne ne fut autorisé à quitter le bateau sauf le patron et mon dragoman, qui était un Mamelouk donc un
des leurs. Ils se rendirent en ville auprès de l’Armarigo afin d’y demander pour nous un sauf-conduit tel
qu’on en donnait aux marchands vénitiens. Chacun devait verser deux ducats, somme que les marchands
vénitiens paient en général dans les villes païennes pour un sauf-conduit mais sur le prix de chaque
cargaison qu’ils apportent ou transportent, ils doivent céder dix de chaque cent ducats au Sultan. S’ils
avaient su que j’étais un pèlerin, j’aurais dû payer cinq ducats et j’aurais cessé d’être dans les bonnes
grâces du seigneur à cause de ce subterfuge. Itemnous arrivâmes donc en ville et logeâmes dans le
fondique vénitien, qui est un entrepôt de marchandises et dont les Vénitiens en possèdent deux dans cette
ville, leurs serviteurs y étant logés aussi. Ceux-ci nous rendirent grand honneur nous servant des repas et
des boissons pour un ducat la semaine. Item ce Fondique ou entrepôts sont fermés chaque soir du dehors
par les païens et ouverts tôt le lendemain.
Après être resté deux jours dans le fondique pour me reposer je traversai à titre de marchand avec les
autres la ville pour y bien examiner toute chose. J’observai et je pensai qu’Alexandrie n’est pas plus petite
que Cologne. Pourtant l’intérieur de la ville est très délabré à cause de tous ces édifices tombés en ruine,
mais elle a toujours des murs solides, des tours et fossés construits à la manière de chez nous aménagés
quand la ville était encore chrétienne.
(p. 94) Item dans cette ville il y a deux collines artificielles, dont l’une est à peu près au centre de la ville et
l’autre à un endroit plus élevé, sur laquelle se dresse une tour carrée. Sur cette tour est postée une
sentinelle qui annonce l’arrivée des bateaux s’approchant de la ville. Autant qu’il en voit venir autant il dresse
de drapeaux sur la tour. L’Armarigo envoie (alors) immédiatement des messagers avec des corbeilles de
pigeons apprivoisés, comme je l’ai décrit plus haut, afin de voir quels bateaux s’approchent.
Item aux alentours de cette ville il y a un grand nombre de plaisants et beaux jardins ayant de jolis pavillons.
Ils y poussent une grande quantité de fruits rares, des oranges, des limons, des dattes, des canéficiers, des
citrons, des figues, des bananes ainsi que d’autres fruits étranges qui tous sont très sucrés. Item à cause
des grandes chaleurs dans ces pays, il n’y croît ni pommes, ni poires, ni prunes, ni cerises qui sont du froid
par nature.
Itemvoici les lieux saints qu’on m’a montrés dans cette ville. On me conduisit à une petite grotte voûtée
souterraine dans laquelle sainte Catherine resta prisonnière pendant douze jours sans prendre aucune
nourriture corporelle. Avant d’entrer on doit payer un madyn, dont vingt-six valent un scheraff, ce dernier
étant un florin païen, l’équivalent d’un ducat et frappé par le sultan. Item tout près de là se trouvent deux
piliers de marbre rouge distants de douze pas l’un de l’autre, sur lesquels se trouvait la roue avec les
couteaux tranchants qui auraient servi à martyriser sainte Catherine. Item en dehors de la ville il y a encore
deux piliers de marbre rouge, dont l’un était de mon temps tombé (p. 95) par terre. En ce lieu, on trancha la
vénérable tête de sainte Catherine. L’ange transporta son corps avec la tête, à quinze jours de voyage d’ici,
à travers le désert Arabique, vers le Sud, sur une haute montagne appelé Mont Sinaï que je décrirai plus
tard. Item en ville se trouve une église dédiée à St. Saba où sainte Catherine avait sa demeure. Il y a aussi
une peinture de notre Sainte Vierge peinte d’après nature par saint Luc. Cette église appartient aux Grecs.
Item dans cette ville se trouve aussi une église dédiée à saint Marc, dans laquelle il a vécu longtemps et où
il a été martyrisé et enterré. Maintenant elle est habitée par des chrétiens appelés Jacobites. Item une autre
église appelée Saint-Michel appartient aussi aux Jacobites. C’est ici que l’on enterre les marchands ou
pèlerins chrétiens de notre pays.
Item à Alexandrie, se trouvent de belles mosquées, qui sont les églises des païens et dans lesquelles ils font
leurs offrandes à Dieu du royaume des cieux et à Mohamed leur prophète.
Item dans cette ville il y a six fondiques ou entrepôts où les Vénitiens, les Génois, les Catalans, les Turcs,
les Maures, et les Tartares en possèdent un chacun dans lesquels ils commercent avec beaucoup
d’animation, achetant et vendant de la marchandise. Aussi des hommes et des femmes chrétiens, des
garçons et des jeunes filles qu’on a capturées en pays chrétiens y sont vendus quotidiennement à vil prix,
pour quinze, vingt ou trente ducats, d’après ce qu’ils ont estimé. Tout d’abord ils inspectent tous leurs
membres, selon s’ils sont en bonne santé, forts, malades, boiteux ou faibles, puis ils les achètent. Item j’ai
aussi vu se vendre beaucoup de grives blanches dont on attrape de grandes quantités dans les jardins à
l’aide de filets.
Item j’ai aperçu aussi beaucoup de grosses autruches se vendre et un grand nombre de léopards dont j’ai vu
un jeune se vendre pour un ducat. Item le léopard est un animal terrible à voir. Il a une tête et un cou qui
(p. 96) ressemble à celui du lion et un pelage rougeâtre avec des taches noires recouvrant son corps, de
cette façon. (dessin)
Item cette ville d’Alexandrie se trouve en Syrie confinant en pays d’Égypte. Le grand roi Alexandre, duquel
elle a gardé le nom, commença sa construction. Item il pleut très rarement dans cette ville, mais pendant la
saison où le Nil déborde, il couvre le pays entier faisant ainsi pousser les récoltes. D’ailleurs les habitants
n’ont pas d’eau douce dans la ville et pour cette raison, quand il pleut, ils la stockent dans des citernes.
Item quand nous eûmes tout bien inspecté nous négociâmes avec un mokari, (celui qui loue des ânes) pour
que les ânes nous transportent d’Alexandrie à Rosette, à quarante milles le long de la mer. »307
306 Schur, N., Jerusalem in pilgrims and travellers’s accounts, a thematic bibliography of western christian
itineraries, 1300-1917, Jérusalem, 1980, p. 147.
307 Traduction : P. Bleser (archives Sauneron, Ifao).
Tardivement, nous avons eu connaissance d’une édition plus récente de ce récit de voyage : Bleser, P., « Le
pèlerinage du chevalier Arnold von Harff », dans Zum Bild Ägyptens im Mittelalter und in der Renaissance.
Comment se représente-t-on l'Égypte au Moyen Âge et à la Renaissance ?, OBO 95, Göttingen, 1990,
p. 59-141.
- 204 - 205 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
16e siècle |
PIERRE MARTYRE D’ANGHIERA (du 23 décembre 1501 au 16 janvier 1502)
Martyre d’Anghiera, P., Relationi del S. Pietro Martire milanese delle cose notabili della provincia dell’Egitto
scritte in lingua Latina alli Serenisse di felici memoria Re Catolici D. Fernando e D. Isabella & hora recata
nella Italiana, par C. Passi, Venise, 1564.
Pierre d’Anghiera, issu d’une des des plus illustres familles de Milan, naît en 1455 à Arona sur le lac Majeur.
En 1477, il se rend à Rome et se met au service du cardinal Ascanio Sforza Visconti puis de l'archevêque de
Milan. Il y reste six ans et entretient des relations avec les littérateurs les plus distingués. Il se rend en
Espagne en 1487 et entre au service du roi Ferdinand et de la reine Isabelle. Il quitte ensuite les armes pour
l'état ecclésiastique. Il est chargé par la reine d'enseigner les belles lettres aux jeunes seigneurs de la cour.
En 1501, le roi Ferdinand l’envoie en mission auprès du sultan d'Égypte Qānṣūh al-Ġawrī pour le disculper
des accusations portées contre lui par les Maures réfugiés d’Espagne et pour protéger les intérêts des
pèlerins en Terre sainte. À son retour, le roi le fait conseiller pour les affaires de l'Inde et le nomme prieur de
l'église de Grenade en 1505. Après la mort du roi, Pierre d’Anghiera conserve un crédit auprès du nouveau
roi et obtient une riche abbaye de l'empereur Charles-Quint. Il meurt à Grenade en 1526.308
p. 22b-23 :
« Chapitre VIII. Description faite par le sieur Pietro Martire sur l’état de la ville d’Alexandrie, et le mauvais
traitement que font subir les Mamelouks aux habitants pour obtenir de l’argent
J’eus l’autorisation de l’Amiral d’Alexandrie de pouvoir descendre à terre, car sans cela ils ne permettent à
personne de débarquer. Et je pris logement chez un certain Filipo da Pareda, de Barcelone, consul des
nations espagnole et française dans cette région. Dès mon entrée à Alexandrie, il expédia un messager au
Caire (qui fut l’ancienne Babylone, et qui, à présent, est la capitale et le siège royal des provinces d’Egypte,
de Judée et de Syrie) pour informer le sultan de mon arrivée ; car il est de coutume que toute personne qui
veut aller au Caire attende d’abord un sauf-conduit du sultan avant de s’acheminer vers le Caire.
Donc, en attendant ce sauf-conduit, je commençai à observer les climats et à considérer à quel point
Alexandrie était à cet égard éloignée, car elle constitue le troisième climat après Méroé ; et je sus qu’à cette
période, dès que l’hiver arrive dans nos régions d’Europe, les hirondelles et les milans (qui en Espagne
s’appellent milans royaux) ainsi que les autres oiseaux migrateurs viennent hiverner à Alexandrie ; en pleins
mois de décembre et janvier, ils avaient de beaux arbres et jardins couverts de verdure.
Le sixième jour suivant mon entrée à Alexandrie, ne pouvant plus passer mon temps à ne rien faire, je
commençai à me promener à travers la ville. Lorsque je vis cette ville, qui fut jadis si renommée et si grande,
peuplée de tant d’habitants, si belle, si riche, siège des Ptolémées rois d’Égypte, maintenant à ce point
ruinée et désolée, et en grande partie inhabitée, je fus saisi d’une telle pitié devant son malheur que j’en
pleurai. Ô malheureuse cité, quelles murailles épaisses, quelles vastes rues, quelles belles façades de
maison, qui montaient vers le ciel, quels grands arcs de portes, sont devenus cendre et ne laissent plus voir
aucune trace ! je cherchais sans cesse d’où était venue cette ruine lamentable, et différentes raisons m’en
étaient présentées. Certains pensaient que cette ruine était venue suite à une grande peste ; d’autres des
guerres et des émeutes de ses habitants ; mais la plus grande partie s’accordait à dire que le dépeuplement
était dû à la cruauté des califes et des sultans qui se succédèrent dans cet État, aux califes, après que le
siège royal eut été transféré au Caire ; et surtout à la tyrannie cruelle des esclaves mamlouks. De fait, à
l’élection de chaque nouveau sultan, ces pauvres gens qui habitent Alexandrie sont dépouillés et écorchés
vifs, selon le bon plaisir des Mamlouks – comme si c’étaient des animaux mis en vente ; tout cela, parce que
la ville d’Alexandrie, à part Damas en Syrie, est la ville la plus commerçante et la plus affairée qui existe
dans tout le royaume du Sultan. Il y eut même certains sultans, informés par des dénonciateurs secrets, qui
leur enlevèrent leur argent par la torture sans donner d’autre raison que celle-ci : “Nous voulons de l’argent”.
C’est pourquoi tous les marchands ou autres riches habitants de la région s’attendent continuellement, nuit
et jour, à mourir, à cause des richesses que l’on croit qu’ils possèdent ; ils en tremblent et mènent une vie
malheureuse, et sont tourmentés de mille soucis. De là vient le fait que de nos jours il se fait peu de
commerce et qu’on ne trouve pas de richesses visibles, sinon en petit nombre ; parce que les marchands
font tous semblant d’être pauvres, et vivent et s’habillent modestement faisant croire qu’ils ont des choses
plus ordinaires qu’à l’accoutumée, pour ne pas être soupçonnés d’être riches. Mais j’en ai assez dit pour le
moment sur les choses d’Alexandrie. »309
308 Weiss, M., « Anghiera, Pietro Martire d’ », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie
Universelle ancienne et moderne 2, Paris, 1811, p. 169-170.
309 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 206 - 207 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVANNI DANESE (du 31 mars au 10 avril et du 23 juillet au 14 août 1502)
Pellegrini, D. M., « Viaggio al Cairo di Giovanni Danese », Giornale dell’italiana letteratura, 1805, p. 99-133.
Benedetto Sanudo est envoyé en 1502 par la République de Venise comme ambassadeur auprès du Sultan
Qānṣūh al-Ġawrī. Il a pour aumônier Giovanni Danese, un chanoine de Saint-Marc, auteur cette relation
écrite dans son propre dialecte.310
p. 123-124 :
« À cette heure-là, nous levâmes l’ancre et arrivâmes à la troisième heure du jour au port d’Alexandrie, où
nous demeurâmes toute la journée et la nuit suivante ; la distance entre Alexandrie et Cao Salomon est de
500 milles.
Le 1er avril, son excellence l’Ambassadeur descendit du navire à la première heure du jour. Là, notre Consul
d’Alexandrie, ainsi que les marchands et les deux amiraux de terre vinrent au port accueillir son Excellence,
et tous ensemble, nous allâmes accompagner l’Amiral Chef à son domicile, puis nous rentrâmes à notre
demeure qui avait été préparée pour nous, depuis longtemps.
Le 2 avril, le matin après la messe, son Excellence l’Ambassadeur, accompagné du Consul, des marchands
et de toute sa suite, alla rendre visite à l’amiral de terre et lui présenta les lettres de créances de notre
Illustre Nation, Une fois la visite terminée, nous partîmes et nous allâmes voir l’autre Amiral du Pharion
auquel furent présentées également les mêmes lettres de la Nation Vénitienne.
Le 7 avril, un courrier du Gouvernement vint à Alexandrie, porteur des lettres du Sultan, lequel donnait
l’ordre aux Amiraux de faire décharger tous les effets de notre Ambassadeur, sans aucune vexation mais au
contraire de les débarquer librement des galères.
Le 8 avril, on déchargea les marchandises nommées plus haut, et le même jour, on offrit aux Amiraux
d’Alexandrie, déjà nommés, les cadeaux, c’est-à-dire des draps de différente qualité et diverses formes de
fromages.
Le 10, à 9 heures, nous partîmes à cheval d’Alexandrie pour aller à Rosette. »
p. 131-133 :
« Le 23 [juillet], environ à la 6e heure, nous quittâmes Rossetto pour rejoindre Alexandrie, et à la 24e heure,
nous fûmes à Bichier où nous nous reposâmes jusqu’à minuit. À cette heure-là nous reprîmes notre route et
parvînmes à Alexandrie avant le lever du soleil, le 24. Ce jour-là, nous demeurâmes, hors de la porte
d’Alexandrie jusqu’à la 3e heure du jour, en attendant que l’émir d’Alexandrie sortit de la ville pour venir
chercher un vêtement que lui avait envoyé le sultan. S’étant habillé selon sa coutume, nous rentrâmes avec
lui à Alexandrie où nous demeurâmes jusqu’au 3 du mois d’août.
Alexandrie est une grande cité et même la première en Égypte. Là, nous vîmes, entre autres, une pyramide,
d’un seul bloc, si haute qu’elle dépasse en hauteur les murs de la ville, large de chaque côté de 6 pieds et
recouverte de signes, soit des arbalètes, des arcs, des flèches, des ailes d’oiseaux et autres diverses
décorations sculptées sur cette dite colonne ou pyramide.
Hors d’Alexandrie, nous vîmes aussi, dans les jardins, une colonne de pierre, semblable à nos deux
colonnes de la place Saint-Marc mais au grain plus fin que les nôtres. Cette colonne est si grande, que les
deux nôtres (réunies) n’atteignent pas une de cette sorte. Elle est très finement gravée et supporte un
chapiteau proportionné au fût ; en bas il y a trois bases superposées. La première, au sol, était faite en une
pierre blanche carrée, qui mesurait de chaque côté deux pas et un pied, et, elle était haute de 3 pieds.
Au-dessus, il y avait une autre base, dont les côtés avaient les mêmes dimensions que la première, mais
haute d’un pas et 4 pieds, d’un seul bloc ; elle était du même grain de pierre que la colonne. La troisième
base était ronde et haute de 4 pieds, du même grain de pierre que la colonne. La circonférence de cette
colonne est de 4 pas. Elle était si haute qu’à notre départ d’Alexandrie, à un mille de distance, la ville
disparaissait peu à peu, mais nous continuions à voir la colonne.
Le 3 août, nous embarquâmes sur notre navire, mais nous fûmes obligés de rester dans le port d’Alexandrie
à cause des vents contraires jusqu’au 7 du mois.
Le 7 août, environ à une demie heure après le lever du soleil, nous sortîmes du port et nous arrivâmes aux
rochers de Bichieri, à peu près à la 6e heure, où nous trouvâmes le bateau de Zustignani de 600 tonnes qui
avait été attaqué par les bateaux des Rhodiens ; nous le remorquâmes jusqu’à Alexandrie où nous restâmes
jusqu’au 14 août.
Le 14, à environ la 2e heure du jour, nous sortîmes de nouveau du port et nous atteignîmes Cao Chilindonia
le 18 à 7 heures de la nuit où nous demeurâmes jusqu’au matin. »311
310 Archives Sauneron (Ifao).
311 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 208 - 209 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LUDOVICO DI VARTHEMA (1502-1503)
Varthema, L. di, Les Voyages de Ludovico di Varthema ou le Viateur, en la plus grande partie d’Orient, par
J. Balarin de Raconis et Ch. Schefer, Paris, 1888.
Au cours de ses longs voyages, Ludovico di Varthema (1470-1517) s’engage dans une troupe de
mamelouks après s’être converti à l’islam. En tant que musulman, il accomplit le pèlerinage à La Mecque. Il
est ainsi le premier européen connu à pénétrer dans les lieux saints de cette ville. Ayant déserté après avoir
été suspecté d’être un espion chrétien, il est emprisonné à Aden d’où il réussit à s’évader grâce au concours
d’une des femmes du sultan. Son ouvrage est un immense succès.312
p. 6-7 :
« Et ayant espoir au divin secours de la mer, nous partîmes de Venise avec la faveur des vents. A iceulx
estendant les voyles, feismes tant par nos journées que nous arrivasmes en Alexandrie, cité d'Egypte, et
oncques homme essardé313 désirant la belle eaue de fontaine n'eust tant de désir d'icelle contrée ; et entrant
en la rivière du Nil, partis de là tant que je arrivay au Caire.»
312 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 224-238.
313 Assoiffé.
- 210 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MARTIN BAUMGARTEN (du 9 au 22 septembre 1507)
Baumgarten, M., The travels of Martin Baumgarten, a Nobleman of Germany, through Egypt, Arabia,
Palestine, and Syria, Londres, 1752.
Né à Kufstein, dans le Tyrol autrichien, Martin Baumgarten (1473-1535) est membre de la noblesse où il
apparaît parmi les chevaliers de cette région. Son récit et celui de Georges de Gaming sont identiques. Ces
deux pèlerins embarquent sur le même bateau qui ramène en Égypte Taġrī Birdī, ambassadeur du sultan
mamelouk Qānṣūh al-Ġawrī auprès des Vénitiens.314 D’après le récit de Diego de Mérida315 (1507-1512) –
voir infra – Taġrī Birdī, malgré son nom turc, serait un marrane d’origine catalane. Le terme marrane désigne
un juif converti.
- 211 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GEORGES DE GAMING (du 9 au 22 septembre 1507)
Gemnicensis, G., « Ven. Georgii Prioris Gemnicensis Ordinis Carthusiani Austria Ephemeris sive Diarium
Peregrinationis transmarinae, Videlicet Aegypti, Montis Sinai, Terrae Sanctae, Ac Syriae », dans B. Pez,
P. Hueber (éd.), Thesaurus anecdotorum novissimus II/3, Augsburg, 1721, p. 453-635.
Le prieur Georges, de l’ordre des chartreux de la ville de Gaming en Autriche, est au service du chevalier
Martin Baumgarten. Il meurt en 1541.
p. 391-393 (Martin Baumgarten) et p. 470-475 (Georges de Gaming) :
« Le neuvième jour, vers midi le guetteur cria qu’il apercevait Alexandrie devant nous. À cette nouvelle, nous
fûmes transportés de joie, espérant être parvenus à la fin de ce périple et dangereux voyage. Nous
exprimâmes notre joie en élevant vers Dieu l’offrande de notre reconnaissance.
Dans la soirée, nous arrivâmes à Alexandrie et en passant à la hauteur de la tour nommée Pharos qui est en
même temps une défense et un ornement du port, nous larguâmes toutes nos voiles (selon la coutume) pour
rendre nos devoirs au sultan, puis nous pénétrâmes ensuite dans notre havre longuement désiré. Nous
précédant de peu, Gamali, amiral de la flotte turque avait débarqué l’ambassadeur turc auprès du sultan et
avait jeté l’ancre au milieu du port. Poussé dans le port par un coup de vent plutôt frais, nous bousculâmes
ses navires : là-dessus, pensant que nous l’avions fait exprès, les Turcs se précipitèrent sur leurs armes et
avec un grand cri s’apprêtèrent à nous attaquer. Mais comprenant par nos cris angoissés ce qui s’était
passé, craignant également les lois et les privilèges du port, ils jugèrent préférable de nous laisser
tranquilles. Nous nous dégageâmes d’eux avec beaucoup de mal et nous trouvâmes un point d’ancrage.
Cette nuit-là, nous dormîmes peu ou pas du tout car les Turcs nous dérangèrent par le vacarme confus des
instruments musicaux et des voix qui leur sont propres, nous demandant d’en faire autant et nous insultant
pendant que nous nous obligions à garder notre calme.
Le dixième jour vers le lever du soleil, l’ambassadeur du Sultan, Tongobardin que nous avions amené avec
nous depuis Venise descendit à terre. Toute la jeunesse de la ville vint se presser autour de lui pour le voir
et lui présenter ses humbles hommages. Le chef de la ville accompagné d’une énorme foule de Mamelouks,
tous bien montés, ainsi qu’un très grand nombre de personnes faisant un tapage confus et désagréable
avec leurs tambours et autres instruments qu’ils avaient, le reçurent très magnifiquement ; et le consul
vénitien qui est le protecteur et le juge entre les sujets de cette république dans ces régions ayant richement
décoré un bon nombre de bateaux avec des banderoles, trompettes, etc… accompagna l’ambassadeur à
terre, au grand étonnement et émerveillement des barbares. Et en plus tous les bateaux qui étaient dans le
port rendirent hommage à Tongobardin, en tirant un nombre infini de coups de canon et emplirent l’air de
leur bruit, de leur feu, de leur fumée et des cris de leurs hommes.
Le onzième jour nous allâmes à l’auberge vénitienne et quittâmes la mer pour quelque temps ; et parce
qu’avec nos habits, nous ressemblions plus à des marchands qu’à des étrangers, nous avions à notre gré
toute liberté d’entrer et de sortir. D’ailleurs nous avions apporté très peu d’argent avec nous, ayant pris à
Venise des lettres de change ; sinon, il aurait fallu payer une douane considérable, car les Sarrasins font
une fouille profonde. Nous arrivâmes néanmoins à sauver une grande partie de ce que nous apportions en
le cachant dans un cochon, animal qu’ils exècrent plus que toute chose. Entre-temps, avec l’aide d’un guide
vénitien, nous visitâmes les plus beaux endroits de la ville où nous remarquâmes un grand nombre de
choses dignes d’être notées, que je raconterais après avoir rendu compte de l’origine de la ville.
Description d’Alexandrie, la pyramide qui s’y trouve. Les églises chrétiennes. Les anciens sages. Le trafic,
l’utilité des pigeons. Le port. Bénéfices tirés des noisettes et des châtaignes. La trahison de Tongobardin.
Alexandrie, la plus grande ville d’Égypte, fut construite par Alexandre le Grand, trois cent vingt ans avant la
naissance de Jésus Christ, sur la côte de la mer égyptienne dans cette partie de l’Afrique qui s’étend près de
l’embouchure du Nil que certains appellent le canopique et d’autres Héracléenne. Cette cité fut fondée par
Alexandre de sorte qu’elle porte son nom et recèle sa tombe ; il est dit que Jules César est venu y faire ses
dévotions. Elle est entourée d’un vaste désert et d’un rivage sans port, de rivières et de marais boisés. Les
rois successifs, comme le relate Diodore de Sicile, ont largement contribué à l’accroissement de cette ville
par les dons qu’ils firent et les ornements qu’ils lui accordèrent ; ainsi donc à la longue, selon certains elle
(p. 392) devint la plus illustre cité dans le monde. Sa longueur comme le relate Joseph était de 30 furlongs.
Tout est creux dans le sous-sol ; il y a des aqueducs partant du Nil et menant à de nombreuses maisons
privées, à l’intérieur desquelles l’eau leur est amenée ; laquelle eau se dépose et se clarifie en peu de
minutes et elle est utilisée par les chefs de famille, leurs enfants et leurs serviteurs : car celle qui est puisée
dans le Nil est pleine de vase et de boue qu’elle apporte un grand nombre de maladies à ceux qui la
boivent ; mais les plus pauvres sont contraints de l’employer, car il n’y a pas une fontaine publique dans
toute la cité.
En ce moment elle est magnifique du dehors ; les murs qui sont très larges, sont ainsi bien bâtis, solides et
hauts et les tourelles qui les surmontent sont nombreuses ; mais à l’intérieur, au lieu d’une cité on ne voit
rien qu’un prodigieux amas de pierres. Il est rare de voir une rue entière, mais il y a de larges passages, des
cours, quelques maisons entières.
Là où s’élevait autrefois le palais d’Alexandre, il y a maintenant un obélisque dressé de marbre rouge et
solide, de onze mains au carré à la base, d’une hauteur merveilleuse se terminant en pointe ; et surtout de
haut en bas, est décoré de nombreuses figures, de créatures vivantes et d’autres choses, démontrant
clairement que les Égyptiens de l’ancien temps employaient cela au lieu de lettres.
Il y en a qui disent que l’obélisque de Rome, à Saint-Pierre, dans lequel les ossements de Jules César sont
conservés s’élevait autrefois près de celui dont je parle maintenant ; mais celui-ci dépasse de beaucoup
celui-là également en hauteur et épaisseur.
Il y a encore à voir à Alexandrie quelques églises chrétiennes, parmi d’autres celle de Saint-Saba
appartenant aux Grecs. Et dans un autre endroit celle de Saint-Marc, qui dit-on fut le premier à avoir jamais
prêché l’Évangile dans ces régions. Et à cet endroit, on vous montre un bassin dans lequel, disent-ils, cet
apôtre baptisait. Derrière l’autel de cette église, on peut voir d’anciens manuscrits contenant les travaux
d’Athanase, Cyrille, Irenée et quelques autres, tous pourris et mangés par les mites, et certains d’entre eux
sont presque entièrement brûlés. Autrefois dans cette cité plusieurs savants éminents et devins florissaient,
tel Philon le Juif qui écrivit plusieurs choses très utiles ; Origène le prêtre, Athanase, ce célèbre et fidèle
évêque de cet endroit ; Dydime, Théophile, Jean l’Aumônier et plusieurs autres qu’il serait fastidieux de
mentionner. Et ici s’épanouirent les soixante-dix interprètes à l’époque de Ptolémée Philadelphe.
De nos jours, on peut voir ici de grandes quantités de plusieurs sortes de produits rapportés de la plupart
des endroits du monde. Ici les marchands de Venise ont deux entrepôts remplis d’une grande quantité de
produits, sur lesquels le consul qui est un homme de grande autorité a pouvoir. Les Génois également, ainsi
que les Turcs et les Scythes qui ont appris à manier l’or, ont quelques entrepôts à eux que les Maures
prennent la précaution de fermer chaque nuit.
Il y a aussi à l’intérieur des murs, deux collines artificielles élevées si haut que du sommet de celles-ci on
peut voir les bateaux à une grande distance.
Ils disent aussi qu’à l’occasion, ils peuvent envoyer des lettres d’Alexandrie au Caire par les pigeons
auxquels ils les attachent et qu’ils élèvent dans ce but. Cela, bien que je ne l’aie pas vu moi-même,
cependant j’avais de bonnes raisons d’y croire, étant renseigné à ce sujet de manière convaincante ; et par
ailleurs comme Pline le raconte, au siège de Mutina, Brutus attacha une lettre au pied d’un pigeon, et par ce
moyen l’envoya au camp du consul.
Au dehors des murs de la cité on peut voir la colonne de Pompée de soixante coudées de haut, au-dessous
de laquelle, ils disent, repose sa tête. Ceci pour la citer.
Quant au port, il est tellement compliqué, que même en temps de paix, il n’est pas facile d’y entrer ; car non
seulement son entrée n’est pas droite, mais est aussi tortueuse, à cause de quelques rochers et pierres qui
sont cachés sous l’eau. Sa partie gauche est renfermée par des digues artificielles ; sur la droite, se trouve
l’île de Pharos, sur laquelle il y a une tour et un fort portant ce nom. Cette tour était autrefois considérée
comme une des sept merveilles du monde, étant si prodigieusement haute que les marins pouvaient voir la
lumière qui était à son sommet à une distance de quarante milles, ou presque, et d’après elle, diriger leur
route vers la terre. Le port à l’intérieur est très sûr, avec à peu près 3 milles et demie de tour ; là sont
apportées des autres parties du monde toutes sortes de marchandises que ce pays désire, et de là est
exporté vers ces pays tout ce qui n’est pas consommé de sa propre production.
Pendant que nous étions un jour à une fête avec les marchands, entre autres choses, un certain vénitien
nous dit qu’en une année, par le chargement d’un bateau de noisettes d’Apulie, il pouvait gagner dix mille
couronnes ; et qu’envoyant un bateau chargé de châtaignes, chaque année, à Tripoli de Syrie, il pouvait se
faire douze mille couronnes. La raison en était que les Maures, les Égyptiens, les Syriens et autres gens de
la religion mahométane, employaient beaucoup cette sorte de fruit ; car bien qu’ils aient d’excellents fruits
chez eux, et d’une grande variété, cependant ils se gâtent rapidement. Par conséquent ce qu’ils ne
consomment pas en été, ils l’exportent dans d’autres pays : et tout l’hiver, particulièrement durant leur mois
de jeûne, ils vivent de ces noix étrangères que leur pays ne produit pas ; transportées dans d’autres pays,
elles ne se gâtent pas facilement (p. 393) pendant longtemps ; elles ne sont pas non plus détruites par la
vermine, comme chez nous.
Dans l’intervalle nous nous approvisionnâmes de toutes choses nécessaires à notre voyage ; et étant
recommandés à Tongobardin, un Mamelouk, et ayant de fréquentes occasions de bavarder avec lui
familièrement, nous lui fîmes un cadeau de cinquante de ces pièces d’or qu’ils appellent des Seraphs, pour
que sous sa faveur et sa protection, nous pussions voyager avec plus de sécurité. Cet argent n’était pas
plus que ce qu’il avait longtemps attendu de nous ; car il était toujours très accessible et affable envers nous
et, souvent, il nous proposa tous les services dont il avait le pouvoir. Mais pas plus tôt eut-il notre argent
dans sa poche, dont l’espoir l’avait rendu si courtois, qu’il commença à nous mépriser et à nous regarder de
haut ; cependant, nous fîmes semblant de tout prendre du très bon côté, considérant que nous étions des
étrangers.
Ils partent et arrivent à Rosette. Description du Nil et de l’Égypte.
Le 22 septembre, le matin de bonne heure, nous montâmes sur nos mules en compagnie de quelques
marchands italiens et nous partîmes pour Rosette en ayant un Mamelouk pour nous guider. »316
- 211 - 213 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN THENAUD (du 3 février au 18 mars 1512)
Schefer, Ch., Le Voyage d'Outremer : Égypte, Mont Sinay, Palestine de Jean Thenaud, suivi de la Relation
de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d'Égypte, 1512, Paris, 1884.
Jean Thenaud, gardien du couvent des Cordeliers d'Angoulême, est l’un des protégés de Louise de Savoie
et de son fils François d'Angoulême. Louise de Savoie profite de l'envoi de l’ambassade d’André le Roy pour
charger Jean Thenaud de se rendre à Jérusalem, afin de prier pour elle dans les sanctuaires des Lieux
saints, et, à l'exemple des Rois Mages, de déposer, en son nom, sur la crèche du Sauveur à Bethléhem, de
l'or, de l'encens et de la myrrhe.317
p. 20-28 :
« Le vingt sixiesme de febvrier, saillismes dudict lieu ayant vent à poupe si tresfort, que nonobstant toutes
les voiles ployées, pour une nuict fismes six vingtz milles. Et le vingt et neufviesme dudict moys au matin,
decouvrismes le Pharillon d’Alexandrie, les montaignes, tours, musquettes et piramides d’icelle, et vismes
hors du port la nef de la Trimoïlle que n’avoye veu dès Vaye et Gennes, qui là estoit arrivée le soir avant
vespres, à laquelle mismes l’ancre, car elle n’osoit entrer au port sans saufconduict ; ésquelz bateaux furent
envoyez d’une nef à l’autre pour parlementer. En l’ung d’eulx me mis pour aller veoir M. l’ambassadeur,
maistre François de Bonjehan et toute la belle compaignie à laquelle me convenoit joindre. Là sceu comme
aulcuns de ladicte nef estoyent demourez en rhodes, mesmement monsieur le baron d’Estaing ; et bientost
que fuz en icelle, survint le viguer de Castres qui avoit esté envoyé vers l’admiral, garny du saufconduict,
parquoy fismes voille pour entrer au port. Mais ainsi que l’ancre eut esté mise, nostre nef de la Trimoïlle
donna contre terre si grans coups que cuidions qu’elle se rompist et estre tous perduz.
Les Mores et Turcqs qui estoyent en terre et qui n’en cuidoyent pas moins, vindrent à si grant foulle au
navire pour le piller que eusmes grande peine à les mettre hors ; mais ladicte nef fut recullée facillement sur
ladicte ancre. Pour cestuy inconvenient, la nef ne tira artillerie pour saluer la ville, mais le tout remis au
lendemain, qui fut le IIIe de febvrier auquel jour prinsmes terre, tyrantes les nefz de la Trimoïlle, de la
Vacquerre qui appartenoit au Consul et la Ragusoise, grande quantité de bombardes. Au devant de nous
vint l’admiral d’Alexandrie bien monté, accompaigné de mammeluz pour nous recueillir, qui fist dire par son
truchement qui estoit juif comment le Souldan estoyt moult joyeulx dont ung si grant et puissant prince que le
Roy de France qui avoit subjugué toutes les Italies avoit envoyé devers luy, et que fissions aussi asseurez
comme si nous estions en France.
Toute la nuit, sur les fondictz des Castellans et Genefvois l’on avoit fait feuz de joye. L’ambassadeur fist par
ledict truchement remercier l’admiral plus de cinquante mille voltes. Après ce, nous fusmes conduictz en la
maison du consul des Castellans Phelippe de Peretz, auquel lieu estoit un beau banquet preparé, garny de
mains bons poissons, confection, fruictz et de bons vins. Les coffres et bagaiges furent conduitz dès le port
audict logis par deux cameaulx pour lesquelz furent payez cinquante seraphs d’or, car telle est la coustume.
Et vouloyent ceulx de la douanne visiter lesdictz coffres pour recueillir de devoir de l’entrée, ce qui ne leur fut
permis.
L’admiral envoya le jour ensuivant à l’ambassadeur presens de poissons et fruictz, esperant en recueillir ung
plus grant, selon la mode d’iceluy pays, ce qui fut faict. Et combien que le sien ne vaulsist six ducatz, on luy
en fist ung de draps, huiles, miel, cire et fourmaiges qui vailloit près de deux cens ducatz, duquel peu se
contenta.
Nous demourasmes en ladicte cité d’Alexandrie jusques au XVIIIe dudict moys de mars.
Et n’est ladict cité au lieu où premierement elle fut fondée par le monarche Alexandre, mais assez près
dudict lieu.
En icelle sont deux petites montaignes artificielement faictes pour donner enseigne à ceulx qui sont sur la
mer ; et au devant est la tour et chasteau du Pharillon ainsi nommé pour la tour de Pharus qui jadis estoit
nombrée entre les sept merveilles du monde, tant pour sa hauteur que fondement ; car elle estoit
profundement en mer assise sur trois chancres de voirre, et le feu qui estoit à la syme se voyoit de nuict de
trente milles en mer. Mais où jadis estoit une isle, à present l’on y va à pied sec, par terre. Il y a ung vieulx
port bien seur près la dicte ville auquel ne permettent les Mores aller les chrestiens, car ilz disent leur pays
par icelluy port devoir estre conquis des chrestiens.
En cestuy chasteau est, de par le Souldan ung admiral qui ne doit jamais permettre celuy d'Alexandrie y
entrer. Et ne veult le dict Souldan, le chasteau estre aprovisionné fors pour deux jours de peur que ceulx du
lieu ayent intelligence à ses ennemis. Combien que Alexandrie soit moult belle, grande et forte de murailles,
si est elle toute ruinée par le dedans, car dès icelluy temps que ung Roy de Chippre, Jacques de Lusignan
l’eust gastée, oncques puis ne fut totallement ediffiée ; et n’y a en icelle plus de deux mille maisons.
Ceste cité est toute creuse et plaine de cisternes pour garder l’eaue que l’on faict venir par dessoubz terre
quand le Nil croist. A ceste cause est malsaine, et qui leur trencheroit ledict conduict, la ville seroit bientost
perdue. Près la maison de l’admiral est une piramide plus haute que celle qui est jouxte saincte Pierre de
Romme, en laquelle sont engravez plusieurs caracteres, oyseaulx et bestes selon l’antique mode et les
saintes lettres des Egiptiens. Item : hors a cité sont deux moult sumptueuses coulompnes : en l’une fist
mettre en ung vaisseau d’or Ptolomée le corps du Roy Alexandre et ordonna sa sculpture là près dudict Roy.
Mais alors que Cesar estoit en Egypte, il voulut veoir le corps d’Alexandre ; et de celuy de Ptolomée n’en tint
compte ne extimation, en disant vouloir visiter les princes par loz et renom vivans, et non ceulx desquelz la
gloire avecques le corpz est ensepvelie.
Ung tyrant prince d’Ethiopie après qu’il eut degasté Egipte, viola ledict sepulchre, duquel il emporta l’or et
mist le corps en sepulchre de voirre dont bien tost après, divinement fut pugny comme sacrilege violateur
des sepulchres. Sur l’autre coulompne fist mettre le piteux et chevaleureux Cesar, le chef de Pompée que le
Roy d’Egipte (duquel Pompée jadis étoit tuteur) avoit fait trencher pour cuider complaire à Cesar. Au circuyt
sont plusieurs beaux jardins plains de fruictiers, d'herbes, poupons318, pateques, cassiers, palmes et aultres
choses singulieres.
Au dedans de la ville sont plusieurs eglises comme Sainct Michel et Sainct Marc que tiennent les chrestiens
de la ceinture.
Item : Sainct Sabe où sont enterrés les Latins par ainsi qu'ilz payent quatorze ducatz à l'admiral pour droict
de sepulture. A l'ocasion de ceste eglise, jadis fut grande contention entre les Veniciens et Genefvois, pour
laquelle finer319 fut determiné qu'elle seroit commune à tous Latins. C’estoit jadis la patriarchalle eglise où
prescha sainct Iehan l’evangeliste, sainct Iehan l’aumosnier, Astanase, Origene et plusieurs aultres
docteurs, que les Sarrazins n’ont sceu prophaner, car ilz ont voulu faire souvent boucherie d’icelle ; mais, en
voulant detailler les chairs, ilz se coupoient bras, mains, ou se coupoient les gorges et ventres, comme
enragez et demoniaques. Puis, l’ont voulu faire musquete ; mais ceulx qui montoient és tours pour crier à
l’oration se gettoit du hault en bas. Item : quant l’ont voulu ruiner, n’ont peu pour plusieurs prodiges qui
s’apparoissoient. En ladicte ville se monstroyt le lieu du martyre de la glorieuse saincte Katherine, les
coulompnes où furent mises les rhoues et la prison.
Item : sont quatre fondictz, deux appartenans ès Veniciens, le tiers est pour les Genevois et le quart pour les
Castellans. En iceulx sont les logis des marchans et belles chapelles èsquels sont enfermez de nuict les
marchans par les Mores. De tout ce qui entroit au port et ville de Alexandrie le souldan en prent tribut. A
ceste cause sa douanne est affermée, par chascun an, deux cens cinquante mille seraphs d'or. Et combien
que les chrestiens soient mal traictez audict lieu, toutesfois le proffict à celuy qui scet320 le traffic de
marchandise est si grant que les marchans ont, tout temps, vouloir de retourner, car ils gaignent cent pour
cent et plus, en marchandises qui icy sont desperées321 et de peu de valeur. Là aussi sont les pois et
mesures plus grandes.
Le jeudy dix huictiesme de mars, après midy partismes d’Alexandrie accompaignez de deux mamelus : le
bagaige se portoit une partie par mer, l’autre par terre. Par mer se portoient vins, coffres, draps, pelleteries
et aultres maintes choses dont devoit estres faict present au Souldan. Chascune botte de vin qui entroit au
Cayre devoit de tribut XIII ducatz, fors celluy des ambassadeurs et de leur train, pour lequel n’est rien payé.
A ceste cause, sous l’ombre de l’ambassade, seis porter IIII bottes ou tonneaulx de vin sur lesquelz, oultre
ce que donnay és religieux de Hierusalem estans en prison au Cayre, c’est assavoir deux charges et une
que retins pour moy, y prouffitay jusques à la montance de L seraphs d’or. Au partir de Alexandrie payoit
chascune compaignie XIIII ducatz ; un seul autant que dix mille et dix mille ne payent plus que ung. »
317 Schefer, Ch., Le Voyage d'Outremer : Égypte, Mont Sinay, Palestine de Jean Thenaud, suivi de la
Relation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d'Égypte, 1512, Paris, 1884, p. LXIX.
318 Melons.
319 Finir.
320 Se livre.
321 Communes.
- 214 - 215 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ZACCARIA PAGANI (du 17 au 28 avril 1512)
Schefer, Ch., Le Voyage d'Outremer : Égypte, Mont Sinay, Palestine de Jean Thenaud, suivi de la Relation
de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d'Égypte, 1512, Paris, 1884.
Zaccaria Pagani appartient à une noble famille de Bellune (Vénétie). Il quitte sa ville natale pour Venise où il
s’attache à Andrea de Franceschi, secrétaire ducal de cette ville, qui utilise ses services dans les différentes
missions dont il est chargé par le sénat. En 1512, il fait partie de l’ambassade de Domenico Trevisan,
chevalier et procureur.322
p. 171-177 :
« Nous passâmes la nuit à bord, et le samedi 17, à une heure de jour, deux grandes embarcations de
navires qui étaient dans le port vinrent chercher l’ambassadeur. Elles étaient ornées et disposées en façon
de palischermes, avec des dorures et couvertes de velours et de drap écarlate. L’ambassadeur avait des
motifs sérieux pour ne point permettre aux galères de dépasser le Pharillon.
Les embarcations prirent donc l’ambassadeur et le conduisirent à terre. Il se rendit à cheval à la marine où il
rencontra l’amiral et le diodar suivis d’une multitude infinie de cavaliers et de piétons. L’ambassadeur trouva
sept chevaux que l’on avait amenés ; il monta sur l’un d’eux : six personnes de sa suite en firent autant, et
on se mit en marche deux par deux. L’amiral tenait la droite de l’ambassadeur ; on entra ainsi dans la ville.
Les rues étaient remplies de monde ; à une portée d’arbalète des fondouqs des Vénitiens, les maisons
étaient tapissées de drap écarlate. A l’entrée de la deuxième porte, là où les maisons commençaient à être
tendues, on lisait une inscription portant ces mots : Hæc dies quam fecit Dominus, exultemus et lætemur in
ea ; benedictus qui venit in nomine Domini, et on voyait les armoiries de Sa Magnificence. La porte du petit
fondouq était couverte de velours cramoisi et d’étoffes de soie. On y avait placé les armes de l’ambassadeur
et l’inscription suivante : Cogitantes in nos mala fiant sicut pulvis ante faciem venti, etc.
L’ambassadeur et sa suite se rendirent à cheval à la résidence de l’amiral : arrivés là, celui-ci se sépara de
l’ambassadeur et entra à cheval dans son palais. On fit mettre pied à terre en dehors à l’ambassadeur et à
sa suite et on les fit attendre pendant quelques instants. Nous fûmes ensuite introduits dans une grande
cour à ciel ouvert. L’amiral attendant l’ambassadeur était assis dans une petite galerie sur un tapis étendue
sur une estrade, haute de deux pieds, que l’on appelle en ce pays-ci mastabé. On avait disposé en dehors
de la galerie une autre mastabé pour l’ambassadeur.
Quand celui-ci fut arrivé près de l’amiral, on lui fit prendre place avant qu’il ne parlât : il s’assit donc et
présenta alors, de la part du doge, une lettre de créance qui fut ouverte par l’amiral, lue par notre secrétaire,
et interprétée par le drogman. On échangea de part et d’autre des paroles extrêmement amicales.
L’ambassadeur prit ensuite congé et se rendit, accompagné d’une suite très nombreuse, à la demeure qui lui
avait été assignée. C’était une des plus belles maisons de la ville. Celui qui l’avait fait construire avait dû
dépenser, au jugement de bien des gens, chose incroyable ! plus de soixante-dix mille ducats. Le sol était
couvert de mosaïques de marbre, de porphyre et d’autres pierres de prix. Les portes, incrustées d’ébéne et
d’ivoire, valaient chacune un puits rempli d’or, et il y en avait plus de soixante dans cette maison.
La construction différait complètement de ce que l’on voit chez nous. Il n’y avait point de dorures à l’intérieur,
mais seulement des sculptutes et des peintures en bleu d’outre mer.
J’exposai l’état présent d’Alexandrie. Cette ville fut bâtie par Alexandre le Grand. Elle a plus d’étendue que
Trévise et elle est beaucoup plus longue que large ; les neuf dixièmes sont en ruines. Jamais on ne vit
pareille décadence ; la dévastation de Candie n’approche pas celle-ci. Un pareil anéantissement a pour
cause les violences et les exactions des souverains qui tyrannisent et dépouillent leurs sujets au point de les
forcer à abandonner leur patrie et leurs foyers : les maisons perdent leurs habitants et, au bout de peu de
temps, elles s’écroulent.
Une grande partie de la ville est construite sur des souterrains ; on voit deux buttes appelées vulgairement
« montagnes des Décombres. » La prison dans laquelle fut enfermée sainte Catherine existe encore ; j’ai
voulu y entrer par dévotion. Tout près se dressent deux grandes colonnes sur lesquelles fut placée la roue,
instrument du martyre de la sainte. On voit aussi au milieu d’une rue, nommée rue de Saint-Marc, une pierre
semblable à une meule sur laquelle cet évangéliste a eu la tête tranchée.
On remarque encore deux obélisques comme ceux de Saint-Pierre à Rome : l’un est debout et l’autre
renversé à terre.
Les chrétiens possèdent trois églises à Alexandrie. L’une, sous le vocable de Saint-Saba, est desservie par
deux frères de l’ordre de Saint-Dominique ; les deux autres, celles de Saint-Marc et de Saint-Michel, sont
gouvernées par des moines chrétiens de la Ceinture. En dehors des murs, on voit une grande colonne où fut
décapitée Pompée qui se réfugia en Égypte après s’être enfui de Rome.
Les bazars que nous appelons chez nous botteghe di merci sont fort nombreux. Alexandrie possède deux
ports, le meilleur est appelé le Port-Vieux ; l’entrée en est interdite aux navires chrétiens ; l’autre est le
Port-Neuf. Le passage est défendu par le Pharillon, château muni d’artillerie qui ne permet pas de sortir aux
bâtimens qui n’ont point obtenu l’autorisation du soudan. L’entrée a plus de largeur qu’une portée d’arbalète.
La ville n’a point de faubourg ; en dehors des murs, il y a quelques petits bois où l’on recueille les câpres
connues sous le nom de câpres d’Alexandrie.
A la distance de quinze milles de la ville, se trouve un souterrain dans lequel, chaque année, au moment de
la crue du Nil qui jamais ne fait défaut et commence environ dans les premiers jours de juin, se déverse l’eau
de ce fleuve. Elle est amenée dans la ville par des conduits placés au-dessus du sol et distribuées dans tous
les quartiers. On se sert pendant toute l’année de cette eau que l’on prend aux conduits pour la mettre dans
des puits. Sans l’inondation du Nil, il serait impossible de vivre dans ce pays, parce qu’il n’y pleut que
rarement.
Le lendemain de notre arrivée, l’amiral envoya en cadeau à l’ambassadeur dix moutons, trois corbeilles de
pains, un panier de citrons, trois paniers de raves et trois paniers de pois frais ; en outre, deux porcs, deux
corbeilles d’oranges, quatre corbeilles de radis et dix couples de poulets. Le porteur de ce présent reçut
quatre ducats à titre de gratification.
Après le dîner, l’ambassadeur envoya à l’amiral un présent dont le détail est consigné ci-après ; il fut porté
par des personnes de la suite de l’ambassadeur, à l’exception des fromages dont les matelots furent
chargés.
Drap d’or à fleurs pour une robe, onze aunes et demie ;
Drap d’or uni, onze aunes ;
Satin orange, deux coupons, vingt-trois aunes ;
Satin couleur d’argent, onze aunes ;
Ecarlate pour vêtement, trois coupons, quinze aunes ;
Drap violet, deux coupons, quinze aunes ;
Six fromages de Plaisance, pesant chacun quarante livres.
Notre drogman présenta ce cadeau à l’amiral et reçut une gratification de vingt ducats.
Le 19, l’ambassadeur se rendit chez l’amiral pour y recevoir une lettre du grand soudan, à lui adressée.
Cette lettre, dont le contenu est inséré dans cette relation, était enfermée dans une enveloppe semblable à
celles dans lesquelles on met chez nous les papiers notariés ou les actes constitutifs d’une dot. Les lignes
étaient séparées l’une de l’autre par la largeur de quatre doigts et la lettre était fermée avec de la colle. Le
grand diodar en donna lecture et notre drogman en fit la traduction. On fit tenir l’ambassadeur debout pour
témoigner le respect dû à une missive du souverain ; l’amiral la remit ensuite à l’ambassadeur qui la porta à
ses lèvres et à son front, selon l’usage du pays. L’ambassadeur s’approcha alors de l’amiral, lui prit la main,
la baisa et prit congé pour s’en retourner.
D’après le conseil de l’amiral, nous séjournâmes à Alexandrie jusqu’au 28 avril à cause de certains Arabes
nomades, et du bruit répandu que le Soudan devait venir dans cette ville. Ces deux motifs nous
déterminèrent à retarder notre départ.
Nous nous mîmes en route le 28 avril, après nous être procuré vingt chameaux et avoir envoyé par mer, à la
bouche de Rosette, une germe chargée de nos bagages et du vin destiné à notre consommation. »
322 Schefer, Ch., Le Voyage d'Outremer : Égypte, Mont Sinay, Palestine de Jean Thenaud, suivi de la
Relation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d'Égypte, 1512, Paris, 1884, p. LXXVIII.
- 216 - 217 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
DIEGO DE MÉRIDA (1512)
Mérida, D. de, « Viaje a Oriente », Analecta Sacra Terraconensis 18, 1945, p. 115-187.
Diego de Mérida est un moine hiéronymite de Guadalupe (province de Càceres, au sud-ouest de Madrid).
p. 179-181 :
« Chapitre XLIX. Comment je suis arrivé à Alexandrie. Des choses merveilleuses de cette ville qui fut
merveilleuse dans un autre temps.
Les frères franciscains et moi sommes arrivés à Alexandrie pour confesser les chrétiens latins et pour leur
communiquer les sacrements, parce que les chrétiens autochtones, qui sont plus de cinq cents habitants,
ont leurs curés et leurs clergés. Parmi les Latins beaucoup sont aussi bien marchands que d’autres sont
hommes de la mer. Il y a aussi deux frères franciscains, moi et un dominicain, qui fîmes tous les offices de
l’Église à partir du jour des Rameaux jusqu’au jour de Corpus Christi et jusqu’à la fête de saint Pierre et saint
Paul. Le frère dominicain et moi ne fûmes pas prisonniers comme le furent les franciscains, sauf que nous
attendions le passage parce qu’aucune nave n’entrait ni ne sortait d’Alexandrie. Ensuite, quelques naves ont
eu l’autorisation de partir ; de là, nous allâmes, le frère dominicain et moi, à Rhodes. Je ne veux pas
manquer de dire ce que j’ai vu à Alexandrie. Auparavant, ce fut une ville merveilleuse qui fut fondée par
Alexandre le Grand. Ici, se trouvait son sarcophage en métal. À l’extérieur, se trouve une colonne de
Pompée et à l’intérieur de la ville, il y a deux aiguilles comme celles de Rome.
Le mur et la barbacane sont aussi entiers et blancs que le jour où ils furent construits, ils ne leur manquent
pas un créneau. À l’intérieur de la ville, il y a deux collines. Les portes de la ville sont toujours fermées. Je
n’ai vu nulle part ailleurs de telles portes si fortes ; les tours, les murs et les portes, qui sont fermées, sont si
grandes et si hautes que c’est une chose merveilleuse. Il y a cinquante-sept alcaydes323, …
Il y a une rue qui est la plus longue de toutes et qui mesure trois milles d’une porte à l’autre. Comme je l’ai
mentionné, toutes les portes sont fermées, surtout depuis que le Roi de Castille a conquis la Barbarie, il n’y
a que deux portes qui sont ouvertes ; l’une est celle qui va au Caire et l’autre qui va aux douanes.
À partir du moment où les Latins entrent à l’intérieur, nous ne pouvons plus jamais sortir hors de la ville sauf
jusqu’à la mer. Il y a beaucoup de gardes (p. 180) et de contrôle aux portes qui font peur. Ils fouillent tous
ceux qui viennent du Caire et qui entrent à Alexandrie, qu’il soit Maure, Chrétien ou Juif, et les font se dévêtir
(parlant avec pudeur) jusqu’à être seulement avec leurs vêtements inférieurs. Ce que j’ai vu par expérience,
pour voir et savoir quelles sont les choses que l’on ramène du Caire et si elles appartiennent à l’Amarillo ou
à des Mamelouks. Ils vérifient s’ils échangent des lettres avec Rhodes, la France ou l’Espagne. Tout ce
qu’ils trouvent est apporté auprès du maître d’Alexandrie, Mamelouk de la Charqiah ayant le droit de porter
une corne dans sa parure, qui vérifie s’il n’y a pas des choses suspectes.
J’ai vu de nombreuses fois à Alexandrie, presque chaque jour, la prison de sainte Catherine et deux grandes
colonnes sur lesquelles étaient les roues. Pour voir la prison qui est sous scellé, on paie un maidin qui est la
moitié d’un réal. J’ai vu aussi la grande rue que j’ai citée dans laquelle fut conduit saint Marc pour le
martyriser et j’ai vu la pierre sur laquelle ils lui coupèrent la tête selon la tradition.
À Alexandrie, il n’y a pas plus de quatre églises. L’une est celle des Latins et des Grecs et les autres sont
celles des chrétiens autochtones. Parmi des trois églises, une fut la première à Alexandrie ; dans celle-ci fut
enterré à l’origine le corps de saint Marc qui fut par la suite enlevé et transporté à Venise pour être patron
des Vénitiens et pour avoir de nombreux royaumes et de seigneuries. Un Juif de Cafra, près de Merida, a dit
qu’il mourut ainsi :
Je jure sur Dieu que saint Marc est mon parent. Il a progressé après avoir été Juif puis cordonnier. Ah ! Si
mes peines étaient comme les siennes. Je jure sur Dieu que je ne ferai plus de chaussures ni de bottes !
Chapitre L. Alexandrie est une chose très puissante qui paraît avoir été un village de C MIL foyers et qui
aujourd’hui n’aurait pas plus de VIII MIL foyers :
Quand le roi d’Espagne fit la grande armada, les Maures eurent peur et cinq cents Mamelouks vinrent à
Alexandrie en plus de ceux qui y étaient pour la préserver. Tous les chrétiens latins, mais pas les chrétiens
autochtones, étaient enfermés chaque nuit dans trois maisons qui s’appellent hondigos ou alhondigos. J’ai
vu ici une vente aux enchères des armes qui se sont perdues dans la guerre de Berberia. J’ai vu un
basilic324 qui est un type de polucra spécial parce que les gens parmi les Maures qui viennent de Berberia
sont très nombreux. C’est une chose frappante que ces nombreux Grenadins qui ont de la famille chrétienne
en Espagne, ils viennent voir (p. 181) les Espagnols et nous embrassent avec beaucoup d’amour et nous
invitent presque de force chez eux pour se détendre, il en est de même pour les gens d’Oran.
La ville d’Alexandrie est très ordonnée dans les maisons, ceci montre qu’elle fut auparavant une grande ville
de C MIL foyers d’après ce qu’il y reste en ruine. Aujourd’hui il n’y a pas plus de VIII MIL foyers. Il faut savoir
qu’Alexandrie est un port, une Échelle et la Porte de l’Égypte. Si elle est prise, c’est la perte de l’Égypte. Elle
a deux grands ports profonds. Par un port, entrent les naves des Chrétiens et des Turcs, et par l’autre port,
entrent les naves des Maures. Il est facile d’entrer dans ces deux ports, mais vous ne pouvez pas sortir sans
autorisation parce que deux châteaux se trouvent de part et d’autre avec des grands canons.
Alexandrie est très puissante et il est difficile de la conquérir. Mais il est encore plus difficile de la ravitailler.
La raison en est qu’Alexandrie n’a pas d’autre eau à boire que celle du Nil qui vient par des conduites d’eau
sous terre sur plus de cent milles. Quand les Maures le voudraient, ils pourraient couper le ravitaillement en
eau de la ville et ils ne leur resteraient que les citernes pleines d’eau. Mais au moment où leur eau sera
épuisée, il faudra commencer à prier parce que si on creuse un puits de C MIL stades de profondeur, l’eau
aura le goût du sel à cause de la mer qui est très profonde. Alexandrie est sur le sable.
Il y a beaucoup d’épices et beaucoup de cana fistola qui poussent là-bas. Pour un ducat, on achète autant
que l’on peut en emporter sur soi-même. Si j’avais un messager à disposition, il est certain que je pourrais
vous envoyer un grand coffre de ces produits. Mais Dieu est témoin que ce que j’envoie maintenant, je
l’envoie à perte. Il est certain que le marchand du caliz qui le transporte est un homme particulier et très
honnête ; il s’appelle Marco Salvado (d’autres l’appellent Salvador) ; il m’a promis de l’envoyer à Séville
parce que là, il peut arriver jusqu’à Guadalupe. Plaise à Dieu qu’il en soit ainsi ! »325
323 Chefs de gardes de forteresse.
324 Arme.
325 Traduction : J. C. Moreno Garcia, O. Sennoune.
Tardivement, nous avons eu connaissance de l’édition de ce récit de voyage : Dams, T., « Le voyage en
Orient de Diego de Mérida (1507-1512) », Mélanges de science religieuse 46/3, 1989, p. 131-157 ; 47/3,
1990, p. 134-156. La partie concernant Alexandrie se trouve dans le numéro 47/3 entre les pages 147 et
150.
- 218 - 219 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-WAZZĀN (JEAN LEON L'AFRICAIN) (1517)
ḤASAN B. MUḤAMMAD AL-WAZZĀN AL-FĀSĪ
Al-Wazzān, Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, par A. Épaulard, Paris, 1956.
Léon l’Africain naît à Grenade entre 1489 et 1495 dans une famille qui émigre après la prise de Grenade par
les Rois Catholiques en 1492. Il est élevé à Fès où il reçoit une bonne instruction, puis entre de bonne heure
au service du gouvernement. Il accompagne à Tombouctou un de ses oncles envoyé comme ambassadeur
et parcourt le Maroc pour accomplir diverses missions diplomatiques. En 1515, il effectue une dernière
mission qui le conduit en Orient par Alger, Tunis et la Tripolitaine. On sait qu’il se trouve en Égypte en 1517
avant d’accomplir le pèlerinage à La Mecque. De retour, en passant par Tripoli et Tunis, il est capturé en mer
par des Siciliens qui l’emmènent à Naples en 1520 et de là à Rome où il se convertit au christianisme. Le
pape Léon X lui donne son propre nom de baptême : Johannes Leo.
Léon l’Africain achève la rédaction de son manuscrit Descrittione dell’Africa en 1526.326
p. 495-498 (tome II) :
« La grande ville d’Alexandrie fut, comme on le sait, fondée par Alexandre le Grand qui la construisit sur des
plans de célèbres et habiles architectes dans un beau site, sur une pointe s’avançant dans la mer
Méditerranée, à 40 milles, à l’ouest du Nil. Ce fut, sans aucun doute, par l’importance et la beauté de ses
palais et de ses maisons, une ville plus noble que toute autre. Elle conserva cette renommée bien
longtemps, jusqu’à ce qu’elle tombât aux mains des Mahométans.
Depuis, au cours des années, elle diminua d’importance et perdit son ancienne noblesse parce qu’elle n’y
eut plus un marchand de Grèce ou d’Europe qui put y faire du commerce, si bien qu’elle devint
presqu’inhabitée. Mais un astucieux pontife mahométan prétendit, par un habile mensonge, que Mahomet,
dans une prophétie, avait accordé de multiples indulgences à la population d’Alexandrie, à ceux qui y
viendraient un jour assurer la garde de la ville et à ceux qui y feraient des aumônes. Au bout de peu de
temps, il la remplit ainsi d’habitants, de gens étrangers au pays et de personnes de toute sorte venues pour
ces indulgences. Tout ce monde aménagea des logements dans les tours du mur d’enceinte, construisit
plusieurs collèges pour les étudiants ès-lettres et aussi plusieurs monastères pour les religieux venus par
dévotion.
La ville est de forme carrée, avec quatre portes, l'une à l'Est, du côté du Nil, l'autre au Sud, vers le lac dit
Buchaira, la troisième à l'Ouest du côté du désert de Barca, la quatrième vers la marine où se trouve le port.
C’est à la porte de la Marine que se tiennent les gardes et les commis de la douane, lesquels fouillent les
gens jusque dans leurs culottes, parce qu’à la douane de cette ville les dinars eux-mêmes paient un tant
pour cent comme si c’était des marchandises. Il existe en outre près des murs deux portes réunies entre
elles par une avenue et une très forte citadelle placée à l'entrée du port appelé Marsa el Borgi, c'est-à-dire le
port de la tour, dans lequel mouillent les plus beaux navires et ceux qui ont le plus d'importance, tels que les
vaisseaux vénitiens, génois et ragusains, ainsi que d’autres bateaux européens. On voit venir d’habitude à
Alexandrie jusqu’à des navires de Flandres, d’Angleterre, de Biscaye, de Portugal et de toutes les côtes
d’Europe ; mais les plus nombreux sont les bateaux italiens, surtout ceux des Pouilles et de Sicile, et aussi
ceux de Grèce, c’est-à-dire turcs, qui arrivent ensemble dans ce port pour s’y mettre à l’abri des corsaires et
de la tempête. Il y a un autre port appelé Marsa es Silsela, ce qui signifie le port de la chaîne, où mouillent
les navires qui viennent de Berbérie, de Gerbo et d’autres lieux. À l’intérieur de la ville il y a une très haute
colline qui ressemble à celle du Testaccio de Rome, dans laquelle on trouve de nombreux vases antiques et,
à la vérité, c'est un monticule artificiel. Sur cette hauteur se trouve une petite tour où se tient constamment
un guetteur qui surveille les navires qui passent. Pour chaque navire qu'il signale aux fonctionnaires, il
touche une certaine prime ; s'il s'endort ou va se promener et qu'il arrive quelque bateau qu'il n'ait pas
signalé aux employés de la douane, ce guetteur est condamné à une amende du double de sa prime,
amende qui est versée à la caisse du soudan.
Presque toutes les maisons d’Alexandrie sont bâties sur des citernes à voûtes soutenues par des colonnes
et des arcs. L’eau du Nil arrive jusque dans ces citernes. En effet, lors de la crue, l’eau vient par un canal
artificiel creusé dans la plaine, du Nil jusqu’à Alexandrie où elle entre en passant sous le mur de la ville, pour
se jeter, comme nous venons de le dire, dans les citernes.
En ce qui concerne ses ressources, Alexandrie est située au milieu d’un désert de sable, si bien qu’elle ne
possède ni terrains de cultures, ni vignes, ni vergers. Le blé y est apporté de 40 milles de là. Il est vrai que
près du canal qui amène l’eau du Nil il existe quelques petits jardins potagers mais leurs produits sont plutôt
pernicieux, car à l’époque où on les consomme, les gens sont pour la plupart atteints de fièvre ou d’autres
maladies. À six milles environ de la ville, vers l’ouest, on trouve de très antiques édifices parmi lesquels une
colonne très grosse et très haute qui porte en arabe le nom d’Hemadussaoari, c’est-à-dire colonnes des
mâts. On trouve en effet écrit dans les ouvrages qui traitent des choses admirables du monde qu’au temps
d’Alexandre un philosophe nommé Ptolémée l’érigea pour assurer la sécurité de la ville vis-à-vis de
l’ennemi. Il fit placer au sommet de cette colonne un grand miroir d’acier, de sorte que tout bateau qui
passait à côté de ce miroir prenait feu immédiatement si l’on découvrait le miroir. Mais le miroir fut abîmé à
l’époque où les Mahométans entrèrent en Afrique et la légende rapporte qu’il fut détérioré par un Juif qui le
frotta à l’ail.
Il existe encore à Alexandrie, parmi ses anciens bâtiments, beaucoup de ces chrétiens que l’on nomme
Jacobites. Ils ont une église à eux, laquelle, bien des fois reconstruite, persiste de nos jours, où fut jadis
enseveli le corps de saint Marc L’Évangéliste qui fut traîtreusement enlevé en 829 par des marchands
vénitiens et transporté à Venise. Tous ces Jacobites sont marchands et artisans et paient le tribut au
souverain du Caire.
Il ne faut pas omettre de mentionner qu'au centre de la ville, au milieu des ruines, il y a une maisonnette
basse, comme une sorte de chapelle, dans laquelle se trouve une tombe très vénérée par les Mahométans,
où l'on entretient des lumières nuit et jour. On dit que c'est le tombeau d'Alexandre le Grand, qui fut prophète
et roi d'après Mahomet dans le Coran327. Beaucoup d'étrangers viennent de lointains pays pour voir ce
tombeau et y faire leurs dévotions. Ils y laissent des aumônes très considérables.
Je m’abstiens de parler de beaucoup d’autres choses notables afin de ne pas grossir cet ouvrage qui
deviendrait ennuyeux et fastidieux pour le lecteur. »
326 Al-Wazzān, Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, par A. Épaulard, Paris, 1956, p. VII-IX.
327 Divers commentateurs voient dans le personnage nommé Ḏū al-Qarnayn – mentionné dans le Coran
(sourate XVIII, 82, 93) – Alexandre le Grand.
- 220 - 221 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PĪRĪ RE’ĪS (1517)
B. ḤAǦǦĪ MEḤMED
Mantran, R., « La description des côtes de l’Égypte dans le Kitāb-i bahriye de Pīrī Reis », AnIsl 17, 1981,
p. 287-310.
Marin et cartographe turc, Pīrī Re’īs naît probablement à Gallipoli vers 1465. C’est auprès de son oncle,
Kāmal Re’īs, que Pīrī Re’īs apprend le métier de marin. Pendant les expéditions, il acquiert une excellente
connaissance de l’art de la navigation et de la Méditerranée. En 1495, le sultan somme Kāmal Re’īs de
servir dans la marine ottomane. Pīrī Re’īs participe aux côtés de son oncle à plusieurs missions maritimes
jusqu’à la mort de ce dernier en 1510 ou 1511. À partir de cette date, Pīrī Re’īs passe la plupart de son
temps à Gallipoli pour réaliser des cartes marines. En 1513, il produit sa première oeuvre qui représente une
carte du monde dont une partie seulement est conservée. On y observe l’Atlantique avec les parties
adjacentes de l’Europe et de l’Afrique et le nouveau monde. Pīrī Re’īs affirme qu’il s’est servi de sources
orientales et occidentales (cartes portugaises et de Christophe Colomb) pour la réaliser. Quelques années
plus tard, en 1521, il achève un livre sur la navigation, Kitāb-i bahriye, qu’il remanie en 1526. Cette oeuvre,
dont la partie sur Alexandrie est présentée ci-dessous, propose à la fois des cartes et un texte. En 1547, il
est nommé amiral de la flotte de l’Égypte et de l’Inde. Après une défaite dans le golfe persique, il est
condamné à mort en 1553-1554 au Caire.328
p. 295-298 :
« Dans les chroniques, il apparaît qu’Alexandrie est une ville qui a été construite dans les temps anciens. On
dit qu’Alexandre aux deux cornes ayant trouvé cette ville en ruines la fit construire. Après l’époque du Saint
Prophète - sur Lui le Salut ! - quelques-uns de ses compagnons vinrent vivre dans cette ville ; c’est pourquoi
elle est un foyer de saints personnages. Plus particulièrement, elle est la clé de la mer du monde arabe ; la
totalité de son rempart de tours mesure huit milles ; mais l’intérieur de ce rempart est maintenant en ruine ;
presque en bordure de mer, ainsi que près de la porte de Rosette, il y avait encore quelques éléments en
place ; le reste était détruit et en ruine ; cependant on a reconstruit le rempart de tours et les ruines sont
maintenant peu nombreuses. Devant cette forteresse, il y a deux ports. Par la terre, la distance entre ces
deux ports est d’un mille, mais par mer, de l’entrée d’un port à l’entrée de l’autre, il y a cinq milles. Le port
situé à l’ouest est appelé Porto Vâkî, ce qui veut dire Ancien Port ; mais les Arabes le nomment Port de
l’Ouest (Garb Limani).
Il y a aussi un port devant la partie Est de la ville ; la majorité des navires relâchent dans ce port situé à l’est,
mais ce n’est pas un très bon port et les navires qui y stationnent doivent veiller à l’arrimage de l’ancre car il
y a des sables mouvants, et c’est dangereux. En outre ce port est rempli de vers rongeurs qui attaquent le
bois du navire. Bref, ce n’est pas un port tranquille. Cependant c’est une échelle, et l’on y vient pour faire du
commerce.
À l’intérieur du port il y a deux rochers qui n’apparaissent pas à la surface de l’eau, il faut faire attention. On
arrive à jeter l’ancre et éviter l’un des rochers en le contournant par le sud-ouest, vers une grande tour ;
l’autre, non loin de la mer libre, se trouve à côté des brisants qui sont devant la ville. On entre dans le port
par le milieu de ses brisants signalés avec ce rocher. À deux milles de la ville, au nord-nord-ouest, il y a un
cap qui ressemble à une île. Au-dessus de ce cap se dresse une belle forteresse avec rempart et tour ; de
nombreux canons veillent sur le port ; les navires étrangers ne s’y arrêtent pas. Devant cette forteresse il y a
un petit îlot appelé Maymûna.
Entre cet îlot et la forteresse, les caïques passent, mais non les gros navires, car il y a des hauts-fonds. On
dit que dans les temps passés, sur cet îlot, il y avait un miroir et que les navires venant de la mer se voyaient
dans ce miroir. En mer, à l’est-nord-est de Maymûna, il y a un haut-fond avec quatre brasses d’eau.
Si, venant de la mer on désire connaître le repère d’Alexandrie, on aperçoit d’abord une éminence en forme
de tente – que l’on appelle la Colline du Lac ; en avançant davantage, on voit une autre éminence ;
au-dessus de la hauteur en forme de tente se dresse une tour ; au temps des Çīndī329, on surveillait depuis
cette tour les navires venant du large ; autant l’on apercevait de navires, autant on élevait de pavillons ; ainsi
la population de la ville et celle de la tour du port, savaient combien de navires arrivaient du large. Ensuite
lorsque ces navires entraient au port, depuis la tour on tirait le canon en guise de bienvenue, puis on
percevait une pièce d’or du navire parce qu’on avait tiré le canon.
Maintenant la tour qui est sur cette éminence est en ruines. Le dessus de la colline qui est à l’est est tout
plat, et sur cette colline on a construit un moulin à vent.
Après avoir vu ces deux collines, on se rapproche un peu de la côte et l’on distingue complètement le port et
le fort ; il y a aussi un repère qui consiste en ce que, en cet endroit, la mer n’est pas trouble ; au contraire,
l’eau est claire.
Si, à dix milles au large du fort d’Alexandrie, c’est-à-dire au nord, on jette la sonde, on trouve du sable mou ;
certains croient que la sonde n’a pas trouvé le fond et ne s’en préoccupent pas. À trente milles au large, il y
a du sable mêlé à du corail. La côte en face de l’ancienne Alexandrie est de sable fin et chaud.
Ensuite, hors de l’entrée du port d’Alexandrie sur trois milles en mer, il y a des écueils. À sept ou huit milles
au large se trouve un bon lieu d’ancrage.
Depuis la forteresse de l’actuelle Alexandrie jusqu’à Aboukir, il y a trente milles. Les côtes sont constituées
par des hauts-fonds, les lieux ne sont pas bons et les navires ne peuvent stationner. Cependant il existe un
petit port naturel où il est possible aux caïques et aux germes de s’arrêter. On donne le nom de Kürük
Hudâd à ce petit port qui se situe entre un rocher semblable à une île et le rivage. On y entre par l’est. Au
large de ce petit port, près d’Aboukir, il y a un rocher que l’on voit à la surface de l’eau : on l’appelle le
Rocher d’Ibn Asli ; les navires peuvent passer entre lui et la côte, c’est encore profond ; les gens d’Aboukir
l’appellent aussi Ukthaynî. Près de ce rocher et d’Aboukir, il y a deux écueils, visibles ; les marins peuvent
passer entre ces écueils et la côte, c’est assez profond. Que cela soit ainsi connu. C’est tout. »
328 Soucek, S., « Pīrī Re’īs », EI2 VIII, Leyde, 1995, p. 317-319.
329 Mamelouks. Note de J.-L. Bacqué-Grammont.
- 222 - 223 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO TENREIRO (1523-1524)
Tenreiro, A., Itinerario de Antonio Tenrreyo que da India veo por terra a este Reyno de Portugue, Cimbra,
1565.
Antonio Tenreiro voyage avec l’ambassade portugaise de Balthasar Pessoa à la cour Safavide de Tabriz
envoyée par le roi et gouverneur Lopo Vaz de Sampaio.330
Folio 79 et 81
« De la ville d’Alexandrie en Égypte
Alexandrie est une grande ville située du côté du ponant éloignée de la mer Méditerranée d’un tir d’une
baliste. Elle est entourée de désert près de la baie de la mer. Elle est encerclée de murs de pierres et
d’édifices très anciens en de pierres de jaspe à certains endroits. Cette ville est dotée de nombreuses rues
belles, droites et larges, ainsi que de petites maisonnettes de pierres et de chaux. Il y a d’autres
constructions sous le sol de la même taille que les petites maisonnettes situées au-dessus. Ces
constructions semblent très anciennes et bien édifiées. Les habitants, chrétiens et Maures qui ne
représentent pas le dixième car ils sont sujets aux maladies. S’il n’y avait pas ce bon port, il me semble
qu’elle ne serait pas habitée car il n’y a pas d’eau potable à boire sinon l’eau qui vient du Nil lors de la crue
et qui remplit les canaux qui alimentent toutes les citernes qui sont innombrables. Les personnes qui y vivent
ne boivent que l’eau qui date de deux ou trois ans car on dit que les eaux nouvelles du fleuve rendent
malades et font mourir les gens car (le fleuve) est mal habité. Quand j’arrivai là, j’eus la fièvre. Il semble qu’il
y avait de beau vestige autour. Mais déjà en ce temps, ce que je vis était presque détruit et désert. Il y vient
de nombreux vaisseaux et navires de toute part de l’Europe qui ont leurs sièges dans cette ville qu’ils
appellent consulats. Ici, il y a le gouverneur avec quelques cavaliers pour le grand Turc. Il y a une forteresse
qui est édifiée dans cette mer dans une baie qui entoure le port du côté du ponant. Il y a un capitaine de
lancier et quelques canons qui y sont en continu. Quand j’arrivai en ces lieux, je ne pus trouver
d’embarcation prête pour partir en Europe parce qu’elles étaient toutes occupées à vendre leurs
marchandises. En ce temps-là, il y avait aussi une armada de Barra violette dans laquelle je vis de
nombreux chrétiens ferrés, mal traités par les Turcs, qui viennent en gage avec les marchandises de la ville
mentionnée comme rançon. Quand je les vis ainsi maltraités et prisonniers, j’éprouvai de la peine. Ayant le
désir de partir de cette ville, je m’embarquai sur une petite nave, qui partait rapidement pour aller sur l’île de
Chypre. (Cette nave) appartenait à un Grec qui avait dans ce port des affaires en suspens avec les Turcs,
qui avaient ici un galion ; ils voulaient s’en emparer dans la mer pour se venger. Nous embarquâmes le plus
secrètement que nous pûmes. Nous (folio 81) levâmes l’ancre pour faire le voyage, mais vinrent vers nous
trois ou quatre barques turques armées que le Grec très courageux voulut attendre ; ayant confiance au bon
vent qu’on avait, il laissa entrer dans la nave une des barques. (Le Grec) avait de bonnes paroles mais eux,
orgueilleux, en rajoutèrent, et, vinrent à l’intérieur. Mais nous les mirent dehors très fâchés. Je me vis en
grand danger duquel Dieu m’en libéra. De la balustrade, nous vîmes les luttes, ils tirèrent et prévinrent les
barques pour nous attaquer.
Grâce au bon vent, nous disparument victorieusement. En navigant par la dite mer en cinq jours et cinq
nuits, nous arrivâmes à l’île de Chypre, au port nommé Alamizo. »331
330 Tenreiro, A., Itinerario de Antonio Tenrreyo que da India veo por terra a este Reyno de Portugue, Cimbra,
1565, p. 3, 20-21, 33.
331 Traduction : A. S. Fonseca, I. Halflants, A. Sennoune.
- 224 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
NOÉ BIANCO (1527)
Bianco, N., Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro et al Monte Sinai co’l dissegno delle città, castelli, ville,
chiese, monasteri, isole, porti,, & fiumi... composto dal R. P. F. Noé dell’ordine di S. Francesco, Venise,
1619.
Comme il a été spécifié plus haut, ce pèlerin reproduit la description que le voyageur Niccolo de Poggibonsi
écrivit lors de son pèlerinage en 1349.
Non paginé :
« Je vous parlerai de la ville d’Alexandrie et de son emplacement. Alexandrie est une ville majestueuse,
entourée de murailles. À l’intérieur de la ville se trouvent de belles maisons et des palais, cette ville est
située au bord de la mer et elle est munie d’un beau port.
Ce fleuve appelé Nison passe au milieu de la ville et prend sa source au paradis terrestre.
Dans cette ville, il y a un grand nombre de marchands et d’autres personnes. Cette ville est à trois cents
milles de Babylone où réside le sultan.
De la pierre où fut coupée la tête de saint-Jean-Baptiste
À Alexandrie il y a l’église de Saint-Jean-Baptiste ; dans cette église se trouve la pierre sur laquelle fut
coupée sa sainte tête. Cette pierre fut transportée de la ville de Sébaste de Samarie et placée dans cette
église de Saint-Jean. Le fait qu’aucun Sarrasin ne puisse s’asseoir sur cette pierre car dès qu’il s’assoit, il se
remplit d’ampoules à cause de la vapeur qui se dégage de cette pierre, est un miracle évident.
Du lieu où fut décapitée sainte Catherine Vierge et martyre
Près de cet endroit se trouvent les maisons qui appartenaient à sainte Catherine, où demeure l’émir des
Sarrasins ; continuant le chemin dans la rue principale de la ville, à main gauche il y a deux colonnes de
marbre près d’une grande maison au bord d’une place. Ici fut tranchée la tête de sainte Catherine. À cet
endroit, les chrétiens firent construire une église, mais de nos jours les Sarrasins y demeurent. On dit qu’ici il
y a indulgence plénière.
Dans cette rue déjà citée, il y a l’église où fut décapité le glorieux saint Marc. Cette église est belle et les
Grecs y officient ; on y gagne une indulgence de 7 ans et 70 jours
Vient ensuite l’endroit où se réfugia le bienheureux saint Athanase, par crainte de la persécution de
l’empereur de Constantinople. Là pour affirmer la foi chrétienne, il inscrivit ce symbole qui dit “Tous ceux qui
veulent être sauvés etc.” Cet endroit est à un demi-mille de la ville d’Alexandrie.
Lorsque je quittai la ville d’Alexandrie, j’allai à Babylone et au Caire ; après avoir cherché ces villes et ces
lieux, nous partîmes de cette ville d’Alexandrie pour aller au Caire ; en chemin, à un demi-mille, nous
trouvâmes le port du fleuve Fison ; là nous nous embarquâmes sur un navire syrien et nous fîmes voile vers
le Caire et Babylone. »332
332 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 225 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GREFFIN AFFAGART (du 24 au 28 août 1533)
Affagart, G., Relation de Terre Sainte (1533-1534) par Greffin Affagart, par J. Chavanon, Paris, 1902.
Greffin Affagart, seigneur de Courteilles (Sarthe), riche gentilhomme du Maine, entreprend en 1533, un
pèlerinage en Terre sainte. Lors d’un précédent pèlerinage, il obtient le titre de Chevalier du
Saint-Sépulcre.333
p. 49-55 :
« Alexandrie fut premièrement édifiée par le grand roy Alexandre, et la nomma par son nom. C’est la cité
capitale et patriarchalle de l’Egypte en la partie de l’Asie, soubz la seigneurye du grand Turc depuys que le
père du Turc eut faict mourir le Souldan, et aussi tout le royaulme d’Egypte, de Asie et de Sirie et de toute la
Grèce ; et combien qu’elle soyt la plus noble cité et principalle, si n’esse pas la plus grande car elle fut
destruite, long temps a, pour roy de Cypre nommé Jacques de Lusignan, et oncques puys ne fut totalement
réédifiée. Elle est assez de belle apparence par dehors en murailles et tours et principalement vers le port,
mays par dedans y a de grands ruynes ; la cité est toute creuse par dedans et plaine de cyternes pour
recepvoir l’eaue que l’on faict venir par desoubz terre quant le Nyle croist, et pour ceste cause est mal saine
spéciallement aux estrangiers, et si seroyt facile à prendre qui leur trancheroyt le dict conduyt d’eau, car ilz
n’en pouroient avoir dedans.
Il y a en la cité d'Alexandrie de plusieurs nations de habitants comme Turcs, Mores, Juifs, chréstiens grecs,
chrestiens de la seincture, chrestiens jacobites et chrestiens latins, lesquels ont en la ville quatre fondicques,
c'est-à-dire quatre lieulx determinéz pour habiter et exercer leurs marchandises, auquelz lieux sont
encloux334 comme ung monastère. Les Venissiens en tiennent deux, les Genevoys tiennent la tierce et les
Françoys tiennent la quarte que les Castellans soulloient335 tenir.
Et y a ung consul député du roy de France pour recepvoir les marchans françoys qui là arivent et pour les
adresser à leurs affaires, lequel nous reçeut très humainement en son logeys, et là, nous rafraichismes
quatre ou cinq jours, car nous estions fort fachez et ennuyez de la mer, et principallement le bon seigneur de
la Rivière, lequel estoyt tout mallade ; et en ce temps que nous demeurasmes en Alexandrie visitasmes les
lieulx saincts et autres choses dignes de mémoire.
Premièrement nous visitasmes l’église de Sainct-Marc en laquelle demeurent aucuns chrestiens hérétiques
nommez Jacobites. En ce lieu demouroyt monsieur sainct Marc l’évangéliste estant évesque de Alexandrie.
Nous vismes le lieu où fut ensevely après son glorieux martire, et a demouré son précieulx corps jusques à
tant que les Vénitiens le enlevèrent cauteleusement, et finement le portèrent à Venise.
Il y a en Alexandrie le lieu ou sainct jehan l’aulmousnier, arcevesque, fut martirisé pour la foy de Jésus Crist.
Après nous allasmes à une autre église nommée Saincte Sable, édiffiée au lieu et maison royalle où
demeuroyt saincte Katharine d’avant qu’elle fust martirysée, et là sont aucuns religieulx grecs de l’ordre
sainct Basille que l’on appelle en leur vulgaire Calloires qui vault autant à dire comme bon vieil. En ce lieu
sont ensepveliz les chrestiens latins quant ilz meurent ; c’estoyt le temps passé l’église patriarchalle en
laquelle se monstre encores la chaire où prescheoyt monsieur sainct Pierre, monsieur sainct Jehan
l’évangéliste, sainct Jehan l’aumlosnier, sainct Anastase et Origène, laquelle jamais n’a peu estre destruicte
par les payens pour les miracles et prodiges qui incontinent se monstroient. Ilz en ont voullu faire une
mesquite, mays ceulx qui monstoyent aux tours pour cryer à l’oraison, se gectoient ou tomboient du hault en
bas. Après l’ont voulu parachever et en faire une boucherye, mays en voullant détailler leurs chairs ilz se
couppoient bras ou mains, ou la gorge, ou quelque autre membre ainsi que gens enragéz ou démoniacles.
En ladicte ville se monstre aussi le lieu où la glorieuse martire et espouse de Jésus Crist, saincte Katharine,
fut emprisonnée douze jours sans boire ne manger, et auprès de là sont encores deux grands coullonnes de
pierre où furent mises les roes pour détrencher son prècieulx corps. Aussi se monstre le lieu où elle fut
décapitée, et son âme glorieusement receue par les anges, et son corps miraculeusement porté sur la
montagne de Sinay.
Dedans la ville a ung vieil pallays qu’on dict estre le logeys du grand roy Alexandre auprès duquel est une
grande pierre de coulleur rouge en faczon de piramide tant grosse et haulte qu’il semble à veoirs de loing
que c’estoyt une tour fort anxienne ornée de antiquailles et lettres incongneuses, plus grande et plus grosse
que celle de Romme que l’on appelle l’esguille de Virgille ; toutesfoiz que l’on dict qu’elle y a esté portée de
Alexandrie et estoyt auprès de l’autre le temps passé, mais il est assez difficille à croire que une si grande
pierre comme une tour toute d’une piecze eust esté apportée de mille lieues. Et comme ils ont esté faictx et
dressées je n’en ay rien entendu, mays quoy qu’il en soyt, ilz sont encores en estat à présent l’une à
Romme, et l’autre en Alexandrie, et est l’une des merveilles de ce monde, car il n’y a si subtil entendement
qui ne se donne merveille comme cela a peu estre levé par puissance humaine.
Hors de la cité y a deux autres collonnes de pierre, chascune est d'une piece, haultes et grosses aussi
merveilleuses dont l'un s’appelle pompeyane pour ce que sur icelle le preux et noble Jules César fist mettre
le chef de Pompée que le roi d’Egypte avoyt faict trancher, pensant faire plaisyr à César pour ce que
Pompée et César estoient ennemys, mays quant il veyt la teste de son ennemy, par pityé compassion se
commencza à pleurer et ne voullut pas prendre vengeance de son ennemy après sa mort, mays envers luy
exercer toute humanité, car bien honorablement y le feist enchasser et mettre sur ceste prédicte coulonne.
Sur l’autre, le roy Ptolomée fist mettre le corps du grand roy Alexandre en ung vaisseau d'or, mays ung
tirant, roy de Ethiopie, après qu'il eut prins et dégasté le pays d'Egipte, viola ledict sepulchre et emporta l'or
et mist le corps en ung sepulchre de voyre336, mays bien tost après, par la justice divine comme sacrileige fut
griefvement pugny.
Tout entour de ladicte ville sont grand habondance de beaulx jardins plains de diverses herbes comme
comcombres, melonges337, pouppons338 et angiers339 qui sont gros comme la teste d'ung homme et sont
plaines d'eaue que l'on succe, et est bonne pour rafraichir. Le sucre aussi croist le long du Nyle en cannes
grosses comme le tuyau d’une escriptoire, moylleux par dedans, et ceste moylle est humide et plaine
d’eaue, et cela pillé et bouilly se convertist en sucre. Il y a aussi par tout le pays d’Egypte grand habondance
de cassiers qui sont grands arbres comme noyers qui portent ung certain fruict long environ de deux piedz,
noyr quant il est meur, long et gros comme ung tuyau d’escriptoire. Il y a grand multitude de palmes qui
portent les dactes.
En nous refraichisant en cedict lieu pour ce que nous avions longtemps demeuré sur la mer à manger chairs
sallées et boyre l’eaue, toute puante, nous prinsmes par trop grand cupidité à manger de la chair fraiche de
petitz oyseaux fort gras qui en ce lieu se trouvent à grand marché ; nous prenions grand plaisir à boyre de
l’eaue de ces cisternes qui vient du Nyle pour ce que nous estions fort altéréz pour les challeurs que nous
avions endurées sur la mer, et nous sembloyt que le vin nous brulloyt et l’eaue nous refraichissoyt, mays elle
est périlleuse à ceulx qui ne sont pas accoustuméz, car elle est laxative pardessus toutes les eaues du
monde, et néanlmoins que nous estions bien advertis du cas par le conseil, toutesfoiz, monsieur de la
Riviere qui estoyt ja mal disposé ne s’en peult tenir, par telle faczon qu’il tumba en ung grief flux de ventre et
nonobstant cela, expectant qu’il se passeroyt par le chemyn, nous délibérasmes de partir pour aller au grand
Caire.
Après avoir eu contenté nostre patron qui nous avoyt passéz la mer, par la conduite de monsieur le Consul
avons faict le marché avecques ung genithsaire pour nous conduyre jusques au grand Caire. Les
genithsaires sont presque tous chrétiens regniez [renégats] d’Esclavonnie, de Albanye et de toute la Grèce
que le Turc prent petitz enffans et les faict instruyre en sa loy et puys les faict exercer en armes et sont se
serviteurs, en leur donnant bons gaiges, et selon qu’il les trouve bons et fidèles il les eslève en dignitéz et
offices pour toute leur vye. Il est à noter que le moindre de ses génithssaires a si grand auctorité que
avecques une verge il chassera cent turcs ou mores davant luy sans se oser deffendre, et, pour ce, qui veult
aller seurement par le pays de Turcquye, il convient qu’il ayt ung génithsaire. Nous prenions aussi des
muletz pour nous porter jusques à Rossecte, car depuys Alexandrie jusques au grand Caire il y environ cinq
journées, et peult-on aller par eaue et par terre, mays communément on va par terre jusques à Rossecte,
pour ce que les eaues du Nyle qui vient du Caire en Alexandrie ne va droict mays circuyt beaucoup de pays,
et après que nous eusmes chargé nostre begaige comme vin, pain et autres choses qui faisoient besoing, à
la garde de Dieu et à la conduicte de nostre génithsaire, partismes de Alexandrie le vingt huictiesme jour
d’aoust. »
333 Clément, R., Les Français d’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, Ifao, Le Caire, 1960, p. 5.
334 Enclos, enfermé de murs. Toutes les notes de ce texte sont de O. V. Volkoff.
335 Avaient coutume, avaient l’habitude.
336 Verre.
337 Melons.
338 Autre variété de melon.
339 Anuries ?
- 226 - 227 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO BARBARIGO (du 10 mars au ? septembre 1537)
Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 429-615.
Le capitaine Antonio Barbarigo est emprisonné à Alexandrie ainsi que le consul vénitien, les marchands et
tous les marins. Un voyageur anonyme raconte le même événement (voir la notice suivante).
p. 446-447 :
« Ivi per essere il paese amorbato, el Capitaneo non volse che si prattichasse da quelli delle galee insino adì
16 luio. Nel detto giorno si cominciò a prattichar et negociar con li Mori segondo il solito. E così si continuò
insino adì 3 septembre, nel qual giorno gionse in Alexandria una fusta turchescha da Sattalia con un
Schiavo della Porta sopra, el qual ito al Castellan del Farion Grande expose al ditto di ordine del Signor, che
si dovesse far buona guardia alle galee dette, indi montato a cavallo andò al Cagiero et expose a Suleiman
bassà il voler et comandamento del Signor turcho, che si ritenessero dette galee, per il che il bassà mandò
in Alexandria il Desdar con gianizzari 500, fatto prima el diuan zoè conseglio.
« Adì 7 septembre M. Almoro Barbaro consolo dei Venetiani in Alexandria andò insieme con li marcadanti a
Ferat Chiaus mandato dal Cagiero in Alexandria per un garbuglio fatto da Mori a Vinitiani, per alcune lame di
spada trovate sopra la navetta di M. Mafio Bernardo patron Franc.o Tagliapietra, et benchè ditto Consolo
facesse presente al ditto Chiaus di tre caxache di seda, nondimeno fu fatto ritenir da lui di ordine come si
credea del bassà, insieme con li altri mercadanti, e fatti condu in (p. 447) la torre delle lanze, et farli turo le
borse et li anelli che s’avevano adosso et in dito, ove stettero servadi giorni dui. Indi havendoli il Consolo
donato ducati 300 li fece levar di lì e lasciòli andar nel lor fontigo ma facendoli star nel fontego serradi con
buona custodia fino ch’avesse risposta dal Cagiero.
« Adì 12 septembre zonse in Alexandria el Desdar che venia dal Cagiero con li 500 gianizzari, il qual fece
raddoppiar le guardie alli fonteghi e alle gallee, et mandò Francho Turciman al cap.o delle gallee con un
comandamento chel venisie in terra, affidandolo tuttavia chel non saria in pericolo alcuno. El cap.o fece ridur
el conseglio de dodeci, nel qual deliberorno chel non andasse in terra, per il chè il Desdar li mandò a dir chel
dovesse obedir il comandamento del Signor, e non dubbitar di cosa alcuna, e che sopra la sua testa lo
affidava. El cap.o vedendo che li era forza obedir, fece armar la barcha della sua gallea, e smontato in quella
andò in terra con li nobeli della gallea e alcuni marcadanti, et raccomandò le gallee al suo ammiraglio.
Giunto il cap.o in terra subito con li nobili e mercandanti fu fatto andar in fontegho grande dal Consolo. In
quel dì istesso dopo disnar, el Desdar andò ad esso cap.o, e li disse chel facesse venir li suoi homeni delle
gallee in terra se non che li faria tagliar la testa. Per il che il cap.o andò a marina e fece venir a sè la sua
gondola, e mandò per quella una lettera a l’ammiraglio comandandoli che dovesse venir in terra con le
zurme, il quale obedì, indi il cap.o fu messo nel fontego grande ove era il consolo. Indi el Desdar mandò una
fusta armata in mezo le gallee a far guardia che alcuno non scappasse, e la mattina seguente alli 13 di sept.
El Desdar venne a marina al messetto cum il cap.o e cum li marcadanti e notorono i fusti insieme cum un
Sanzacho e andorono a tuor in nota e li danari e l’haver dei marcadanti e dei galleotti, indi lassorno circha 25
homeni per gallia, e il resto mandorno in terra nel fontegho cum tutti li altri.
« Adì 14 el Desdar fece tuor in nota tutte le persone e le robe del consolo e delli marcadanti e non li lassò
salvo una muda di drappi, e bollò tutte le camere et magazzini … De lì a dui giorni cominzorono a mandar li
homeni delle gallee al Chairo de 50 alla volta ligati ad una corda uno cum l’altro menandoli fuora di
Alexandria per la porta di Rossetto circha doi miglia al Calexme e ivi mettendoli in zerba a 20 e 30 per zerba,
in ultimo rimase il consolo et el cap.o cum li officiali e passezieri ; Adì 2 octobre furono menati il consolo et il
cap.o cum il resto a Rossetto et ivi imbarchati et condutti al Cagiero. »
- 228 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
VÉNITIEN ANONYME (du ? au 7 septembre 1537)
Vénitien anonyme, « Viaggio & impresa che fece Soleyman Bassà del 1538 contra Portoghesi per racquistar
la città del DIU in India », dans A. Manuce (éd.), Viaggi fatti da Venetia alla Tana in Persia, in India, et in
Costantinopoli, con la descrittione particolare di città, luoghi, siti, costumi et della Porta del Gran Turco et di
tutte le intrate, spese et modo di governo suo et della ultima impresa contra Portoghesi, Venise, 1545.
Voir la notice d’Antonio Barbarigo ci-dessus.
p. 143-144 :
« Voyage d’Alexandrie aux Indes 7 octobre 1537
Je décrirai un voyage fait aux Indes, non pas par notre propre volonté, mais par nécessité, à la suite de la
personne de Soleiman Bassà eunuque lequel était envoyé par Soleiman Sach empereur des Turcs en
expédition contre les Portugais à l’époque où éclata la guerre en 1537 contre notre Illustrissime Seigneurie
de Venise et où nous demeurions à Alexandrie avec les galères de marchandises vénitiennes dont le
capitaine était messire Antonio Barbarigo le Magnifique. Nous fûmes gardés dans la dite ville d’Alexandrie, à
ce moment-là, sans avoir la possibilité ni de vendre, ni de négocier nos marchandises et demeurâmes là
jusqu’au 7 septembre 1537, jour où le consul de notre nation appelé Messire Almoro Barbaro et le susdit
capitaine Barbarigo, les marchands et tous les marins ainsi que les effets de chacun furent pris et conduits à
la tour des Lances ; après un choix de tous ceux qui étaient aptes au service de la mer, parmi lesquels je me
trouvais, nous fûmes expédiés au Caire, cinquante à la fois, et de là envoyés au Pacha Soleimano ; celui-ci
choisit des bombardiers, des rameurs, des lanceurs de pierre, des calfats, des capitaines, et l’amiral, et
quelques compagnons et les envoya à Suez, où peu après il en envoya beaucoup d’autres, pour construire
les navires jusqu’au jour de son arrivée qui fut le 15 juin, comme on le dira pleinement en son lieu. »340
340 Traduction : archives Sauneron (Ifao).
- 229 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOSSE DE MEGGEN (du 18 octobre 1542 au ? et février 1543)
Meggen, J. de, Iodocia Meggen patricii lucerini peregrinatio hierosolymitana, par J. Mayer, Dilingae, 1580.
Josse de Meggen, patricien de Lucerne, en voyage pour la Terre sainte, accoste à Alexandrie suite à une
violente tempête. Son devoir accompli, il revient à Alexandrie pour y embarquer le 14 février 1543.
p. 164-168 :
Chapitre XV
« La beauté des arts et son port très fréquenté rendirent autrefois cette ville magnifique et puissante. Elle est
distante de Crète de 600 000 pieds. Elle a été construite par Alexandre le Grand suivant un plan admirable,
comme le montrent assez de nombreuses colonnes d’une taille extraordinaire, des places vastes et
régulières, ainsi que d’autres ruines. Mais comme l’eau douce manquait tout à fait, au prix d’énormes
dépenses, avec une merveilleuse intelligence et une souveraine habileté, on a construit par un travail
remarquable un immense aqueduc venant du Nil, de plus de 50 000 pieds, suffisant pour que deux bateaux
puissent y naviguer. Cet aqueduc amène pour l’usage de la ville une grande quantité d’eau dans
d’innombrables citernes très bien construites. À cause de leur construction très soigneuse, ces citernes
peuvent conserver plusieurs années l’eau qu’elles ont une fois reçue. Il y en a une très grande quantité à
travers toute la ville, si bien que beaucoup estiment -et ils n’ont pas tort- que cette ville vaut plus par ce que
la terre cache que par ce qui est au-dessus et apparaît, remarquable et magnifique pourtant. En vérité, je
suis descendu moi-même dans ces citernes et j’ai eu le grand plaisir de voir avec la plus vive admiration
leurs vastes dimensions, leurs parois très grandes et très belles, leurs voûtes. Tout cela cependant, fait
depuis si longtemps, se dégrade petit à petit.
La ville ne semble pas très bien défendue, à cause de ces deux ports : le nouveau, assez ouvert et l’ancien
moins protégé, aux remparts à moitié détruits. Mais à cause de l’abondance des marchandises, quelques
places, remplies de misérables édifices ont un grand nombre d’habitants. Il y a, en outre, des Vénitiens, des
Français, et d’autres, qui habitent des maisons magnifiques, mais séparées et qui leur sont personnelles. Ils
ont pour chaque nation un consul qui a autorité aussi bien au sujet des marchandises que pour les
différends entre chrétiens. Au milieu d’une place, on trouve, marqué par une grande pierre, le lieu où, dit-on,
saint Marc l’Evangéliste a été mis à mort, alors que, dans l’église de Saint-Sabas, sur une tribune
maintenant à moitié en ruine, il enseignait au peuple la parole divine. C’est l’évêché des chrétiens grecs qui
est le plus important. Les occidentaux ont pourtant un autel pour célébrer les fonctions sacrées. Là, pendant
notre passage, nous fîmes l’enterrement, suivant nos rites, du capitaine d’un navire appartenant à un
Marseillais (on l’appelle Galéas) : peu de jours avant, il était arrivé de France en bonne santé.
Il y a en outre deux ou trois églises pour les chrétiens, tant grecs que latins. Sans parler d’autres choses
remarquables, un lieu très célèbre est celui – marqué par deux hautes colonnes – du martyre de sainte
Catherine. Cette très sainte vierge et épouse du Christ y fut mise à mort, après que les bourreaux eurent
préparé en vain les roues du supplice. Là, dans un angle qui avance un peu, se trouve sa prison : elle était
alors réunie au palais royal, dont aujourd’hui encore on peut voir les angles.
Dans cette même ville, près des murailles d’enceintes, se trouve une petite pierre taillée à angles droits,
d’une hauteur extraordinaire, et d’une largeur de plus de 7 pieds de tous les côtés, montant comme une
pyramide vers un sommet très pointu. À cause de la similitude, tout le monde l’appelle l’aiguille. De tous
côtés y sont gravés d’étranges caractères inconnus. On pense qu’elle a été élevée par le roi Alexandre en
mémorial singulier. On dit qu’il y en avait deux et que l’autre, maintenant couchée à terre, disparaît au milieu
des autres ruines. On voit là, à côté, quelques autres très grandes colonnes renversées.
Le site de cette ville est plat et bas, sauf deux monticules ou collines contenues dans les remparts : l’une est
tout à fait nue, l’autre porte à son sommet une forteresse ou plutôt un observatoire. Mais hors de la ville tout
est plat et exposé aux inondations marines, comme la plupart des terrains de cette région.
Alors que presque tous avaient décidé d’aller au moins au Caire, une partie, manquant d’argent, changea
d’avis, d’autant plus qu’on entendait dire que le voyage était dangereux et coûteux. D’autres, en mauvaise
santé, n’auraient pu, à cause de leur maladie, réaliser leurs intentions, sans mettre leur vie en danger.
Nous nous divisâmes donc en plusieurs groupes. Six seulement d’entre nous, en bonne santé et nous
entendant bien, nous décidâmes de partir. Nous laissâmes nos affaires dans les maisons des Français,
assez en sécurité jusqu’à notre retour. Pour que notre voyage soit plus sûr, nous prîmes un interprète et un
guide janissaire (la plupart de ceux-ci, ayant abandonné le Christ et adorant Mahomet, sont à la solde des
Turcs et les servent pour la guerre).
Ainsi, ayant obtenu la permission de partir -sans laquelle nul, en effet, ne peut sortir de la ville-, ayant payé
divers tributs et angaries, comme on les appelle, ayant loué des bêtes de somme, nous partîmes enfin le
soir du 22 octobre.
À environ 4000 pas nous vîmes sur la droite des marais salants, plus petits qu’à Chypre et produisant moins.
Peu après, à une courte distance, nous arrivâmes à l’aqueduc dont nous avons parlé plus haut. À cet
endroit, près d’Alexandrie, nous avons trouvé des câpriers très fertiles. Le terrain lui-même est plat et
sablonneux, avec quelques collines de-ci de-là ; mais à cause de l’inondation annuelle du Nil, la terre produit
en grande abondance du blé et d’autres choses. Le fruit du palmier est très abondant et commun : il passe
auprès des Egyptiens pour un aliment vulgaire, et même les pauvres s’en nourrissent. Il semble qu’à cause
de cette abondance, on admette comme une chose permise que les passants puissent en ramasser et en
cueillir. À peu près au milieu du chemin, vers un village appelé Aboukir, près du port, où nous avons vu de
loin la lumière habituelle, nous nous sommes reposés quelques heures, en nous couchant par terre, après
avoir dîné. »341
341 Traduction : H. Rostan d’Ancezune (archives Sauneron, Ifao).
- 230 - 231 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PIERRE BELON DU MANS (fin août-début septembre 1547)
Belon, P., Voyage au Levant : les observations de Pierre Belon du Mans de plusieurs singularités & choses
mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie & autres pays étranges (1553), par
A. Merle, Paris, 2001.
Pierre Belon naît dans la campagne sarthoise en 1517 et meurt en 1565. Après des débuts qui semblent
avoir été humbles, il devient successivement garçon apothicaire, étudiant itinérant, envoyé officieux,
prisonnier à Genève, familier d’un cardinal et licencié en médecine à Paris et Montpellier. Au cours de ses
voyages, Pierre Belon est intéressé particulièrement par la faune et la flore qu’il veut découvrir dans leur
milieu naturel. Dans sa relation, il décrit longuement les plantes et les animaux.342
p. 264-277 :
Des deux villes d’Alexandrie, une en Égypte, & l’autre qui était colonie des Romains en Phrygie
Le lendemain matin nous descendîmes du navire et allâmes en la ville d’Alexandrie. Avant que de parler
d’Alexandrie, je dirai premièrement qu’il y a eu diverses Alexandries, mais sur toutes y en a eu deux
renommées : car mêmement, dès le temps des Romains, la ville de Troie la grande ayant été refaite par eux,
et y ayant envoyé des colonies romaines, ils la nommèrent Alexandrie, dont Pline fait mention. C’est celle
dont Galien a souventes fois parlé, lequel n’a jamais entendu sinon de cette Alexandrie où était Troie, et non
de l’Alexandrie d’Égypte, laquelle chose on peut (p. 265) assez connaître par ses écrits. Il me suffit pour le
présent traiter succinctement les choses exquises concernant mon observation, car écrire de la ville
d’Alexandrie par le menu après tant de grands personnages, ce ne serait que redite.
Elle est située en pays sablonneux dessus une pointe, car d’un côté elle a la mer Méditerranée, et de l’autre
côté est le grand lac Mareotis, de moult grande étendue. Les mêmes murailles qu’Alexandre le Grand fit
anciennement édifier sont encore en leur entier, mais le dedans de la ville n’est pour la plupart que ruine des
anciens bâtiments. Elle fut expressément ruinée quand le roi de Chypre, forcèrent le soldan de la laisser,
lequel voyant ne la pouvoir garder la fit démolir. Mais depuis on y a réédifié des maisons peu à peu, selon
qu’on y a voulu habiter. Et n’était que les marchands chrétiens y tiennent quelques hommes pour le trafic
des marchandises, elle serait bien peu de chose. On y apporte toutes sortes de vivres, tant du pays
d’Égypte que de Chypre et des autres lieux voisins. Le pain qui est fait en ce pays-là, et en Syrie, est formé
en tourteaux, aplati en fouasses, dessus lequel ils ont coutume semer de la nigelle franche. Pourquoi on
trouve telle semence en vente à grandes sachées par les marchés et ès boutiques des marchands.
Il y a toutes sortes de vins qu’on apporte par mer de divers lieux, car mêmement Chypre n’en est guère loin.
Les chairs, tant de mouton que de chevreau, de veau et boeuf, y sont moult savoureuses. Ils ont grande
quantité d’espèces de chèvres, qu’on nomme gazelles, lesquels anciennement les Grecs nommaient oryx,
qu’ils tuent à l’arquebuse par les campagnes, car elles y vont en troupes. L’on y trouve aussi des poules et
des oeufs. Alexandrie est située en lieu abondant en poisson, où j’ai reconnu des brèmes de mer, bars,
maigres, dentals, mulets, raies, anges, chiens, gourneaux. Mais encore y en a plusieurs autres qui leur sont
apportés du Nil, tant frais que salés. Ils ont aussi des grenades, mouses, limons, oranges, poncires, figues
de figuier, et figues de sycomores, et (p. 266) caroubes, et plusieurs autres fruits que nous n’avons point. Ils
ont aussi de toutes sortes de légumes, desquels le renom est grand. Aussi sont-ils opulents en toutes sortes
de blés, comme riz, orge, far autrement dit épeautre.
La plante appelée des Grecs dolicos y porte la fleur jaune. Aussi ont-ils grande quantité de la semence
d’une espèce de pois que les Grecs nomment Latyri, les Vénitiens manerete, les Romains cicerchie, et les
Français cerres. Quiconque voudra savoir quelle chose abonde le plus en une ville, aille se promener par les
places aux jours des marchés où l’on vend le gibier, le poisson, herbages, le fruitage et autres hardes, et il
comprendra en peu de temps les choses de quoi les habitants ont le plus : chose qui m’a été manifeste en
Alexandrie. Les Égyptiens ne font guère de repas qu’ils n’aient une manière de racine, nommée de la
colocase, qu’ils font cuire avec la chair. Elle est de grand revenu à toute l’Égypte, aussi est-ce la chose
qu’on y vende le mieux par les marchés des villes et des villages. Et suivant mon observation, j’ai ici retiré la
figure d’Alexandrie, pour la représenter au naturel.
(p. 267) De la bête anciennement nommée « hyaena » & maintenant civette
Le consul qui était lors en Alexandrie pour le fait des Florentins avait une civette si privée, que se jouant
avec les hommes elle leur mordait le nez, les oreilles et les lèvres, sans faire aucun mal : car ils l’avaient
nourrie dès sa naissance du lait des mamelles de femme. C’est chose rare à voir qu’une bête si farouche et
malaisée à apprivoiser devienne si privée.
Les Anciens ont bien connu la civette, et je prouverai bien, par leur autorité, qu’elle doit être nommée
hyaena343, combien qu’ils n’avaient jamais aperçu qu’elle rendît un excrément de si grande odeur : toutefois
l’on trouve bien qu’il y ait eu une espèce de panthère odoriférante. Les auteurs ont parlé de hyaena comme
de bête sauvage du pays d’Afrique, ce qui me fait penser que la civette en ce temps-là n’était point gardée
en cage. Mais nous, l’ayant apprivoisée, elle nous est de plus grand revenu qu’elle n’était anciennement.
Aussi le nom dont nous l’appelons est emprunté des auteurs arabes, car nous avons delaissé son ancien.
Elle est trapue comme un bedouaut ou taisson344, mais de plus grande corpulence ; et sachant qu’elle a un
conduit, outre celui de sa nature, dont on tire la civette, plusieurs lisant l’histoire de hyaena pensaient que
hyaena fût un blaireau, bedouaut, ou taisson, qui est tout un. Mais les Anciens et Aristote ont nommé le
blaireau throchus. Elle porte les crins noirs dessus le col et le long de l’épine du dos, lesquels elle dresse
quand elle est courroucée, tout ainsi que fait un pourceau les siens. C’est de là que le poisson nommé glanis
a aussi été nommé hyaena. Son museau est plus pointu que celui d’un chat, et a semblablement de la
barbe. Elle a les yeux reluisants et rouges, et a deux taches noires sous les yeux. Ses oreilles sont rondes,
approchantes de celles d’un blaireau. Elle a le corps mouchté, savoir que le champ est de blanc, sur quoi
sont assises des taches noires ; comme aussi ses jambes et pieds sont noirs, comme ceux d’un ichneumon.
Sa queue est longue, noire par-dessus, ayant quelques taches blanches par-dessous. Son pâturage est
chair, et elle est de corsage agile. (p. 268) Voilà la description de la civette. Maintenant, qu’on la confère
avec celle de hyaena, et par là on verra que ce que nous nommons maintenant civette est le hyaena des
Anciens.
Discours de diverses choses d’Alexandrie, & des obélisques & gros colosses des Égyptiens
Le jour d’après allâmes voir la haute colonne de Pompée, hors de la ville, dessus un petit promontoire, à
demi-quart de lieue d’Alexandrie. La colonne est d’admirable épaisseur, et de démesurée hauteur, plus
grosse que nulle autre que j’aie jamais vue. Les colonnes d’Agrippa au Panthéon de Rome n’approchent en
rien de son épaisseur et grosseur. Toute la masse, tant de la colonne, du chapiteau, que de la forme
cubique, est de pierre thébaïque, de la même pierre dont furent faits tous les obélisques qui ont été retirés
d’Égypte. L’on dit que César la fit ériger là pour la victoire qu’il obtint contre Pompée. Cette colonne est si
grosse qu’il serait maintenant impossible de trouver un ouvrier qui par engins la pût transporter ailleurs.
Quand on est dessus ce promontoire, l’on voit bien la mer, comme aussi en terre ferme.
(p. 269) Tournant le visage vers le midi, on voit le lac Mareotis large et spacieux, environné de forêts de
palmiers. D’Alexandrie au susdit lac il n’y a pas demi-lieue. Les campagnes sont pour la plus grande partie
de sablon mouvant, qui seraient stériles n’était qu’il en croît d’une herbe nommée harmala, et aussi des
câpriers sans épines qui portent celle manière de grosse câpres qui nous sont apportées de ce pays-là. Car
les petites câpres viennent ès câpriers épineux, qui perdent leurs feuilles en hiver. Mais les câpriers sans
épines d’Égypte, et ceux qui sont arborescents en Arabie, ne perdent point leurs feuilles. Les tamarisques
aiment grandement à croître par les sablons en ce territoire, et toutefois ailleurs ils ne cherchent que les
lieux humides.
La susdite herbe de harmala est moult semblable à Moly345. C’est une espèce de rue sauvage que les
Arabes, Égyptiens et Turcs ont à présent en divers usages. Ils ont coutume de s’en parfumer tous les
matins, et se persuadent par cela qu’ils chassent tous mauvais esprits. Cela a donné si grand usage à telle
herbe et à sa semance, qu’il n’y a si petit mercier qui n’en tienne en sa boutique, comme si c’était quelque
précieuse drogue. Apollodorus auteur ancien a attribué au souchet ce que j’ai dit de harmala, disant que les
Barbares ne sortent jamais de leur maison qu’ils ne soient premièrement parfumés de souchet. Cela m’a
quelquefois fait penser que l’usage en est ancien.
Entre les choses singulières que nous avons vues en Alexandrie sont deux aiguilles, autrement appelées
obélisques, qui sont près le palais d’Alexandrie. L’une est droite et entière ; l’autre est couchée et rompue.
Celle qui est droite est beaucoup plus grande que l’autre qui est couchée. Elle pourrait être comparée en
grosseur à une qui est à Saint-Pierre à Rome. Quand je parle d’un obélisque, je parle d’une des choses de
ce monde qui est de la plus grande admiration, et dont l’on est en doute, pourquoi elles ont été taillées si
étranges. Si l’on n’en voyait que trois ou quatre, l’on aurait raison de dire qu’ils ont été taillés par la curiosité
de quelque roi : mais voyant qu’il y en a plusieurs, dont les uns sont moult grands, comme sont ceux qu’on
voit derrière la Minerve à Rome, et en une place près le Panthéon, et là-haut à Ara coeli, et que les autres
sont (p. 270) moult petits, comme ceux que l’on voit au Populo et au palais du pape, sachant aussi qu’ils
sont taillés de caractères égyptiens ou lettres hiéroglyphiques, je peux conclure qu’ils ont été taillés
anciennement pour mettre sur les sépulcres où étaient confits les corps en leurs sépultures au pays
d’Égypte, et non pas pour dédier aux temples.
Plusieurs voyant une pierre toute d’une pièce massive, si grande, si longue, si grosse, et si bien polie, ne
peuvent croire qu’elle ne soit faite de mixtion ; car tous obélisques sont entaillés de pierre thébaïque, qui est
toute grenée de divers grains, ayant deux ou trois couleurs, comme la poitrine d’un étourneau. Qui est la
raison pourquoi les Grecs la nommèrent jadis psaronium, car psaros en Grec est à dire un étourneau. Mais
ils pensent mal : car sa grivelure ou granelure lui procède de la nature du rocher, qui est de telle couleur. Ce
qui rend les obélisques si admirables est de les voir faits tout d’une seule pierre, comme qui imaginerait une
tourelle carrée faite toute d’une seule pièce.
Je dis que tous les obélisques que l’on voit aujourd’hui à Rome étaient déjà entaillés en Égypte, avant que
Romulus eût mis le pied à Rome. Le rocher dont ils ont été pris est tellement continué346, sans y avoir
aucune veine, que l’on pourrait trouver la pierre sortable347 à tailler une tour d’une pièce, plus grosse et plus
longue que ne sont les tours de Notre-Dame de Paris, s’il était possible qu’on la pût remuer ; car l’on verra
une montagne de deux lieues de long, toute de pierre massive, sans aucune veine, de laquelle taillant les
colosses ou obélisques de telle longueur et grosseur qu’on voudra, l’on trouvera la matière.
Il y a trois petites montagnes dedans le circuit des murs d’Alexandrie, qui sont nommées les montagnes des
balayures, comme ce qu’on nomme à Paris voieries. Les beaux conduits d’eau, les grandes citernes et les
puits où se vient rendre le Nil sont vraiment choses dignes de voir, lesquels ont été faits de si bonne étoffe,
et si somptueux qu’ils sont encore en leur entier : aussi étaient-ils nécessaires. Les habitants d’Alexandrie
les remplissent d’eau une seule fois l’an, quand le Nil a inondé l’Égypte, dont il leur convient boire tout le
long de l’année. Elle entre par un (p. 271) grand canal qui remplit premièrement les citernes de la ville, où
elle se purifie et rend claire. Toute la ville d’Alexandrie est bâtie dessus belles citernes et voûtes. Elle fut
anciennement bâtie de forte maçonnerie de pierre de taille, d’autant qu’il ne croît que bien peu de bois en
Égypte, sinon de palmiers qui y sont fréquents ; mais ils ne valent rien à en faire ouvrage de charpenterie.
Les paysans d’Égypte vont par les campagnes cherchant les palmiers avortés, auxquels ils coupent la
sommité, et là trouvent une blanche moelle, qu’ils portent vendre en Alexandrie, laquelle ils mangent crue, et
a le goût d’artichaut. C’est ce que les Anciens ont nommé moelle ou cerveau de la palme, et les Grecs
encephalon. Mais il faut entendre qu’il y a plusieurs sortes de palmes, car j’en ai mêmement observé une
autre espèce épineuse en Crète, différente à celle que les mariniers apportent d’Espagne par mer, nommée
cephaloni, qui sont ces petites palmettes que les grossiers et épiciers de Rouen et de Paris vendent toutes
fraîches en leurs boutiques, qui ne coûtent que quatre ou cinq sous la pièce.
Que l’ichneumon est encore pour le jourd’hui gardé privé en plusieurs maisons d’Égypte, & le combat d’un
autre qui est aussi nommé « ichneumon vespa » avec le phalangion
Les habitants d’Alexandrie nourrissent un animal nommé ichneumon, qui est particulièrement trouvé en
Égypte. On le peut apprivoiser ès maisons tout ainsi comme un chat ou un chien. Le vulgaire a cessé de
plus le nommer par son nom ancien, car ils le nomment en leur langage « rat de Pharaon ». Or j’ai vu que
les paysans en apportaient de petits à vendre au marché d’Alexandrie, où ils sont bien recueillis pour nourrir
ès maisons, à cause qu’ils chassent les rats, tout ainsi que fait la belette, et aussi qu’ils sont friands de
serpents, dont ils se paissent indifféremment. C’est un petit animal qui se tient le plus nettement qu’il est
possible. Ceux qui l’ont fait peindre à discrétion sans l’avoir vu ne l’ont pu bien exprimer, comme on peut voir
par ce présent portrait, car les peintures qui en ont été faites à plaisir ne retiennent rien du naturel.
(p. 272) Le premier que je vis en Alexandrie fut ès ruines du château, lequel avait pris une poule qu’il
mangeait. Il est cauteleux en épiant sa pâture, car il s’élève sur les pieds de derrière, et quand il a avisé sa
proie, il va se traînant contre terre et se darde impétueusement sur ce qu’il veut étrangler, se paissant
indifféremment de toutes viandes vives, comme d’escargots, lézards, caméléons, et généralement de toutes
espèces de serpents, de grenouilles, rats et souris, et autres telles choses. Il est friand des oiseaux, et
principalement des poules et poulets ; et quand il est courroucé, il se hérissonne faisant dresser son poil, qui
est de deux couleurs, c’est à savoir blanchâtre ou jaune par intervalles, et gris par l’autre, rude et dur,
comme un dur poil de loup. Il est de corpulence plus longue et plus trapue que n’est un chat, et a le museau
noir et pointu comme celui d’un furet, et sans barbe. Il a les oreilles courtes et rondes, et est de couleur
grisâtre, tirant sur le jaune paillé, tout ainsi que celui des guenons nommées cercopitheci. Ses jambes sont
noires, et il a cinq doigts ès pieds de derrière, dont l’ergot de la partie de dedans est court. Sa queue est
longue, et est grosse en icelui qui touche au râble ; et il a la langue et les (p. 273) dents de chat. Il a une
particulière marque qu’on ne trouve point ès autres animaux à quatre pieds, et qui a fait penser aux auteurs
que les mâles portassent aussi bien que les femelles : c’est qu’il a un moult grand pertuis tout entouré de
poil, hors le conduit de l’excrément, ressemblant quasi au membre honteux des femelles, lequel conduit de
l’excrément ne laisse pourtant être fermé, en sorte qu’il a une cavité leans. Il porte les génitoires comme un
chat, et craint grandement le vent. Combien que cette bête soit petite, toutefois elle est si dextre et agile
qu’elle ne craint à se hasarder contre un grand chien ; et mêmement si elle trouve un chat, elle m’étrangle
en trois coups de dents. Et pource qu’elle a le museau si pointu, aussi a peine de mordre en une grosse
masse, et ne saurait mordre la main d’un homme ayant le poing clos. Les auteurs en ont dit plusieurs autres
choses, et principalement de la guerre qu’il a contre l’aspic, et aussi qu’il détruit les oeufs du crocodile et qu’il
est moult vigilant, lui attribuant beaucoup de vertus singulières que je n’ai mises en ce lieu pour éviter
prolixité, pensant satisfaire d’en bailler sa description.
Mais pource qu’il y a encore une autre petite bête, qui est espèce de mouche guêpe, nommée aussi
ichneumon vespa, qui mène guerre mortelle avec le phalangion, et pource que j’ai vu leur combat, il m’a
semblé bon la décrire en ce lieu. C’est une espèce d’insecte sans sang, ayant le corsage d’une avette ou
guêpe, qui est moult semblable à une bien grande fourmi ailée, de moindre corpulence que la guêpe, et qui
fait aussi son pertuis en terre comme le phalangion. Et toutes fois et quantes qu’elle trouve le phalangion,
elle en est supérieur ; toutefois l’assaillant en son creux, s’en retourne souvent sans rien faire.
Advint en un combat que l’ichneumon vespa trouvant le phalangion à l’écart hors de son pertuis, le traînant
après soi par force, ainsi comme la fourmi fait un épi de blé, et le conduisait partout où il voulait, combien
que ce ne fût sans grande peine, car le phalangion, se retenant avec les crochets de ses pieds, faisait
grande résistance. Mais l’ichneumon le piquait en divers endroits de son corps avec un aiguillon, qu’il tire à
la manière des avettes, et, étant lassé de le traîner, se mit à voler ça et là, (p. 274) quasi à la portée d’une
arbalète ; et revenant chercher son phalangion, ne le trouvant en l’endroit où il l’avait laissé, suivait ses pas
à la trace, comme s’il les eût sentis à l’odeur, comme les chiens après le lièvre. Lors il se repiquait plus de
cinquante fois. Et se remettant à le traîner, le conduit à sa fantaisie et là achevait de le tuer.
Voyant les marchandises qui sont en réserve ès magasins d’Alexandrie, drogueries et autres singularités,
nous avons trouvé des peaux d’autruches, avec leurs plumes en moult grand quantité. Car quand les
Éthiopiens les ont tuées, ils les écorchent. De la chair ils en vivent, mais troquent les peaux à l’échange avec
toutes les plumes pour d’autres hardes, lesquelles puis les marchands apportent vendre en Alexandrie, et de
là sont distribuées en divers lieux de Turquie : car les Turcs ont aussi bien usage d’en faire panaches et les
porter à leur turban, comme en France ès armets348, mirions et accoutrements de tête.
Les jardins d’Alexandrie et de toute Égypte, hormis au rivage du Nil, sont malaisés, car il faut incessamment
tirer l’eau par engins avec les boeufs pour arroser la terre. Leur josium349 est différent du nôtre, car celui-là a
sa fleur jaune, moult odoriférante. Les roses aussi y ont la fleur jaune, mais sans odeur.
Des moeurs des Alexandrins & des déserts de Saint-Macario, & de plusieurs autres choses d’Alexandrie
Cinq journées au-delà d’Alexandrie tirant vers Afrique, il y a des déserts qu’on nomme les déserts de Saint-
Macario, qui sont ès confins de Saint-Antoine, où habitent des caloyers arabes, qui conviennent en la
religion avec les Grecs ; et il y a plusieurs monastères mêlés d’Arabes avec les Grecs. Étant en Alexandrie
trouvâmes quelques gentilshommes vénitiens qui en étaient naguère retournés, dont les uns par curiosité
avaient rapporté des rameaux et fleurs de tamarindes, qui croissent là. On y trouve aussi si grande quantité
de pierres d’aigle qu’il en a à charger navires, desquelles les marchands apportaient anciennement de ce
lieu-là (p. 275) à Rome. Car Pline écrit que la pierre aquiline surnommée cissites était trouvée naissante en
Égypte près de la ville de Coptos.
Les Anciens nous ont laissé un secret par écrit pour éprouver le larron avec la pierre d’aigle, qui dure encore
pour le jourd’hui entre les Grecs, et duquel Dioscoride a fait spécial mention ; mais il ne le déclare pas
totalement. Quand les Grecs veulent connaître le larron, il faut qu’ils assemblent tous ceux qui sont
soupçonnés du cas, et à ce faire s’accordent de s’y trouver. Il y a grandes cérémonies : car les caloyers font
cela en disant plusieurs paroles. Faisant une pâte sans levain, ils forment des petits pains de la grosseur
d’un oeuf, et faut que chacun de l’assemblée mange ses trois pains, chacun en un morceau, et les avale
sans boire. Je me suis trouvé à en voir faire l’expérience : et celui qui avait commis le larcin ne put avaler
son troisième petit pain, et se cuidant efforcer, s’étrangla quasi ; ains ne le pouvant avaler, le recracha. Les
religieux de Grèce gardent cela comme pour un secret, et ne le veulent dire. Mais j’ai entendu que c’est avec
la pierre de l’aigle, de laquelle mettent un peu de poudre parmi la pâte en formant leurs pains.
Le lieu que César nommait Pharus, qui lors était l’île, est maintenant en terre ferme, et y a un château
malaisé et fort incommode, car il y faut porter l’eau chaque jour par chameau, prise des citernes
d’Alexandrie. Tous les bâtiments d’Alexandrie sont couverts en terrasse, comme aussi sont communément
tous ceux de Turquie, d’Arabie et de Grèce, où les habitants se mettent la nuit pour dormir au frais en tout
temps, tant en hiver comme en été. Les Égyptiens et Arabes sur toutes autres nations dorment en tout
temps au découvert sans aucun lit, et moyennant qu’ils aient seulement quelque petit manteau ou
couverture par-dessus eux, ils ne se soucient ; et n’ont aucun usage de lits, sachant que la plume leur serait
fort dangereuse. Ce n’est donc pas de merveille si les gens de ce pays-là ont pu observer si exactement le
cours des étoiles, car ils les voient à toutes heures de la nuit, tant quand elles se lèvent que quand elles se
couchent ; joint que le temps n’y est point couvert.
Le naturel des Alexandrins est de parler arabe, ou more ; mais les Turcs étant mêlés avec eux usent de
langage beaucoup différent. Et aussi pource (p. 276) qu’il y a plusieurs Juifs, Italiens, et Grecs, l’on y parle
divers langages. Il y a des caloyers, jacobites et grecs, qui y ont un logis pour patriarcat avec leur église, en
l’endroit où anciennement était le corps de saint Marc, avant que les Vénitiens l’eussent enlevé pour
l’emporter à Venise. Les Latins et les Juifs aussi y ont semblablement leur église à part. Entre les
singularités que le consul des Florentins350 me montra, me voyant chercher les drogueries, il me fit goûter
d’une racine que les Arabes nomment bish, laquelle me causa si grande chaleur en la bouche, qui me dura
deux jours, qu’il me semblait y avoir du feu. Plusieurs modernes ont presque meurtri les auteurs arabes pour
cette racine, et leur ont tant donné de démentis, et fait d’injure à tort, qu’il serait honte de le dire ; et toutefois
eux-mêmes ne la connurent jamais. Elle est bien petite, comme un petit navet. Les autres l’ont nommée
napellus.
Voyage de la ville d’Alexandrie au grand Caire
Après avoir demeuré quelques jours en Alexandrie, fîmes nos apprêts pour aller au Caire. L’on peut y aller
par deux chemins, l’un est plus long, par le Nil, et l’autre plus court, par terre. Mais pour autant que le Nil
avait inondé l’Égypte, nous allâmes pour nous embarquer sur le Nil à Rosette. Quand nous fûmes à
demi-lieue hors de la ville d’Alexandrie, entrâmes en une spacieuse campagne sablonneuse, en laquelle
croissent diverses herbes, entre lesquelles y en a une que les Grecs nommèrent anthillis et les Arabes Kali,
laquelle ceux du pays font dessécher pour brûler, d’autant qu’ils n’ont que bien peu de bois.
En cuisant la chaux avec cette herbe, ils ont double gain, car ils portent vendre la chaux en Alexandrie, et ils
gardent soigneusement les cendres de l’herbe, qu’ils vendent aux Vénitiens. Elles s’endurcissent comme
pierres, et en font grand amas, tellement qu’ils en peuvent charger les navires des marchands qui les
viennent acheter pour porter à Venise pour en faire les verres de cristallin. Ceux qui font les verres à Marran
de (p. 277) Venise la mêlent avec des cailloux qu’ils font apporter de Pavie par le Tessin, lesquels
proportionnés avec la cendre font la pâte du plus fin verre cristallin. Mais les Français ayant n’a pas
longtemps commencé à faire des verres cristallins, ont fait servir le sablon d’Étampes au lieu des cailloux du
Tessin, que les ouvriers ont trouvé meilleur que ledit caillou de Pavie. Mais ils n’ont encore su inventer chose
qui puisse servir au lieu de la susdite cendre, ains faut qu’ils aillent en acheter en Provence. Cette chose me
fait penser que ce soit la même qu’ils apportent de Syrie par la mer. Vrai est qu’en français elle est nommée
la soude, prenant son appellation d’une autre herbe nommée soldanella, laquelle brûlée fait cendre de
même vertu, et de laquelle l’on peut user en défaut de la syrienne.
Des choses singulières trouvées entre la ville d’Alexandrie & la ville de Rosette
Nous trouvions les pasteurs sur les chemins par les champs à deux lieues d’Alexandrie paissant les chèvres
à troupeaux, qui ont les oreilles pendantes si longues qu’en outre ce qu’elles leur traînent par terre,
davantage les ont recrochées plus de trois doigts contremont. Leurs pasteurs ne voulant perdre temps en la
campagne ventent le sable cherchant des monnaies antiques. Car il advient quelquefois qu’ils trouvent des
médailles et monnaies d’or fin et d’argent. Le pays que nous avions au côté dextre était spacieuses
campagnes sablonneuses, où il ne croissait sinon quelques câpriers et de la susdite herbe de kali et de
harmala.
Le pays qui nous était à main senestre était quelque peu plus élevé, où nous voyions des grands villages
épandus ça et là entre les forêts de palmiers. Quand nous eûmes cheminé environ trois lieues, nous
trouvâmes de l’eau douce bonne à boire, qui semblait une fontaine, mais ce n’était sinon une cruche remplie
de l’eau du Nil qu’on avait apportée là sur chameaux dedans des outres, dont quelque Turc entretenait le
remplissage pour l’amour de Dieu : car ils estiment grande aumône et mérite de mettre de l’eau sur les
grands chemins pour abreuver les passants. Car tant s’en faut qu’on y puisse recouvrer du vin, que
mêmement ès villes c’est beaucoup de trouver de l’eau fraîche. »
- 232 - 236 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN CHESNEAU (du 6 au 16 septembre 1549)
Chesneau, J., et al., Voyages en Égypte, 1549-1552. Jean Chesneau, André Thevet, par F. Lestringant,
Ifao, Le Caire, 1984.
Jean Chesneau est le secrétaire de Gabriel d’Aramon, ambassadeur de François 1er à la cour de Soliman le
Magnifique ayant pour mission de négocier une alliance.351
p. [24]-[26] :
« Nous partismes de ce lieu le deuxiesme de Septembre, pour aller en Alexandrie, et allasmes a cheval
jusques a Boulac, qui est à deulx mil loing de la ville située sur la Riviere du Nil. Et là est l’escale de ladicte
ville, ou se faict la cherche352 de toutes marchandises qui y arrivent.
(p. 25) Et sur les huict heures du soir, le Sr ambassadeur monta sur un brigantin a vingt quatre rames avec
partie de sa compagnie, et le reste sur grosses barques qui nous menerent toute la nuict. Le landemain,
nous arrestames a un certain village pour disner, et de la vinsmes a une ville appellee Foua, ou ledict
Sr Ambassadeur laissa le brigantin sur lequel il estoit monté, et print une barque afin de passer le canal qui
va de ce lieu jusques aulx jardins d’Alexandrie, ou arrivasmes le VIme jour dudict mois. Et vindrent au devant
dudict Sr Ambassadeur le Consul des François et plusieurs aultes marchans qui pour lors y estoient. Car là
est le port ou tous marchans chrestiens qui traffiquent au pays d’Egipte abordent.
Ladicte ville est fort desolee, et croy qu’il n’y a maison entiere, pour la grand ruine que le Turcq a faict faire
d’icelle. Et n’y a aultre chose d’entier que les murailles qui sont tres belles et haultes et de pierre de taille,
avec grand quantité de tours carrees, et dont on dit que Alexandre le grand les a faict faire, quand il fonda la
ville ; et a la verité, elles sont fort vieilles. Toute ladicte ville est a voulte et conduictz par dessous, dont
encores aujourd’huy (p. 26) s’en voyent les vestiges, à cause d’ung canal tiré du fleuve du Nil qui y passe à
la saison de son inundation.
Le pallais dudict Alexandre le grand et du tout353 ruyné, et n’y aulcune apparance de maison, prez duquel
sont deulx esguilles de pierre de chacune un piece, fort belles et de grande haulteur ; l’une desquelles est
couchée à terre, et l’autre debout, ouvrée354 et escrite en caracteres Egiptiens, qui a de haulteur environ
soixante piedz pour le moings.
Hors la ville, y a aussy en un lieu fort emynent une colonne bien grosse et merveilleusement haulte qu’on
nomme la colonne de Pompée. Et vers ce quartier, a ung mil loing de la, y a ung lac qui donne fort mauvais
air aulx habitans dudict lieu d’Alexandrie, auquel sejounasmes jusques au seiziesme Septembre que nous
en partismes pour retourner au Caire par le chemin mesme qu’avions faict en y allant. »
351 Chesneau, J., et al., Voyages en Égypte, 1549-1552. Jean Chesneau, André Thevet, présenté et annoté
par F. Lestringant, Ifao, Le Caire, 1984, p. [3]-[13].
352 La recherche. Note de F. Lestringant.
353 Tout à fait. Note de F. Lestringant.
354 Gravée, ciselée. Note de F. Lestringant.
- 237 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LUIS DE MARMOL CARVAJAL (milieu du XVIe siècle)
Marmol Carvajal, L. de, L’Afrique de Marmol, Paris, 1667.
Luis de Marmol Carvajal, historien et voyageur espagnol, naît à Grenade vers 1520. Très jeune, il s’engage
dans l’armée de Charles Quint et assiste au siège de Tunis de 1535. Prisonnier des Maures vers 1542
pendant près de huit ans, il séjourne une vingtaine d’années en Afrique. Son ouvrage est en partie inspiré de
celui de Léon l’Africain.355
P. 37 :
« Le siège des derniers rois d’Égypte estoit comme j’ay dit, à Alexandrie, qui a donné naissance à Ptolémée,
& a esté fondée par Alexandre, & célébrée par Cesar, & par une infinité d’écrivains. Elle est encore fameuse
par le grand concours des marchans, à cause du commerce qui s’y fait, qui est le plus grand du Levant. »
355
355 Cassou, J., Itinéraires de France en Tunisie du XVIe au XIXe siècle, Catalogue d’exposition, du 6 mai au
27 juillet 1995, Bibliothèque Municipale de Marseille, Marseille, 1995, p. 162.
- 238 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANDRE THEVET (1551)
Chesneau, J., et al., Voyages en Égypte, 1549-1552. Jean Chesneau, André Thevet, par F. Lestringant,
Ifao, Le Caire, 1984.
André Thevet naît en 1516 à Angoulême et meurt à Paris en 1592. Il entre très jeune au couvent des
cordeliers, mais il a un goût très prononcé pour les sciences profanes. Il acquiert en peu de temps une vaste
culture qui lui permet d’obtenir de ses supérieurs la permission de voyager en Italie en 1549. De là, il se rend
en Grèce, en Égypte et en Terre sainte. À son retour en France, en 1554, il publie une relation de voyage
sous le titre de Cosmographie de levant. L’année suivante, il fait un voyage au Brésil. Ayant obtenu, en
1558, sa sécularisation, Catherine de Médicis le nomme aumônier et obtient la charge d’historiographe et
cosmographe du roi Henri III. André Thevet, auteur de plusieurs traités de cosmographie et d’une abondante
production cartographique, séjourne en Égypte quelques mois, entre 1551 et 1552, dont la plus grande
partie de son temps est une quarantaine forcée à Alexandrie.356
La description suivante est tirée de son ouvrage Cosmographie de levant publié en 1575, dans lequel il
réutilise ses écrits antérieurs.
p. [97] :
« Le Nil ha augmenté les richesses des Egypciens, non seulement en arrosant les terres, mais aussi pource
qu’il est navigable : à raison dequoy, plusieurs marchandises y abordent tant d’Ethiopie, d’Arabie, et des
Indes, que des autres contrées et regions, et principallement en Alexandrie : combien que meintenant le
Caire est la vile d’Egypte ou les marchans trafiquent plus qu’en autre qui soit. »
p. [108]-[118] :
De la ville d’Alexandrie
« Alexandrie donques (comme ci devant ay dit) est en Égypte, prochaine d’Afrique, du diocese de laquelle
estoit les eglises de la région Cyrenaïque, de laquelle S. Luc fait mencion aus actes des Apotres en
plusieurs passages, ce qui est facile à démontrer. Car nous lisons qu’en plusieurs conciles célébrez en
Alexandrie, les Evesques Pentapolitiens, c’est-à-dire, de Cyrene, Apollonie, Ptolemaïs, Arsinoé, Berenice,
qui sont en nombre cinq viles, y ont assistez. Outre plus, l’oportunité du lieu nous induit à croire, que lesdits
Pentapolitiens faisoient l’ofice à la maniere des Grecs, comme Alexandrie, et toutes les Eglises Orientales :
vù que Cartage, et les Eglises, qui estoient sous les arenes d’Afrique, faisoient à la maniere des Rommeins,
comme les autres Eglises Occidentales. Dont s’ensuit qu’en Afrique y ha eu deus sieges fort renommez,
savoir est, celui de Cartage, et celui d’Alexandrie, ainsi qu’on peut connoitre par l’Epitre du concile de
Nicenne, envoyee en Alexandrie. Au paravant cette vile s’apeloit No, metropoliteine d’Egypte, situee au bort
de la mer Egypciaque : mais depuis Alexandre de Macedone, apres avoir conquesté l’Egypte, l’amplifia, et
lui bailla son nom, l’an de son regne cinquieme, ou (comme aucuns disent) settieme : l’opinion desquels
peut estre vraye, si nous tenons que les uns ont eu esgard au commencement, les autres à la fin, comme
Eusebe et Eutrope. Les murailles ont de circuit trente deus stades, (qui reviennent à deus lieues françoises)
et encores sont en leur entier, ayans alentour trois cens cinquante tours merveilleusement grandes,
spacieuses, et bien faites, ou autrefois en chacune y avoit un capiteine demourant avec ses gendarmes,
comme disent les Juifs, et les Maures. Cette vile est presque toute cavee, et y ha sous terre abondance de
Cisternes grandes de deus getz de pierre, faites par dedens avec piliers de marbre rouge et blanc,
lesquelles recevoient l’eaue du Nil qui se desbordoit : mais à présent elles sont toutes ruïnees, et n’y ha
point d’eaue. Il y ha aussi pour le jourd’hui quatre montagnes merveilleusement belles, faites artificiellement,
ou jadis on faisoit le guet tant sur mer, que sur terre : et là on y trouve grandes antiquitez. Que diray je des
edifices, des rues, et temples fameus et specialement de celui de Serapis (duquel S. Augustin fait mention
en son Livre de la Cité de Dieu, dixhuitieme chap.) qui fut abatu du temps de S. Ambroise, a l’aveu de
Theodosien, qui tenoit l’Empire avec Gracian : ce que nous témoignent amplement Sophronius, et Ruffinus
en leurs Histoires. Outre ceci avoit entre autres beautez de la vile, un lieu magnifiquement edifié et dedié
aus professeurs des sciences, et disciplines liberales, avec une Biblioteque, et Librairie, garnie de septante
mile volumes, achetez par tout le Monde, aus frais, et despens des Princes. De laquelle Librairie autrefois ha
eu le gouvernement Demetrius Phalereus Atenien, Filozofe, bien renommé. Pour orner, et de plus enrichir la
ville d’Alexandrie, Ptolemee Philadelphe impétra de Eleazar, Pontife de Jerusalem, les septantedeus
personnages de singuliere doctrine, et aus langues Grecque, et Hebraïque fort bien entenduz, l’an devant la
Nativité de nostre Signeur, environ trois cens cinquante. Mais sur toutes choses ha esté decoree du
Christianisme, lors que S. Marc disciple de saint Pierre, y annonça le Redempteur du Monde lequel fut de si
grande doctrine et sainteté de vie, qu’il atiroit un chacun à son exemple. Son humilité fut si grande, qu’il se
coppa le pouce, à fi qu’il ne fut Prestre, se jugeant indigne de parvenir à si excellente dinité. Du tems dudit
S. Marc, pour le college, qu’on apeloit Musaeum, il y eut une escole instituee d’une façon tresbonne : Et
ceus qui y regentoient, estoient apelez Magistri Catechisewn, cest-à-dire, maitres des premiers
enseignemens de ceus qui estoient enrolez, et voloient batailler sous l’enseigne du Redempteur. Ces
enseignemens peuvent estre apelez Catechismes, ainsi se peut entendre le lait, duquel parle saint Paul, aus
Corintiens : ce que les bons maitres, et bien experimentez font en toute discipline. Le principal de ces
Regens (comme dit S. Jerome) estoit Pantaenus, duquel fut disciple Clement le Prestre, qui succeda à son
maitre : De Clement fut disciple Origene, fils de Leonides martir, qui pareillement succeda à son maitre, et
quelque tems apres mourut à Tyr en grand’povreté, pour ce que son nourissier Ambroise, diacre Alexandrin,
estoit mort devant lui. D’Origene fut disciple Denis, qui tint semblablement l’escolle de Catechisme apres son
maître. Je laisse Didime maitre de S. Jerome, Athanase, et plusieurs autres : hors mi Arrius l’heretique, qui
troubla fort l’Eglise Cretienne. Encores void on en Alexandrie la prison ou fut mise et detenue sainte
Caterine, et deus Colomnes hautes destantes l’une de l’autre, environ onze pas, ou elle fut flagellee, et de là
apres son trespassement translatee au mont Sinai en Arabie. Parquoy non sans cause, cette vile ha esté
apelee par excellence, Polis. Là fut translaté le corps d’Alexandre le grand, qui estoit paravant à Memphis,
qu’on apelle pour le jourd’hui le grand Caire. Et encore à present, ou estoit la grand’salle d’Alexandre, y ha
une Coulomne carree de couleur [Grav. I] rouge, inscrite de plusieurs lettres Sacerdotales, et hieroglifiques.
On dit cette Coulomne estre faite toute d’une pierre, laquelle ha de largeur douze piez, et de longueur
cinquantecinq : tellement que de loin semble estre une haute tour. Cette colomne est beaucoup plus grande
et grosse, que celle qui est à Romme aupres de l’eglise S. Pierre, en laquelle (comme on dit) reposent les
cendres de Jules Cesar. Il y ha plus de trois mile autres colomnes en Alexandrie, moindres toutefois que
cette ci. A present cette vile qui ha esté tant fameuse, est toute ruïnee, et n’a bruit qu’entre les Marchans.
Les guerres et séditions ont esté causes de la ruine d’icelle, ayant esté tiranniqement oprimee par Octavus
Caracalla, et Dioclecian357. Je ne veus omettre la grande abondance des Tourterelles qui sont en
Alexandrie, lesquelles font leur habitacion es maisons ruïnees et desolees. Leur couleur est argentine tirant
sur le gris : Et sont si tresaproivisees que par leur simplicité peuvent estre prises à la main. Pour rien un
Turq ou Maure, n’en voudroit tuer ne geter pierres contre icelles. Ils font conscience de tuer l’oiseau que
Dieu ha creé pour l’usage de l’homme, et ne font grand’difficulté, s’ils trouvent le tems et commodité, de
desrober un marchand, ou de luy inventer mile vaines moresques, pour lui faire perdre corps et biens, en
quoy ils on beaucoup de semblables au Monde. Les Cretiens qui font residence audit lieu, n’ont gueres autre
recreacion que d’aller chasser à ces oiseaus. Aristote parlant de la nature de la Tourterelle dit qu’elle est
appelee Tourterelle pour sa voix. C’est un oiseau moult chastte : quand elle est privee de sa compagnie, elle
ne veut point avoir compagnie à un autre : elle ne ront point les droits de chasteté, ny les aliances de son
masle : car le premier amour la deçoit. Seneque au settieme livre des naturelles questions, [Grav. II] dit que
Agrippine, femme de Claude Cesar, aymoit si fort cet oiseau, qu’elle n’estoit jamais sans en avoir.
Davantage, il se trouve en Alexandrie un oiseau qui se nomme Autruche, qui plaisant à voir, pour son
panache : nonobstant il est diferent aus autres oiseaus, comme on peut voir au dixneuvieme livre de Pline.
Dehors ladite vile d’Alexandrie y ha un Temple d’Indignacion, lequel Cesar fit faire, ou est la teste de
Pompee, comme plusieurs recitent. Il y ha pareillement une colomne ronde, merveilleusement haute, qu’on
apelle la Colomne de Pompee, laquelle il fit faire en memoire de lui. Icelle est grosse de six brasses, et
haute de quinze, et est ladite Colomne à un petit demi-quart de lieue de la vile. Estant quelquefois sur le lieu
entré en propos avec certeins Maures et Arabes, de la demolicion de telle Colomne, leur allegant qu’ils
pourraient trouver grand tresor enfouï sous tel Trofee de renom, prenans exemple au grand Turcq, qui,
pendant que j’estois en Constantinople avoit fait ruer par terre celle de Justinian Empereur, pour en décorer
sa mosquee, ou avoit trouvé plusieurs Medailles, et Medaillons d’or et d’argent. Lors avec grande
indignacion et d’un rebarbatif visage, me respondirent : Va malheureus chien, ignores tu que icelle abatue,
toute la machine du Monde doit estre subvertie ? mesme peu s’en falut que je ne reçusse des coups, tant ils
sont ignorans, et abusez, pour estre privez de la lecture des saints escritz, qui nous rendent ample
temoignage, et du commencement et du de finement de ce Monde, reservé à l’instructable jugement de
Dieu. Le port d’Alexandrie est fort scopuleus et dangereus, à raison dequoy Ptolemee Philadelphe, bon
prince, fit edifier par Sostrate Gnidien, au milieu de la mer, pharum, c’est-à-dire, une tour grande et
merveilleuse, de pierres blanches, laquelle couta (selon que dit Pline) octante Talents, qui valent quarante
huit mile escus. En cette tour y avoit flambeaus toute la nuit, à fin que les Navigeans plus facilement
evitassent les dangers. Plusieurs autres tours faites à mesme fin, ont esté apellees phari, comme celle qui
est près de Bisance, aujourd’hui dite Constantinople, et celle d’Ostie. Or font residence en ladite vile
d’Alexandrie deus honnestes personnages nommez Consulz, dont l’un est François natif d’Avignon, nommé
Guillaume Gardiole, homme fort sage, discret et debonnaire aus estrangers allans par delà. L’autre est
Venicien, et sont là commis, tant pour recevoir les marchans qui vont en celle part, que pour garder et
meintenir leur droit, si par fortune les Turqs et Maures leur vouloient faire aucun tort. Ils ont chacun un
tresbeau et ample logis, nommez Fondiques, là ou les marchans estrangers apres avoir desembarqué, font
porter leurs marchandises. Ceus de Venise et leurs sugetz, comme ceus de Cipre, de Legente, de Corfou,
de Candie, et autres se retirent au Fondique Venicien : ceus de France, d’Espagne, de Gennes, de
Florence, de Raghuse, et de plusieurs autre nacions, au Fondique de France. A chacun Fondique, il n’y ha
qu’une grande porte, pour entrer et sortir de laquelle un Maure porte la clef, ayant expresse charge et
commission, de fermer lesdites portes, à sept heures du soir : tellement que les marchans qui sont dedens,
ne peuvent issir jusqu’à sept heures du matin. Mais le jour du vendredi, ledit maure tient iceus Fondiques
clos et fermez, depuis dix heures, jusques à une apres midi : à cause qu’à telles heures, ils font leurs
oraisons et autres cérémonies en leur Mosquees. Je demouray quatre mois audit lieu, qui me durerent et
ennuyèrent beaucoup, pour le grand desir que j’avois d’aller au Mont Sinai, ou notre Signeur donna la Loy à
Moyse. Toutefois temporisant toujours en ce lieu, je vis plusieurs antiquitez, comme medailles et idoles de
marbre fort antiques, qui avoient esté trouvees tant es vieilles ruines des lieus circonvoisins, que aportees
de lointaines contrees : entre lesquelles pour chose exquise et belle je vis une statue de Juppiter qu’avoit un
Venicien, laquelle avoit esté aportee de l’Isle de Crete. Icelui Juppiter estoit de la hauteur de trois piez, et
avoit le pié gauche sus une boule ronde, et l’autre sus un petit temple : au milieu de ladite boule et du
temple, droit entre ses jambes, estoit une aigle ayant les ailes estendues, comme si elle voulust prendre son
vol, le tout estant posé sur un corps cube, tout autour duquel estoit escrit en lettres Grecques fort antiques,
et quelque peu effacees, (…), c’est-à-dire, Juppiter fils de Saturne. »
356 Weiss, M., « Thevet, André », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie Universelle
ancienne et moderne 45, Paris, 1826, p. 386-388.
357 L’empereur Caracalla ordonna un massacre des habitants de la ville en 215. Dioclétien, en 295, s’empara
d’Alexandrie qu’il ruina, en représailles des séditions que la cité avait soutenues. Note de F. Lestringant.
- 239 - 241 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANDREA PITTI (1552, 1553, 1555)
Pitti, A., Tre viaggi in Egitto, Florence, 1893.
Membre de l’illustre famille florentine, Andrea Pitti naît en 1519. On ne connaît que peu de choses de sa
jeunesse durant laquelle il ne paraît pas avoir accompli de faits remarquables. Il effectue trois voyages en
Égypte pour rendre visite à son frère Bernardo, négociant à Alexandrie.358
Premier voyage : du 5 janvier au 18 février 1552.
p.10-15 :
« Apressandomi a loro, cavato fuori alquanto di moneta acciennai loro che si pagassino se pretendevono da
noi cosa alcuna. Onde con poco di miseria achordai questa lite et restamo tutti in concordia, et subito demo
mano a fare legnie per la nostra nave, et consumato tutto el giorno tornamo i’nave, et a di XXVIII detto in sul
tramontare del sole facemo vela partendoci da detta isola de’Gozi col vento in poppa, attale che a di V di
gennaio arivamo in porto di Alessandria d’Egitto, dove trovai Bernardo mio fratello sano e di bonissima
voglia, il quale stava fermo achasato in detto luogo per negozi, dal quale fui riscievuto molto allegramente, e
per mezzo del quale in breve tempo detti spedizione a miei negozi, finendo a buonissimi prezzi le pannine
che io avevo condotte, et alsi inpiegato li danari in (p. 11) varie merchanzie cioè lini, cotoni, quoira pelose,
pepi, chassie, gengiovi et altro ; onde avendo riposo tutti i dinari che ero obrigato per li merchanti che mi
avevono dato le achomandite, mi avanzava il tempo doppo che furno caricate le merchanzie.
Non voglio manchare di non racontare un risico che io portai della vita mia. In questo mezzo venne nuova
che una nave franzese s’era rotta, venendo in Alessandria, lontana quaranta miglia sopra Alessandria
presso a una città chiamata Rossetto ; onde subito il nostro Consolo bisogno che si partissi d’Alessandria et
andassi al Rossetto per ricuperare, se e’sifussi salvato, cosa alcuna di detta nave. Pregommi, veggiendomi
scioperato, che li dovessi far compagnia. Non potetti manchare di non andare col Consolo insieme con
alquanti cristiani, che allora si trovano in Alessandria, et cavalcando sopra li asinelli con la bardella, che cosi
si costuma per il paese, l’altro giorno arivamo a luogo dove s’era rotto la nave, che per tre miglia di paese
lungo la marina si comincio a trovare le mercanzie rotte e guaste, et alsi de’corpi morti, i quali buona parte
erano mezzi mangiati dalle fiere salvatiche. Subito visto questo, si dette mano a fare delle fosse, e si fecie
seppellire quelli si trovorno. E quelli che erono salvati furno sedici di sessanta che erono sopra detta nave, i
quali ci rifersono che il giorno medesimo che la nave si roppe, uscirno fuori della detta città del Rossetto
circha a dugento mori, i quali ruborno assai merchanzie che s’erano salvate alla proda del mare ; e non
bastando loro questo, che e’poveri marinari che s’erono salvati furno tutti svaligiati, e tolto loro alcuni danari
e orerie che avevono salvate. Onde il Consolo ricorse alla iustizia, prese partito di andare alla città del Cairo
a recramare avanti al Bascià del Gran Turco come Reggiente di tutto l’Egitto.
(p. 12) Sentendo che il Consolo voleva andare al Cairo, lontano dal Rossetto miglia cento o più, domandai
licenzia per tornare in Alessandria, perchè s’andava apressando al tempo della mia partita. Onde il consolo,
visto la mia schusa, mi dette buona licenzia. E perchè nel moi ritorno che dovevo fare in Alessandria il
camino non era molto sicuro per terra, fui consigliato di montare in barcha e venirmene per mare, ché a
punto si voleva partire una carovana di ventiquatro barche cariche di lini che portono circa a trenta sacha per
ciascuna, e sono guidate da dua mori per barcha. Fui racomandato dal Consolo a uno moro barcharolo, che
mi conducessi in Alessandria, e pagato la barcha, subito montai con la mia provisione di mangiare ; e chon
bonaccia tutte dettono le vele al vento. Non fumo a pena caminati dieci miglia, andando sempre presso a
terra un miglio, che si levo un vento da terra, il quale forzatamente ci pingneva dentro in mare e ci
dischostava da terra. E perchè dette barche non possono resistere alle fortune, sono usate andare senpre
terra terra ; onde sendo il mare adirato, comincio a mettere sotto quando una barcha e quando un’altra. Tu
debbi pensare se allora mi tenni a chattivo partito. Non sapendo dove potessi meglio ricorrere, ricorsi al
magnio Iddio, faciendo boto, il quale poi a suo tempo osservai. Il travaglio del mare duro quatro ore, e ci
discosto da terra venti miglia, e di ventiquatro barche che eravamo insieme, ne peri sedici con tutta la
mercanzia. E quando il mare fu alquanto pracato, a poco a poco cominciamo a tornare presso a terra
mettendoci al nostro camino, et avanti che fussi notte arivamo in Alessandria a salvamento racontando tutto
il succiesso, et da Bernardo mio fratello fui molto biasimato l’avere voluto tornare per quella via, perchè ne
capita male spesso spesso di molte barche.
Esendo presso al termine di dovermi partire da Alessandria per tornarmene in Christianità, non ebbi molto
tempo a potere schorrere la città, come era il mio (p. 13) desiderio, per potere racontare se cosa vi fussi
notabile ; niente di mancho non taciero il poco che io o visto. Alessandria dico adunque che in detto tenpo
essere la maggior parte i casamenti rovinati, e ridotta abitabile alcune vie maestre, nelle quali sono botteghe
esercitate la maggior parte da mori. Alessandria la maggior parte d’essa è vota sotto, ed è fondata sopra le
colonne con bello artifizio d’archi, dove per condotto vi si conducie l’aqua del Nilo pigliata lontano venti
miglia, rinovandola ogni anno, quando il Nilo è nella sua maggiore altezza. La quale aqua serve a tutta la
città perchè non v’é altra aqua che sia buona per bere, et ogni casa à la sua gola a uso di pozzo che
risponde alla detta aqua, elzia ancora per le strade sono delle gole a uso di pozzo per servizio commune a
potere pendere detta aqua. E quando fu cavato la terra per fare detta volta fu portata poco lontana della
città, dove ancora oggi vi sono dua montagniuole, sopra le quali v’é edificato una torre, che schuopre molte
miglia, dove sta del continovo una guardia per dare cenno alla città quando schuopre legni in mare, la quale
torre si domanda Schovazzi.
Apresso ancora fuori della terra, lontano mezzo miglio, v’é una colonna ritta che si domanda la colonna di
Ponpeo, la quale, il fusto propio, è alta Braccia XXXXV senza il capitello, posta sopra una basa di Braccia
XII grossa in tondo, quatro omini presi per mano a pena la circhundano, ed è d’una pietra rossa simigliata al
porfido, come se ne vede assai pietre in questo paese. Ancora si vede alcuni residui di bellissimi palazzi
rovinati dentro nella città, dove in sur una piazza de’quali vi sono dua agulie, una in terra rotta nel mezzo,
l’altra ancora ritta, e sono di grandezza secondo quella che oggi è nella città di Roma, che si tiene sia cosa
tanto notabile. Ancora vi sono assai giardini cosi dentro come fuori d’Alessandria.
E per dare notizia di alcune cose, che sono molto contrarie alle nostre, di questo paese, si dice le porte della
(p. 14) città sono di ferro e le chiave di legno; e gli uomini vanno senza calze e calzoni, una vesta sola sopra
la camicia lungha fino in sul collo del piede, et la magior parte in zocholi di legno. E le donne portono tutte
e’calzoni e gli stivaletti ferrati, e vanno coperte il viso portando dinanzi agli ochi un pezzo di burratto, per il
quale possono conosciere altri non possono conosciere loro ; elzia I mariti propii riscontrandole non si
manifestano. Usano una grande parte delle donne tigniersi, l’ungnia delle amni far rosse. Cavalcasi li asinelli
colla bardella coperti da un tappeto, eccietto pero e’Turchi, che anno l’abilita cavalcare I cavalli, che questi
non possono cavalcare e’Mori che sono li abitatori del paese ; e’quali cavalli e asini non si usa in detto paese
ferrare, e pero si dice che in Egitto le persone vanno ferrate e le bestie sferrate, come s’é fatto menzione di
sopra che si ferra le stivaletti che portano le donne.
Non voglio manchare di non dire del bello e superbo et forte castello il quale è posto fuori della terra in sul
porto per guardia del porto e della città, nel quale si vede grandissima quantità di artelleria che saria
abastante a fornire dieci fortezze.
Sentesi per tutta la città grandissima odore di spelzerie, garofani, cannelle, nocie moschade, et altre drogerie
perchè per tutto vi sono I magazini pieni di varie spelzerie, dentro ne’quali molte volte entravo per fare
bazzarro a pannine e denari contanti, secondo le commissione che m’erono state date. Aprossimandosi al
tenpo che dovevo tornare in cristianità, cominciai a fare dare ordine al padrone di nave caricassi aqua e
bischotto per potere al primo buon temporale far vela. In pochi giorni si levo buon vento per il nostro camino.
In pero, fatto le debite cirimonie col Consolo e altri amici et Bernardo mio fratello, montato I nave fecemo
vela a di XVIII di febraio. Non posso quatro giorni che la bonaccia si (p. 15) converti in grandissima e
spaventosa, per la quale fumo costretti a schorrere verso l’isola di Cipri, e per tre giorni e notte tanto fumo
travagliati, che non vi era marinaro che potessi più la vita.
Deuxième voyage : du 21 juin au 8 août 1553 puis du 27 au 30 août 1553.
p. 20-21 :
« Partiti da loro con prospero vento caminando alla volta d’Alessandria senza avere impedimento alcuno,
arivamo in porto d’Alessandria a di XXI detto, dove trovai Bernardo mio fratello che stava acasato in detto
luogho, (p. 21) come nel primo viaggio s’é fatto menzione. Per mezzo del quale in breve giorni rispesi tutti
e’denari che avevo per acomandita in varie merchanzie, secondo le comessione che m’erano state date, e
questo feci con sollecitudine perchè avevo voglia che m’avanzava della stallia del noleggiato, andare fino
alla città del Chairo. Onde mi successe a proposito la ventura che il nostro Consolo aveva bisognio di
andare al Chairo per negozi attenenti alla dogana, a parlare al Bascià Signore di tutto l’Egitto, uno de’quatro
del Gran Turcho ; e perchè tutte le volte che il Consolo va al Chairo lontano miglia 150, è forzato fare una
buona spesa, perchè bisognia che vadi molto sontuoso, e meni buona corte : in pero, desiderando fuggire la
spesa, elesse mandare in suo canbio due inbasciatori. Volse che fussino Chimenti Grassi, cittadino
fiorentino allora in detto luogo, in compagnia di me Andrea Pitti : la quale inbascieria acciettai volentieri, e mi
messi a ordine con veste di drappo et altre apartenenze per mio uso, et cosi fece Chimenti Grassi. El
Consolo spese in ogni altra cosa che nel nostro vestire, e ci achomodo della sua credenziera d’argenti et
altre cose a proposito, dandoci dua turcimanni che avevanola lingua turchescha, greca et morescha. E più
ce dette quatro Giannizeri chavati dal castello d’Alessandria per la guardia delle nostre persone. E portamo
al Bascia un presente di ventiquatro tagli di drappo di più sorte con oro e senza oro per fare ventiquatro
veste, accio più facilmente si potessi ottenere la grazia che s’andava cercando. E a di VIII d’agosto ci partimo
d’Alessandria : camminando per terra, arivamo alla città del Rossetto lontana d’Alessandria XXXX miglia, la
quale città resiede in sur uno ramo del Nilo e quivi togliemo una barcha grossa per andare su per el fiume
del Nilo, il quale conduce al Chairo.
p. 32-33 :
« A di XXIIII d’agosto partimo dal detto luogo per tornare in Alessandria sopra la medesima barca che
eravamo venuti. Et perchè il Nilo era grosso et noi andavamo colla corrente alla china, fu il nostro ritorno più
facile, et cantando e sonando tronbe, ci fu fatto li medesimi onori a quelli casali medesimi che allonsù,
venendoci in contro donne et omini, donandoci assai cocomeri zucherini et d’una sorte, che sono dentro et
molto rinfreschono e’corpi e spengono l’ardore della sette.
A di XXVII detto arrivamo in Alessandria et referto tutto quello che s’era seguito al Consolo, il quale molto ci
ringrazio del nostro ben servito, e subito detti ordine alla spedizione per potere partire al primo vento che
fussi stato a proposito.
(p. 33) A di XXX detto, sendosi levato buon tenporale, facemo le debite di partenze col Consolo et altri nostri
amici, e particularmente con Benardo mio fratello et Chimenti Grassi insieme con noi ci partimo, et senza
tochare in luogho alcuno con prospero vento arivamo alla vista di Candia...
Troisième voyage : du 18 mars au 3 mai 1555.
p. 42-43 :
« A di XVIII detto arivamo in porto d’Alessandria, dove io attesi a rinvestire i danari che avevo portati in quelle
mercanzie che io era ubrigato secondo le concessioni, che la maggiore parte trovai in mano di Francesco
Biffoli, il quale me concedette mediante una lettera di Messina a lui presentata di Bernardo mio fratello come
inanzi s’é fatto menzione. E tutto feci con sollecitudine perchè volevo, del tempo che mi avanzava, ritornare
al Cairo dove ero stato il secondo viaggio. El quale disegnio mi venne fallito perchè in fra poche settimane
che eravamo arivati in Alessandria, se senti nuova come al Cairo cominciava la peste, e questo fu causa che
io conperai alcune cosette per me et per amici, per potere al primo tenporale buono partirci. E in
questotenpo conperai dua gatti pardi picoli et agevoli per recare al Duca Cosimo de’Medici mio Signore, et
mi costorono scudi cinquanta amendua, et conperai buona provisione di pollastri et piccioni per detti pardi,
che non mangiono se non carne cruda, et li messi in nave col mio garzone che le avessi buona cura, et io
stavo in Alessandria aspettando il tenpo a proposito, chè mi pareva mill’anni partire per il sospetto della
peste. Venne la nuova al Cairo moriva mille persone il giorno. In Alessandria si schoperse alcune case
appestate, onde sentendo questo, soldai tutti li mia conti, feci la dipartenza et montai i’nave, protestando al
padrone d’ogni danno et interesse, se lui non partiva al primo vento. Onde il padrone subito fece la solita
provisione di bischotto et aqua et altre cose a proposito et monto i’navi, et fecie comandamento a tutti e’sua
marinari che nessuno smontassi in terra a pena di non essere acciettati più i nave. El padrone et io soli
andamo nella città, e menamo la dona con quella puttina che noi (p. 43) avevomo conperata a Modone, et
condotta avanti il prete che ufizia la chiesa de’cristiani nel fondaco del nostro Consolo, et facemo battezare
la detta banbina e si li pose nome Marta, et dipoi ricondotta alla nave. Non stette molto che si fecie buon
tenpo per il nostro partire et a di III di maggio ci partimo di Alessandria senza portare con esso noi la lettera
della Sanità, perchè sendo la città infetta mal volentieri ci poteva essere fatta. Et caminando per parechi
giorni con prospero vento, avanti che noi fussimo alla vista de l’isola di Candia… »
- 242 - 244 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
DANIEL ECKLINS VON AROW (1553)
Ecklins von Arow, D., « Daniel Ecklins von Arow », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen
Lands, Francfort-sur-le-Main, 1584.
p. 401 :
« Quittant Candie, nous allâmes à Chypre en passant par Alexandrie. Après nous être reposés, nous
partîmes pour Chypre. Alexandrie est une grande et puissante ville qui se trouve en Afrique dans l’autre
partie du monde au bord de la mer Méditerranée entre Syrène et l’embouchure du grand fleuve Nil. Elle a
été construite par Alexandre le Grand qui y est enterré. Alexandrie est célèbre dans le monde parce que
c’est une bonne ville, j’étais content d’avoir eu l’occasion de la visiter. (On y trouve) toutes les épices
délicieuses et les parfums qui poussent en Inde ainsi que tout ce qu’on y fabrique comme des tissus en
soie ; on apporte toutes ces marchandises sur des navires par la mer Rouge en Égypte. À partir de la mer
Rouge, on les transporte sur une petite distance par voie de terre jusqu’au fleuve du Nil et sur le Nil jusqu’à
Alexandrie. Là, on les distribue dans tous les pays de Syrie, en Grèce, en Italie, en Espagne, en Allemagne
et en France.
On trouve dans cette ville de nombreux peuples qui habitent sur terre de l’Asie, de l’Afrique, de l’Europe. On
y voit beaucoup d’animaux, beaucoup d’oiseaux étranges et des (créatures) miraculeuses de la mer. Je
pourrais en raconter davantage, mais nous ne perdîmes pas beaucoup de temps ici ; c’est pourquoi, à
présent, je veux commencer à raconter mon récit de la traversée vers Chypre. »359
359 Traduction : K. Machinek.
- 245 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PELLEGRINO BROCARDI (1557)
Brocardi, P., « Relazione del Cairo di Messer Pellegrino Brocardi, 1557 », dans J. Morelli, Dissertazione
intorno ad alcuni viaggiatori eruditi veneziani poco noti, Venise, 1803.
Ce voyageur, que Jacopo Morelli croit être Vénitien, est certainement de Ligurie comme il est spécifié dans
son manuscrit conservé à Turin.360
p. 35-37 :
« Nous embarquâmes sur un navire raguséen et nous arrivâmes à Alexandrie en quatre jours ; là nous
trouvâmes les grandes galères. Il y a beaucoup à dire sur cette ville, je commencerai tout d’abord par le site.
Elle a deux très grands ports : le vieux port regarde vers l’ouest et le sud-ouest, il est protégé par trois
forteresses, dont deux sont aux angles de ce rempart de mur qui le protège et la troisième au milieu. Le
nouveau port est au nord. De part et d’autre de la baie se trouvent deux tours ; la plus grande s’appelle le
Farion, presque semblable à celui de Naples ; l’autre en face s’appelle Farbiello, ou château Saint-Marc. J’ai
relevé un croquis du premier port.
La ville a une longueur de deux milles, une largeur d’un demi-mille et un pourtour de cinq milles. Elle touche
les deux ports du côté sud-est. À un mille de la ville vers l’intérieur des terres il y a un très grand lac
navigable. À l’intérieur de la ville, près des murailles qui touchent le nouveau port, il y a une Aguglia debout,
et un autre (p. 36) démolie, à terre, avec des lettres égyptiennes. Hors de la “Porte du Poivre”, à un quart de
mille vers ledit lac en un lieu assez élevé se dresse la colonne Pompée, d’une grandeur remarquable ; je
n’en ai jamais vu de semblable ni de plus grande à Rome ou ailleurs ; elle est d’autant plus belle qu’elle n’a
pas une seule cassure à l’exception des feuilles du chapiteau corinthien, très érodées par le temps. Je vous
enverrai les mesures de celle-ci et de l’obélisque avec les autres dessins : l’une et l’autre sont en granit
rouge. Les rues de ladite ville sont très droites en toute direction ; et si elles n’étaient pas tellement abîmées,
elles seraient majestueuses à voir. Les murailles sont de double épaisseur et sont intactes, construites avec
une technique remarquable, agréables à voir, comme vous le verrez sur le dessin ; il y a des tours, plutôt
des palais, où habitaient ces seigneurs Mamelouks et d’où ils surveillaient la ville. Elle a de nombreuses
portes, mais elles sont fermées : ils n’en utilisent que trois : celle du Poivre, celle de Rosette, et la porte
Zizzil du côté de la mer du nouveau port. À trois mille de ces murailles, en mer en direction de Rosette, on
voit le château de Ptolémée.
Toute Alexandrie est fondée sur des colonnes entre lesquelles sont disposées des citernes d’eau qui se
remplissent à la crue du Nil arrivant par le Calese qui commence près de Fua, île de ce fleuve, fertile à toute
époque, et qui coule jusqu’à Alexandrie pour fournir l’eau à ces citernes au moyen d’égouts souterrains. On
boit cette eau toute l’année. Lorsque le Nil décroît, le canal est à sec, mais les citernes sont pleines d’eau.
Je ne dirai rien d’autre de la campagne car vous savez déjà très bien que c’était le grenier des Romains.
C’est une grande distraction de se promener à travers ces jardins et d’admirer tant de citronniers, de
cédrats, d’orangers et des palmiers. Les cassiers sont semblables aux noyers, et presque aussi grands, sauf
qu’ils sont plus (p. 37) clairs. Le cassier est toujours vert, il ne lui manque jamais ni fleurs, ni fruits, acides ou
mûrs, et j’ai vu le tout en une seule fois.
Il y a, dans ces jardins, une très belle chasse aux grives bien grasses pendant trois mois, c’est-à-dire
octobre, novembre et décembre ; à cette époque les dattes sont mûres. Les grives viennent par vol d’Afrique
en grand nombre, on en attrape une infinité. »361
360 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 299.
361 Traduction : C. Burri, N. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 246 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
QUṬB AL-DĪN AL-NAHRAWĀLĪ (1558)
Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī, Journey to the Sublime Porte. The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s
Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the Magnificent. The Relevant Text
from Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī’s al-Fawā’id al-sanīyah fī al-riḥlah al-Madanīyah wa al-Rūmīyah, par
R. Blackburn, Beyrouth, 2005.
Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī naît en 1511-1512 en Inde, probablement à Nahrawālah (Patan, à l’ouest de l’Inde)
et meurt en 1582 à La Mecque, mais il est d’origine arabe. Sa famille s’était établie en Inde au XIIIe siècle.
Après avoir étudié dans son pays natal, au Hedjaz, en Égypte et en Turquie, il se fixe à La Mecque. Sa
bonne connaissance du persan et du turc lui vaut l'amitié des responsables ottomans qui le nomment mufti
de La Mecque avant de le porter à la tête du nouveau Collège hanbalite dont on vient d'ordonner la création
en 1567. Entre temps, Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī dirige une mission à la cour ottomane à Istanbul. Il quitte
La Mecque en octobre 1557, et à son retour il passe par l’Égypte en 1558. Le but de cette ambassade est
de dénoncer un certain Deli Pīrī qui a dégainé une arme dans le sanctuaire du Prophète. Quṭb al-Dīn
al-Nahrawālī a pour mission de demander le retrait de Deli Pīrī et de ses troupes de la ville de Médine, mais
le sultan refuse.
En tant que savant, il est l'auteur d'un vaste index des savants de l’école hanafite, d'un recueil de hadith et
de plusieurs travaux historiques l'un sur l'histoire de La Mecque et le second sur la conquête du Yémen par
les Ottomans.362
Remarque : traduction d’après le manuscrit arabe inséré dans l’édition citée ci-dessus.
p. 158b-159a :
« Le samedi 1er ramaḍān363, nous arrivâmes à Alexandrie. Les Alexandrins dirent qu’ils virent la nouvelle
lune de ramaḍān la nuit du vendredi. C’est une ville magnifique, bâtie de marbre splendide, mais elle est en
ruine. Ses constructions occupent moins d’un dixième (de la ville). Ses merveilles sont évoquées dans les
Histoires. (Le monument) le plus merveilleux qui subsiste jusqu’à maintenant est la colonne des colonnes.
C’est une colonne haute, comme le phare, d’une seule pièce de marbre. On dit qu’elle fut transportée à
Istanbul pour les constructions de Sulaymān. (Une colonne) identique fut transportée à Ḥimṣ pour laquelle
on dépensa beaucoup d’argent. Dans l’Histoire de Maqrīzī, la colonne des colonnes est une des quatre
colonnes qui portaient au-dessus une haute construction pour préserver les livres des Grecs et de Sagesse
antérieurs à l’Islam. Mais cette construction fut détruite et changea de place. Il ne reste que cette colonne
qu’on appelle colonne des colonnes à cause de sa hauteur.
Poème
À Alexandrie, je rencontrai le cheikh Barakāt b. Ḫayr al-Dīn, savant d’Alexandrie et un de ses transmetteurs ;
il me fit honneur, me donna l’hospitalité et me reçut bien – Que Dieu le Puissant le récompense de la
meilleure façon sans reproche ! Parmi ses marchands, Al-Ḫawaǧa Sa`īd b. al-Ḥaḍariyya al-Maġribī me fit
honneur, me donna l’hospitalité et me reçut bien – Que Dieu-le-Puissant le récompense ! Je vis le cadi
Yaḥyā Afandī, fils de la soeur du défunt `Abd al-Qādar Afandī, le cadi de La Mecque la Magnifique et de
Miṣr ; il mourut à Miṣr en 954364. Ce cadi me connaissait de l’époque où il était à La Mecque avec son oncle
maternelle. Il me fit honneur et me donna l’hospitalité – Que Dieu-le-Puissant le récompense bien !
J’observai qu’Alexandrie avait plus de ruines composées de nombreuses colonnes que lorsque je l’avais
précédemment connue ; j’étais passé à Alexandrie pour me rendre à Rūm en 943365 accompagné de `Umdat
al-Malik, ministre du défunt sultan Bahādur, seigneur de Kuǧarat – Que Dieu-le-Puissant leur accorde sa
miséricorde ! Parmi mes compagnons, il y avait à cette époque notre mollah, le cheikh Nūr al-Dīn al-`Usaylī,
un des nobles oulémas et fils célèbres de Miṣr. Nous marchions à cette époque dans l’ennui de la jeunesse
et nous cueillions le fruit de la vieillesse avec nos mains : ce fruit est la maturité de la vie savoureuse. Que
Dieu chérisse ce temps ! Que Dieu pardonne nos fautes et nos actions de grâce !
Poème
(p. 159a) Le dimanche après-midi 3 ramaḍān366, nous partîmes d’Alexandrie et nous voyageâmes toute la
nuit jusqu’à arriver en fin de matinée le lundi 4 ramaḍān à Rosette. »367
362 Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī, Journey to the Sublime Porte. The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s
Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the Magnificent. The Relevant Text
from Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī’s al-Fawā’id al-sanīyah fī al-riḥlah al-Madanīyah wa al-Rūmīyah, Introduction,
traduction et annotations par R. Blackburn, Beyrouth, 2005, p. XI-XVI.
363 En 965, c’est-à-dire le 17 juin 1558.
364 1547-1548.
365 1536-1537.
366 965, c’est-à-dire le 19 juin 1558.
367 Traduction : S. Renaud, O. Sennoune, H. Zyad.
- 247 - 248 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BASILE POSNIAKOFF (1558)
Posniakoff, B., « Le pèlerinage du marchand Basile Posniakoff aux Lieux saints de l’Orient, 1558-1561 »,
dans S. P. Khitrovo (éd.), Itinéraires russes en Orient, Genève, 1889.
p. 288-290 :
« En 1558, le marchand russe Basile Posniakoff, l'archidiacre Guénnade de Novgorod et Côme Saltanoff,
bourgeois de Peskov, trois pèlerins arrivèrent à Alexandrie chargés d'un message du Tzar Ivan le Terrible
pour le patriarche grec Joachim. Ce dernier les reçut dans sa demeure, fit apporter des sièges pour ses
visiteurs, car, affirma Posniakoff, « il n'y a pas de bancs le long de sa chambre et le milieu est recouvert de
tapis de soie. » Le patriarche se plaignit des persécutions qu'il subissait de la part des Turcs, et annonça aux
trois Russes :
« Il est écrit dans nos livres grecs qu'un roi viendra des contrées orthodoxes de l'Orient et que Dieu lui
soumettra bien des royaumes, et que son nom sera célèbre de l'Orient à l'Occident comme celui
d'Alexandre, roi de Macédoine, dans l'Antiquité ; il montera sur le trône de la ville souveraine et nous serons
délivrés par sa main des Turcs impies. »
- 249 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GRAFEN ALBRECHT VON LÖWENSTEIN (du 6 janvier au 17 févier 1562)
Löwenstein, G. A. von, « Grafen Albrecht von Löwenstein », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz
heyligen Lands, Francfort-sur-le-Main, 1584.
Il voyage en compagnie de Jacob Wormbser (voir infra).
p. 200b-205b :
« 21 décembre
La peste à Alexandrie
Nous nous réveillâmes vers trois heures avant le jour et nous avançâmes de cinq milles jusqu’au Caire où
nous arrivâmes à deux heures de l’après-midi. Là nous apprîmes de mauvaises nouvelles : l’épidémie [de
peste] s’était entre-temps répandue à Alexandrie de sortes que plusieurs marchands chrétiens moururent. À
cause de cela les marchands furent tous retenus. Aucun bateau, ni aucune marchandise ne partaient vers la
chrétienté, et aucun bateau n’arrivait également. On les avait mis au courant de l’épidémie.
6 janvier
Comment nous fûmes emprisonnés et ensuite libérés
Le mardi matin, nous arrivâmes à Rosette et nous avançâmes encore au-delà de la porte en direction
d’Alexandrie. En arrivant de l’autre côté de l’eau, entre Rosette et Alexandrie, notre janissaire se querella
avec un Arabe et le blessa mortellement avec son sabre car il avait été escroqué. Nous eûmes très peur
d’être capturés ; nous en étions conscients à chaque instant.
Mercredi, nous arrivâmes de bonne heure à Alexandrie. La veille cinquante personnes y étaient mortes et
trente-cinq ce jour-là, aussi nous ne sortîmes pas beaucoup pour visiter.
8 janvier au 6 février
Les pèlerins sont accusés et emprisonnés
Les pèlerins sont mis au carcan
La fidélité du consul français
Les pèlerins sont emprisonnés de nouveau
Le consul français n’agit pas très honnêtement
Les pèlerins sont amenés d’Alexandrie au Caire
Les pèlerins sont un peu réconfortés au Caire
Les pèlerins sont visités et volés en prison
Les pèlerins sont de nouveaux libérés de la prison
15 février
Le dimanche matin nous arrivâmes à Alexandrie et nous prîmes nos dispositions, car une nave voulait partir
sans tarder vers Ancône.
16 février
Nous, à savoir moi-même, Sigmund Rumpff, Reinsprecht de Gleinitz et Jacob Wormser, terminâmes nos
préparatifs. Nous dûmes encore emprunter trois cent cinquante couronnes pour contenter tout le monde.
Nous embarquâmes vers le soir sur le bateau dont le patron s’appelait Angelo Pico qui était d’Ancône. De
Thuringe ne voulut pas partir avec nous parce que notre nave était petite. Il resta pour attendre une autre
nave plus grande qui partait huit à dix jours après. Cependant, je craignais tout le temps qu’ils nous
cherchent noise à nouveau, aussi je ne voulais pas attendre davantage, car c’était surtout moi qui fut trahi.
Enfin nous nous rendîmes compte aussi de la friponnerie du consul français, car il exigea que l’on donne
trente six couronnes à l’un des Juifs, son trucheman, que le Zausch avait au début enchaîné avec nous.
Lorsque nous nous excusâmes disant que nous ne lui devons rien et n’étions au courant de rien, il répondit
que l’interprète avait été emprisonné à cause de nous. Aussi, s’il voulait être libéré il devait donner tant de
couronnes au Zausch. Or pour être tranquilles et éviter d’autres tracas, nous étions obligés de payer et de
donner huit autres couronnes au consul. Nous n’étions pas du tout au courant de tout cela, sinon nous ne
serions pas retournés à Alexandrie ce jour-là, mais nous serions partis vers Chypre et n’aurions rien eu à
payer.
17 février
Le matin vers huit heures, au nom de Dieu, nous quittâmes joyeusement le port d’Alexandrie, toutes voiles
déployées.
Pèlerinage à Alexandrie, une ville d’Égypte
À Alexandrie, on voit l’endroit où sainte Catherine fut décapitée et martyrisée. Idem on voit l’endroit où saint
Marc l’Evangéliste célébrait la messe le lundi de Pâques quand les mécréants lui jetèrent une corde autour
du cou et le traînèrent sur le sol jusqu’à “Jacabucchi” près de la mer sous un rocher. Là il fut martyrisé et
enterré. Idem à Alexandrie on voit l’endroit où saint Jean l’Aumônier mourut et fut enterré. »368
368 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 250 - 251 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACOB WORMBSER (du 6 janvier au 17 février 1562)
Wormbser, J., « Jacob Wormbser », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Jacob Wormbser voyage en compagnie de Löwenstein (voir supra).
p. 228-231 :
« L’entrée dans la ville d’Alexandrie. Nous entrâmes alors dans la ville et sous les portes se trouvaient des
Juifs qui exigèrent des taxes et qui nous rançonnèrent pour la douane ; nous arrivâmes ainsi le sixième jour
de l’année 62. La peste sévissait terriblement dans cette ville et nous entendîmes dans les maisons de
grands cris de lamentation à cause des morts, ce qui était pitoyable à entendre. Nous vîmes également des
bières arrêtées devant les maisons, mettant le comble à notre horreur et à notre épouvante. Nous logeâmes
dans la maison d’un marchand allemand qui habitait Le Caire ; il nous avait donné la clé de sa maison, car à
ce moment-là personne n’y habitait, sauf un chrétien de la foi de saint Thomas qui logeait à côté. Puis
vinrent les Juifs qui regardèrent tout ce que nous avions acheté au Caire et enregistrèrent pièce par pièce
les droits de douanes à prélever, ensuite ils scellèrent les coffres avec leur sceau et ainsi ce jour-là nous ne
sortîmes point et nous ne pensions pas qu’il y aurait des suites à propos du More que notre Janissaire avait
frappé la nuit précédente.
Les pèlerins négocient avec le patron au sujet du retour à Venise. Le sept janvier, de bonne heure, Albrecht
von Lowenstein et Sigmund Rumpff von Walross, gentilhomme carinthien, s’en allèrent à la nave pour
négocier avec le patron afin qu’il nous conduise à Venise, et moi-même Jacob Wormbser et Reinprecht
Glinitz zu Glinitzenstein, également gentilhomme carinthien, allâmes à la douane pour contenter les Juifs au
sujet de leurs taxes, conformément à tout ce qu’ils avaient noté la veille. Le pèlerin Adam von Thoringen
zum Stein resta seul à la maison avec un domestique. Lorsque que nous fûmes tous sortis, des parents de
la victime avec des représentants de la justice, pensant nous y trouver tous, firent irruption dans la maison,
faisant prisonnier le dit von Thoringen dans l’intention de l’amener au sandjak.
Les pèlerins doivent comparaître devant la justice à cause du More blessé
Les pèlerins sont emprisonnés
Les pèlerins sont emmenés dans une autre prison
Le More blessé meurt
On règle l’affaire des pèlerins
Colonne Pompée. Nous allâmes nous promener une journée à l’extérieur de la ville pour visiter une belle
colonne qui est appelée la colonne Pompée, et, au-dessous de laquelle est enterré le corps de Pompée.
C’est une belle colonne, très haute et très épaisse, qui est considérée comme l’une des sept merveilles du
monde.
Prison de sainte Catherine. Ensuite nous visitâmes beaucoup de jolis jardins et nous vîmes l’endroit où
arrive le Nil avant de s’écouler dans la ville pour remplir d’eau tous les endroits prévus. Après cela nous
retournâmes à la ville et nous visitâmes la prison de la vierge sainte Catherine ; il y avait là deux belles
colonnes de marbre sur lesquelles elle fut martyrisée avant d’être posée sur une roue. Ensuite nous vîmes
plusieurs colonnes carrées gravées de signes égyptiens très étranges à voir, des oiseaux, des animaux et
d’autres choses. Après cela nous retournâmes à notre auberge. Le Turc, un chrétien renégat, nous avait
accompagné et nous avait montré tout ce qui est décrit ci-dessus, il nous invita aussi dans sa maison, ce
que nous acceptâmes. En arrivant chez lui il avait préparé un banquet turc, nous mangeâmes et nous
redevînmes joyeux. Puis nous prîmes congé et le remerciâmes pour la peine et la fatigue que nous lui
avions données. Nous retournâmes à notre auberge et nous fîmes de nouveaux préparatifs pour embarquer
sur le bateau. Tôt le matin, nous prîmes le Juif, qui était notre interprète, et le Zausch, et nous sortîmes de la
ville jusqu’au port. On exigea de chacun d’entre nous une couronne mais nous dîmes que nous étions des
pèlerins venus de Jérusalem et nous convînmes d’un marché finalement pour qu’ils se contentent de trois
couronnes, sans compter les autres taxes que nous devions payer pour nos bagages. Nous allâmes sur la
nave en pensant être débarrassés de tous nos ennuis et chacun sur le bateau se réjouit avec nous ; le
patron nous indiqua notre place pour mettre nos bagages et pour dormir.
Les pèlerins se préparent au voyage du retour. Nous fîmes alors nos préparatifs et nous déjeunâmes. Nous
nous démenâmes pour faire le voyage dans de bonnes conditions. Après le repas, nous rassemblâmes nos
affaires dans un coin et nous nous installâmes confortablement. Le patron n’était pas sur le bateau, mais en
ville, il revint le soir accompagné du domestique du sandjak qui nous redemanda de comparaître devant le
sandjak. Le patron nous affirmait que ce n’était rien et que le chef des douanes voulait avoir également de
l’argent et qu’il suffisait que deux d’entre nous y aillent. Alors quatre d’entre nous allèrent en ville et le
cinquième resta sur le bateau.
Les pèlerins ont de nouveaux démêlés
Le sandjak fait mettre des chaînes aux pèlerins et les fait emmener au Caire
Le consul français trahit aussi les pèlerins
Les pèlerins sont emmenés enchaînés au Caire
Les pèlerins doivent racheter leur liberté
Les pèlerins arrivent de nouveau à Alexandrie. Nous arrivâmes à Alexandrie où des gens mouraient encore.
Nous fûmes hébergés par le consul qui nous garda pendant notre séjour et nous rassemblâmes nos
bagages à un endroit. En plus de l’argent déjà emprunté au Caire et ailleurs, nous en empruntâmes de
nouveau pour payer notre retour sur la nave.
Le lundi 16 février de l’année 62, nous allâmes sur la nave car nous craignîmes de devoir payer ou de nous
faire extorquer encore beaucoup d’argent, ce qui n’arriva pas. On nous laissa partir sans nous faire d’autres
ennuis car par l’intermédiaire de notre interprète, nous avions fait voir la lettre du pacha du Caire et celle du
sandjak d’Alexandrie et ils ne nous demandèrent plus rien. Toutefois, les Juifs nous importunèrent ; nous
dûmes encore leur verser trente-huit couronnes bien qu’avant dans toute notre affaire, ils furent plutôt avec
nous que contre nous. Que Dieu le leur rende !
Les pèlerins quittent le rivage d’Alexandrie. Le 17 février, le matin de bonne heure, notre patron déploya les
voiles bien que le vent ne fût point bon pour nous. Mais le patron craignait qu’on nous rançonnât davantage,
lui et nous, car un Zausch était venu du Caire. Pour cette raison, au nom de Dieu, nous partîmes et nous
fûmes joyeux d’avoir échappé aux mains des tyrans. Mais notre joie se transforma bientôt en désarroi car le
patron dirigea la nave à un endroit où il pensait attendre jusqu’à ce que nous eussions de nouveau un bon
vent. En y arrivant, le timon s’enfonça dans le sable de sorte que le bateau se mit fortement à craquer
comme si tout allait se briser. Aussi chacun eut très peur et le patron leva les mains au ciel, ce qui ne nous
rassura pas. Nous étions à peine sortis d’une aventure cruelle que déjà nous devions affronter un grand
malheur. Nous pensions en effet qu’il serait impossible d’en réchapper tant ce fut violent. Mais l’intérieur du
bateau ne fut pas endommagé ; le timon ou le gouvernail arrière, qui avait heurté le sable, s’était brisé et
nous louâmes Dieu. Cependant, ce même jour et durant la nuit, nous fûmes malades de peur à cause de la
violence de la mer. Une si cruelle frayeur ne fut pas oubliée de sitôt. »369
369 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 252 - 253 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LUIGI VULCANO DELLA PADULA (1563)
Vulcano Della Padula, L., Vera et nuova descrittione di tutta Terra Sancta, et peregrinaggio del sacro monte
Sinai, compilata da verissimi autori, Naples, 1563.
Luigi Vulcano, originaire de Padula et frère de l’Ordre mineur de saint François, est théologien et
prédicateur.370
p. 188a-189 :
Brève description de l’Égypte
« De la ville d’Alexandrie. La première ville qu’on rencontre en Egypte est Alexandrie qui était très noble
dans l’Antiquité et aussi très grande comme le montre ses ruines qui sont construites du côté de la Libye, au
bord de la solitude de l’arène.
Hors des forteresses de la ville, vers l’occident, il y a le désert (Aride) où l’on ne peut ni semer, ni cultiver.
Cette ville est le Diocèse de toute l’Égypte.
Les anciennes histoires racontent qu’elle fut construite par Alexandre le Macédonien, fils de Philippe à
laquelle il donna son nom.
Jules Salin raconte qu’elle fut fondée au cours de la cent douzième Olympiade. Elle est située près de la
partie du Nil appelée Heracleoticon ou canopicon. Aujourd’hui on l’appelle Rosette et elle est à six milles de
la 5e branche du Nil ; néanmoins certaines de ces branches inondent la ville durant la saison où le niveau de
l’eau se lève et remplissent abondamment d’eau les citernes construites à tel effet ; cette eau sert pendant
toute l’année. Lorsque les réservoirs sont pleins, on arrose les jardins qui entourent la ville aux moyens de
canaux.
Cette ville est très commode pour faire du commerce, elle possède deux ports séparés par un morceau de
terre en forme de langue étroite ayant au bout une tour très haute appelée le phare, qui fut édifiée par Jules
César qui la retenait nécessaire.
Les marchandises nécessaires à la ville y arrivent en abondance de la haute Egypte par le Nil.
Ici arrivent des marchandises de toutes sortes, des épices, des pierres précieuses, et toutes autres choses
dont notre monde a besoin. Ces marchandises arrivent des Indes de Sabba, d’Arabie, des Éthiopies, de
Perse et de toutes ces provinces voisines car elles arrivent par la mer Rouge à un endroit appelé Aideb situé
sur le bord de mer, et de là elles arrivent ensuite par le Nil. Les marchands orientaux et occidentaux se
rencontrent ici pour négocier (entre les marchands orientaux et occidentaux, il y a une concurrence pour les
marchandises).
Dans cette ville, se trouve le patriarcat de Saint-Jean l’Aumônier sur lequel on lit beaucoup sur la vie des
Saints Pères. Il mourut ici et fut enseveli mais aujourd’hui cette église a été transformée en mosquée par les
Sarrasins malgré la présence des chrétiens. Les évêques S Atanasio et Cirillo vécurent ici et y furent
ensevelis.
Au centre de la ville, on aperçoit une pierre sphérique sur laquelle, dit-on, saint Marc l’évangéliste vola vers
le royaume céleste. On voit aussi l’endroit où il célébra la messe de Pâques ; ce jour-là, les païens lui mirent
une corde au cou et le traînèrent jusqu’à un lieu appelé Buccoli qui se trouve près de la mer où sous certains
rochers, il fut martyrisé et enterré. À cet endroit, les chrétiens construisirent une église en son honneur.
Près de la place, on voit la prison où l’empereur Massentio enferma l’épouse du Christ et Martyre Catherine ;
dans cette prison il y a une roche où il y a un trou dans lequel fut fixé le fer de la roue sur laquelle fut
étendue et torturée la vierge Catherine. À un mille d’ici, il y a une autre pierre posée sur une colonne érigée
en son honneur, sur laquelle décolla son esprit heureux vers les cieux.
Dans ce même endroit furent brûlés les deux cents philosophes, dont “Porfirio” et ses compagnons, qui, en
compagnie de la vierge Catherine, méprisant la vie terrestre, achetèrent la vie éternelle au nom du Christ.
Ici on voit les ruines de beaucoup de monastères, comme celui de Saint-Maccarios, de Saint-Saba et
d’autres dans lesquels, dit-on, l’Évangéliste saint Marc avait l’habitude de prêcher.
Cette ville fut assiégée par Almarico, roi de Jérusalem, au cours de la 4e année de son règne, en 1156. Mais
après plusieurs batailles, il fit la paix avec le sultan.
À cause de son ancienneté et des ruines qui existent autant sous la terre qu’au-dessus, j’aurais pû raconter
beaucoup d’autres choses sur cette noble ville mais je m’arrêterai ici. »371
370 Minieri Riccio, C., Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Naples, 1844, p. 187.
371 Traduction : Z. Hamza (archives Sauneron, Ifao).
- 254 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHRISTOPH VON HAIMENDORF FÜRERI (du 17 août au 6 septembre 1565)
Haimendorf Füreri, Ch. von, Itinerarium Ægypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae Aliarumque regionum
Orientalium, Nuremberg, 1621.
p. 5-14 :
« Le 17 août, nous arrivâmes à Alexandrie ; elle a été fondée par Alexandre de Macédoine qui lui a donné
son nom. Cette ville, d’après Ammien Marcellin, fut la plus merveilleuse des cités, elle que rendirent célèbre
les munificences de son fondateur et le génie de l’architecte Dinocrate. Comme ce dernier traçait les belles
et amples murailles de la ville, la chaux vint à lui faire défaut, ce dont il ne fit pas grand cas ; il continua le
tracé des remparts avec de la farine : cet incident fortuit présage l’abondance des vivres qui devaient par la
suite affluer dans la cité. À propos de cet architecte au génie remarquable à divers titres, Pline rapporte
encore qu’il avait tracé le plan de la ville sur un espace de quinze pas en lui donnant la forme circulaire
d’une chlamyde macédonienne frangée sur les bords, avec des saillies anguleuses à droite et à gauche.
Justin écrit que, bien qu’on ait construit un mur de six mille pas, la ville fut achevée en dix-sept jours.
Marcellin traite encore de la douceur de son climat : « Une brise salubre souffle ici. Le climat est doux et
clément et, comme l’expérience accumulée au cours des âges l’a montré, presque jamais les habitants de la
ville ne voient un jour sans clair soleil ». Par ces mots, Marcellin a voulu souligner la rareté des pluies dans
cette région. De cela, nous parlerons plus loin.
(p. 6) Voici le plus digne d’être vu aujourd’hui : d’abord la grande citadelle, assez solide, occupée par une
garnison. Elle fut élevée par le sultan Caizbeck en l’année 1475, en dehors de la ville, à droite du nouveau
port, sur une roche marine ; elle est de plan quadrangulaire et est reliée d’un côté assez légèrement à la
terre. Aux temps anciens, il y avait là une île fortifiée d’une muraille assez solide et d’une tour. Aujourd’hui,
cette tour est appelée la tour du Phare. Autrefois, c’était l’île qui était appelée Phare, bien que la tour à cette
époque portât également ce nom, comme en témoigne Marcellin. Celui-ci raconte qu’elle avait été élevée
par Cléopâtre pour que sa lumière guide de nuit la marche des navires, pour les mettre en garde contre les
écueils et pour leur indiquer l’entrée du port. Cette coutume est observée aujourd’hui encore, toutes les
nuits, avec un soin extrême. Flavius Joseph affirme que ses feux étaient visibles jusqu’à trois cents stades.
Du côté opposé au Phare se trouve le vieux port, commode encore et vaste, mais très inférieur cependant
au nouveau et par le dessin et par la grandeur. Il est embelli d’édifices qui l’entourent en forme de
circonférence. Les deux ports sont séparés par une sorte de bras de mer. Au bord de la mer, on a élevé des
boutiques de marchands. Entre elles et la grande citadelle du nouveau port se dresse un autre fort
désaffecté, qu’on appelle tour de la lance.
La ville elle-même est assez vaste, plus longue que large, sise sur un terrain plat et sablonneux. Du côté de
la terre, elle est ceinte d’une muraille double, mais du côté de la mer, d’une muraille simple. Cependant,
outre deux cent soixante tours carrées grandes et solides, elle est bordée d’un fossé creusé sans grande
profondeur qui n’est renforcé d’aucun talus.
La ville a trois portes, la nouvelle, l’ancienne et une troisième par laquelle on se rend à la bouche canopique
du Nil. Le sous-sol de la ville est presque entièrement creusé, comme en témoigne César à propos de la
guerre d’Alexandrie. Il y a de nombreux (p. 7) aqueducs sur lesquels se trouvent des citernes publiques, plus
ou moins grandes au nombre de trois cents. Outre ces citernes, presque chaque maison possède la sienne
propre. Elles sont remplies par l’eau qui vient des aqueducs et surtout par celle qu’apporte un fossé creusé
près du vieux port. Ce fossé reçoit l’eau du Nil par un long canal d’environ 60 milles appelé Calés. Il y a en
outre des égouts, distincts des aqueducs, par lesquels les ordures de la ville s’écoulent dans la mer. À ce
propos, les Saintes Ecritures y font allusion dans les prophéties de Nahum où il est dit qu’Alexandrie est à
côté des fleuves et que les eaux l’entourent, ou encore, que la mer est sa richesse et que les eaux protègent
la ville comme un rempart. Aujourd’hui, la ville a subi bien des ravages ; elle est ruinée en grande partie. Au
centre seulement et près des ports se trouvent quelques rues mais sans grande beauté. Autrefois, à ce qu’il
semble, elle a eu des rues bien tracées parallèlement, non seulement larges mais d’une si grande longueur
que d’une extrémité l’on n’en pouvait voir l’autre bout. Les citernes dont j’ai parlé sont faites de briques
cuites. Elles sont voûtées et soutenues, pour la plupart, par six colonnes. Les marchands chrétiens habitent
les plus grandes maisons de la ville. Les étrangers ont coutume de loger soit dans les bâtiments du
représentant du roi de France soit dans ceux des Vénitiens. Là pour quatre « bacies » par jour, on vit assez
somptueusement. L’intérieur des maisons est assez beau et seul le rez-de-chaussée est destiné à
l’habitation. Au centre des bâtiments se trouve une cour quadrangulaire sur laquelle donnent les pièces aux
usages divers. Elles restent toutes ouvertes, sauf les chambres à coucher, et sont en général pavées de
marbre aux couleurs variées. Rares sont les fenêtres, mais à la partie supérieure de la maison, il y a une
grande ouverture par laquelle chaque pièce reçoit la lumière. Dans la pièce où l’on mange, certains
possèdent une sorte de cheminée (p. 8) par où l’on reçoit l’air et la fraîcheur. Les toits ne sont pas de tuiles,
mais forment des terrasses pavées et dallées.
Il y a beaucoup d’églises pavées de marbre et ornées de colonnes élégantes, mais, elles ont aujourd’hui
presque toutes été transformées en mosquées turques par cette race impie. Entre toutes brille celle qu’on
appelle église de Saint-Jean l’Aumônier. Elle était autrefois le siège de l’évêque. Des portiques l’entourent,
avec un double rang de colonnes en bas et un quadruple rang en haut. Sa longueur est de
quatre-vingt-treize pas et sa largeur de quatre-vingt-huit. Le sommet de la partie médiane est découvert et il
y a peu de fenêtres ; leurs chancels sont faits d’airain de cet admirable et célèbre colosse du soleil de
Rhodes, oeuvre de Charès Lydius, disciple de Lysippe, dont la hauteur est de soixante-dix coudées. Cette
statue, selon le témoignage de Pline, renversée cinquante-sept ans après un tremblement de terre, était
considérée comme une chose étonnante même lorsqu’il gisait au sol. Dans cette église sont ensevelis Jean
l’Aumônier, le divin Athanase, auteur du fameux symbole : “Quiconque veut être sauvé...”, ainsi que saint
Cyrille. Non loin de là se trouve une pierre ronde de couleur rouge, sur laquelle, dit-on, fut exécuté saint
Marc l’évangéliste, parce qu’il avait enseigné la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le septième jour des
calendes de mai, la huitième année du règne de Néron. Les habitants se plaignent amèrement que son
corps, enterré d’abord hors de la ville, fût déterré par les Vénitiens et emporté par eux dans leur propre cité.
Dans la même rue où l’on montre cette pierre de saint Marc, nous vîmes les ruines d’un palais bâti en
briques cuites : on veut persuader le peuple que c’est celui du roi Costa, père de sainte Catherine vierge qui,
dit-on, attesta sa foi au Christ en versant son sang, sous l’empereur Maxence, aux environs de l’an trois cent
dix. Mais les personnes qui ont un peu de culture historique savent que la chose s’est passée autrement.
(p. 9) Dans la ville, les chrétiens que l’on appelle Coptes ou Jacobites ont encore trois églises : Saint-Saba,
qui n’est pas très grande, où l’on montre le siège sur lequel saint Marc fit ses prédications, Saint-Marc et
Saint-Michel, où Jean comte de Solms, mort le premier novembre 1483, fut enseveli. En dehors de la ville, il
y en a seulement une, dédiée à Saint-Georges, près du petit fort à côté du nouveau port, au lieu où
autrefois, rappelle-t-on, saint Athanase se sauva des embûches et des persécutions de l’empereur Valens,
en se cachant dans une citerne. Les fidèles observent presque le rite grec, mais ils se servent d’une langue
qui leur est propre, écrite en caractères grecs, et qu’on appelle copte, dont la traduction arabe se trouve visà-
vis dans les livres. Dans cette ville, il y eut la bibliothèque fameuse de Ptolémée Philadelphe, contenant
sept cent mille volumes, comme l’atteste Marcellin sur la foi de documents anciens. Là, vécurent les
Septante qui traduisirent en grec la sainte Bible.
Parmi les autres édifices connus de la ville se trouve encore le bureau de perceptions des impôts, près de la
porte du nouveau port, bâtiment de forme carrée et entouré d’un mur. C’est là que les marchands payent
l’impôt que le sultan turc a coutume d’affermer aux Juifs pour une très forte somme. Non loin de là, il y a une
rue étroite et couverte, appelé bazar, c’est-à-dire un marché couvert où l’on expose, pour les vendre, des
marchandises de tout genre. Presque tous les marchands habitent cette rue, ou du moins dans ses
environs.
Près de l’autre partie de la ville qui regarde le port ancien, se trouve une tour sur laquelle on monte la garde.
Non loin d’elle, il y en a deux autres très grandes et solides, qui se font (p. 10) vis-à-vis pour défendre le
vieux port. À gauche de là, se dresse une autre tour, très puissante et ceinte d’une muraille comme une
forteresse et un peu plus haut une autre encore. On les appelle tour de César et une garnison de Janissaire
les occupe. Autrefois, en ce lieu, rappelle-t-on, s’élevait le palais royal des Ptolémées, dont on voit encore
trois colonnes et le théâtre. Il y a là aujourd’hui une mosquée et un très bel hôpital.
Or les habitants possèdent encore des salines dignes de mention. Ils amènent l’eau provenant du canal
appelé Calés dans de vastes mares et ils la gardent là pendant l’hiver, en attendant que pendant l’été sous
la chaleur du soleil, l’eau s’évapore et laisse un résidu solide, croûte durcie de l’épaisseur de trois doigts
qu’ils détachent comme de la glace et qu’ils transportent en ville sur des ânes. Tout autour de la ville, la terre
est couverte d’arbres remarquables. Le plus commun est le palmier. C’est un arbre d’une grande hauteur.
Au sommet du tronc s’ouvre un éventail de feuilles très longues qui retombent. À l’intérieur de ces feuilles se
trouvent des fleurs nombreuses, suspendues à des tiges tenues à la façon d’une grande grappe. De ces
fleurs naîtront les dattes qui mûrissent au début de l’automne, au mois de septembre. De la nature
étonnante de cet arbre, voici comment parle A. Gellius, d’après Aristote et Plutarque : « Si l’on place sur le
bois de palmier de lourds fardeaux et que le poids soit si excessif qu’il ne puisse le supporter, la branche de
palmier ni ne se brise, ni ne fléchit vers le sol, mais son élasticité la pousse à se redresser pour repousser
son fardeau ». On dit aussi que les palmiers s’accouplent car ils sont de sexe opposé (on peut facilement le
remarquer !) et ressentent l’attirance mutuelle de l’amour. À ce sujet, comme au sujet d’autres propriétés de
cet arbre, Pline et d’après lui Marcellin racontent des choses étonnantes. Le cassier que l’on dit laxatif
pousse également ici de même que les pommes d’or de Perse, de Carthage, c’est-à-dire des grenades et
les citrons, en grande quantité. De même pousse une plante, (p. 11) appelée Viscus, d’où, selon l’affirmation
de Pline, provient une glue, qui, mêlée à de l’huile de noix, est capable de retenir les ailes des oiseaux qui
se collent au toucher si on veut les prendre au piège. Puis il y a le caroubier ou Silique dont le fruit, la
caroube, est ligneux et courbé en forme de faux de la longueur d’un doigt et de la largeur du pouce. De
même il y a le Musa et l’Alcanna, c’est-à-dire le troène égyptien : ses feuilles broyées produisent une teinture
rouge dont les Turcs teignent leurs chevaux.
Parmi les monuments de l’Antiquité, il y a deux obélisques à proximité de cette partie des remparts par où
l’on va au nouveau port. L’un gît brisé sur le sol, mais le second est dressé et intact, (près de là autrefois, diton,
se trouvait le palais royal dont les ruines actuelles attestent l’ancienne magnificence) ; il est enfoui sur la
moitié de sa hauteur par la terre et les décombres ; l’autre moitié du fût dépasse le sol de onze palmes. Il est
gravé de hiéroglyphes, c’est-à-dire de lettres égyptiennes. Il y a une excellente description de ces
obélisques dans Ammien Marcellin : « L’obélisque est une pierre dure, de la forme d’une borne de champ de
course ; il s’élève insensiblement à une grande hauteur en s’amincissant petit à petit comme un rayon, mais
garde un plan carré jusqu’à son sommet pointu ; il est poli par le travail de l’ouvrier. Les caractères
innombrables, appelés hiéroglyphes, que nous y voyons incisés de toutes parts, portent la marque de
l’antique prestige de la sagesse des premiers temps. En sculptant de nombreuses espèces d’oiseaux et de
bêtes, même d’un monde étranger, on transmet la mémoire des empereurs pour qu’elle soit accessible à
tous aux époques suivantes, et l’on proclame les promesses des rois aux dieux, ou l’accomplissement de
leurs voeux. Ce n’est pas comme nous qui, dans un nombre limité de lettres, avons le moyen facile
d’exprimer tout ce que l’esprit humain peut concevoir : certes, les anciens Égyptiens avaient aussi une
écriture, mais chaque signe correspondait à un (p. 12) mot et exprimait un sens complet ». Si tu cherches
l’origine de ces obélisques, écoute ce qu’en dit le même Marcellin : « Les anciens rois, fiers de leurs victoires
sur les nations et de leur succès dans les affaires les plus importantes dédièrent et exigèrent dans une
pensée religieuse aux dieux célestes ces obélisques taillés dans les veines des montagnes qu’ils ont fait
rechercher jusqu’aux extrémités du globe ». Pline loue le roi Mitren de s’être employé le premier à l’érection
des obélisques ; il écrit aussi qu’à Alexandrie, Ptolémée Philadelphe en avait dressé un de quatre-vingts
coudées que le roi Nectabis aurait fait tailler d’un seul bloc ; que par la suite six autres semblables furent
taillés et que l’artisan fut gratifié de cinquante talents ; qu’il y en eut encore deux autres dans le port, près du
temple de César, hauts de quarante-deux coudées, que fit taillé le roi Mesphée.
Tout cela vu, nous nous rendîmes sur le rivage, à deux milles environ de la ville où l’on visite des ruines qui
dit-on sont celles du grand palais de Ptolémée Philadelphe, mais me semblent plutôt les ruines d’un camp
romain. Ensuite, face au vieux port, non loin de la ville, nous vîmes la colonne de Pompée, placée sur une
base carrée dont chaque côté est de dix-sept pieds et d’une hauteur semblable. Son diamètre est de quinze
palmes, mais sa hauteur est de cent trente-cinq, de style ionique. Ce type de colonne, comme le rapporte
Pline, a en hauteur neuf fois le diamètre de la base. Le sommet est couronné par un chapiteau
quadrangulaire, travail d’une grande beauté, qui frappe de loin le regard de ceux qui s’en approchent.
Parmi les habitants de la ville, il y a soit des Éthiopiens, soit des Arabes, autrement dit Sarrasins, mais
également des Chrétiens et des Juifs. Tous ont la même allure, si ce n’est qu’ils se différencient à la couleur
et à la forme de leur coiffure. Il y a aussi une sorte d’homme appelée « Santon » qui se promène nu ; (p. 13)
[ces hommes] sont honorés comme des saints, un peu comme les saints canonisés chez les papes, et on a
aussi coutume après leur mort de leur dédier des églises. L’usage des bains est très fréquent chez les
habitants. Il y a bon nombre d’établissements de bains, aussi beaux que commodes, en grande partie
recouverts de marbre. Là les baigneurs utilisent, pour s’épiler, un onguent particulier, composé d’un sel d’or,
de chaux vive et d’eau.
Ainsi, nous pûmes visiter Alexandrie à notre fantaisie, pendant trois semaines. Tout se passa pour le mieux,
si ce n’est qu’au début de notre séjour, un malheureux apostat, originaire de Malte, fils détestable d’un père
excellent, commandant dans l’île du château Saint-Ange, n’avait par une traîtrise honteuse failli retarder
notre voyage, non sans nous faire courir un grave danger. En effet, peu de jours après notre arrivée, nous
fûmes invités à déjeuner par le représentant du roi de France, appelé ici consul, François Guardiola, à qui
l’ambassadeur de France à Venise nous avait recommandés par lettre. Nous nous y rendîmes et notre
traître (il s’était enfui de sa patrie, il n’y avait pas longtemps, en raison d’un acte sacrilège, avait gagné
Alexandrie et, ayant renié sa foi chrétienne, était passé dans le camp des Musulmans. Ceux-là le reçurent
dans les rangs des Janissaires, en lui donnant le nom d’Ali), notre traître, dis-je, s’était mêlé aux convives,
les Janissaires étant très portés sur la bouche et avides de nouvelles. Il arriva que la conversation tombât
sur le siège de Malte, entrepris alors par les Turcs ; le consul s’informa auprès de cette canaille de la
géographie, des fortifications, de la garnison de cette île. Notre homme lui répondit : « Que n’interroges-tu
plutôt ces chevaliers de Malte. Il tendit le doigt vers moi et vers Schulenburg. Ils peuvent répondre à tes
questions. Je les connais, en effet, je les ai vus combattre là-bas ! » Comme à cette (p. 14) réponse, tous les
regards s’étaient tournés vers nous, on peut deviner à quel point nous fûmes atterrés, d’autant plus qu’il
avait ajouté qu’il rapporterait la chose au pacha du Caire, près de qui il allait se rendre bientôt. Il savait que
celui-ci serait trop heureux qu’on lui dénonce de tels espions. Quant à nous, faisant front, nous niâmes être
ce qu’il disait, mais sans succès. Le Janissaire redoublait d’audace et avec d’autant plus d’animosité que
visiblement le consul prenait notre parti, lui qui, non moins que nous, craignait pour nos affaires la
méchanceté de ce scélérat. Comme il persistait avec entêtement dans son propos, bon gré mal gré, nous
fûmes obligés de l’adoucir en l’arrosant de bonnes paroles et de bon vin. Cependant, nous ne nous sentions
pas à l’abri de la méchanceté de notre homme, et avant de quitter enfin Alexandrie, nous demandâmes au
consul de pourvoir à notre sécurité en adressant au “Sandjak” du Caire une lettre de recommandation, ce
qu’il fit volontiers, généreusement et non sans succès. Ainsi désormais un peu plus tranquilles, nous
quittâmes Alexandrie le six septembre. Nous traversâmes d’abord le lac Cales, qui nous conduisit ensuite au
Nil, pour arriver à la ville de Fua, distante d’Alexandrie de soixante milles. »372
372 Traduction : H. de Lagrevol (archives Sauneron, Ifao).
- 255 - 258 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN HELFFRICH (du 5 janvier au 10 février 1566)
Helffrich, J., Kurzer und warhafftiger Bericht von der Reis aus Venedig navh Hierusalem ; von dannen in
Aegypten, auff den Berg Sinai, Alcair, Alexandria und folgens, Leipzig, 1581.
Johann Helffrich, bourgeois de Leipzig, voyagea en compagnie de Bockenberg, Vlaming et Villinger.
Non paginé :
Arrivée à Alexandrie
« Le lendemain, nous arrivâmes à Alexandrie, environ deux heures avant le jour. Nous nous rendîmes au
fondique, c’est-à-dire au comptoir des Français et nous demandâmes l’hospitalité au consul français qui
nous l’accorda immédiatement et, à notre demande, mit à notre disposition des chambres et des locaux dont
nous reparlerons dans la description de la ville d’Alexandrie. Nous parlerons maintenant un peu de la ville
d’Alexandrie, de ses coutumes, de sa situation et de ses bâtiments.
Courte description de la ville d’Alexandrie
La ville d’Alexandrie fut fondée par Alexandre le Grand de Macédoine et ainsi que le mentionne Justinus
dans le Livre 11, il la fit construire en sa mémoire et l’appela d’après son nom « Alexandrie » ; aujourd’hui les
habitants la nomment “Scanderia”. Cette ville est située au bord de la Méditerranée, non loin de
l’embouchure du Nil. C’est le port le plus important de tout le pays d’Égypte. Si l’on se base sur le fait admis
généralement que le Nil sépare l’Asie de l’Afrique, alors elle se trouve plus en Afrique qu’en Asie. Elle est
située dans un endroit agréable (comme on l’a déjà dit) ; du côté du couchant, il y a la mer et de l’autre, vers
le nord dans la direction du Nil, il y a de beaux jardins avec toutes sortes de fruits et d’autres plantes
comestibles ; vers le Levant s’étend un terrain désertique et vers le Midi, non loin de là, un grand lac. Le Nil
se jette dans la mer assez loin de là, mais un grand canal le relie à cette ville et y apporte son eau. C’est au
bord de ce canal que se trouvent les jardins mentionnés, ils sont arrosés ainsi par l’eau du Nil et peuvent
donner des fruits.
La ville d’Alexandrie est assez vaste. Elle est entourée et ornée à l’extérieur d’une belle muraille et de
nombreuses tours hautes qui, toutefois, se délabrent et tombent en ruine car les habitants ne les réparent
pas. À l’intérieur de la muraille d’enceinte, la ville est en grande partie déserte ; pas même un quart est
construit et habité. Dans les autres parties, on ne trouve que de vieux bâtiments en ruine formant des amas
de pierres amoncelées. En raison de leur grande négligence, les habitants ne construisent rien, bien que
parmi ces vieux bâtiments se dressent encore de nombreuses maisons qui pourraient facilement, et à peu
de frais, être aménagées et habitées.
À voir ces vestiges importants et ces bâtiments en ruine, il est évident qu’autrefois c’était une ville
magnifique, surtout au temps des Ptolémées et ensuite des Sultans. Actuellement, comme il y a plus de
bâtiments en ruine que de maisons habitables, il est clair que peu de gens habitent dans cette ville.
À l’intérieur du mur d’enceinte de cette ville d’Alexandrie, on peut voir ce que nous décrivons ci-après.
La douane
Tout d’abord, lorsqu’on entre dans la ville par la Porte de la Mer, on arrive à une maison longue et large,
haute de deux étages et recouverte d’un toit. Elle renferme beaucoup de petites pièces et une grande cour.
C’est dans cette maison que toutes les marchandises, arrivant par terre et par mer, doivent être apportées et
déchargées. Elles sont alors aussitôt inspectées et estimées par les Juifs chargés de la douane et à qui il
faut payer des droits. L’Empereur turc a baillé la douane à des Juifs qui doivent lui verser chaque semaine
une certaine somme d’argent mais ceci ne les gêne pas beaucoup car ils peuvent estimer les marchandises
à leur gré et pressurer les marchands comme ils le veulent.
Les rues des fondiques
De cette maison, on continue et on arrive par une porte spéciale dans une longue rue construite comme une
ville dans la ville. Elle n’a que trois issues ou portes bien gardées que l’on ferme la nuit. Dans cette rue il y a
très peu de maisons d’habitation mais surtout des magasins et des boutiques où les chrétiens, les Juifs et
les Turcs vendent toutes sortes de marchandises. C’est là que se trouvent également les fondiques des
Français, des Vénitiens et d’autres nations. Ce sont des comptoirs avec des logements car les habitants ne
permettent pas que les Chrétiens étrangers dispersés dans la ville aient leur habitation. C’est pourquoi
chaque nation doit avoir sa maison particulière appelée fondique, dans laquelle le roi de France envoie un
ambassadeur ou comme on l’appelle un consul. Les Maures, eux, l’appellent “baile”, il porte généralement
une longue robe de velours rouge. Nous logeâmes et prîmes nos repas dans ce fondique. Nous avions à
payer une couronne par semaine auquel prix nous fûmes bien traités ; on ne nous servit à boire que du
muscat et du malvoisie, ce que, après l’eau, nous appréciâmes énormément. Les Vénitiens ont également
leur fondique dans cette rue. Ils y habitent mais leur consul est la plupart du temps à Alkair, il entretient la
même pompe que le consul français. Les Ragusains et les Génois y ont également leur fondique où ils
peuvent séjourner. Ces bâtiments sont tous de forme carrée, mais ils sont de grandeurs différentes. Celui
des Français est le plus grand, viennent ensuite les fondique des Vénitiens, des Ragusains et des Génois,
légèrement plus petits. Ils comprennent deux étages. À l’étage supérieur, il y a beaucoup de petites pièces
où séjournent les marchands. À l’étage inférieur, il y a d’autres locaux où ils peuvent entreposer leurs
marchandises. Ces fondiques n’ont qu’une porte qui donne sur ladite rue ; un Maure est chargé de la fermer
le soir et de l’ouvrir le matin. Le soir, avant de fermer la porte, il frappe, à l’aide d’un marteau, plusieurs
coups sur un morceau de fer spécifique qui est fixé sur la porte afin d’avertir les personnes qui se trouvent à
l’extérieur de rentrer. De ce fait, personne ne peut rentrer la nuit. Les marchands grecs et indiens possèdent
également leur propre maison où ils séjournent et où on procède de la même façon. Les consuls ou les
envoyés sont également chargés par le roi de France et par les Vénitiens de veiller à ce que les marchands
soient traités équitablement et qu’il ne leur soit pas fait de difficultés ; leur rôle est d’aplanir les conflits entre
les Chrétiens et les habitants, d’intercéder auprès des autorités suprêmes afin que justice soit faite, d’éviter
les querelles et la discorde.
Visite de la ville
Sortant de cette rue citée maintes fois, nous marchâmes dans la ville et nous arrivâmes à une autre rue où
les Maures vendent des fruits et d’autres aliments. Ils nous montrèrent, située sur une petite place, une
petite hutte d’argile et de pierres qui aurait été la prison de la vierge Catherine. À côté de cette misérable
construction, se dressent deux belles colonnes de porphyre, hautes de deux hauteurs d’homme et d’une
toise d’épaisseur sur lesquelles le corps de sainte Catherine aurait été étendu (après sa décapitation). Ce
lieu est vénéré par les chrétiens. Tout près de là se trouve une petite église construite il y a longtemps en
l’honneur de sainte Catherine ; à présent c’est une mosquée pour les Turcs. De là, nous continuâmes vers la
mer, et, parmi les bâtiments en ruine, nous vîmes trois colonnes, hautes et épaisses, faites d’une pierre
appelée porphyre. C’est une pierre tachetée de rouge et blanc, bien lisse et polie comme le marbre. De là
nous arrivâmes à un marché ou bazar comme ils le nomment. Les Chrétiens nous montrèrent sur le sol une
grande pierre ronde épaisse de couleur rouge. Elle comportait un trou au milieu et ressemblait à une grande
meule. C’est sur cette pierre que saint Marc l’Évangéliste se serait agenouillé lorsqu’il fut décapité. Non loin
de cet endroit, on arrive, par une autre rue à une église appelée Saint-Saba. Elle est tenue par les Chrétiens
qui y habitent avec des moines grecs ou caloyers. C’est une église assez grande et bien construite au milieu
de laquelle les caloyers nous montrèrent une chaire en marbre blanc du haut de laquelle saint Marc
l’Evangéliste aurait prêché. On a coutume d’y enterrer les Chrétiens étrangers qui meurent ici. Quittant cette
église nous nous dirigeâmes vers la mer parmi les maisons en ruine et tout près des murs de la ville nous
vîmes deux beaux obélisques ou aiguilles, appelés ainsi par les Italiens. Ce sont des pierres hautes et
massives, carrées en bas et pointues en haut. L’un est cassé, mais on peut encore voir les morceaux. Le
second, qui est dressé, est encore intact ; il est gravé de toutes sortes d’oiseaux, de caractères et de petits
animaux à la façon de l’Égypte ancienne. Elle est également en pierre tachetée de rouge et blanc. Près de
ces deux pierres pointues, nous vîmes quatre belles colonnes de la même pierre dont trois étaient encore
intactes et la quatrième brisée, elles étaient assez hautes et massives. C’est là que se serait trouvé le
Palatium, château d’Alexandre le Grand ; d’après les lieux, cette hypothèse est très possible, la vue qui
donne sur l’intérieur du pays et sur la mer est belle. Parmi les bâtiments en ruine, on découvre des salles
dont les murs et le sol sont revêtus de plaques de marbre, de toutes les couleurs, posées soigneusement. Il
n’y a rien d’autre à voir dans cette ville d’Alexandrie car, comme nous l’avons déjà dit, la majorité des
constructions sont en ruine.
L’extérieur de l’enceinte
À l’extérieur de la ville, vers la mer, nous vîmes tout d’abord, en arrivant d’Alkair et avant d’entrer dans la
ville, une enceinte assez haute construite en carré où il y avait beaucoup de fenêtres et de portes en beau
marbre blanc qui indiquaient qu’autrefois devait se trouver là un édifice splendide ; on nous affirma que
c’était un Palatium du roi Ptolémée. De là nous contournâmes la ville en allant vers le Levant. À environ un
mille italien, nous arrivâmes dans le sable devant une colonne terriblement haute de la même pierre rouge
dont nous avons déjà parlé. Le socle de cette colonne est plus élevé qu’un homme, il est carré et très
volumineux. Il supporte une colonne ronde plus haute que trois hauteurs d’homme et est épaisse de deux
toises. La colonne est surmontée d’un chapiteau presque aussi grand que le socle, également de forme
carrée. Les Italiens la nomment la colonne de Pompée. Certains affirment que c’est Jules César qui la fit
ériger en mémoire de Pompée lorsqu’il le vainquit en Égypte.
Le canal d’Alexandrie
De là, nous repartîmes vers la gauche et arrivâmes au canal par lequel l’eau du Nil arrive dans la ville
d’Alkair. Il est bordé de beaucoup de beaux jardins où poussent des oranges amères, des citrons, des
grenades et d’autres fruits. Ils cultivent encore d’autres produits tels que salade et autres végétaux
comestibles.
Jardiniers maures
Les jardiniers qui habitent là sont pour la plupart des Maures. Ils sont très noirs et très pauvres. Ils vivent
dans de petites huttes faites de branches de dattiers. Quelques-uns ont tendu une toile entre deux arbres
pour s’y abriter, avec leurs femmes et leurs enfants, le jour, de la chaleur, et, la nuit de la rosée et de la
pluie. Les marchands s’amusent avec ces femmes lorsqu’ils vont se promener dans ces lieux. Ces dernières
courent vers les marchands en bande et leur crient en langue maure : « O caristian ente flus ? ente vrini
kus ». Pour un pfenning de cuivre, elles leur montrent tout ce qu’elles ont. Elles n’ont pour vêtement, de
même que les hommes, qu’une longue chemise bleue comme on peut le voir plus haut.
Construction vers la mer
Du côté de la mer, à l’extérieur de la ville d’Alexandrie, se trouvent vers le midi des centaines de petites
maisons misérables construites en pierre et en argile. C’est un grand faubourg où habitent les Juifs et les
Turcs ; aucun Juif ne peut habiter dans la ville. Près de ces petites maisons se trouve l’habitation du
Sandjak, gouverneur suprême du lieu ; elle a deux étages et est construite entièrement en pierres. Un grand
nombre de Janissaires et de Spachis habitent également dans les environs. Après ces maisons commence
une muraille haute et massive qui continue loin dans la mer et va jusqu’au fort construit dans la mer pour
protéger le port. Ce port, en forme de demi-cercle, est beau à voir. La forteresse est bien protégée par des
bastions et possède une grosse tour au milieu. Il est possible d’y aller à pied par la muraille qui est construite
de la terre ferme jusqu’au fort. Toute l’année, des Janissaires y sont en garnison. Dans ce port, on voit
beaucoup de beaux bateaux chrétiens et turcs. L’arrivée des bateaux se fait comme suit : les Turcs et les
Maures entrent en longeant ladite forteresse, les Chrétiens entrent par le milieu du port et y jettent l’ancre.
Les galères et autres bateaux de guerre appartenant à l’Armada et à la Guardia sont derrière la forteresse
dans un petit port spécial à l’extérieur du grand.
Au milieu du grand port se dresse une maison de deux étages construite en pierres. C’est là que les Juifs
perçoivent la douane ; rien ne peut être chargé ni déchargé sans que des droits ne soient versés à ces
derniers.
Tout près de la douane commence un pont de bois qui s’avance de plus de cent pas dans la mer. Il n’est
pas très haut et sa largeur est de six pas. Il fut construit à cet endroit car la mer n’est pas très profonde ;
ainsi les petits bateaux ne peuvent pas accoster et doivent s’arrêter à ce pont.
Population
Les habitants de cette ville sont pour la plupart des Chrétiens et des Maures comme dans le reste de
l’Égypte. Toutefois les Turcs et les Juifs habitent à l’extérieur de la ville comme nous l’avons déjà dit. Ils
parlent la même langue, portent les mêmes vêtements que les habitants d’Alkair. Ils pratiquent la même
religion, mais à Alexandrie, il n’y a pas d’églises, qu’on appelle mosquées, bien construites. Ces mosquées
sont très petites car ils font la prière dans les champs la plupart du temps.
Climat
À propos de la ville d’Alkair, on a dit qu’il ne pleuvait pas en Égypte pendant toute l’année. Cependant il faut
savoir qu’à Alexandrie il pleut souvent en hiver car la ville est située au bord de la mer et au couchant. Ainsi,
il fait un peu froid en hiver mais pas durant une longue période.
Voici donc tout ce que je pus apprendre sur la ville d’Alexandrie en peu de temps et en m’informant
consciencieusement.
Départ d’Alexandrie
Du 5 janvier au 9 février, nous attendîmes un bateau appelé “la nouvelle Barbara” qui était de Venise. Nous
nous mîmes d’accord avec le capitaine et nous y fîmes transporter notre équipement. Le lendemain
10 février, nous embarquâmes au nom de Dieu. Lorsqu’il fut à peu près trois heures de la journée, nous, les
trois Allemands, Georgius Beck de Nuremberg, Zacharias von Schotten d’Andtorff et moi, Johann Helffrich
de Leipzig, nous embarquâmes au nom de Dieu sur “la nouvelle Barbara”. Nous laissâmes le capitaine faire
tous les préparatifs et nous attendîmes un vent favorable. Bientôt, le vent souffla de telle sorte que nous
pûmes sortir du port toutes voiles dehors ce qui donna du courage. Nous continuâmes ainsi et vers le soir
nous ne pouvions plus voir la ville d’Alexandrie. La nuit suivante, le vent nous fut également favorable. »373
373 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 259 - 262 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FILIPPO PIGAFETTA (1576)
Pigafetta, F., Viaggio da Creta in Egitto ed al Sinai 1576-1577, par A. da Schio, Vicence, 1984.
Filippo Pigafetta, originaire de Vicence (vers 1533-1603), embrasse l’état militaire qui lui permet de parcourir
un grand nombre de pays. Il fait la guerre en Croatie, en Pologne, dans le golfe Adriatique et en Hongrie où
il accompagne le comte Aldobrandin dont il est le conseiller. Le pape Sixte-Quint l’envoie en tant
qu’ambassadeur auprès du roi de Perse pour conclure une alliance contre les Turcs et le charge d’une
mission semblable auprès du roi de France. Filippo Pigafetta voyage dans toute la Méditerranée visitant
Constantinople, l’Égypte, le mont Sinaï et la Terre sainte. Ses services et ses mérites lui valent l’amitié des
princes, des monarques et des papes, passant ainsi de conseiller de Ferdinand II, grand duc de Toscane, à
camérier d’Innocent IX. Filippo Pigafetta n’est pas seulement un homme d’armes, il s’intéresse aux lettres
comme en témoignent ses écrits sur l’art militaire et la géographie. Il est parent du navigateur Antonio
Pigafetta (vers 1491-après 1534) qui accompagna Ferdinand Magellan (1480-1521) dans sa circonvolution
du monde entre 1519 et 1521 et qui, suite à ce voyage, écrivit un récit intitulé Notizie del Mondo Nuovo con
le figure de paesi scoperti descritte da Antonio Pigafetta vicentino cavaglier di Rodi. 374
p. 64-106 :
« Si diede fondo fuori del porto, la notte del sabbato venendo alla domenica. E la matina, di buonissima ora,
si entro dentro, salutando il faro con molti pezzi. Subito dato fondo, il Capitano della saettia ando a retrovare
il Sangiacco di Alessandria, che si dice Bei, il quale è governatore e capo delle guardie di quella città, la
quale guardia è di otto galere, e alcuna volta di più, che tutto il verno si disarmano, come ho veduto io. E col
predetto Capitano ando quel Giovanni di Matteo ancora al quale le dessi aver usato cortesia in Candia, ma
dipoi lo conobbi in fatto tristo, sconoscente e ingannatore, avendomi, in luogo di tante accogliense fattegli,
guiderdonato con altretante offese : e bene si conobbe, secondo l’antico detto, che un beneficio grande si
paga con una grande ingratitudine, della qual cosa incolpo il genio e la natura di quei popoli inclinati dalla
contrada, credo io, alla frauda e alla bugia. Venne dapoi il Dragomanno della nazione veneziana per torre le
lettere dei mercanti, le quale erano tutte in mano mia. Ma non gliele potei dare per aver portata seco la
chiave quel ribaldo di Giovanni sudetto.
[Franchigia del porto d’Alessandria per tutti i vascelli del mondo per conto di mercanzia]
Fratano Teodorino, padrone della nave rubbata dal Marchese de Vico, se ne ando al Sangiacco e gli narro la
sciagura sua e più che di quella galera che l’aveva saccheggiato erano cinque uomini sopra la saettia. Onde
subito il Sangiacco mando i suoi ministri e, fra gli altri, un rinegato italiano suo maggiordomo, che si dice
Cathaio, a pigliarli e ponerli in catene. Ma dapoi, in processo di tempo, mediante il Console di Francia,
mostrando che il porto di Alessandria è libero, furono liberati di ordine del Bassà del Cairo, il quale conserva
le franchigie in quella città e vuole mantenere quella scala che al Re utile grande apporta.
[Usanza de’Sangiacchi di Alessandria intorno a’passagieri]
Usa il Sangiacco interrogare con gran diligenza li padroni delle navi e i passagieri delle cose di Ponente e
massimamente delle galere di Malta. E vogliono sapere ogni cosa, e riconoscere i passagieri, e sapere che
vanno facendo.
S’intese dapoi che il vascello del predetto Teodorino abbandonato in mare dal Marchese de Vico, era stato
regittato dalli venti al lito di Alessandria sano e salvo. Io, l’istessa mattina della domenica, smontai, alli 14 del
mese, e consegnai le lettere alli mercanti e fui albergato in casa del Magnifico Messer Mariani da Messer
Paolo suo nepote, essendo egli in Cairo, al quale io avevo lettere di raccomandazione e di credito dell’Ill.mo
Signore Jacomo Foscarini, Dittatore nell’Isola di Candia. Fui consegliato a trattenermi in casa per alcuni
giorni finché cessasse l’umore di quei prigioni al Sangiacco, ed essendogli stato detto che su quel vascello vi
era anco uno ingegnero che faceva del pelegrino, intendo di me, talché non fui senza sospetto grande di
ricever qualche villano assalto da quello avarissimo Sangiacco.
[Distanza vera dall’Isola di Candia in Alessandria]
Ora, il viaggio di Candia fino ad Alessandria non è tanto lungo, come si dice, percioché in poco più tempo di
due giorni e con le sue notti da Capo Placa fino nel porto di Alessandria scorse quella saettia. Vero è che
per un giorno e mezzo il vento soffiava si fieramente che, secondo il conto fatto da loro, si andava più di
dieci miglia l’ora. E quanto a me, non credo che vi sieno cinquecento miglia ; ben diro che a gran pena si
potrebbe, nè più piacevolmente nè passare in contrada tutta differente di aria e di costumi di quello che
facemmo noi.
La città di Alessandria, la quale fu edificata dal Magno Alessandro, detta oggidi dagli Arabi e dai Turchi
Scanderai, fiori un tempo sotto i Re Tolomei, successori di Alessandro nello Egitto, e sotto gli Imperatori di
Roma, cominciando dal Dittatore Giulio fino al tempo del falso Macometto. Ma ora è rovinata affatto e non
riesce in effetto come sembra da lunghi in mare e la sua fama risuona ; percioché, quantunque in guardando
di fuori rende meravigliosa prospettiva, inalzandosi prima alla destra il castello picciolo posto sopra l’isoletta,
o scoglio già nomato Antirodo, nel mezzo de’quali due castelli entra il mare e si apre il porto di Alessandria,
nel cui fine è la spaggia che si distende fra il mare e le bellissime muraglie della città, e un gran pianura,
nella quale sono alcuni notabili edifici e molte case, quasi un’altra città fuori di Alessandria, e si scuoprono
alcuni monti dentro la terra e il grande obelisco, overo aguglia, e fuori la smisurata colonna detta di Pompeo,
e nel porto istesso molti navili e galere, e vi sia la peninsula e il porto vecchio con li suoi castelli, le quale
cose tutte fanno mostra di regale città e promettono alla curiosità singolare speranza di sodisfarsi,
nondimento, resta poi altri ingannato, percioché appare distrutta e rovinata affatto. Talché, bene assai si
confià quel detto del poeta : « gran città gran deserto ». Ma, per trattar di lei secondo le cose da me
proposte, l’andero descrivendo con qualche diligenza.
[Notizia moderna e antica del Faro di Alessandria]
Faro che ritiene oggidi ancora il nome, usando gli Antichi questo vocabolo quasi fano, significa ogno torre
che per li naviganti ha la lanterna. Quella di Alessandria fu la più famosa, e ora è una isoletta, o scoglio, tutto
in sasso che gira poco manco di un miglio, congionto con la terraferma per un molo lungo forsi due terzi di
miglio. Ma nel tempo antico, come scrive Plinio e Strabone, era discosto la navigazione di un giorno,
secondo Omero, e di scrive che fu poi lunge otto stadi e che fu congionto alla terra ferma col lavoro di sette
giorni, per levare le gabbelle a quei de Rodi, che lo possedevano mediante quella congionzione, quasi que
ella non fosse più isola. Questo dice Ammiano Marcellino nel XXII delle sue Istorie. Oggidi non si vede
segno alcuno di cio. Sopra quel scoglio sta il castello dirimpetto di Alessandria, verso ponente, impicciolito
dal continovo percuotere dell’onde del mare, non vi essendo rimaso altro che quanto occupa il castello e un
poco di piaggia tutto all’intorno delle sue mura, quasi strada rispetto a quello che si legge in Strabone esser
stato al tempo antico, percioché oltra la terra grande vi era anco il villaggio. Ha verso levante molti sassi
coperti dalle acque e scoperti, e fra gli altri quello che si dice il Garofalo, che è un picciolissimo scoglio
lontano dal Faro una tratta di archibuggio, il quale spinge fuori sopra l’acqua dieci o doddici braccia,
grandemente temuto e schifato dalli marinari, ergendosi sul destro lato all’entrare della bocca del porto, che
è poco più larga di un quarto di miglio e incomincia dal detto Garofalo e finisce in tanto spazio per certe
secche di sasso sotto acqua, le quali occupano tutto quel lungo del mare fino all’altro castello, né di sopra
essi possono passare i vascelli, che si sdruscirebbono, il che ben si conosce dal rompere dell’onde fatte
spumose da quelle secche, le quali frangono l’impeto del mare che non vada inanzi e urti furioso, e randano
quel sito buon porto di cattiva spaggia che sarebbe senza loro, e ha buon tenitoro né va a traverso, ove si
spezza vascello alcuno giamai, se non percuote nell’entrare o uscire della bocca in quelle pietre, talché è
difficil molto l’entrare in lui e l’uscirne, onde le navi non si levano giamai di notte, quantunque si abbia
contezza del vado.
Alla destra di questo porto sogliono mettersi le navi de’Macomettani e le galere della Guardia, per essere in
sito più coperto e sotto il castello del Faro ; né concedono lo starvi ad altri vascelli, es è luogo riservato per
quelli delli Macomettani. Ma quelli de’Cristiani danno fondo più adentro, inverso la sinistra nella ampieza del
porto, ove parimente è buona stanza, sebene travagliano quando soffia il vento di maestro e di tramontana e
di greco.
Questo castello fu già fabricato per securezza di quel porto intorno agli anni di Nostro Signore 1470 dal
Soldano dell’Egitto nomato Cait Bei si come affermano gli uomini del paese, ingrandito poscia nel modo che
ora si trova da Selim Ottomano e dalli successori suoi, il quale Selim vinse e affatto spense in cinque fatti
d’arme, ad Aleppo ed a Gazza, alla Maatarea, al Cairo e oltra il Nilo, appresso Bulacco, l’anno 1517, i
Soldani dell’Egitto e la razza tutta de’valorosi Mamalucchi.
Cosi Cat Bei pianto prima nella sinistra parte del Faro, verso tramontana, un picciolo castello e forte secondo
la capacità di quei tempi, con le muraglie alte, fatte di sassi designati in forma quadrata, con quattro torri
tonde agli angoli, quasi franchi, ma senza artificiosa difesa di canoniere. Ed ha nella sudetta parte di
tramontana come da lungi si comprende, buone stanze, veggendosi alcune fenestre nella sala, e ai lati le
stanze e alcune logge, afine di pigliare il fresco dalli venti maestrali la state. E vi è la sua picciola moschea,
con le torri alte per chiamare il popolo all’orazione. Ivi abitava in quei tempi Alessandro, già Vaivoda della
Vallachia, privato dello stato suo da Selim Ottomano e confinato in quella perpetua prigione donde non puo
partire senza guardia, e subbito ritornarvi. Negli angoli di questo castello, i quali, nella facciata di tramontana,
stanno a levante e ponente, sorgono, in alto, due sporti piccioli e coperti per adattarvi dentro due lanterne a
fine di far lume ai vascelli che navigano ad Alessandria, le quali lanterne sogliono accendere i Turchi ogni
notte la state, ma diferentemente dal costume antico, percioché, si come narra Strabone, mentre regnava in
Egitto il secondo Tolomeo, nomato Filadelfo, Sostrate da Gnido, architetto valente, fabrico a posta per l’uso
delle lanterne e per la securezza de’naviganti una maravigliosa torre di marmo bianco, di molte volte, nella
quale si contento quel Re che l’architetto vi scolpisse il suo nome con queste parole : « Sostrate Gnido,
figliuolo di Dexifano alli dei salvatori per li naviganti », contro l’usanza dei buon Greci e Romani, i quali non
comportavano che gli architetti mettessero i suoi nomi nei nobili edifici, di che mostra Plinio nel libro 36
prender meraviglia, chiamando quel Re magnanimo per avervi lasciato scolpire il nome di quello architetto.
Dinanzi all’istessa facciata di questo castello, verso levante, sta in piè ancora, lunge una tratta di mano, la
vecchia torre ritonda piantata nell’acqua, ove già soleva farsi la guardia del porto, ma ora non si usa, e va in
rovina. A questo picciolo castello hanno i Turchi, dopo che sono padroni di Alessandria, tirate alcune
muraglie lungo la marina, più basse di quelle del castello, di maniera che gli viene a servire per maschio di
tutta la fabrica, che al presente si vede in questo modo che la facciata posta a tramontana del picciolo
castello fa eziendio parte della facciata dello agiunto, allungata de qua e di là quanto tiene quasi il Faro per
quella linea. Questa è la prima faccia di tutto il castello del Faro, composta di due del maschio, cioè
dell’agionto, e il primo lato volto a tramontana, nel quale si veggono in pelo, come si dice, d’acqua forse dieci
cannoniere, senza arteglieria, fatte in volta con fenestra, nel principio del quale l’acosta la torre vecchia, di
che di sopra ho ricordato, verso levante. Sigue poi, al secondo lato, pure a levante, verso il porto maggiore
del primiero, lungo forse ottanta passi di midura, nel cui angolo è una torre tonda di mezzo rilievo, quasi
fianco, e nel lungo della cortina stanno diciasette canoniere, come le altre in pelo di acqua, le quali vanno a
dare nel porto verso il fiume. Di questo lato, sopra il colmo della muraglia, sono al coperto quattro pezzi di
arteglieria da sei, ove suole stare la guardia, i quali pezzi dimorano a cavalieri del porto tutto. Nella porta,
poi, che mira ad ostro, fino al principio del modo, del quale diro appresso, si veggono d’intorno otto
canoniere simili in tutto alle descritte. Ma nella parte di questo lato, oltra il molo verso ponente, non vi sono
canoniere, nè vi fanno bisogno. Questo lato è smezzato, per dir cosi, e diviso dal molo, overo argine, fondato
di muro nel mare, cominciando dalla terraferma fino all’isola del Faro, quasi ponte, e viene a dare nella
fronte di questo lato del castello che ho detto esser volto ad ostro, ed è lungo presso che mezzo miglio e fu
ivi fondato al tempo antico, al fine di potere da Alessandria andare al Faro e di congiungerlo con la
terraferma, in che ripresero alcuni Omero percioché chiamo il Faro isola, per esser mediante quel ponte
congionto col continente. Nella parte di questo molo che è presso il castello del Faro sono forse cinque
canoniere, di forma e di livello come l’altre sudette, che feriscono l’ampieza del porto in pelo d’acqua, nelle
quali per l’ordinario non stanno arteglierie, né in alcun altro luogo del detto castello, fuori che nel predetto
della guardia e vedetta. È fama che vi sia arteglieria assai in quel castello ; ma per molte ragioni io non lo
credo, con quanto ne abbia con diligenza ricercato. Il resto di questo lato australe del castello del Faro non
ha cannoniere, come di sopra ho mostrato ; nemeno il quarto lato di ponente, non gli facendo mestieri per
guardare il porto.
Cosi abbiamo il circuito del castello del Faro, dentro il quale sono le case e gli alloggiamenti del presidio
turchesco, che vi sta con le sue femine, il quale castello è quadrato, lungo, fatto di sassi lavorati in quadro,
non di mattoni, bellissimo a vedere, con la sua strada tutto all’intorno e merlato, e ciascuno delli quattro
angoli ha il suo torrione di mezzo rilievo, senza canoniere o difese ragionevoli. Il ponte poi, o argine o molo
che lo vogliamo chiamare, congionge il Faro con la terraferma, nel quale, al tempo, antico, soleva essere
l’acquedotto che conduceva l’acqua della fossa del Nilo al Faro, come scrive Strabone. E oltra la torre della
lanterna vi era un villaggio di uomini di male affare abitato. Questo molo al presente non serve ad altro che
per ponte a passare del continente inanzi e indietro, e ha tutta la sua lunghezza un altro muro verso il porto,
verso l’estremo suo margine, overo orlo, il qual muro, incominciando al castello, finisce alla porta verso
terraferma ed è quasi tutto merlato e distinto in cinque quadrate, la prima delle quali fu la porta che va di
terra sul molo, e l’altre quattro di mano in mano lontane l’una dall’altra egualmente, in ciascuna delle quali
sta la guardia e vi sono allogiamenti diversi.
A ponente di questo porto non sono muraglie alcune, onde pare che sia stata quella di levante inalzata per
coprirsi dal porto e dalla città e non essere veduti andare per il molo. Oltre alla porta, di verso la terra, la
strada è forte stretta, posta fra due mari, fatta dalla natura lunga quasi, stimo, per una tratta d’arco.
Adonque, partendosi da terra, per andare al Faro, prima si trova questa scoperta lingua di terra fra due mari,
poi vi è l’argine, o molo, fondato dall’arte, nel principio del quale è la porta che è la torre, con la sua guardia,
ove comincia il muro predetto, che copre e difende la strada del molo. Di là da questa prima torre giace la
seconda torre, ove parimente è guardia, e con le tre altre, di mano in mano, ad uno istesso modo, il che
rende per di fuori bellissima vista. Si entra poi nel castello, fabricato nella forma sopra scritta, al presidio del
quale sta sino tremila buoni archibugieri Giannizzari, i quali con gelosia guardano quel luogo e con barbara
diligenza, non vi lasciando non solamente entrare, ma manco da lungi avicinare persona alcuna che non sia
di legge maomettana o soggetta all’Ottomano, andandovi qualche Ebreo per servizio o qualche Cristiano del
paese, dai quali si puo intendere ben poco del sito di dentro di quei luoghi. Verso l’occidente del castello,
cioè all’angolo che fa la faccia di tramontana con quella di ponente, cominciano alcune secche sopra acqua,
le quali per ponente vanno a dare in un picciolo scoglio discosto forse un quarto di miglio, che sta per
traverso da ostro e tramontana, il quale scoglio si congionge quasi con la peninsula che poco appresso
descrivero ; talché, stando quella peninsula a levante e ponente e le secche parallele alte, traversandosi al
mezzo della peninsula lo scoglio detto ad ostro e tramontana, e verso il castello facendo riparo il molo, si
viene a serrare un picciolo ridotto e porto securo per li piccioli vascelli, la boca del quale giace fra le secche
predette e lo scoglio, il qual porto è quello che per avventura Strabone chiama Canosto.
Al dritto di questo Faro, lunge forse due miglia, giace un altro scoglietto, di gran lunga minore del Faro, il
quale è parimente congionto con la terra mediante un ponte, o molo antico, che ha le volte per le quali passa
l’acqua del mare di qua e di là, e il muro che ricopre la via la quale conduce allo scoglio, e alcune torri, come
è in quello del Faro, ma assai più breve. Sopra il quale scoglio, che giace presso le mura della città poco più
di un miglio, è posto un castello in quadro, molto minore di quello del Faro, ma simile, con le stanze dentro
per li Giannizzeri e con la sua moschea, fabricato dall’istesso Caet Bei Soldano ; ed ha egli ancora alcuni
pezzi di arteglieria commodi a’luoghi convenevoli per ferire i vascelli del porto, e il presidio di alquanti
archibugieri Giannizzari col suo capo. Ivi presso è una chiesa di Coffi cristiani, ove sogliono andare a dire la
Messa, e alla marina, vicino alle muraglie, sta la guardia de’Giudei gabellieri, né vi si puo andare, come
neanco al Faro. Questo Castello risponde a quello del Faro per distanza di due miglia, spingendo in fuori più
in mare, verso tramontana, il Faro. E ambidue, quasi braccia, assecurano il Faro e il porto di Alessandria
da’nemici. Ma il picciolo castello viene ad esser fatto puitosto per bellezza ed ornamento che per bisogno,
conciosiaché, come ho detto, non si puo entrare nel porto di Alessandria se non per il solo vado che sta
presso il Garofalo, il quale è cosi al castello del Faro che basta per impedire l’entrata al nemico. Nel resto
della marina, in linea dritta verso il castello picciolo, sono secche e sassi, né si puo, come è narrato, passarvi
di sopra.
Questi due castelli rendono piacevole veduta percioché, mancandosi la piaggia nel mezzo in forma di luna,
finisce in queste due punte, sopra le quali s’innalzano i due predetti castelli, e la città è loro di dietro, in verso
ostro, situata quasi fra loro, senonché spinge più a levante, oltra il picciolo castello, fino alla Porta di
Rosceto.
Al tempo antico stimo io che quello scoglio, ove dico stare il picciolo castello, si nomasse Antirodo, cioè al
dirimpetto di Rodo isola, come dice Strabone, essendo appunto all’incontro di Rodi. Ivi Marcantonio
Triumviro si fabrico una casa di solitudine, dopo che fu rotto a Santa Maura, insieme con Cleopatra, da
Ottavio Cesare : e oggidi ancora vi appaiono i segni e le fondamenta di grande fabriche, le quali si
distendevano fin sotto le mure della città, che toccano al presente il mare ; e vi erano alcune colonne le quali
sono state levate via di là e a Costantinopoli condotte per le moschee.
Nel giro di questa piaggia non si puo smontare commodamente, ma bisogna farsi portare, overo, aspettando
che l’onda ritorni, con prestezza saltare nel lito sul suolo. Ben vi è fondato un molo oltre il mezzo della
piaggia, verso ponente, il quale è certo, per la sua piccolezza, indegno di quel luogo, rispetto alla fama e
grandezza del luogo e del porto e al gran numero de’vascelli che ci capitano, e alcune fiate tanta è la
quantità delle barche le quali in uno istesso tempo hanno da caricare e scaricare, che non vi capiscono, e si
dura fattica ; ma ben si vede che, per le fondamenta, che già tempo soleva esser molto lungo.
Al dirimpetto di questo molo è una bella loggia di legname per ridotto de’gabellieri giudei, i quali soli tengono
le gabelle del Gran Signore in tutto l’Egitto, in che sono diligenti e d’avantaggio tristi, ma per lo più si
rovinano e finiscono la loro vita in povertà e in certa prigione posta nel castello del Cairo, detta in arabo
Arcana.
[Descrizione delle case che sono fuori di Alessandria e del gran casamento degli Ebrei]
Ho detto que fra il mare e la città si allarga una gran pianura ; ora l’andero descrivendo.
Più adentro, verso la città, in detta pianura, è il luogo dove stanno tutti gli Ebrei, quasi alla turchesca, in
caravarsan, overo fondaco. Oltre gli Ebrei vi alloggiano anco gli stranieri, Mori, Turchi e d’ogni nazione, con
le mercanzie loro, e vi sono diversi magazzeni abasso, ma di sopra, nelle stanze migliori, abitano gli Ebrei, e
fuori vi è il mercato delle cose da mangiare. Questo gran casamento, fatto in quadrato lungo, fu edificato da
un Bassà per cavarne utile, ed ivi d’intorno sono assai case di Ebrei e di altri fabricate di nuovo. Credesi in
poco tempo la città di Alessandria aversi a ridurre e transportare tutta in quel sito, percioché l’aere è
buonissimo e non ha molto che vi sono moltiplicare assai le case, e vi stanzia il Sangiacco e quasi ogni
personnaggio turco.
Dal molo adunque, quasi fin presso la muraglia della città, per un quarto di miglio ad ostro, tutta quella parte
della pianura predetta è occupata da case nuovamente fatte, le quali giungono fino al porto vecchio, verso
ponente (ma del molo, verso levante, in quella pianura non vi è casa alcuna fra la città e il mare) la quale
pianura va a finire nell’istesse muraglie della città e parte libera. La libera è dal molo, a levante, fra le
muraglie della città e il mare, ove non si vede altro che alcuni padiglioni di Beduini, o tende, che hanno
sempre volta la porta, all’entrata loro, verso quella parte ove il vento non soffia, e stanno ivi con le loro
femmine per servizio de quelli della città. La occupata, poi, comincia al molo sudetto e abbraccia quel luogo
abitato e arriva al porto vecchio e alla prima porta del Faro e al principio della peninsula, di modo che la città
resta per fronte. Oltra il molo predetto, lungo la marina, verso ponente, si fabricano le navi, e ivi presso è il
luogo dell’arzanà vecchio dal quale si vede il fine del porto in verso otro, che è lungi dal lito dell’altro porto
manco di mezzo miglio, riducendosi ivi al netto il terreno, in estremo stretto quanto ho detto, il quale stimo
piega verso ponente e si va distendendo per una lingua di terra che pure alla destra prende alla marina il
castello detto delle Lance. Sopra questa lengua, o peninsula, sono alcuni molini da vento al principio, ove è
più grossa, ed una moschea chiamata dalli Franchi Belvedere. E poi, nel suo dorso sono piantati arbori assai
e molte sepolture di Maomettani e qualche verdura, e al mezzo di lei, nella parte di dentro, cioè verso il porto
vecchio, è un castello quadrato, fatto dell’istesso Caitbei, e ivi presso, ai lati, l’arzanà nuova, nel qual castello
è l’arteglieria e presidio de’Giannizzari per guardia di quel porto. E questa peninsula è lunga forse due miglia
al dirimpetto del fiume, della quale che termina in acuto, quasi lingua, è uno scoglio, lunghi da lei un tiro di
archebugio, il quale fa la bocca prima e miglior del porto vecchio. E per un miglio più là, verso ostro, si trova
la riviera di Barberia, che si dice da Tolomeo Marmarica, e sta a ponente e levante e serra da quella parte il
porto vecchio di maniera che viene ad avere due bocche, l’una fra la punta della peninsula e lo scoglio, la
quale è picciola e netta e fonda e buona, e l’altra più grande e peggiore, cioè dallo scoglio alla costa di
Barberia. Il mare vi entra dentro da ponente e forma quel porto lungo d’intorno a due miglia e largo uno,
terminando in giro verso il fine della muraglia della città e compiendo una stanza per li vascelli e piccioli, a
meraviglia buona e grande e sicura, non gli dando noia vento altro che libeccio, overo garbino, ed è capace
de ogni grande armata e de vascelli da carico, e si chiama il porto vecchio. Non permettono i Turchi che i
vascelli de’Cristiani vi dieno fondo, ma è riservato per li maomettani, e vi stanzano il verso le galere
disarmate nel lito che è presso l’arzanà, ove è partinente il castello sudetto. E vi è un altro castello nella
piaggia e ultimo sino di questo porto, posto nelle muraglie della città, le quali finiscono apunto quasi sul
mare. Il qual castello ha presidio di Giannizzari e arteglieria e risponde a quell’altro nuovo da me poco inanzi
descritto, e chiamasi il Castello Vecchio. Questi due castelli sono per guardia del porto, né vi puo andare
Cristiano alcuno che non sia del paese, né meno appresarsi a tiro di cannono, anzi, i Turchi e gli Arabi del
paese avvisano i Franchi che non si accostino a quei luoghi, come anco fanno gli altri due castelli di quel
porto.
Cosi la città di Alessandria ha due gran porti e quattro castelli che gli guardano. In quei porti sono del
continovo molte navi, massimamente la state, veneziane, ragusee, genovesi, francesi, siciliane, navili
dell’Arcipelago e altri vascelli de Constantinopoli e del Mare Negro. E quando vogliono partire, usano di farsi
immurchiare fuori del porto da una di quelle galere della Guardia, donando al capitano, che si dice raizi, una
veste di panno che vale d’intorno a quindici ducati corrienti. La Guardia di Alessandria suole essere di dieci
galere, le quali tutte disarmano il verno e se riarmano la primavera, capitano delle quali è il Sangiacco e
Governatore di Alessandria. Fra quest dieci galere della Guardia di Alessandria si contano le due, l’una che
arma la terra a Roscetto e l’altra, di Damiata, che porta fano.
[Caso accaduto agli schiavi spaggnuoli che fuggirno con una galea d’Alessandria]
Quando io dettavo queste cose in Cairo, nella festa della Epifania, s’intese di Alessandria che, con
l’occasione della partita di Saban Sangiacco di Alessandria e Capitano di quella Guardia, li schiavi cristiani,
che vogavano le sue galere al numero di trecento, nel più spaggnuoli, si erano congiurati insieme di
recuperare la loro libertà, come molte inanzi avevano fatto, nè mai menatolo ad effetto, per esser stati
scoperti, e di occidere i guardiani turchi che li tenevano nel bagno, che cosi chiamano i Turchi le prigioni e la
stanza dove serrano i miseri schiavi, le quali erano nell’arzanà, chiamate da’Latini ergastula. Posero ad
effetto la deliberazione di prima notte, e, uccisi i guardiani e quanti Maomettani se gli fecero incontro,
presero l’arzanà e ivi si fecero forti e, compartendo fra loro i servigi, in tre ore armorono di tutto punto la
galera di un rais, che si trovava al Cairo, che era la migliore di tutte, difendendosi con sassi e con le fronde e
con qualche altra arme tolta a quei Turchi nell’arzanà. E da certi vicini si erano mossi pigliando anco ivi
armegi e biscotti e tutto cio che loro faceva mestieri per fornire la galera. Fatto questo, vi montorno sopra.
Ma, per esser già carica, non poteva star vicina al lito, onde bisogno allargarla. In questo tempo ando la
voce alli castelli de cotale accidente e se udi tirare alcuni pezzi d’arteglieria, onde la galera si parti, e
d’intorno a trecento uomini parte de’quali era stata messa alle guardie, per doversi imbarcare poi con lo
schifo, remase nelle mani de’nemici, perciochè, con fretta montati nello schifo imorchiato dalla galera, e
dando la strappata, la fune del rimurchio si ruppe, né potevano quelli della galera udire i gridi loro per la furia
del vogare e del percuotere i remi nell’acqua al buio della notte. La mattina, essendosi discostato poco dal
porto con lo schifo, furono ripresi dagli Arabi, che gli viddero, e rimenati nella cattività primiera, in più aspre
catene. La galera non si vede più essendosi abbattuta in buon tempo. S’intese dapoi che arrivo alla costa
dell’Isola di Creta, verso ostro, al castello detto Sfachia, ove furono ricevuti da quei valent’uomini e carezzati
e aiutati dal proveditore di quel castello, il quale si chiamava Pietro Bollano, gentiluomo veneziano delle
Colonie, il quale fu poi sbandito per cio. Ma egli ando a pregare il Santo Padre a Roma e ottenne il perdono
dalla Serinissima Signoria mediante Sua Santità.
Partita poi, quella galera a gran pena arrivo salva ad Otranto, avendo sofferto dissagio di pane e di acqua.
Capo di quella azione fu un Portoghese. Non furono consapevoli più di quindici di loro al principio, e fu
maneggiata con singolare secretezza e promossa e agevolata e solleciata grandemente da frate Vincenzo
da Portogruaro, dell’Indie, di San Francesco, il quale gli aveva tutti confessati e communicati e incitati a
questa fuga. Di che essendosi accorti i Turchi, l’andorno cercando con diligenza, poi, per farli poco piacere.
Ma egli se ne fuggi al Cairo, ove stette nascosto forse un mese in casa de un Cristiano Coffo.
[Disegno di Alessandria fatto sul luogo]
[Incomincia la descrizione d’Alessandria e dei luoghi circonvicini, paragonando il moderno con l’antico, e
de’suoi porti, castelli, edifici, arzanà, Guardia de’Giannizzeri e delle galere e de’cavalieri delli Spai o Spacchi]
Ma tornando alla prospettiva di Alessandria, dico che di prima giunta si mostrano questi castelli e la
moltitudine delle case che ho detto essere in quella pianura e il gran casamento ove stanno gli Ebrei nella
parte di sopra ; ma di sotto, nella corte e intorno ai portici, alloggiano Turchi, Mori, Arabi e altre genti che il
passagio con le loro mercanzie vi capitano. E quando io vi entrai, viddi alcuni Turchi i quali dal Cairo
avevano condotti molti uomini e femmine di Nubia per rivenderle in Anatolia e nel paese di là e in
Costantinopoli, tenendosi ad uso di bestie in terra. Fra i due castelli, cioè del Faro e di quell’altro minore,
sorge la città, la quale si distende da levante in ponente e oltre i due castelli, per modo che ella non è per
linea dritta compresa fra loro e mostra di fuori, in quanto alle mura, una grande e maravigliosa apparenza di
sè per l’altezza e grossezza loro, per la nuova forma delle porte e di tutta la fabrica delle sudette muraglie.
[Muraglia mirabile di Alessandria simile a quella di Costantinopoli e di Salonichi]
Sono le mura doppie con li suoi merli e torri grandi, spesse e distinte, con eguali spazi per lontananza l’una
dall’altra, nelle quali torri erano già e sono ancora in essere di buonissime stanza già con le famiglie sue
da’soldati mamalucchi, i quali facevano la guardia, compartite in modo che in ciascuna torre stava un capo
de dieci uomini. E cosi tutto all’intorno quella città era fornita d’opportune custodie. E non solamente i
Mamalucchi la guardavano, ma, al tempo del sospetto della guerra, vi facevano andare i Cristiani di
Alessandria, suoi sudditi, a’quali erano consignate le poste ai merli, in ciascuno delli quali erano obligati la
notte una lanterna accesa, gran copia delle quali lanterne si vede anco oggi nelle chiese di Cofti di
Alessandria.
La forma di queste muraglie è fatta, apunto, come le mura di Costantinopoli e di Salonicche, che già si nomo
Tesalonica, conciosiaché prima la forma è assai ben lunga, che già aveva il muro di fuori per ripa e riparo
con li suoi merli ; ma ora si veggono quasi affatto cadute. Seguita poi il primo ordine di muraglia, alto grosso,
che giace sopra la ripa di dentro della fossa predetta con le sue torri, grandi e spesso con li merli, e’suoi
corridori atorno, larghi e commodi per caminarvi senza pericolo, con le sue scale per montare e scendere. La
qual prima muraglia, quando io la viddi, era tutta fornita d’un’argene de sassi appoggiato a’merli, postovi per
difesa dopo il conflitto de Curzolari, ove avevano a stare, al tempo de’Mamalucchi, li Cristiani Cofti per
combattere. Oltra questa prima cinta di muraglia, per tanto intervallo di terreno quanto è larga la fossa, è
fondato l’altro ordine, overo giro, di muro, con li suoi merli che guardavano, apunto, al derimpetto di quelli
della ripa di fuori della fossa, con le sue torri più grandi e le stanze soprascritte, e con li corritori e con le
sclae d’intorno, talché vi resta, fra un muro e l’altro, la strada larga, che divide e circonda cosi per quasi tutto
il contenuto della città, fuori che per quella parte che io dissi esser le mura bagnate dal mare, nel qual luogo
il mare serve loro per fossa, né vi è se non un ordine di mura. Queste muraglie sono tutte fabricate di pierre
lavorate in quadro, non di mattoni, le quali pietre erano negli antichi edifici di Alessandria. Le torri e le scale,
che sono del tutto abbandonate, vanno cadendo né si rinovano, in alcuna delle quali solevano già essere
magazzini de’mercanti, ma ora sono stalle e alberghi di cornacchi e di altri augelli, e vi si veggono lupi e volpi
ed è cosa pericolosa l’andarvi, percioché i Turchi con quella occasione apporrebbono che fossa spia, e si
arebbe grande impaccio. Cosi quelle magnifiche e belle stanze e grandi sono ora disertate in tutto.
[Porte di Alessandria smisurate]
Il giro di Alessandria puo essere intorno a cinque miglia, di figura che non si puo brevemente scrivere, ma
tiene dell’ovato, essendo la sua maggior lunghezza a levante e ponente, cioè della Porta di Roscetto fino al
castello detto Vecchio, il quale dissi stare nell’ultima parte delle mura, alla spiaggia del porto vecchio ; e la
sua larghezza da ostro in tramontana, cioè dalla Porta del Pepe, per distanza di un miglio, o poco più, fino
alla Porta della Marina.
Nell’entrare della città per la Porta della Marina e delle due altre, del Pepe e di Roscetto, si vede in quelle
porte una sformata grandezza, percioché le basi loro e gli architravi e le colonne che le sostengono sono, in
lunghezza e larghezza, in altezzaa e in grossezza, molto maggiori dell’ordinario uso delle porte, e di
finissima pietra tebaica di un pezzo solo, senz’altro lavoro che di quadro. E la piazza fra le porte è ampia e
ha i volti altissimi.
L’ordine di quelle porte è tale : si entra, nella prima porta, in una piazza coperta di altissimi volti, alla destra,
è l’altra porta, che mena fra le due muraglie, e alla sinistra, è la porta che parimente conduce nella strada fra
le due muraglie, e a fronte la quarta porta che va nella città, e per tutto, ove sono porte maestre, il sito sta a
questo modo, fuori che alla Porta della Marina, ove non è porta, alla sinistra, per non vi essere doppia
muraglia, ma semplice, toccando la marina tutta quella parte della muraglia verso levante, finché poi, a
dirimpetto del picciolo castello, si discosta dal mare inverso terra, e ivi si fa doppia, ove è anco una picciola
porta, che esce alla marina, serrata e murata, e un’altra porta, somigliantemente, è fra questa e la porta
maestra della Marina, ove è la Dogana, che rade volte sta aperta. A queste porte maestre non sta guardia
de uomini armati, ma alcuni Alessandrini che aprono e serrano le porte con alcune gran chiavi di legno, e i
doganieri giudei i quali cercano con ogni diligenza in tutte le bisaccie o sacchi o altro che passano dentro e
fuori, ed anco nelle propie persone, ma vengono spesse volte ingannati, come fu allora che i quelle sporte
furono portate sacre ossa di San Marco, dicendo quei che le portavano esser « granzis », che in quella
lingua carne di porco che essi hanno a schifo.
Si puo dire che la città di Alessandria abbia nell’ovato suo quattro porte maestre, situate verso li quattro
angoli principali della terra, secondo i quattro venti, levante, ponente, ostro, tramontana, tenendo la sua
lunghezza a ponente e levante, e la larghezza per l’altro verso, in modo che la Porta di Roscetto stia a
levante e quella del Castello Vecchio a ponente, al dirimpetto l’una all’altra, per linea dritta e per via larga e
principale e nel piu abitate e piena di gente e di edefici e moschee. Vera cosa è che la porta del Castello
Vecchio è piccola né serve ad altro che per uscire al porto vecchio a qualli del presidio, e ora intendo esser
murata. Ma la Porta della Marina e quella del Pepe, cosi detta percioché i camelli carichi di spezierie, che si
conducono per la fossa del Nilo appresso ad Alessandria, entrano per lei e non per altra, e di là, poi, su i
camelli portano alla città, si rispondono al dirimpetto similmente l’una dell’altra, se non vi fossero traposte
alcune case e cert’altre fabriche che lo rompono.
Narra Srabone che l’antica Alessandria era compartita in due strade maestre che si tagliavano in croce,
onde si puo credere che coloro quali fanno renovare le muraglie della città istessa abbino ritenuto la forma
primiera, percioché si vede espresso oggi ancora quella gran croce di strade, ché tutte l’altre vie di quella
città sono parallele a quelle due, incrociandole fra loro secondo il primo disegno datole da Alessandro il
Grande che la fabrico dalli fondamenti. E scrive le istesso Strabone che inverso ponente si distedeva questa
città fino oltra fossa detta Calis, che porta l’acque del Nilo in Alessandria nel lato che è verso ponente. Ma, al
tempo dell’acrescimento del fiume, le fosse della città sono tutte piene d’acqua torbida del Nilo.
Al presente non si conosce da lato alcuno, presso le mura, segno o fondamento alcuno del quale si possa
argomentare ivi esser stata parte della città.
Questa è la faccia di Alessandria nel primo incontro per difuori. Ma di dentro è cosa degna di compassione a
vederla, essendo afatto rovinata nè parte alcune ritenendo in sé né sembianza della gloria antica e della
grandezza de’miracolosi edefici de’quali e de tutta la fabrica della città sono pieni i scrittori greci e latini.
Or veniamo al di dentro.
Entrando per la Porta della Marina l’uomo si rempie di meraviglia veggendo quelle amplissime porte e di
forma nuova alle genti di Europa, le quali, con tutte le muraglie, furono, al mio parete, fabricate dagli
Imperatori Greci, quantunque non appaia memoria alcuna de cio, né lettere greche si veggono in tutta quella
città. Poco lungi della porta, tra molte rovine, é un bellissimo bagno, fabricato già da Sinan Pascià quando
era Governatore dell’Egitto. Alla sinistra è la Dogana, ove si spande un gran cortile e un coperto, ove
serbano le mercanzie. E nelle mura della città sono torri e stanze buonissime. Si va poi in strada detta
Bezaro ; ché è stretta, torta e oscura per esser coperta di tavole e di stuore. In quella strada si vende e si
compra ogni sorte di mercanzie che si trova in Alessandria, ed è un publico mercato e vi abitano i Franchi
nelli suoi fondachi, cioè nelli due primi fondachi, il grande e il piccolo. [Consoli de’mercanti di Alessandria]
L’uno vicino all’altro stanzano i mercanti col suo vice Consolo, e vi soleva anco abitare il Consolo, ma ora fa
residenzia in Cairo. Questi due fondachi sono commodi, e anco molti magazzini e assai stanze buone e
appartamenti onorevoli, e hanno di intorno le muraglie alte. Al fondaco piccolo, per esser nel cuore del
Bazaro, si riducono li mercanti a negoziare e trafficare le cose loro. Vi è il fondaco de’Genovesi e quello
de’Ragusei ; e i Ragusei hanno il suo Consolo che veste di porpora e di violato, come fa il Veneziano. Vi è il
gran fondaco della nazione francese fuori del Bazaro sudetto, col suo Consolo, il quale è il maggiore e piu
stimato de tutti gli altri Consoli, che similmente veste di roscio, il quale non è da un tempo in qua creato dal
Re di Francia, ma da una Madama francese, la quale, per meriti, possiede quella autorità di fare il Consolo di
Alessandria, traendone molto utile.
Tutti questi Consoli tengono due Giannizzeri e molti Dragomanni, che vestono di violato, cioè interpreti della
lingua turchesca nell’italiana, tratandosi di affari tutti in lingua italiana, e il Dragomanni poi riferiscono alli
Turchi in lingua turchesca, come si costuma anco in Costantinopoli che gli Ambasciatori delli Imperatori, del
Re di Francia, delli Signori Veneziani e de’altri prencipi negoziano col Gran Signore e con il Bascià in
italiano. Questo privilegio ha la nostra favella. Hanno i consoli cura delli mercanti, delle mercanzie e
de’vascelli, ciascuno della sua particolar nazione.
Il Consolo de’Veneziani, si come ho detto, soleva già stare in Alessandria, e ora abita al Cairo e tiene il suo
Dragomanno e due Giannizzeri, oltra i due Dragomanni e due Giannizzeri che tiene in Alessandria, il
medico, il barbiere, il capellano e un cavallo per la sua persona e due asini per lo Dragomanno e per l’uso di
casa, e veste sempre di rosato.
Questi Consoli sono pagati, con tutti gli altri del suo servizio, delli denari che si cavano delle mercanzie che
vanno e vangono a tanto per cento ; e, piu mettono, alcuna volta, sopra la mercanzia qualche gravezza per
mantenere le gravi spese. Quello di Francia guadagna assai, percioché, essendo il porto di Alessandria
libero e sicuro ad ogni nazione, molti si fanno Francesi e passano sotto la protezione di quel Consolo, che,
senza lui, non si porrebbero a rischio, come Fiorentini, Genovesi, Messinesi, Napolitani ed altri popoli
soggetti al Re di Spagna e ad altri prencipi, che trafficano in Egitto, (perchè) nemeci dell’Ottomano. E non ha
molto che soleva stanziare in Alessandria il Consolo di Barcellona.
Già tempo i mercati e baratti solevano farsi in Alessandria e i mercatanti vi albergavano, onde era molto
frequentata quella città. Ma ora i negozi sono ridotti al Cairo e i mercanti portano le ronne loro e li danari in
quella città, e cosi, a poco a poco, rimane abbandonata Alessandria, tale che si crede col tempo non
esserve per abitare altri che i marinari. Il venerdi si serrano tutti i fondachi dei Franchi in Alessandria mentre
che per due ore, sul mezzo giorno, fanno l’orazione li Maomettani ? Né sarebe senza perciolo il lasciarsi
trovare fuori a quell’ora, perché dicono trarsi dalle profezie loro dove esser presa la città di Alessandria dalli
Franchi un giorno di venerdi. Serrato anco ogni fondaco la notte ; e si apre poi alla dimane, tenendo le chiavi
i Turchi, avendo cio procurato i Franchi stessi per causa de’ladri, onde ogni notte si fanno le guardie con
diligenza in ciascuno fondaco dalli Alessandrini maomettani pagati dalli mercanti. Alcuna volta è intervenuto
che i ladri hanno di notte scalate le mura, overo nelle cisterne sotto terra penetrato, fin dentro li fondachi, e
uccisi e rubbati, anco a viva forza, quelli che li difendevano.
Ciascuno mercante puo stanziare nel fondaco della sua nazione senza pagare nulla della sua stanze ed ha,
secondo la condizione sua, stanza buona, dando solo il diritto che riceve la mercanzia, che i Veneziani
chiamano cottimo.
[Chiesa di San Marco e luogo dov’era sepolto e fu rubato]
In capo a questa strada detta detto Bazaro è una gran porta, e oltra quella porta il fondaco de Francia, che è
il maggiore e il più onorato de tutti. Andando più inanzi, oltra il fondaco sudetto, si entra nelle rovine della
città chiamate Carabe degli Alessandrini, che sono le antiche case cadute fino a’ fondamenti e ridotte in
monti.
E caminando per una lingua via, lasciando a sinistra, verso tramontana, le mura, si trova per quelle rovine la
chiesa di San Marco Evangelista, piccola e oscura, povera e mal tenuta, officiata da Cristiani Copti, [Coffi, e
loro religione] i quali usano de dir la Messa loro in lingua caldea, che ha trentaquattro caratteri, la maggior
parte de’quali sono greci, talché è chiaro essi aver tolte le sue lettere dalli Caldei. Ed io leggevo quasi tutte le
parole de’loro libri, de che essi ne prendevano gran meraviglia. Costumano leggere l’Evangelio prima in
caldeo e poi in arabo, come fanno i greci, ancora che primieramente lo recitano in greco e poi in arabo,
mostrando in quella chiesa il luogo dove fu sepellito il corpo di San Marco, il quale già più di settecento anni
fu con industria tolto di là e portato a Venezia, ove dal Senato gli fu edificata quella richissima chiesa, e lo
fecero protettore della città.
Ogni volta che i Copti celebrano la Messa, cantano alcuni deputati asaissime volte alleluia, battendo con
certi bastoni in alcune picciole tavole che tengono in mano e mandando fuori suono di allegrezza
artificiosamente e dicendo il « Pax vobis ». Il più giovine di loro va toccando la mano a tutto il popolo che è
alla Messa. E nell’entrare in chiesa lasciando fuori le scarpe e, dopo la consecrazione del pane, ne danno un
pezzo non sacrificato a quelli che sono in chiesa, come fanno anco i Greci e i Francesi, e nelle preghiere
pregano per il Papa nostro e fanno professione di essere della religione istessa che il Re della grande
Etiopia, il quale si dice Preteianni, ed esso lo nominano, cioè, Re ed Imperatore della Abasia.
Più oltre di questa chiesa sono alcune case abitate, quasi in quartiero separato dalli sudetti Copti e da alcuni
pochi Greci e da qualche Cipriotto e da quelli Franchi li quali non vogliono stare nelli fondachi.
[Obelischi d’Alessandria]
Presso a questo luogo, accosto le mura bagnate dal mare, sta ancora in piedi un obelisco, overo aguglia
scolpita tutta di lettere antiche egizie, alla sembianza di quella che si vede in Roma nella Piazza di San
Macuto e di quella sorte di pierra medesima tebaica, granita rossa, ma bene molto più alta e più grossa, al
parer mio, di quella di Roma, che si vede dietro la chiesa di San Pietro, ercioché, quantunque ella sia
alquanto sotterrata e larga, per lato, dieci spanne di uomo, col primo nodo del dito grosso per gionta. Ivi
presso ne giace un’altra, della istessa grandezza, distesa in terra, rotta e nelle rovine quasi sepolta, ove è
una gran piazza e una conserva di acqua antica, che non si adopra, con due ordini di colonne. Ed è cosa
mirabile a vedere, per la qual cosa, forse, potrebbesi con ragione dire ivi essere il sito ove giacea lo
Ipodromo da Strabone scritto.
[Descrizione del Patriarcato ch’è fatto moschea]
Per un’altra strada, paralella a questa che io dico stare la chiesa di San Marco, si vede il tempio bellissimo e
ornatissimo di colonne diverse, finissime, il quale al tempo de’Cristiani era il Patriarcato, fabricato in forma
quadrata, scoperto nel mezzo e piantato da alberi posti in striglia. Ha d’intorno le sue belle volte sostenute
da colonne e le sue loggie, ed ognuna dai lati ha più porte. Non vi puo entrar Cristiano alcuno, neanco
apena ve si puo fermare a mirarlo. Ora è la principal moschea di Alessandria, dalla quale tutte l’altre
moschee attendono il segno del chiamare il popolo all’orazione, cominciando il Talismano di quella e
spandendo una certa bandiera quadra sopra la torre che era campanile –dapoi seguitano i Talismani
dell’altre moschee, -ritenendo al presente ancora il primo luogo.
Oltre la chiesa sudetta, più ad ostro, si trova la strada principale di Alessandria, che va alla Porta di
Roscetto, che è paralella con l’altre due da me ricordate di sopra, secondo che io ho descritto tutta la città
essere distinta in vie le quali, al dritto incroccichiandosi, sono tra loro paralelle, cioè quelle di levante a
ponente con la strada maestra dalla Porta di Roscetto al Castel Vecchio, e quelle da ostro a tramontana con
la via che va dalla Porta del Pepe a quella della Marina. Vi sono altre chiese de’Cristiani Cofti e greci, come
Santo Saba, residenza del Patriarca delli Greci, ove i Franchi hanno uno altare e luogo, nella chiesa, per
sotterrare i morti, il qual Patriarca de’Greci avendo fatto fabricare presso Santo Saba il monastero per stanza
de’Caloieri e sua, venne voglia a certi Macomettani di Alessandria di dire che esso, sotto specie di
monasterio, il Patriarca aveva fatto una fortezza e che voleva mettervi delle arteglierie. Inde si levo il popolo
a furore e, se non che il Console di Francia e Viceconsolo della nazione di Venezia ve si interposero, quella
fabrica tutta atterrata e i poveri Caloieri ammazzati, tanta è l’invidia che portano quelle genti a’Cristiani.
[Pozzi e conserve di acqua di Alessandria mirabili]
Cosa meravigliosa in Alessandria è che tutta la città di sotto è vota, fuori che le fondamenta degli edefici che
sono in tierra, e sta sopra le volte e tutte le colonne, nelle quali volte e pozze si conserva l’acqua, percioché,
non nascendo acqua buona da sé in tutta quella contrada, per esser il fondo del terreno salso e che produce
del salnitro assai, [Salnitro assaissimo in Egitto per far polvere d’artiglieria] anzi è tutta salnitro, si come è
anco tutto l’Egitto ove non bagna il Nilo, talché non manca materia di comporre polvere d’artiglieria in copia,
per dir cosi, infinita, bisogno di fornire la città di assaissime camere o pozzi per conservar l’acqua, onde in
publico se ne vengono molte e in privato ogni casa ne ha più di una, accioché tanta gente, quanta era già in
quella amplissima città, non patisse d’acqua, la quale, secondo la sentenza di Pindaro, è cosi ottima, e anco
a fine di poter raccogliere l’acqua nova, torbida, che non si puo bere se non purgata dopo molti di nelle sue
deputate conserve, e averne dell’altre piene d’acqua vecchia, si che, come ho detto, fu necessario che tutto
il sotto di quella città fosse pozzi e conserve di acqua. E chi non ha in casa queste conserve, patisce
grandemente d’aprile, di maggio e tutto il resto del tempo, fino al mese di novembre, percioché l’acqua
cominciano a sentire di fango e a non essere cosi chiare, la qual cosa fu notata da quello autore il qual
scrisse la guerra Alessandrina fatta dal Divo Cesare, fosse o Hirtio overo Oppio, in che si puo considerare
gran diligenza aver usato Alessandro Magno poiché, essendo affatto il rimanente degli altri edefici, e grandi
e piccioli, ridotti a niente, le cisterne sole siano restate e servono al presente ancora, parendo fatte di poco
tempo. L’architettura loro è tale : sono le volte sue profonde tre o quattro passi, di cinque piedi di misura,
fabricate di pietra lavorata in quadro, non di mattoni, e incrostate in fondo di quella istessa materia che sono
anco a vedere gli antichi acquedotti di Roma, fatta credo io di mattoni pesti con altre cose dentro, perché
rosseggia e ve si discerne espresso il mattone pesto.
Alcune cisterne sono molto grandi e profonde, con due ordini grandi di colonne, l’uno sopra l’altro, e distinte
e compartite in quattro quadri e più, e in esse agevolmente si discende per alcuni buchi tondi, quasi pozzi,
quali nel giro hanno le pietre cavate come scaglioni, per mettervi dentro i piedi e le mani. Scesi a basso, si
vede la gran piazza e il cielo coperto incrostato nel modo che ho detto.
[Fossa del Nilo che dà l’acqua ad Alessandria]
Molte sono andate in disuso, si perché, essendo mancato il numero del popolo, non bisognano, e si perche,
non avendo nettate ogni anno, sono turati i canali, e solamente da poco tempo in qua, per avviso d’alcuni
Ebrei, hanno cominciato a nettare le cisterne e il canali. Un’altra sorte di cisterne si vede acanto a queste
grandi e, per dire cosi, maestre, le quali sono minori e fatte per conservare l’acqua più netta in questa guisa.
Passa (come appresso si dirà apieno) la fossa del Nilo vicino alla città due miglia verso ostro, correndo per
linea paralella alla città, snonché, nel fine, piega verso le mura e mette nella fossa delle muraglie, la qual
fossa del Nilo tiene nella ripa sua, che guarda verso Alessandria, alcune porte fatte di muro con gli usci suoi
di ferro, per le quali porte, al tempo dell’accrescimento del Nilo, l’acqua entra e, per diversi condotti fabricati
sotto terra in volta e incrostati come le cisterne e posti nel lungo della ripa in siti diversi, con li suoi spiragli di
sopra, corre verso la muraglia della città ed a’suoi luoghi sotto le fondamenta delle muraglie, e per loro si
comparte per le cisterne grandi con arteficio raro, andando per li suoi rami e canali disposti per tutta la città,
per li quali rami e canali, quasi per vie, che sono alcuni che con lumi vi sanno andare. E riescono in questi
grande conserve di acque e sono governati in questo modo questi canali che, nel principio
dell’accrescimento del fiume, non si aprono le porte, ma, a fine che la più sporca acqua se ne vada, si lascia
scorrere alcuni giorni. Purgata che ella è, in parte aprono le porte, e l’acqua corre a vestire le cisterne.
Quando poi cala l’acqua del Nilo, cala anco l’acqua di quelle cisterne e ritorna nella fossa che si dice Calis. E
quando si beve di quell’acqua cosi torbida, cagiona molte malattie.
Piene che sono le cisterne maggiori, cavano da loro l’acqua per via di certe ruote grandi fornite tutte ad
intorno della sua circonferenza di Boccali col collo lungo e istretto e voltate da buoi, le quali sono dagli Arabi
nomate « sachie », onde forsi depende la parola spagonla « sachar », cioè « cavare ». Ma li Greci le
chiamano « aleatis ». E ne ho io veduto in Oriente e in Spagna e per tutto dove si ha scarsità d’acqua,
nomandosi in Spagna « anovè ».
Cavano dico l’acqua mediante quelle ruote dalle cisterne grandi e la ripongono per via de’canali nelle piccole
e, sebene queste paiono congionte con le grandi, tuttavia sono distinte da muraglie, siché l’acqua dell’una
non passa nell’altra, e sono di fondo separato ; e cio fanno a fine che l’acqua meglio si purghi e si mantegna.
E si vede, in molti luoghi, la gran cisterna di larga bocca, con molte altre piccole vicine, quasi figlie, le quali
tengono dalla grande l’acqua separata, il che fu necessario, come si è detto, per conservazione dell’acqua
nel tempo dell’accrescimento del Nilo. E non solo in publico si veggono queste cisterni grandi e piccole, ma
ogni casa ne ha molte ; e in ciascuna, finalmente, si entra per certe scale intagliate nelle pareti loro.
I sassi per fare queste cisterne e per fabricare le case si prendevano su la riva del mare presso la città due
miglia, ove si veggono al presente le caverne e segni di cio e il villaggio detto Ramole, cioè arena o
sabbione, per esservi monti d’arena ammassatavi dalli venti. E ivi appresso è un altro villaggio detto Come
La Fia, abitato nel più da Giudei, per causa dell’aere buono, ove se retirano tutti tempo della pestilenza,
talché prima, verso levante, si trova il villaggio Come La Fia e, poi, Ramole, nel quale si puo credere per
molte congietture essere già stata la città di Necropoli, ove Cesare Augusto vinse l’ultima volta Marcoantonio
e lo condusse a darsi per se stesso ma morte.
In quel sabbione stanno molti pozzi di buon’acqua nascente : vi sorgono giardini pieni de frutti : melloni, fichi,
uva e simili, e si veggono vestigi de grandissimi edefici e appare l’acquedotto antico e li manifesti segni della
fossa Canobica su la strada di che favella tanto Strabone. La città di Alessandria, in generale, è abitata in tre
luoghi separati l’uno dall’altro. Nel primo, ove è il Bazzaro, cioè la strada del trafico e del mercato e del
ridotto de’mercanti, e i fondachi tutti, fuori che quello di Francia, sono nella istessa via. [Nazareno nome
rimaso a’Cristiani] Nel secondo, ove stanno i Cristiani Cofti e li Greci e alcuni Franchi, i quali Cofti se dicono
nostrani, cioè Nazareni, col quale nome gli Arabi chiamano i Cristiani, essendo Nostro Signore Giesù Cristo
allevato in Nazzareth. E il Giudeo che era meco chiamavano Givit, cioè Giudeo ; e cosi i Turchi nominano il
Giudeo Chifut. Il terzo loco abitato di Alessandria è dalla Porta di Roscetto fin quasi al mezzo della
lunghezza della città, e vi sono molte buone case e moschee e altri edefici e la più bella parte di tutta la città,
su la quale strada, di qua e di là, stanno ancora in piedi, vicino al Patriarcato, molte colonne grandi, come
della piazza di San Marco, e dell’istessa sorte di pietra, piantate in striglia.
[Segni del Gimnasio e della Libraria di Tolomeo]
Dicono gli Alessandrini che quell’ordine di colonne seguita fino alla Porta di Roscetto, ma io non ho che
affermare se forse ivi non fosse stato alcuno delli palaggi reali fabricati dalli Re Tolomei o, per aventura, il
sito del Gimnasio overo Biblioteca o Libraria edificata dal secondo Tolomeo, detto Filadelfo, nel quale fama
che ragunasse tanti libri e che facesse tradurre di ebreo in greco tutti i volumi delle Sacre Lettere, i quali in
greco si chiamano « biblia » per eccellenza, cioè libri, la quale Libraria poi arse tutta al tempo del Divo
Cesare mentre che egli in Alessandria, dopo la porte di Pompeo, guerregiava col Re ultimo Tolomeo.
Sono, pero avanti, verso ponente, nella strada istessa, altre colonne della pietra medisima, minori. E il
restante della città è quasi tutto rovinato e abbandonato, senonché, verso la Porta del Pepe, sono alcune
poche case ; e il Bagno è appresso al Castel Vecchio. Né si vede altro che monti di rovine e case disabitate
e si conosce espresso gli edefici antichi esser stati fabricati di pietre, senza legnami, e li tetti e coperti fatti in
volta. Ma quella pietra è cosi tenera che i venti di ostro e di terra, che sono caldi e secchi, la rodono e
consumano, né vi possono durate e restano quelle pietre forate e ridotte in polvere.
E quando cade una casa, più non si rinova, talché quell’amplissima città, a poco, se ridurrà al niente.
Nella città sorgono quattro gran colli, i quali sono non naturali ma fatti dal portarvi per tanti secoli le
immondizie delle case e il terreno e delle altre materie che da’ fondamenti si cavano dalle fabriche e dalle
rovine sue, e le spazzature e la terra che, nettandosi le cisterne, traevasi fuori, le quali tutte cose, in
processo di tempo ammassate insieme, hanno ben pottuto inalzare quelli quattro monti, come si vede, a
Roma, per tal cagione essere accresciuto a tanta altezza il monte detto di Testaccio.
Il primo di questi monti, apunto, è chiamato dalli Veneziani il monte delle Scovazze, cioè spazzature. È
situato al dirimpetto del molo del porto e s’erge in forma di piramide, nel colmo del quale è posta una
torretta, dalla quale si scorge, di lontano, il mare. Ivi, quando si scuopre qualche vascello in mare, piantano
gli Alessandrini una piccola bandiera per darne segno alli mercanti. E se sono più, spiegano tante bandiere
quanti sono vascelli. Di là si riconosce apieno tutto il sito di Alessandria, ma non vi si puo andare senza
rischio, vietandolo i Turchi. Nondimeno, con l’occasione della venuta di qualche nave, i Franchi vi montano.
Gli altri tre monti questa medisima qualità sono posti a ponente della città. Vi sono molti giardini con erbaggi
e frutti e melloni, buoni secondo le stagioni, e sopratutto vi sono assaissimi carcioffi, o artichiocchi che si
chiamano, de’quali se ne mandano anco al Cairo. Vi sono molti bagni commodi e belli e servono benissimo
gli Alessandrini, e si paga poco. Si macina il grano. Sono li molini girati da buoi e da cavalli, non solo in
Alessandria, ma in tutto l’Egitto non avendo ingegno da farne da vento o sopra i fiumi.
Volano di continovo sopra quella città infiniti augelli, come nibi e tortore e altri, non dando loro noia li
Maomettani. Ma i Franchi con le balestre da balotte ne amazzano assai.
[Artificio notabile de’suoli o selicati delle case di Alessandria]
Veggonsi per le case abitate e disabitate molti marmi e pietre de colori diversi e lavorate in quadro, in tondo,
in stella e in altre forme, con cui componevano con singolare maestria i suoli e i pavimenti delle case, e
incrostavano i muri, quei buoni antichi, opera veramente maravigliosa si per lo lavoro e commissura di quelle
pietre ben lavorate, come per la qualità ed eccellenza loro e per la diversità de’colori. E vi ha qualche casa
nella quale è rimaso intero cotale edeficio e si vede compiuta l’opera e gli spazzi e pavimenti forniti. Ora
quell’arte è affatto perduta, nè più sanno farne di nuovo, ma tengono ben tanto giudicio che commettono
insieme i pezzi trasportandoli da a loco e togliendo tutto un suolo di una casa, commettendolo nell’altra, si
come ho veduto io che di una casa vecchia avevano levato un bellissimo pavimento e lo portavano al Cairo
per servirsene in una casa nuova. I marmi con vene negre dentro portavano in Alessandria dall’Isola di Paro,
ove nasceva anco il bianchissimo marmo, e più dall’Isola che giace nella Propontide, che si dice oggi il Mare
di Costantinopoli, nomata oggi di Marmara, nella quale sono montagne di marmo venato nero, di cui già era
incrostada la chiesa di Santa Soffia di Costantinopoli ; e molti pezzi se ne veggono, toldi di là, nella chiesa di
San Marco di Venezia. Ma le rosse pietre e di altri colori e le nere, simile a quelle che si nomano di tocco, e li
porfidi si conducono giù per il Nilo, parte di Etiopia, detta oggi Abasia, e parte della Tebaida, che si dice Sait,
ove dicono oggi vedersi ancora li monti de tali pietre e le caverne ove tante se non state cavate.
Al presente tutte le belle cose di Alessandria si portano al Cairo, ove, da poco tempo in qua, si veggono
assaissimi di questi lavori e nelle case e nelle moschee, essendo cresciuto il Cairo in tanta grandezza per le
rovine di Alessandria e per la residenzia delli Soldani e per le gran commodità del fabbricare.
Le case di Alessandria sono, nel più, di forma quadrata lunga, con le sue cisterne dentro. E hanno le spazzo
composto di finissime pietre, come ho detto. Il lume hanno di sopra, con un pertugio che, appunto, è nel
mezzo del tetto ; e tutte sono di terra. Non hanno finestre, o molto piccole. I letti stanno d’intorno a questo
quadrato, in certi nicchi ; e non hanno scale, o piccole, e le porte piccole, strette e basse e l’entrata torta e
buia, senz’ordine o architettura.
Degli antichi edefici non si vede nulla, di modo che, lasciando l’antichissima Troia e Ninive e Babilonia e
Cartagine e Atene e Lacedemone e qualche altra, non stimo che vi sia città alcuna più distrutta, rispetto alla
sua fama, di Alessandria.
[Popolo di Alessandria]
Questa città è abitata da Alessandrini, Maomettani e da Turchi, i quali vi stanno per guardia e per negozi, e
da alcuni pochi Cristiani Cofti e Greci e da assai Giudei, i quali stanno fuor della Porta della Marina, e dalli
Franchi mercatanti. [Monete di Alessandria] Si usa moneta di varie sorte. La moneta di loro si chiama
« sultano » e pesa quanto il ducato zecchino veneziano ed è di cosi fino oro e vale 45 maideni di quella
moneta di argento, il qual maideno è la terza parte di un giulio o di un marcello veneziano, overo quattro
soldi veneziani ; e questi sultanini non hanno immagini o figure di sorte alcuna, ma lettere che, nel più,
dicono il nome del Signore de’Turchi che allora regna, come Sultan Selim. Aam significando quell’Aam in
lingua turchesca tartara, Imperatore.
La seconda sorte di monete è il maideno, che, come ho detto, vale quattro soldi veneziani. Vi è poi un’altra
sorte di monete, chiamata da loro foller, cosi dechiara li sui da « follis » esser stata sorte di moneta, e in
Creta chiamarsi le medaglie in quella loro lingua foller, che è di rame, sei de’quali fanno un maideno, che si
chiamano foller grandi. Vi è un’altra maniera di questi folleri, de’quali dodici fanno un maideno ; e la terza
sorte, che sono come bagatti veneziani, de’quali 48 fanno il maideno.
Questo sono le monete del paese. Si vede anco qualche seriffo battuto alla Mecca, ma ora non si coniano
più monete a Mecca dalli Signori Seriffi, ma dall’Ottomano che n’è signore. Le monete forestiere, poi, sono li
scudi, che corrono assai con guadagno, i ducati d’argento di Venezia, con guadano de un maideno. Ma le
giustine non vagliono se non con perdita, né si spendono questi lironi nuovi per nulla, né le monete nuove di
Venezia, come le gazette. L’altre monete vecchie de’Veneziani passano con guadano. Sono in molta stima
tutti i reali di Spagna e di Napoli e di Sicilia, e i testoni francesi, de’quali tutti va gran quantità in quei paesi
per comprarne speziarie e mercanzie.
Sono quelle nazioni di Alessandria piene di frauda e ingannatrici e ingarbugliano e sempre, di mercato fatto,
ritengono qualche cosa.
Vi è assai vino, e si vende due scudi e manco il barile, e viene portato da Provenza, da Napoli, da Sicilia, da
Candia, da Rodi, da Cipro.
Dal Monte Libano vengono condotti i frutti di Attalia, che si dice Satalia, come mele, pome, uve, prune,
melgranate, e anco di queste alcuna volta di Sitia, terra della Isola di Creta, e della uva, la quale è molto
amata da quelle genti ; e vi portano anco del mele. L’oglio hanno da Barberia e il butiro da quella parte che
si appellava Cerenaica ; e nell’istessa Alessandria e ivi d’intorno si fa butiro assai. Sono gli uomini di
Alessandria accorti affatto e pratichi del mondo, e, quando vi capita un uomo nuovo, subito sanno di che
nazione è e che va facendo, e parlano molte lingue.
[Giardini fuori d’Alessandria]
Uscendo fuori della Porta di Roscetto, si trovano le saline, copiosissime di sale bianco, e, piegando alla
destra verso ostro, si va alli giardini, che sono molti e grandi e abondanti de frutti e di erbaggi, secondo la
stagione, posti ad ambedue le rive della fossa per molte miglia si fattamente che di lunge pare un perpetuo
bosco di palme e di altri alberi, come aranci, fichi, limoni, cedri di Sebertia di Carie e di sicomori e di altri
alberi fruttiferi.
A questi giardini vanno spesso i mercanti a diporto e, con le loro reti e balestre da ballotte, alla caccia delle
tortore e dei tordi e di altri augelli, de’quali è gran copia, massimamente il verno, allora che spira il vento di
garbino che dice anco libecchio, cioè di Libia, i quali menano la pioggia e grandissima copia di tordi, che si
ingrossano con li frutti delle palme chiamanti dattali, e sono tanto caldi di stomaco che, come i struzzi,
inteneriscono anco il nocciolo suo. Ma le tortore sono magre e dure. In tutto l’Egitto si pigliano anco il mese
di settembre, con le paine, assaissimi augelli grossi affatto, i quali sono di passaggio dell’Europa all’Africa,
ma non sono cosi buoni come in Cippro, né sani, ma bene della stessa maniera, come beccafichi, pettirossi,
lusignoli, capinegre e altri che noi chiamamo ucelli di uvetta, e ve ne è in tanta gran copia che si insalano e
si vendono a buona derrata.
Alle ripe de questa fossa sono molti casamenti, fabricati già dalli Signori Ciracassi, o Mamalucchi che si
chiamano, i quali solevano essere commodi e magnifichi e di gran piacere, ma ora vanno a rovina, mancati i
padroni loro, né trovandosi chi le rinove e abiti. Pure vi stanno alcuni villani, a coltivare gli orti. E io vi sono
andato con li mercanti veneziani a desinare sotto quell’ombre e fra quegli alberi sempre verdi, facendosi
alcune volte il desinare, in quelle case mezze cadute, sotto alcune belle logie che guardano sopra la fossa
nella quale di novembre, non corre più, ma vi resta dentro, l’acqua per tutto, come in stagno. Mangiando,
surgono sopra l’acqua i pesci a pigliarsi il pane che se gli getta, li quali sono di nova forma rispetto alli nostri
di qua, con certe guancie lunghe, quasi mustacci, che non sono buoni a mangiare.
Sempre sono per quei giardini femine a lavorare che si dicono Baduine, le quali, per un maideno, cantano, e
danzano, e fanno ogni cosa, purché si possano scantonare, e mostrano il suo dinanzi e il suo di dietro senza
vergogna.
Si adacquano quei giardini con fatica de’buoi, i quali levano su l’acque del fiume raccolte in grande cisterne.
E si vedono assai fondamenta e rovine di fabriche antiche, di modo che si puo credere, al tempo antico,
esservi stati in tutto quel tratto bellissimi edefici, orti e altre cose dilettose.
Non lascio qui di ricordare che in quei giardini sono molte erbe, le quali, ogni anno il verno, si sfrondano né
di loro che la radice sotto terra rimane, come il mirasole catoprezia, che si dice la magiorana, e altre ; ma ivi
sono alcuni arbori assai grossi, ed è chiaro che, nell’Indie, anco il bambagio nasce negli alberi.
[Descrizione della fossa del Nilo che conduce l’acqua in Alessandria]
Ne ho molte volte fatta menzione della fossa che conduce l’acqua del Nilo alla città di Alessandria, onde
sarà forse necessario, per notizia di quello che in qui si è detto che si ha da narrare, descriverla brevemente.
Il fiume Nilo si parte in due rami principali, lontani dal Cairo sedici miglia, l’uno che va alla destra, verso
Damiata, e l’altro alla sinistra, verso Rosceto, e formano Il Delta, cosi nominato dagli Antichi, del quale si
tratterà poi. Lontano dalla foce di questo ramo sinistro di Roscetto forse trenta miglia, sotto il villaggio detto
Fua, comincia la fossa, o rivo, che porta l’acqua in Alessandria, veggendosi ivi, alla boca, segno di fabriche
antiche per mantenere la ripa del fiume e agevolare l’entrata dell’acqua, le quali, essendo rovinate, l’hanno
poco tempo fa rinovate. Questa fossa, che si chiama in arabo Caliz, è cavata per la pianura quasi tutta
coltivata per causa dell’acqua che vi puo montar sopra ; e dove non è il terreno coltivato, vi sono laghi che,
poi, seccandosi, fanno bianchissimo sale. E, dal principio di questa fossa fino al suo fine, ove mette sulle
fosse di Alessandria, e poi, per via di certi cannoni di pietra, in mare presso il Castel Vecchio, sono forse
quarantacinque miglia. È navigabile all’in giù e all’in su con vascelletti piccoli, detti zerme a vela e a rami da
Alessandria fin dove ha principio nel Nilo, non già tutto l’anno, ma d’agosto fin tutto l’anno nel tempo dello
crescente del Nilo, con grandissima commodita e risparmio de’ mercanti e de’viandanti, accorciandosi molto
il camino. Poco avanti ch’io vi andassi, essendo molto cresciuto il terreno, i Turchi lo avevano fatto ricavare
da un capo all’altro, fondo un passo di misura, parte con li danari pagati dalli mercanti di Alessandria d’ogni
nazione e legge e parte con angaria de’villani vicini, chiamanti Beduini. Credesi che, al tempo dei Re
Tolomei, ella corresse e fosse navigabile tutto l’anno e, più, che ella fosse tutta nel fondo selicata e
mattonata.
Gionta che questa fossa è al dritto di Alessandria, come ho detto, per molti passi d’acqua e irrigando quelli
giardini che sono alle sue ripe, di qua e di là, va a scaricare le sue acque nelle fossa della città e, poi, per
canoni di pietra, nel porto vecchio presso il castello sudetto.
Di là da questa fossa verso ostro, la quale vi varca in molti luoghi per ponti d’un arco solo, per essere larga
mai più di due passi, oltre quelli giardini, giace il lago detto dagli antichi Marea e Mareotide, di cui Strabone
scrive apieno. Ora non vi è altro che il sito ed è perduto poco meno che affatto l’uso della navigazione ed è
cessato quel gran traffico di lui con la città di Alessandria, come scrive il sudetto autore esservi stato a suo
tempo.
Questo lago è fatto dall’acque del Nilo quando, alla stagione della crescente, trabocca e monta sopra le
pianure dell’Egitto ed esce fuori per molti rivi del suo gran letto ; l’acque del quale non ritornano più, nè meno
sono dalla terra sorbite, ma scorrono e restano nelle basse e, seguendo la sua natura, fanno non solo
questo, ma infiniti altri nell’Egitto, colando e andando a morire nelle basse ove rimane salata per causa del
fondo del terreno che è salato e pieno di salnitro.
Gli Alessandrini chiamano quel lago Sabach, avendo perduto il nome primiero. La sua maggior longhezza è
verso ostro, per quello che riferiscono gli uomini del paese, e la sua larghezza da levante e ponente.
Strabone afferma la sua maggior lunghezza essere trentadue miglia, con la larghezza di diciotto.
Al presente non si ha da lui altra utilità che di legno, e si veggono quelle isole che egli nota, ma non vi nasce
uva nè vi sono, all’incontro, villaggi, come a’suoi giorni, cosi la setta maomettana va distruggendo ogni cosa.
Questo lago rende l’aria di Alessandria molto trista, come dicono i medici di quel paese, quantunque al
tempo antico fosse cosi buona. E io ho conosciuto per prova che di verno e di state l’aria di quella città è
torbida e malenconica e apporta malattie che difficilmente guariscono, né si puo liberamente prendere il fiato
e si pena assai a recuperar le forze, percioché non aiuta la digestione quantunque spirino i venti maestri,
nomati, Etesii da Cesare, cinque mesi continovi, i quali veramente rinfrescano cosi l’aere che non si patiche
caldo, anzi, la notte bisogna tenere due coperte e il giorno vestir caldo. Tuttavia non sono sani quelli venti,
senza i quali, non di meno, sarebbe quella città inabitabile. Ma la state è un piacere rispetto al verno che, per
il freddo, per la pioggia, per il fango e per li venti si tollera difficilmente la vita. La mattina, a buon’ora, si vede
una sottilissima nebbia, nata la notte, la quale bagna come pioggia e si dilegua poi, crescendo il sole, la
quale sente di solfo ed è molto mal sana e fredda.
[Colonna di Pompeo, cosi detta]
Fuori della Porta del Pepe un miglio, per la strada dritta verso la fossa, vassi a quella grande e meravigliosa
colonna in grossezza e altezza, percioché ella è grossa quanto conque uomini, stendendo le braccia,
possono cerchiarla. Ed è di pietra tebaica, come l’agulia, overo obelisco, che è dietro San Pietro in Roma, o
della sorte che sono le colonne de San Marco a Venezia, cioè quella rossa. Sta quasi sopra un cubo, overo
dado, grande, di un pezzo dolo, della istessa sorte di pietra, il quale è alto dodici palmi e lungo quindici, dico
palmi, cioè spanne col primo nodo del dito pollice. Questo cubo posa sopra un muricciolo fatto di pietre e di
calce, rotto in alcune parti e racconcio che minaccia rovina, onde io stimo in breve tempo quella machina,
per trascuragine, esser per cadere, nè posso io intendere come al principio fosse ella cosi mal fondata.
Sopra il cubio e la sua gran base con le cornici ergesi la colonna ; e vi è in cima il capitello, grande e
schietto, lavorato a foglie di acanto senza molt’arte. Dicono i Franchi che fu dirizzata in onore di Pompeo
Magno, chiamandola la Colonna di Pompeo ; ma non si veggono lettere, né di tal cosa, che io sappia, fassi
menzione nelle antichi istorie, né cosi credono gli Alessandrini e gli uomini del paese.
Ivi presso e per tutto son fondamenti e segni di grandi edefici. Poco più oltre è la fossa e il lago, e vi va la
strada maestra che conduce in Nubia, e più là è una grande moschea, presso la colonna, sotto la quale
sono alcune grandi e profonde caverne, nelle quali è fama esservi nascosi tesori guardati da demoni, né ve
si puo scendere percioché intendo moversi un rumore che sembra acqua, e spaventa chiunque ardisce
entrarvi.
D’intorno alla colonna, e per tutta quella campagna che giace fra lei e la città, nascono da sé, sen’arte,
assaissimi cappari e buoni, e ne insalano le botti e mandanle fuori, oltra a quelli che si mangiano in
Alessandria, e sono grandi molto più degli ordinari.
[Descrizione della riviera del mare di Alessandria a Cirene e alle Sirti]
Lungo la riviera del mare di Alessandria, verso ponente, e fra terra, parimente il paese è deserto,
quantunque cinque miglia presso la città sorga una fontana di buon’acqua, detta Golette, ove sono orti,
erbaggi e frutti e melloni ; e più oltra sette miglia, sul lido, apparisce vestigia di città e di grande abitazione,
ove si dice Alessandria, e vi è buon porto ; e più là venti miglia, dove si dice la Torre degli Arabi per una torre
che vi è senza altra abitazione e abbandonata, nel qual sito è buon ridotto per vascelli a guisa di una fossa,
e si veggono molti fondamenti di fabriche come di città. Più oltre si va verso Cirene e verso le Sirti, nomate le
Secche di Barberia, e gli Arabi le dicono Certes, le quali sono due, la grande e la piccola. Dalla grande, che
è prima, fino ad Alessandria si contano ottocento miglia. Ed è cosa chiara tutto quel tratto, dalla Torre degli
Arabi fino alla Sirta grande, verso ponente, esser pieno de porti e di acque dolci e in qualche parte fertile, il
quale era già quasi tutto soggetto alla famosa Republica di Cirene. Cadde poi in mano dei Re Tolomei e poi
de’Romani, i quali mostravano tenerne poco conto, poiché mandavano un Proconsolo in Creta che sotto la
sua potestà e governo teneva Cirene ancora con tutto la stato suo, come si leggono espresso in più di una
pietra lettere greche scolpite in marmo fra le rovine della già amplissima città di Certina posta nella gran
pianura detta Mesarca della Isola di Creta, nomandosi quel Proconsolo Antipatos Krétes Kai Kerénes, cioè
Proconsolo di Creta e di Cirene, che è situata, apunto, al dirimpetto del capo occidentale di quell’Isola, detto
Crio. [Distenza da Cirene in Creta] Congionsero i Romani sotto un solo governo quelle due provincie vicine
tanto che, al tempo de’maestrali venti, che cominciano a soffiare il maggio e durano per quasi tutto ottobre,
vi si puo passare con la navigazione di poco più di un giorno naturale, non ve si traponendo più che lo
spazio di duecento miglia.
Questa contrada, che ho detto, di Alessandria fino alla Sirte maggiore, mentre fiori la Repubblica di Cirene e
al tempo dei Re Tolomei e, poscia, degli Imperatori Romani, era molto frequentata e abitata e più governata
da quei principi con buone leggi e civilmente. Ma ora è quasi deserta e in possanza di ciascuno che la
occupa e scorsa dagli Arabi e da certi popoli che chiamano Magarbini, ben conosciuti in Alessandria e in
Cairo percioché son gran caminatori e servono per tale effetto in quelle città.
[Condizione degli Arabi abitanti nell’Egitto, sue nemicizie, parti, nobilità, armi e vestimenti]
Vivono gli Arabi sotto le tende sue che portano seco, rubbando e mutando luogo secondo li paschi che
trovano e le acque in siti aprichi, non conoscendo altro prencipe che Dio né tra loro essendo signoria,
senonché gli uomini nobili e di antico legnaggio, di che fanno professsione, sono capi degli altri e vengono
seguiti da molte famiglie e riveriti, alla guisa de’Zingari, [Cingari e origine loro], i quali, al parer mio, sono di
quelle contrade di Barberia di Egitto e di Arabia e del paese de Cirene, cosi da Cireneo, mutando alcuna
lettera, si dice Cingaro e Cingano, sparse queste genti per tutta la Europa e uscite da quelle magne contrade
e deserte e ritenute nelle grosse e abitate di Europa. I Francesi gli appellano Egiziani e gli Spagnuoli Gittani
e gli Italiani Zingari. La lengua loro non è di Egitto, cioè araba, si come afferma il Magnifico Messer Paolo
Mariani, famoso mercante in Cairo, il quale intende e parla molti linguaggi, e massimamente l’arabico, e mi
diceva aver favellato con questi Zingari sul Padovano, ove egli ha possessioni, né essi avere inteso l’arabo
né egli la lor lingua. Ma, nel resto, la faccia, l’andare, il vestire e li costumi loro sono arabi. Questi popoli
arabi, come ho detto, albergano alla campagna, e pochi nei villaggi, massimamente nell’Egitto, né si
fermano giamai nelle città per starvi, né le famiglie loro, né vi pratticano, se non per negozio, ma quelle
usano nelle città che tolgono ad affitto i terreni del Gran Signore. E alcuni ve ne sono de questi capi di Arabi i
quali si chiamano Sequi, che, per esser fedeli all’Ottomano, hanno soldo da loro e sono creati Sangiacchi e
Governatori di provincie. Fanno professione di nobilità, e la mantengono, e di cavalleria, prezzando sopra
tutte le cose i cavalli e le armi, le quali conservano per eredità, e fra loro essercitano perpetue brighe e si
amazzano, si come presso Alessandria, mentre che io vi ero, nacque nemicizia fra due famiglie prencipali de
Arabi, l’una delle quali si nomava Catavi, i quali abitavano verso la Torre degli Arabi, alla montagna, e gli
altri, più al levante, alle ripe del Nilo capo de’quali era uno chiamato Lisa. Queste fazioni si venivano spesso
ad incontrare insieme, mille e più alla volta, talché tutte le strade d’intorno ad Alessandria erano battute e
mal sicure, né si arrischiava alcuno andare atorno. Un di fra gli altri comparvero fuori della Porta del Pepe
forse duecento di questi catavi, venuti per fare intendere al Sangiaco di Alessandria che, quantatunque
perseguitassero i suoi nemici, non erano pero rebelli del Gran Signore né per dar noia ad uomo alcuno
mussulmano o ebero o cristiano, se non agli suoi avversari, e, pero, domandavano che loro fosse data
licenzia di entrare nella città e di mandare le femine loro a fornirsi de vettovaglie, pressentando al Sangiacco
alcuni camelli e montoni. Io, con alcuni altri, andai a vederli, montando sopra le muraglie della città, di dove
fummo, ben presto, cacciati da un Turco con molte ingiurie di parole e con pericolo di essere accusati, onde,
veggendo che gli Arabi non davano impaccio a persona veruna, scendemmo alla pianura, a riconoscerli
meglio.
Hanno buonissimi cavalli, magri e senza ferri alli piedi, velocissimi e contenti di poco cibo, avvezzi di star
fermi da sé, smontatone il cavaliero, forniti di selle leggerissime con le sue staffe e con la briglia. Le loro
arme sono lance, non fatte come le nostre, che si adoprano con la resta, o, come quelle de’Turchi, vote di
dentro e poste in resta nell’urto, o vero arcione, dinanzi della sella con fortissime coreggie. Ma le sue sono
lunghe smisuratamente, col ferro in cima acuto, lavorato a foglia di oliva, e nel calcio un altro ferro pungente,
minore dell’altro, portandole nel mezzo e usandole, in combattendo, sopra la mano. Le loro lunghissime aste
sono di frassino e di abeto, recate loro d’Attalia, polite e lavorate in Cairo, ove sono maesti che non fanno
altro che adattare e dirizzare cotali aste. Li nobili e le persone di qualità si cingono anco la spada, ma, nel
più, non adoprano altre armi che queste lunghissime lancie, overo zagaglie, che essi chiamano maszraat.
Gli archibugi non conscono, né sanno maneggiarli, ma li temono oltramodo ; né gli possono comprare, ed è
pena a chi gli ne vende, per publico bando. Vestono poveramente, portando una berretta di lana rossa,
overo leonata, lunga e in cima rotonda, che li pende di dietro, overo all’orecchio. Alcuni la fasciano tutta col
dulipanno bianco di bambagio e alcuni hanno indosso, uno, due o più camiscioni o veste di tela colorata,
lunghe fino in terra, con le maniche larghe, a guisa delle ducali usate in Venezia, ma serrate dinanzi. Sopra
queste portano un certo manto largo quattro braccia e lungo quindici e più, che chiamano bedeno o baracan,
di lana che, nel più, é di colore, con le cimoscie vergate di colori diversi e vaghi, e se le vestono in modo che
nel mezzo sta sul capo e poi pende a’lati ed è raccolto di dentro alle spalle, talché egli pare il paludamento
usato da’Romani antichi : e veramente i Romani presero quell’abito da questi paesi, come si comprende
dalle statue antichissime, le quali, fatte avanti che i Romani signoreggiassero quelle contrade, hanno le
vestimenta come si veggono le romane, si i maschi come le femmine, con li suoi capucci e con li suoi pilei, o
galeri, che sono questi beretini da marinaro, lunghi, i quali già si costumavano in Venezia, come si consce
dalle pitture vecchie. Ed è casa poco ragionevole il credere che gli antichi Romani non portassero cos’alcuna
in testa, di che sarà tempo altra volta fare menzione. Portano anco le sue calze, larghe e lunghe fino al
tallone, come quelli de marineri, e in piè le sue scarpe, e battono i cavalli con la punta della staffa, non
usando, nel più, gli speroni, mutando il vestire in pare quanto più abitano verso la riviera di Affrica a ponente.
Nel resto sono canaglia povera, burgiarda, superba e data alle armi, e sobria, e contenta di poco, assassina,
nemica mortale de’Turchi.
In Egitto le capi degli Arabi si dicono Siequi, che significa Signore ed è voce de titolo che si dà solamente
agli uomini di seguito ed a’nobili. Sono dal Signore stipendiati e alcuni fedeli creati eziamdio Sangiacchi, ma
vivono di rapine e agricultura e delli bestiami loro. E alcuni sono capi di cavalli, come barigelli di campagna,
ed hanno cura di tenere guardate le strade. E avviene volte che gli Arabi vengono a rubbare fin su le porte
del Cairo, si come accade’nel mese di gennaro quell’anno istesso che mi trovai in quelle contrade, che,
andando a diporto alcuni Cairini ad un villaggio tre miglia lontano dal Cairo, inverso ostro, furono spogliati da
alcuni Siequi arabi, che avevano seco, molti Beduini, cioè villani, chiamandosi con tal nome i poveri Arabi.
Per quella strada istessa passai io pochi di avanti sopra un asino, accompagnato da Jaia Chiaris, fagliulo di
un rinegato veneziano, il quale bene a cavallo mi condusse a vedere quelle caverne e quel monte ove
furono cavate le tante pietre con le quali si fabricorno le tre piramidi che sono presso il Cairo e l’acquedotto il
quale dal Nilo menava l’acqua all’antica Babilonia, posta già, secondo Strabone, ove oggi è fabricato il
castello del Cairo. Quel Turco me lo venne poi a dire e mi assecurava che rade volte franco alcuno è mai
stato a vedere quei luoghi.
[Capo di Buon Andrea ridotto de’corsari cristiani]
Ma tornando alla riviera di Barberia, da Alessandria fino alla grande Sirte, è ridotto de’corsari di Ponente
cristiani e piena di porti e di acque buone molto, ben conosciute da loro che ogni anno vi scorrono con
danno notabile de Turchi, né sono molto aversi a’nostri, massimamente non gli facendo molto danno. Or, per
vietare questi gran danni’ de’corsari ponentini, l’anno del 1568 Ali Bassa, Capitano dell’armata di Ottomano,
avendo navigato da Costantinopoli in Alessandria, apparecchiandosi alla guerra di Cipro, che comincio due
anni appresso, disegnando vietare quei disegni de’ponentini e alle armate nemiche, delibero di piantare una
fortezza con l’arteglierie e presidio al capo detto dalli Cristiani Bonandrea, ove è porto e fiume, il quale giace
non molto discosto dalla gran Sirte e dal sito della città di Cirene. Ma il conseglio non ebbe effetto precioché,
partendosi, Ali, di Alessandria, navigo in Cipro, ove gionse a mezzo agosto, e nella parte occidentale di
quell’isola diede fondo al Bafo con forse sessanta galere, ove io, per ventura, mi trovai col Signor Giovanni
Sozzomeno, cavaliero di Cipro, e, girato per di dentro tutta l’isola, diede volta a Costantinopoli, avendo a suo
agio veduto e riconosciuto le riviere tutte e la istessa città di Famagosta.
La guerra segui, poi, l’anno 1570, nella quale, combattendo a Curzulari, ando a sodisfare al suo destino.
[Governo di Alessandria]
La città di Alessandria è governata dal Sangiacco, che è anco Capitano delle nuove galere della Guardia ; e
suole eleggersi sempre qualche personaggio. A mezzo il corso e alla ripa del mare, il verno, disarma tutte le
galere e la primavera le riarma, pigliando per forza i poveri Beduini di Alessandria e del Cairo per vogare e
mettendovi i Giannizzeri del presidio da quei castelli e prendendone anco da quelli del Cairo. Vi è Cadi, che
giudica le liti ; vi è il Subassi, che è come bargello ed ha cura delle carceri ed è giudice del criminale ; vi è
l’Hemin, che procura l’entrare reali. Ma il Sangiacco ha maggiore auttorità de tutti. Le difficoltà, poi,
d’importanza si riduccono dinanzi al Bascià del Cairo e alli grandi Cadi Leschieri di Cairo, i quali sono Giudici
Generali di tutto l’Egitto. Ma accadono poco liti d’importanza, conciosiacosa che il Gran Signore è padrone
de tutti i terreni, e massimamente in Egitto, e non sono de particolari, come si dirà poi.
[Entrate del Gran Turco]
La Dogana si affitta di tre anni in tre anni agli Ebrei, e pagasi in tre anni, si dell’entrata come dell’uscita e di
altre imposizioni sopra le mercanzie, cento borse de sultanini, valendo il sultanino quanto il ducato
veneziano, cioè quarantuno maideni, e il maideno vale il grosso, cioè soldi quattro. La borsa vale
seicentoventicinque sultani. Altra entrata non cava il Gran Turco di Alessandria se, per aventura, non avesse
qualche utilità del sale e del tributo che gli pagano gli Ebrei e i Cristiani a tanto per testa, che è ben poco.
Gli Ebrei gabbellieri menano seco Giannizzeri e sono molto stimati e rispettati, massimamente il principale,
che si chiama in arabo Malem, cioè Maestro ; e a tutti i gran mercanti chiamano Malem e affermano che
tanto è dire Malem in arabo Rabi in ebreo.
Quando il Sangiacco va al Cairo o naviga, si pone al governo di Alessandria un altro Sangiacco delli
ventiquattro che fanno residenza in Egitto e al Cairo. E quando ritorna, va al suo luogo, e fa mestieri che le
nazioni franche gli diano il presente, e quante volte esce fuora, tante volte bisogna rapresentarlo, altrimenti
si duole che di lui sia tenuto poco canto.
Allora che giunge qualche vascello nel porto di Alessandria, saluta il Castello, ma essi non risalutano con le
arteglierie. E il Sangiacco manda a chiamare il padrone della nave e lo interroga con diligenza delle cose
de’Cristiani e specialmente delle galere de’corsari di Malta, che chiamano ladri della Croce Bianca, e vuole
sapere la condizione delli mercanti e delli passagieri, e alcuna volta, non fidandosi del detto del padrone
ricerca dalli fanciulli di nave, detti mozzi, con minaccie. Spesso manda il Sangiacco e il Cadi a chiedere alle
nazioni franche, e massimamente alla Veneziana, barili di vino e di aceto, panno di lana e di seta, dicendo di
pagare. Ma non pagano mai.
Quando cavalca, il Sangiacco mena a’piedi seco più di cento bravi archibugieri e molti cavalieri bene a
cavallo, con le zagalie e con la scimetarra.
Bisogna lasciar stare le femmine maomettane perché vi è pena la vita a toccarle, e guardarsi da loro
invitano, percioché gabbano poi, e attende molto il Subassi a cogliere qualche Franco, traendone molto
guadagno. Stanno gli Alessandrini la state con timore de essere saccheggiati dalle galere di Ponente, e
principalmente gli Ebrei che abitano fuori della città, onde hanno deliberato di fabricare un forte sopra le
scoglio del porto vecchio, si per impedire le galere nemiche che non entrino, come per ritenere che più non
gliene sia rubbato, come poco fa fu quella delli schiavi cristiani. E veramente, da un tempo in qua, i corsari di
Malta, di Sicilia e di Napoli, ogni, scorrono quelle riviere di là e fanno alli Turchi di gran lunga più detrimento
che i Turchi non recano ai Cristiani nel golfo de Venezia e per tutto il mare d’Italia e di Spagna.
E questo è quanto io posso dire di Alessandria.
Dimorato che io fui un mese e mezzo in Alessandria, mi apparecchiai per andare al Cairo e di là, poscia, al
Monte Sinai, sendo secondo il pirmiero mio proposito. E con l’occasione dell’andata al Cairo del Magnifico
Signor Nicolo Giustiniano, mercante e gentiluomo di Chio e di Genova, mi accompagnai con esso lui, il quale
per tutto quel viaggio mi tratto cortesemente fino al Cairo nella sua zuma, che dalli Franchi si dice zerma,
che egli a Roscetto tolse a posta per sé, condottagli da quei Turchi, essendo fatta a posta per condurre
personaggi al Cairo.
Sogliono le Barche di Roscetto, dette zerme, fatte a guisa de’burchi, alcune delle quali portano tanto quanto
quasi che i vascelli che a Venezia chiamo marani. Adoparsi, per alleggieri le navi, partirsi il venerdi di
Roscetto venticinque e trenta per volta, cariche di mercanzie diversi, e, arrivate nel porto di Alessandria col
capo loro privilegiato, di non pagar nulla al Re della sua zerma, come le altre tutte, che le danno un certo
diritto, e in segno di maggioranza quella zerma è adornata di molte bandiere.
Pagasi delle persona, fino a Roscetto, tre o quattro maideni, secondo le occasioni, e di là al Cairo dieci, o
poco più o meno.
Nel ritorno di queste zerme, le quali allora erano forse trenta, tutte cariche di legni da opera de’Gran Signor,
dolci, come dicono rispetto alli forti, percioché di Attalia, che chiamasi ora Satalia, non portano altri legni per
lo più che dolci, come pini, abeti, larici, faggi, frassini e simili ; ma li forti si recano del Golfo di Nicomedia e
del Mare Negro appellato, per fare vascelli in Alessandria ed a Roscetto, e si conducono anco al Cairo e di là
al Sues sopra i camelli, per fabricare galere e altri simili a nome del Gran Signore. Questi legni, riposti nei
magazzini, si vendono per conto deli Re. E ivi si lavorano navi grosse di cinquecento botti e vi sono
bonissimi maestri di cotal arte in ogni maniera di vascello.
[Legni per fabricare vascelli non nascono in Egitto]
Non nasce legno in Egitto per tale opera ; ma quel poco che si trova è di palma, di tamarisso e alcuni tali
alberi.
[Descrizione della riviera di Alessandria fino a Roscetto e della foce del Nilo detta Canobica antica,
anticamente]
Partiti la matina, su l’ora di terza, con vento maestro gagliardo, arrivamo a Roscetto, nomato in arabo Rossit,
per distanza di quaranta miglia. Dopo mezzodi arrivammo poco distante do Flora, e parevamo un’armata, e
la nostra valeggiava meglio di tutte l’altre zerme, onde le passo oltre per il dritto, seben partimmo un’ora
dopo loro. Si costeggiava il promontorio a punta di Bocchier, che è un villaggio picciolo con la sua torre
guardata da alcuni Giannizzeri, per assecurate con l’arteglieria quel luogo, che ha porto e buon ridotto per li
corsari. Vi sono assaissimi giardini, vigne e orti pieni de frutti diversi, ed è ad un terzo del camino di
Alessandria a Roscetto. Io stimo, per molte congetture, sopra quella punta essere già posta la città di
Canobo, percioché quadra la distanzia secondo le misure di Tolomeo e di vede espressamente il segno
della fossa Canobica, nominata da Strabone, la quale metteva nel lago vicino, e le vestigia dello antico
aquedotto, che quasi di continovo menavano le acque sotto terra delle fosse di Alessandria a Canobo,
sebene è ora in quella arena qualche pozzo di buon’acqua. Di là poi, fino alla foce del Nilo, anticamente
nomata Canobia, overo Heracleotica, e al presente di Roscetto, sono le riviere basse e torte, quali, in giro
spingendosi il mare fra terra, come in golfo. Veggonsi lunghe di Alessandria cinque miglia, grandissimi muri
di mattoni e segni di nobilissimi edefici su la marina e caverne fatte in volta, sotto terra, e fondamenti di
terme e di maravigliose opere, ove di dice volgarmente essere già stato uno delli palaggi dei Re Tolomei. Ma
io non saprei in cio che affermare.
Quando i marinari de quelle zerme prima scuoprono Roscetto, fanno gran festa e lo salutano cantando,
come si da un lungo e fastidioso viaggio fossero arrivati alli suoi alberghi. Ma, apparendo allora certa nube
nera nell’aria, si turbano tutti e, con orazioni a Dio e con segni e col gettar del sale nell’acqua, si danno ad
intendere di farla dileguare. Un tal cosa ho io anco veduto adoprare alli Greci cristiani, i quali con un coltello
del manico negro e con orazioni sogliono egnare i nembi e i nodi delle nuvole le quali sogliono aportare
tempesta in mare.
Cominciammo a vedere, tre miglia inanzi l’entrare della fossa del Nilo, l’acqua del mare mutata di colore, ma
non di sapore, restando salata. Giunti alle foce, trovammo il mare fortemente rompere e urtare nelle ripe, per
essere bassa la piaggia e di poco fondo. Il terreno era tutto coperto dall’acque del Nilo, quasi lago, e le ripe
del fiume erano verdi di giunchi e di cannelle. Più adentro si vedevano palmizi assai e giardini. L’entrata per
questa foce è difficile, onde bisogna tenersi alla destra per imboccarla, sendovi alla sinistra secche e scanni
di terra. Due miglia all’insù del fiume, giace alla destra, su la ripa, un castello quadrato con alcune case ivi
presso, nel quale è il presidio de’Giannizzeri e arteglierie per vietar l’entrata alli vascelli de’corsari. Si arriva
poi a Roscetto, il quale è posto su la destra ripa di quel fiume Roscetto, il quale è posto su la destra ripa di
quel fiume cinque miglia discosto dalla foce. E se veggono di qua e di là campagne basse e, alla parte di
Roscetto, molte case e sepolture antiche, fatte di Mattoni alla sembianza delle romane. »
- 263 - 279 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHN FOXE (1577)
Foxe, J., « The woorthy enterprise of John Foxe an Englishman in delivering 266 Christians out of the
captivitie of the Turkes at Alexandria, the 3 of Januarie 1577 », dans R. Hakluyt (éd.), The principal
Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, made by sea or overland to the
remote and farthest distant quarters of the earth, vol. III, Londres, Toronto, New York, 1926.
Au détroit de Gibraltar, le navire anglais, nommé les « Trois Demi-Lunes », est encerclé par huit galères
turques. Les Anglais se retrouvant prisonniers sont emmenés en prison à Alexandrie. Cette aventure est
racontée par l’Anglais John Foxe.
De la vaillante entreprise de l’Anglais John Foxe pour libérer 266 Chrétiens qui avaient été faits prisonniers
par les Turcs. Le 3 janvier 1577.
p. 40-47 :
La prison d’Alexandrie
« Près de la ville, à Alexandrie, qui est un port sous la domination turque, il y a un mouillage bordé de
grands murs où les Turcs ont l’habitude de mettre leurs galères à sec chaque hiver pour les réparer. Le long
de ce port, il y a une prison où des galériens s’y trouvent pour un temps jusqu’à ce que la mer soit
suffisamment calme pour la navigation. Chaque galérien avait les fers de la honte aux jambes, (p. 41) ce qui
était extrêmement pénible, douloureux et astreignant. C’est dans cette prison que les chrétiens furent mis
sous bonne garde pendant tout l’hiver.
Très vite, le capitaine et l’armateur furent libérés grâce à des amis. Le reste resta confiné dans une grande
misère due aux mauvais traitements et à une mauvaise nourriture ; on mourait à moitié de faim. Seul John
Foxe, qui était un habile barbier, put, grâce à ce métier, améliorer très sensiblement son ordinaire avec
quelques bons repas de temps en temps. Il y aura toujours des hommes qui se débrouilleront mieux que
d’autres tout comme certains supportent mieux la misère et la dureté de la vie. Ceci dura jusqu’à ce que la
faveur de Dieu se manifeste en la présence du gardien de la prison. En le payant et en gardant un boulet au
pied, John Foxe put aller et venir sur le port selon son bon plaisir. Six autres hommes avaient cette même
liberté parce qu’ils étaient dans la prison depuis longtemps et personne ne les soupçonnait de partir
secrètement ou de comploter contre les Turcs. Ils devaient aussi porter des chaînes et rentrer tous les soirs.
En l’an de grâce 1577, pendant l’hiver, les galères étaient revenues avec chance à leur port d’attache ; leurs
mâts, leurs voilures et tout l’appareillage des galères furent descendus. Tous les capitaines et les marins
rentrèrent dans leurs foyers. Dans la prison du port, il restait 268 prisonniers chrétiens qui avaient été
capturés par les forces turques, il y avait 16 nations différentes. Parmi eux, il y avait trois Anglais, l’un
s’appelait John Foxe de Wood bridge dans le Suffolk, l’autre William Wickney de Portsmouth dans le comté
de Southampton et le troisième Robert Moore de Harwich dans l’Essex. John Foxe avait passé 13 ou 14 ans
sous leur agréable tutelle. Sa patience était vraiment à bout, il voulait s’échapper et cherchait par n’importe
quel moyen si cela pouvait être possible. En y pensant continuellement, il se redonna du coeur dans l’espoir
que Dieu ne châtiait pas ses enfants éternellement. Il pria toujours pour le succès de son entreprise future et
pour la gloire qu’elle lui apportait.
Non loin du port, un peu en retrait d’un côté de la ville, il y avait un restaurant loué par un certain Peter
Unticaro qui payait une taxe au gardien du port. Ce Peter, chrétien d’origine espagnole, était prisonnier
depuis une trentaine d’années et n’avait jamais essayé de s’enfuir. Au contraire, il était resté tranquille et
n’avait jamais été soupçonné de complot. John Foxe, qui venait d’arriver, voulut s’échapper. (Ces deux
hommes) partagèrent leurs idées sur l’emprisonnement et les entraves à leur liberté. John Foxe fit part à
Unticaro de son projet qu’il désirait exécuter dans le secret avec une autre personne. Tous les trois en
discutaient chaque fois qu’il leur était possible de se rencontrer, si bien qu’au bout de sept semaines, ils
avaient mis en place tous les détails de l’entreprise avec l’aide de Dieu. Ils mirent cinq autres personnes
dans le secret avec lesquelles ils pensaient pouvoir avoir confiance et ils décidèrent que leur projet serait
mis à exécution dans trois jours, une fois la nuit tombée. John Foxe, Peter Unticaro et les six autres se
donnèrent rendez-vous ensemble dans la prison le jour suivant, dernier jour de décembre. John Foxe parla
au reste des prisonniers et leur dit ce qu’étaient leur intention ainsi que leur projet, quand et comment on le
mettrait à exécution. Il les persuada ainsi sans peine à collaborer avec eux.
Le lendemain soir, John Foxe et ses six compagnons s’étaient réunis chez Peter Unticaro ; ils passèrent une
joyeuse soirée pour éviter les soupçons jusqu’à ce qu’il soit assez tard pour qu’ils puissent commencer.
Peter Unticaro fut envoyé comme messager chez le gardien du port d’un des maîtres de la ville que le
gardien connaissait et aux ordres duquel il obéirait promptement. Ces ordres étaient de le rencontrer en ville,
la promesse était qu’il serait reconduit chez lui. Le gardien accepta et dit aux gardes de laisser les portes
ouvertes et qu’il rentrait très bientôt.
Pendant ce temps, les sept autres s’étaient équipés avec les armes qu’ils avaient trouvées dans la maison.
John Foxe prit une vieille lame d’épée toute rouillée, sans garde ni pommeau, mais il put s’en servit en
recourbant l’extrémité. Les autres avaient trouvé des glaives et des dagues de fortune.
Le gardien, de retour chez lui, ne voyant pas la lumière, n’entendant aucun bruit, soupçonna tout de suite
quelque chose. Au moment où il se retourna, il vit John Foxe qui se tenait derrière le coin de la maison, il
s’avança vers lui et lui dit : « Oh Foxe, qu’ai-je fait pour mériter ceci et pour que tu souhaites ma mort ? »
« Tu n’as autre qu’une sangsue de sang chrétien et tu vas maintenant recevoir ce que tu mérites de mes
mains. » John Foxe leva son épée toute rouillée de dix ans, lui assena un tel coup que sa tête s’ouvrit en
deux. Le gardien tomba mort sur le sol. Alors Peter Unticaro entra et dit au petit groupe que le gardien était
bien mort ; tous suivirent avec son couteau, le dépecèrent, l’un d’eux le coupa en deux avec son glaive, lui
coupa la tête et le traita de telle sorte qu’il était méconnaissable. Alors Ils marchèrent vers le port où ils y
entrèrent tout doucement. Il y avait six sentinelles, l’une demanda « qui va là ? » « Des amis » répondirent
Foxe et ses amis. Ils leur prouvèrent vite le contraire dès qu’ils furent rentrés. Car, Foxe dit, nous ne
sommes pas ici un contre un, donc jouez bien vos rôles. Ils firent si bien que les six furent expédiés très vite.
John Foxe, qui n’allait pas arrêter à ce moment et pour être sûr de ne pas être interrompu, ferma les portes
avec précaution et y plaça un canon.
Puis ils entrèrent dans la loge du geôlier et trouvèrent le chef de la forteresse près de son lit, ils purent
prendre de meilleures armes. Il y avait dans cette pièce un coffre avec beaucoup d’argent et de ducats.
Peter Unticaro et les autres l’ouvrirent et remplirent leur chemise d’autant de pièces qu’ils purent. John Foxe
n’y toucha pas et leur dit que c’était la liberté qu’il voulait pour l’honneur de Dieu et qu’il ne cherchait pas ces
maudits trésors des infidèles. Mais ses paroles leur passèrent au-dessus la tête et ils ne le firent pas avec
une mauvaise intention.
Saül ne sauva-t-il pas les boeufs les plus gras pour les offrir au seigneur et lui rendre service en même
temps ? Mais Saül n’échappa pas à la colère divine de ceux qui prennent ce qu’ils désirent ardemment.
Telle est la justice de Dieu. Ceux qui ont la foi seront délivrés des mains tyranniques de leurs ennemis, il
sera leur providence, du moins c’est ce que je dis.
Maintenant, nos huit compagnons ont trouvé de bonnes armes comme ils l’entendent, ils s’estiment assez
fort pour rencontrer un ennemi plus impressionnant. Ils entrèrent dans la prison dont les portes furent
grandes ouvertes par John Foxe qui appela les prisonniers et donna des instructions : aux uns de manier le
bélier à la porte et à d’autres de s’occuper de l’équipage d’une galère qui était la meilleure du port (elle
s’appelait « le Capitaine d’Alexandrie »). Tous amenèrent le matériel nécessaire à cette galère : les mâts, les
voiles, les rames et d’autres choses.
À la prison, John Foxe et sa compagnie tuèrent quelques gardes. Pendant ce massacre, huit autres Turcs
les virent et montèrent tous en haut de la prison. À ce moment, John Foxe et sa compagnie durent monter
les échelles, la bataille fut difficile. Il y eut des hommes tués et des blessés, d’autres avaient très peur, mais
n’étaient pas touchés. John Foxe lui-même reçut trois balles dans ses vêtements, mais il ne fut pas blessé.
Peter Unticaro et les deux autres qui s’étaient armés de ducats furent massacrés car leurs mouvements
n’étaient pas assez spontanés, ils étaient gênés par le poids et l’encombrement de ce trésor profane et de
mauvais augure. Il y eut d’autres chrétiens blessés dans cette bataille et des Turcs tués.
Un des Turcs, en se battant, tomba du haut de la muraille de la prison (je ne dirais pas que c’était un
malheur) et fit un tel atterrissage que les habitants du dessous (car il y avait quelques maisons autour de la
prison) sortirent et comprirent ce qui se passait ainsi que la façon dont les prisonniers payaient leurs
rançons. (Les habitants) donnèrent l’alerte à la forteresse d’Alexandrie qui est à l’ouest du port à l’extrémité
de la ville ainsi qu’à une autre forteresse qui se trouve au nord du port. Il ne restait plus qu’un seul chemin
pour s’échapper et ce dernier semblait (à cause des deux tours de guet qui étaient à l’entrée du port)
impossible pour tout homme de raison. Mais il avait semblé impossible aux Israéliens de passer la mer
Rouge avec les collines et les rochers d’un côté, et, leur ennemi de l’autre. Il avait été impossible aussi aux
murs de Jéricho de tomber sans avoir été frappés à coups de bélier sans l’intervention humaine. Ce sont
des possibilités que Dieu accorde.
Celui qui put tenir en suspens les mâchoires du lion qui allaient broyer Daniel et rendre l’animal inoffensif ne
pourrait-il pas retenir les canons grondeurs des forces de l’enfer ? Celui qui a pu arrêter les flammes dans le
four brûlant et sauver les trois enfants qui glorifiaient son nom ne pourrait-il pas retenir les projectiles
brûlants lancés sur ses élus ?
À ce moment, le port était plein de soldats, d’ouvriers et de marins affairés qui s’efforçaient de remplir leur
fonction. Chacun faisait son devoir qui était de transporter des provisions, des munitions, des rames ou
autres, mais surtout de faire en sorte que l’ennemi ne dépasse pas le mur du port. Il n’y eut pas de temps
perdu, personne ne resta inactif, tout ce travail ne fut pas effectué en vain. En peu de temps, la galère fut
équipée ; tous y sautèrent aussi vite qu’ils purent, les voiles furent hissés à toute vitesse et ils s’en remirent à
la merci de Dieu dont les mains tiennent les vents et le temps.
La galère était à flot et n’avait plus la protection du port. Les deux tours de guet pouvaient donc concentrer
leurs forces sur la galère et la faire couler. Comment éviter ce sort ? Les canons lancèrent leurs boulets de
chaque côté de la galère qui était au milieu entre les deux lignes de tir. Qu’est-ce qu’un homme peut faire
pour sauver cette galère ? Pas un homme au monde ne pourrait penser échapper à l’inévitable.
Pas un seul sur la galère ne fut effrayé par les tirs qui faisaient rage et sifflaient à leurs oreilles ; personne ne
fut touché malgré les quarante-cinq boulets lancés depuis les forts. Car Dieu interposa son bouclier et
protégea la galère. Dieu, ayant éprouvé la foi de ses passagers jusqu’à la dernière limite, leur envoya son
aide mystérieuse. Même si toute aide semble impossible, Dieu descend du ciel avec son pouvoir tout
puissant et agit avec la rapidité de l’éclair. La galère, intacte, n’ayant pas été touchée ni même effleurée à
travers la canonnade, poursuivit sa route et fut vite loin des tirs des canons turcs. C’est alors qu’ils virent les
Turcs descendre vers la mer en masse comme un essaim d’abeilles pour prétendre vouloir les poursuivre
avec leurs galères. Les Turcs s’affairèrent pour s’équiper, mais il aurait fallu qu’ils soient très rapides à la
tâche car rien n’était prêt sur aucune des galères ; il n’y avait ni voiles, ni mâts, ni cordages. Ils essayèrent
cependant, en transportant tout le nécessaire d’une galère à une autre, mais ils créèrent une telle confusion
à cause du manque d’ordre, que les chances de rattraper les prisonniers disparurent. D’autre part, il n’y avait
pas un seul homme prêt à prendre une galère en charge car la mer était houleuse et ils étaient tous
abasourdis. Pour être franc, je crois que leur Dieu était aussi abasourdi et ne pouvait être qu’honteux ;
n’ayant jamais élevé la voix, Il pouvait encore moins les aider dans une telle extrémité. Quoi qu’il en soit, leur
Dieu est à blâmer en les ayant abandonné de la sorte ; quelle que fut l’attitude de leur Dieu, le nôtre se
montra en vrai Dieu, le seul Dieu vivant que les mers obéirent en entraînant ses fidèles. Les ennemis étaient
effrayés car les nôtres avaient un pilote habile pour les guider et des marins qui mettaient tout leur coeur à
l’ouvrage. Alors que les Turcs n’avaient pas de marins, de pilotes ou de capitaine de valeur qui furent prêts à
ce moment critique.
Quand les chrétiens furent en sécurité, loin des côtes ennemis, John Foxe leur parla et leur demanda d’être
reconnaissants envers Dieu tout puissant d’avoir retrouvé leur liberté, et, de se mettre à genoux humblement
pour lui demander de les conduire vers une terre amie et non vers de nouveaux dangers, Lui qui les avait
délivrés d’un esclavage si terrible.
Ainsi, après que chaque homme pria, chacun retourna aux rames en s’aidant les uns les autres quand la
fatigue était trop intense. Chacun s’efforça, en se fiant aux étoiles, de s’approcher d’une terre chrétienne
avec beaucoup de peine et de persévérance. Mais les vents furent souvent capricieux et changeants, les
poussant de part et d’autre, ils étaient complètement perdus, pensant que Dieu les avait abandonnés à un
danger plus pressant encore. N’ayant plus de vivres sur la galère, il y aurait eu des murmures contre Dieu
s’ils avaient été Israéliens, mais ils savaient que leur Dieu les avait délivrés d’Égypte, les aimait et avait pitié,
et, qu’Il ne pouvait supporter de les voir mourir après avoir fait tant de choses extraordinaires. Ils savaient
que les diverses calamités qu’ils durent subir n’étaient que des épreuves et des raisons pour qu’ils ne
s’approprient pas la gloire et le triomphe de leur délivrance. En effet, il semblait que les catastrophes
tombassent sur eux l’une après l’autre car il n’y avait plus de vivres à bord ; la famine prit de telles
proportions que pendant les 28 jours de navigation, huit hommes moururent au grand étonnement de
chacun. »375
375 Traduction : C. Young (archives Sauneron, Ifao).
- 280 - 282 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LUPOLD VON WEDEL (du 29 septembre au 11 octobre 1578)
Wedel, L. von, Beschreibung seiner Reisen und Kriegserlebnisse, 1561-1606, Stettin, 1895.
Lupold von Wedel (1544-1615) naît à Kremzow en Poméranie (aujourd’hui en Pologne). En 1552, il est
élève à l’école de Stargard avant de devenir valet au service du duc Volrad von Mansfeld avec lequel il
voyage dans presque toute l’Allemagne. Il part en campagne militaire en Hongrie en 1566, participe aux
guerres des Huguenots en France entre 1575 et 1591 et prend part également à la guerre de Cologne et à
celle des évêques de Strasbourg en 1583-1584 et 1592-1593.376
p. 154-159 :
« La nuit suivante nous avons continué le voyage et le matin du 29 septembre, à la saint Michel, nous
sommes arrivés à Alexandrie. On nous a conduits sur une place de cette ville où nos habits et nous-mêmes
ont dû se soumettre à une investigation minutieuse de la part des Juifs. J’avais mis environ 10 ducats
hongrois dans une poche de derrière de mon habit. Croyant que c’était des diamants, les Juifs m’obligèrent
à enlever mon habit de sorte que je me trouvai en chemise. Je m’étais drapé dans un caftan turc sinon il
m’aurait fallu rester debout en ne portant qu’une chemise. Après que nous eûmes été visités à fond, nous
avons remis nos habits puis nous nous sommes rendus à la Maison italienne où le consul nous fit assigner
une chambre et où nous fûmes nourris contre paiement.
Visite d’Alexandrie
Bien qu’Alexandrie soit une grande ville, elle ne se laisse pas comparer au Caire. Les trois murs qui
l’entourent sont bien construits pour la défense, je n’en ai pas vu de meilleurs dans toute la Turquie. Du
reste l’intérieur de la ville n’est pas beau, il y a même des parties qui sont foncièrement laides.
Le 30 et dernier jour du mois nous sortîmes pour aller voir l’endroit où saint Marc fut décapité. Il se trouve au
milieu d’une ruelle où une large pierre a été posée en commémoration de son martyre. D’ici nous visitâmes
la prison où sainte Catherine fut captive. Elle fut décapitée à dix pas de cette prison et deux colonnes
marquent la place où l’exécution aurait eu lieu. Exactement à cet endroit se trouvait le palais de son père. La
Sainte fut hissée vers le haut au moyen d’une roue spécialement construite pour martyriser les victimes.
Après ces tortures, on la décapita. On dit que Dieu fit alors tomber le feu du ciel et que cette flamme
consuma le bourreau.
D’ici nous nous rendîmes à Saint-Saba, un couvent desservi par les Grecs. On nous mena à l’église
Saint-Marc où l’on nous montra la chaire du saint et une colonne qui aurait servie à la flagellation de sainte
Catherine. Ensuite on nous conduisit à l’endroit où le pharaon avait son palais. Dans celui-ci il y avait un très
beau bain. Sur l’emplacement une immense et haute colonne taillée d’un seul bloc et non pas maçonnée de
plusieurs pièces. Elle est sculptée artistiquement comme si elle était travaillée en bosselage. Je me
demande toutefois de quelle façon, on a pu dresser une si haute et grande pierre. Devant la ville se trouve
également une grande et haute colonne sculptée et qui a été érigée en mémoire du Romain Pompée. Nous
l’avons visité le 1eroctobre.
Le 2 octobre, nous vîmes des « arbres à Musa » dont Adam aurait mangé le fruit, causant ainsi la perdition
du genre humain. Les troncs de cet arbre ne sont pas beaucoup plus hauts qu’un homme de grande taille.
De l’extérieur ces troncs sont verts comme des choux mais les feuilles poussent tout droit en hauteur et sont
également presque aussi longues qu’un homme. L’arbre n’a pas plus de 6 à 7 feuilles qui sont très belles à
voir sous leur lustre soyeux. Le fruit de l’arbre à Musa est agréablement doux et très tendre, le goût en est
délicieux et quand on le coupe, on y voit non seulement une croix à l’intérieur mais encore un véritable
crucifix à la manière dont on peint chez nous le Christ en croix. L’évêque d’ici a sept femmes et pardessus le
marché il entretient encore quelques fillettes.
Au Caire il y a quatre évêques qui font de même. Certaines épouses stériles envoient leurs maris chez ces
évêques qu’ils doivent implorer à genoux pour l’amour de Dieu de bien vouloir coucher avec leurs femmes.
Après de longues supplications, les évêques se laissent persuader d’agir en conséquence. Il arrive alors que
ces femmes soient enceintes. Les enfants procréés de cette façon sont considérés comme très précieux,
puisqu’ils proviennent des évêques. Il paraît qu’il y a aussi dans ces régions des gens qui se marient avec
des fillettes qui n’ont que sept ou huit ans.
Le 3, on nous fit voir deux “Bragonien” (cercopithèques). Ils ont l’air de singes, mais sont plus petits que
ceux-ci et ont de longues queues.
Le château fort d’Alexandrie, qui se trouve en dehors de la ville, est en partie baigné par la mer. Un roi de
Valachie y est détenu en captivité. Il fut fait prisonnier cet été seulement et on l’amena ici.
Le 6, quelques enfants à dos de cheval, couverts de vêtements et d’armures somptueuses, allaient et
venaient dans notre ruelle. On nous affirma que ces enfants avaient été circoncis ce jour-là et qu’une vieille
coutume veut qu’à cette occasion, on les promène avec ostentation, afin que tout le monde puisse les
admirer.
Le 7, nous commençâmes des pourparlers avec un patron vénitien qui avait l’intention de partir pour Venise
le lendemain. Nous lui demandâmes de nous accepter comme passagers. Bien qu’il ait d’abord refusé, il finit
néanmoins à consentir à nous prendre à bord pour ce long voyage. Nous convîmes de lui payer 8 couronnes
par personnes et par mois pour la nourriture et 10 couronnes pour le trajet jusqu’à Venise. Malgré ses
promesses réitérées de veiller à notre bien-être, il n’en fut rien et nous avons eu de mauvaises expériences.
Douane de sortie
Comme je l’ai déjà mentionné le patron du bateau voulait faire voile le lendemain, nous avons donc pris une
barque le 8 pour nous faire conduire jusqu’au navire qui s’appelait Brisyelle. Mais avant de sortir de la ville
avec nos effets de voyage et de poser les pieds sur la barque nous fumes obligés de verser la taxe quatre
fois aussi bien aux Juifs qu’aux Grecs. En effet, les Juifs de cette ville doivent verser à l’empereur de tous
les Turcs une redevance de 700 couronnes par jour. Grâce à cette disposition, ces Juifs ont le droit
d’accaparer des sommes considérables et qui leur permettent de s’enrichir. Imaginez combien la douane
rapporte par an.
Incident de rue
Aujourd’hui, un jeune garçon insouciant se jeta à dessein contre le dos de Schouberk. Ce dernier réagit en
donnant un coup de pied au garçon qui se mit alors à crier ; ce dernier se plaça face à Schouberg pour le
frapper de ses poings en plein visage. Si Schouberg avait insisté sur ses droits nous serions tous allés au
diable.
Les monnaies en usage
À Alexandrie aussi bien que dans toute la Turquie on se sert de pièces de monnaie ayant la valeur suivante :
6 petits fuller valent une aspre, 3 grands fuller (folli) valent aussi une aspre, 2 aspres valent un modin, 26
modins font un thaler, 35 modins valent une couronne et 40 ou 41 modin font un sickin (sequin), un ducat ou
bien un florin hongrois.
Le Suisse a acheté pour 80 couronnes un esclave qui était son compatriote et qui avait ramé pendant 5 ans
sur une galère. Il l’a emmené. Le 9 et le 10, le navire était immobile dans le port parce que le consul de
Venise au Caire devait encore confier à notre patron des lettres à destination de Venise.
Départ d’Alexandrie
Le 11, grâce à Dieu, nous partîmes, mais on fit tirer le navire par une galère jusqu’en haute mer pour avoir
un bon vent. »377
376 Bär, M., « Wedel, Lupold v. », ADB 41, Leipzig, 1896, p. 413-414.
377 Traduction : P. Bleser (archives Sauneron, Ifao).
- 283 - 284 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS JACOB BREÜNING VON UND ZU BUOCHENBACH (du 3 au 5 août 1579)
Breüning von und zu Buochenbach, H. J., Orientalische reyss dess edlen vnnd besten Hanss Jacob
Breüning von vnd zu Buochenbach, so er selb ander in der Türkey, vnter dess türckischen sultans
iurisdiction vnd gebiet, sowol in Europa als Asia vnnd Africa, ohn einig cuchium oder frey gleit, benantlich in
Griechenland, Egypten, Arabien, Palestina, das Heylige Gelobte Land vnd Syrien, nicht ohne sondere
grosse gefahr vor dieser zeit verrichtet, Strasbourg, 1612.
Hans Jacob Breüning (1552-1616/1617), né dans une vieille famille patricienne de Tubingen, est le fils du
conseiller impérial Wolfgang Breüning von Rommersheim. Nous n’avons aucune information sur son
enfance et son éducation, mais il semble avoir une culture humaniste assez vaste qui le pousse à voyager
en Europe et dans le Levant. En 1584, il est employé dans l’administration de la cour de Württemberg. En
1595, le duc Frédéric 1er le place à la tête d’une délégation diplomatique qui a pour mission de demander à
la reine Elizabeth 1ère de lui remettre l’ordre anglais de la Jarretière. Mais les négociations restent sans
succès. Sa carrière est assez mouvementée ; nommé maréchal supérieur au Collegium Illustre à Tubingen,
il en est destitué à plusieurs reprises.378
p. 116-127 :
Chapitre IX
« Dans l’après-midi du 3 août, n’étant plus loin de l’Égypte, nous aperçûmes la ville d’Alexandrie. L’Égypte
est un pays plat et bas qui est dépourvu de montagnes, ainsi nous ne pûmes la voir avant d’en être proche.
Mais dès que nous la vîmes, nous étions aussitôt dans le port d’Alexandrie qui se trouve à 500 milles de
Rhodes ou à 4000 stades selon Strabon (Liv. I), c’est-à-dire 20 milles de moins. De Constantinople à
Alexandrie, on compte 1200 milles ; nous y sommes arrivés au bout de 13 jours de navigation.
(…)
Chapitre X
(…)
Pour continuer notre voyage, il faut savoir que dès l’arrivée de notre galion, le consul français, Monsieur
Esquissier, en fut averti ; ce dernier nous envoya son interprète qui nous fit débarquer à terre sur un bateau
turc. Nous payâmes 8 maietin, dont chacun vaut 3 kreuzer, pour la barque. Après avoir débarqué au port,
nous nous dirigeâmes vers la ville par différentes portes ou poternes. Nous fûmes fouillés à quatre reprises
par les douaniers qui devaient être Juifs, mais on ne trouva pas notre or que nous avions cousu à même la
peau. Sur le rivage, les Mores nous dérobèrent devant nos yeux d’un sac de biscuits, avec une telle
maestria et une telle rapidité que nous ne nous en apercevions même pas. Pour de tels actes on leur
accorde l’honneur étrange de grande gloire et de rapidité.
À Alexandrie, nous descendîmes au fontigo français. Nous payâmes 16 maietin au More, qui avait
transporté nos affaires depuis le port, et un demi-ducat aux sus-dits douaniers. Le sus-dit consul français
honneur car nous avions une lettre de recommandation de Constantinople ; il fit preuve de respect et de
bonne volonté, il nous invita à sa table ce qui n’est pas l’usage ordinairement. En principe, on offre
seulement une chambre dans le fontigo aux autres étrangers qui doivent se procurer eux-mêmes leur
nourriture et leur boisson. Le consul nous attribua également deux de ses janissaires pour visiter la ville.
Ainsi nous fûmes bien traités par les Français aussi bien ici qu’à Constantinople.
En Turquie, on appelle consuls ceux qui ont été nommés par les potentats et souverains chrétiens comme le
roi de France, des Vénitiens, des Ragusains ou d’autres, afin qu’ils puissent secourir les leurs en les aidant
par leurs conseils et par leurs actes, et pour qu’ils accueillent les étrangers de leurs nations dans leur
demeure. Les démêlés des marchands sont plaidés devant les consuls qui sont reconnus et privilégiés par
l’empereur turc. À n’importe quel moment les marchands de leur nation, ainsi que d’autres chrétiens en
voyage, peuvent arriver chez eux en sécurité et être protégés des avanies extérieures des Turcs et des
Maures. Ce sont des notables bons et raisonnables qui connaissent bien les langues et qui en l’honneur de
leur maître et pour leur bonne réputation s’entourent de servants, se parent de vêtements et concluent des
traités. Les chrétiens, ainsi que les Turcs et les Maures les tiennent en grande estime et les respectent
beaucoup.
Chapitre XI. Alexandrie, la très ancienne et célèbre ville.
Son premier nom fut No selon Jérôme, supra 3, cap. Proch. Naum. Elle fut construite ou plutôt agrandie par
Dinocrate l’architecte sur l’ordre d’Alexandre roi de Macédoine, dont elle prit le nom, la 113e Olympiade, l’an
du monde 3640 avant J.C. Les Mores l’appelle aujourd’hui Scanderia. Elle est construite le long de la mer et
elle est entourée de gros murs de blocs blancs ou de blocs ouvragés. Son pourtour doit mesurer six milles
français mais pas davantage. Au Nord, elle possède deux beaux ports ou havres appelés l’un porto vecchio,
l’autre porto nuevo qui sont tous les deux sur la mer Méditerranée. Mais la ville elle-même et ses entrepôts
se situent devant la porte du Grand Caire. Au Sud, il y a le lac Maréotis qui est grand et large à cet endroit.
Ainsi, les habitants ont toutes sortes de bons poissons en quantité. Il y a aussi trois châteaux différents. À
l’intérieur de la ville se trouvent deux montagnes (sic !) qui ont été surélevé petit à petit grâce aux ordures, à
la boue des rues et aux balayures comme le mont Testaceus à Rome. Ces deux montagnes existaient déjà
du temps de Strabon.
Alexandrie est entièrement construite du dessous ; au lieu de caves, on trouve des citernes dans lesquelles,
tous les ans au mois d’août, l’eau du Nil se déverse, dans deux Calisses ou aqueducs, après les avoirs
balayés et nettoyés. Ils utilisent cette eau toute l’année car ils ne possèdent pas de puits d’eau douce.
Hors de la ville, non loin de la colonne Pompée, on peut voir, au mois d’août, lorsque le fleuve sort de son lit,
le bras du Nil à partir duquel l’eau arrive dans les citernes par les deux aqueducs cités ci-dessus. À la même
époque, on peut faire le chemin directement jusqu’à Boulack sans être obligé de faire le détour par Raschet
ou Rosette. On attribue à ces citernes l’origine du mauvais air pestilentiel ; chaque année, les mêmes
épidémies et maladies prolifèrent. Mais dès que le soleil entre dans le lion, cela cesse et diminue. Les
ruelles, longues et scandées de carrefours, sont tracées d’est en ouest et du sud au nord. Les Coffti ou
Chrétiens de la ceinture, de même que les Grecs ont leurs propres rues et vivent séparés des Turcs et des
Mores.
Les Grecs ont leur propre Patriarche qui réside à la cour du Grand Caire et n’ont qu’un vicaire à Alexandrie.
Cette ville est en grande partie démolie ; elle est remplie d’amas de pierres et certains endroits sont
abandonnés et déserts. De l’extérieur et de loin, son apparence est meilleure que lorsqu’on la pénètre et
qu’on voit sa misère.
Les maisons et les édifices sont construits en pierre dure et sont peints en blanc, les toits, sans tuiles, sont
plats et à terrasse. Les habitants sont en majorité des Mores comme dans tout le reste de l’Égypte ; on peut
les comparer aux gitans pour la couleur, leur langue est l’Arabe. Jadis, les beaux-arts y florissaient ;
Philadelphe, le fils de Lagos, Ptolémée 1er, avait fondé une célèbre université dans la bibliothèque qui
comptait 700 000 volumes qui furent détruits à l’époque chrétienne dans un incendie.
Le même Ptolémée Philadelphe, roi d’Égypte, avait fait traduire la Bible à grands frais de l’hébreu au Grec
en 283 avant J.C. En l’an du salut 45, l’évangéliste Marc prêcha l’évangile à ses débuts et il fut succédé par
un Alexandrin nommé Amzan ou Anan. Athanase fut également évêque de la communauté de Dieu. Cette
ville fut bénie de dons spirituels et temporels, mais le diable y a construit sa chapelle à côté de l’église de
Dieu et Arius l’hérétique y a semé ses hérésies et sa racaille diabolique. De nos jours il n’y a plus ici qu’une
“mera barbaries” un peuple rude, bestial et sans Dieu si bien que la vieille expression pourrait être employée
très opportunément en parlant des habitants actuels. Car on est à ce point éloigné aujourd’hui de cette
période bienheureuse que l’on pourrait bien dire avec le poète : “Hélas ! où est aujourd’hui l’antique piété, la
pureté, la foi ?”
Nous n’avons visité qu’une seule église chrétienne nommée Saint-Saba qui fut rénové depuis peu. Le grand
choeur appartenait aux Grecs et les Francs y ont une chapelle à l’entrée à droite. Au milieu de l’église, on
nous montra l’endroit où prêchait saint Marc ; à droite du portail, se trouve la colonne où sainte Catherine
aurait été attachée. Cette église fut sans aucun doute grande et belle, en témoignent les belles colonnes de
Thébaïde qui sont encore là. À l’un des carrefours nommés ci-dessus, se trouve une grande pierre ronde et
plate qui dépasse du pavé où, dit-on, saint Marc aurait été décapité. Les Cofftis possèdent la tête à
Alexandrie, mais le corps fut emporté par les Vénitiens.
À Alexandrie, nous avons pu porter les mêmes vêtements qu’à Constantinople car c’est une ville où il y a
toujours beaucoup de trafics et de commerçants ; ces habits sont passe-partout dans toutes les villes
marchandes et commerçantes de la Turquie.
Chapitre XII. Des antiquités d’Alexandrie et ce qu’on peut en observer
Un peu partout dans la ville, on voit de belles colonnes ainsi que l’appareil de portes qui sont des anciennes
ruines. Au nord, en longeant les murs de la ville et non loin du fontigo du consul français, se trouvent deux
obélisques qui se tenaient devant le palais de Cléopâtre : l’un est encore debout, l’autre est à terre. Chacun
d’eux est d’une seule pièce. Ils sont parsemés de taches noires comme toutes les autres pierres de la
Thébaïde. À cet endroit, on peut extraire des blocs aussi grands que l’on veut. Ces pierres sont mouchetées
comme les étourneaux (?) ; on les appelle également grano d’Egitto. Ces obélisques quadrangulaires sont
taillés dans le sens de la longueur et leur sommet pointu a la forme d’une quille. Ils portent tout le long des
inscriptions hiéroglyphiques qui sont plutôt gravées ; hormis ces lettres, il n’y a pas d’autres inscriptions.
Celui qui est encore debout mesure 9 pieds de côté à la base, c’est-à-dire 36 au total et sa hauteur est très
grande. Ces pierres viennent du désert appelé Thèbes. La ville de Thèbes avait jadis 100 portes et autant de
palais, elle mesurait 9 milles de longueur et 18 de circonférence. C’est là que les premiers rois égyptiens
tenaient leur cour et par la suite ce fut à Memphis. Ensuite ils descendirent à Alexandrie ; c’est encore le cas
de nos jours avec le Bassa au Grand Caire.
On signale aussi à Alexandrie les ruines du château du roi Coffti qui est en pierre rouge. Non loin de là se
trouve la prison de la martyre sainte Catherine, cet endroit est muré et comporte une petite ouverture au
sommet. On y voit beaucoup de noms inscrits ainsi que trois belles colonnes de pierre dont l’une se tient
debout à part tandis que les deux autres sont prises dans les murs en ruine. Là, dit-on, se trouvait la roue
sur laquelle sainte Catherine fut martyrisée.
Le troisième lieu que l’on nous montra est celui où ce serait trouvée la maison du prophète Jérémie ;
aujourd’hui il y a une petite mosquée turque. Cet endroit se trouve au pied de l’une des montagnes citées
ci-dessus, c’est-à-dire à l’intérieur de la ville.
En quatrième lieu, on visite tout près d’Alexandrie, mais hors la ville, la colonne de Pompée qui se trouve sur
une hauteur. Ce bloc est fait d’un seul tenant « del medisimo grano d’Egitto ». On dit que c’est Jules César
qui la fit ériger après la victoire qu’il remporta sur Pompée. Cette colonne mesure 5 toises de circonférence
et sa hauteur est si indicible qu’un homme fort aurait du mal à lancer une pierre au-dessus d’elle. Cette
colonne repose sur une grande pierre carrée qui mesure 18 empans de côté et dessous, on voit une autre
maçonnerie. De cette colonne, la vue est assez jolie : on aperçoit, au loin vers le sud, le lac Maréotis. Entre
le lac Maréotis et la colonne, il n’y a que des marécages.
En cinquième lieu, il ne faut pas oublier de citer une grande tour en marbre qui existe depuis l’Antiquité et
qu’on appelle Pharos. Cette tour est construite sur une petite île du même nom. De nos jours, c’est une
péninsule depuis que Cléopâtre y aménagea une digue jusqu’à la terre ferme. (Pline, Lib. II et V).
Aujourd’hui, il y a un Fanar que les habitants appellent Mahelech. Auparavant, il y avait le nom de Ménélas
(enterré là). La tour est une très belle oeuvre d’art et elle est démesurément haute. Les rois égyptiens l’ont
construit au prix de 800 talents dans l’unique but d’y allumer un grand feu afin que la nuit les marins puissent
se diriger.
La plupart des scribes l’attribuent à Ptolémée Philadelphe. L’architecte a dû être Sostrate (Pline, 37). Caius
Julius César la nomme également dans ses commentaires, de même qu’Ammien Marcellin et Solinus. Cette
tour fut considérée comme l’une des sept merveilles du monde. De même qu’on ne voit plus rien du colosse
de Rhodes, de même il n’y a plus rien à voir de cette époque-là.
Chapitre XIII. De quelques animaux rares et inhabituels que nous avons vu à Alexandrie
Dans la résidence du consul français, nous vîmes pour la première fois, un civeth ou bisamthier appelé
hyaena. Sa figure et sa stature ressemblent à un blaireau, toutefois, la bête est plus grande et plus charnue.
Elle a sous le ventre un petit trou d’où on tire le musc. Sur le cou et l’échine, elle a le poil noir et dur qu’elle
ouvre quand elle est en colère de la même façon qu’une truie. Elle a une barbe comme celle d’un chat mais
sa gueule est pointue ; ses yeux sont rouges feu et a sur la tête des petites taches noires. Ses oreilles sont
rondes comme celles d’un blaireau. Son poil est en grande partie blanc tacheté de noir. Ses pattes sont
noires, sa queue est longue, le dessus est tout à fait noir, mais le dessous est tacheté de blanc. C’est une
bête rapide et agile.
Nous vîmes également chez un More un animal nommé ratto de pharaone ou ichneumon. On les élève en
secret à la maison comme des chiens et des chats ; ils chassent les rats, les souris et autres bêtes nuisibles.
L’ichneumon est par ailleurs une bête pure et propre ; il se nourrit de ce qu’il trouve : rats, souris, grenouilles,
caméléons, toutes sortes de vers, serpents, lézards et aussi oeufs de poule et d’oiseau. Quand il est en
colère, il dresse son poil (qui est à la fois grisâtre et jaunâtre) ; son poil est dur comme celui des loups et sa
couleur ressemble à celle des guenons ; la queue de derrière est longue et épaisse. Concernant la langue et
les dents, il s’apparente aux chats, mais sont de taille plus grosse et plus longue. L’ichneumon a une queue
et une gueule pointues comme le putois mais sans barbe ; ses oreilles sont rondes. Outre son anus naturel,
il a un autre trou enfoui dans les poils qu’il entrouvre lorsqu’il a chaud. Cet animal est très intrépide et très
carnivore ; il égorge les chats sur place et s’en prend même aux chiens les plus gros et les plus forts. À
Alexandrie, nous avons vu également une mise en vente de peaux d’autruche avec leurs plumes que l’on
fait venir en grande quantité d’Éthiopie.
Chapitre XIV. Des commerçants, des Francs ou des fontigi des Francs. De même du bazar et autres, de la
plante Kali en particulier, de la douane en Égypte et de la monnaie
Les Franci ou Francs (nom que les Turcs et les Mores donnent en général à tous les chrétiens qui viennent
d’Europe) ont cinq Fontigi ou Fontiques : les Français en ont deux et l’un d’eux avait été autrefois celui des
Génois. Les Vénitiens en ont deux autres et les Ragusains, un. On appelle fontigo la demeure où réside le
consul de chaque nation qui est particulièrement respectée et ordonnée afin que les marchands puissent en
disposer pour y entreposer leurs marchandises et les conserver sous bonne garde et en toute sécurité. Les
marchands ainsi que beaucoup d’autres étrangers peuvent y héberger à partir du moment où ils
s’annoncent. Chaque fontigo n’a pas plus d’une seule porte devant laquelle les janissaires montent la garde
et attendent les ordres du consul pour l’accompagner à pied ou à cheval à travers la ville. À la nuit tombée,
les Chrétiens doivent regagner les fontigi dès que les Mores en donnent l’ordre en tapant avec un marteau
en fer sur un fer ou sur les portes. Après cet appel, on ferme les porte ; personne n’a le droit de passer la
nuit dehors sans s’exposer à de lourdes peines.
La scala, ou entrepôt des marchandises, est ouverte à tous les Chrétiens qui y sont en sécurité sous la
réserve qu’ils arrivent à Alexandrie « Sotto bandiera » des Français, des Vénitiens ou des Ragusains, et,
qu’ils fassent partie de cette compagnie et s’y inscrivent. Le Bazar d’Alexandrie, où tout se vend et tout
s’achète ouvertement, est couvert comme le Bedestan à Constantinople et dans les autres villes de la
Turquie. On trouve de chaque côté des ruelles couvertes du Bazar ou Batzar les magasins et les échoppes.
Suivant l’opinion général chaque marchandise a une place déterminée ; à cette même place les ouvriers
travaillent. Là on trouve d’innombrables articles somptueux et coûteux que j’ai vu également ailleurs, mais
mon but n’est pas d’écrire sur les marchands, je renonce donc à être précis. J’ai remarqué cependant
quelques articles étranges et inhabituels. En particulier Il faut noter qu’il existe, en raison de la grande
pénurie de bois en Égypte, une herbe que les Arabes appellent kali et les Grecs Anthillis. On fait sécher
cette herbe dont l’usage est double : on s’en sert pour le feu de la cuisine puis on recueille les cendres qui
une fois entassées deviennent dures comme la pierre. On en fait le commerce et l’on s’en sert dans
l’industrie. On expédie de grandes quantités de ce Kali à Venise où on s’en sert pour le verre de cristal. On
utilise conjointement cette cendre et des pierres de Pavie puis on les mélange proportionnellement pour en
obtenir du verre.
Par ailleurs, les paysans égyptiens recherchent les palmiers ou dattiers, ils en abattent le sommet pour en
extraire une moelle blanche qui est vendue ici et consommée en grande quantité. Le goût de cette moelle se
rapproche de l’artichaut, les Grecs l’appellent Encephalon.
On y vend également en abondance la coriandre romaine ou encore le cumin noir appelé ailleurs Nigella ou
Melanthion ; on le mélange à la farine et on le cuit pour que le pain soit bon, odorant et appétissant.
On y vend de même, en grande quantité, une racine nommée colocase avec laquelle les habitants
accommodent leur viande.
Il y a aussi une racine qu’on appelle Bisch ; si on la met dans la bouche, on a l’impression d’avoir une fièvre
d’enfer. Cette racine chauffe comme le feu sur la langue à tel point que son effet ne se dissipe pas même
après deux jours. Les Mores invitent les gens à en goûter par malice. On s’en sert par ailleurs comme d’un
médicament.
La taxe des marchandises est de 24 % en Égypte alors qu’ailleurs, en Turquie, on ne paie que 2 %. Le
montant élevé des droits de la douane s’explique par le fait que lors de l’annexion par la force de l’Égypte
par les Turcs, on a laissé le choix aux habitants de rester au taux qu’on prélevait sous les sultans
précédents ou de s’aligner sur le nouveau taux d’imposition.
Ils se sont donc consultés et ont décidé de conserver leur ancienne habitude et de verser volontairement
24 % aux Turcs de crainte que ce dernier, comme un tyran, ne les impose plus durement et ne les accable
davantage.
Concernant les monnaies, les petites aspres n’ont pas pus cours à Alexandrie et dans toute l’Égypte ; on se
sert d’une autre monnaie en argent nommé maietin qui équivaut à un asper et demi ou 3 kreutzer. Il y a de
même le shahi qui est aussi une monnaie en argent qui vaut 8 aspres et demi ou un huitième de gulden,
8 shahi font un ducat de même que 40 maietin font aussi un ducat. Outre cela, ils ont aussi des monnaies en
cuivre dont 6 font un maietin ; on les appelle folari ; il y a aussi des demis folari dont 12 font un maietin.
Les ducats turcs et les zechini vénitiens ont en Égypte ainsi que dans toute la Turquie la même valeur, mais
on s’en sert plus pour payer des marchandises valant une grosse somme d’argent que dans la vie
quotidienne, excepté quand on veut faire de la monnaie.
Chapitre XV. De quelle manière nous avons poursuivi notre voyage, comment il a été accéléré à force de
lettres de recommandation et autres, et quels furent nos vêtements à terre
Comme nous vîmes ici ce qui était le plus remarquable, à notre avis, et compte tenu du peu de temps dont
nous disposions, nous fixâmes donc la date de notre départ pour la poursuite de notre voyage. Monsieur
Esquissier, le consul, nous a donné des renseignements et de bons conseils pour poursuivre ce voyage, et
ce, oralement mais également par écrit sous forme de lettres de recommandations. Il le fit de bonne grâce
lorsque nous lui demandâmes. En l’occurrence, il s’agissait d’un message pour des personnes du Caire et
d’un autre pour le Patriarche d’Alexandrie que l’on appelle aussi archevêque du mont Sinaï, qui réside
habituellement (comme mentionné ci-dessus) au Grand Caire. Ainsi notre voyage projeté en Arabie s’en
trouvait accéléré grâce à lui. Nous remîmes aussi un troisième message au consul de France à Tripoli en
Syrie Phénicie, nommé Monsieur Renier. Au fontigo, on n’accepta de notre part ni argent ni paiement
d’aucune sorte. De plus, Monsieur le consul, souvent mentionné, nous donna un de ses serviteurs pour nous
accompagner jusqu’au Grand Caire par amitié spéciale et pour nous assurer plus de sécurité. Jusqu’à
présent, en tant qu’étranger, nous avons reçu en pays turc plus de soutien, d’honneur et d’amitié que
certains pourraient espérer de leurs propre amis dans leur patrie, notamment ici de la part du consul pour
lequel nous avons beaucoup de respect et aussi à Constantinople de la part de Monsieur de l’Agent de Vie.
Aussi, je reçus personnellement de la part des Français, notamment des nobles, non seulement en Turquie
mais également auparavant en France et dans d’autres pays, toutes leurs amitiés et bonne volonté. Par
conséquent on peut les recommander propter humanitatem & hospitalitatem erga exteros. Il faut que je
mentionne cela parce qu’on pourrait penser que je suis très stupide et très ingrat si je garde le silence en
face de ces bonnes actions que j’ai reçues et si j’oublie de me souvenir avec respect de ces coeurs français
comme il faudrait dans mon récit de voyage.
Nous commandâmes un chameau pour nos provisions alimentaires et nos autres bagages, et, pour
nous-mêmes et notre interprète juif, des mulets. Nous avons promis de payer deux ducats jusqu’à Rosette.
Les mouckeri allaient à pied.
Concernant notre habillement, nous avons voyagé dans la tenue que nous portions sur le bateau turc
(appelé il galeon del capitano). Entre Alexandrie et Rosette, nous avons vu beaucoup de dattiers dont les
fruits étaient tantôt rouges, tantôt jaunes.
Au fontigo, comme susdit, nous n’eûmes pas de dépenses autres qu’une gratification que nous avons
accordée spontanément aux janissaires de Monsieur le consul qui nous avaient accompagnés à travers la
ville et nous avaient servis à diverses reprises. »379
- 285 - 289 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CARLIER DE PINON (du 3 au 5 août 1579)
Pinon, C. de, Voyage en Orient (1579), par E. Blochet, Paris, 1920.
Dans le manuscrit (Bnf, fr. 6092), Carlier de Pinon précise qu’il est en compagnie de Hans Jacob Breüning,
voyageur précédent.
p. 141-149 :
De la ville d’Alexandrie
« La ville d’Alexandrie, qu’Alexandre le Grand, dont elle a prins son nom, a faict bastir, est pour le jourdhuy
appelée par les Turcs Scandaria, corrompans de ceste façon son appellation ancienne.
(p. 142) Elle est située en Egypte, et ha du costé de levant la coste d’Egypte sablonneuse au long de la mer,
et du costé de ponant, (p. 143) non fort loing, dela, celle de Barbarie. Elle ha vers le midy le continent
d’Egypte, et devers septemtrion, deux assez beaux ports en la mer Mediterranée, desquels l’un est levantin
et l’autre ponentin. A raison de quoy elle est dicte estre le port du Caire, parce que la plupart des
marchandises, qu’on mene du Caire en Asie et Europe, ou bien de ces pays au Caire, passent par ladicte
ville d’Alexandrie.
Sa longueur est de levant au ponant, estant presque bastye en ovale, et ha une grande partye des rues
tirantes les unes droict d’orient en occident, et les autres au travers de celles cy de midy vers le septentrion.
Elle est entourée d’une muraille bastie de pierres de taille, et peut avoir environ six milles de tour. Les
maisons sont pareillement bastyes de pierres de taille, et les murailles sont couvertes de plastre, affin de
n’estre fendues et mangées en hyver, de la pluye et du vent, dont le plastre est mangé au bout de peu
d’années, tant le vent et la pluye y sont frequents et forts durant l’hyver. A raison de quoy les habitans sont
subjects a souvent faire replaster leurs maisons. On voit deça dela par la ville grand nombre de petites
colomnes, les unes plus riches et mieux elabourées que les autres, et de fort beaux portails de maisons,
dont la plupart sont à demy ruinez, comme aussy il y a en plusieurs endroicts des grandes places, ou l’on ne
voit autre chose, que les ruines de maisons. Il y ha aussy deux montaignes, lesquelles ont esté faictes des
immondices de la ville, et (p. 144) racompte Strabon, qu’elles y estoyent desja de son temps. On ha
accoustumé de monter au haut de ces montaignes, pour bien descouvrir toutte la ville, laquelle est toutte
creusée par dessoubs, ou il y ha des grandes cisternes tant communes respondantes aux rues que
particulieres aux maisons, lesquelles sont voultées la plupart, et soustenues de plusieurs rangées de
colomnes les unes sur les autres. On guarde l’eau du Nil tout le (p. 145) temps de l’année dans ces
cisternes, et ne boivent ou se servent les habitans d’autre eau, que de celle cy, sans laquelle il n’y auroit
aucun moyen d’y demeurer, parce qu’il n’y a en toutte la ville, ou lieux circonvoisins aucune eau douce.
Encores est ceste cy amenée par artifice, par le moyen d’un canal, lequel a esté faict par (p. 146) cy devant
par main d’hommes, et prenant iceluy son commencement au Nil, dure plus de vingt lieux, se venant rendre
jusques a un quart de lieue de la ville, auquel endroict, il y a deux calissy qu’ils appellent, lesquels sont deux
murailles espesses, que l’on faict tous les ans pour boucher l’entrée de deux grands conduicts d’eau, quy
venants dessous terre des cisternes de dessoubs la ville, se rendent au susdict canal. La tous les mois
d’Aoust, après avoir rompu les vieilles murailles, et laissé couler l’eau par ces conduicts susdicts pour
remplir les cisternes, on y en rebastit deux autres, affin qu’icelles empeschent, que l’eau du Nil, laquelle n’est
point tousjours par tout le canal, mais seulement lors que le Nil est fort creu, n’antre point petit a petit dedans
les cisternes, mais tout a coup, emportant touttes les immondices, et eaux corrompues, quy sont dedans les
icelles. A raison de quoy ils ont faict faire plusieurs conduicts de l’autre costé, affin que l’eau passante par
les cisternes, emporte avecq soy dans la mer, touttes les corruptions, quy s’y pourroyent estre engendrées
depuis un an. Mais bouchent pareillement lesdicts conduicts, au bout de quinze jours ou troix sepmaines,
lors qu’ils voyent les cisternes bien nettes, et remplyes d’eau. Il eschappe fort peu d’habitans de la ville,
lesquels ne soyent malades au temps, dudict esgout, quy est cause que les plus moyennez d’entr’eux s’en
absentent durant ledict temps. Il y a du costé de la mer troix chasteaux, lesquels defendent les deux ports.
Les rues, ou sont les principalles bouticques, sont couvertes a la façon du beseslan de Constantinople.
Les habitans sont la plupart mores, (car ils prennent ce nom, encores qu’ils ne soyent point noirs). Il y ha
neantmoins (p. 147) assez grand nombre de Chrestiens de ceinture, et grecs, lesquels ont particulierement
des rues ordonnées pour leur demeure. Il n’y a aussy pas moins de Juifs, mais plustot d’avantaige, comme
en la pluspart des villes de la Turcquie. Les Francs ou Latins y ont cinq fontigues, dont deux sont pour les
François, parce qu’ils se servent pour le jourd’huy de celuy la, quy a esté autrefoix pour ceux de Gennes.
Les Venitiens en ont deux autres et les Raguséens un. Et peuvent se venir habituer en iceux fontigues ou
logis, les Chrestiens latins ou Européens, de quelque nation qu’ils soyent, pourveu qu’ils viennent soubs la
bandiera, qu’ils appellent, de France, Venise, ou Raguse.
De ce quy est a veoir dans Alexandrie
Il y a en une grande place au dedans de la ville près des murailles d’icelle, deux grands Obélisques,
lesquels estoyent erigez devant la porte du palais de Cleopatra, duquel on y voit les ruines. L’un de ces
obelisques est encores debout, mais sa base, et une partye d’iceluy est couverte de terre er ruines, ayant a
l’endroict qu’on le peut mesurer au bas, neuf pieds de l’un des quarrés a l’autre, qui faict trente et six pieds
pour les quattre quarrés. L’autre obelisque est cheut par terre. Tous deux sont plus hauts et larges que n’est
celuy de Constantinople, estant en iceux gravées par tout des lettres hieroglificques. Ils sont faicts d’une
pierre, laquelle est marquetée de petites taches noires, a la façon que sont touttes les autres, lesquelles sont
amenées du desert de Thebayde. Et a prins son nom ce desert de la ville de Thebe, laquelle est scituée sur
le Nil, trente journée au dessus du Caire.
Les Chrestiens latins et grecs ont par ensemble un temple, qu’on nomme de Saincte Saba, lequel a esté
refaict de nouveau, (p. 148) ayant esté quelque temps auparavant ruiné par la commune en une emotion
populaire. Il y ha audict temple en tout deux chapelles, la plus grande desquelles est tenue des Grecs, et la
moindre des Latins. Au milieu de la nef nous fust monstrée l’endroict, auquel Saint Marc a presché autrefoix,
et a main droicte du coeur, la colomne, a laquelle Saincte Catherine a esté liée. Ce temple a esté autrefoix
fort beau et grand, comme on peut juger par les belles colomnes de pierres du desert de Thebayde,
lesquelles y sont encores a present.
On monstre au milieu d’un petit carrefour de la ville, une pierre ronde, mais platte par dessus, et fort peu
hors de terre, sur laquelle, ou au moins, en la place d’icelle, Saint Marc a eu la teste tranchée, et ont de
present les Chrestiens de ceinture en ladicte ville, la teste d’iceluy, mais le corps est a Venise.
On y voit aussy la prison, en laquelle a esté guardée Saincte Catherine, le lieu est enfermé, ou au dedans
de la voulte sont escrits plusieurs noms de chrestiens européens. En ce lieu sont troix colomnes, dont l’une
est enfermée, et les deux autres sont en veue, et tiennent les habitans, qu’a ces troix colomnes fust
accommodée la roue, de laquelle on se servoit pour donner la gehenne a Saincte Catherine.
Près desdictes colomnes sont monstrées les ruines du palais du Roy Costo, pere de Saincte Catherine,
ayant iceluy palais esté basty de bricques.
Au pied de l’une des montaignes provenues des immondices de la ville, nous a esté monstré le lieu ou estoit
la maison et demeure du Prophete Jeremie, auquel endroict il y a pour l’heure une petite mosquée.
De ce quy est remarcquable hors de la ville
Il n’y a gueres autre chose digne d’estre veu près d’Alexandrie, que la Colomne Pompée, laquelle est a la
portée d’une barquebusade loing des murailles de ladicte ville, ayant esté erigée par (p. 149) le Roy
Ptolomée en l’honneur de Pompée, lequel l’avoit remis en son Royaume, après qu’il en avoit esté chassé.
Ceste colomne est en lieu fort eminent, estant soustenue d’une base quarrée. Elle est au reste d’une piece,
ayant son chapiteau ouvraigé, et est faicte d’une pierre amenée du desert de Thebayde. Sa rondeur est de
cinq de mes brasses, lesquelles reviennent au moins a vingt et cinq pieds. Sa hauteur approche de cent
pieds, selon que j‘ai remarcqué par l’ombre du soleil que j’ay mesurée a un baston, jugeant que telle
proportion, qu’il y auroit de la longueur de l’ombre au baston, telle seroit celle de l’ombre de la colomne a sa
vraye hauteur. Tout ce que le plus fort et exercité a jetter la pierre, de dix ou douze, que nous estions, sceut
faire, fust de jetter une pierre aussy haut que le chapiteau de ladicte colomne, laquelle est la plus grande,
qu’on sache estre pour le jourd’huy au monde, qui soit faicte d’une seule pierre. La base est pareillement
d’une pierre, laquelle est soustenue sur plusieurs autres pierres de taille, ladicte base est quarrée, ayant dix
et huict ampans d’un coing de quarré a l’autre, lesquels il faut multiplier par quattre, pour avoir la grandeur
des quattre quarrez. »
- 290 - 291 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SALOMON SCHWEIGGER (du 23 au 27 mars 1581)
Schweigger, S., « Salomon Schweigger », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Salomon Schweigger naît en 1554 à Sulz dans le pays de Wurtenberg. En 1577, il prend part en tant que
ministre évangélique de la légation, à l’ambassade autrichienne dirigée par le comte de Sizendorf envoyée
auprès de la Porte ottomane. Après le départ du comte pour Vienne, en 1581, Salomon Schweigger se rend
en Égypte et en Terre sainte avec quelques savants.380
p. 98-100 :
Chapitre IX
« La traversée de Rhodes à Alexandrie
Après s’être promenés dans la ville de Rhodes pendant quelques heures jusqu’à la tombée du jour et après
s’être approvisionnés d’eau fraîche, nous retournâmes à notre galion et partîmes, au nom de Dieu.
Du 12 au 21 mars, nous n’aperçûmes rien d’autres que ciel et eau, nous avions en permanence un mauvais
vent bonazza ou gatmo, c’est-à-dire calme. Le 21, nous vîmes l’Afrique et l’Égypte, le même jour nous
avions un vent fort et confortable. Le soir nous jetâmes l’ancre dans le port de Pikeria381 qui se trouve à
20 lieues italiennes à côté d’Alexandrie. Pendant quelques jours, on ne voit pas de terre, mais on s’en
approche avant qu’on ne l’aperçoive, on garde alors espoir qu’on va bientôt débarquer. A ce moment-là, les
marins montent dans la hune et regardent avec zèle autour d’eux pour chercher la terre, quand ils la voient,
ils informent les gens du bateau. Après quoi, ils veulent un bottenbrodt, chacun donne avec plaisir environ
un meidin, c’est-à-dire 3 kreuzer. Les gens expriment une grande joie. On ne peut pas dire à quel point le
désir de voir la terre ferme peut être grand chez un être humain. Je ne sais pas si j’ai déjà ressenti un tel
désir pour une chose. C’est comme un enfant qui se réjouirait de sa mère qui sans le vouloir l’aurait
abandonné quelques temps. Puisque la terre est notre mère à tous, elle nous porte, elle nous nourrit et nous
éclaire de sa grâce. Donc pourquoi l’être humain ne devrait-il pas se réjouir d’elle, notamment dans ces
occasions où on vit les dangers de l’eau et où l’aide de la chère terre-mère est nécessaire.
Nous passâmes toute la journée du 22 mars dans le port de Pikeria, nous attendîmes un vent favorable afin
de nous rendre en bateau à Alexandrie. Près de ce port, se trouvent un château turc et quelques maisons
égyptiennes.
Chapitre X
Description d’Alexandrie
Le 23 mars à minuit, nous arrivâmes joyeusement à Alexandrie que les Turcs nomment Scenderia. Le 24,
nous descendîmes du galion et nous prîmes un logement dans la ville chez un Grec de Chypre. Chez lui,
nous trouvâmes un accueil et un hébergement très confortable, ceci nous rendit très contents. Cette ville est
bien réputée en dehors de son pays mais quand on s’en approche ou qu’on y entre, on ne voit rien d’autre
qu’un désert désolé. On y trouve très peu de maisons entières, la plupart sont presque toutes détruites. On
doit marcher une longue distance dans cette ville pour arriver à une maison. Je ne peux pas mieux décrire
cette ville qu’en la comparant à (p. 99) une carrière. On y trouve de nombreuses marchandises de divers
commerçants venant d’Inde, d’Arabie, de Perse et d’Ethiopie en passant par le Caire ; ce sont surtout des
épices et de la soie. Dans cette ville habite un consul français qui possède une maison et des domestiques.
Le consul assure l’exportation et l’importation des marchandises et le déplacement des commerçants.
Je n’ai pas trouvé d’autres Antiquités qu’une colonne de porphyre qu’on appelle pyramide ou obélisque
décorée d’anciens symboles égyptiens païens religieux ou hiéroglyphes. On en trouve une comme je l’ai
décrit ci-dessus à Constantinople. Item, il y a une autre colonne en dehors de la ville sans inscriptions. La
ville est très grande, elle possède une enceinte fortifiée en bon état, on peut deviner à l’apparence de ses
tours qu’elle a dû être une ville magnifique avant que l’empereur turc Soliman ne conquière le royaume
d’Égypte en 1517 après J.-C.
La ville d’Alexandrie se trouve dans le royaume d’Égypte, dans leur langue, les Arabes l’appellent
Bardamassar qui vient du mot bar, la terre, et, massar est le nom du petit-fils de Noé, en l’occurrence
Mizraym, ce dernier était le fils de Ham. Le pays porte toujours le nom de ce Mizraym. (Citation de la Bible,
psaume 105). La capitale de cet empire qui est Cairo ou Alchiabir est appelée Missir, (nom dérivée)
également de ce Mizraym. Ce royaume, comme d’autres, s’est attiré la colère de Dieu de sorte que sa
splendeur ancienne ne se ressent nulle part, contrairement à l’époque de Ptole. Philad. régnant sur 20 000
villes qui par la suite s’unirent dans une seule ville Cairo.
Cette ville fut construite sous le règne du puissant empereur Alexandre de Macédoine en 3629 et aux
alentours de 338 avant J.-C. Au début elle mesurait 15 000 pas de longueur qui correspondent à 4 lieues
allemandes moins un quart de lieue. D’autres disent qu’elle mesurait 80 stades qui correspondent à 3,5
lieues allemandes et qu’elle avait la forme d’une robe macédonienne qu’on appelle chlamis. Cette forme
correspond à un demi cercle. Au midi de cette ville se trouvait un grand lac, Mareotis, à partir duquel partait
une branche vers le Nil, Ostium primum Nili Canopicum, qui se trouvait à 4 lieues de la ville. La mer
Méditerranée touche la ville de sorte que l’emplacement est magnifique. A moins d’une lieue allemande
devant la ville, c’est-à-dire 875 pas, se trouvaient une île et une belle tour pour les marins qu’on appelait
Pharus. Cette île fut reliée à la ville par Cléopâtre au moyen d’une digue de sorte qu’on pouvait y aller en
marchant à pied jusqu’à la tour. C’est pour cette raison que de nos jours de pareilles tours sont appelées
Pharus et Phanar. A l’intérieur, pendant la nuit, il y a une lumière afin que les marins puissent naviguer
prudemment. Au Pont-Euxin se trouve un Phanar semblable car il est très dangereux d’y naviguer. De nos
jours le lac Mareotis n’existe plus. Auparavant on appelait cette ville No qu’Alexandre le Grand a agrandi à
une époque tardive et lui donna une réputation plus grande en l’appelant par son nom. C’est ici qu’il est
enterré après être mort à Babylone.
Après sa mort quand l’empire fut divisé en quatre parties, le fils de Ptolemaeus Philadelphus Lagi a établi
dans cette ville une puissante cour royale et une grande École. Il possédait 20 000 chevaux, 2000 véhicules,
4000 éléphants et 200 000 soldats d’infanterie. Il avait toujours dans sa baie 700 000 volumes dont 4000 ont
été détruits dans un incendie en 45 avant J.-C.
En 3684 après la création du monde, c’est-à-dire en 283 avant J.-C., le roi Ptolemaeus Philadelphus a
demandé au prêtre Eleasar à Jérusalem de lui envoyer 70 prêtres connaissant les deux langues, l’hébreu et
le grec, pour traduire la Bible en grec. Ils accomplirent cette tâche avec zèle et ont été récompensés par le
roi par des dons royaux. Le roi leur donna deux tonnes d’or. Les arts libres s’épanouirent aussi bien que les
sciences ; il y avait une École fameuse mentionnée également dans l’Histoire des Apôtres. Dans cette
Histoire on lit que beaucoup de membres de cette École s’opposèrent à saint Stéphane et aidèrent à le
condamner à mort. Dans cette École furent élever beaucoup de savants notamment le très savant
astronome Claude Ptolémée qui excellait en comparaison des autres astronomes de cette époque. Il vivait
en 131 après J.-C.
Dieu le tout puissant ne donna pas seulement à Alexandrie les lois de Moïse qui l’ont guidé à la vérité. Dieu
envoya aussi Marc l’évangéliste qui prêcha le saint Évangile et l’enseignement du fils de Dieu, l’évangéliste
ne fit pas que prêcher avec un grand effort, il créa aussi des églises avec beaucoup de zèle. Dans les temps
anciens le maître Athanase vivait dans cette ville, il assurait la fonction d’évêque dans les églises
chrétiennes. Ce dernier, lors du concile de Nicée en 320 après J.-C. s’est montré très courageux contre
l’hérétique Arium. De plus il y avait dans cette ville d’autres évêques très pieux et excellents. En somme,
Dieu le puissant éleva cette ville en la dotant de beaucoup de dons terrestres et célestes. Mais cette ville
déclina terriblement de sorte que de nos jours elle ressemble plus à une carrière qu’à une ville comme je l’ai
mentionné plus haut. (On peut lire chez Strabon les mots de Poere : plus grande est la ville plus grands sont
son déclin et sa décadence). (p. 100) Nous devons bien garder en tête cet exemple de la colère de Dieu et
nous devons le remercier de tout coeur pour ces riches dons et ses bienfaits qu’il nous donna en Allemagne
afin que nous ne nous fâchions pas avec notre ingratitude et nos péchés et qu’il ne détruise pas notre ville
comme il le fit avec Alexandrie. Dieu ne regarde pas la personne, Dieu punit chaque mauvaise action et
n’épargne personne.
La ville d’Alexandrie est actuellement habitée par des Mores, des Turcks, des Chrétiens et des Juifs. Il y a
divers chrétiens, beaucoup sont de religion grecque, les autres chrétiens sont appelés Kofdi, qui signifie les
excisés en grec vulgaire, et, sont appelés christiani della cintura par les peuples romans, ce terme vient du
mot ceinture. Les Jacobites de Jacob l’hérétique ont la même religion que les Abyssins ou Pretejani382 dont
je parlerai plus loin. Les Grecs ont appelé une des églises de cette ville du nom de S. Saba. La résidence du
patriarche grec se trouve là, mais il a l’habitude de séjourner au Caire pour être près du wascha383 afin de
mieux régler directement les affaires avec la cour. Mais un vicaire du nom de Meletius Jeromonachus est à
Alexandrie, c’est un homme aimable et il est le plus savant des grecs que j’ai rencontrés, il maîtrise très bien
le latin, l’italien et le grec. Excepté cet homme, je n’ai rencontré qu’un autre grec capable de connaître le
latin ; il s’appelle Joannes Zygomalas (Protoherminea Patriarchae Constantinop.). Après m’être lié d’amitié
avec le susmentionné Meletius, je lui offris un Nouveau testament greco-latin qu’il accepta gracieusement.
Meletius me rendit visite aimablement dans mon logement et auberge pour prendre un verre avant de se
coucher. Il nous accompagna aussi, moi et mes braves compagnons, quand nous voulions partir pour
Raschidi, près du Nil. Après quelques jours, quand nous nous trouvions à Raschidi sur le Nil, je reçus une
lettre aimable de sa part dans laquelle il me présentait ses salutations et félicitations pour notre voyage ; il
me déclarait également sa nostalgie pour la Terre Sainte et l’endroit des souffrances de notre seigneur le
Christ. Il se plaignait également de cette affaire et des nombreux obstacles. Dans cette même lettre, il nous
conseilla d’être modeste et prudent à Jérusalem et de bien apprendre les moeurs, les habitudes et l’histoire
pour ne pas nous mettre en danger. Il craignait que nous soyons trop libres et imprudents dans notre volonté
de tout connaître. De plus, il me demanda, après que Dieu m’ait ramené en Allemagne chez les miens, que
je lui fasse un récit de mon périple. De tout cela on peut ressentir qu’il a une bonne âme allemande et non
pas une âme grecque espiègle. En tant qu’étranger dans un pays étranger, je me réjouis de cet événement.
Cette lettre, rédigée en bon grec, contenait à la fin un periodus latine (citation en grec et en latin).
Alexandrie le 27 mars 1581. »384
380 Abbé Gley, « Sweigker ou Schweigker, Salomon », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.),
Biographie Universelle ancienne et moderne 44, Paris, 1826, p. 264-265.
381 Aboukir.
382 Prêtre-Jean.
383 Pacha ?
384 Traduction : K. Machinek.
- 292 - 294 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PROSPER ALPIN (de mars à juillet 1581)
Alpin, P., Histoire naturelle de l’Égypte, 1581-1584, par R. de Fenoyl, S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1977.
Prosper Alpin naît à Marostica dans l’état de Venise en 1553. D’abord militaire, il se tourne vers la médecine
qu’il étudie à l’Université de Padoue dont il en sort diplômé en 1578. Il exerce d’abord son art aux environs
de cette ville, mais il sent le besoin de s’instruire ailleurs. L’occasion lui est donnée de partir pour l’Égypte
comme médecin avec le consul de la République de Venise. Embarqué le 21 septembre 1580, il arrive à
Alexandrie le 22 mars suivant, après avoir mis à profit ses escales pour herboriser. Il s’informe sur la
médecine que l’on y pratique, afin d’enrichir ses connaissances par l'étude des maladies et des remèdes. Au
Caire où il exerce, il multiplie les contacts non seulement avec les colonies vénitienne et française mais
aussi avec les médecins et malades locaux. Il séjourne en Égypte trois ans et demi. De retour en Italie, en
octobre 1584, il est engagé comme médecin à Gênes. Plus tard, Venise le rappelle pour lui confier la chaire
de botanique au Jardin botanique de l’Université de Padoue où il meurt en 1617. Ses publications lui valent
une grande notoriété de botaniste et de médecin. Histoire naturelle de l’Égypte, en quatre livres, n’a été
publiée qu’en 1734. Il est également l’auteur de La médecine des Égyptiens éditée en 1591.385
p. [14] (t. 1) :
« Mais, dans les endroits plus proches de la mer, comme Alexandrie, Rassit (Rosette) et Damiette, nous
avons vu tomber des pluies très abondantes en mars et avril, et beaucoup plus fréquentes en hiver. Il n'est
donc pas étonnant que là-bas l'air soit plus humide et moins chaud. »
p. [33]-[36] (t. 1) :
« Mais maintenant, parmi les villes les plus illustres d’Égypte, j’en viens à Alexandrie, Galien de Pergame,
sans conteste le premier des médecins après Hippocrate qui les dépasse tous, a coutume de nommer
« Alexandrie la Grande ». Bien qu'à notre époque cette ville gise, à demi démolie dans sa plus grande partie,
et presque à moitié ensevelie, cependant son étendue et sa majesté sont attestées par les ruines et les
vestiges qui en subsistent, et spécialement par des édifices qui furent construits si hauts que la partie
d'eux-mêmes enfouie dans la terre égale celle qui dépasse la surface du sol. Maintenant encore toute la ville
repose sur des colonnes de marbre et tous les espaces rendus vides par les terrassements en profondeur
sont remplis par l’eau du Nil qui, chaque année, au moment de la crue, s’écoule dans ces parties
souterraines par le canal appelé Caliz.
Il reste, croit-on, dans cette ville, des vestiges de l'ancien palais royal de Cléopâtre. Nous avons vu
nous-mêmes que, près de ces restes, on avait déterré deux têtes de marbre, nullement endommagées par
le temps, mais en très bon état et absolument parfaites : l'une représentait artistement Cléopâtre, et l'autre,
Marc-Antoine. Il subsiste aussi la colonne appelée colonne de Pompée, d’une longueur et d’une épaisseur
vraiment remarquables, ainsi que le très bel obélisque sur lequel sont gravées des lettres égyptiennes
(appelées hiéroglyphes).
À côté de la ville se trouve le lac nommé « Maréotis », formé par de l'eau dérivée du Nil mêlée à de l'eau de
mer. Ce lac, en effet, lorsqu’il est à son niveau le plus haut, se mêle à la mer au point de sembler lui-même
en faire partie.
La vieille ville n'est presque rien d'autre que les vestiges et les ruines de la cité plus ancienne, et elle a très
peu d'habitants. En conséquence, l'air est devenu beaucoup plus malsain qu'auparavant, surtout en août,
tant à cause de l'eau, qui est stagnante et à demi corrompue (car elle est devenue fangeuse et presque
complètement putride à cause de sa faible quantité ; et sa mauvaise qualité n'est pas améliorée avant qu'elle
soit renouvelée, en septembre, par la crue du Nil, lorsque beaucoup d'eau excellente arrive du fleuve et la
remplace), qu'en raison des vents, en partie fétides qui soufflent du lac Maréotis, stagnant et à moitié
corrompu, lui aussi, à cause de l'eau fangeuse. Et c'est à cela que les indigènes attribuent les maladies
pestilentielles – presque des épidémies – qui se répandent à ce moment dans la ville.
La nouvelle ville
Depuis plusieurs années, beaucoup de gens ont fui la ville et se sont installés en assez grand nombre sur
les terrains jouxtant la mer, c'est-à-dire vers la Citadelle d'Alexandrie, là où habitent maintenant tous les
juifs : ainsi, par les uns et par les autres, une seconde ville a pour ainsi dire été fondée. Cette ville a de très
beaux espaces verts ; certains sont même le long du rivage de la mer, sur un sol de sable, en dehors des
remparts de la ville ; et il y a lieu de s'étonner en voyant comment vivent et prospèrent, dans le sable seul,
les plantes potagères et les fruits de jardins tels que concombres, melons bausia386, meloukhia387, laitue,
figues, pêches, abricots, bananes et autres semblables. Des câpres sans épines poussent, spontanément,
en telle abondance que, chaque année ; conservés dans du sel, ils sont exportés en grande quantité vers
diverses régions et vers les provinces.
Il y a des forêts de dattiers, beaucoup de cassiers purgatifs, des sycomores, des paliures, nommés Habac388
par les Égyptiens ; les fruits du paliure sont d'un goût très agréable, tout à fait semblables, par leur grosseur
et leur aspect, aux néfliers mais pas aussi astringents. Les raisins poussent ici en assez grande abondance ;
ils sont très beaux et très bons ; ils servent de nourriture, et non pas pour faire du vin, car les Alexandrins
n'en ont pas assez pour pouvoir en faire à la fois un aliment et du vin. Ils sont mûrs au mois de mai. Nous
nous souvenons d'avoir vu ici, dans un jardin, le 14 mai, des raisins blancs et des raisins noirs tout à fait
mûrs. Que ces quelques indications sur Alexandrie soient données en passant, car il ne nous échappe pas
que d’autres auteurs en ont transmis beaucoup plus à la postérité. »
p. [56] (t. 1) :
« …Alexandrie a été appelée le grand Marché du Monde. »
p. [134] (t. 1) :
« La polenta faite avec de l'orge fraîche est la nourriture habituelle de beaucoup de gens. À Alexandrie on
mange encore ce plat que Galien avait coutume de nommer "le plat des Alexandrins". Il est fait de poireaux
salés et de bière ; mais on ne fait pas de bière actuellement en Égypte : on la remplace par un vin de dattes
appelé subia389 et très supérieur à la bière. »
p. [177]-[178] (t. 1) :
« Les Maures prient pieusement cinq fois par jour, comme nous l'avons dit, et surtout le vendredi, que la
plupart d'entre eux respectent comme un jour de fête. Remarquable est ce que font, ce jour-là, les habitants
d'Alexandrie, parce qu'un saint homme (comme ils disent) leur avait prédit autrefois que des chrétiens
étrangers s'empareraient de leur ville un vendredi : mus par cette crainte, pendant qu'ils sont en prière dans
les temples ces jours-là, ils enferment tous les Italiens, Français, Anglais et autres chrétiens étrangers dans
leurs (p. 178) boutiques, gardent les clés et ne permettent pas que les portes soient ouvertes et que les
marchands sortent de chez eux avant la fin de la prière. Ils font cela par crainte que, pendant qu'ils sont
occupés à la prière, les chrétiens s'emparent de la ville et l'arrachent à l'empire des Turcs. »
p. [185]-[186] (t. 1) :
« C’est de leur groupe que faisait partie Serge, dont on croyait qu’il fut le principal fondateur de la secte de
Mahomet, parce qu’il fut irrité de ce que les caloyers ne l’avaient pas élu Patriarche d’Alexandrie comme il le
souhaitait. Ce fut lui, en effet, qui instruisit et aida Mahomet. Car Mahomet ne savait même pas lire et écrire :
au lieu de signer pour authentifier ses préceptes, il noircissait d’encre sa main et l’appliquait sur le papier
pour y laisser son empreinte. »
p. [187]-[188] (t. 1) :
« À Alexandrie, un certain Malem, c’est-à-dire un publicain chargé de percevoir les taxes sur les
marchandises qui entrent ou qui sortent, avait obligé ces révérends moines à payer la taxe pour une certaine
quantité de vin qui leur venait, par bateau, de l’île de Crète. Mais comme il n’avait jamais payé de douane à
cause du privilège que leur avait autrefois concédé Mahomet, ils allèrent trouver le vice-roi et le supplièrent
de ne pas les obliger à payer, étant donné qu’ils avaient toujours été exemptés de tout versement en raison
de la franchise que Mahomet leur avait concédée. Ibrahim lut le document en audience publique, devant
beaucoup de monde, et ayant reconnu l’empreinte de la main de son prophète Mahomet, il posa
immédiatement le parchemin sur sa tête, en signe de respect, selon l’usage des Turcs, et dit : « C’est une
honte, et même très grande, que de laisser ces saintes reliques de notre prophète entre les mains des
infidèles». Après quoi le vice-roi garda le document et le remplaça par un autre, et en souvenir de Mahomet,
il accorda très volontiers aux moines tout ce qu’ils demandèrent. »
p. [307]-[308] (t. 1) :
Les câpres
« Pour les câpres, dont Alexandrie fournit une abondante récolte, on ramasse les fleurs avant qu’elles
s’ouvrent et on les confit dans le sel, ou on en fait cuire dans l’eau et on les conserve avec de l’huile et du
vinaigre. Les plus réputés de toutes sont celles venant d’Alexandrie. Il y en a bien qui viennent de Ligurie,
conservés dans le sel ; elles sont savoureuses mais beaucoup plus petites que celles d’Alexandrie, parce
que les câpriers qui poussent à Alexandrie d’Égypte sont eux-mêmes plus grands, ont de plus grandes
feuilles et sont moins épineux. Les câpres salées sont hautement recommandées pour ceux qui ont
l’estomac chargé d’humeurs grasses et pituiteuses, ainsi que pour les estomacs faibles et souffrant
d’inappétence, pour les obstructions intestinales, spécialement pour les spasmes ou la paralysie de la rate
provoquée par ces humeurs, pour les fièvres invétérées et chroniques. »
p. [345] (t. 1) :
« Nous avons vu que la jusquiame blanche a son origine en beaucoup d'endroits, mais en particulier dans la
plaine autour des pyramides. Nous en avons donné un dessin dans notre second livre sur Les Plantes
Exotiques que nous avons collectionnées durant les vingt années passées à Venise. (…). La plante en
question ne pousse plus, à Alexandrie et dans l'ancienne Memphis, que sur les gravats des ruines. »
p. [347]-[348] (t. 1) :
Chiens : legs à leur intention
« Mais les Égyptiens sont tellement humains et généreux envers les bêtes, surtout envers les chiens, que
beaucoup, en mourant, prescrivent par testament à leurs héritiers de distribuer chaque jour aux chiens de
nombreux pains de blé. C'est une chose que beaucoup font de leur vivant. En effet, des gens viennent
chaque matin dans certains quartiers de la ville, presque déserts, où se trouvent toujours des bandes de
chiens auxquels ils apportent des corbeilles de fibres, parfois grandes, pleines de très bons pains. En
arrivant, ils appellent les chiens à pleine voix en criant "Thiau, Thiau !". À ce cri, les chiens accourent et
dévorent la ration habituelle qu'on leur jette. C'est à Alexandrie que nous avons vu faire cela pour la
première fois – non sans étonnement. Il y a beaucoup de femmes qui nourrissent les chiennes vivant sur la
voie publique et les chiots qui viennent de naître. Mues par la pitié, elles entretiennent devant leur maison,
pendant plusieurs jours, un vase plein de la meilleure eau, et elles servent aux chiens de l'eau pure qu'elles
renouvellent, ainsi que des pains et d'autres aliments excellents.
Il est étonnant que, sous ce climat très chaud, les chiens ne soient jamais atteints de la rage ; les indigènes
voient, non sans raison, un rapport entre ce fait et la lèpre dont souffrent tous les chiens, sauf ceux – peu
nombreux – qui se baignent, une fois ou plus chaque jour, dans le Nil. J'ai vu à Alexandrie une très belle
chienne, nourrie chez des marchands vénitiens et qui, chaque jour, à l'aube, allait se baigner dans la mer.
Ainsi demeurait-elle toujours indemne de la lèpre. Chose plus étonnante encore : chaque matin elle habituait
ses chiots à la baignade, les conduisant quotidiennement à la mer ; ils se portèrent, eux aussi, très bien. »
p. [382] (t. 1) :
« Les chouettes pullulent partout dans les ruines d'Alexandrie et du Caire ; elles ont presque la taille des
colombes et volent jour et nuit en décrivant des cercles. »
p. [383] (t. 1) :
Volatiles aquatiques
« Dans le lac proche d’Alexandrie, nous avons vu souvent des poissons qui sortent de l’eau et volent
au-dessus de la surface. D’aucuns les appellent colombes, et ils n’ont pas tort, vu une certaine
ressemblance qu’ils ont avec les colombes. »
p. [391]-[392] (t. 1) :
Poissons de mer
« À Alexandrie, à Rassit et à Damiette, la mer d’Égypte produit d’innombrables et excellents poissons. On en
sale de grandes quantités que l’on envoie dans les provinces limitrophes, et surtout dans l’île de Crète d’où
l’on rapporte, en échange des poissons, d’excellents vins pour les chrétiens et les juifs qui habitent ici. On
conserve dans le sel des oeufs de poissons appelés botarac, que l’on exporte pour la vente dans les îles
voisines et aussi, en quantité non négligeable, à Venise. On trouve communément en Égypte les dorades,
les soles, les barbeaux, les mulets, l’aiguille comestible, les goujons, les crabes, les huîtres, les chames, les
tellines.
Allant à pied à Rassit, sur le rivage de la mer d'Alexandrie, nous avons vu de tout petits crabes, pas plus
grands que l'ongle d'un pouce d'homme, tellement rapides qu'ils volaient pour ainsi dire du rivage à la mer
en un clin d’oeil. C'est à juste titre qu'Aristote les a nommés crabes coureurs. Ils montent en masse de la mer
sur le rivage et nous en avons vu, sur le rivage, une bande quasi innombrable. »
p. [450] (t. 1) :
« En arrivant à Alexandrie, je vis deux pards, très grands, comme des lions ; ils étaient chez Antoine
Calepio, noble Bergamasque, vice-consul de la Nation Vénitienne et qui dirigeait ici un important commerce.
Dans un but lucratif, il élevait toujours quelques-uns de ces animaux. Une fois, il en vendit un cinq cents
écus couronnés. Ces pards étaient tellement bien apprivoisés qu'ils dormaient avec lui en ronronnant
comme des chats. Ils étaient calmes ; ils dormaient toujours sur les canapés du vice-consul, déchirant même
ses coussins en soie d'une grande valeur. Il les nourrissait de viande. Nous allions souvent avec un pard
chasser la gazelle et nous contemplions la lutte entre les deux animaux, spécialement l'adresse de la
gazelle, qui combattait le pard avec ses cornes très dures mais, finalement, très fatiguée et très épuisée par
la lutte, était tuée. »
p. [459]-[461] (t. 1) :
Les callitriches
« Malgré sa nature très sauvage, cet animal est si facile à apprivoiser que n'importe qui le rend traitable en
lui donnant à manger et qu'il reste un ami bienveillant et fidèle pour les hommes qu'il connaît. Le second des
singes callitriches, nous l'avons vu à Alexandrie, vivant avec le premier, auquel il ressemblait assez par sa
couleur semblable à celle d'un âne, sa face et tout son corps, sa barbe de chèvre. Il a, comme ce singe, des
traits repoussants ; comme lui, il est farouche, sauvage, mal élevé, inconstant avec tout le monde ; bien qu'il
paraisse apprivoisé, jamais on ne peut lui faire confiance car c'est un animal sauvage et inconstant.
Maître et esclaves chez les callitriches
Ces deux derniers singes, nous les avons vus, comme nous l'avons dit, à Alexandrie, dans l'auberge
vénitienne ; ils avaient été achetés par l'Illustrissime François Priuli, exerçant ici la charge de consul pour la
Sérénissime République de Venise. Celui qui ressemblait à un lion et avait, comme je l'ai dit, la face et le
corps tout noirs était appelé Carander ; l'autre, ressemblant à un âne par sa couleur et sa forme, Suidam. Ce
dernier, quoique plus gros, obéissait à l'autre, qu'il craignait et redoutait beaucoup. Si on lui présentait de la
nourriture, il n'osait pas la prendre et manger avant que l'autre se soit servi et ait mangé. Si par hasard il
avait eu la négligence de prendre le premier ce que quelqu'un présentait, Carander le punissait sévèrement
en le mordant. Suidam, lorsqu'il avait commencé à prendre quelqu'un en grippe, supportait mal de le voir. Il y
avait un certain chrétien copte qui servait les marchands vénitiens demeurant dans l'auberge. (Je ne me
rappelle pas pourquoi il fut pris en grippe par ce singe). Suidam avait pour ce serviteur copte une telle
aversion que, à sa vue, il se moquait de lui en allongeant son museau et en faisant des grimaces et des
contorsions propres à le tourner en ridicule. Chaque fois qu'il le voyait, il s'appliquait à se montrer moqueur
et pénible avec lui. Une fois, pour s'amuser, le chrétien prit un morceau de bois et fi semblant de vouloir
frapper le singe. Celui-ci, saisissant brusquement le bâton avec ses puissantes mains, frappa violemment le
chrétien à la tête. »
- 295 - 298 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN PALERNE (du 20 au 25 juillet 1581)
Bernard, Y., Jean Palerne, d’Alexandrie à Istanbul, Paris, 1991.
Jean Palerne Forésien (1557-1592) serait natif de Fouillouse, près de Saint-Étienne en Forez. À l’âge de
dix-neuf ans, il suit François duc d’Anjou et d’Alençon, fils d’Henri II, dans ses divers voyages en France et
en Angleterre, en qualité de secrétaire. De 1581 à 1583, il effectue un voyage dans le Levant à partir duquel
il rédige un récit en 1584 lorsqu’il se trouve à Lyon. En 1587, il est nommé Contrôleur des Trésoriers à
Orléans.390
p. 71-79 :
« Chacun se resjouissait du beau & bref voyage : ainsi allans a l'ayse entrasmes dedans le port : à la
bouche duquel y a deux chasteaux, qu'est le Farzion à droite, & castelletto à gauche : & ayans desployé
toutes les enseignes, bannières, & banderolles, & mis toute l'artillerie par ordre, furent lesdits chasteaux
salues de quinze coups de canon : & apres avoir donné fonds, furent les autres navires du port saluees de
toutes nos pieces ensemble, qui faisoyent au nombre de vingt cinq, tant grosses que petites, de façon qu'il
sembloit, que la ville fust assiegée. Or nous arrivasmes le XX, dudict mois de Juillet, & le 23 jour de nostre
navigation depuis Venise distant dudit Alexandrie environ de deux mil.
De nostre arrivée en Alexandrie, & comme tous les vaisseaux estrangers faut qu’ils marchent soubs la
banniere de France
Le lendemain nous allasmes en terre loger aux Frantiques de France, qu’est une maison dans la ville en
forme d’un monastere, separé par petites chambrettes, destinées pour les François qui y traficquent. Il y en
a encores d’autres pour les Vénitiens, & autres : toutefois il fault notter que toutes les nations du monde
negocians en Levant, sur les terres du grand Seigneur, sont contrainctes de marcher soubs la banniere de
France, en payant le droict de deux pour cent au conseil, qui se tient là pour la nation Françoise, qui a
pouvoir de decider des differens qui naissent entre les marchans. Et encores qu’ils ayent à faire à Mores &
Turcs, si est ce qu'ils ne sont point obligez d'aller à la Justice Turquesque, tellement qu'arrivant un navire
Chrestien, de quelque pays et contrée qu'il soit, hormis des Venitiens, fault qu'il mette la banniere, & armes
de France entrant au port : car autrement seroit le tout confisqué : car ainsi le veut le grand Seigneur, qui à
donné ceste auctorité au Roy de France en ses Franticques, dont s'accommodent tout passagiers &
pelerins, se retirans chacun vers sa nation, au moins aux villes maritimes, où il y en a. Laissans donc nostre
navigation, & disours de la mer, il s’ouvre maintenant subject de parler de terre ferme.
De la ville d’Alexandrie en Aegypte, des Antiquités, singularités, & lieux saincts, qui se voyent, du lac
Maréotis, arbres, & plantes, qui croissent au tour de la ville
Alexandrie est située au bord de la mer, en pays sablonneux, comme sont presque toutes les autres villes
d’Égypte, s’avançant asses dans la mer, appellée par les Mores & les Turcs Scanderia, de Scander, qui
signifie Alexandrie : quasi en forme ovale, ayant d’un costé la mer Méditerranée, & de l’autre un grand lac,
qu’on nomme le lac Marcotis, contenant environ trois cens mil de circuit, comme nous asseurarent ceux du
pays : & disoient d’avantage, que s’estoit celuy là mesme, qui fut anciennement fait & cavé par artifice,
profond de vingt cinq toyses, pour conserver l’eauë qu’on y fait aller par un canal du Nil, qui se sépare au
dessus du Caire. On nous voulut persuader, que tous les Vendredis ores l’eauë en devenoit rouge.
Dudict lac il y a environ un mil jusques à la ville, laquelle souloit estre de grand trafic : & est celle mesme que
Démocrate Mathematicien designa à Alexandre le grand, estant encores les mesmes murailles en leur
entier, qui sont doubles, & si bien estendues par belles arcades, que le soldat à pied, voire à cheval, peut
aller au tour toujours à couvert : & sont si bien flanquées, qu’on y conte de trois à quatre mil tours, ayant
environ six mil de circuit.
Elle fut ruinée lors qu’un de nos Roys de France avec celuy de Chypres contraignirent le Soldan de la
quitter. Il se peut encores veoir par les colonnes arcades, & fragments de marbre, quelle estoit ceste ville, où
il n’y a maintenant que deux ruës habitées, qui sont couvertes, comme elles sont aussi par toute l’Egypte,
terre Saincte, & Surie : quoy que soit celle, où se vend la mercerie, qu’ils appellent Bazarts : & ce à cause de
la grande chaleur qu’il y faict, & les maisons couvertes en platte forme, ou terrasses, de façon qu’on peut
marcher au dessus comme en la ruë : aussi est ce le promenoir des habitans apres le repas. Cecy servira
donc pour l’intelligence des bastimens des autres provinces méridionalles, dont sera cy apres traicté, sans
repeter la forme d’iceux.
La ville est tellement ruinée, que sans les Frantiques des nations qui y trafficquent, elle seroit presque
déshabitée & encores ceux qui y veullent habiter, s’en vont plustost bastir à la marine, hors de la ville, que
dedans. Tellement qu’au pres du port, l’on a desja faict un petit bourg, plustost pour la commodité dudit port,
qu’autre chose, encores que la ville n’en soit pas loing : où il y a tousjours quatre galères pour la garde.
Le lieu est tres-abondant en poisson, chair de mouton, & plusieurs fruicts, que nous n’avons pas communs
en nostre Europe, comme Carrobes, l’arbre duquel ressemble au Cassier, & produit son fruict comme febves
estans en leur escorce mais plus gros, plat, & de mesme couleur estans seiches, que seroit un morceau de
colle-forte, & ainsi faict. Ses noyaux y sont rangez comme febves, mais ne servent à rien, & n’y a que ce qui
est au tour : & à son escorce dure, comme marrons. Plus y a force de grenades, limons, oranges, & des
figues les plus grosses & meilleures, que j’aye veuës. On y apporte aussi de bons raisins, dont nous
mangeasmes lors que nous y estions, bien que ce ne fust encores qu’au dix neufiesme de Juillet.
Il y a quantité de Cappriers produisans des cappres tres-grosses, & des palmiers qui jettent les dattes. De
c’est arbre ils en tirent plusieurs commoditez. Premièrement ils ont les dattes, qu’est son naturel & meilleur
fruict. Tirent du boys une certaine filasse, de laquelle ils font des cordes, bruslent le boys, dont ils ont grande
necessité au moys de May. Ils recueillent encor’ certains petits rejects, dont ils font salades : & apres
coupent la pointe des rameaux : recueillent encores une certaine moüelle, qu’ils portent vendre aux villes, &
se mange cruë : mais ce qui est digne de remarque en cest arbre, c’est qu’il y a masle & femelle, laquelle ne
produiroit jamais quoy que ce soit, son fruict ne viendroit à maturité, si premierement on ne jettoit des
rameaux du masle sur la femelle.
Or revenans à la ville, les belles cisternes, qui y sont sans nombre, sont aussi dignes d’admiration, si bien
fabriquées par grandes arcades & colonnes, le tout en son entier : & la ville bastie au dessus : elles ont esté
faictes respondantes les unes aux autres, pour recevoir l’eauë du Nil ; n’ayant autre commodité d’eauë que
celle là. Car lors qu’il croit, ils y font aller l’eauë par le canal ou rameau qu’Alexandre le Grand fit encores
caver exprez, qu’ils appellent Calix, lequel remplit toutes lesdites cistemes une foys l’année, lors que le Nil
croist. Par ainsi ils ont provision d’eauë pour tout le reste de l’année, jusques à ce qu’il retourne.
Pendant ce temps là, qui dure environ deux ou trois moys, on se peut embarquer sur ledit canal, pour aller
au Caire : mais hors ledit temps il demeure à sec, & se faut aller embarquer à Rosette, journée & demy delà.
Il y a trois montaignes dans la ville : & entre autres singularités, & antiquités qui s’y voient, faut premierement
remarquer deux esguilles, ou obelisques, qui sont dans la ville près la muraille d’icelle. L’un desquels est
droict, & en son entier : l’autre couché, & rompu, la poincte fichée en terre : celuy qui est droict, est entaillé
de characteres Egyptiens, que nous appelons lettres Hieroglyfiques : & peut avoir environ cinquante pieds
de hauteur, à se reigler selon son diametre, qui est de cinq pieds. Et celuy qui est couché, en a soixante
douze, comme il se peut aussi cognoistre par sa faciade, qui estoit de huicts pieds, qui seroit dix fois autant,
ou neuf au moins. Ils sont de pierre Thebaïque, meslée de petits grains noirs, blancs & rouges. Ce qui a
donné occasion à plusieurs, voyans une pierre massive toute d’une pièce si grande, longue & grosse, & tant
bien polie, qu’elles ont esté jettées, & qu’elles sont mixtionnées. Car tous obélisques sont d’une mesme
pierre, gravez de divers grains. Un Architecte nous dict en sçavoir l’invention : mais si confessa il en fin,
qu’ils avoyent ainsi esté taillez au roc.
Se voient encores hors la ville, près de la porte, une tres-belle colonne à la Corinthe, appellée vulgairement
la Colonne de Pompée, à cause de Cesar, qui la fit dresser en mémoire de la victoire qu’il eut contre
Pompée, sur laquelle fut mise une statue, que les Égyptiens adoroyent : ceste colonne est admirable en
hauteur & grosseur, pour estre toute d’une pièce, de mesme pierre que les Obelisques : & tient on, qu’il ne
s’en soit jamais veuë de telle. Elle a sept pieds de diamètre, qui revient à soixante pieds de haut, & plus ; &
grosse, qu’à peine six hommes la peuvent embrasser.
Dans la ville l’on voit encores la prison de Saincte Catherine, que l’on y feist mourir, & son corps porté par
les Anges sur le mont Sinai, & une pierre au millieu d’une ruë, dont les Mores font cas, sur laquelle on dit,
que S. Marc eut la teste tranchée. Les Chrestiens l’ont voulu chèrement achepter : mais les Mores ne la
veulent donner pour rien au monde. L’église, où il fut enterré, y est aussi. Toutesfois son corps a despuis
esté transporté à Venise, que les Venitiens tiennent pour leur patron, & protecteur : hors la ville y a encores
un lieu, où l’on tient, que S. Athanase Evesque dudict Alexandrie, fit le Symbole, Quicunque vuit salvus
esse. Outre ce ceste ville est fameuse, tant pour les lettres, qui y ont autresfois flory, que pour la tour de
Pharo, qui servoit de fanal aux navigeans, mise aux sept merveilles du monde, pour sa hauteur & grosseur,
au lieu de laquelle y a aujourd’huy un champ, qui est encores appellé Farion, ou Farzion de ce nom de
Pharo, qui est, comme dict est, à l’entrée du port. D’avantage pour la statue de Serapis, qui estoit soustenue
en l’air, par ce qu’estant de fer elle estoit attirée par l’aymant. Et pour le grand amas de livres, & belle
bibliothèque, que les Ptolémées Roys d’Egypte y firent assembler, contenant jusques à sept cens mil
volumes, lesquels despuis furent tous bruslés à la première guerre Alexandrine : firent encores traduire la
bible d’Hebrieu en Grec, par soixante douze interpretes. Ce fut aussi là où Cleopatra Royne d’Egypte alla
recevoir Marc Antoine, avec des vaisseaux à voiles d’or, & rames, qui sonnoyent la musique.
Apres que nous eusmes veu tout ce qui était digne de veoir, il y avoit un Anglois de nostre compagnie, qui
avoit la practique de l’astrolabe, & parce moyen remarquoit en quelle eslevation du pole la plus part des
villes sont, quelle longitude, & latitude elles ont. Lequel ayant regardé sur Alexandrie, il trouva qu’elle avoit
environ soixante degrez, & trente minutes, & trente un degrez de latitude, en eslévation du pole Articque. »
- 299 - 301 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
NICOLAS CHRISTOPH RADZIVIL (du 19 septembre au 9 octobre 1583)
Radzivil, N. C., « Nicolas Christoph Radzivil », dans S. Feyerabend (éd.), Reyszbuch desz heyligen Lands,
Francfort-sur-le-Main, 1584.
Nicolas Christoph Radzivil, duc d’Olica et de Nieswitz (1549-1616), est issu d’une famille illustre de Pologne.
Son père, chancelier de Lituanie, l’envoie en Allemagne alors qu’il n’a que quatorze ans. Lorsque la guerre
éclate avec la Moscovie, il participe à la campagne de 1578. Se sentant atteint d’une maladie grave que
toute la science des médecins ne peut guérir, il fait voeu de visiter Jérusalem s’il recouvre la santé. En 1583,
il s’embarque à Venise pour accomplir le pèlerinage. En 1587, il devient maréchal à la cour. Cette relation de
voyage en Terre sainte est écrite sous la forme de quatre lettres.391
p. 188-208 :
TROISIEME LETTRE
« Le soir nous arrivâmes à Foua, cette belle ville située au bord du Nil n’est cependant pas très grande. Les
tours des mosquées étaient illuminées par des lampes en raison du futur jeûne. Cette ville est surtout
renommée pour ses grenades qui partout ailleurs ne sont pas aussi grosses, comme j’ai pu le constater par
moi-même.
Cette même nuit, après avoir parcouru trois lieues, nous arrivâmes à un canal construit par l’homme. Ce
canal va jusqu’à Alexandrie, on le considère comme le huitième bras du Nil.
Toute la journée du 18 septembre, nous naviguâmes sur ce canal qui passe par de nombreux villages. Ce
dernier mesure trente aunes de large et il est si profond que de grands bateaux peuvent naviguer dessus,
mais lorsque le Nil ne déborde pas, il ne reçoit pas d’eau et se retrouve complètement à sec. Dès que le
fleuve est en crue, l’eau coule dans ce canal jusqu’à Alexandrie pour remplir toutes les citernes ainsi que les
puits. Cette ville ne possède pas de puits d’eau douce, c’est pour cette raison qu’on a creusé un canal
jusqu’à cet endroit. La ville d’Alexandrie, étant très basse et près de la mer, n’a pas une bonne eau.
(p. 189) L’eau qui vient du Nil à cette époque est mise en réserve soigneusement pendant toute l’année
jusqu’à ce que le Nil soit de nouveau en crue. Il y a quantité de citernes dans les rues et dans les maisons.
Si quelques citernes viennent à se vider, beaucoup d’habitants doivent quitter la ville à cause de la pénurie
d’eau.
Lorsque le Pacha Ibrahim, gouverneur d’Égypte, arriva à Alexandrie avec trois cents et quelques galères, il
consomma tant d’eau qu’il vint à en manquer. Bien qu’il eût voulu séjourner plus longtemps, il dut partir le
sixième jour pour Rosette et de là, il regagna le Caire par le Nil. Rosette est à quatre-vingts lieues du Caire ;
c’est à cet endroit que se jette dans la mer le dernier bras du Nil du côté de la Barbarie. Par ce bras, les
bateaux arrivent chargés en direction du Caire. Les très grands bateaux ne peuvent pas passer par le canal
qui va à Alexandrie. Néanmoins les Djermes peuvent naviguer sur les sept bras du Nil au moment où ces
canaux sont profonds. Deux de ces bras, Damiette et Rosette, peuvent recevoir les grands bateaux chargés
car leurs lits sont plus larges et plus profonds. On compte près de dix lieues de Rosette à Alexandrie.
Ce jour-là était la nouvelle lune de septembre. Les trois janissaires ainsi que les vingt mariniers arabes
avaient jeûné toute la journée ; ils guettaient la nouvelle lune et le coucher du soleil. Comme ils ne pouvaient
les apercevoir, ils nous demandèrent de leur signaler le moment où la lune se levait. Nous la vîmes peu
après quand il fit un peu plus noir. Comme c’était le troisième jour, il était difficile de la voir, mais dès que
nous pûmes l’apercevoir, nous la leur montrâmes. Ils nous remercièrent joyeusement, et, les yeux dirigés
vers la lune et les bras ouverts, ils firent la prière selon leurs rites. Peu après, ils mangèrent de la viande, du
poisson et ce qui leur fut présenté. Cela dura toute la nuit jusqu’à l’aube car c’est un péché de manger le
jour mais non pas (p. 190) la nuit. Nous constatâmes à Alexandrie, que les gens riches de haut rang
dorment jusque dans l’après-midi et vont ensuite prier à la mosquée. Un grand drapeau est alors hissé sur la
tour (à Alexandrie, il était de couleur mauve) pendant seulement un quart d’heure ; on le rabaisse dès que la
prière est finie puis chacun rentre chez soi pour déjeuner après le coucher du soleil. Des Chrétiens résidant
au Caire nous ont racontés qu’au moment où l’heure du repas approche, c’est à dire un peu avant le
coucher du soleil, certaines personnes sont chargées de parcourir la ville avec des cymbales et de crier qu’il
est permis de manger, de boire et de faire d’autres choses inconvenantes. Mais je n’entendis rien de tel à
Alexandrie.
Après avoir parcouru quatre lieues entre les murs en ruine, les vieux palais et les dattiers qui bordent le
fleuve, tôt le matin du 19 septembre, nous arrivâmes aux portes de la ville d’Alexandrie situées à un quart de
lieue de la ville par voie terrestre ; cette ville s’appelait Racasta avant l’époque d’Alexandre le Grand. Là,
j’annonçai mon arrivée aux personnes que j’avais connues au Caire et lorsqu’ils arrivèrent, nous montâmes
sur les ânes et nous partîmes en direction de la ville.
Non loin des portes de la ville, on aperçoit, sur une hauteur à gauche, la colonne Pompée qui est très belle
et somptueuse. Le socle sur lequel elle repose mesure seize aunes de hauteur, il est de forme carrée et
mesure neuf aunes de côté. La colonne en pierre est ronde et mesure soixante aunes de haut et quatre
toises de circonférence. Le chapiteau et la plaque carrée situés au sommet ont une hauteur de dix aunes. La
totalité de la colonne mesure donc quatre-vingt-six aunes. Le marbre est cendré et un peu rougeâtre sur la
colonne de sorte que le socle et le sommet semblent être de deux marbres différents. On se demande
comment un bloc si lourd et si haut a pu être monté et dressé sur cette colline. Je ne sais pas en quel
honneur cette colonne fut érigée par Jules César et pourquoi elle fut appelée colonne Pompée ; les
historiens en parlent, donc je n’insisterai pas.
(p. 191) Aux portes de la ville, les Turcs nous fouillèrent pour voir si nous n’avions pas de marchandises
avec nous. Un interprète nous accompagnait, c’était un Juif employé par le consul vénitien, il leur expliqua
que nos affaires étaient sur le bateau et qu’on nous les apporterait sur des ânes. Ce Juif resta donc avec
mes serviteurs jusqu’à ce que les problèmes de douane fussent réglés. À Alexandrie, les droits de douane
sont perçus non seulement sur les marchandises mais aussi sur les moindres choses et sur l’argent. Je me
rendis au carvaseria, ou hôtellerie des Vénitiens, pour m’y installer.
Après le repas, j’allai visiter le port avec Hieronymo Vitali, un marchand vénitien que je connaissais bien. Ce
marchand, qui avait fait la connaissance du capitaine turc arrivé de Rhodes avec dix galères, peu de temps
avant moi, voulait se concerter avec ce dernier. Je lui demandai donc de l’accompagner sur la galère de ce
capitaine qui était considéré comme étant le plus important après Occhialo. Je voulus voir comment la galère
était équipée en hommes de guerre et en canons. En principe, personne ne peut y monter sauf les
marchands ; les Turcs y veillent soigneusement. Nous prîmes donc un petit bateau et nous allâmes
jusqu’aux galères. Le capitaine n’était pas là, il était en ville. Nous attendîmes son retour pendant plus d’une
demi-heure. La galère, entièrement dorée, était belle, mais comme toutes les galères turques, elle était un
peu plus petite que celles des Chrétiens. Les rameurs étaient tous Chrétiens, ils étaient cinq par rame
jusqu’au mât central du bateau et ensuite seulement quatre par rame. Il n’y avait que quarante hommes de
guerre, mais il y avait un grand nombre de canons. Lorsque le capitaine revint, il demanda au marchand de
lui rapporter d’Europe plusieurs sortes d’étoffes de couleur dont cinq de chaque. Ensuite il ordonna de nous
offrir du raisin de l’île de Rhodes. Les grappes mesuraient trois quarts d’aune de long et chaque grain était
aussi gros qu’une prune de chez nous. Nous prîmes congé et nous retournâmes à terre à bord de notre
embarcation. De là, nous regagnâmes la ville le soir.
Parmi toutes les merveilles qui existent encore à Alexandrie, il faut citer la très grande place agréable qui se
trouve en face du port. Les historiens affirment (p. 192) que cette place est artificielle (jadis, on l’appelait l’île
de Pharos) ; il n’est donc pas nécessaire que j’en parle davantage mais il semble bien qu’elle fut construite
ingénieusement et à grands frais. Comme on le verra plus tard, l’air de la ville n’est pas très sain, ainsi les
habitants préfèrent construire leurs maisons sur cette place ; le sandjak lui-même y réside. La ville est par ce
fait déserte et tombe en ruine de jour en jour, il est plus sûr d’habiter les faubourgs.
Pourquoi les galères étaient là ? elles transportaient les trois hommes de confiance du Pacha Hassan (qui
fut auparavant Pacha suprême et gouverneur du Caire) : son chancelier, son secrétaire et son notaire. Ces
derniers avaient été envoyés de Constantinople à Rhodes, et de là, à Alexandrie pour ensuite être emmenés
par bateau au Caire où ils seraient jugés car ils avaient été les instigateurs de la tyrannie cruelle avec
laquelle le dit Pacha tourmenta le pays et le saigna à blanc. Il est intéressant de raconter brièvement
comment cela se passa. Le Pacha Hassan était un eunuque qui avait séjourné au Caire et avait pillé les
marchands d’une telle façon qu’aujourd’hui encore, suite à sa cupidité insatiable, les marchandises des
Indes et de La Mecque n’arrivent plus dans le pays. Comme il ne voulait pas être déplacé de cet endroit si
propice à sa cupidité, il envoyait secrètement de généreux cadeaux à la mère de l’empereur Amurathi
[Mourad III] et à son épouse. En raison de l’éloignement et des difficultés d’approcher l’empereur, ce que le
Pacha empêchait soigneusement, les personnes qui étaient opprimées injustement ne pouvaient donc se
plaindre à l’empereur des injustices qui leur étaient infligées.
Ainsi, lorsque le Pacha apprit que le Maure qui entretenait le baume possédait une assez grande somme
d’argent, il le fit jeter en prison. Pour savoir où était l’argent, il le fit torturer de telle façon qu’il en mourut peu
après. Comme personne ne savait comment on fabriquait ce baume, cette huile précieuse disparut
complètement après sa mort comme il vient d’être mentionné. Il y avait également un riche marchand
éthiopien que je vis ; (p. 193) le Pacha l’accusa faussement et le jeta en prison où il fut torturé de telle façon
qu’il dut racheter sa vie avec ses biens valant deux fois cent mille couronnes. Il paraît incroyable qu’il ait pû
payer une si forte amende, surtout après l’avoir vu marcher pieds nus et portant sur lui seulement un turban
et une chemise de soie. Toutefois, il est possible qu’il ait payé au Pacha une telle amende. Au Caire, il
possède un très beau palais que j’ai vu et dont la valeur et la splendeur peuvent être comparées avec les
plus grands édifices que j’ai décrits et visités. Ce marchand se plaignit de son infortune, on lui conseilla
d’aller à Constantinople et de dénoncer une si grande injustice auprès du souverain. Ce projet ne plaisait
guère au marchand, d’une part à cause du long voyage et d’autre part à cause du danger. Finalement, il
déclara que s’il n’allait pas à Constantinople, il était prêt à donner le restant de ses biens pour que le Pacha
Hassan fût châtié de son vivant. Son conseiller lui répondit qu’il devait d’abord lui verser de l’argent et ainsi il
pourrait satisfaire son désir d’ici peu. On raconte que le marchand envoya soixante-dix mille sequins à
Constantinople dont cinquante mille servirent à acheter des pierres précieuses pour en faire hommage au
souverain. Il offrit au vizir vingt mille sequins, ce qui attira ses bonnes grâces. Il lui déclara qu’il avait non
seulement un somptueux cadeau pour le souverain mais aussi qu’il pouvait lui montrer comment obtenir un
grand trésor. Lorsque l’empereur le fit comparaître devant lui, le marchand lui remit les pierres précieuses
parmi lesquelles se trouvait un diamant de 18 000 couronnes que j’avais vues à Venise en 1580 chez ce
marchand qui l’envoya l’année suivante à Constantinople. Ce diamant avait été acheté là pour le souverain.
Ensuite, il lui présenta ses doléances contre le Pacha Hassan et lui expliqua en détail comment le Pacha
Hassan dépouillait depuis longtemps ceux qui avaient quelque richesse et avait amassé beaucoup d’argent.
Le souverain pourrait donc à la fois venger les iniquités commises, arrêter le voleur et mettre l’argent dans
son trésor.
Cela plut au souverain qui confia au Pacha Ibrahim le gouvernement du Caire (p. 194) et lui promit sa fille en
mariage. Il lui donna une lettre à remettre au Pacha Hassan dans laquelle il ordonnait à celui-ci d’envoyer sa
propre tête au souverain dès qu’Ibrahim arriverait au Caire. L’empereur des Turcs a coutume d’écrire de
telles lettres de sa propre main et de les mettre dans une enveloppe de velours ou de soie de couleur noire.
Ibrahim se mit sur le champ en chemin pour aller porter les ordres impériaux. Entre temps, la mère de
l’empereur et son épouse furent interrogées ; ceci eut pour conséquence le départ d’Ibrahim pour
Alexandrie. Les choses tournaient mal pour le Pacha Hassan que ces dernières protégèrent si longtemps ;
elles lui firent savoir aussitôt par courrier le motif de l’arrivée d’Ibrahim à Alexandrie et l’exhortèrent de ne
pas l’attendre mais de partir immédiatement pour Constantinople avec ses trésors quand Ibrahim arriverait à
Alexandrie. De leur côté, elles s’efforceraient d’apaiser la colère du souverain.
Donc avant l’arrivée à Alexandrie d’Ibrahim avec ses trente-six galères, Hassan, ainsi averti, se prépara à
partir avec deux mille hommes. Ibrahim l’apprit avant qu’Hassan n’arrive au Caire ; il pensait que le Pacha
Hassan ne connaissait pas la cause de son arrivée et lui fit savoir par écrit qu’il devait l’attendre car il devait
s’entretenir avec lui de choses importantes de la part de l’empereur. Hassan ne resta pas inactif et s’enfuit
avec les siens. Ibrahim ne put arriver au Caire que le quatorzième jour après le départ d’Hassan. Ibrahim
écrivit d’Alexandrie à Constantinople qu’Hassan avait pris la fuite.
Entre temps, la mère du souverain et l’impératrice s’efforçaient d’obtenir la grâce d’Hassan. Elles réussirent
dans une certaine mesure. Hassan aurait dû verser à l’empereur le trésor estimé à trois millions et demi et
s’en remettre entièrement à sa mansuétude. Cependant, il fut jeté dans une prison du château et fut étranglé
secrètement quelques jours après. Il paya ainsi sa cupidité par un châtiment bien mérité. Par ailleurs, on
ordonna de ramener au Caire ses hommes de confiance mentionnés ci-dessus afin que leur mort fût un
spectacle agréable pour le peuple.
Dans cette ville, je vis un obélisque, il s’agit d’une colonne carrée et pointue, faite entièrement de marbre
rouge et décorée de hiéroglyphes qui y sont gravés. Cet obélisque est très grand et très beau ; bien que la
partie inférieure soit dans la terre, sa hauteur est encore de quarante aunes et il a six aunes de côté.
Non loin de là, vers la mer, on voit encore les traces d’un palais magnifique qui fut construit à grands frais il y
a longtemps. Les murs sont tous recouverts de plaques de marbre et les colonnes sont en marbre
également. Au-dessus de celui-ci, il y avait un autre palais, mais il fut rasé entièrement ; bien qu’il soit
recouvert d’éboulis, on peut encore en reconnaître la forme. Au pied des murs, se trouve une tour ronde où
s’alignent de magnifiques maisons de marbre dont quelques-unes sont très grandes et de très belles
constructions. Certains soutiennent que Cléopâtre qui se suicida y habita.
Le 21 septembre, je montai sur deux collines qui se trouvent dans la ville. Sur l’une d’elles se dresse la tour
de guet qui n’est pas très haute et sur laquelle sont accrochés autant de fanions qu’il y a de bateaux dans le
port. La seconde colline, située vers Rosette, est un peu plus haute ; de son sommet on peut voir la ville qui
s’étend jusqu’aux murs d’enceinte. En bas, il y a beaucoup d’anciens palais en ruine et l’on trouve encore
beaucoup de plaques de marbre.
Ce jour-là et bien souvent par la suite, je vis dans la rue principale, la prison où sainte Catherine fut
enfermée. C’est un caveau petit et bas ; non loin de là se dressent deux colonnes hautes et épaisses, faites
entièrement de marbre rouge, et, entre lesquelles cette sainte vierge reçut la couronne du martyre.
Au milieu de cette même rue, dans la direction de Rosette, se trouve une pierre carrée sur laquelle on dit
que fut décapité saint Marc l’Évangéliste, évêque d’Alexandrie. Cet endroit est même vénéré par les Turcs ;
cette pierre est recouverte soigneusement d’une autre pierre large afin que personne ne pose les pieds sur
cet emplacement sacré qu’ils considèrent comme le lieu authentique du martyre de ce saint.
Le 22 septembre, je visitai l’église Saint-Marc située non loin de (p. 196) l’Obélisque ; cette église appartient
aux Coptes ou Chaldéens. En se dirigeant vers le plus grand autel, il y a à droite une voûte très étroite sous
un autre autel ; c’est à cet endroit que reposa le corps de saint Marc après son martyre jusqu’à ce qu’il fût
enlevé secrètement par les Vénitiens (ceci affecte profondément les Coptes et leur fait honte) et fut emporté
à Venise ; toute une histoire fut écrite à ce sujet, donc je m’en dispenserai.
Le 25 septembre, le sandjak d’Alexandrie revint du Caire où le Pacha Ibrahim l’avait appelé. Il était
accompagné de vingt cavaliers et d’autant de janissaires à pied.
Les autres jours, nous visitâmes la ville qui, autrefois, dut être parée de nombreux bâtiments splendides,
comme on peut le constater en observant les constructions imposantes en ruine qui se trouvent sur et sous
la terre. À présent, tout est dévasté et rasé. Selon moi à peine un cinquième de la ville est habitée, et cela
seulement de temps en temps. Par ailleurs, il y a ici un grand et bel établissement de bains qui fut construit à
grands frais par l’empereur Soliman ; nous y prîmes quelques fois notre bain.
À observer ces palais qui étaient construits sous terre, il est facile de conclure qu’il y a longtemps, une autre
ville avait été bâtie sous terre ; c’est là que les gens habitaient pour fuir la chaleur, et en hiver, ils
emménageaient dans les maisons d’en haut. Ces anciennes constructions souterraines ont été transformées
à présent en citernes dans lesquelles l’eau qui arrive du Nil dans la ville par le canal est mise en réserve.
Certaines citernes sont publiques et d’autres sont dans des maisons privées ; ces dernières appartiennent à
leurs habitants qui y puisent l’eau toute l’année pour leurs besoins quotidiens. Si l’eau vint à manquer,
comme on l’a déjà cité, il faut aller la chercher à Rosette, par la mer, à neuf lieues de là.
À partir du mois de mai et jusqu’aux premières pluies d’automne, l’air d’Alexandrie est malsain et presque
empoisonné (il peut pleuvoir, une averse tomba le 27 septembre lorsque je m’y trouvai). Les bourgeois de
haut rang et les marchands quittent la ville à cette époque pour aller dans les faubourgs ou au bord de la
mer. Ceux qui restent dans la ville sont toujours pâles et ont l’air malades. Certains (p. 197) attribuent cet air
malsain aux maisons souterraines en ruine et humides qui attire les serpents et beaucoup de vermine. Ainsi,
l’humidité, la puanteur et le poison (en Égypte, il y a beaucoup d’insectes venimeux) infectent l’air.
D’autres imputent ces désagréments au lac Maréotis ou Araepot qui est situé à une lieue et demie de la ville.
Le Nil y déverse toutes les immondices des champs d’Alexandrie et en outre il contient des vers venimeux.
Le vent du sud (les Italiens l’appellent Caurum ou Maestrum) amène pendant tout l’été l’air empoisonné
dans la ville jusqu’à ce qu’arrivent les pluies qui chassent les vapeurs nuisibles avec des vents plus sains.
Ceux qui écrivent sur Alexandrie mentionnent également le lac Maréotis. Mais quelle qu’en soit la cause, il
est certain que l’air y est malsain, surtout la nuit ; c’est pourquoi les fenêtres ont des contrevents qui sont
bien fermés afin que l’air malsain ne pénètre pas dans les appartements auquel cas les risques de maladies
sont si grands que je le ressentis moi-même plusieurs fois. Dès qu’on sort la nuit pendant quelque temps, on
ressent des maux de tête et une faiblesse dans tout le corps. De même, les habitants du pays se couvrent
surtout la tête soigneusement pour éviter l’air nocturne.
Il faut signaler un fait qui montre l’aveuglement des païens. Selon les prédictions des Turcs (ils s’adonnent à
la magie noire et à la superstition), la Terre Sainte tomberait aux mains des Chrétiens un vendredi au
moment où ils prient à la mosquée. À Damas, on monte précautionneusement la garde à l’endroit où
commence la Terre juive, et la ville est fermée une heure plus tôt que d’habitude. Aucun chrétien ne peut
entrer dans le château Jérosimilitain ; il n’est même pas recommandé de le regarder de loin. Leurs
prédictions insensées affirment que les Chrétiens passeront par Alexandrie pour partir en guerre en Terre
Sainte. (p. 198) Le plus petit bateau chrétien ne peut entrer dans le vieux port (on a dit et les historiens en
témoignent que ce dernier avait été séparé du nouveau au moyen de terrassement par Antoine), car ils
pensent que les Chrétiens attaqueront à cet endroit malgré les rochers et les écueils. Le vendredi, vers midi,
au moment de se rendre à la mosquée, ils ferment à clé de l’extérieur les carvaseras, ou hôtelleries des
Chrétiens (les Vénitiens en ont deux, les Français également, ainsi que les Génois, les Ragusains et
d’autres nations européennes). Des gens chargés spécialement à cette tâche nous enferment le vendredi
pendant une demi-heure car leurs dévotions superstitieuses ne durent pas plus longtemps. Aussi, les
Chrétiens ne se promènent pas beaucoup en ville à ce moment-là ; chacun s’arrange pour être chez soi
pour ne pas être suspecté, ce qui est très dangereux. La nuit, ces hôtelleries sont également fermées par les
Turcs afin que les Chrétiens ne puissent être soupçonnés de fomenter quelque chose, auquel cas, ils
prendraient soin de les punir. Des gardiens Turcs sont également présents dans les hôtelleries et ils veillent
à ce que les Chrétiens ne s’avisent pas à faire quelque chose. Les Chrétiens ne peuvent donc être accusés
à tort. Cette règle est d’usage à Alexandrie afin d’assurer plus de sécurité à ceux qui font du commerce.
Cette ville a été abondamment décrite par d’autres comme la cité orientale la plus magnifique, donc, je ne
m’étendrais pas plus longtemps. J’ajouterai seulement que l’on trouve ici une foule de gens de tous les pays
chrétiens et toutes sortes de bateaux. Lorsque j’y étais, il y avait 15 gros navires, appelés galions, de mille
cinq cents tonneaux chacun. Un tel navire, transportant cent mille sequins, avait été capturé non loin
d’Alexandrie par deux galères maltaises. Un autre galion put échapper à deux de ces galères grâce à un
vent favorable, mais leur tire les avait endommagées. Quatre galères maltaises avaient donc attaqué deux
galions. Deux fois en été, une telle flottille, comportant quelques fois vingt galions, arrive à Alexandrie en
provenance de Constantinople. Ces galions transportent peu de marchandises mais beaucoup d’argent avec
lequel ils achètent de grandes quantités de riz, de sucre, de céréales, (p. 199) de dattes et d’autres
marchandises apportées de La Mecque et de l’Arabie Heureuse au Caire. Bien que Constantinople soit
située dans une région fertile, elle fait venir une grande partie de ces produits d’alimentation d’Égypte. Ces
galions partent la première fois en mars de Constantinople et y retournent en juin. La seconde fois, les
galions prennent la mer en août et rentrent chez eux à la fin octobre. Quand ils se dirigent, soit vers
Alexandrie, soit vers Constantinople, ils choisissent toujours l’époque où ils pourront accoster en premier à
Rhodes avec un vent favorable. De là, selon les circonstances, ils prennent le cours voulu et naviguent avec
une grande rapidité. Pour plus de sécurité, ils sont escortés par 26 galères turques qui sillonnent l’archipel.
Lorsque j’étais à Alexandrie, on attendait tous les jours l’arrivée du général Occhiali avec ses galères car
c’était l’époque où les galions devaient prendre la mer. Il leur tardait de partir car ils craignaient les tempêtes
que plusieurs signes faisaient prévoir et que nous éprouvâmes au cours de notre traversée comme il sera
raconté plus tard. Les deux galions cités ci-dessus, dont l’un tomba entre les mains des Maltais, naviguaient
séparément de ceux qui furent escortés par les galères ; ils étaient partis plus lentement de Rhodes et se
fiaient à leurs nombreux canons. S’ils avaient eu un vent favorable, ils n’auraient pas eu à se soucier des
Maltais, mais dès qu’un bateau de marchandises n’a pas un bon vent, malgré son puissant armement, il ne
peut pas résister à trois ou à quatre adversaires. Toutefois, l’un des deux galions réussit à s’échapper grâce
au vent. Quatre jours avant mon départ, trois cents Djermes arrivèrent en même temps, elles transportaient
des céréales qui furent chargées à bord des galions ancrés dans le port.
Il faut mentionner également que le port d’Alexandrie est un port franc (aujourd’hui, les Turcs maintiennent
encore ce privilège mais pas entièrement) ; les bateaux amis ou ennemis sont libres de sortir comme ils le
veulent. Toutefois, les bateaux espagnols ne s’y fient pas et leurs bateaux ne viennent pas ici. Néanmoins,
les bateaux florentins viennent souvent dans le port où ils sont en sécurité, excepté une fois où plusieurs
navires se trouvaient en pleine mer à une vingtaine de lieues ; les galères turques partirent à leur rencontre
et en capturèrent un, les deux ou trois autres s’échappèrent. Suite à cet incident, les Turcs les humilièrent
car les galères florentines de Sainte Etienne (p. 200) ne leur cause pas le moindre dommage quand elles
font une sortie en mer comme il en fut récemment avant mon arrivée à Chypre et rapporté ci-dessus. Cette
sortie ressemble à ce que font quelquefois nos cosaques sur le champ de bataille, dans le cas où cela se
passe bien, tant mieux, sinon ils ne se soucient pas beaucoup des dommages
Le port d’Alexandrie est large et ouvert si bien qu’en hiver il est dangereux d’y rester. Ainsi, les bateaux turcs
et les galions, décrits ci-dessus, jettent l’ancre près du grand château situé à droite de l’entrée du port où il y
a de gros rochers dans la mer qui arrêtent le vent. À l’un des angles, il y en a un assez haut appelé
Gariophyl à cause de son sommet fendu ; les bateaux poussés par le vent le heurtent souvent. Quant à
l’autre château, situé à gauche de l’entrée du port, l’accès n’en n’est pas sûr à cause des rochers. Au milieu
du port, il y a également des récifs où les bateaux viennent souvent se fracasser. Lorsque le ciel est clair et
que la mer est calme, on peut les apercevoir facilement à partir d’un endroit élevé. Les châteaux sont si
éloignés l’un de l’autre que les bateaux se trouvant au milieu peuvent être touchés par un boulet de canon
de campagne tiré par l’un ou l’autre ; ceci donne facilement une idée de la largeur de l’entrée du port. Le
château de droite, assez grand, est fortifié, celui de gauche, qui est plus petit, n’est pas entouré de
nombreux récifs et n’a pas d’autres fortifications. Dans le vieux port où les chrétiens n’ont pas le droit
d’entrer, il y a deux petites forteresses, l’une du côté de la ville et l’autre de la mer, non loin de l’arsenal situé
dans ce port. Les galères sont stationnées ici. À cette époque, il y en avait quatre seulement qui gardaient le
port d’Alexandrie ; elles n’étaient pas des mieux équipées comme nous en vîmes souvent.
(Janissaire suisse au Caire, rachat de deux Chrétiens et de deux jeunes italiens)
(p. 202) La veille de mon départ d’Alexandrie, un Italien, Johann, vint me voir en compagnie de deux autres
personnes qui étaient au service des marchands. Il parlait assez bien l’Espagnol ; il tomba à mes pieds et
me demanda instamment de le racheter aux Turcs. Il était sur l’une des galères préposée à la garde du
port ; il avait des fers aux pieds comme en portent les prisonniers. Il me raconta sa misère et m’exposa son
désir d’être racheté. Il était barbier et expert en médecine ; il me promit de me servir fidèlement et d’être mon
valet jusqu’à la fin de sa vie si seulement il pouvait échapper au joug turc et surtout aux galères. Ses
connaissances en médecine ne m’intéressaient pas et j’avais déjà un bon barbier, un Italien, nommé Antonio
de Gênes, qui (p. 203) remplaçait celui qui était mort. Il n’était pas prudent non plus de confier sa santé à un
étranger ; toutefois, je m’apitoyai sur sa misère et je le rachetai. Je le chargeai de soigner des léopards et
des bouquetins ainsi que d’autres animaux et oiseaux exotiques que j’avais achetés. Il se conduisit bien en
mer par la force des choses, mais une fois que nous arrivâmes en Crète pour y séjourner quinze jours, il
vola différentes choses et prit la fuite. Mes serviteurs ne s’en aperçurent qu’au bout de quatre jours car
certaines de leurs affaires venaient à manquer. Nous finîmes également par s’en rendre compte, moi et
quatre personnes qui logions au palais ducal ; les autres logeaient chez les moines aux pieds nus [?], au
monastère de Saint-François. Contre mon gré (cela me suffisait de l’avoir racheté aux Turcs pour le ramener
chez les Chrétiens), on se mit à sa recherche et on le retrouva sur l’autre versant du Mont Ida, vers la
Barbarie, chose surprenante car de là, il ne put aller plus loin. On ne put savoir ce qu’il eut en tête. Les
personnes qui le rattrapèrent voulurent le juger. Mais je ne le sauvai pas de la mort et des galères pour qu’il
y retournât. J’eus pitié pour deux raisons : la mort d’un homme et le fait de voir pendu celui que je rachetai
pour cent florins d’or. Lorsqu’il restitua les affaires volées à mes serviteurs (il avait dépensé une partie de
l’argent) et qu’il voulut me servir à nouveau, je le renvoyai. Il s’embarqua sur un galion en partance pour
l’Italie et put ainsi s’échapper. Je n’entendis plus parler de lui et je ne sais pas ce qu’il devint.
Un marchand vénitien qui habita longtemps au Caire affirma que les esclaves rachetés tournaient rarement
bien. Quand il était au Caire, il sut que sur deux mille esclaves qui furent rachetés, seulement une
cinquantaine réussirent ; les autres volèrent, assassinèrent, pillèrent, et finirent par être exécutés, ainsi, ils
reçurent leur dû. Quelques-uns d’entre eux, chose épouvantable à (p. 204) entendre, auraient même adopté
la religion turque après avoir été libérés. Cela est très vraisemblable car ils n’arrivaient pas à se nourrir et
n’avaient pas la possibilité de regagner l’Europe. Ils cherchaient à éviter ce malheur afin de ne pas retomber
en esclavage après avoir regagné leur liberté. Ce marchand donna d’autres raisons [de cette conversion] qui
ne furent pas très catholiques. Celui que Dieu, dit-il, laisse tomber en esclavage peut s’abstenir de pêcher
plus facilement. Mais on ne peut le justifier car le Christ, Notre Seigneur, nous offre autre chose pour la
libération des prisonniers.
À Alexandrie, on trouve toutes sortes d’animaux, j’en achetai quelques-uns pour les amener en Europe. Les
voici : deux léopards, deux chats appelés pharaons tels qu’on en voit souvent dans les maisons à Alexandrie
et à la campagne, surtout en Syrie, une civette donnant le musc que je fis acheter à Apamée lors de mon
séjour à Tripoli, deux cynocéphales, un mâle et une femelle au pelage rougeâtre, différent des autres ; la
femelle mordait toujours quand elle voyait un enfant ou une femme mais elle ne faisait rien aux hommes qui
étaient assez grands. J’achetai aussi dix jeunes singes de différentes sortes, mais ils tombèrent presque
tous à l’eau près de l’île Carpathos où le vent nous secoua avec violence. J’emmenai également de très
beaux perroquets, trois bouquetins dont deux se noyèrent en mer ; cet animal est très agile et bien qu’il ait
de très fines pattes, il sait si bien s’en servir sur les rochers que ceux qui le voient s’en étonnent.
À Alexandrie, il y a également beaucoup d’oiseaux qui ressemblent à ceux que nous appelons Parduen. Ils
ne savent pas voler, mais ils courent si vite que les chiens ne peuvent les rattraper sauf si des filets leur sont
tendus. Ils ne mangent que des petits cailloux qu’ils trouvent dans le sable. Cet oiseau, qui est très gras et
très agréable, est dangereux à manger quand il est frais ; celui qui en mange trop meurt. Cet oiseau se
nourrit seulement de cailloux, ainsi celui qui en mange devient (p. 205) hydropique et cause lui-même sa
mort prématurée. Dès qu’ils sont plumés, on les met dans le sel pendant une nuit, ensuite on les rôtit et on
les fait mariner dans le vinaigre ; préparés ainsi, ils ont bon goût et sont comestibles. Il en est de même pour
d’autres petits oiseaux qui ressemblent à nos tarins ; ils volent et sont gras. On en trouve beaucoup à
Chypre, mais il faut les faire mariner dans le vinaigre. Certains voyageurs qui sont allés en Arabie Heureuse
affirment que l’on y trouve aussi des Parduen ; d’autres croient qu’il s’agit des cailles qui furent envoyées du
ciel aux Juifs dans le désert.
Près du mont Horeb, dans la région du Sinaï, pousse la manne comme en Calabre, mais elle n’est pas aussi
blanche, elle est plutôt rougeâtre. J’en vis aussi au Caire qui servait de purge ; d’autres affirment que les
Juifs la reçurent du ciel, mais aucun des deux ne peut le prouver.
(Autruches dans les déserts de la mer Rouge, aspect d’un dromadaire, les habitants des déserts d’Arabie)
(p. 207) À Alexandrie, je vis aussi un dromadaire sur lequel était assis un Arabe qui venait de Rosette. Cet
animal court aussi vite qu’un palefroi et peut servir à effectuer des voyages rapides ; on peut lui mettre une
selle car il n’a qu’une bosse et non deux comme les autres chameaux qui portent des fardeaux.
Les autres jours de septembre, je visitai ce qui était à voir en dehors de la ville et sur le port. Nous ne
pouvions pas partir plus tôt car le sandjak exigeait une grosse somme d’argent pour les quatre bateaux qui
voulaient partir en même temps. Les marchands finirent par convenir avec lui d’un montant assez élevé,
mais comme les vents nous étaient contraire, nous ne pûmes lever l’ancre avant le neuvième jour d’octobre.
Le neuf octobre, vers quinze heures, nous embarquâmes (p. 208) sur notre bateau, le Saitia, et, nous
quittâmes le port à seize heures. Le soir, à vingt-trois heures nous aperçûmes le rivage de la Barbarie. »392
- 302 - 307 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACQUES DE VALIMBERT (1584)
Valimbert, J., Voyage de Jacques de Valimbert à Jérusalem écrit en 1584, Besançon, Bibliothèque
municipale, Ms. 1453-f. 46.
Jacques de Valimbert est le fils d’un noble piémontais venu s’établir à Besançon vers 1537 en tant que
maître monnayeur comme le signalent les registres qui, par ailleurs, ne mentionnent pas le nom de notre
voyageur. Jacques de Valimbert a dû naître entre 1556 et 1560. C’est suite à un voeu qu’il effectue un
pèlerinage en Terre sainte où il est fait chevalier du Saint-Sépulcre.393
Non paginé :
« Alexandrie est entre l’Afrique et l’Asie, une grande cité ruinée en dedans, mais dehors belles d’hautes
murailles et grandes portes quarrées, le crental est de fer, et la clé de bois, et il n’y a que trois portes, avec
deux ports, un des galères, l’autre de naves, et deux châteaux pour leur défense, un ruiné et l’autre à demi.
De là, on nous mena au fontigo des francs, le long d’une grande Rue de deux ou trois mille, et, en allant on
nous montre la pierre ou saint Marc eut la tête coupée, qu’ils laissent au milieu de la rue, hors de terre un
demi pié, en forme de colonne. Au fontigo, nous trouvâmes un gentilhomme nommé César de Paulo, qui
nous fit grande caresse, et s’informant de nos qualités et ou nous rendions nous dit, que nous avions pris un
étrange chemin pour Jérusalem, et que pour nous assurer et voir la plus belle ville du monde, qu’il falloit aller
au Grand Cayre, où il nous addresseroit à son oncle, qui nous feroit toute assitance et addresse. Ce faisoit-il
pour sa courtoisie et commodité, car son oncle plaidoit avec un vénitien le consulat des chrétiens, et il ne
pouvoit rencontrer plus braves témoins pour s’autoriser du roi de France ; cependant ce sieur Paulo nous
faisoit bonne chère, nous conduisant partout ou l’on voyait choses dignes, comme en un monastère grec on
voit la pierre sur laquelle sainte Catherine eut la tête tranchée et la chaire en laquelle saint Jean prechoit,
toute rompue. On voit en la ville la prison où fut détenue sainte Catherine, et la maison de son père le roi de
Costes ; auprès d’une forte tour est dressée une grande éguille de pierre avec des figures élevées, en lettres
hiéroglifiques, et aussi bien grosse et longue avec mêmes figures, couchée en terre et rompue. Du côté des
murailles, auprès de la mer, sont de belles citernes de deux trois et quatre étages, faites avec pilliers et
pierre rougeâtre comme porphyre, servant à conserver l’eau du Nil qui entre une fois l’an, écoulant l’eau
pour la rafraîchir quand on coupe le Nil, pource qu’on ne trouve fontaine en toute l’Egypte sauf que celle de
la Mataréa, ou Jésus Christ demeure sept ans ; aussi parce qu’il n’y pleut jamais, et n’y fait serein ni rosée, y
pouvant dormir à l’air surement ; et du déblais qu’on a, refaisant ces citernes, en furent faites deux
montagnes artificielles, l’une presque au milieu de la ville et l’autre au pié de la mer. Dehors de la ville, à un
coup d’arquebuse est la colonne de Pompée, toute d’une pièce, de douze piés de large avec sa proportion,
avec son pié d’estale et chapiteau, laquelle on tient pour la plus grosse colonne et merveille du monde.
Retournant en la ville nous vîmes en une profonde citerne une autre colonne suspendue n’étant soutenue
que du dessus. Il y a aussi, dehors de la ville, un port de pierre par où le Nil s’écoule, où il y a de tous côtés
de beaux jardins, avec cassiers, dattiers, grenadiers, cappriers, limoniers et autres beaux fruits, que les gens
gattent mais ils ne sont pas trop furieux.
Après avoir demeurés sept ou huit jours à Alexandrie, César de Paulo nous accompagna de 4 janisses
arquebusiers sur une germe couverte et tapissée, avec de bons vin, viandes, lettres favorables, nous
addressant à son oncle M. Vante, et vîmes de fort belles villes, passant sur le Nil, tant du côté de l’isle Delta,
que de l’Egypte, où sont gens nuds assemblés comme bêtes criants et urlant de nuit, voyans ou sentans
autres que des leurs, tuans et massacrans, craignans fort l’arquebuse : pource, nos jannisses toute la nuit
tiroient à mébanq pour les épouvanter et faire reculer. »394
393 Gazier, G, « Le pèlerinage d’un bisontin en Égypte et en Terre Sainte en 1584 », Mémoires de la Société
d’Émulation du Doubs décembre, 1932, p. 35-64.
394 Transcription : S. Sauneron (archives Sauneron, Ifao).
- 308 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PEDRO DE ESCOBAR CABEZA DE VACA (1584-1585)
Cabeza de Vaca, P. de E., « Luzero de la Tierra Sancta », dans J. R. Jones (éd.), Viajeros Espanoles a
Tierra Santa (siglos XVI y XVII), Madrid, 1998.
Ce voyageur appartient à l’ordre des Templiers de Jérusalem.
p. 359-360 :
« Je fus retenu treize jours durant dans la ville antique d’Alexandrie, à visiter les restes mémorables que j’ai
pu voir pendant ce court laps de temps. Cette ville a été anciennement fondée par Alexandre le Grand. Son
nom suffit à exprimer sa grandeur que montre bien le grand rempart qui la ceint maintenant, bien qu’elle ne
soit pas peuplée à proportion de sa longueur et largeur.
Elle possède deux ports, l’un s’appelle vieux port, par où les Turcs pensent que la ville sera perdue (cette
prédiction est ancienne). C’est pourquoi ils ont bouché l’entrée spacieuse avec une adresse et un art que les
galères ne peuvent y entrer qu’une à une en faisant des détours par différentes passes (c’est de cette
manière qu’ils arrivent à interdire l’entrée à ceux qui en ignorent le secret). L’autre port est tout ouvert. C’est
là que jettent l’ancre tous les bateaux chrétiens qui s’y présentent.
Il y a là deux châteaux forts, pas très solides. À l’intérieur de la ville il n’y a pas de forteresse.
Il serait injuste que mes vers taisent quelques-uns des saints martyrs de cette grande ville, ainsi que les
lieux où ils ont souffert un terrible supplice. J’ai visité la prison où fut enfermée la bienheureuse Catherine
par le cruel empereur Maxence. Un peu plus loin j’ai vu deux colonnes très hautes qui dominaient toute la
ville, là fut placée la roue armée de lames où l’on attacha la glorieuse vierge pour que tous pussent voir son
martyre. J’ai visité l’église Saint-Saba : là se trouve la colonne où fut coupé la tête de sainte Catherine. Dans
l’église appelée « Egyptiens » (Coptes dans leur langue), j’ai vu la chaire où saint Marc prêchait la parole
divine attirant à Dieu des milliers d’âmes. Son sépulcre reste à l’endroit où les Vénitiens s’emparèrent de son
corps glorieux. Les Maures laissent par mépris la colonne où il fut martyrisée presque tout entière sous terre
dans une rue passante et publique. Venise offrait de l’acheter à prix d’or, mais ces gens perfides n’y
consentirent pas, préférant leur plaisir mauvais à leur profit.
On me conduisit hors de la ville par la porte del Pépé ; à une distance d’un mille j’ai vu la colonne Pompée
qui était placée là en sa mémoire (il est d’ailleurs injuste qu’elle rende hommage à sa mémoire pour
l’éternité). C’est la plus grande de l’univers (p. 360) et c’est l’une des sept merveilles du monde, dit-on. Sa
hauteur est de 100 coudées et sa circonférence est de 20. Elle est d’une seule pièce et je pense qu’aucun
pouvoir humain ne peut la changer de place.
De là je partis pour la ville où je vis les palais de la grande Cléopâtre. Bien que ce bâtiment soit détruit, il
reste encore quelque chose de sa grandeur. A l’entrée, se trouvent deux obélisques qui sont plus grands
que ceux de Saint-Pierre de Rome.
Après avoir vu ces choses et beaucoup d’autres dont je ne parle pas à cause de toutes celles qui
m’attendaient encore, je ne voulus pas retarder le voyage que les marchands m’offraient en compensation
des services rendus grâce à mon adresse. Je pris ici un janissaire courageux qui pouvait me servir
d’interprète et de guide (autrement il m’était impossible de poursuivre une route si longue). Je partis vêtu en
costume français, reniant mon vêtement et mon espagnol car nous avons une réputation extrêmement
épouvantable et personne n’aurait jamais pensé que je puisse visiter seul la Terre Sainte si ce n’est dans le
but d’espionner, auquel cas je n’aurais pas échappé à la prison ou à la mort. Je reniais non seulement mon
nom et mon pays mais quand il était question de ma patrie, je disais beaucoup de mal des Espagnols.
Tous les jours je donnais au janissaire quatre reales et il me servait d’interprète, de guide et de domestique.
Ce qui m’arriva dans la barque pendant le restant du voyage, je le raconterai dans le prochain poème qui
sera le troisième.
(Troisième chant)
Toute entreprise, même facile, renferme quelque difficulté au commencement, mais les choses les plus
difficiles deviennent faciles lorsqu’on les fait volontiers. Donc il n’est pas bien qu’un coeur défaille lorsqu’il
s’agit d’entreprendre des choses difficiles, bien qu’au commencement il y ait mille empêchements : le
courage persévérant et la volonté en viennent à bout. On verra par la suite quels obstacles je rencontrai au
début avant d’arriver au port désiré, et que de fois j’ai vu l’ombre obscure de l’épouvantable et rigoureuse
mort. Dorénavant on saura comme il est facile de faire ce bienheureux voyage si on l’entreprend de bon
coeur.
Par le « Cales » qui vient du grand Nil je suis allée en barque, en deux jours seulement, de la ville
d’Alexandrie, jusqu’à l’endroit où ce fleuve, dont je viens de parler, se détache du Nil. Il sera bon d’en faire
l’éloge lorsque je serai arrivé dans la grande ville du Caire, jusqu’à laquelle il doit bien y avoir cinq cents
milles ; par terre on dit qu’il y en a deux cents, mais c’est un chemin plus dangereux, à cause des déserts et
des Arabes qui y demeurent jour et nuit. »395
395 Traduction : M.-T. Joy (archives Sauneron, Ifao).
- 309 - 310 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHN SANDERSON (du 2 au 19 novembre 1585 et du 28 avril au 7 mai 1587)
Sanderson, J., The travels of John Sanderson in the Levant, 1584-1602, par W. Foster, Londres, 1931.
John Sanderson (1560-1627 ?) est originaire du nord de l’Angleterre. À l’âge de dix-sept ans, il est employé
par Martin Calthorpe comme drapier et marchand à Londres où il reste à son service pendant sept ans. En
1584, il part en voyage à Constantinople dans un but commercial. De cette ville, il se rend à Alexandrie à
deux reprises.396
p. 39-41 :
« Je quittai Constantinople le 9 octobre 1585 sur une galère, avec le Bey d’Alexandrie. Nous fîmes escale à
Gallipoli, Troie, Lemnos, Mitelin, Sio et Samos et d’autres îles de l’Archipel des Arches, avant d’arriver à
Rhodes, cette place forte très étrange et très puissamment armée. Sur les deux rochers qui avaient soutenu
les Colosses (une des sept merveilles) il y a maintenant deux hautes tours de guet. La défense terrestre de
la ville comprenait un double fossé et une triple muraille. De là, après six jours de traversée, les vents nous
étant très favorables nous arrivâmes à Alexandrie d’Égypte le 2 novembre.
Les dangers de la côte.
Cette ville et la terre alentour sont si basses que seule la vue du Phare et le haut des palmiers vous
indiquent sa présence ce qui est très dangereux pour les navires qui viennent y mouiller ; pendant le temps
que j’étais là, (p. 40) plusieurs navires ont sombré y compris une grande caraque vénitienne qui s’appelait le
Bon Gallion. Un autre bateau vénitien passa sur un rocher et en échappa par miracle, ayant dépassé le port
d’Alexandrie.
Il semble que ce banc de rochers s’étend dans la mer un peu au-delà d’Aboukir.
D’Alexandrie au Caire.
Je quittai Alexandrie le 19 et arrivai au Grand Caire le 29, voyageant par chemin de terre pendant une
journée et demie et une nuit jusqu’à Rosette puis par voie d’eau par le Nil dans un bateau tiré, de la berge,
par les haleurs maures. Nous passâmes plusieurs villes et villages. Cette partie du voyage est très
agréable ; seule la chaleur et la peur des brigands qui continuellement vous volent, qui sur la rivière, qui sur
la rive, sont gênantes.
L’approvisionnement d’Alexandrie en eau.
En chemin, on me montra beaucoup de curiosités telles les ruines des anciens conduits de l’eau du Nil vers
la ville d’Alexandrie, car il n’y a ni sources ni provision d’eau douce, hormis celle fournie par le Nil qui dans le
temps était conduite sur 20 à 30 milles pour remplir les citernes souterraines car Alexandrie est bâtie sur
d’admirables piliers de marbre, le sous-sol est entièrement voûté et chaque maison a sa citerne particulière.
Cette eau, qui était précédemment apportée de cette manière, l’est maintenant à dos de chameau, dans des
outres de cuir.
Ils remplissent ces citernes au mois d’août, quand le Nil est en crue, et c’est l’eau qu’ils boivent toute
l’année. Elle reste douce toute l’année bien que stagnante. Vers la fin de l’année, elle est plus lourde qu’au
début, où elle est claire comme le cristal, et moins agréable à boire que pendant (p. 41) les premiers mois.
Donc, chaque mois d’août, ils nettoient les citernes pour les remplir d’eau fraîche.
Arbres du Delta.
Il y a des quantités de différents fruits. J’ai vu des petits figuiers de pas plus d’un pied et demi de haut,
portant des figues mûres. Il y a aussi quelques acacias, des caroubiers, des câpriers, tous ceux-ci surtout
aux alentours du Caire. Le pays entier est plein de dattiers.
Curiosités d’Alexandrie.
À Alexandrie il y a l’église Saint-Marc ; à l’entrée de cette église se trouve l’endroit où saint Marc a prêché. À
l’intérieur et à l’extérieur de la ville, on voit divers piliers de renom. À l’intérieur des murs, il y a les ruines
anciennes d’un château où Cléopâtre mourut d’une piqûre. Il y a aussi les ruines d’une forteresse très haute
appelée le Faros, l’une des sept merveilles. Par le chemin que nous empruntâmes, nous traversâmes à
cheval la plaine où Pharaon planta sa tente. De là l’étendue est extraordinaire, limitée jusqu’à ce jour par
quatre grandes bornes. »397
« The 28th (april) I went to Alexandria, to see what newes the shipp Tiger had brought, who arived then two
dayes before. Backe to our caramisall I retorned the next day. We sett sailed the 7th of May, calmelie
coasting all the Palestine sea, and arived in Tripolie the 13th, beinge satterday. »
p. 137 :
« William Shales and J. S. at Cairo to John Bate at Constantinople ?
30 December 1586
…Since the order for our departure from hence they have sent us from Alepo bales six of silke and one bale
of shar merdany398, importinge the som of d[ucats]s 5212, m[edines] 19, of that mony ; which they required
[us] to imploy in peper, nutt[meg]s, and indigo, and to goe speedilie for Tripolie to meet with the ship ; which
we mynd to do with all speed possible. As yet we have don nothinge, for until yesterday the caravan of
spices from Tore and Zues was not arived. The store is great, at the least 8,000 quintalls of peper, which is
come alredie. The buyers ar fewe ; only at this time a Frenchman which hath to imploye 30,000 d[ucat]s, and
the Venetians have not above as much more to bestowe. Besides, by reason of the plague in Alessandria
ther will (as it is thought) com but fewe shipes this yeare. [So] that all men hope they willbe goodcheap. So
that, findinge to deale reasonnably, we mind to chargd them in Alepo by exchange for 9 or 1000 d[ucat]s
gould, and so to cleare the country. If not, at least the goods shable dispatched at prise as we find, to fulfill
the order geven us. »
396 Sanderson, J., The travels of John Sanderson in the Levant, 1584-1602, par W. Foster, Londres, 1931,
p. ix-xli.
397 Traduction : C. Young (archives Sauneron, Ifao).
398 Apparently cassia is meant.
- 311 - 312 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇOIS DE PAVIE, BARON DE FOURQUEVAUX (1585-1586)
Pavie, F. de, Relations de François de Pavie, seigneur de forquevauls d’un saint voyage fait en l’an 1585
aux terres du Turc et aux divers lieux de l’Europe, Paris, Bnf, Ms. Fr. N.A. 6277.
François de Pavie, né à Fourquevaux (Haute-Garonne) vers 1561, est gentilhomme ordinaire de la chambre,
surintendant d’Henri IV, lorsque celui-ci n’est que roi de Navarre, et chevalier d’honneur de la reine
Marguerite. Passionné par les voyages, il parcourt l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Il meurt en 1611.399
p. 138-147 :
« Du Cayre en Alexandrie trois cents milles
La ville d’Alexandrie, bastie avant la venue de Jesus Christ en terre trois cents vint et six ans, par ce grand
Roy de Macédoine, dont elle retient le nom, est en forme longue, ayant deux marets qui le ceignent, l’un au
Midi et l’autre au Septentrion nommez mareotides, grande environ sept milles, peu peuplée de gents du
païs, mais bien s’y trouvênt grande quantité d’estrangers pour le trafic qui se faict en ceste eschele où tous
les ports de la mer Méditerranée, et plusieurs de l’Océan négotient ; elles est ceinte de deux murailles pres
l’une de l’autre, avec fossez, et grosses tours à l’entour, non toutesfois forte, estant construite à l’antiene, et
pour son antieneté la plus part ruynée et destruicte.
La grandeur de cette ville est que tout ainsi qu’elle estoit double de murailles elle estoit aussi doublement
habitée, et y avoit deux Alexandries à scavoir l’une sur l’autre, dautant qu’elle estoit fondée sur des
colonnes, et sur des piliers, mais aujourd’huy le dessoubs est deshabité, tant pour estre mal sain que pour
estre presque le tout en ruyne, et ne s’y connoist que le beau dessein du fondateur, qui grand en toutes ses
actions voulut faire un oeuvre digne de luy, laquelle est maintenant fort deperie.
Ceste ville est subjecte à un mauvaise air, qui procede à mon advis de la concavité qui est dessoubs, d’où
naist une grande humidité, et qu’il soit vray elle est en ses faubours, où les maisons ne sont point voutées,
bien saine ; les eaux d’autour sont quelque peu ameres, estant le terroir de sa nature salmastre, et salé ; les
habitans a ceste occasion au croistre du Nil ouvrent un canal faict exprez, qui vient d’auprès de Rozette,
lequel leur conduict l’eau à demi mille de la ville, et delà par des chemins sousterrains ils en remplissent les
cisternes, desquelles ils ont en grand nombre, et les plus belles qui se voyent point, s’en servant jusques à
l’inondation de l’année suivante.
En Alexandrie se voyent les ruynes du palais du Roy Costa, et vis à vis la prison où il tenoit Ste. Catherine, à
laquelle il fit trancher la teste, estant encore la pierre surquoy elle fut tranchée à une Eglize de Grecs,
appelée Ste. Sabe.
Il y a au milieu d’une rue la pierre aussi sur laquelle St. Marc fut décolé, laquelle les Vénitiens ont voulu
acheter à quel pris que ce fut (ne la pouvant desrober comme ils ont autrefois faict le corps du dict St.) mais
les Turcs ne l’ont voulu consentir.
A l’un des coins de la ville, regardant la marine, sont les ruynes d’un grand palais qu’on conjecture devoir
estre celuy d’Alexandre, et depuis de ceste Cléopatre Royne d’Ægypte, dont il est tant parlé en la vie
d’Antoine, au devant du quel y a deux aiguilles, ou obélisques de pierre, pareilles ou de peu moindres de
celle où sont les cendres de César, à Rome escriptes d’haut à bas de lettres hiéroglyphiques, faictes à
quatre carres, d’une encore en pieds, l’autre estendue en terre.
Hors de la ville, assez loing d’icelle, vers le Ponant se voit une colomne de pierre Thebaïq, toute d’une
pierre, de telle hauteur, et grosseur qu’on tient pour chose assurée en tout le monde n’y avoit sa semblable,
les Francs habitans Alexandrie la nomment colomne de Pompée, et les Mores (parceque tous les noms
moresques, et turcs, sont significatifs) Homadussaour, come qui diroit colomne des arbres, et ce, comme je
croy, d’autant qu’aux environs d’icelles y à quelques arbres, car de luy attribuer la vertu du miroir qui brusloit
autres fois les arbres des navires estant en mer ce sont des reveries, et songes de l’antiquité.
Retournant à la ville par un autre chemin que nous n’estions allez à la colomne nous vimes un motte de terre
sabloneuse assez estendue, et presque faicte à la façon d’un clapier, sans herbe, ny buisson dessus, et
icelle trouve haut et bas en tous les endroicts par lesquels trous entroît et sortoînt une espece de rats gris
obscur, grands comme escurieux, en si grand et merveilleux nombre qu’on ne le scauroit estimer, qui sans
s’espouventer de nous se laisoint aprocher d’assez pres.
Alexandrie à trois portes, l’une du costé de Rozette, l’autre du costé de terre, et la tierce allant vers la
marine, qui s’appelle Boabelbar, hors laquelle se voit une jolie peninsule dicte en leur langue Ghiesina400, où
y a beaucoup de maisons basties, la plus part habitées de Juifs : ceste peninsulle est assize au milieu de
deux beaux ports, mais l’un bien plus sur que l’autre appelé port vieux, où ne peuvànt donner fons autres
vaisseaux que ceux de Barbarie, et les six galleres deputées à la garde de la dicte ville ; et y â en ce port un
fort de peu d’importance, gardé de quinze ou vint hommes ; et l’autre qu’ils appelent port neuf, où peuvent
aborder toute sorte de vaisseaux, â de chasque costé de son emboucheure un chasteau, dont celuy de main
droite est gardé de deux cents Janissaires, et l’autre qui est plus petit en peut avoir environ vint, ausquels
toutes les nuicts s’allument deux phanals, pour redresser les vaisseaux qui vont errant par la mer, d’autant
que toute ceste coste de Barbarie est plage, et fort dangereuse à l’aborder ; non toutes fois qu’aucun de ces
chasteaux soit ce phare que le Roy Ptolomée Philadelphe fit bastir, duquel fut architecte Sositrate Gnidien,
car il estoit en un port la aupres nommé Bichieri.
Nous trouvions en Alexandrie sur les arbres, et sur les ayes des petits bastions dicts Chameléons, des quels
plusieurs autheurs ont diversement escript, tenant la plus part qu’ils ne reçoivent autre nourriture que de l’air,
j’y ay prins garde, et en ay eux tant que demeuray en Alexandrie, pour voir plus à loisir si sa nature se
pouvoit, et veu par experience qu’il pourchasse sa vie ainsi que toutes les autres choses animées, l’ayant la
nature prouveu, en deffaut de dans ou de bec, d’une langue longue et pointue, de laquelle, la sortant viste
comme un traict, il scait finement attraper, cheminant lentement, et d’aguet, toutes les mouches, et petits
vers qu’il peut trouver, si fin, et plaisant en sa chasse que je m’y suis maintes fois amusé une partie du jour,
tandis que j’en faisois tirer ce suivant portraict, que je donne pour estre murement considéré, et tiré sur la
mesme proportion (dessin) ses yeux sont faicts en la forme d’un demi pois, ayant la prunelle au dessus fort
petite, et noire, et luysante comme jayet, qu’il tourne tout d’une piece pour regarder. Quant au changement
de sa couleur en un’autre, je l’ay veu maîntes fois, non pas qu’il prenne ainsi qu’on la escript la couleur des
corps qui luy sont opposez, car c’est une erreur que j’ay tres-bien verifiée, mais indifferement ores il est noir,
sur du vert ; ores vert sur du noir ; ores rougeastre, sur du gris ; et ores gris, sur du rouge ; estant ces quatre
couleurs celles en quoy je les ay veu changer, en non en autre.
En ce séjour que je fis en Alexandrie neuf Mores furent mis au gauche, par un Juif qui fut employé à ceste
execution, et parce que ceste forme de justice m’estoit nouvelle j’en voulus savoir la façon, et vis qu’au
milieu d’une place on dresse une grande, et haute potence, suivant le nombre de ceux qui l’ont meritée,
laquelle jusques à moytié de cousté et d’autre est garnie de longs crochets de fer, et au dessus d’icelle y a
une poulie, avec laquelle, et une corde, on eslève le condamné, l’attachant dessous les espaules, et le
guidant jusques à mont, d’où ils le laissent tout à coup tomber sur ces ganches ou crochets susdits,
ausquels il s’attache casuelement, ores par un bras, ores par la jambe, et ores par le faux du corps, suivant
le tencontre ; languissant, en ce triste estat jusq’à ce que la douleur, ou la faim le tue.
D’autant que j’avois ouy fort recommander les Ægyptiens pour grands magiciens, et entendus en ces
sciences occultes, je fus désireux, estant en Alexandrie, où l’on me faisoit grand cas d’un qui se mesloit de
deviner, de parler à luy pour scavoir quelque choze dont j’estoit en peine, et le fis à ceste occasion venir à
moy, lequel apres plusieurs cermonies, m’ayant baillé la plume de son escritoire de laquelle il escrivoit, qui
estoit de ces canes, ou rozeaux qui croissent dans l’eau, (car guere de Mahometans n’ont l’usage d’escrire
avec plumes d’oizeaux), il me la fit mettre en la bouche, et prononcer tout bas ce que je desirois scavoir, ce
qu’ayant faict il ouvrit un vieux livre déchiré, escript en charactères Arabes, avec lequel ayant sur du papier
pozé quatre fois quatre rangées de poincts, et iceux deux à deux adjoustez, et des derniers faict quatre
petites figures j’apperçeus que son art estoit ceste Geomance de Catan, qui nous est si commune, et
incertaine qu’on s’en moque, aussi au lieu que j’attendois quelque temoignage de sa philosophie, je connus
bien à la response qu’il me fit assez mal à propos, et loing de ce que je demandois qu’il n’y scavoit rien ;
comme à la vérité je croy que ces Ægyptiens, desquels l’ont souloit faire tant de cas, sont esvanouis, et que
ceux qui restent sont de vrais ignorans, et encore plus ceux qui s’arrestent en leurs charmes. »
399 Du Mège, A., Biographie toulousaine, Paris, 1823, p. 249-250.
Weiss, M., « Fourquevaux, François Pavie baron de », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.),
Biographie Universelle ancienne et moderne 15, Paris, 1816, p. 390-391.
400 Ǧazīra signifie île en arabe.
- 313 - 314 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MICHAEL HEBERER VON BRETTEN (1585-1586)
Heberer von Bretten, M., Voyages en Égypte de Michael Heberer von Bretten, 1585-1586, par O. V. Volkoff,
Ifao, Le Caire, 1976.
Michael Heberer naît entre 1555 et 1560 à Bretten dans le Palatinat. Il suit des cours à la Faculté des Arts
où l’on enseigne en priorité la philosophie. De 1580 à 1582, il est précepteur d’un comte suédois à
Heidelberg. En 1585, il s’embarque sur un navire qui va livrer la guerre de course contre les Turcs. Au cours
de ce voyage, Michael Heberer est fait prisonnier en Égypte où il passe trois années comme galérien. En
1587, suite à l’intervention de l’ambassade française et de l’Ordre de Malte, il est racheté. En 1589, il revient
à Heidelberg où le récit oral de ses aventures fait sensation à la cour.401
p. [10]- [32] :
« Alors ils nous cachèrent dans une caverne, près d’une haute colonne, non loin de la ville d’Alexandrie
qu’ils appelaient Schandriam.
[p. 11] Comme nous étions donc couchés dans la caverne, ils virent bien que nous étions tout épuisés,
fatigués et exténués ; aussi l’un des Maures partit pour nous chercher du pain ; ils apporta de belles petites
miches rondes et blanches (c’est de cette façon qu’ils ont l’habitude de cuire le pain à Alexandrie). Alors
nous mangeâmes un peu. Mais à cause de la grande soif nous ne pûmes pas le savourer, ils nous firent
sortirent de nouveau de la caverne et nous firent aller vers une église turque qui s’élevait en plein champ. Là
pour l’amour de Dieu, on nous donna à boire de l’eau. Et il y avait là un vieux Turc qui parlait très bien italien
qui sans aucun doute était un renégat ; il eut grand pitié de nous. Il nous demanda comment ce grand
malheur nous était arrivé, nous consola, nous exhorta à la patience et [nous dit] de ne pas perdre l’espoir
d’être libérés, ce qu’il nous souhaitait de tout coeur.
Puis les Maures qui nous tenaient prisonniers, nous firent continuer le chemin [jusque] dans une caverne
[tout] près de la ville d’Alexandrie. Elle avait une entrée si basse que nous dûmes ramper [pour y entrer].
Lorsque nous y fûmes entrés, nous trouvâmes [là] quelques-uns de nos compagnons que l’on y avait
cachés auparavant. Nous [restâmes] donc là assis, attendant notre chance ou notre malchance, et nous
criâmes à Dieu [lui demandant] de nous aider.
[12] Nous n’étions pas assis depuis longtemps dans cette caverne, que nous entendîmes au-dessus de la
caverne un grand bruit et des cris. Les Maures nous enjoignirent de rester tranquilles ; mais c’était le
gouverneur en chef d’Alexandrie qui avait été informé de notre malheur par deux prisonniers grecs. [ils
avaient été] aussi dans notre compagnie, et ils avaient essayé de se rendre tout seuls, pendant la nuit, au
rivage de la mer à Alexandrie (dans l’espoir d’obtenir auprès de leurs coreligionnaires du secours et leur
libération).
Mais ils avaient été vus par les sentinelles et avaient été faits prisonniers [par les gardes] qui avaient été
informés de notre malheur. C’est pourquoi il s’était rendu, avec quelques soldats à pied ou à cheval, aux
environs de la ville, pour fouiller ça et là dans les cavernes, chez les Maures qui avaient l’intention de nous
voler subrepticement et de nous vendre.
Lorsqu’il s’arrêta devant notre caverne, il exigea [de voir] les Maures qui, effrayés, nous ordonnèrent de
sortir en rampant.
Aussitôt que le gouverneur susmentionné nous vit, il demanda immédiatement, en italien, à mes
compagnons, si je n’étais pas Allemand ; ils répondirent affirmativement ; il me demanda si j’étais aussi un
chien luthérien, comme la plupart des Allemands. Je fis comme si je ne le comprenais pas et je ne lui
répondis pas, mais je m’étonnais grandement qu’on ait entendu parler de Luther en Égypte. C’est que le
gouverneur susmentionné est un renégat [p. 13] espagnol. C’est pourquoi il était au courant des différences
entre les religions et les sectes des chrétiens, ce que les Maures, en tant que païens ne savaient pas.
Ensuite on nous mena, environ une trentaine (entre autres mon pieux Poméranien que l’on avait retrouvé),
comme un troupeau de moutons, [revêtus] seulement de chemises, [à coups] de bâtons et de lances, à
travers la magnifique et royale ville d’Alexandrie où beaucoup de négociants français, italiens et anglais
nous virent en route, avec beaucoup de tristesse et de pitié. Mais ils ne pouvaient pas parler avec nous, par
crainte de Maures qui nous poussaient devant eux à [coups de] bâtons, à travers la ville, jusqu’à l’autre côté
de la mer, car ils avaient une prison près du port arrière. Là on nous mena dans l’avant-cour, et nous y laissa
nous asseoir et nous reposait, car nous étions très épuisés à cause de la grande chaleur et de la fatigue.
Car nous avions été forcés de marcher dans les champs pendant presque tout le jour et la nuit.
[p. 14] Comment nous fûmes reçus et mis dans les fers à Alexandrie.
Comme nous étions donc assis dans l’avant-cour, nous nourrissons l’espoir que l’on nous apporterait
quelque chose à manger et à boire. Car nous étions très affamés, assoiffés et fatigués.
Après une heure ou une heure et demie vinrent quelques Maures portant beaucoup de chaînes. On nous mit
alors dans les fers et on nous enchaîna. À quelques uns les larmes coulèrent alors que les joues. Mais
comme nous vîmes qu’il ne pouvait en être autrement, nous priâmes que nous deux, Allemands, nous
soyons enchaînés ensemble, ce qui fut fait.
Ensuite on nous apporta quelques sacs de cuir avec de l’eau et on nous donna des biscuits ou du pain deux
fois cuit, pour que nous nous restaurions.
Lorsque nous nous fûmes donc un peu restaurés, on nous mena tous ensemble dans une grande et longue
écurie, une sorte de prison, qui n’avait aucune fenêtre, à l’exception [d’une ouverture] [p. 15] au milieu en
haut. Car les maisons à Alexandrie, de même que dans les autres agglomérations de l’Égypte et de la Syrie,
n’ont pas de toits [en pente], mais sont en haut tout plats, si bien qu’on peut s’y promener, et les maisons
reçoivent d’en haut la lumière à l’intérieur.
Dans cette prison nous fûmes gardés dix jours, enchaînés pendant le jour, mis de plus dans les fers pendant
la nuit.
C’est alors que je compris pour la première fois pourquoi Moïse, le saint prophète, a nommé le pays
d’Égypte une fournaise de fer, au quatrième chapitre du Deutéronome ; car je n’en souffrais
malheureusement que trop, de cette fournaise de fer- c’est-à-dire des liens et des chaînes de fer- dans
laquelle je fus torturé, devant rester comme dans une fournaise, dans une pénible servitude, dans le pays
d’Égypte.
L’autre partie de notre compagnie, retenue par les Maures, ou qui était restée sur le vaisseau, fut retrouvée
peu à peu parmi les Maures, et fut jointe [à notre groupe]. Entre-temps des Turcs et des Maures, hommes et
femmes, vinrent chaque jour nous [p. 16] examiner et se moquer de nous. Quant aux chrétiens, on n’en
laissa aucun s’approcher de nous.
En plus [des souffrances que nous valait] notre pénible captivité, on se mit à nous couper les cheveux tout
ras sur la tête ; de même [on nous coupa] la barbe avec un rasoir. Ceci nous chagrina beaucoup, et cette
indignité nous fit plus de peine que la prison elle-même.
Dans cet extrême malheur, quelques-uns, perdant la patience, se mirent à se maudire eux-mêmes, leur jour
de naissance ou même leurs parents, comme s’ils étaient cause de leur malheur [qui leur arrivait] et de la
pénible captivité. Parmi ceux-ci il y avait en particulier quelques Français à qui je fis de violents reproches, et
que j’exhortai à la patience et à la prière, [leur expliquant] que nous ne devions accuser personne d’autre
que nos péchés. C’est [à cause d’eux] que Dieu nous avait infligé ce châtiment. Si nous le supportions avec
patience, Il nous adoucirait ou peut-être même nous en délivrerait. Mais si nous devenions impatients et [si
nous] murmurions, Il nous ferait périr complètement, comme Il l’avait fait avec son peuple d’Israël. Ainsi je
refrénai un peu leur conduite impie, si bien qu’ils devinrent plus patients.
Mon pieux Poméranien qui avait une moustache qui lui arrivait jusque derrière les oreilles, refusait
catégoriquement de se laisser faire. Il disait aux autres que de se laisser raser ainsi était efféminé, [et
rappelait] les prostitués. Mais les protestations et les objections [p. 17] n’y firent rien. Comme je vis qu’il ne
pouvait en être autrement, que personne à cette occasion n’était épargné, je parlai à mon compagnon, le
Poméranien et je l’exhortai à la patience, [lui disant] qu’il pensât à ce que nous étions et où nous étions, et
que si nous ne y soumettions volontairement, on nous y forcerait et [nous y] obligerait en nous battant
jusqu’au sang. Alors le bon Poméranien se mit en colère, saisit le rasoir et se coupa lui-même les deux
[bouts de] moustaches, en déclarant que les coquins ne méritaient pas qu’on leur permît de lui enlever les
poils. Ensuite il fit terminer complètement l’opération, avec un rasoir, par un Français. Il en fut de même pour
moi.
Comment les chevaliers furent enfin aussi capturés, avec des considérations chrétiennes sur l’inconsistance
du bonheur.
Après [avoir relaté] cet [événement] pitoyable, je laisserai quelque temps notre compagnie là où nous
sommes, pour informer [le lecteur] de ce qui est arrivé aux [autres] chevaliers pendant leur fuite.
Ils avaient emporté dans leurs barques un peu d’eau, assez de pain et quelques sacs de riz. Mais il leur
manquait le nombre nécessaire de rames.
Comme il leur en fallait plus qu’ils n’en avaient, ils se servirent d’un morceau [détaché] du bord du [bateau],
et s’en aidèrent [p. 18] d’abord comme ils purent. Nous ne les vîmes pas longtemps à cause des grandes
vagues de la mer. Comme ils naviguèrent pendant quelque temps dans la mer démontée et en proie aux
vagues, un morceau du bord se brisa chez l’un d’eux, une rame chez l’autre, si bien que finalement après
beaucoup d’angoisses, et peines et d’efforts, et après avoir éprouvé beaucoup de chagrin et de tristesse
pendant cinq jours et [cinq] nuits entières, ils durent regagner la terre. [Ils furent aussi obligés] de le faire par
manque d’eau douce et de grand danger [que présentait] la mer déchaînée. Ceci arriva à environ cinquante
milles d’Alexandrie, vers minuit, non loin de Cyrène.
Aussitôt descendus à terre, ils furent attaqués par les Maures. Comme les bons chevaliers et [toute] leur
compagnie n’avaient d’autres armes que des rapières et des dagues, et pas de carabines, les Maures, avec
leurs longues lances, eurent le dessus, et deux de leur compagnie furent tués par les Maures. Quand les
autres le virent, ils se rendirent malgré l’aversion qu’ils éprouvaient de le faire.
Le butin que les Maures en emportèrent fut toutefois peu important. Ce ne fut que le bateau et ce qu’il y
avait là-dedans [en fait] de riz, de sucre et d’épices. Car les chevaliers avaient tous les cheveux longs, et ils
avaient collé, derrière, avec de la poix, leur argent et leurs bijoux dans leurs cheveux et les avaient encore
enduits de poix, si bien que les Maures, malgré toutes leurs soigneuses recherches, ne purent trouver sur
eux de l’argent.
Quelques-uns de ces Maures appartenaient aux seigneurs d’Alexandrie. C’est pourquoi leurs chefs leur
ordonnèrent, à [p. 19] quelques-uns de ceux qui étaient à pied ou à cheval, de livrer les chevaliers et leurs
compagnons à Alexandrie.
On les fit donc aller, comme [cela s’était passé avec] nous, mais beaucoup plus loin, sur le sable chaud.
Pendant le jour, dans la grande chaleur, ils étaient cachés dans les cavernes ; le soir et toute la nuit, ils
devaient marcher. Si bien qu’ils furent aussi livrés à Alexandrie le dixième jour.
Toutefois on ne les conduisit pas dans notre prison, mais [ils furent] gardés dans la ville, pour que nous ne
soyons pas ensemble et ne puissions converser. Mais quelques-uns des anciens nous informèrent de leur
situation, avec la communication additionnelle qu’ils ne savaient rien d’autre sinon que le plus tôt possible on
les remettrait, au Caire, au pacha en chef. Ce qui arriva. Mais nous ne nous sommes pas vus, ce qui nous fit
à tous beaucoup de peine.
[p. 20] Ici je laisse méditer l’aimable lecteur et chaque chrétien sur l’inconsistance du bonheur et les
merveilleux et imprévisibles incidents de la vie humaine.
Le comte prisonnier et les nobles chevaliers étaient, il y a encore quelques semaines, honorés de tous, dans
l’opulence, hautement considérés par beaucoup de gens à Malte. Maintenant ils sont méprisés plus
profondément que [ne l’étaient] jadis leurs valets, dédaignés, plus mal entretenus que leurs chiens. Et de
plus, par leurs ennemis, par ceux-là même que le Christ a appelés chiens ou qu’il a comparés aux chiens.
Matth. chap. 15. À ceux-ci, dis-je, eux et nous, nous devions tous être soumis corps et âmes.
Et pour parler de moi-même ; sept ou huit semaines auparavant j’étais encore en France, joyeux, heureux,
libre et indépendant. Je m’imaginais, à Marseille, pouvoir éviter la captivité des chrétiens. Comment aurais-je
pu rêver qu’en si peu de temps, je serai non seulement transporté à deux mille lieux de là, sur la mer
démontée, mais encore que je serai en Égypte, à laquelle je n’avais pas pensé un seul jour de ma vie, et
que je me trouverais dans la servitude, chez les païens, que je serais abreuvé de l’eau de l’affliction [puisée]
au fleuve du Paradis, le Nil ? Comme boisson, [p. 21] j’aurais souvent préféré de beaucoup celle du puits de
St. Pierre à Heidelberg. Mais tout cela en vain, parce qu’il a plu ainsi à Dieu, à la volonté clémente Duquel je
me suis soumis sans réserve, avec une prière fervente, à Lui qui, malgré ma nature stupide se mes faibles
facultés, m’a fortifié, m’a consolé et m’a merveilleusement (comme il est dit dans le psaume de David)
conduit et gardé, et m’a finalement libéré, sain et bien portant et m’a de nouveau ramené dans ma chère
patrie. C’est pourquoi je lui dois aussi, de Le louer, de L’honorer et de Le glorifier pendant le reste de ma vie.
[p. 22] Description de la ville royale universellement célèbre, Alexandrie, mon premier lieu de captivité en
Egypte, et de ses habitants.
« Puisqu’il avait donc plu à Dieu tout puissant, que je sois tenu à Alexandrie, avec d’autres chrétiens, dans
une pénible servitude, [astreint à] un travail dur et journalier, je me rendis tout léger par la patience
chrétienne, par des implorations continuelles et par des prières [adressées] à Dieu. Les chevaliers avaient
été conduits avec leur compagnie au Grand Caire chez le pacha en chef qui commande à toute l’Egypte et à
l’Arabie.
Entre-temps nous vîmes et reconnûmes la disposition de la ville d’Alexandrie, que je n’ai pas voulu manquer
de décrire comme le premier lieu de ma servitude, car c’est une vieille ville royale universellement connue.
C’est la ville d’Alexandrie, d’altitude (sic) 60 degrés 30 min., de latitude 31 degrés 0 min., une grande [et]
magnifique ville, belle [et] universellement célèbre, bâtie par le puissant roi Alexandre le Grand en l’année
4870 de la création du monde, mais en 330 av. J.C., et appelée d’après son nom, grande Alexandrie. Elle a
30 stades en longueur et 10 en largeur. Nombreux y sont toutes sortes de négociants venus principalement
par le Nil, en Égypte, et d’autres lieux voisins. Elle est située tout près de la mer, si bien que dans le port
avant les vagues battent les murailles de la ville, comme on le voit sur la gravure n°4. Elle a deux
magnifiques ports, toutefois le [port] avant, de forme naturellement ronde, grand de 30 stades, gardé par
deux châteaux à son entrée, est principalement employé par les négociants et les vaisseaux marchands.
Sur le côté droit de l’entrée du port avant, il y a eu, sur une petite île, une très haute tour, qui fut comptée
parmi les sept merveilles du monde ; [elle était] nommée Pharos, d’où l’endroit a gardé encore aujourd’hui le
même nom. [Du haut] de cette tour, les marins [étaient guidés] par une lumière, [visible] à une distance de
plusieurs milles. D’après elle, ils pouvaient se diriger vers l’entrée [du port] (qui présente beaucoup de
danger en plusieurs endroits à cause des récifs dissimulés dans la mer).
Ce port avant est, comme [nous l’avons] mentionné, utilisé principalement par les négociants. Dans l’autre
[port] ou port arrière se tiennent habituellement les galères qui appartiennent au bay d’Alexandrie. On en
tient là ordinairement quatre, pour garder le port et accompagner les navires.
Cette ville est puissante, non par sa construction, mais sa situation naturelle, partie à cause de la mer
impétueuse, partie à cause du [caractère] désertique du pays, et aussi à cause des marais dus au Nil et aux
lacs d’alentour. Malgré cela elle a été prise et misérablement dévastée, en l’année 293 après J.C., par
Dioclétien qui l’a assiégée, [du côté] de la mer et [du côté] de la terre, pendant huit mois.
Dans cette ville, il y a encore un bel obélisque en pierre de porphyre rouge et blanc. [Il porte], gravées, des
inscriptions égyptiennes ou des figures, et [il est] si haut qu’on peut le voir du dehors, par-dessus les
murailles de la ville, en face de la mer. On trouve aussi des citernes entièrement bâties de marbre, où le Nil,
ou [plutôt] l’eau du Nil, est conduite par des canaux, pour que les habitants puissent en boire. D’une telle
citerne nous avons aussi apporté tous les jours de l’eau potable dans notre prison, dans de petits tonnelets
appelés bacille, ainsi que pour les besoins domestiques de notre patron.
Entre autres [constructions], on peut [y] voir une église chrétienne, bâtie en l’honneur de Sainte Catherine
(qui avait été martyrisée dans cette ville) qui, à part de nombreuses autres [églises] est encore utilisée
aujourd’hui pour le service divin, et est habitée par le patriarche d’Alexandrie et d’autres Grecs.
Je ne dois pas aussi manquer de mentionner comment les Maures détruisirent une fois une telle église, de
propos délibéré (comme les Grecs me l’ont raconté eux-mêmes). Toutefois le patriarche d’Alexandrie est
parti, à cause de cela, à Constantinople, et s’est plaint auprès de l’empereur turc de l’insolence et de la
violence des Maures. Alors, par ordre de l’empereur turc, les Maures susmentionnés furent forcés de bâtir
une église semblable, à leurs propres frais, [et même] plus belle qu’elle ne l’était auparavant, telle qu’on la
voit encore aujourd’hui. Ceci est étonnant de la part de l’empereur turc, car dans la chrétienté on n’en fait
pas de même, particulièrement en ce qui concerne les bâtiments religieux.
Ce patriarche d’Alexandrie est le plus élevé et le plus considéré de la chrétienté ; il est égal en dignité à celui
de Constantinople, comme aussi à celui d’Antioche, et vient avant celui de Jérusalem. Il a aussi un titre
magnifique ; il s’intitulait de mon temps comme suit :
(texte en grec)
Silvestre le [très] Saint Pape et Patriarche de la Grande [ville d’]Alexandrie, de Libye, de Pentapolis, du pays
des Maures [d’Ethiopie] et de toute [la terre d’]Égypte. Père de tous les pères, pasteur de tous les pasteurs,
grand prêtre au-dessus de tous les grands prêtres [=Archiprêtre des Archiprêtres], [le] treizième [des]
apôtre[s] et juge de l’Univers habité.
[Mais], par ailleurs, il va très mal vêtu. C’était un homme de soixante-dix ans. Il avait peu d’instruction et ne
connaissait pas le latin, car dans ces parages, de même que dans toute la Turquie, on ne voit pas d’école
chrétienne, [autant que] j’ai pu m’en rendre compte pendant mes voyages.
L’évangéliste saint Marc fut aussi décapité dans cette ville, en la 64e année ap. J.C. En son honneur on y
maintient encore une petite église. Et il faut particulièrement noter que le magnifique livre de Syracidis,
nommé Jésus Syrach, a été composé dans cette ville en l’année 4970 de la création du monde, et en
l’année 230 av. J.C. Et jadis il y a eu dans cette ville une remarquable école, comme on peut le lire dans [le
livre des] Actes, VI. On y trouvait aussi les livres les plus remarquables, comme en aucun autre endroit du
monde, surtout au temps de Ptolémée Philadelphe, sous lequel les 72 interprètes ou traducteurs traduisirent
l’Ancien Testament de l’hébreu en langue grecque.
Près de la ville il y a une assez haute montagne artificielle, sur laquelle il y a une tour de guet d’où l’on
donne continuellement des signaux en hissant ou en baissant [un drapeau], pour informer [les autorités] d’où
viennent les navires [qui veulent aborder là].
Ensuite il y a non loin de la ville une magnifique colonne ronde de pierre, dont le socle carré a quatre aunes
de hauteur ; là-dessus s’élève la colonne, haute, selon mon estimation, de douze aunes, et épaisse de trois
aunes. En haut, au bout, elle est de nouveau carrée, mais [cette partie est] plus petite que le socle de la
colonne. On la nomme colonne Pompée. Quelques-uns sont de l’opinion qu’elle fut érigée par Jules César
en mémoire de Pompée, mentionné plus haut, quand celui-ci fut tué traîtreusement, en cet endroit, par ceux
chez qui il avait cherché secours et refuge. Mais il n’y a pas là d’inscription. Par ailleurs on voit d’après les
boules de marbre [et] les colonnes ornées d’or et [peintes] de diverses couleurs, placées près des portes et
des fenêtres, et dont on voit beaucoup çà et là à Alexandrie, [colonnes extraites] des ruines de la ville, que
dans les temps passés, il y avait dans cette ville de magnifiques bâtiments de marbre et d’autres pierres
précieuses. Mais ils sont pour la plupart complètement ruinés et donnent l’impression que la ville n’a été
détruite que peu d’années de cela. C’est pourquoi la plus grande partie de la ville n’est pas habitée et est en
ruine.
Dans cette ville habitent aussi quelques ambassadeurs des souverains chrétiens. Ils sont nommés consuls.
Chez eux loguent des négociants de tous pays, et d’autres voyageurs. [Tous], tels que [les sujets] de la
Seigneurie de Venise, du roi de France, de la reine d’Angleterre, etc., y trouvent refuge. Ils n’aident pas
seulement les négociants chrétiens, étrangers dans [l’exercice de] leur profession et dans [la protection de]
leurs droits, mais rendent aussi des services aux voyageurs de passage qui [viennent] visiter le pays, en leur
prêtant de l’argent et en arrangeant [leurs] autres affaires par [l’entremise de] leurs drogmans. Ils rendent
également de grands services aux pauvres prisonniers et compatissent [à leurs malheurs en leur distribuant]
de généreuses aumônes. Mais pendant la nuit ils sont enfermés dans leurs maisons, appelées fondics ; les
Maures les ferment de l’extérieur, si bien qu’ils ne peuvent sortir jusqu’à ce que les Maures les ouvrent,
d’après le règlement, le matin.
Les Turcs et les Juifs habitent pour la plupart en dehors des portes de la ville, dans de petites maisons, entre
les deux ports maritimes. Ainsi, mon patron, le bay, avait lui-même sa maison dehors, devant la ville, tout
près de notre prison. C’était un petit bâtiment, toutefois bâti en pierre, à deux étages, sans toit [incliné] à
cause de la pluie, comme il en arrive dans ces régions en hiver ; ceci pour que les marchandises soient bien
conservées et ne se mouillent pas, et pour que la rosée ne les gâte pas non plus.
Pendant que nous étions donc retenus à Alexandrie, les Turcs et les Maures amenèrent chaque jour
d’autres de nos compagnons qui avaient été cachés par les Maures, ainsi que plus d’un de ceux qui
n’avaient pas gagné [la côte] en nageant mais étaient restés sur le navire. Ainsi nous étions tous de
nouveau réunis, à l’exception du seul Français qui s’était noyé, et d’un Maltais qui s’était enfui à l’aide d’un
Maure qu’il avait soudoyé avec de l’argent.
Le navire sur lequel nous avions été, avait été confisqué par le bay d’Alexandrie, avec tous les biens, y
inclus deux beaux chevaux turcs (qui en dix jours n’avaient pas reçu une goutte [d’eau] à boire). Mais à
Constantinople on établit ensuite s’il avait ou non le droit [de le faire]. J’ignore ce qui fut décidé.
Comme les Maures nous avaient complètement dépouillés et nous avaient aussi enlevé les vêtements, on
nous donna à chacun un morceau de toile, [provenant] de vieilles voiles, pour que nous nous en vêtions, à
chacun [suffisamment] pour se confectionner une chemise et une paire de pantalons. Nous devions
fabriquer nous-mêmes du fil à partir de vieux morceaux de corde, et [quant aux] aiguilles, nous devions les
rendre de nouveau au gardien, pour que personne ne puisse se débarrasser de ses fers. J’appris en effet,
que plusieurs esclaves, entre autres un compagnon d’orfèvre, avaient fait d’une grosse aiguille une lime,
avec laquelle ils s’étaient libérés, ainsi que d’autres [esclaves], en limant [les fers]. »
- 315 - 319 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHN EVESHAM (du 27 avril au ? 1586)
Evesham, J., « The voyage of John Evesham by sea into Ægypt, Anno 1586 », dans R. Hakluyt (éd.), The
principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, made by sea or overland
to the remote and farthest distant quarters of the earth, vol. III, Londres, Toronto, New York, 1926.
p. 350-351 :
« La ville d'Alexandrie est une vieille localité délabrée et ruinée, ayant été une grande et belle ville d'environ
deux milles de long ; par en dessous elle est toute en voûtes où l'on garde de l'eau fraîche ; celle-ci ne vient
là qu'une fois par an de l'un des quatre fleuves du Paradis (comme on l'appelle) nommée Nilus qui, en
septembre, coule (p. 36) à environ dix-huit pieds plus haut que d'ordinaire ; la digue est coupée, comme si
c'était une écluse, à environ trente milles d'Alexandrie, dans une ville appelée Rosette ; l'eau arrive à la dite
ville en une telle quantité, que des bateaux de douze tonnes flottent sur cette eau qui remplit les voûtes. Les
citernes et les puits dans la dite ville avec de la très bonne eau, et qui reste bonne jusqu'à l'année suivante ;
car il y pleut très rarement ou même pas du tout ; par contre, il y a des rosées très abondantes.
Ils ont du très bon blé en grande quantité ; tout le pays est très chaud, particulièrement aux mois d'août, de
septembre et d'octobre. Il y a aussi dans la dite ville une colonne de marbre appelée par les Turcs aiguille du
roi Pharaon ; elle a quatre carrés, chaque carré ayant douze pieds, et la hauteur [de la colonne] est de
quatre-vingt-dix pieds. Il y a là aussi, (p. 351) hors des murs de la dite ville, à environ vingt pas, une autre
colonne de marbre, ronde, appelée colonne de Pompée : ce pilier se dresse sur une grande pierre carrée,
chaque côté a quinze pieds, et cette même pierre a quinze pieds de haut et le tour du pilier est de 37 pieds
et sa hauteur est de 101 pieds ; il est une merveille de penser comment il fut jamais possible de placer ledit
pilier sur ladite pierre carré.
Le port de la dite ville est bien fortifié, avec deux puissants châteaux, tandis qu’un autre château à l'intérieur
de la ville, est bien approvisionné en munitions. »402
402 Traduction : A. et P. Hénault (archives Sauneron, Ifao).
- 320 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LAURENCE ALDERSEY (du 28 au 31 juillet 1587)
Aldersey, L., « The second voyage of M. Laurence Aldersey to the city of Alexandria & Cayro in Ægypt,
Anno1586 », dans R. Hakluyt (éd.), The principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the
English Nation, made by sea or overland to the remote and farthest distant quarters of the earth, vol. III,
Londres, Toronto, New York, 1926.
Laurence (1546-1597/1598), né à Aldersey Hall (Spurstow, Cheshire, au sud de Liverpool), se rend à
Londres dans le milieu des années 1560, pour faire carrière dans le commerce Baltique et international. Plus
tard, il effectue deux voyages dans le Levant. Au cours du premier voyage, qui débute en avril 1581, il se
rend à Venise d’où il s'embarque pour accomplir le pèlerinage en Terre sainte. Il arrive à Jérusalem
le 12 août. Étant capitaine de mer, le conseil secret le charge en 1586 de ramener un groupe de cent Turcs
dans leur patrie. Ces derniers avaient été ramenés des Antilles par Francis Drake. Après cette mission
accomplie, Laurence Aldersey visite les diverses îles de l'archipel grec. De là, il se rend en Syrie, puis à
Alexandrie où il arrive le 28 juillet. Il visite cette ville et Le Caire en quatorze jours. Il meurt peu après une
mission diplomatique au cours de laquelle il est chargé de remettre des lettres de la reine Élisabeth à
l’empereur d’Éthiopie.403
p. 356-357 :
« Le 28 juillet j'arrivais à Bichieri où je fus bien reçu par un juif que était l’officier de douane en ce lieu. Il
m'offrit du muscat et but lui-même l'eau. Après que j’eus rompu le jeûne avec lui, il me fournit un chameau
pour mes bagages, une mule pour moi et un Maure pour courir auprès de moi jusqu'à la ville d'Alexandrie.
[Ce dernier] était chargé de me conduire sain et sauf à la Maison anglaise. J'y parvins, mais n'y trouvait pas
d'Anglais. Mais alors mon guide m'amena à bord d'un navire de l'Alderman Martins, appelé "Le Tigre", de
Londres, où je fus bien reçu par le capitaine et tout l'équipage de ce navire. Son nom était Thomas Rickman.
Le dit Capitaine, m'ayant offert un bon repas, me fit aussi boire de l'eau du Nil ; ayant les clés de la maison
anglaise, il m'y accompagna lui-même, me donna une belle chambre et me laissa un homme qui devait me
procurer les choses dont j'avais besoin ; et chaque (p. 357) jour, il venait lui-même, m'emmenait dans la ville
pour me montrer les monuments qui sont les suivants :
Il me conduisit d’abord à la colonne de Pompée qui est imposante, faite de marbre gris et tout d’un seul bloc.
D’après estimation, elle mesure 32 yards de haut et six brasses de pourtour.
La ville a trois portes, l'une appelée la porte de Barbaria, l'autre de Merina et la troisième de Rossetto.
Il m'amena à une pierre dans une rue de la ville, pierre sur laquelle saint Marc avait eu la tête tranchée, à
l’endroit où sainte Catherine mourut, s'y étant cachée parce qu'elle ne voulait pas se marier ; ainsi qu'aux
bains de sainte Catherine.
J'y vis aussi l'aiguille de Pharaon qui est un monument d'une hauteur presque égale à celle de la colonne
Pompée qui a cinq brasses et demie de circonférence ; elle est toute faite d'une seule pierre.
On m'emmena aussi à un bain très beau et très élégant, où nous nous lavâmes ; le bain était de marbre et
d'une construction très curieuse.
La ville s’élève sur de grandes arches ou voûtes, comme dans les églises, avec de puissants piliers de
marbre pour soutenir les fondations, lesquelles arches sont construites pour recevoir l’eau du fleuve du Nil
qui est pour l’usage de la ville. Elle a trois châteaux et cent églises ; mais la partie [de la ville] qui est détruite
est six fois plus grande que celle qui est debout.
Le dernier jour de juillet, je partis d’Alexandrie vers Le Caire sur un bateau de voyageurs à bord duquel j’allai
d’abord à Rossetto. »404
403 Baldwin, R. C. D., « Aldersey, Laurence (1546-1597/8) », Oxford Dictionary of National Biography,
Oxford, 2004 ; [www.oxforddnb.com].
404 Traduction : A. et P. Hénault (archives Sauneron, Ifao).
- 321 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BERNHARDT WALTER VON WALTERSSWEYL (1587)
Walterssweyl, B. W. von, Beschreibung Einer Reiss auss Teutschland biss in das gelobte landte Palestine,
unnd gen Jerusalem auch auff den Berg Sinai von Dannen widerumb zuruck auff Venedig und Teutschland,
Munich, 1609.
p. 60a-61a :
« Ensuite chacun peut se rendre dans la ville [Le Caire], dans son ancienne auberge, et interroger
soigneusement les négociants chrétiens au sujet des navires se trouvant à Alexandrie et quand, et pour
quelle destination, chacun d’eux se propose de partir.
Par parenthèses, la compagnie fera mieux, comme on l’a déjà dit, de s’embarquer là, à Alexandrie sur un
navire en partance pour Malte ou la Sicile, et non à destination de Venise, pour éviter une longue
navigation ; et par ce moyen, elle pourra parcourir et visiter l’Italie.
Lorsque la compagnie s’est donc renseignée au sujet d’un navire qui lui convient, elle peut se munir de
provisions, telles que du pain, du vin, du fromage, des langues de boeufs fumées, du poisson frais ou
mariné, de fruits et d’autres objets nécessaires. Ensuite elle doit engager un Janissaire bien connu qui
l’accompagnera jusqu’à Alexandrie.
En ce qui concerne les auberges d’Alexandrie, chacun peut se loger dans un fontico qui lui convient le plus,
et là s’enquérir soigneusement au sujet des meilleures possibilités pour s’embarquer, car il n’est pas
conseillé d’y séjourner longtemps.
Au sujet de la quantité de nourriture et de boisson, et d’autres objets dont chacun doit se munir pour le
voyage projeté, et aussi comment il doit discuter avec le patron du navire au sujet de la table et du coût du
voyage, le pèlerin l’aura, en partie, appris par lui-même, en partie il pourra le voir dans mes instructions
inscrites ci-dessus.
Par ailleurs, qu’il suive les conseils donnés par les négociants à ce sujet : [en tout cas] on ne perdra rien à
se munir en quantité suffisante de nourriture et de boisson, et de vêtements chauds, car le voyage du retour
dure plus longtemps que l’aller, à cause des tempêtes violentes et des vents contraires. »405
405 Traduction : O. V. Volkoff (archives Sauneron, Ifao).
- 322 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS LUDWIG VON LICHTENSTEIN (juillet-octobre 1587)
Lichtenstein, H.-L. von, et al., Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588. H.-L. von Lichtenstein,
Samuel Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire,
1972.
p. [24]- [25] :
« La ville d’Alexandrie est grande et étendue, située à un endroit agréable au bord de la mer, avec deux
châteaux fortifiés. Quand nous eûmes de nouveau envie de partir pour Constantinople, nous envoyâmes
notre esclave italien à Venise par un bateau vénitien avec nos oiseaux, animaux et ce que nous avions
acheté dans ces pays.
Du fait que ce bateau vénitien avait emmené et débarqué les chevaliers maltais de St. Jean à Malte, nous
perdîmes toutes nos affaires, car les Maltais interceptent et enlèvent en mer les marchandises des Juifs et
des Turcs. Les Maltais auraient pris aussi nos affaires, mais dans ce cas, pour les chrétiens, on fait suivre
tous leurs objets ; pour cela, nous supposâmes, comme l’esclave n’était plus retourné chez nous, que luimême
nous avait volés.
Ici, il n’y a rien de particulier à voir, si ce n’est une belle, très haute et épaisse colonne en marbre, en trois
morceaux, qui aurait été érigée par Pompée. Dans la chapelle grecque, on montre aussi une pierre, sur
laquelle Ste. Catherine aurait été décapitée. Il y a ici beaucoup de tourterelles grises qui sont capturées en
grand nombre et mangées. Lorsque nous fûmes alors décidés à partir pour Constantinople, nous
rencontrâmes tout de suite deux galères de Constantinople ; avec le patron de l’une nous discutâmes, le 14 ;
nous nous embarquâmes le 19 et partîmes la nuit à la rame en direction de Rhodes. »
- 323 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
IBN `ABID AL-FĀSĪ (1587-1588)
Ibn `Abid al-Fāsī, Raḥlat Ibn `Abid al-Fāsī min al-Maġrib ilā Ḥaḍramūt, Beyrouth, 1993.
Ibn ‘Abid al-Fāsī naît à Fès en 1557/1558 et meurt en 1638/1639.
p. 91 :
« Je suis entré à Alexandrie où des cheikhs de la Šāḏaliyya ont leurs tombeaux. J’ai visité leurs tombeaux ;
parmi eux il y a celui du cheikh Abū al-`Abbās al-Mursī et d’autres. J’y suis resté quelques jours. Ensuite on
m’a dit que le cheikh Muḥammad b. al-Ḥasan al-Bakrī n’a pas fait le pèlerinage cette année. »406
406 Traduction : O. Sennoune, H. Zyad.
- 324 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SAMUEL KIECHEL (du 25 avril au 8 mai 1588)
Lichtenstein, H.-L. von, et al., Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588. H.-L. von Lichtenstein,
Samuel Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire,
1972.
Samuel Kiechel, né en 1563, appartient à une famille originaire de Brisgau (région entre le Rhin et la forêt
Noire). Il ne s’attache à aucune profession particulière, mais avide de connaissances, il commence très tôt à
voyager. Il visite successivement les principaux pays d'Europe et du Proche-Orient, et séjourne cinq mois en
Égypte en 1588. Il meurt en 1619.407
p. [29]-[43] :
« Nous arrivâmes le 25 après-midi dans le port d’Alexandrie d’Égypte, dans lequel il est dangereux de
naviguer à cause de certains écueils et récifs cachés sous l’eau. Ce port est étroit et possède deux châteaux
qui se font face, de telle sorte qu’on peut tirer alternativement de l’un à l’autre. Ces châteaux, plus
spécialement celui à main droite de l’entrée, sont bien munis de canons et de soldats pour protéger le port.
Quand je débarquai à terre de la chaloupe du bateau, un Juif vint me voir à la douane, passa ses mains
dans mes vêtements, car dans ce pays, il faut donner un pour cent de son argent, mais il n’en trouva pas
beaucoup sur moi. Il y a encore un mille romain de la douane jusqu’à la porte de la ville, sous laquelle se
tient un More, un Juif et un « Nosseran » ou chrétien, pour prélever la douane. Ceux-ci me fouillèrent encore
plus soigneusement, mais ne trouvèrent cependant rien. Enfin, j’allai tout à fait dans la ville et vers le fontico
de France, où je demandai au consul de cette même nation de me loger, ce qu’il accepta bien volontiers. Il
me fit donner une chambre par le majordome ; j’y déposai ma caisse, mon baril et d’autres affaires et je me
mis à table avec les commerçants français. Je payai huit meidins par jour. Ici, il faut savoir que dans ce
pays, un meidin a autant de valeur que deux meidins syriens, ce qui équivaut presque à trois Kreutzers de
notre monnaie ; c’est une lourde et forte monnaie, dont celle de moindre valeur est en argent et 40 font un
sequin ou ducat en or ; l’autre petite monnaie est faite de cuivre.
Alexandrie est une ville extrêmement ancienne, fondée et construite par Alexandre le Grand (d’où aussi son
nom) en 320 avant la naissance du Christ ; elle est appelée par les habitants Scandria. Cette ville est assez
grande avec de solides murailles et de puissantes tours, construites pour la protéger sur son pourtour ; mais
comme elles ne sont pas entretenues, elles tombent en ruines à beaucoup d’endroits. Les maisons, ainsi
que d'autres constructions se trouvant dans la ville, sont pour la plupart désertes, abandonnées, en ruines et
peu habitées, soit par des chrétiens, qu'on appelle Christiani de la cintura, soit par des Mores et Arabes, qui
séjournent dans la ville. Le prince408, et le sandjak, comme d'ailleurs les Turcs et les Juifs, habitent tous en
dehors de la ville, au bord de la mer, où ils ont de mauvaises maisons basses ; et beaucoup plus de gens
vivent à l'extérieur de la ville qu'à l'intérieur.
Alexandrie est en ce moment le principal port du royaume d'Égypte. On la considère plus comme faisant
partie de l'Afrique que de l'Asie. Beaucoup de marchandises y sont apportées, particulièrement du poivre et
d'autres épices, venant du Caire par le Nil. Ici, les amis des Turcs aussi bien que leurs ennemis peuvent
faire du commerce, car elle est une "escale libre", pas comme en Syrie, à Constantinople ou dans d'autres
endroits de Turquie, dans lesquels à l'exception de trois nations, c'est-à-dire les française, vénitienne et
anglaise, aucun autre chrétien ne peut faire du commerce. Les bateaux ragusains, siciliens, napolitains,
ceux de Livourne, de Gênes et des autres villes chrétiennes de la mer, viennent ici à côté des bateaux
français, vénitiens et anglais. Tous circulant librement et ouvertement, à condition de présenter et de donner
aux consuls respectifs, à leur consulat, le pourcentage qui leur est dû, [en échange de quoi] ces derniers
leur donnent à eux, ainsi qu'aux ressortissants de leurs pays, protection et sauvegarde.
Les Vénitiens possèdent deux maisons, appelées Fondiques, dans lesquelles se trouvent des pièces et des
caves, où l'on met les marchandises et, au-dessus, des chambres et des habitations pour que les
commerçants y logent. De même, les Français, les Ragusains et les Génois ont également leurs Fondiques
spéciaux, qui sont tous situés à l'intérieur de la ville et étant donné qu'il y en a davantage [de Fondiques] de
vides que d'habités, on peut supposer qu'il y avait autrefois beaucoup plus de négoce et de commerce.
En ce qui concerne la fonction et la charge des consuls, j’en ai parlé précédemment. Ici, il n’y a pas plus de
deux [consuls] un français et un vénitien, qui résident surtout au Caire ; ils ont leurs adjoints, appelés viceconsuls.
Quant aux Génois, aux Napolitains et aux Siciliens, ils sont pour la plupart sous la protection du
consul français. Celui qui était le consul de cette nation à cette époque, s’appelait Christophero Vento,
homme plein de dignité, issu de la noblesse et de l’une des familles les plus distinguées de Marseille.
Pendant cette période, il était en France et son remplaçant ou vice-consul, était son proche cousin,
également de sa famille, nommé Angelo Vento. Ils m’accordèrent beaucoup de courtoisie, d’amitié et de
bonté, particulièrement à mon retour, lorsque je fus victime de la fièvre.
On doit savoir ici que, non seulement à l’intérieur de la ville, mais aussi à l’extérieur, il n’y a ni le fleuve Nil, ni
puits, ni aucune autre sorte d’eau douce courante. Comme le Nil n’a pas son cours à Alexandrie (en effet, il
se jette dans la mer à une journée de voyage d’ici, j’en parlerai plus loin), il y a sur beaucoup de milles un
canal spécial, toujours sec en été, grâce auquel le Nil en débordant, apporte l’eau jusque dans la ville. À
cause de cela on dit que cette ville serait construite autant sous terre, ce qui échappe aux yeux,
qu’au-dessus ; quand au mois d’août elle s’approvisionne en eau pour toute une année, il n’y a pas de
maison aussi misérable et délabrée soit-elle, qui n’ait une, sinon deux citernes. Je l’ai vu sous quelques
constructions abandonnées et en ruine, ces citernes sont artistement, proprement et bien faites, au-delà de
toute mesure ; j’ai remarqué que beaucoup de colonnes, supportant une voûte, sont faites de beau marbre.
On peut donc supposer que cette pierre était aussi commune que chez nous d’autres pierres vulgaires.
Ainsi, à l’intérieur de la ville, dans beaucoup de vieilles maisons, les carrelages et les sols sont en beau
marbre coloré faits d’incrustation en forme d’étoile ou de traits et garnis artistiquement et avec élégance ; et
cela, bien que dans beaucoup de maisons habitent maintenant des Mores et des Arabes pauvres, gens qui
sont les derniers à construire ou à réparer. Si une maison tombe en ruine au point qu’ils ne peuvent plus
l’habiter, ils en cherchent une autre, car, dans la ville, beaucoup de maisons sont inhabitées.
Une fois, lorsque je me promenai dans la ville avec quelqu’un qui me guidait et qui connaissait la langue, je
répétais qu’il était dommage de laisser tomber en ruine ainsi tous ces bâtiments, ce qu’il traduisit en langue
arabe à un More ; ce dernier lui répondit que Dieu n’aurait pas ordonné de restaurer et de réparer une vieille
maison.
Cette ville est plus longue que large et sa taille est comparable, environ, à celle de Naples en Italie. On peut
voir comme sanctuaires un petit monastère, appelé Saint-Saba, qui est habité par quelques « Caloiri » ou
moines grecs, il y a à l’entrée de l’église, à main gauche, une pierre en marbre blanc, sur laquelle sainte
Catherine aurait été martyrisée.
Non loin de là est encore située une autre église, propriété des Éthiopiens ou Chrétiens de la ceinture. Dans
celle-là, on peut voir la tombe de l’évangéliste Marc, dont le corps reposerait actuellement à l’église Saint-
Marc de Venise. À l’intérieur de la ville, dans un croisement de rues, bien au milieu, se dresse une pierre
ronde en marbre, pas plus haute que le sol d’alentour, sur lequel on marche ; d’ailleurs la ville ou les ruelles
ne sont pas pavées. C’est sur cette même pierre que saint Marc, cité précédemment aurait été décapité.
Non loin de là, dans une autre ruelle, un petit cachot en boue et en argile aurait été la prison de la vierge
Catherine. Juste en face, sur deux hautes colonnes en marbre rouge, selon la légende, le corps de cette
vierge Catherine aurait été exposé.
En haut, près de la muraille de la ville, en direction de la mer, on peut voir deux belles colonnes carrées,
l’une est renversée mais l’autre est encore intacte et debout ; elles sont au sommet toujours plus pointues,
hautes de quelques brasses ; le carré de base est épais d’environ quatre brasses et des caractères étranges
d’oiseaux et d’animaux y sont gravés, oeuvre juive ou égyptienne. On peut encore voir à Constantinople une
colonne de même forme et celle que le pape Sixte Quint a fait ériger devant l’église Saint-Pierre, sur la
place, est comparable, bien que rien n’y soit gravé ; elle est lisse et repose au bas sur un haut piédestal.
En dehors de la ville, à quelques milles romains en direction du levant, une autre colonne, appelée Colonne
Pompée, est à voir. Elle domine une petite colline en rase campagne, seule et isolée. Elle est ronde, de
même diamètre de haut en bas, posée sur une solide fondation, dont le piédestal sort de terre d’une hauteur
de deux hommes. Elle est surmontée d’un couronnement, ou bien de roses sculptées ; elle est très épaisse
et si haute, que quelqu’un a de la difficulté pour lancer à la main une pierre par-dessus. C’est un monolithe
extrêmement grand, dont je n’ai vu le pareil en aucun endroit. On peut se demander d’où aurait pu être
apportée une telle pierre. Quelques-unes veulent qu’elle ait été coulée ; c’est un mélange de pierres
rougeâtres et blanches. Cette colonne aurait été érigée par Jules César pour commémorer et faire connaître
sa victoire contre Pompée.
Dans la ville on n'ouvre pas plus de trois portes, deux donnant vers l'intérieur du pays et une vers la mer.
Vendredi est considéré comme leur jour de repos ou sabbat ; cependant ils ne travaillent pas moins,
seulement vers midi ils font leurs prières dans toutes les mosquées ou églises turques, et cela dure environ
une heure. Pendant ce temps, ils ferment les portes de la ville ainsi que celles de tous les Fondiques,
jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs dévotions. Les Fondiques sont fermés de l'extérieur chaque nuit par un
More et sont ouverts par lui le matin, de sorte que ni le consul, ni les commerçants ne peuvent en sortir.
On fait de même pour les bazars ou marchés, où toutes sortes de marchandises sont vendues et où les
boutiques ont leurs échoppes. C'est comme une large ruelle, bordée des deux côtés de boutiques et
couverte en haut pour qu'il ne pleuve pas dans la rue. Là, on peut acheter des marchandises diverses. Ce
marché est fermé en haut et en bas, pendant la nuit, par un More attitré.
À l'intérieur de la ville, il y a deux collines distinctes, pas très élevées ; sur l'une se trouve une petite tour
avec un gardien, jour et nuit, car de cet endroit, on peut voir loin en mer. Aussitôt qu'il aperçoit un bateau ou
une galère, il met un drapeau à l'extérieur de la tour, et il y a autant de bateaux ou de galères qu'il y a de
drapeaux.
Mais l'autre colline, à ce qu'on m'a dit, serait uniquement faite d'ordures ou de saletés qui proviennent des
maisons. Rien n'est plus vrai ; comme on peut s'en rendre compte à différents endroits, il n'y a rien d'autre
que des saletés ; aussi peut-on y trouver tous les jours de menus objets, qui se ramassent dans les maisons
en les balayant. Que la colline en provienne, je ne me prononce pas.
À l'intérieur et autour de la ville il y a quantité de beaux jardins avec des citrons, des limons, des oranges,
des grenades, des dattes, qui abondent en Egypte, et d'autres fruits divers. Mais comme ces fruits poussent
en des endroits sablonneux, où il pleut rarement et en été pas du tout, ils n'ont pas le même goût qu'ailleurs.
Il en va de même, non seulement pour les fruits, mais aussi pour les animaux et les volailles, parce qu'ils
n'ont pas du tout de pâturage.
Les limons sont bon marché ; pour un « medin » on peut en acheter 50 ou 60. Autour de la ville poussent
grand nombre de câpres, dont beaucoup sont exportées salées, dans de grands pots, à Venise et en
d’autres pays chrétiens ; ce sont de petits arbustes, hauts environ comme la moitié d’un homme ; le tronc
mesure un bras d’épaisseur et se partage en beaucoup de branches ou de rameaux. Ils poussent ça et là
dans le sable, comme chez nous les prunelliers ; les câpres étaient juste mûres pour être cueillies. On plante
aussi grand nombre de casses ; ces dernières poussent sur des arbres dans de très longues cosses.
Quand j’arrivai à Alexandrie, je vis beaucoup de bateaux dans le port, entre autres galions du Grand Turc,
qui étaient au nombre de 7, chacun pouvant porter près de 1500 tonnes. Ils viennent de Constantinople
jusqu’ici deux fois par an pour embarquer toutes sortes de marchandises, principalement de la nourriture,
dont la cour fait une consommation quotidienne. Ce sont de grands bateaux, puissants et magnifiques. Les
bateaux chrétiens ne peuvent aller là où ancrent les bateaux turcs, à côté du château ; aussi doivent-ils
mouiller plus haut, vers la ville. En ce qui concerne les galères, toujours au nombre de quatre et dont le
prince garde une pour son propre usage, elles mouillent de l’autre côté, à un endroit spécial, appelé le vieux
port, où il existe aussi un mauvais château, qui n’est en rien comparable aux deux autres. Un des châteaux
en particulier, situé à main gauche de la sortie, est bien fortifié, entièrement construit sur un rocher et en
grande partie entouré par la mer.
Pendant que je demeurais à Alexandrie, j’ai assisté aux festivités accompagnant la circoncision des garçons,
mais seulement au défilé.
D’abord, devant eux, marchent 20 ou 30 Turcs, tous armés et bien astiqués ; c’est magnifique à voir. Après,
suivent les enfants qui seront circoncis, au nombre de deux, trois, six et parfois davantage, vêtus d’habits
précieux en soie et parés de joyaux, montant de beaux et superbes chevaux. Chaque enfant chevauche
séparément et seul. Derrière eux suivent les différents instruments de musique : les tambours, les
trompettes, les tambourins, les chalumeaux et autres encore, qui sifflent et tambourinent dans toutes les
rues comme c’est la coutume chez eux. Car avant d’être circoncis, on les promène par-ci par-là dans la ville,
ensuite on les ramène à la maison où ils seront circoncis. Pour cet acte, ils n’ont pas de jour ni d’heure fixe ;
l’âge même des personnes n’entre pas en considération, car bien des enfants de deux ans, d’autres de dix
ou de moins d’années sont circoncis ; surtout s’il s’agit d’enfants chrétiens qui deviennent Turcs, ils ne sont
généralement plus tout jeunes.
(…)
Entre- temps, étant arrêté là, je recherchai de la compagnie pour le Caire, car on ne peut pas voyager dans
ces pays sans être accompagné, surtout lorsqu’on ne connaît pas la langue. J’appris alors que le
vice-consul de Venise désirait aller au Caire. Je l’abordai et lui demandai s’il voulait me laisser voyager à ses
côtés, ce qu’il m’accorda de bonne grâce. Sur ces entrefaites, je me préparai pour le voyage, donnai ma
caisse ainsi que d’autres affaires au majordome du Fondique français pour qu’il les garde.
Dans la soirée du 8 mai, au coucher du soleil, nous étions en selle dans le Fondique des Vénitiens, sur des
mulets de location, excepté le vice-consul qui avait un cheval. Notons ici qu’à Alexandrie et au Caire aucun
chrétien, à part les consuls, ne doit monter à cheval mais seulement à âne. Dans ce pays uniquement, c’est
interdit aux chrétiens, car à Constantinople, en Syrie et dans d’autres pays de Turquie, on ne fait pas de
différence ; aussi peut-on monter ce qu’on a sous la main. »
- 325 - 327 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS CHRISTOPH TEUFEL VON KROTTENDORF (du 19 au 26 septembre 1588)
Lichtenstein, H.-L. von, et al., Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588. H.-L. von Lichtenstein,
Samuel Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire,
1972.
Christoph Teufel, baron de Guntersdorf et d’Eckartsau, naît en Autriche en 1567. Il fait ses études à
l’Université de Padoue puis à Bologne et à Sienne. Il voyage de 1587 à 1591. Par la suite, il obtient une
charge à la cour de Rudolf II avant de servir comme officier sous Matthias et Ferdinand II. Il meurt en
1642.409
p. [147]-[151] :
« Nous entrâmes dans le port d’Alexandrie, le 19 [septembre] au soir ; d’ici à Constantinople, il y a 1200
milles. À notre entrée dans ce port, nous vîmes, à main droite, un château fort qui est là où, anciennement,
se trouvait Pharos, cette tour aux miroirs enchantés que j’ai déjà citée, dans lesquels on pouvait voir,
cinquante jours à l’avance, l’arrivée de toute armée qui venait avec l’intention de nuire au royaume d’Égypte.
Ce fut la raison pour laquelle les Égyptiens, voyant tant de jours à l’avance le danger qui se préparait, purent
éviter, grâce à leurs prévisions et préparatifs, l’attaque de toute armée.
À la fin cependant, le gardien de ce miroir fut enivré par un Grec et s’endormit ; le Grec brisa le miroir, et de
ce fait le royaume d’Égypte tomba par la suite entre les mains d’autres gens, le miroir ayant perdu son
pouvoir.
Le 20, nous tous, passagers du galion, voguâmes sur une petite barque jusqu’à la rive, où nos bagages
furent inspectés par les douaniers.
Ne trouvant aucune marchandise de quelque sorte que ce fût, ils nous laissèrent ; entrant dans la ville, nous
fûmes conduits au fondique de Venise, et ayant présenté nos lettres de recommandation au Vice-Consul,
nous fûmes logés dans une salle où parfois les pèlerins sont hébergés.
Alexandrie, ville de la troisième partie du monde, c’est-à-dire l’Afrique, est dans le Royaume d’Égypte, au
bord de la mer Méditerranée ; construite par Alexandre le Grand, d’où elle tire son nom, elle est appelée
aujourd’hui par les Turcs Scanderia ; tant de ruines, à l’intérieur et à l’extérieur de la ville, prouvent qu’elle a
compté dans l’Antiquité parmi les belles villes : encore de nos jours, on trouve tant de voûtes souterraines,
qu’on a l’impression que cette ville est placée plus sous terre qu’au niveau du sol ; elle est gouvernée par un
Sangiac ; c’est la résidence d’un des quatre patriarches Grecs : (Constantinople, Jérusalem, Antioche et
cette ville) ; le Patriarche qui y réside s’attribue le titre de "juge du monde", étant donné qu’un des
patriarches d’Alexandrie a résolu un litige qui opposait l’Empereur au Pape.
Il y a dans cette ville quatre « Fontiques » ; celui des Anglais, celui des Génois, le troisième des Vénitiens, et
le quatrième des Ragusains, car il arrive souvent des navires de ces régions et de diverses autres ; ce port
est en effet largement fréquenté par ces vaisseaux, l'entrée étant assez libre, puisque même les navires
génois peuvent y entrer.
Les antiquités que l’on nous montra furent celles-ci. D’abord, dans un monastère de Calogeri appelé
St. Saba, nous vîmes dans l’église une colonnette de marbre blanc, au-dessus de laquelle, dit-on, Ste.
Catherine a été décapitée ; dans la même église, nous vîmes quelques pierres, morceaux provenant, disentils,
de la chaire où St. Marc prêchait d’ordinaire. Puis dans la grande-rue, nous vîmes sortir de terre une
pierre ronde qui ressemble à l’extrémité d’une colonne, et au-dessus de laquelle ils prétendent que la tête de
St. Marc a été tranchée. Dans un autre endroit, également, dans la grand-rue, une cavité dans un mur en
forme de chapelle : ils disent que ce lieu a été la prison de Ste. Catherine. Pas très loin de là, deux colonnes
où Ste. Catherine fut suppliciée ; telles sont les reliques que l’on voit à Alexandrie.
Quant aux antiquités, on nous montra ensuite – à l’intérieur cependant des murailles de la ville – deux
colonnes carrées et pointues, dites aiguilles (obélisques), dont l’une se tient dressée et l’autre est couchée
par terre, avec certaines sculptures de différents signes, oiseaux, quadrupèdes, appelés lettres
hiéroglyphiques, sculptures vraiment très anciennes. Avant qu’on eût découvert l’écriture, on utilisait de tels
signes, dont on comprenait le sens ainsi qu’on peut lire dans le 1er chapitre de la "Selva di Lettioni" de Pietro
Messia. Et selon l’itinéraire du Juif Benjamin de Tudèle, ces deux colonnes sont l’épitaphe d’un roi enterré à
cet endroit, avant le déluge. À peu de distance de là se voient les ruines du Palais de Cléopâtre, aujourd’hui
entièrement détruit et hors de la ville, mais jadis au-dedans.
Nous vîmes aussi cette colonne, droite, haute et superbe, appelée colonne de Pompée, si haute et si digne
d’être vue, du fait qu’elle est taillée d’un seul morceau de pierre ronde. Ce grand capitaine, le grand
Pompée, citoyen de Rome, la fit dresser en cet endroit, pour perpétuer sa mémoire. Autour de cette colonne,
sur des buissons bas, poussent des câpres en abondance.
Le 26 [septembre], ayant pris congé du Vice-Consul, accompagnés d’autres marchands francs d’Alexandrie,
nous partîmes à dos d’âne – vu que les Égyptiens n’acceptent pas, aujourd’hui que les Chrétiens montent à
cheval, sauf cependant s’il s’agit d’un ambassadeur, prétendant que nous sommes indignes d’une telle
monture ; aussi les chrétiens en Égypte utilisent-ils des chameaux et des ânes. Étant à une distance d’un
mille de la cité, nous nous embarquâmes sur un bras du Nil, appelé Khalig ; nous fîmes cela pour la bonne
raison qu’après l’inondation du Nil ce canal devient rapide, s’emplit d’eau et abandonne la route ordinaire qui
va à Rosette ; cet itinéraire nous paraissait plus court et plus sûr, notre compagnie étant bien munie
d’arquebuses ; sans de telles armes, il est très dangereux de naviguer la nuit sur le Nil, à cause des Arabes
qui habitent ce royaume. »
409 Lichtenstein, H.-L. von, et al., Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588. H.-L. von Lichtenstein,
Samuel Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, présenté et annoté par
S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1972, p. [VI]-[VII].
- 328 - 329 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
REINHOLD LUBENAU (du 25 au 28 octobre 1588)
Lichtenstein, H.-L. von, et al., Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588. H.-L. von Lichtenstein,
Samuel Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire,
1972.
Né en 1556 à Königsberg en Prusse orientale, Reinhold Lubenau fait ses études à l’école religieuse, puis les
poursuit au service du médecin et apothicaire de cour Jacobus Montanus. C’est auprès de ce savant
personnage que Reinhold Lubenau reçoit à la fois une instruction variée et le goût des voyages. En 1586, il
accompagne l’ambassade que Rudolf II envoie à Constantinople pour payer le tribut à la Porte afin de
préserver l’empire des Habsbourg des attaques militaires turques. Il revient dans sa ville natale en octobre
1589 et occupe un poste de haut rang dans l’administration. Il meurt en 1631.410
p. [203]-[234] :
« Le 25 octobre au matin, nous aperçûmes de loin Alexandrie. Vers huit heures, nous laissâmes à notre
droite le débouché du lac Maréotis. Nous arrivâmes à un grand port, étendu, dans lequel peuvent rester en
sécurité une grande quantité de navires. Il est presque circulaire, son entrée est bien praticable. Le vieux
port est appelé Porta Veza, de la ville d’Alexandrie.
Il y avait cinq grands kraken, appartenant aux Turcs, qui (p. 204) étaient venus récemment de
Constantinople. Sur l’un d’eux se trouvaient Monsieur Hans Christof Teufel, baron de Gundersdorf en
Autriche, Monsieur Ge[o]rge Christoph Fehrenberger et Bastian Stahn, leur serviteur. Ils étaient venus de
Constantinople, comme je l’appris à Alexandrie, mais avait déjà fait le voyage du Caire, pour faire au-delà le
pèlerinage au Mont Sinaï.
Il y avait aussi dans le port deux autres kraken appartenant aux Vénitiens, et autrement beaucoup de
français et de bateaux grecs ; car les chrétiens doivent rester dans ce port et ne peuvent aller dans l’autre,
près de la ville. Mais je crois qu’aucun bateau ne vient dans ce dernier, à cause du grand danger d’entrer et
de sortir.
En outre, dans ce port mouillent toujours quatre galères ordineri, armées, appartenant au Bey, pour protéger
le port et escorter les bateaux.
Nous passâmes par le port et arrivâmes auprès d’un grand château ou palais, situé comme sur une île ; à
l’origine il dut y avoir une île, nommée Pharos, de construction ingénieuse. Située à main droite, elle est
maintenant rattachée au continent, la reine Cléopâtre l’ayant ainsi reliée à la terre. Au centre se trouve une
haute tour fortifiée.
(p. 205) Les galères tirèrent plusieurs coups de canon et envoyèrent des lettres à la forteresse. Ceux de la
forteresse répondirent par deux coups de canon et hissèrent leur banderole et leur drapeau. Nous passâmes
près d’un rocher, nommé encore aujourd’hui Chariophilius, à cause de son aspect pointu et de son
tranchant. Lorsqu’il fait un peu de vent, il est bien imprudent d’entrer et de sortir par-là. Dieu soit loué, au
nom de Dieu, nous entrâmes sains et saufs dans le port, et laissâmes à gauche un petit château sur un
rocher, autrefois nommé Anthirhodus. Maintenant, les Turcs l’appellent Môle, parce qu’il y a là un endroit
d’où l’on peut atteindre la terre avec de petites frégates ; et dans tous les ports les quais qui entourent en
partie le port et où l’on peut mouiller s’appellent Môle. En avant du port se font face deux châteaux pour le
protéger.
Description de tout ce qui est arrivé à Alexandrie, ce qu’il y a à voir, ce que font les marchands ; l’état actuel
de la ville et sa situation, ses édifices et tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur cette ville
Ce port a une entrée étroite et dangereuse ; devant lui beaucoup de rochers et de récifs émergent en partie
de l’eau, d’autres sont immergés, auxquels les bateliers et les pilotes doivent faire bien (p. 206) attention.
Nous avons jeté l’ancre sous l’arsenal. Comme les galères mouillent dans ce port, l’arsenal y est tout près.
La mer monte jusqu’à la porte de la ville et amène quantité d’algues et toutes sortes d’ordures, à tel point
que les caves en sont remplies.
Le général ou Grand Pacha se rendit tout droit chez le nouveau Pacha, qui l’attendait ici. Après le repas,
j’allai en ville avec le Deli Mehemet et le renégat anglais, d’abord au Fondique des Vénitiens, où le Deli
Mehemet était connu, et où il avait à remettre au consul quelques lettres du Baile de Venise, installé à
Constantinople.
Le consul et les autres marchands italiens nous reçurent magnifiquement et après le repas nous partîmes.
Nous allâmes voir un Allemand, nommé Affion Kochet, qui habitait Porte Babisuel. Il avait une échoppe avec
toutes sortes de choses ; il n’avait qu’un oeil ; je fus son client. Il m’emmena voir le consul français et de
nouveau le consul vénitien, chez lequel (p. 207) j’avais été déjà auparavant. Cet Affion annonça au consul
vénitien que j’étais un pharmacien, venant de Constatinople. Affion avait un beau livre d’or, dans lequel il me
montra [les noms de] beaucoup d’hommes, qui m’étaient connus et qui a une époque étaient passés à
Alexandrie et y avaient inscrits leurs noms : le comte Henrich von Thurm ; Hector Ernauer ainsi que
Christophoro Wexio, son précepteur ; le comte Henrich Mathias von Thurm, Rudolph Gall ; Carl Nutzel,
Ambrosius Tesmar, Christophorus Radziwil, Hans (p. 208) Christoph Teufel von Gundersdorf, Ge[o]rge
Christoph Ferenberger, Christoph von Wallenfels, Wolf Christoph von Rotenhan, Hans Ludwich von Munster,
Hans Ludwig von Lichtenstein, Salomon Schweiger, Bernhardt, baron de Herberstein, Adam von Schlieben,
Wolfgangk Bachelbel et d’autres.
Dans les Fondique des Vénitiens, chez le consul il y avait un médecin allemand, né à Trieste, Octavianus
Roboreti. Ce jeune homme m’offrit une feuille de palmier, dure comme de la corne et un morceau de bois de
cèdre, que je pris avec moi et que je garde encore. La feuille a deux aunes de long ; et aussi le morceau de
bois qui s’est pétrifié ; car en Égypte, il existe un endroit dans le désert, où tout bois qui pousse sur le sol se
pétrifie.
Le jeune médecin Octavius Roboreti m’accompagna pour visiter la ville. Nous emmenâmes avec nous un
renégat allemand né Hans de Beuren, qui se faisait d’habitude passer pour interprète. Nous allâmes aussi
chez un vieux Croate nommé Scander, pouvant me parler en polonais assez bien pour que je puisse le
comprendre, et bientôt nous nous trouvâmes des (p. 209) connaissances. Mais les Français, là-bas, sont
des filous, auxquels on ne peut se fier.
En parcourant la ville, je commençai tout d’abord par ce qui me tenait le plus à coeur. Le consul vénitien
s’appelait Signore Aloisyus Donato ; lorsqu’il apprit que j’étais pharmacien, il me pria de venir chez lui et me
montra des corps entiers de momies, beaucoup de pierres de bezoar, des pierres d’aigle, des pierres
d’astres, pierres de serpents, qui remuent quelquefois, si on met des gouttes de jus de citron acide. Le
consul nous fit savoir que les bateliers ne voudraient pas prendre de momies dans le bateau ; il fallait donc
les cacher sous la (p. 210) marchandise, pour que les bateliers ne l’apprennent pas, et ne viennent pas à les
voir.
Il me montra aussi quelques produits nouveaux, que ni lui ni moi ne connaissons. Ils lui étaient envoyés des
Indes Orientales et d’ailleurs, et il désirait ensuite les faire parvenir à Venise. Il me demanda si je les
connaissais moi-même.
Nous sommes restés là le 26 et le 27 octobre, de sorte que j’eus suffisamment de temps pour voir la ville.
Quelqu’un vint me voir avec une noix indienne pleine de stirax liquide (p. 211) clair comme de la
térébenthine chypriote ; il avait aussi du grain de stirax-calamite, clair comme de l’ambre, environ deux
onces [encore en ma possession], pour lesquelles je donnai un ducat.
Le consul me montra deux sortes de baumes. L’un obtenu de feuilles de baumier distillées, était rouge
foncé, presque noirâtre. L’autre était jaune pâle et coulait de saignées faites sur les arbustes dans les jardins
de Matariéh, près du Caire ; il est estimé très cher.
D’autres choses avec lesquelles j’aurais pu probablement gagner de l’argent m’avaient été apportées dans
la galère ; mais l’argent me manquait et je ne savais pas encore comment je pourrais sortir du pays. Pour
cela, j’économisai soigneusement le peu que j’avais.
Les Arabes vendent aussi ici de la "thériaque", nommée encore "thériaque alexandrine", estimé plus chère
que celle de Venise. Les vipères se trouvant également en Égypte, les Turcs, les puissances chrétiennes, et
les légats ne tiennent (p. 212) rien en plus haute estime que la "thériaque alexandrine", "le baume de la
Matariéh" et "la terre de Lemnos". Les beaux chevaux, les tapis, les objets précieux sont, à côté, des
cadeaux qui ne sont pas autant considérés.
Dans cette ville d’Alexandrie on peut voir encore les grands murs d’enceinte doubles, construits comme ceux
d’Alexandre le Grand, avec de nombreuses tours en pierres de taille. La ville s’appela d’abord No, ensuite
Racasta ; elle fut agrandie par Alexandre, dans l’année du monde 3629 (l’an 338 av. J.-C.), et fut appelée
Alexandrie. En raison des possibilités qu’elle offrait, par mer et par terre, Alexandre eut une grande
prédilection pour elle, et quand il mourut à Babylone, c’est à Alexandrie qu’il fut enterré.
Il a entrepris aussi de creuser un canal, de la Mer Rouge jusqu’au Nil, et il y dépensa une grosse somme
d’argent ; mais il mourut et le canal resta inachevé. Certains supposent que Sesostris aurait commencé le
canal ; mais comme le pays est très bas, Darius n’aurait pas voulu l’achever de peur que la Mer Rouge
n’inonde l’Égypte. Par la suite les Ptolémées l’achevèrent, d’une grande largeur et d’une grande profondeur,
(p. 213) pour que les bateaux de transport puissent y naviguer ; mais sans lui donner d’écoulement à la mer.
La ville a perdu de sa renommée ; le commerce a diminué ; car les épices, les perles précieuses, les soieries
et toutes les marchandises chinoises et indiennes qui auparavant parvenaient, par la Mer Rouge et le Nil, à
Alexandrie, puis à Venise et ailleurs, passent maintenant à Lisbonne par la mer, en contournant l’Afrique. Si,
après cette époque, les consuls vénitiens et français, qui ont leurs Fondiques, leurs magasins et d’autres
libertés accordées par l’Empereur Turc, n’étaient pas demeurés ici avec leurs serviteurs, ainsi que les
agents et les entrepôts de ces deux nations, l’existence dans cette ville aurait été misérable. Cela contrariait
beaucoup les Turcs et bien plus encore les Vénitiens, qui étaient devenus riches et puissants grâce à cette
ville : maintenant, avec la découverte de la route de l’Espagne par le Cap de Bonne-Espérance les pertes
des Turcs et des Vénitiens sont considérables, et d’autant plus que les Hollandais, les Anglais, les Français
et d’autres nations l’utilisent.
(p. 214) Les pèlerins et les chrétiens étrangers se rendent chez les consuls, pour être protégés. Leur
protection n'est pas toujours efficace, car si les hauts fonctionnaires turcs, les pachas, les soubassa, les
Sanjak beys, les beys et autres racailles peuvent s'approcher des étrangers pour les punir, ou trouver
quelque prétexte pour les détrousser, ils ne le manquent pas. Particulièrement ici et dans toute la Barbarie,
la Syrie, et l’Égypte, qui sont loin de Constantinople, on ne peut pas se plaindre aussitôt à la cour impériale ;
aussi les pauvres pèlerins doivent-ils se saigner souvent pour pouvoir poursuivre leur voyage ; ils sont
obligés de payer pour des choses dont ils n’ont pas la moindre connaissance. Si l’on porte plainte, les
coupables doivent payer de leur tête. Je pourrais citer des cas qui se sont présentés, alors que j’étais dans
la ville.
Dans cette ville a habité, en 130 après J.-C., Claude Ptolémée ; astronome excellent, érudit et expérimenté,
il a mis le monde dans des tables géographiques ; et beaucoup [d’autres] hommes distingués, sages et
savants.
La Bible y fut traduite de l’hébreu en grec, en l’an du monde 3684 (283 av. J.-C.). L’évangéliste St. Marc
prêcha ici l’évangile douze ans après l’ascension du Christ et fut le premier chef de l’Église alexandrine ;
c’est là également qu’il écrivit son évangile, (p. 215) en langue grecque, et qu’il mourut. Dans une large
ruelle, on montre une pierre ronde en marbre blanc, enfouie dans la terre, sur laquelle l’évangéliste St. Marc
aurait été décapité en 64. Avec un grand recueillement les Italiens m’indiquèrent aussi un autre lieu où Ste.
Catherine aurait été décapitée, ainsi que la prison où elle aurait été martyrisée. Un belle église, construite en
l’honneur de Ste. Catherine, existe toujours, mais actuellement dans un bien triste état ; elle appartient
encore au patriarche. Dioclétien l’a dévastée en 293. Cette église a été récemment spoliée et dépouillée par
les Mores ; mais sur l’ordre de l’empereur turc Amurathi, qui demeura ferme au sujet des Chrétiens, ces
Mores furent contraints de la reconstruire à leurs frais. Ce qui, pour des païens, est un grand miracle.
Le corps de St. Marc fut emmené ensuite à Venise et une très grande église fut construite, appelée
St. Marc ; son tombeau, d’un grand art, existe derrière l’autel. Les Vénitiens mettent (p. 216) tous leurs
revenus afin d’honorer St. Marc, et les personnages officiels s’arrogent le titre de "provediteurs" de St. Marc,
ce qui est assez connu des gens qui voyagent à travers différents pays.
Il existe aussi dans cette ville une église St Marc dans laquelle sont enterrés de nombreux princes
allemands, des comtes, des barons et les corps des gens du peuple qui sont venus en ce lieu et y sont
morts.
St. Athanase qui composa le beau "symbole", fut évêque ici en 329 ; d’autre part, la ville fut célèbre à cause
de son immense bibliothèque, qui brûla finalement en 45 av. J.-C. De nombreux écrivains ont écrit que
quatre fois cent mille livres y auraient été exposés par Ptolémée Philadelphe. Le grand prêtre Eléazar avait
envoyé 72 savants pour traduire la Bible en langue grecque. Jésus Syrach a séjourné ici et à (p. 217)
l’époque du Christ existait une grande école distinguée ; ceux de cette école ont participé à la condamnation
à mort d’Etienne.
En ce qui concerne l'intérieur de la ville, il est maintenant presque inhabité. Les maisons sont toutes
construites en marbre, sans toit mais plates et les murs sont exhaussés d'une demi-hauteur d'homme, pour
qu'on puisse se pencher par-dessus sans tomber. Comme c'est le cas dans tout l'Orient, quelques maisons
sont même ouvertes en haut avec seulement quatre murs, parce qu'il ne pleut pas ou très rarement. J'ai vu
environ deux ou trois ruelles qui sont encore bien construites. Les autres bâtiments et palais tombent en
ruines et comme il fait cruellement chaud, la plupart des gens construisent leurs habitations près du grand
château sur la place du Phare, car au bord de la mer il y a un bon vent. La reine Cléopâtre a rattaché Pharos
à la ville par une digue, nommée Heptastadion. Elle mesure sept stades, ce qui fait presque un quart de
mille allemand et on peut y aller à pied sec.
Ici, le manque d’eau est grand. La ville n’est pas très élevée par rapport à la mer. Un grand canal vient du Nil
jusqu’à la ville. Sur son bord, il y a de beaux jardins avec des palmiers, (p. 218) des orangers, des
citronniers, des grenadiers, des pommes d’Adam, une sorte spéciale de figues appelée sycomori en latin, et
un fruit, que les gens appellent Musam. L’arbre mesure une brasse et demie de haut. Les feuilles ont
presque chacune une brasse de long et une largeur de deux empans. Le tronc, gros de trois empans, est
plein d’eau. Le fruit est sucré et vert, presque comme une grosse prune verte, sans noyau. Lorsqu’il est mûr,
la sève coule auprès de la petite tige et tombe par terre, ainsi se fait sa fécondation. En haut sur sa tige, il a
seulement quelques fleurs bleues, grandes comme une rose.
Quand le Nil monte, se répand et déborde, il inonde les jardins, qui deviennent ainsi très fertiles. Alors, les
chevaux de mer sortent du Nil pour aller dans les jardins. Ils ont une grande tête rugueuse, sans cornes, des
poils marrons foncés, de petits pieds avec de gros sabots et de gros doigts de pieds, comme en ont les gros
cochons, seulement beaucoup plus grands. On les appelle en latin hippopotami. Leur taille n’est pas
inférieure à celle d’un éléphant ; ils sont également sans poils, avec de petites oreilles pointues ; les autres
membres sont, comme chez le cochon, brunâtres. Si le temps est calme, ils vont sur la terre, font beaucoup
de dégâts dans les jardins, mangent les plantes et même les hommes, s’ils en rencontrent. Mais ils ont peur
du feu, et si les gens se rendent comptent qu’ils se dirigent vers les jardins, ils y font un feu ; alors ils ne
viennent pas.
(p. 219) Ce canal est creusé, et vers le mois d’août, quand le Nil déborde, l’eau arrive dans toutes les ruelles
et les maisons de la ville d’Alexandrie. Il y a de grandes citernes où l’on peut garder l’eau pendant un an.
Souvent les gens doivent quitter la ville par suite du manque d’eau, car le canal du Nil est asséché. Mais
lorsque le Nil a débordé ainsi, et que le canal est plein d’eau, de petits bateaux viennent du Nil jusqu’à
Alexandrie par le canal et le reste de cette eau se jette dans la mer au vieux château.
Par suite du manque d’eau, le pacha et sa cour doivent parfois séjourner au Caire. Si le patriarche
d’Alexandrie se tient aussi au Caire, il laisse seulement un vicaire à Alexandrie. Pendant cette période, un
Sanjak bey tient la cour à Alexandrie. Les galères et la grande armada en particulier, ne doivent pas mouiller
ici plus de deux ou trois jours, à cause du manque d’eau ; autrement ils seraient obligés de chercher de l’eau
douce à dix milles de là, à Rosette, avec des petits bateaux. Plusieurs citernes, des puits et des aqueducs
sont dans les ruelles, pour conserver l'eau en cas de besoin ; mais la plupart se trouvent dans les maisons
et enterrés.
Quand le pacha est présent, il réside dans le château, sur l'île de Pharos. Le reste du temps s'y tient le
Sanjak bey. Ce dernier (p. 220) possède également une maison particulière en dehors du château, sur la
place de Pharos.
Dans la ville, j'ai trouvé le pied d'une statue, sur lequel était écrit :
Ego Isis sum Aegipti regina, a Mercurio erudita
Quae ego legibus statui nullus solvet.
Ego sum mater Osiridis, ego sum prima frugum inventrix,
Ego sum Ori regis mater, Ego sum in astro canis refulgens
Mihi Bubastia urbs condita est.
Gaude gaude Aegipti quae me nutristi411.
Juvénal et aussi Lucien mentionne cette Isis. Elle aurait été une fille d’Inachos, le roi de Grèce, prise en
mariage par le (p. 221) roi d’Égypte et qui reçut le nom d’Isis. Après sa mort, le peuple l’a tenue pour une
déesse, l’a adorée et lui a régulièrement sacrifié une oie ; ce sacrifice se nommait Isiaca. En dehors du
Caire, quand on va à cheval aux pyramides, on voit son image en pierre, d’une grande dimension. La tête
mesure une hauteur de trois hommes et huit brasses de circonférence. Cette tête est creuse et un souterrain
secret y conduit. Les prêtres païens entraient par ce souterrain pour parler par la tête, et les gens ont cru
que la tête parlait. Ainsi ont-ils été dupés. La tête s’appelle encore "Imago Isidis".
Pareillement, un énorme obélisque est à voir, non loin de l’eau, semblable à celui de Constantinople sur
l’Atmeïdan. Il est en marbre rouge, alors que celui de Constantinople est gris et en pierre dure. Toutes sortes
de caractères étranges y sont gravées, qui, comme on le dit, seraient des lettres égyptiennes. La partie
inférieure est presque recouverte de terre ; hors de terre il mesure quelque trente aunes de haut. Non loin de
là, un obélisque brisé est couché par terre, mais moins (p. 222) grand. A côté de la mer se trouve enterré un
palais magnifique avec des murs et des colonnes tout en marbre. Il devait être superbe autrefois ;
maintenant il est presque entièrement détruit et tend à disparaître ; la mer l'a recouvert de roseaux. Deux
grandes (p. 223) colonnes en marbre rouge sont debout dans une ruelle. Au pied de la plus grande,
qu'Alexandre le Grand, dit-on, fit ériger, se trouvent les caractères grecs, suivants : DHMOKRATHS PERI
KAI TOS ARCITEKTOS ME ORQOSEN DIA ALEXANDROU MAKEDONOS BASILEIOU.
Auprès de l'enceinte de la ville se dresse une grande tour ronde avec un beau palais en marbre, dans lequel
la reine Cléopâtre eut sa demeure. Quelques esclaves m'ont dit qu'il aurait été le palais du roi Alexandre le
Grand.
Sur une colline de la ville, il y a également une tour de garde, construite de main d'homme. Les veilleurs
doivent toujours y planter au-dehors de petits drapeaux, pour indiquer combien de navires ou galères
arrivent de la mer dans les ports. Beaucoup de beaux et vieux palais et édifices sont enterrés, pour (p. 224)
la plupart en ruines. Il y a presque plus de constructions sous terre qu’au dehors de terre. Je suppose, que
les gens s'y tenaient en été à cause de la grande chaleur.
De la grande colonne du grand Pompée, des fours dans lesquels sont couvés les poulets, du lac Maréotis et
des animaux de toute sorte qui sont vendus à Alexandrie
À environ un quart de mille en dehors de la ville, se trouve sur une grande colline la colonne du Grand
Pompée, de couleur cendre avec des taches rouges ; au-dessous, le piédestal est carré et tout entier de
couleur cendre, mais sa colonne est ronde, presque comme celle du "Pont-Euxin", à cette réserve près que
le piédestal de celle du "Pont" à Constantinople est rond et que, comme la colonne, il est blanc comme la
neige. Celle d’Alexandrie est beaucoup plus haute, avec au sommet un chapiteau rond d’une grande
épaisseur de trois ou quatre brasses ; et avec son piédestal elle mesure plus de quatre-vingt aunes (p. 225)
de haut. C’est un grand prodige, comment on l’a amenée et dressée sur la colline ; cela a dû coûter un
argent inouï. On dit que Jules César l’aurait fait ériger en mémoire de sa victoire sur Pompée. Quelques-uns
pensent, chose également croyable, que Pompée lui-même l’aurait placée là, car il avait l’habitude de fonder
un mémorial, lorsqu’il avait conquis un pays. Ainsi fit-il au Pont-Euxin, près de Constantinople, lorsqu’il
vainquit Mithridate, le roi du Pont.
Non loin de la colonne, sur une autre colline, se trouve une belle mosquée turque. Non loin de là, dans une
ferme, j’ai vu un four, dans lequel on couve les poussins. Comme je l’appris, ils ne sont pas tous faits de la
même manière, mais je n’ai pu voir que celui-ci. Vous devinerez que je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de
courir en dehors de la ville. Je devais tout me procurer auprès des janissaires avec de l’argent, et je n’en
avais pas beaucoup. Le général me permettait de quitter la galère à toute heure. On m’affectait chaque fois
un janissaire ou un autre soldat, qui m’accompagnait. Ils le faisaient de bonne grâce, parce qu’ils y
gagnaient un pourboire.
Ces fours sont en général dans les fermes et ces dernières en retirent un grand revenu. Celui-ci était rond,
tressé avec de la (p. 226) grosse paille de riz ou de cotonnier, dont je n’avais pas encore vu d’exemple en
Égypte. Il était enduit de crotte et de limon et divisé en son milieu. En haut de la partie supérieure se trouve
un trou rond, pour que les rayons du soleil n’aillent pas tout droit sur les oeufs, qui sans cela seraient cuits, à
cause de la chaleur. En effet, il fait tellement chaud en Égypte, qu’on ne peut même pas aller pieds nus.
Mais les habitants y sont à ce point habitués que j’ai vu des gens, en particulier les esclaves sur les galères,
ou encore les chameliers, qui avaient le devant de la jambe et la plante des pieds si gercés, que la graisse
en sortait, sans qu’ils y prêtassent attention. La plante de leurs pieds est tellement épaisse, qu’ils ne sentent
pas quand on tape sur eux. Au midi, le four avait une petite porte, par où sont introduis les oeufs ; au nord,
un autre trou est ouvert pendant la journée, mais fermé la nuit avec du fumier de buffle, pour que le four
reste chaud à l’intérieur. Comme ils utilisent pour tout des buffles, il y a suffisamment de fumier. Pendant la
journée, le soleil chauffe la crotte et le limon, de sorte que les oeufs ne sont pas gâtés par le froid de la nuit.
Le limon et la crotte collés sur la paille sont assez épais et conservent ainsi la chaleur qui passe à travers la
paille dans le four ; c’est comme si une poule était assise sur les oeufs.
Les oeufs sont rangés sur le sol en terre battue, en prenant soin qu’ils ne se touchent pas, et les poussins
sortent rapidement, (p. 227) sans que les poules aient eu à les couver. Ils obtiennent ainsi une si grande
quantité de poulets que les bermes entières en sont remplies et envoyées à Chypre. J’ai déjà noté que
presque chaque fermier possède un tel four dans sa ferme ; il en retire de gros intérêts. Des oeufs lui sont
donnés en comptent. Un four de ce genre, s’il a une certaine grandeur, contient une grande quantité d’oeufs,
et les fermiers reconnaissent bientôt les oeufs qui ne donneront rien. Ils les renvoyent à ceux qui les ont
apportés. Nos fermiers ne se donneraient pas autant de peine. Comme les poules ne couvent pas, elles
pondent d’autant plus d’oeufs.
J’ai appris qu’on ferait même du feu à l’intérieur ou autour du four, mais je ne l’ai pas vu ; dans ce four, il n’y
avait pas de feu, et à l’époque je n’ai pas pensé à le demander ; je le décris comme je l’ai trouvé.
Dès lors, l’automne était bien avancé, mais il faisait si chaud, qu’on résistait avec peine. Qu’est-ce que cela
doit être en plein été. J’ai appris aussi que les Égyptiens ne mangent pas d’oeufs ; je n’en ai jamais vu en
manger, encore moins en vendre ; ils doivent avoir pour cela quelque répugnance. À (p. 228) cause de cela,
les poulets sont très bon marché. On ne les laisse pas beaucoup grandir et on garde seulement les plus
grands pour la reproduction. J’en ai vu quelques-uns non loin de la colonne Pompée ; mais il doit y en avoir
beaucoup au bord du Nil, où habitent la plupart des fermiers. Un singulier écrivain aurait reproché aux
Égyptiens de manger des poulets couvés dans de la crotte !
Le lac Maréotis est non loin de là. Il est poissonneux, riche en petits et grands poissons et un canal du Nil s’y
jettent. Le Nil déborde tous les ans à une certaine époque avant la St. Jean, et inonde le pays tout entier de
ses eaux troubles. La quantité de poissons augmente, lorsqu’il se répand, et l’eau s’écoule ensuite dans la
mer. Si l’année et sèche et non fertile, ce qui se produit lorsque le Nil ne déborde pas à une hauteur
suffisante, aucune eau n’arrive du canal dans le lac Maréotis et sur l’autre côté se trouve le désert de
Saint-Macaire et ensuite, le désert de Saint-Antoine avec beaucoup de monastères, habités par les Caloiris
arabes qui ont presque la même religion que les Grecs.
Ce désert est couvert de palmiers et de myrtes. Ils n’ont en Égypte pas d’autre bois et ils font la cuisine avec
la bouse (p. 229) de buffle et de chameau séchée. Ils enlèvent l’écorce extérieure des palmiers ; l’intérieur
se présente comme du bois pourri. Ils le sèchent au soleil après quoi il brûle sans flamme comme de
l’amadou. Dans le désert poussent aussi beaucoup de tamaris, de sorte que les gens peuvent se mettre à
l’abri de la chaleur. Le désert arrive presque jusqu’à "Cachabar" et St. Antoine s’y était installé comme
ermite.
À Alexandrie toutes sortes d’animaux sont à vendre : plusieurs espèces étranges de singes, babouins,
macaques, de jeunes léopards, de jeunes lions, des panthères et des tigres, tous capturés près d’ici ou dans
le reste de l’Afrique et amenés ici au marché. Il y a aussi beaucoup d’espèces de perroquets, perruches et
oiseaux de paradis, des rats de pharaon, des civettes, des ichneumons qu'on trouve dans presque toutes les
maisons, parce qu'ils attrapent les souris et les rats plus rapidement que les chats. Il existe aussi bien
d'autres choses étranges : plusieurs espèces de coquillages, de la vaisselle en porcelaine, (p. 230) coupes,
plats et aiguières, de la vaisselle à boire venant de Chine et des Indes par la mer Rouge, des oeufs
d'autruches, en grande quantité, car on tue les autruches dans le désert ; des perles, des pierres précieuses,
toutes sortes d'épices et de drogues. Chaque jour tout cela est apporté en grande quantité aux bateaux par
les chrétiens.
J’ai vu aussi dans le château du Pacha, plusieurs autruches vivantes et la peau d’un crocodile terriblement
grand ; sa mâchoire ouverte avait ma taille. La peau du crocodile considérée ici comme une merveille ;
beaucoup d’entre eux sont capturés dans le Nil.
On rencontre là toutes sortes de nations qui existent sous le soleil, des Indiens, des Perses, des Arabes, des
Turcs, des Tartares, des Juifs, des Mores, des Abyssins du pays du prêtre (p. 231) Jean ; toutes sortes de
chrétiens, des Grecs, des Anglais, des Hollandais, des Italiens, des Français et des Coptes, qui sont des
chrétiens qui se font circoncire et sont appelés Christiani della cintura – de la ceinture, Jacobites, de Jacob
l’hérétique. Un patriarche grec, qui séjourne en grande partie au Caire, habite ici.
Beaucoup de marchandises sont encore apportées d'Ormuz, de la Mecque et des Indes par la mer Rouge,
et ensuite par le Nil : des perles, des pierres précieuses, toutes sortes de matériaux. Il y a également un
grand commerce de sucre, de dattes, de casses venant de Damiette, de feuilles de séné, de grands sacs
comme des sacs en laine, mais tressés avec de la paille de riz. Près de la colonne de Pompée, j'ai acheté
chez un Arabe plusieurs pierres d'aigle. Dans cette région, le riz pousse en grande quantité, mais il n'est pas
transporté dans les pays chrétiens ; il n'est pas blanc, plutôt gris-cendre. J’ai bien observé que plus un pays
est chaud, plus le riz est noir. Pour cette raison, le riz qui pousse autour de Milan est le plus beau et le plus
blanc ; même à Valence, il n’est déjà plus aussi beau.
D’ailleurs ce n’est pas la peine de décrire la fertilité de l’Égypte, car chacun sait qu’elle est le grenier du
monde entier, et que (p. 232) Constantinople ne pourrait pas subsister sans elle. La Sainte Écriture nous
rapporte que lorsqu’il y avait une famine dans le monde entier, l’Égypte avait des grains en abondance et
cela grâce au Nil, qui inonde le pays, bien qu’il ne pleuve jamais. Aussi déjà des rois y régnèrent avant
l’époque d’Abraham. Osiris, père d’Hercule aurait inventé le premier l’agriculture en Égypte. L’Égypte assure
le ravitaillement de constantinople en riz et en grains.
La ville d’Alexandrie est nommée Scamandria par les Turcs, Bardamassar par les Arabes, du mot bar = le
pays, et massar : le petit-fils du patriarche Noé, c’est-à-dire de Misraïm qui était un fils de Ham. De ce
Misraïm le pays a gardé le nom arabe jusqu’à nos jours. Ce Misraïm aurait été le premier à construire la ville
d’Alexandrie, la nommant Noa ou No. Plus tard, elle a été agrandie et appelée Racosta, jusqu’à ce
qu’Alexandre l’ait construite comme elle est maintenant et appelée de son nom.
Amasis donna l’ordre, en Égypte, que chaque citoyen rende compte de ses ressources et s’il vit
malhonnêtement, il est puni de mort. Solon d’Athènes fit déjà une loi semblable et quand le temple de
Delphes brûla, Amasis, cité ci-dessus, donna pour sa reconstruction de l’alun d’une valeur de mille talents.
Les Égyptiens en donnèrent autant, c’est dire quelle quantité d’alun se trouve en Égypte.
(p. 233) Les bateaux font deux fois par an le trajet de Constantinople à Alexandrie. Partant pour la première
fois en mars, ils retournent en juin, puis repartent après en août, parce qu’à cette époque il y a
habituellement le vent du nord. Ils retournent en octobre, mais attendent toujours le général avec les galères
pour être protégés des Maltais et des galères chrétiennes ; d’ailleurs cette fois-ci, cela se passe ainsi.
Soliman, l’empereur turc, prit cette ville ainsi que toute l’Égypte en 1517. Deux kraken, chargés de riz, de
dattes et d’autres marchandises voulaient faire voile vers Constantinople, mais ils devaient attendre nos
galères, car un bateau qui traîne en route tombe aux mains des Maltais.
Comme je l’ai déjà dit, la ville est en ce moment gouvernée par un Pacha qui réside surtout au Caire, et la
justice est rendue par les Cadis. En outre, l’empereur turc a nommé, dans toute l’Égypte 22 Sandjak-beys,
qui font office de police, 3000 janissaires et 4000 saphis ou cavaliers, avec une solde permanente, pour la
protection du pays. L’Égypte rapporte à l’empereur turc six cent mille ducats par an. Ils lui sont envoyés à
Constantinople fin septembre, quelquefois par voie d’eau si les (p. 234) circonstances s’y prêtent, comme ce
fut le cas cette fois-ci. Si la guerre menace sur la mer, l’argent doit prendre le long chemin de terre,
accompagné de trois cents cavaliers et de deux cents janissaires. L’argent est rassemblé au Caire et gardé
pendant l’année.
Vers le matin, le 28 octobre, nous avons quitté le port avec toute l’armada. »
- 330 - 336 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACQUES DE VILLAMONT (du ? mars au 22 mars 1590)
Vénitien anonyme, et al., Le voyage en Égypte des années 1589, 1590, 1591. Le Vénitien anonyme, le
Seigneur de Villamont, le Hollandais Jan Sommer, par C. Burri et S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1971.
Jacques de Villamont, originaire de Bretagne, naît vers 1558 et meurt vers 1625. Dans la préface de de son
récit de voyage, il se présente en tant que militaire. Il ferait partie des gentilshommes attachés à François de
Carné, gouverneur de Morlaix. Il est intéressant de noter que dans la première édition datée de 1595, il est
mentionné « gentilhomme de Bretagne » alors que dans celle de 1600, on lit « gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roy ». Le périple de Jacques de Villamont dure plus de trois ans, de juin 1588 à septembre
1591.412
p. [232]-[243] :
Ample description de la cité d’Alexandrie en Egypte, & de ses aiguilles admirables, ensemble les
descriptions de la Giraffe, de l’Elephant, du Chameau, & de plusieurs choses advenues sur mer
« La cité d’Alexandrie fut jadis edifiee (comme chacun sçait) par Alexandre le grand, sur les bord de la mer
Mediterranee. S’estant toujours maintenuë en sa beauté et splendeur, jusques à ce qu’elle vint sous la
puissance des Mahumetans, où elle commença à décliner peu à peu & tomber en ruine, comme elle se void
à present, & n’estoit quelle est situee le long de la marine, & que la plus part de tous les vaisseaux
d’Occident qui vont en Egypte y prenne port, pour la commodité d’un des bras du Nil, qui en est peu distant,
je croy qu’elle demeureroit sans estre aucunement habitee, à cause du mauvais air qui y regne.
Elle est situee en lieu fort sablonneux, bastie de forme carree & encore environnee de ses deux anciennes
murailles, qui sont de grand circuit esquelles y a quatre portes principalles, couvertes de lames de fer,
sçavoir celle qui est vers le levant, & du costé du Nil, nommee porte du Caire, l’autre qui est su costé du
ponant, & qui conduist aux grands deserts de Barca, & de Sainct Machaire, qui s’appelle la porte de Barca
ou des deserts. La troisieme se nomme porte du Pepe : ceste-cy est situee vers l’Affrique & le Midy, &
conduist droict au grand lac de Bouchiara, dit autrement Mareotis, distant d’Alexandrie d’environ demie
lieuë. Ce lac est de grande estenduë, & de tres-grand revenu en poisson. La quatrieme est dicte porte de
Marine, pour ce qu’elle est assise sur le bord de la mer. A ceste-cy demeurent ordinairement les gardiens de
la douanne, lesquels sont establis par le grand Turc pour recevoir les daces413 & gabelles de toutes les
marchandises qui vont et viennent par terre et par mer prendre port à Alexandrie, soit des Indes, d’Arabie
heureuse, de Genes, Venise, Angleterre, Marseille, Raguse en Sclavonie, Constantinople, Barbarie, Sicile, &
autres lieux du monde. Car le port est tresseur, & hors le peril des corsaires & mesme fort commode pour le
trafic du grand Caire, & de tout l’Orient.
Ce port est divisé en deux par une petite isle laquelle (si j’ay bonne souvenance) Caesar nommoit Pharus,
qui maintenant est joincte à terre ferme, & aux murailles de la cité, de maniere que venant faire deux
poinctes du costé d’Orient & d’Occident, se viennent joindre presque à deux autres poinctes qui sont fort
avancees en plaine mer, laissans au milieu d’elles, deux embouchemens pour entrer dans lesdits ports,
lesquels sont faicts quasi en forme d’ovalle. L’un est appelé Porto Vecchio, qui n’a aucun château pour sa
deffense, sinon du costé de la ville une maniere de chasteau, dit castel Vecchio. Sur les deux pointes qui
sont à l’embouchure de l’autre port, sont deux chasteaux assez forts & tenables, appellez Pharillons, mais
mal-aisez & incommodes, à raison que les garnisons qui sont dedans, n’ont aucune eau douce, si elle ne
leur est apportee des cisternes de la cite sur des chameaux.
Le grand Pharillon est beaucoup plus fort que le petit, car il est fermé de hautes murailles qui sont garnis de
tours bien flanquees, ayans en son exterieur un gros dongeon carré environné de quatre tours tresbien
flanquees, l’une desquelles est de beaucoup plus haute que les autres. C’est telle qui sert pour loger la
sentinelle, & de phanal pour porter la lumiere, pour r’adresser au droit chemin les desvoyez414 qui ont la nuict
sur la mer. Ces deux chasteaux sont si pres l’un de l’autre qui se peuvent secourir facilement, & nul vaisseau
ne peut entrer au port, sans passer entre leurs murailles.
Quant aux maisons d'Alexandrie, elles sont toutes couvertes en terrasse & plate-forme, comme sont celles
de Turquie, Grèce, & autres lieux de l'Orient : & sur les plate-formes ou terrasses les Alexandrins, Egyptiens,
& Arabes, dorment toutes les nuicts de l'hyver & de l'esté pour chercher la fraischeur, d'autant qu'en ces
pays là, il n'y faict point de froid. Ils ne dorment sur les licts de plumes, comme nous faisons, car cela seroit
fort dommageable à leur santé, mais se contentent seulement d'avoir quelque manteau ou couverture autour
d'eux. Ce n'est donc de merveille si telles gens, de toute antiquité ont si exactement observé le cours des
estoilles, veu qu'à toutes les heures de la nuict, ils les voyent se lever & coucher & faire le cours du
Zodiacque, par ce que le temps est tousjours serain & clair en ces pays là, & en toute l'Egypte.
Pour retourner aux bastimens d’Alexandrie, les maisons sont basties sur grosses arcades & colonnes de
marbre, sous lesquelles sont les citernes qui reçoivent l’eau du Nil, au temps de son accroissement : Car il
faut noter que combien que le Nil en soit beaucoup esloigné, si est-ce toutesfois que une partie d’iceluy y
vient par un canal que les anciens Egyptiens feirent faire, qui passe par dessous les murailles de la cité, &
remplit toutes les cisternes, l'eau desquelles quand elle est nouvelle venuë, est tres-mauvaise à boire,
engendrant une fiebvre avec la dissenterie qui faict mourir le plus souvent ceux qui en sont atteints : de
maniere que les habitans qui sont curieux de leur santé, reservent l'eau de l'annee precedente pour s'en
servir jusques au mois de Novembre.
Combien que la ville soit située en lieu desert et areneux, si est-ce toutesfois que l’on y trouve abondance de
toutes choses necessaires à la vie, car le poisson d’eau douce & de mer n’y manque nullement, pource
qu’elle est sur le bord de la mer, et le lac de Bouchiara ou Mareotis le voisine de pres d’un costé, & de l’autre
costé le Nil.
Pour le regard des chairs, le mouton, veau, boeuf & chevreau, s’y trouvent à grand marché, comme aussi
toute sorte de gibier, & entre’autres certaines gazelles qui sont chevres sauvages, qu’on tuë à grand coups
de harquebuse. Il s’y trouve aussi grande quantité de bleds, fruits & legumes. Quand est du vin, il y en vient
de toutes parts, d’Occident, Septentrion, & Orient, tellement qu’il n’y manque aucune chose, sinon le
mauvais air qui y regne, fors és mois415 d’Aoust, Septembre & Octobre, lequel par sa subtilité engendre
fiebvres tierces & contiguës.
J’estois bien adverty longuement auparavant que d’arriver en Alexandrie, qu’il estoit necessaire tenir son
estomach fort chaudement, s’empescher de manger par trop de fruicts, & vivre sobrement : Je m’esforcay
d’observer ceste reigle de toute ma puissance, qui fut en vain : Car dès le quatriesme jour la fiebvre tierce
me saisit avec un froid si vehement, & une chaleur bruslante apres, qu’on n’en esperoit de moy sinon la mort
prochaine, qui fut occasion que plusieurs me conseillerent d’aller changer l’air autre part, ou bien retourner
en la Chrestienté.
Je pensay en moy-mesme que j’avois veu toutes les choses qu’un homme pourroit desirer voir, & qu’il ne me
restoit des-ormais, que de retourner en ma patrie, & que pour ce faire, je voyais plusieurs belles commoditez
se presenter devant mes yeux : y ayant au port plusieurs vaisseaux Marseillois & Venitiens, dans lesquels
seurement je pouvois passer la mer à peu de frais, toutesfois je ne voulois en ce du tout suyvre ma propre
volonté, sans en avoir communiqué à nostre Vice-Consul & autres Italiens, Grecs & Juifs, qui m’estoient
bons-amis : tous lesquels unanimement me conseillerent suyvre ma resolution. Bien me dirent-ils qu’ils
n’estoient pas d’advis que je passasse droit en France, à cause des corsaires de la Barbarie, & de soixante
galeres que le grand Turc y avoit envoyees à la Sainct Jean precedente, pour chastier ceux de Tripoly de
Barbarie, qui s’estoient voulu rebeller contre sa Seigneurie.
Aussi que nul vaisseau ne suyvoit ceste route, jusques à la fin du mois de Mars, mais que une nave
Venitienne faisoit voile dans deux ou trois mois416, en laquelle ils estoient d’advis que je m’embarquasse. Ce
conseil donné, incontinent417 je parlay au patron & à l’escrivain de la nave, avec lesquels faisant marché
pour ma nourriture & passage, me promirent de faire voile dans trois jours.
Cependant j’eus la commodité de voir plusieurs choses antiques qui sont tant au dedans d’Alexandrie qu’au
dehors : car au dedans se voyent trois petites montagnes semblables à celle du Testacio de Rome, dans
lesquelles on trouve plusieurs vases de terre, qui me fait presumer qu’elles ont esté autresfois faictes
artificiellement.
Il se voit aussi pres l’ancien palais d’Alexandrie, deux obelisques ou aiguilles faites d’une seule piece de
marbre d’environ cent pieds de haut, & huict de large, ressemblans presque à celle de Sainct Pierre de
Rome, l’une est droite & entiere, l’autre est couchee par terre & rompuë. Ces Obelisques ou aiguilles sont
choses de tres-grande admiration, car elles sont d’une seule piece massive, si grande, si grosse, si longue,
& si bien polie & engravee, que l’homme demeure esmerveillé voyant une telle oeuvre au monde, & comme
on la peu eslever & tailler ainsi d’une seule piece de marbre. J’ay l’opinion que celles qui sont à Rome y ont
esté conduites de l’Egypte, pour ce qu’il ne se peut trouver rocher Thebaicque si commode, pour cest effect,
comme il se faict en Egypte, mesmes que les caracteres & figures qui sont engravez à celles de Sainct Jean
de Latran, de nostre dame du Populo, & de Saincte Marie major à Rome, sont semblables à ceux de
celle-cy.
Ceste sorte de marbre Thebaicque est grisatre & marqueté de deux ou trois couleurs, & duquel mesmement
l’admirable & haute colonne de Pompee est faicte toute d’une seule piece, d’une si demesuree hauteur,
espaisseur & grosseur, qu’il est impossible de pouvoir trouver ouvrier qui par engins la peust transporter
autre part, ayant pour le moins six vingts pieds de haut, & quinze de circuit par le bas. Toutes les colonnes
de Rome ny celles de nostre dame de la Rotonde, n’approchent en rien celle-cy : Elle est eslevee dessus un
promontoire qui est à demy quart de lieuë d’Alexandrie, & duquel on voit facilement le lac de Bouchiara, &
les palmiers qui l’environnent, comme aussi la mer, & grande partie de la terre ferme : m’enquerant de
plusieurs pourquoy on la nommoit du nom de Pompee : il me fut dit que c’estoit Caesar qui l’avoit faict eriger
pour perpetuer la memoire de la signalee victoire qu’il avoit euë contre Pompee le grand.
Se voit aussi hors de la cité, le lieu où Sainct Athanase s’alla cacher fuyant la persecution Arienne, & auquel
il composa le beau Cantique, Quicumque vult salvus esse.
Au dedans de la ville se voit le lieu joignant trois colonnes de porphire, où la bonne Saincte Catherine eut la
teste tranchee : les Chrestiens y avoient faict faire une eglise, que les Turcs ont reduicte en mosquee.
Quasi tout joignant est le lieu où monsieur Sainct Marc L’Evangeliste fut decapité, le corps duquel à depuis
esté porté à Venise. Il y a une pierre en l’eglise dediee à Sainct Jean Baptiste, sur laquelle il eut la teste
tranchee par le commandement d’Herodes : On dit que nul Turc ou infidele ne se peut seoir dessus sans
endurer quelque tourment, je n’ay pas veu la pierre, non plus que l’experience d’un tel mal.
Or pendant que je sejournay en Alexandrie, y arriva certains Turcs qui menoient un Elephant à
Constantinople, une Giraffe & plusieurs autres especes de diverses & rares bestes à nous incogneuës,
toutes lesquelles le grand Bacha du Caire envoyoit au grand Turc, d'autant qu'il se plaist fort d'avoir en son
serrail toutes sortes d'animaux, entre lesquels je croy qu'il ne s'en peut voir un plus beau, plus rare, plus poly
& de nature plus douce que la Giraffe418.
Cest un animal que nature a produit d’une estrange maniere, & qu’elle a enrichi (à mon advis) de beaucoup
sur tous autres, pour ce que les pieds de derriere elle va toujours haussant jusqu’au sommet de sa teste : La
raison de cecy est, que ses pieds de devant sont de moitié plus haut, que ceux de derriere, puis portant le
col gresle, droit, & long, cela la rend fort haute et eslevee. Elle a la teste presque semblable à celle du cerf,
sinon que ces petites cornes mousses n’ont que demy pied de long, ses oreilles sont grandes comme celles
d’une vache, & n’a point de dents au dessus de la macheliere, ses crins sont ronds & deliez, ses jambes
gresles & semblables à celles d’un cerf, & ses pieds à ceux d’un taureau : Elle a le corps fort gresle, & la
couleur de son poil ressemble à celuy d’un loup servier, quand elle court, se pieds de devant marchent
ensemble, du reste sa maniere de faire est fort semblable à celle du chameau : c’est un animal entre tous
ceux que j’ay veus par le monde qui est le plus beau & le plus rare.
Au contraire l’Elephant & le chameau sont les plus sales & vilains. L’Elephant est une beste de merveilleuse
grandeur, & est tout noir, & sans aucun poil, n’ayant autre jointure que celles des epaules, il a la teste fort
grosse & grande, & les yeux roux & espouvantables, les dents grandes hors la bouche d’environ deux pieds
de longueur, & le mufle ou nez de dessus est long jusques en terre, duquel il se sert pour lever tout ce qu’il
veut manger : il a les pieds ronds & les oreilles semblables à celles d’un Dragon, & tant plus pesant il porte
et plus chemine il asseurément, n’estant de merveille si l’on dict qu’il peut porter une tour pleine de
gens-darmes avec leurs victuailles.
Le chameau est un animal beaucoup plus grand qu’un cheval, de sorte quand on le veut charger &
descharger, il se met à genoux contre terre beuglant assez espouvantablement : Il a les pieds fourcheze
comme un boeuf & mols comme paste, faisant son urine par derriere au contraire des animaux masculins : il
a le milieu du dos fort haut eslevé, l’encolure gresle, & la teste petite, le poil de couleur cendrine, & rongeant
son frein comme un boeuf, & quand il paist ou mange quelque chose, il leve la teste en haut pour l’avaler.
Le jour estant venu que la nave Venitienne dite Trevizana devoit faire voile la minuict ensuivant, je feis porter
ma casse dedans & quelques petites provisions de vin, fruicts & autres choses, combien que j’avois faict
marché avec le patron à six escus d’or & demy par mois pour me nourrir, sans le nolle & passage qui me
coustoit huict ducats Venitiens.
Et apres avoir contenté & pris congé du Vice-Consul, je montay en la nave le vingt & deuxiesme jour dudit
mois. »
- 337 - 339 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
VINCENZO DANDOLO (1591)
Dandolo, V., Relazione del nobile uomo ser Vincenzo Dandolo fu console in Egitto, Venise, 1873.
Vincenzo Dandolo est consul à Alexandrie de 1587 à 1591.419
p. 1 :
« J’aurais quantité de choses à dire à Votre Sérénité, concernant ce royaume, mais vous sachant très
occupé dans les affaires très graves et importantes de la république, je ne vous raconterai que ce que j’ai
estimé et reconnu digne de Votre Majesté, c’est à dire les entrées de ce royaume, d’où elles proviennent,
quelles sont les dépenses, le nombre des gouverneurs qui récoltent les impôts extérieurs, le nombre des
soldats et ce qu’ils utilisent pendant la guerre ; comment sont traités les voisins et les gens du pays,
comment se fait le commerce, quels en sont les marchands. »
Il cite Alexandrie pour les rentrées et les dépenses :
p. 3 : On retire du quai d’Alexandrie : Vni 96 25
p. 4 : On donne à 95 Asapi d’Alexandrie : Vni 4000
p. 6 :
« Le commerce en Égypte, et surtout au Caire, est actuellement de plus en plus serré et on fait très peu
d’affaires. »420
419 Archives Sauneron (Ifao).
420 Traduction : C. Burri (archives Sauneron, Ifao).
- 340 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JAN SOMMER (du 8 au 11 septembre 1591)
Vénitien anonyme, et al., Le voyage en Égypte des années 1589, 1590, 1591. Le Vénitien anonyme, le
Seigneur de Villamont, le Hollandais Jan Sommer, par C. Burri et S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1971.
Le Hollandais Jan Sommer ne consacre que quelques lignes à Alexandrie. Il y arrive en prisonnier, ayant été
capturé par les Turcs, et ne doit sa libération qu'à l'obligeance du consul de France.
p. [275] :
« Le 8 de ce mois [septembre], vers 5 heures de l’après-midi nous étions en vue d’Alexandrie. La première
chose qui frappe l’oeil avant que l’on ne puisse voir la terre, en arrivant à Alexandrie, est une grande
colonne. On dit qu’Alexandre le Grand l’a fait ériger et elle se dresse dans la ville ; mais il y a aussi des gens
qui prétendent que c’est Pompée qui l’a fait dresser. En réalité, on ne sait pas exactement ce qu’il en est. »
p. [279]-[280] :
« La ville d'Alexandrie est plus grande que Candie mais elle a été terriblement ravagée par la sauvagerie
des Maures qui y ont mis le feu à deux ou trois reprises. Il y règne une odeur fétide et il n'y a rien de
remarquable à voir à part un mur en albâtre et marbre. On dit que ce sont là les restes du palais d'Alexandre
le Grand. Il y a aussi la colonne [de Pompée] dont j'ai déjà parlé ; elle est faite de marbre rouge. »
- 341 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AMARO CENTENO (1595)
Centeno, A., Historia de Cosas del Oriente. Primera y Segunda parte, Cordoue, 1595.
Amaro Centeno naît à Puebla de Zanabria, ville du royaume de Léon (actuellement Zamora, dans le
nord-ouest de l’Espagne).421
p. 60 :
« Ce royaume a deux ports de mer qui sont Alexandrie et Damiette. La ville d’Alexandrie et très forte,
entourée de murs puissants. L’eau que boivent les habitants est amenée du Nil par des conduites secrètes
sous la terre qui remplissent les citernes qui existent bien ordonnées en ville, et ils n’ont pas d’autre eau à
boire en dehors de celle-là ; si elle leur était enlevée, ils ne pourraient pas la conserver et ils leur serait très
difficile d’en prendre par la force d’une autre façon. … Le sultan tire des droits et des revenus importants des
marchands de ces deux ports d’Alexandrie et de Damiette. »422
421 Villenave, M., « Centeno, Amaro », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie Universelle
ancienne et moderne 7, Paris, 1813, p. 520.
422 Traduction : A.-P. Lavaud (archives Sauneron, Ifao).
- 342 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHRISTOPHE HARANT (du 3 au 12 novembre 1598)
Harant, C., Le Voyage en Égypte de Christophe Harant, 1598, par C. et A. Brejnik, Ifao, Le Caire, 1972.
Christophe Harant, seigneur Tchèque, naît en 1564 en Bohême occidentale. Son père est un grand
magistrat du royaume. À douze ans, Christophe Harant entre à la cour d’Innsbruck au service de Ferdinand
de Styrie, cousin de Rodolphe II, roi de Bohême et Empereur du Saint Empire Romain Germanique. Il y
poursuit parallèlement ses études d’histoire, de géographie et de sciences politiques. Il devient par la suite
l’un des conseillers de Ferdinand. Il fréquente alors les milieux d’artistes, de lettrés, de savants. À partir de
1591, il participe à la guerre contre les Turcs durant six ans. En 1598, il part en pèlerinage accompagné de
son beau-frère. Ce voyage, en plus de son caractère pieux, est peut-être aussi une enquête discrète sur
l'état de l'empire turc. De retour chez lui, Christophe Harant consacre la majorité de son temps à écrire et à
étudier. Il met dix ans à préparer son ouvrage pour la publication de son récit qu’il enrichit de nombreux
compléments érudits. "Homme universel" est l’appellation qu’il se donne pour présenter au lecteur le récit de
son voyage.423
p. [263]-[284] :
« …la porte d'Alexandrie. Celle-ci est toujours fermée. On ne l'ouvre que lorsque quelqu'un veut entrer dans
la ville.
Les deux Juifs qui nous accompagnaient appelèrent le portier et le prièrent de faire venir des Juifs de leur
connaissance. Après un moment d'attente, quelques-uns de ces Juifs accompagnés de quelques Turcs
sortirent à notre rencontre, et demandèrent nos noms et notre provenance. Ils notèrent tout cela. Avant de
nous permettre d'entrer, ils firent payer à chacun de nous un ducat par tête, tant aux Juifs qu'aux Turcs.
Puis nous longeâmes une longue rue, puis d’autres rues plus courtes, pendant un bon moment, avant
d’arriver à un fondique chrétien appartenant au peuple franc et à ses alliés, représentés par un vice-consul
français, qui y siégeait et l’administrait. Nous y mîmes pied-à-terre, et les Juifs et les âniers s’en allèrent
chercher compagnie de leurs pairs.
Le bruit de notre arrivée courut vite par tout le fondique, et parvint aussi à ceux de nos compagnons de
pèlerinage à Jérusalem, qui avaient quitté le Caire bien avant nous, mais qui séjournaient encore ici en
attendant un bateau. Ils accoururent avec une grande joie, nous menèrent vers leurs habitations, et
s’efforcèrent de nous offrir toutes les commodités possibles. Mais notre fatigue était telle, que nous ne
pensions même pas à manger, et après un bref entretien, nous nous retirâmes pour nous reposer.
Le lendemain matin, quatrième jour du même mois [novembre], nous nous dépêchâmes d’aller saluer le
vice-consul, sachant que son habitude était d’aller aussitôt habillé à la Messe dans la belle et spacieuse
chapelle de la maison. Le vice-consul nous reçut amicalement, il se mit à notre entière disposition, et nous
promit de nous aider à trouver de la place sur un bateau du type Caramusala, ou tout autre, naviguant vers
Malte ou la Sicile.
Puis ce jour même, ainsi que les jours suivants, il fit chercher dans le port des bateaux n’appartenant pas
aux Vénitiens, mais n’en trouva point. Il nous conseilla donc de prendre langue et de nous arranger avec l’un
des bateaux vénitiens, disant qu’avec eux nous arriverions chez nous avec plus de sécurité, car ils
risquaient moins de la part des pirates.
Nous prîmes son conseil au sérieux, et ce même jour après le déjeuner, nous nous rendîmes au port, et
dans un petit canot, nous nous dirigeâmes vers les bateaux vénitiens qui étaient à l’ancre près de la
forteresse, ne pouvant pas entrer dans le port qui n’offrait pas assez de profondeur pour eux. En ce
moment-là, il y avait trois bateaux, le Balbiana, le Vidaletta, et le Balbania nova.
Nous demandâmes d’abord lequel d’entre eux était le premier prêt au départ pour les pays chrétiens, et l’on
nous annonça que c’était le Balbiana le plus grand des trois navires. C’est donc avec son patron que nous
prîmes un arrangement pour notre voyage à Venise. Il nous dit que son navire partait le douze de ce mois,
ce qui nous donnait encore le temps de voir librement la ville d’Alexandrie.
Description de la ville d’Alexandrie
Alexandrie, appelée maintenant en turc Scanderia, ou Ischenderia, fut édifiée tout d’abord par Alexandre, roi
de Macédoine, selon Josèphe en 320 avant la naissance de Jésus-Christ. En dix-sept jours, la ville fut ceinte
de murailles en pierres de taille, qui suivaient la forme d’un bouclier macédonien, et qui avait un pourtour de
6000 pas. Justin, livre 2.
C’était dans l’antiquité une grande ville dont les murailles s’étendaient sur quatre-vingt encablures ;
cependant, je ne pense pas que cet espace ait jamais été entièrement bâti, car les collines appelées en latin
Promontorium Alexandriae, et qui sont assez abruptes et rocheuses, sont, du côté égyptien, incluses dans
l’enceinte. D’autre part, on n’y remarque pas beaucoup de ruines ni de fossés.
C’est une ville forte, non seulement à cause de ses bons murs, mais aussi à cause de sa position sûre. Car
elle a d’un côté la mer Méditerranée, de l’autre le lac Maréotis (à présent nommé Buschiara, et au sujet
duquel Strabon, livre 17 écrit, sur un troisième côté, elle a des déserts de sable inaccessibles s’étendant
jusqu’au monastère de St. Makarius, (celui-ci est encore aujourd’hui habité par des moines grecs) et du
quatrième côté, elle a le fleuve Nil et ses grands marécages.
Au cours des années passées, Alexandrie a été la première ville commerciale du monde, à cause de son
port pratique et sûr. Les marchandises les plus rares et les plus chères, tout ce qui pousse aux Indes,
comme je l’ai déjà dit, ont été transportés par la Mer Rouge en Égypte, à Alexandrie, et de là en Syrie, Asie,
Italie, France, Espagne, Allemagne, et Afrique, etc. Et tous ces pays, je dis bien l’Asie, l’Europe et l’Afrique
ont été obligés de payer des droits de douane énormes à la ville d’Alexandrie, où les rois ont puisé des
bénéfices indescriptibles. Cela donna l’origine à l’adage qui dit : Aurea Alexandria, Antiochia pulchra,
Nicomedia speciosa, Alexandrie est d’or, Antioche est belle, et Nicomédie a du charme. HERODIEN écrit qu’au
point de vue du nombre des habitants, elle n’a été surpassée que par Rome. La belle construction y
prospérait. Lorsque l’empereur Octave, qui régnait au temps de la naissance de Jésus-Christ, conquit
Alexandrie, il eut l’intention de la détruire pour ne pas la laisser à son ennemi Antoine. Mais lorsqu’il vit la
ville, il se décida à ne pas la détruire, cela pour trois raisons : à cause de la beauté de ses édifices, parce
que le corps d’Alexandre y reposait (quoiqu’il soit mort à Babylone en pays de Chaldée, c’est à Alexandrie
que l’on a transporté son corps), et à cause d’Arrius, le philosophe grec, qui y avait établi son école et son
domicile.
Le site où se trouve la ville est gai, mais stérile. Son sol est sablonneux et rocheux. On y importe tous les
vivres et toute la nourriture. Ses beaux et amples jardins, ainsi que tout ce qui y pousse, ne sont là que
grâce au bras du Nil, à son canal creusé tout exprès.
Il est à noter que dans les étendues désertes des environs, pousse une plante nommée en arabe Harmala,
en grec Kaly, qui est brûlée et dont les cendres sont exportées à Venise, pour les employer dans les
manufactures du verre le plus pur. Il y a dans les environs une abondance de divers herbages.
Alexandrie a quatre portes, l’une sur la mer, l’autre sur le Nil donnant sur l’Orient, la troisième sur le désert
au couchant, et la quatrième sur le lac, au sud. C’est là que se tiennent les préposés aux douanes, qui
prélèvent les taxes sur les marchands, et qui bouleversent toutes leurs affaires, qui fouillent tout, et qui
maintes fois arrivent à mettre les gens à nu, pour que rien ne leur échappe. Les chrétiens vivent près de la
mer, et mènent le commerce, qui y arrive de partout. Sur tout ce qui est importé, ils paient le dixième, sur
tout ce qui est ensuite exporté, ils repaient la même somme. Les Turcs ne paient que le vingtième. Les uns
et les autres ne paient rien pour transporter quelque chose par voie terrestre, au Caire.
À présent, la ville est en grande partie démolie et abîmée, comme on peut le voir, ce qui provient, disent les
historiens, des ravages causés par le roi de Chypre, qui vint à assiéger et à conquérir la ville, pour tirer
vengeance du sultan, pour la défaite et la capture de Louis le Français près de Damiette. Ce roi, assiégé à
son tour dans Alexandrie par le sultan, et ne pouvant résister, brûla la ville et la mit à sac, et partit par mer
pour Chypre. Depuis, la ville a du mal à retrouver son apparence d’autrefois.
Il y a sur l’endroit le plus haut d’une colline une grande tour très haute, sur laquelle il y a toujours une
sentinelle qui observe par mer, pour avertir aussitôt les Turcs des forteresses lorsqu’elle aperçoit au loin un
bateau qui approche, et ainsi éviter d’être surpris par l’ennemi.
Il y a aussi un vieux palais qui devait être autrefois luxueux, et dont on dit que c’est le Palais d’Alexandre le
Grand. Dans les alentours, deux colonnes, chacune faite d’un seul morceau de marbre bigarré. Toutes deux
sont recouvertes de figures et de lettres diverses taillées dans la surface. L’une est debout, entière, l’autre
est couchée, cassée en plusieurs morceaux. Leur hauteur est de 100 souliers ; elles ont pour nom
obélisque, car elles ne sont pas rondes de pourtour, comme des colonnes, mais carrées, larges à la base, et
pointues au sommet.
Pline, liv. 36, ch. 9, écrit que les empereurs romains Auguste et Claude firent transporter par mer d’ici à
Rome deux colonnes similaires, d’une hauteur de 125 pieds.
Cependant toutes ces colonnes sont dépassées en hauteur par celle qui est érigée sur le tombeau de
Pompée (Prince romain), qui périt près d’Alexandrie en faisant la guerre à l’Empereur Jules, dont ce dernier
décrit les faits dans les Commentaires de bello civili, et qui est encore aujourd’hui, toute entière, à un mille
italien derrière la ville. Elle est de 80 coudées de hauteur, et de 15 empans de pourtour. À son sujet, PLINE
écrit que c’est Ptolémée Philadelphe qui l’a fait ériger à Arsinoé, en dépensant pour son transport d’abord à
Thèbes, puis par le Nil plus bas, plus que ce que n’avait coûté sa taille. C’est une colonne cylindrique, lisse
et douce de surface.
Nous fîmes une sortie hors de la ville, en compagnie d’un janissaire qui servait de guide, pour aller voir cette
colonne, et il nous fallut payer un pourboire à la porte de la ville donnant de ce côté-là. Il nous sembla
d’abord possible d’atteindre, ou même d’en dépasser la pointe, en lançant un caillou dans l’air. Mais nos
essais de tir en dépassèrent à peine la moitié. Ajoutons que cette colonne repose sur un socle carré de deux
brasses de haut, et que le sommet de la colonne est coiffé d’une plaque similaire.
Au sujet de toutes ces colonnes, les Turcs racontent plusieurs fables ridicules, que je passe sous silence,
par souci de brièveté.
Le port de la ville semble décrire la forme d’une demi-roue, dans le centre de laquelle se trouve une île
appelée Pharos, défense et forteresse de cette ville, fermant le port par deux chemins ou digues qui mènent
des deux côtés depuis la mer vers la ville et qui ne laissent qu’un étroit passage. La navigation en ces
parages est dangereuse, à cause de gros rochers, visibles ou cachés sous l’eau. Pour cette raison,
Ptolémée Philadelphe, roi d’Égypte, fit construire sur cette île de Pharos, du côté où l’on navigue d’Égypte
en terre syrienne, une tour très haute, de marbre blanc, et ordonna d’y maintenir un grand feu toutes les
nuits, comme signal et avertissement pour les navigateurs qui s’approchaient du port, pour qu’ils puissent y
entrer en évitant ces dangers.
Sur cette île, il y avait quatre-vingt deux petites maisons pour 72 devins (que je mentionnerai plus bas) pour
que chacun d’eux puisse tranquillement étudier dans l’une d’elles, sans être dérangé par les gens ; elles ont
été montrées encore de son temps, nous affirme JUSTIN philosophe et matyr, Admon. Gentium.
Cléopâtre, reine d’Égypte, fit rénover et embellir cette tour, au point qu’elle fut comptée parmi les sept
merveilles du monde, et c’est d’après elle, que les tours des autres ports ont été appelées Pharos. Cléopâtre
fit relier cette île à la ville par une grande jetée, de sept encalubres de longueur, qui avançait dans la mer.
De nos jours, à cause de la terre apportée par le Nil, l’île se trouve de plusieurs encalubres proche de la
terre ferme, et il n’y a plus de tour. Tout ce qui en reste sont quelques pierres et gravats, et on ne dirait
même pas qu’autrefois l’île a été éloignée de la terre.
Ce port est appelé le Vieux Port. Comme il est de peu de profondeur et qu'il n'est pas nettoyé, seulement les
habitants de ce côté de l'Afrique y pénètrent avec leurs petites embarcations de peu de tirant. C'est de cela
que provient l'erreur de ceux qui écrivent qu'il est interdit aux bateaux chrétiens d'y entrer. Il n'en est rien. Si
leurs navires, par leur tirant, n'étaient pas empêchés d'y entrer, ils y vogueraient aussi bien que les autres.
Maintenant il y a un nouveau port principal, qui se trouve à une distance de quelques encalubres de la ville.
Entre le port et la ville, s’étend un faubourg de masures caduques habité par les Juifs et les soldats turcs, qui
doivent être là, prêts à intervenir dans la forteresse du port en cas de nécessité.
Il y a un gros mur s’avançant dans la mer, par lequel on peut atteindre la forteresse située en son extrémité,
elle-même protégée par une double enceinte, plusieurs bastions, avec une grosse tour en son milieu. Sa
garnison y est tenue en permanence, et ses vivres, l’eau incluse, sont transportées depuis la ville.
De l’autre côté, en face de la forteresse, se trouve un donjon entouré d’une enceinte, dans laquelle se
tiennent aussi des gardes. C’est entre ces deux tours que chaque bateau doit passer, en entrant ou en
sortant du port. Cette entrée peut être fermée par une chaîne de fer reliant la forteresse à la tour, et
empêchant tout bateau de passer sans l’autorisation de la garnnison.
Une passerelle de bois, fermant le port de ce côté, relie la tour à la rive, près de la douane. Cet édifice bâti
en pierres, a deux étages. Il est habité par des Juifs, qui inspectent tellement à fond tous les bagages pour
percevoir des droits, que dans tout l'empire turc, on ne trouverait pas de pareils.
De certaines choses, ils s'emparent souvent de force, pour d'autres, ils usent de tromperie de ruse. C'est
comme s'ils posaient des pièges pour certaines choses dont ils sont avides, et ils font comme ce chien du
proverbe qui, ne pouvant avaler tout l'os, au moins le ronge, El cane rosega l'osso, perchè non puo inglotire.
Dans ces forteresses, les Turcs élèvent des pigeons voyageurs. Lorsqu’ils reçoivent l’annonce de l’approche
d’un navire, ils sortent en bateau à sa rencontre, en transportant avec eux ces pigeons dans leurs cages.
Puis, après avoir vu de près le navire et son équipage, ils lâchent un ou deux de ces pigeons avec leurs
missives, pour qu’ils les portent au sangiac de la ville et le renseignent aussitôt. Déjà plus haut, une mention
a été faite à ce sujet.
Les maisons d'Alexandrie sont bâties à la manière de celle des Cairotes, sans toits, à cause de la chaleur
intense, et de l'utilisation de ces toits plats pour y coucher la nuit, et y jouir de la fraîcheur nocturne, été
comme hiver. Ils ne font pas leurs lits comme nous. Ils les font sans bois ni baldaquins. Ils tendent tout
simplement une couverture ou un tapis par terre, et se couvrent par une autre couverture. Et là-dessus, et
là-dessous, ils dorment aussi doucement que quelqu'un de chez nous dans le lit le mieux fait.
Ce n’est donc que normal que dans ces contrées, les Égyptiens, et parmi eux les Alexandrins, soient les
meilleurs astronomes de toutes les nations. Au-dessus de leurs regards, ont défilé depuis toujours les
constellations du Zodiaque, pendant qu’ils allaient se coucher, se lever, ou qu’ils restaient étendus, rêveurs.
Pour eux, il est vrai que la nuit fait naître les pensées, la notte la madre dei pensieri.
Dans cette ville, les chrétiens jouissent d'une liberté plus grande que dans toute autre ville turque, car c'est
sur eux que repose le plus grand commerce. Celui qui veut, peut y mener le commerce avec les pays
chrétiens, à l'exception des Espagnols, à cause desquels les Turcs ont déjà perdu quelques tonnes d'or de
revenus, échappés par l'autre côté des Indes, et qui continuent à gêner de plus en plus leur commerce.
Chacun peut imaginer comme les Turcs l'apprécient.
Les chrétiens peuvent y exercer ouvertement leur religion, l’église latine y a ses églises, comme en ont aussi
les Grecs, ou d’autres ordres orientaux. Cependant, ce sont les Jacobites et les Grecs qui tiennent l’église
principale, attachée au siège du patriarche. C’est l’église dans laquelle depuis l’antiquité, le corps de saint
Marc l’évangéliste a été enseveli, et qui encore aujourd’hui porte son nom. Lors du sac de la ville perpétré
par le roi de Chypre, le corps fut exhumé et transporté à Venise, où les Vénitiens le garde pieusement à
l’église Saint-Marc.
Les Vénitiens, les Génois, les Autrichiens, les Florentins et d’autres nations d’Europe ont à Alexandrie leurs
consuls et leurs bailes, qui habitent dans leurs comptoirs, ou fondiques, où la marchandise de leur pays ou
ville est gardée, et d’où elle est expédiée. Le meilleur comptoir, où nous étions logés, est celui des Français.
Au rez-de-chaussée, se trouve une série de chambres voûtées pour garder la marchandise ; au premier
étage, tout autour, une multitude de chambres à coucher. C'est en haut que se trouvent les appartements
des marchands. L'édifice se dresse, carré, sur quatre étages. Nous étions un groupe nombreux, et nous
mangeâmes à des prix raisonnables.
Le soir, quand le portier s'apprêtait à fermer l'unique portail de toute la maison, il se mettait à frapper avec un
gourdin sur un morceau de fer pendu à l'entrée, ce qui résonnait très loin. Ceux qui se trouvaient en ville se
dépêchaient alors de rentrer dans leurs habitations, car la nuit tombée, et le portail fermé, personne ne
pouvait ni sortir ni entrer.
Au lieu de promenades, pendant la journée, nous visitâmes surtout les comptoirs de diverses nations,
indiennes avant tout. Ceux-là sont les plus riches, on peut y voir des objets de valeur, des oiseaux curieux et
des animaux vivants en abondance. En plus de comptoirs, il y a plusieurs rues pleines de magasins de
vente, ce d’après quoi on peut bien voir combien cette ville a été célèbre et débordante de commerce avant
que les Espagnols n’arrivassent aux Indes.
Mais pour toutes ces promenades, nous fûmes obligés de nous dévêtir de nos habits de pèlerins, et de nous
vêtir de tuniques bleues ou rouges, et aussi de remplacer nos chapeaux par des bandes bigarrées de
cotonnade enroulées autour de notre tête pour dissimuler notre qualité. Nous arrivâmes à reconnaître en
effet, que les pèlerins n'étaient pas les bienvenus, soient par ce qu'ils n'apportaient pas d'affaires ni de
profits, soit parce qu'on les tenait pour des espions. Il nous arriva, alors que nous sortions vers le port par la
porte de la ville, de rencontrer un groupe de Turcs, dont l'un frappa l'un des nôtres, sans raison aucune, d'un
coup de poing fermé dans la figure. L'homme atteint tomba à terre et perdit connaissance, car il avait été
déjà éprouvé auparavant par la maladie. Mais les Turcs ne me permirent pas de le relever, ni de le ramener
à lui, ils brandissaient contre moi, menaçants, des sortes de hachettes au bout d'un long manche. Il faut dire
qu'en vérité, tout au long de notre voyage, nous n'avons rencontré nulle part de gens plus hostiles aux
pèlerins que dans cette ville.
Une des choses que l'on montre est la chapelle construite sur l'emplacement de la prison de sainte
Catherine, édifice qui est à présent transformé en mosquée.
Une autre église chrétienne, qui a aussi été saisie, est celle de Saint-Jean-Baptiste, dans laquelle doit se
trouver la pierre qui a servi, selon l'usage romain, à la décapitation du Saint ordonnée par le roi Hérode.
On dit qu'aucun Turc, ni aucun autre païen n'ose s'asseoir sur cette pierre, car ils seraient atteints de visions
et de douleurs internes. Cette pierre est donc tenue en haute estime.
L’air d’Alexandrie est parfois malsain, quoi que CAELIUS, Livre 16, chap. 3, assure qu’il a été bon. D’aucuns
en rejettent la faute sur le lac Maréotis, et sur les étendues boueuses des environs, d’où, spécialement en
automne, un vent malsain et humide souffle sur la ville et la contamine. Quant à moi, je suis de l’avis de
ceux qui l’expliquent par le fait des puanteurs et souffles secrets émanant des caves souterraines sous
chaque maison.
Par toute la ville en effet, on trouve sous chaque maison une cave-citerne voûtée, parfois avec des colonnes
et des arcs de marbre, qui communique souvent avec celles des voisins ; puisque ni dans la ville, ni dans les
environs, il n’y a point d’eau douce. Celle-ci pourtant doit être facile à trouver, surtout près des rivages de la
mer, où d’ordinaire se tient toujours d’eau douce. Jules CESAR dit, dans Commentaires de Bello Alexandr.,
qu’après avoir encerclé la ville, les recherches qu’il fit pour trouver de l’eau douce, qu’il rencontra en
abondance, le lui confirmèrent.
Les habitants d’Alexandrie remplissent donc ces citernes par l’eau que le bras du Nil appelé Caleg y mène,
et lorsque toutes les caves sont remplies, chacun en arrête le débit près de sa maison, la laisse décanter, et
s’en sert pendant toute l’année. Mais comme l'eau y arrive boueuse, et que toute la boue se dépose au fond
de la cave, c'est cela qui donne origine aux mauvaises odeurs et aux airs malsains. De plus elle se gâte vers
la fin, et pue ; pourtant, on ne nettoie pas les caves des boues et des immondices, avant de les remplir à
nouveau. L'eau nouvelle se contamine du fait de l'eau gâtée, transporte la contagion dans le sang des
hommes, qui, pour cette cause, souffrent principalement de fièvres brûlantes, qui frappent surtout ceux qui
ne savent pas s'abstenir de manger des fruits crus, qui y poussent fins et frais.
On y trouve en abondance toutes les choses à manger. Il y a beaucoup d’excellents poissons de mer, du lac
et du Nil, des oiseaux sauvages et domestiques, du gibier, des gazelles et d’autres bêtes qu’on voit en vente
dans certaines rues et places, par monceaux.
Il y a de grandes provisions de fruits, de céréales et d'autres choses à cuire, qu'on transporte d'ici en
Turquie, surtout à Constantinople. Il est par contre strictement interdit d'en vendre et d'en transporter pour
des pays chrétiens. Les tissus de lin d'Alexandrie qu'on y fabriquait autrefois, ont gardé encore leur
renommée dans le proverbe : Ha chiera bionda, come lino d'Alexandria.
Quoi que le vin soit importé de Chypre, d’Italie, de Candie et d’Hispanie, nous en trouvâmes à peine, et très
cher. Pendant l’antiquité, la ville brillait par ses arts et ses lettres célèbres.
Ptolémée Philadelphe, roi d’Égypte, y fit bâtir d’excellentes écoles, et dédia d’importants fonds pour y
maintenir des hommes doctes, faisant ainsi de l’Alexandrie de son temps, le centre reconnu du savoir.
ATHENEE, liv. 4, ch. 24. STRABON, liv. 14. AMMIEN MARCELLIN, liv. 22.
Le même roi y assembla aussi une grande bibliothèque, dont l’énorme nombre de livres fut estimé par
Vitruve à sept fois cent mille exemplaires variés ; ZONARAS, tom. 1, l’évalue à deux cent mille, AULU GELLE,
liv. 6 ch. 17 à soixante-dix mille.
Quel que soit le cas, aujourd’hui, alors que l’imprimerie a été créée et que l’on peut posséder un grand
nombre de livres, chacun de ses chiffres cités nous semble trop grand, presque impossible, car à l’époque,
les livres étaient écrits à la main, sur du parchemin ou de la peau de chèvre, ce qui ne fait qu’augmenter
notre admiration. Par surcroît, ce roi obtint de la part d’Éléazar, grand prêtre juif, qu’il envoie soixante-douze
hommes, connaisseurs de la Loi et des langues, pour qu’ils viennent à Alexandrie, dans la bibliothèque
royale, traduire en grec à partir de l’hébreu l’Ancien Testament. Pour ce service, Philadelphe envoya à
Jérusalem une table d’or pur, richement ornée d’émeraudes et de pierreries, qui était destinée au Temple,
ainsi que deux vases et trente tasses faits en bon or massif. Il donna également aux soixante-douze
traducteurs de magnifiques présents.
En attendant, le roi avait fait écrire la Bible en soixante-douze exemplaires sur parchemin en lettres d’or. Or
chacun des soixante-douze interprètes traduisit la Bible séparément, et leurs interprétations coïncidèrent
comme si elles avaient été faites par un même homme. Mais ils avaient travaillé isolés les uns des autres
pendant tout ce temps, sans avoir la possibilité de communiquer entre eux ni peu ni prou. Tout cela, selon le
témoignage des historiens, coûta au roi deux tonnes d’or : JOSEPHE, 12, livre des Antiquités.
L’Ancien Testament ne fut toutefois pas le seul livre prouvant la générosité de ce roi. On peut lire à son sujet
qu’il a donné pour certains livres des centaines et même des milliers. Par exemple, il n’hésite pas à donner
pour un seul exemplaire des tragédies de Sophocle, d’Euripide ou d’Eschyle quinze mille talents d’argent, ce
qui ferait neuf mille couronnes. Galien et d’autres en donnent témoignage.
En l’an 45 avant la naissance de Jésus-Christ, pendant cette guerre que Jules César mena contre le jeune
roi d’Égypte Ptolémée, il arriva que plusieurs navires royaux fussent incendiés dans le port et que le feu se
propageât au quartier de la ville où se trouvait la maison dans laquelle on conservait tous ces livres. Le feu
dévora tout. Alors périrent les oeuvres de moult auteurs et écrivains que le monde ne reverra plus jamais.
Pourtant, maint amateur sacrifierait volontiers quelques milliers pour en racheter si cela était possible.
Les lettres n’y connurent aucun déclin pendant le règne chrétien. EUSEBE, second livre de l’Hist. Ecc.,
rapporte que l’évangéliste du Seigneur, saint Marc, y vécut et y prêcha pendant plusieurs années et que le
siège du Patriarcat y fut établi et maintenu pour les Grecs jusqu’à nos jours. Pendant l’année de grâce
329 après la naissance du Fils de Dieu, saint Athanase fut promu chef et évêque de l’église et de l’École
d’Alexandrie. C’est lui qui s’opposa puissamment aux hérétiques Aryens, et qui écrivit le beau Symbolum ou
Credo de la Sainte Trinité, qui est utilisé et que l’on chante dans les églises chrétiennes jusqu’à nos jours en
l’appelant Symbolum Athanasii. Beaucoup d’hommes saints, tels Origène, Didyme, Théophile et autres
martyrs et grands fidèles, sont originaires de cette ville ou y vécurent. Sous les empereurs Julien, Jovien et
Arcadius, comme l’histoire ecclésiastique nous l’apprend, Alexandrie était même le siège des conciles.
Depuis toujours, le peuple de cette ville a été et est encore très facétieux. Il est fort enclin aux jeux, aux rires,
aux plaisanteries et à la moquerie. À maintes reprises, cela lui coûta très cher, quand il ne savait pas limiter
ses plaisanteries à se pairs et les dirigeait même contre les seigneurs, voire l’empereur. C’est ainsi par
exemple que l’empereur romain Heliogabale, appelé aussi Antonius Caracalla, se vit devenir la cible de
chansons moqueuses et d’histoires vraies ou diffamantes que l’on chantait et racontait librement à son sujet.
À l’apprendre, l’empereur, partit tout exprès pour Alexandrie, puis, avec une amabilité apparente, il invita la
jeunesse alexandrine à s’assembler sur une place de la ville, pour choisir les meilleurs d’entre eux pour sa
garde du corps, selon ce qu’il fit annoncer. Cette position était grandement convoitée à l’époque, car de ces
rangs, on recrutait souvent pour de hautes fonctions, y inclus l’empereur. Or plusieurs milliers
s’assemblèrent, vêtus comme pour un concours d’élégance. L’armée de l’empereur les encercla alors, et sur
son ordre les exécuta tous séance tenante, et puis les enterra. Ainsi les Alexandrins souffrirent un grand
chagrin, pour cause de leurs moqueries. Ceci est rapporté par HERODIEN, livre 4.
D’après SUETONE, le physique et l’avarice de Vespasien furent ainsi pour les Alexandrins dans leurs pièces
de théâtre un objet de risée. Ils gagnèrent ainsi leur réputation de moqueurs et de hâbleurs. Alexandrini
derisores et dicaces.
SUIDAS décrit une coutume d’Alexandrie, qui consiste à faire circuler, certains jours, des charrettes avec
chanteurs et diseurs autorisés, qui passent par toute la ville et qui s’arrêtent aux endroits de leur choix, pour
y chanter et raconter tout ce qu’ils savent sur le compte d’un chacun. Ils rendent ainsi public tout ce qui a été
fait, fût-ce le pire. Et pour cette occasion, ils furètent partout pour trouver les faits les plus scandaleux.
Le voyage de retour d’Alexandrie à Venise
Le 11 novembre, mercredi de la saint Martin, le patron du bateau Balbiana nous prévint de faire porter nos
affaires à bord pour nous y installer assez tôt et profiter encore de la lumière du jour. Nous avons donc fait
nos provisions d’eau à boire en barrique et de nourriture, spécialement de chair de gazelles, animaux que
j’ai mentionnés plus haut, et que nous avons achetées vivantes, que nous avons tuées, dépouillées,
dépecées, salées et mises en seille nous-mêmes.
Les Turcs et les Juifs, chacun de leur côté, bien entendu, nous ont fait payer au port des droits de douane
pour toutes ces choses, y inclus quelques perroquets et chats de mer (guenons).
Ayant pris congé de Monsieur le Consul et payé toutes nos redevances, nous nous dépêchâmes donc de
gagner le bateau, la joie au coeur, car c’était le début de notre voyage de retour vers notre patrie bien-aimée.
Nous y arrivâmes dans une petite embarcation vers le temps des Vêpres.
Le capitaine nous montra nos couchettes situées dans une pauvre cabine près du gouvernail, où logent
habituellement les marins malades, et qui nous déplut sérieusement. Mais nous n’avions guère d’autre
choix. À l’aller, nous avions vu les soldats transportés en Terre Sainte, et maintenant, il nous fallait accepter
une place plus étroite que la leur. C’est tout dire !
Peu de temps après, nous vîmes aborder une barque avec quelques Turcs, que le patron vint accueillir
révérencieusement. Ceux-ci se mirent à faire l’inspection de toutes les choses sur tous les ponts, pour voir
s’il n’y avait rien d’interdit à l’exportation. On appelle cette patrouille d’employés spéciaux de la douane, la
« circa ». Lorsqu’ils eurent bien fouiné partout, ils vinrent s’attabler pour bien se remplir le gosier de toutes
les sucreries et du vin en cruchon que le patron, selon une coutume bien établie, avait fait servir à leur
intention.
Puis, ayant jugé convenable le temps écoulé, ils prirent congé du patron, lui souhaitant bonne chance, et
s’en allèrent vers d’autres bateaux à fouiller.
Il y avait d’autres navires en rade qui, comme le nôtre, étaient pressés d’appareiller. Car il est une habitude
que l’on conserve à Alexandrie, qui veut que les bateaux en partance réussissent à quitter le port avant le
15 novembre ; en cas contraire, il leur faut passer tout l’hiver dans le port, et attendre pour partir le printemps
de l’année suivante. Cela probablement à cause des tempêtes en mer, qui entraînent des pertes de biens et
de vies, et qui, à partir de cette date, sont certaines.
Le douze, le jeudi après la saint Martin, l’attente d’un bon vent étant vaine, le patron se vit obligé de louer
une douzaine de barques à rames pour remorquer le bateau en haute mer. À peine les rameurs l’avaient-ils
laborieusement sorti du port au bout de leurs filins, qu’un léger vent se leva, suffisant pour que le patron
ordonnât de tendre les voiles et appareiller.
C’était vers une heure de l’après-midi. En trois heures de temps nous perdîmes de vue Alexandrie, tous en
bonne santé, laissant l’Égypte derrière nous… ».
- 343 - 348 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AQUILANTE ROCCHETTA (de la fin juillet au 10 août 1598)
Amico da Gallipoli, B., et al., Voyages en Égypte des années 1597-1601. Bernardino Amico da Gallipoli,
Aquilante Rocchetta, Henry Castela, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1974.
Le religieux Aquilante Rocchetta (1504-1589) est originaire de la terre de Santo Fili del Marchesato de
Renda en Calabre.424
p. [74]-[85] :
« Nous arrivâmes enfin, le samedi matin, le jour étant levé depuis trois heures, à Alexandrie, ville très
ancienne, grande déjà dans l’antiquité, peuplée et riche, dont les somptueux bâtiments sont à notre époque
démolis et réduits en cendre ; mais étant donné qu’il en reste quelques vestiges, on peut en apprécier la
magnificence.
De l’arrivée à la ville d’Alexandrie et sa description
Nous entrâmes dans cette ville par une porte moyennement grande, située dans les murs de la ville, où
nous trouvâmes des juifs qui étaient les douaniers de la ville ; ceux-ci voulaient absolument nous envoyer
avec nos affaires à la douane, située presque à la limite de la ville, du côté du port ; et donc (comme c’était
samedi leur jour de fête principale, où il n’est pas permis de faire quoi que ce soit), ils envoyèrent chercher
tout ce que nous avions par un chrétien du pays, homme de peu d’importance et très pauvre ; il était –
d’après ce que nous avons compris– évêque de la nation des Coptes. En allant vers la douane, nous
passâmes par une rue principale de la ville, longue de deux milles peut-être, très étroite, ne voyant de part et
d’autre que les ruines d’édifices démolis et, parfois, de grosses et hautes colonnes de pierre, de couleur
presque semblable à celle du porphyre. Arrivés ensuite à la douane, nous payâmes peu de médines.
Nous nous en retournâmes alors par le même chemin, jusqu’au logement du très illustre Consul de France,
où nous rencontrâmes le chancelier ou secrétaire du Consul, appelé Gio. Battista Manfredi. Celui-ci nous
fournit toute chose avec beaucoup de libéralité et de magnificence. Cependant, nous autres catholiques
restions retirés, évitant le plus possible de fréquenter les gens, en raison des craintes de peste dans cette
ville.
Mais le 2 août, toute crainte de peste étant écartée, nous commençâmes à nous fréquenter les uns les
autres, faisant grande fête dans l’allégresse, mangeant à la même table que le chancelier, recevant de lui
toutes sortes de gentillesses et amabilités.
Parlons à présent de la ville d'Alexandrie. Elle est de forme carrée avec quatre portes : l'une vers le levant,
du côté du Nil, l'autre vers le midi du côté de Bucchieri, la troisième vers le ponant, du capté du désert de
Barca, la quatrième vers la mer, où se trouve le port, et où sont les gardiens et agents de la douane ; ceux-ci
fouillent ceux qui arrivent par mer, jusqu'aux culottes, car non seulement ils font payer un pourcentage sur
les biens mais aussi sur l'argent.
En dehors des murs de la ville il y a deux autres ports, séparées l'une de l'autre par un couloir et une
forteresse, très solide, située au-dessus de l'entrée d'un port appelé Marsà al-borgh, c’est-à-dire le port de la
tour, où arrivent les navires plus nobles et transportant les marchandises les plus précieuses, aussi bien de
Venise que de toute autre partie d’Europe. Il y a un autre port, celui de la chaîne, où accostent les navires en
provenance de Barbarie, c'est-à-dire de Tunis, ceux de Gerbo et d'ailleurs.
Les chrétiens doivent payer dix pour cent de douane et les mahométans cinq pour cent, aussi bien à l’entrée
qu’à la sortie, mais on ne paye rien sur les marchandises qui sont transportées au Grand Caire par voie
terrestre.
Ce port est actuellement le plus noble port d’Égypte, car il est près du grand canal ; on y vend une infinité de
marchandises et les marchands y accourent de toutes les parties du monde.
Dans cette ville, la plus grande part des habitations sont situées dans un coin de la ville, près de la porte
donnant sur la mer ; là se trouvent de nombreuses boutiques et auberges où habitent les chrétiens ; de
même du côté du levant jusqu'au ponant, il y a une longue rue avec des habitations : tout le reste est détruit.
Tout cela arriva ainsi : lorsque Saint Louis Roi de France fut délivré des mains du sultan, le roi de Chypre,
accompagné de galères de Vénitiens et de Français, assaillit Alexandrie à l’improviste, la saisit, la pilla et tua
une infinité de gens. Mais le sultan, venu en personne pour secourir la ville avec une grande armée, voyant
qu’il ne pouvait pas la défendre, y mit le feu et y brûla toutes les maisons, puis s’en alla en la laissant dans
cet état.
Le sultan restaura ensuite les murailles, du mieux qu’il put, et fit construire la forteresse qui est au-dessus du
port ; et il la remit petit à petit dans l’état dans lequel elle se trouve à présent.
Il y a dans la ville une grande colline, très haute, semblable au mont Testaccio de Rome, au sommet de
laquelle se trouve une petite tour ; il y a là en permanence quelqu’un qui guette les navires qui passent,
informant chaque jour les agents de la douane.
Presque toutes les maisons de la ville sont bâties sur de très grandes citernes voûtées et sur de grosses
colonnes et arcades ; ces citernes reçoivent l’eau du Nil. C’est pourquoi lorsque le Nil croît, l’eau y arrive par
un canal creusé artificiellement dans la plaine, et qui réunit le Nil à Alexandrie ; il passe sous les murs de la
ville et arrive, comme je l’ai dit, dans les citernes dont l’eau devient trouble et boueuse ; c’est pour cette
raison que, l’été, beaucoup de gens tombent malades.
La ville est située au milieu d’un désert de sable, de sorte qu’il n’y a pas de terrain cultivable, non seulement
pour les jardins, mais même pour les semailles. Ils font venir le blé d’une distance de 40 milles ; et bien
qu’au bord de ce canal, par où arrive l’eau du Nil, il y ait quelques petits jardins, il n’y a de fruits qu’en petit
nombre ; ils ont peu de goût et sont très dangereux, provoquant des fièvres très graves.
Il y a dans cette ville de nombreux chrétiens Jacobites, qui ont leur église où se trouvait autrefois le corps de
saint Marc Evangéliste, enlevé en cachette par les Vénitiens, et transporté à Venise à peu près en l'an
278 de l'Hégire, c'est-à-dire environ 900 ans après la naissance du Christ Notre Seigneur. La plupart de ces
Jacobites sont des artisans et des intermédiaires, et payent le tribut au Grand Turc.
Strabon qui vécut à l’époque d’Auguste et de Tibère, parlant dans le livre 17 (p. 798) de la richesse et de la
grandeur de la cité d’Alexandrie, alors province romaine, dit ceci :
« Ce site d’Égypte est apte à recevoir tout ce qui vient par mer, grâce au port, et tout ce qui se transporte par
terre, puisqu’il y a le Nil, qui achemine les marchandises si facilement. C’est pour cela que c’est la ville de
commerce la plus riche au monde. Réellement les revenus de l’Égypte sont si considérables que Marcus
Tullius dit dans un de ses discours que le roi Ptolémée dénommé Aulète, père de la Reine Cléopâtre, avait
douze mille cinq cents talents d’entrées (si on fait le compte pour cette époque cela représente sept millions
et demi d’or) ; si ce roi, qui fut si pervers et incapable et qui gouverna avec si peu de soin, avait un si fort
revenu, combien grand doit être celui que l’Égypte récupère actuellement qu’elle est gouvernée avec tant de
soin par les Romains, qui ont accru tout le commerce et trafic des pays étrangers et de l’Inde ; en effet au
temps passé on pouvait à peine trouver vingt navires qui ensemble avaient le courage de pénétrer dans le
golfe arabique, alors qu’à présent de très grandes armées vont jusqu’aux Indes, et dans les parties les plus
éloignées de l’Éthiopie d’où de très précieuses marchandises de grande valeur sont amenées en Égypte,
puis de là sont envoyées dans d’autres pays. »
Cette ville fut bâtie, selon ce que racontent les histoires anciennes, par Alexandre fils de Philippe de
Macédoine, et fut fondée, selon ce qu’écrit Julius Solinus, à la CXIIe Olympiade, alors que Lucius Papirus,
fils de Lucius, et Caius Petilius, fils de Caius étaient consuls. De même l’architecte Dinocrate raconte qu’elle
tient la seconde place parmi les choses remarquables qu’a réalisées Alexandre. La ville fut construite au
bord de la mer Méditerranée, avec une très belle architecture, et sur un splendide emplacement, à une
distance de 40 milles au ponant du Nil. Elle fut célèbre par ses maisons, ses palais, ainsi que sa puissance,
comme aucune autre ne l’a jamais été, jusqu’au moment où, tombée entre les mains des Mahométans, elle
sombra dans la décadence, et fut abandonnée par les marchands, aussi bien de Grèce que d’Europe, de
sorte qu’elle semblait inhabitée.
Léon l’Africain raconte dans la huitième partie de sa Description qu’un Pontife mahométan très rusé voyant
la ville inhabitée, imagina un faux récit, et répandit le bruit que Mahomet, dans un de ses écrits, avait laissé
un grand nombre d’indulgences aux habitants de cette ville et à ceux qui y séjourneraient quelques jours,
pour la conserver et y faire des donations : c’est ainsi qu’en peu de temps il la repeupla d’étrangers.
Description de quelques sites particuliers et remarquables en Alexandrie d’Égypte
Nous allâmes un jour avec un père Soccolant425, qui avait été l’aumônier du très illustre Consul, visiter
certains endroits de la ville dignes de mémoire et entre autres le palais dit du Roi Costa, père de sainte
Catherine, vierge et martyre. Nous trouvâmes dans les ruines de ce palais un reste de construction voûtée,
presque enseveli dans les ruines, près de la rue principale ; à cet endroit, de grandes et grosses colonnes
de pierre, couleur de porphyre, sont encore debout. La tradition ancienne dit que ce reste de construction
voûtée fait partie de la prison de cette glorieuse sainte, et l’on dit qu’au milieu de ces colonnes, se trouvait
un petit pilier de marbre, sur lequel fut tranchée sa tête.
Le susdit palais et ses murs sont faits de briques de terre, ou d’argile rouge, et une grande partie des
murailles est encore debout ; celles-ci nous prouvent que c’était une construction tout à fait étonnante, non
seulement par ses dimensions et sa beauté mais par l’épaisseur de ses murs, grâce à laquelle ils sont
encore conservés de nos jours.
Nous allâmes ensuite à l’église de Saint-Sabba, où demeurent les Grecs, bien que dans l’église il y avait une
chapelle de sainte Catherine tenue et utilisée par les chrétiens francs, avec tout l’appareil nécessaire pour
célébrer la sainte messe ; dans cette chapelle une lampe est allumée en permanence. Devant la chapelle,
se trouve ce pilier de marbre, sur lequel la glorieuse sainte eut la tête tranchée ; il est protégé par des
barrières de bois, où par une ouverture on peut aisément le toucher et le voir. Ce pilier est en marbre blanc
très fin, d’un peu moins de cinq palmes de haut (ou de long), et d’une palme et trois-quarts de côté ; sur
chaque côté de carré une croix de même marbre est gravée, et à chaque angle il y a une moitié de colonne
en demi-relief ; au sommet du pilier il y a un trou, de la dimension d’une main ; à l’ouverture du trou le
marbre est taché de rouge, ou couleur sang ; on dit que le précieux sang de la tête de sainte Catherine était
tombé dans ce trou et que, par miracle, ce pilier a été tellement teinté et taché qu’on ne peut d’aucune façon
enlever cette tache ni l’effacer. Mais certains, par manque de respect des choses – d’autant plus que ce
marbre est très dur- ont voulu en détacher des éclats, ou reliques, sans se soucier d’abîmer ces sculptures
et ces très belles oeuvres.
Un autre jour de fête, soit un dimanche, nous allâmes très tôt à l’église où l’Évangéliste saint Marc prêchait à
l’époque où il vivait dans cette ville. Cette église est tenue et gardée par des Coptes qui y officient, lesquels
se sont déjà soumis les années passées à l’Église Romaine ; pour cela il leur fut accordé des livres pour
officier. Nous arrivâmes alors qu’ils avaient commencé l’office dans leur langue ; puis ils célèbrent la messe
avec beaucoup de dévotion et de belles cérémonies, ce qui nous a fort édifiés ; cet office et cette messe
sont beaucoup plus longs que ceux de l’Église Romaine. Ceci fait, nous visitâmes, à côté de l’autel principal,
l’endroit où reposa longtemps le corps de saint Marc après qu’il eut été martyrisé, et la chaire où il prêchait.
Eusèbe dit que ce saint fonda à Alexandrie la première école de l’Écriture Sainte ; on dit aussi que dans
cette ville saint Marc ayant conseillé à certains de se retirer dans les montagnes, d’habiter dans des grottes
et d’y mener une vie solitaire, ils furent si nombreux à le faire que Philon le Juif, écrivant à cette époque,
raconte comme une chose merveilleuse, combien ils avaient été nombreux à mener cette vie et les
difficultés qu’ils avaient à rencontrer, louant leur charité, leur dévotion et toutes autres sortes de vertu.
Les Prélats de cette ville après saint Marc furent Athanase et Cyrille. Le patriarche d’Alexandrie est second
en dignité ; il est métropolite d’Égypte, de cinq villes de la Libye et de plusieurs autres provinces.
La chaire de saint Marc dans cette église est plaquée de marbre très fin, blanc, avec des incrustations de
porphyre, embellies par des morceaux de nacre, ce qui est très beau à voir et comme elle est surélevée, on
y monte par un petit escalier. Quelques-unes de ces incrustations manquent ; je crois qu’elles ont été prises
par dévotion. Cette chaire est placée à droite de l’autel et à gauche se trouve cet endroit où était le corps
très saint, mais qui n’est pas aussi vénéré qu’il devrait l’être.
Ayant ainsi tout visité, nous retournâmes à notre logement pour écouter la sainte messe latine.
Comment nous partîmes en direction d’Italie et de la Sicile
Mardi 10 août, invoquant d’abord la grâce de Notre Seigneur, nous nous embarquâmes au port d’Alexandrie
à 18 heures sur un galion français, chargé de marchandises variées qu’il transportait à Marseille. À
l’embarquement montèrent à bord avec nous de nombreux officiers de cette ville, aussi bien des officiers de
la douane et de l’octroi, afin de vérifier les marchandises expédiées à la douane, que des officiers de la
justice pour voir si sur le vaisseau Il n’y avait pas une de leurs femmes ou quelque chrétien esclave fuyant
sans avoir de document d’affranchissement, ou bien quelque Turc ou More captif des matelots ; et là, après
une minutieuse inspection, ils prélevèrent des droits, sur le propriétaire du vaisseau et sur la cargaison, ainsi
que des boissons, et donnèrent l’ordre que nul n’osât faire embarquer d’autres personnes ni d’autres
marchandises sans leur autorisation, sous peine de châtiments graves. Mais comme la sortie de ce port est
très difficile pour les navires de haut bord, nous demeurâmes dans ce port tout le restant du jour et de la nuit
suivante, plus par nécessité que pour autre chose.
Le mercredi, n’ayant pas de vent pour pouvoir sortir du port, on fit une manoeuvre : ils emportèrent une
chaloupe ou petite barque du navire, les ancres qu’ils jetèrent à la mer lorsqu’ils se furent suffisamment
éloignés du vaisseau ; puis sur le navire, au moyen de roues en bois, ils tirèrent le vaisseau jusqu’à l’endroit
où se trouvaient les ancres ; et répétant de temps en temps la même manoeuvre, nous nous éloignâmes du
port de six milles environ. »
- 349 - 351 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
17e siècle |
STEFANO MANTEGAZZA (été 1600)
Mantegazza, S., Relatione tripartita del viaggio di Gerusalemme, Milan, 1616.
Stefano Mantegazza, natif de Milan, porte l’habit de saint Dominique en 1600. Il meurt de la peste en
1630.426
p. 60-73 :
« Andava dunque il nostro Naviglio solo con la vela del trinchetto di Prora, il Roccheto parimente di Prora, la
cinadera, la qual vela tocca sempre l’acqua avanti la detta Prora, & è la più bassa vella di tutte l’altre, & cosi
andavamo innanzi facendo honesto viaggio per tutta la seguente notte, & allo spuntare dell’Aurora ben’per
tempo il detto Padrone uscendo al chiaro, conoscere, & s’accorse, che si scoprivano le palme d’Alessandria,
delle quali è quel paese d’honesta abbondanza ricco, benche di miglior perfettione siano quelli di Barberia.
Di questa nuova ne sentirono tutti allegrezza dal primo all’ultimo, poiche prima del nostro intento, arrivassimo
al desiderato Porto ; & (p. 61) se per lo sospetto d’essere, o non essere terra ferma non si levavano le vele,
al certo la nostra Nave giungeva prima della meza notte in Alessandria, come v’arrivo, & prese Porto la
mattina seguente ; fece poi il Padrone sparare un prezzo d’artigliaria, per dare aviso à quei Signori Mercanti ;
che colà stavano con tanto desiderio ad aspettare le loro care, & pregiate mercantie.
Subito che fu quello pezzo sparato fece il Capitano porre all’ordine una salua di venticinque tiri, benche
fossero se non pezzi deciotto, & tutti noi che’eravamo sopra la piazza della Nave, & altri sotto al Cassero si
partimmo da’nostri luoghi particolari, salendo ad alto per dare luogo à Bombardieri, sino che fossero sparati
quei pezzi apparecchiati, il che fu ad honore di Dio per ringratiarlo delli rivevuti beneficii, & in segno
d’allegrezza che tutti sentivamo ne’cuori nostri, per essere giunti a Porto sicuro, dopo un lungo, faticoso, &
pericoloso travaglio di giorni ventinove, che si scette a penare con quelle angoscie di Mare, che si patiscono
in simili viaggi, benche l’havessimo più che felice, di che ne sii lodato il Signore.
Havessimo dunque contento tale, che per dolcezza non potevamo contenersi dalle lagrime, & quasi
havevamo rossore appresso di quelli che ci miravano in faccia, versando gl’occhi sopra le guancie in
grandessima abbondanza le lagrime.
Sparate che furono le sudette artigliar, & salutato il Porto, & la Città insieme per commandamento del
Capitano, vennero ad incontrarci nelle Fregatte Moresche (giubilando) quei Signori Mercanti, stando il nostro
vascello discosto d’Alessandria non più di due o trè miglia, facendo gran festa, & mostrando molti segni di
particolare allegrezza, & da lungi alzando fortemente le voci, salutavano il Capitano della nave ; con tutti
quei Mercanti ch’erano dentro, & tutti insieme erano tanto allegri, che non capivano in loro medesimi, per lo
contento, che nell’interno loro sentivano : & non è meraviglia, che facessero tanta sesta, posciache che il
viaggio va bene diventano per le mercantio ricchi in una sol volta.
Approssimatisi poi alla Nave, entraronui dentro, & strettamente insieme abbraciandosi gl’uni, & gl’altri con
mille baci in fronte in segno di stretta amicitia, alzandosi cosi abbraciati in aria con sereno viso, lagrimavano
di souerchia allegrezza ; fatti dunque fra loro li soliti saluti, & dovute accoglienze, diedero il buon’giorno al
Reverendo Padre Guardiano, poi a tutti gl’altri, dicendoci, siate tutti i benvenuti ; offerendosi la propria casa,
& loro spese raccetandoci più che volentieri. Mentre dunque si facevano i detti compimenti s’accostammo
un’miglio vicino alla desiderata Città d’Alessandria da Mori chiamata, Scanderia, ove il Padrone fece calare
le vele, e gettare l’Ancore in Mare, dando al fondo, & fermandosi la Nave un’miglio discosto della spaggia
d’essa Città o poco più.
(p. 62) Uscivi noi tutti di conseglio, & licenza del Padrone, & entrati in una delle Fregatte di quei Mori bianchi,
s’avicinammo al lito, ove è fabricata novamente una buona parte della Città, e tuttavia ogni giorno si va
fabricando. Nell’uscire della Fregata in terra, uno di quei Mori s’accosto al mio compagno, toccandogli il seno
con ambedue le mani, cosi per ischerzo ; si conturbo il compagno di quell’atto, & s’impallidi un’poco in faccia,
vedendosi palpare da colni, che pareva un’negromante, dubitando di maggior male, si pose a ridere quel tale
dicendo, ti non dubitar, che non far mi à ti mal, ma veder’se ti in sen haver cosa da mangiar, onde il
compagno, & io si mettessimo à ridere cosi di buona voglia, che per molti giorni prima non haveva cosi di
cuore riso, mosso da quel ridicoloso modo di parlare mezo Italiano, & mezo Marinaresco, come à punto
sogliono favellare i nostri Tedeschi quando vengono in Italia.
Dimando colui della Fregatta la sua paga, & non havendo noi denari minuti per sodisfarlo, s’accontento il
buon meschino d’aspettare il nostro commodo, il che forli non sarebbono i nostri Barcaruoli, buona parte de
quali è a morevole, come sono l’arpie il che sii detto con riserva de’cortesi, se bene frà similgente il ritrovare
un’amorevole è come se frà le mosche se ne trovasse una bianca.
Sbarcati che fummo al lito, restai molto maravigliato, parendomi d’essere entrato in un’mondo novo,
mirando, & rimirando in ogni parte, stupido della vaghezza di quei paesi non mai più da me veduti, con nuovi
costumi, & come à me nuova era la Città, cosi parimente nuovo era il linguaggio mischio di Moresco, Arabo,
Schiavo, Turchesco, Hebreo, Raguseo, & altre incognite lingue, come Greca, Indiana, & Soriana ; nuove
erano le genti, nuovi li riti, i costumi ; nuovi gl’animali, che ne’nostri paesi non ve ne sono, come Dromedarri,
Cameli, quali trovammo per la strada, che portavano mercantie.
Passassimo ancora una Moschea, nella quale s’insegnava la Legge Maomettana ad’una gran moltitudine
de’sigliuoli, che più tosto non apprendessero quei figli il precipitio all’inferno, che la via della legge vera,
essendo quella falsissima, & apunto legge che lega le loro anime con catene di fuoco nel baratro infernal, e
nostro Signore apra loro gli occhi della cieca mente, come cieca fu quella del suo perverso institutore, &
falso Maometto ; all’hora passando noi con gli occhi bassi à terra, senza far’alcun motto, stringendo le labra,
e le ciglia inarcando, levai la mente al cielo ringratiando Iddio, che per sua misericordia non era nel numero
di quelle perdute anime della Setta Maomettana, & che m’havesse raccolto nei grembo de Fedeli, onde hora
altro non mi resta, suor’che di pregare sua Divina Maestà, che mi faccia buon Religioso, accioch’io possa
osservare quanto nella mia’professione promisi à Dio, alla Vergine Santissima, & al mio Padre San
Domenica, di cui io sono indegno figlio. Entrati nella Città fummo condotti al (p. 63) Fondico de’Signori
Venetiani, da quali gratiosamente raccolti, & ben’trattati, andassimo di lungo à ringratiare la Maestà Divina
de ricevuti beneficci nell’oratorio, che essi hanno nella loro casa, nella quale si celebra la santa Messa tutte
le feste di precetto, & di più ancora alcuni giorni della settimana.
Della Città d’Alessandria, Metropoli dell’Egitto, del Sito, dispositione, & sue qualità. Cap. XI
Fu la città d’Alessandria per commandamento d’Alessandro Macedone, quando ritorno dall’oracolo
d’Ammone edificata dall’Eccellentissimo Architetto Democrate, nella Centesima, e duodecima Olimpiade,
come scrive Giulio Solino ; era anticamente detta Scanderia, & è la prima Città, che si trovi nell’Egitto, quale
fu ne’primi anni grande, & nobile, come si puo chiaramente dal le gran due ruine conoscere ; è fabricata
verso la Libia nel termine della solitudine dell’Arena, onde à pena usciti dalle fortezze di detta Città verso
Ponente, si camina per larenoso deserto il quale in modo alcuno non può essere ne coltivato, ne seminato.
Non è molto discosta questa Città dalla Porta del Nilo, laquale da alcuni viene chiamata conquesta voce
Heracleoticon, & da altri Canopicon, nondimeno al presente s’adimanda Ressit, & è discosta dà ruscelli di
quel fiume cinque o sei miglia ; & alcuni di quei ruscelli, mentre che il Nilo va crescendo, sboccano, &
allagano tanto, ch’arrivano in fino alla Città per meati soterranei, riempiendo abbondantemente tutte le
citerne, che sono in detta Città per uso commune de’paesani, & con la medessima acqua adacquano anco i
loro giardini, che sono dentro, & fuori della Città.
Ritrovandomi in un’ Monastero de’Religiosi Greci, vidi che’adacquavano il loro Giardino col mezo d’una ruota
alla quale erano legati molti vasi di terra tutti d’una forma, e ben’disposti intorno à quella con proportionata
distanza l’uno dall’altro, la quale si raggirava prendendo l’acqua dal sudetto fiume Nilo, & votandosi poi in
un’canale di legno, & con tal dispositione era l’acqua distribuita in quei luoghi, ove era il bisogno, & di ruote
tali ve ne sono senza fine nell’Egitto alla ripa del Nilo, & nelle case particolari ancora per adacquare tanti, e
tanti Giardini, & in somma non si vede altro, per cosi dire, che di queste ruote, & puochi luoghi vi sono, che
non ne habbino, facendole girare da Cameli, & Cavalli, & altri loro animali, & molte volte lo sanno da loro
stessi per mancamento di giumenti.
Questa Città, mentre Iddio la favori, che fosse posseduta da Christiani, ottenne il secondo luogo frà le
Chiese Patriarcali, & il primo (p. 64) fosse, delle Libia, di Pentapoli, & di molt’altre Provincie ; ma con gran
suo danno ritrovasi hoggi nelle mani de’nemici nostri, prosanatori della Christiana Religione, onde lasciando
loro il titolo del suo generoso nome, non Alessandria, ma Scanderia (come se detto) vien chiamata, si come
Scandarona chiamano quell’Alessandretta ancora, alla quale facevano scala tutti gli Vascelli, che andavano
in Oriente, ma da quattro, o poco piu anni in qua, non in Scandarona, ma in Tripoli di Soria fanno ricapito per
la buon’aria si come per essere pessima in Alessandretta, se ne sono da quella ritirati i Mercanti.
E questa Città d’Alessandria molto commoda per le mercantie ; hà due Porti l’uno dall’altro separato per
mezo d’uno stretto di terra, che tiene la forma d’una lingua, in capo del qual separatamente ci è la gran Torre
chiamata il Farro, la qual fù edificata da Tolomeo Filadelfo Rè dell’Egitto sopra un’vino sasso combattuto
dall’onde del Mare, la qual Torre è eminentissima fabricata di bianchissime pietre, & fù l’architteto Sostrato
Cnidio valentissimo huomo in tal’arte d’architettura ; & con tanta maggnificenza, & splendidezza, che come
alcuni scrivono si spesero ottocento talenti, & ciascun’talento vale centaia de’scudi, che percio dù
annoverata frà le sette meraviglie del Mondo, & la fece il detto Rè edificare solo per commodità de’naviganti,
accio che dallo splendore del lume, che di notte sopra questa Torre acceso si teneva, più agevolmente
trovassero l’entrata del Porto, & fosse loro guida per ricoverarsi in luogo sicuro, accio per disaventura non
inciampassero in qualche scoglio con pericolo di rompere il Vascello, & perdere la robba, & la vita. Quest’è
quel Filadelfo, che in Alessandria fece fare quella si famosa liberaria, nella quale per opera di Demetrio
Falereo che di essa fece Prefetto, vi fece porre la sacra Bibbia translata dalli 72 Interpreti, la qual dopo molti
anni fù da quel monstro di natura Diocletiano Imperatore fatta abbrusciare huomo maligno, diabolico, figliuol
del Diavolotanto nemico del nome di Christo.
Costui lascio l’Imperio per non poter estirpare il nome Christiano : posciache se né faceva morire mille, se ne
convertivano alla fede di Christo per essempio due mille : onde per questa gran conversione ch’ogni giorno
si faceva, si despero l’iniquo e depose l’Imperio del quale ne fù sempre indegno, era di natione Schiavone.
Il numero de libri, che furono abbrusciati della detta Filadelfica libraria per commandamento del detto
Diocletiano, come habbiamo per l’Historie, furono da settecento mille volumi d’inestimabile costo.
Vengono ancora in questa Città abbondantemente per il Nilo le cose necessarie dal paese dell’Egitto, & in
particolare sono qui trasportate gran mercanti di speciarie, pietre pretiose, gioie di gran valore, & d’altre sorti,
scendendo le medesime mercantie non solo dall’Indie, ma da tutte due l’Etiopie, & da tutte quelle vicine
Provincie, venendo (p. 65) per lo Mare Rosso per un’luogo detto Aideb, o secondo altri Aidem, il quale siede
al lito del Mare, atrivando poi in Alessandria per il fiume Nilo, & per occasione di queste mercantie vi
concorrono Mercanti da Levante, Ponente, & d’altre principali parti del Mondo.
Et se non fosse il gran concorso de’Mercanti, che colà trafficano, & in particolare dalla Barbaria, da tutto
l’Oriente, & dalla Christianità, rispetto al gran Porto, che è del Gran Cairo, essendone scala, sarebbe poco
meno che dishabitata, poiche v’è per dispositione naturale pessima aria, massime quando il Nilo è tagliato
per soccorso delle campagne, & si taglia circa alla meta del mese d’Agosto, adacquandosi quei paesi per
tutto il mese d’Ottobre, & perche arrivammo noi colà in quella stagione, io ne sentii in quel tempo un
indicibile, dolore di capo oltreche la mattina quando mi levava dal letto, mi pare va per lo spatio di trè hore,
ch’io fossi senza capo si che à pena mi poteva reggere in piedi ; se bene poscia tutto il restante del giorno
mi sentina assai bene.
Rendesi parimente nobile questa Città per lo martirio di gran moltitudine de’Santi, che per amore di Giesu
Christo con la loro constantissima patienza superarono tutte le crudelta de’Tiranni, che percio hora trionfano,
coronati di gloria in Cielo, il numero de’quali è solo da quel Dio conosciuto, per lo cui amore il sangue
sparsero. In particolare fù in questa Città Martirizata la Santa sposa di Christo Caterina Vergine, & martire,
che per particolare privileggio fù favorita dal Signore in questo, che ogn’uno che di lei divoto fosse, non gisse
dannato, ma in Ciolo perpetuamente godesse l’eterna beatitudine, come si dirà nel seguente capitolo.
Della Pietra sopra la quale fù decapitato S. Gio Battista, & di quella eretta in titolo, nella quale fù posto il ferro
della ruota di S. Caterina, & d’un altra ove fù decapitato S. Marco & d’altre cose simili. Cap. XII.
In questa Città d’Alessandria v’è la Pietra, che fù portata dalla Samaria, dico dalla Città di Sebasten, sopra la
qual, come si dice, fù decapitato il gran Santo Gio. Battista Precursore del Figliuolo di Dio, ad honore del
quale fù edificata una chiesa e successivamente ivi vicino il Convento, & Chiesa di Santo Sabba Abbate,
dove è una Capella di Santa Caterina martire nell’entrare in Chiesa à man’manca, al qual Altare celebrano
tutti gli Sacerdoti latini, & vi celebrammo noi Domenicani ancora per gratia del Signore. (p. 66)
Vicino à quest’Altare da fei o otto passi in circa c’è la Pietra eretta in titolo d’una base di colonna, nel centro
della quale v’è un buco di figura sferica della grandezza d’un’ostia, nella quale (come ci fù detto) fù posto il
ferro, che sosteneva la Ruota di Santa Caterina, la qual Pietra d’ogn’intorno, tanto fuori, quanto dentro è
macchiata del Sangue della Santa Martire, & dicono alcuni, che sopra di quella fù decapitata : io non fui
presente, ma presente, ma l’istesso bucco è causa di questa controversia, o sia l’uno, o l’altro ; certo è che è
stato lo stromento del martirio suo ; ma è più credibile la prima opinione, & più conforme al vero, & alla
ragione.
In questo convento di S. Sabba, il qual hà del sotterraneo, & fabricato al modello di quei conventi antichi
de’Santi Padri, vi fà ordinaria residenza il Patriarca d’Alessandria con molti religiosi Caloiri Greci, i quali
vivono con gran rigore, & austerità divita, & in particolare quel Patriarca, ch’all’hora vivena, nel dormire,
vestire, & vivere era sopra modo rigoroso, non havendo altro per suo letto, che un’tapeto Cairino sotto la sua
persona, & non mangiava più d’una volta ogni due giorni, & bene spesso per certe sue divotioni saria stato
trè continui giorni senza prendere cibo alcuno, per quanto ivi mi fù detto da più persone.
Andassimo poi con certi Padri Zoccolanti da parte del Padre Guardiano à visitare detto Signor Patriarca, &
presentarlo di cose portare dalla Lombardia, ch’egli volentieri, & gratiosamente accetto, ringratiandone di
cuore quei raccolse tutti con molt’affabilità, & dopo l’havere discorso alla lunga di più cose dell’Egitto, ci fece
bere, & mangiare certi biscotti, & la bevenda fù la più delicata malvasia, ch’io gustassi mai à giorni miei.
Questo Signor Patriarcha, benche fosse di natione Greco, havea pero buona lingua Italiana, & havea
studiato alcuni anni nella Città di Padoa, era huomo molto intelligente, & per le sue mani passavano tutte le
differenze della sua natione, acquetandole con tanta gratia, & faciltità, ch’ogn’uno gli restava obligatissimo.
E questo Monastero discosto dalla Città circa un’miglio, al quale più volte col compagno, mentre
dimorassimo in Alessandria andavamo per nostra divotione ad orare ; V’andammo ancora à cantare una
Messa ad’honore della Santa, & fù il decimo giorno d’Ottobre in martedi insieme con tutti, o la maggior parte
de’Padri Zoccolanti della famiglia.
Nel sudetto luogo, ove è la situata la detta Chiesa, o sia Capella di Santa Caterina furono abbruggiati quei
ducento Filosofi insieme con quel gran Capitano Porfirio, & suoi compagni nati per il Cielo, i quali per li nome
Santissimo questa presente vita col propio sangue comperarono la futura eterna del Cielo. Si vede questa
Città il Patriarcato (p. 67) del Grandi Elemosiniero S. Giovanni, del quale si leggono gran cose nelle vite
de’Santi Padri, qui termino i giorni suoi, & qui anco è sepolto ; se bene questa Chiesa, con infinite altre, sia
hoggidi fatta Moschea de’Saraceni, qui anco furono Vescovi quei gran defensori della Chiesa, Atanasio, e
Cirillo, amendue Dottori illustri della nostra Santa Madre Chiesa, & qui ancora furono sepolti, se bene forse
di presente i corpi loro riposano altrove.
In mezo à questa Città, v’era una Pietra di figura circolare, sopra la quale (per quanto ci fù detto da quei
Signori Mercanti, & da Religiosi) fù tagliato il capo all’Evangelista San Marco, se bene da molti anni in quà fù
levata da quei Mercanti nel buio della notte per timore de’Mori, & fù da loro in luogo più secreto trasferita,
con intentione di farla condurre à Venetia con quella maggior secretezza, che possibil fosse ; ma quando fù
levata da quel luogo, si levo anco un’temporale tanto spaventoso, con tuoni lampi, e saette, ch’all’hora
ogn’uno si teneva morto, stimando, che dovesse la Città d’Alessandria profundare, & si dubita, che forsi cio
nascesse per lo movimento di quella Pietra, la quale è ancora colà in detta Città, sotto al dominio pero
de’Signori Venetiani nascosta.
Si mostra ancora il propio luogo, ove il detto Santo il giorno di Pasqua celebro la sua Santa Messa, nel qual
punto quei pagani gli possero una fune al collo, strascinandolo infino ad’un luogo detto Buccoli, vicino al
Mare sotto certe rupi, & ivi fù martirizato, e sepellito, dove fù poi da Christiani fabricata una bella, &
ben’adornata Chiesa ; dopo molto tempo fù d’indi’quel Santo Corpo trasportato à Venetia, nella insigne
Chiesa di San Marco Protettore di quella nobilissima Republica.
Dice un’Giovanni felice Astolfo, che non sapendo i Signori Venetiani il propio luogo nella Chiesa di San
Marco, ove riposasse la Santa Reliquia del suo Corpo per la morte de custodi, che lo sapevano, vennero ad
una determinatione, come diro sotto la felice memoria del Doge Vitale Faliero, cio grandemente spiacendo à
quel’Eccellentissimo Senato, & alla Città tutta, quantunque nissuno ponesse in dubio, che quel Santo corpo
ivi non si trovasse, é temendo di doverne essere dal mondo di negligenza incolpati, fece
quell’Eccellentissimo Senato publicare un’solenne digiuno di trè giorni, che fù l’anno di nostra salute 1094 il
quale fù da ogni Fedele con particolare divotione essquito.
Passati li trè giorni corse il giorno di San Pietro Apostolo, che si celebra li 29 di Giugno, nel qual di fù
ordinata una solenne Processione, à fine che Iddio benedetto per i prieghi de’Fedeli si degnasse di
manifestare il luogo della depositione d’un tanto tesoro, & venuto il determinato giorno, scese il Serenissimo
Duce di Venetia accompagnato dall’Illustrissima Signoria nel Tempio, concorendovi d’ogni lato (p. 68)
grandissimo numero di popolo, ove uditasi la messa, si comincio con gran fervore di spirito ad avuiarsi la
Processione, in tanto non fù tardi il signore ad essaudire quei accesi, prieghi, & fece alla presenza de tutti
scopire miracolosamente il luogo, ove se ne stava nascosto il Santo Corpo, in modo che spezzatisi da se
stess quei duri marmi ch’erano posti d’intorno ad un’certo pilastro, o fosse colonna quadrata di molte pietre
insieme congiunte fabricata, che a punto è quella ove al presente è situato l’Altare di San Giacomo,
commincio pian piano à moversi dal detto luogo, & à comparire in vista d’ogn’uno una picciol arca, che
rinchiuso tenea il Sacro Corpo. Indianc’essa da se stessa ma ravigliosamente apprendosi ; da quel
Serenissimo Duce, & da tutti gl’astanti lasciaronsi quelle sacre reliquie vedere, sentendosi per tutto il tempio
un’odore saovissimo.
Vedutosi con grande stupore de tutti cosi celebre miracolo, non si potrebbe spiegare il giubilo universale de
tutti, per lo che furono di tenerezza sparte abbondantissime lagrime, & al fine da tutti ringratiato il signore,
con lode del santo, che tal gratia havesse loro conceduta.
Et mentre cio si fa ceva fù anco visto da tutti in un’dito della mano del santo un’Anello d’oro, onde piacque a
Dio, che succedesse un’altro miracolo non minore del primo ; & fù che ritrovandosi con altri Gentilhuomini
uno questo santo, che l’Anello diligentemente osservato haveva nell mano del Santo, s’accese in lui gran
desiderio d’haverlo, onde supplichevolmonte lo prego, che si compiacesse di fargli gratia d’un’tale, & tanto
dono, cosi avicinatosi al Santo Corpo, per far’prova s’ottenere lo poteva, gli riusci fallito il suo disegno,
perche non potendo trarglielo di dito, conobbe per quell’isperienza non essere volere di Dio, che l’havesse.
Ne solamente hebbe tal desiderio questo Domenico Delfini, ma il duce, il Patriarca, il Vescono, & altri nobili
Signori della Città, che in cio di santo desiderio accesi tutti gareggiavano d’haverlo ; ma il tutto fù vano,
perche ritrahendo à se il santo la mano, con l’anello, diede evidentissimo segno, che non era di suo volere,
che alcuno l’havesse. Non si smari percio il gentilhuomo ma perseverando in lui la sede, & la devotione,
torno di nuovo, pure con ardente desio, & con novelle lagrime à chiederlo con maggior’instanza di prima à
fine che ottenendone la gratia, qualunque, suo divoto l’havesse havuto à dosso, fosse sanato da qual si
voglia infermita l’occupasse per inercessione del Santo, che tale, e non altra, era l’intentione sua : à questo il
Sant’Evangelista le porse la mano con l’Anello, che prima l’havea à se ritratta, quasi che glie ne facesse
un’libero dono ; onde lieto percio il gentilhuomo, lo prese con grandissima sua consoltaione a commune
benefitio degl’infermi ; per quest’Anello seguirono in successo di tempo meravigliosissimi effetti à pro
de’mortali.
(p. 69) Passo questo nobile à suo tempo à vita migliore, lasciando con perpetua successione herede, di
detto Anello la sua famiglia, se bene poi Lorenzo Delfini ne fece un’libero dono alla scuola di san Marco,
perche fosse portato in processione ogn’anno nel giorno di tale apparitione alla sua Chiesa, il che fù per
molt’anni essequito ; infino all’anno 1575 quando per sciagura, & con universale dolore della Città fù cosi
pretioso tesoro rubbato insieme con altre tante reliquie da un’huomo scelerato, il qual poscia venendo alle
mani della giustitia, hebbe fra le due colonne poste appunto sopra la piazza di San Marco, il meritato
castigo ; & avanti che fosse questo ribaldo preso, volle iddio, che un’suo sigliuolo, che’l padre aiutava à far
liquefare l’Anello nel fuoco, ne havesse anch’egli la sua parte della pena, cadendo miserabilmente in esso, &
terminando infelicemente i suoi giorni senza che potesse essere in modo alcuno soccorlo dal presente
Padre, il che fù stimato da tutti particolare giudicio di Dio.
Et perche quell’Anello non era d’oro fino, non puote lo sciagurato dall’orefice, à chi lo vendette, transmutato
in una picciol verga, cavarne più d’un’Ducato in circa, ove per giusto giuditio di Dio, essendo stata la verga
posta dall’orefice nella borsa, dopo ch’hebbe dato al ladro lo scambio, sparve in modo, che ne lui ne altri la
videro mai più, come anco ne sanno manifesta testimonianza molte persone degne di sede.
Ho voluto qui raccontare questa santa, & curiosa Istoria à gloria di Dio, & honore di questo Santo
Evangelista à questo proposito ; essendo io stato in quella Città d’Alessandria, nella quale, come gia dissi
sono stati martirizati tanti martiri di Christo fra quali uno fù il Protettore di Venetia, San Marco Evangelista,
che con la sua gran charita, & patienza s’acquisto la corona del martirio ; & io non solo ho veduto, ma sono
stato sopra l’istesso pulpito, ove il santo predico con ardentissimo zelo, & con meraviglioso frutto delle anime
la parola di dio, & ho vedute altre cose degne d’eterna memoria pertinenti à questo Santo, le qualitaccio per
brevità, sii egli per tutti noi intercessore appresso il Signore, & noi un tanto à lui raccommandandosi
seguitiamo la nostra Istoria.
Si raccontano alcune cose occorse in questa Città d’Alessandria, & in particolare d’alcune nostre attioni.
Cap. XIII.
Mi sono avveduto d’havere con la mia soverchia lunghezza passato molto oltre nel precedente capitolo ma
perche tal volta stà in potere dello scritore la brevita tanto più ove si tessono lunghe istorie secondo le
nascenti occasioni, non ho voluto tacere di dire dubitando che si sarebbe torto all’opera ; saro pero più breve
nel seguente perche (p. 70) tosto voglio con lo scrivere partirmi d’Alessandria, & gire verso Rossetto.
In questa città dunque d’Alessandria vi sono ancora molti vestigii & ruine de’ Monasteri, i quali per la loro
antichità sono hormai affatto smariti ne di presente, à mio sapere, altro vi si trova in piedi, che quello poco fa
da me nominato Monastero dell’Abbate Santo Sabba di natione Greco, & un’altro parimente molto antico
habitato da Caloiri Greci Religiosi, ove ho veduto un’bellissimo appartamento tutto di marmo macchiato di
diversi colori, & di incomparabile spesa : un altra fabrica di simile fattura, bellezza, & architettura ho visto al
Gran Cairo nella casa dell’Illustrissimo signor Consolo ; in questa città in somma non si veggono se non gran
ruine, quali danno chiarissimo inditio che sii stata una delle prime città del mondo, come se detto.
Quivi fu anco decapitato quel famoso Capitano Gallicano, che hebbe quella miracolosa vittoria contro i Sciti
nella Traccia, sotto l’Imperio di Constantino il Magno per la qual vittoria con molta prudenza abbandono il
mondo, sprezzo gl’Idoli, & abbraccio la Christiana Fede, & l’autore di lei Christo Crocefisso, libero cinque
milla schiavi, che stavano alla sua serviti, facendogli dono d’una parte delle sue facoltà, si diede a servire a
poveri peregrini, lavando loro i piedi, somministrandogli l’acqua alle mani, & cibandogli delle sue proprie
facolta, per le quali stupende attioni, era gia sparsa in lontani paesi la fama del Religioso vivere suo, onde
concorrevano da ogni parte del mondo infinite persone a mirare l’opere di pieta, che procedevano da questo
servo di Dio, & partendosi pieni d’ammiratione, & di divotione ancora, ritornavano a loro paesi tutti edificati, &
ammaestrati di quanto havevano veduto nella città di Roma, & Ostia essercitare per mano d’un’tant’huomo,
che era la prima persona appresso l’Imperadore, il quale in un’subito per amore di Giesu Christo scese
dall’alto monte della mondana gloria, al profondo sentiero dell’humiltà ; ma felice, e ben mille volte fortunato
colui, che à questo modo s’abbassera per amore del sopremo signore, poiche questa è la via d’alzarsi al
Paradiso, come appunto dice la bocca della verità, qui se humiliat exaltabitur.
Lascio finalmente il buon servo di Dio, Roma, & Ostia, ove havea la maggior parte delle sue facolta, & dove
haveva fatto soggiorno infino al tempo di Giuliano Apostata, per cagione del quale partitosi, venne in questa
Città d’Alessandria, ove in breve tempo pieno del timore di Dio, & del suo santo amore, più tosto che mai più
offenderlo, ne ritornare al vomito, volle animosamente essere coronato della corona del martirio insieme con
un’suo caro compagno per nome chiamato Hilarino, il che fu per commandamento del sudetto, Giuliano
Imperatore, che apostato dalla Fede : si che hora godono, questi santi martiri, & goderanno in eterno il
premio delle loro virtuose fatiche, (p. 71) & santi essercitti si come il tristo Giuliano nemico di Dio per la sua a
postata, & persecutione fatta a fedeli di Christo, sara senza fine tormentato nelle eterne pene dell’inferno
giustamente dovutegli per i suoi enormi errori.
L’anno 1167 Almerigo Ré di Gerusalemme prese questa città con cinquemilla fanti e cinquecento cavalli,
nella quale erano più di cinquanta milla combatitutti prattici nell’arme, lasciando quelli, che non le sapevano
adoprare, onde essendosi poi restituita, fù in segno della conquistata vittoria posta l’insegna sopra la torre
del Farro, e vi stette infino al seguente giorno, nel quale il Ré commando poi, che al Soldano fosse
consegnata, come a Procuratore, & ministro del Califa, & egli con l’essercito se ne parti.
Sono ancora in questa città di molti bei giardini, vaghi à vedere con molte frutiffere piante, & di frutti
saporitissimi, & molto differenti da nostri, che non ponno domesticarsi col nostro terreno, come la
maggior’parte delle nostre piante non possono in quelle parti riuscire, per essere un’paese troppo caldo, & il
nostro a proportione, troppo freddo.
Vi sono de gl’arbori, che viueranno più di due milla anni, non solo in questa città, ma in tutto l’Egitto, sonovi
ancora molt’arbori medicinali, & molte palme, che producono i dattili, hanno di carne in abondanza :
raccolgono poco grano, il che proviene dalla loro dapocaggine, perche non seminano, & se pure seminano,
lo fanno molto scarmente, non si cura questa natione punto d’arricchirsi, ma basta loro che habbino
poveramente da sostentarsi, onde pare, che non habbino tanti stimoli d’avaritia, come nei nostri hoggidi si
vede, mangiano, anzi si burlano di noi Christiani, & della soverchia nostra commodità.
Si fermammo lo spatio di tredeci giorni in questa città aspettando, che il Signore ci favorisce di prospero
vento, il quale non soffio mai per tutto quel tempo ; un giorno andammo insieme con tutta la famiglia & col
Padre Guardiano, accompagnati dal Signor Console di Francia, che ci pago la vittura de gl’animali a vedere
quella gran’colonna detta Pompeo, se bene per quanto si dice, fù opera di Massentio, o fosse di Massimino,
sopra la quale era un Idolo, che facevano da ciascuno adorare, dando incontanenete la morte a chi ricusava
di farlo ; hora v’é la detta colonna, senza l’Idolo, sopra una grandissima base, la maggior machina non vidi
mai, ne credo di vedere.
Io vidi ancora in piedi più volte passando da quei luoghi tre colonne di bellissimo porfido, le quali (affermano)
che fossero del Palazzo di Santa Caterina. Da questa città infino al Porto del Zaffo, se bene è tutto distrutto
(che secondo la scrittura sacra, non Zaffo, ma Ioppen viene chiamato) vi sono per Mare miglia cinquento in
circa, & (p. 72) da Ioppen sino in Gerusalemme vene sono quaranta lunghe e strette parte in buona, e piana
via, & parte in difficile, & faticola, perche è piena de sassi, & montuosa assai ; ma facendo il viaggio per terra
alla volta di Rosetto, & da qui per il Nilo andando al gran Cairo, & alla città di Damiata, & al Zaffo, o sia
Ioppen, o Porto della Giudea sino in Gerusalemme, v’é lo spatio di mille miglia.
Fermati dunque in Alessandria il detto tempo, si fece isperienza più d’una volta se potevamo vellegiare, per
andare tutti insieme, alla desiderata Gerusalemme, come anco eravano venuti, in Alessandria, ma non fu
mai possibile, che ci favorisce il vento. Al fine il moi compagno, & io facemmo risolutione di seguitar’il viaggio
per la via del gran Cairo, che percio di subito s’ando alla della nave, & ripigliare le nostre robbe si divisero,
rimandando a Venetia la parte me no necessaria per lo scrivano, riportando con noi il rimanente per nostri
bisogni ; & cosi presa licenza dal molto Reverendo Padre Guardiano, dopo haverlo ringratito delli benefici
ricevuti da lui nel viaggio, & presa la sua benedione il di 19 d’ottobre dopo pranso si partimmo d’Alessandria,
come si dira nel seguente capitolo.
Della partenza fatta dalla citta d’Alessandria, & dell’andata a Rosetto, & di quanto ci occorse in quel viaggio.
Cap. XIIII.
Desiderava invero con ardente desio il Signor Console del Cairo di ricevere la divota, & religiosa famiglia
de’Reverendi Padri Zoccolanti, che andava in Gerusalemme alla casa sua nella città del Cairo, come quello,
che era molto pio, & assai affettionato à questa religione del glorioso Padre San Francesco, & ancora per
essere stati da Venetia con lettere molto efficaci raccommandati da primi personnaggi di quella città, onde
dicevano quei Signori Mercanti Venetiani, che all’hora si trovavano in Alessandria a questi Reverendi Padri,
che se bene la via del Cairo era più longa, non era pero tanto pericolosa, come quella del Mare, & che il
Signore Console gli haveria trovato bellissima commodità di navigare con felice passagio in Gerusalemme
per il fiume Nilo, & senz’alcun’pericolo fino a Damiata, & da colà gli havria raccommandati al Viceconsole, il
quale sicurammente gli havrebbe fatti condurre al Porto della Giudea, chiamato (come sopra) il Zaffo, ove
giunti, erano poi sicuri per terra sino in Gerusalemme, & percio si lasciassero consigliare, che à questo modo
gli saria riuscito meglio il loro viaggio, oltre che sariano arrivati sani, & gagliardi in Gerusalemme.
(p. 73) Risiuto sempre tal partito d’andare per la via del Cairo il Padre Guardiano, accettando pero il
buon’animo accompagnato da tante proferte dal Signor Console, che tanto lo desiderava, & con lettere
affettuosissime l’invitava, il che fu non di poco disgusto a quei Padri della famiglia, che ardentemente
desideravano andare per la via del Cairo, tanto per fuggire il Mare cosi noiolo alla maggior parte de corpi
humani, si anco per qualche curiosità di vedere quella città grande e tanto celebre al mondo tutto. Et se
bene fu instantemente da quei Signori Mercanti Venetiani pregato, che lasciando la via del Mare pericolosa
andasse per la più sicura del Cairo per più commune utilità, non ne volle pero fare altro, anzi mentre noi
eravamo in Alessandria, communicato il conseglio con la sua famiglia fece risolutione d’andare per mare, se
bene la risolutione non piacque a tutti.
Partiti dunque noi d’Alessandria il sudetto giorno 19 d’ottobre vicino al tramontar del Sole con alcuni
Mercanti di Venetia, con i quali eravamo venuti, & con alquanti Cameli con un’Gianizzero, & un’Torcimano,
che ci accompagnavano, che fra tutti eravamo quindeci persone, con molti sommari, Cameli, Muli, & Asini ;
che in quei paesi si chiama una caravana, caminammo a buon’viaggio verso la città di Rosetto, &
veleggiarono i Padri Zoccolanti un’paro de giorni dopo la nostra partenza : Ma quando giunsero in
Gerusalemme erano più morti, che viui, si fattamente dibattuti, & stomacati, che per cagione del mare la
maggior’parte di loro era infermata. »
- 352 - 358 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HENRY CASTELA (de la mi-janvier au 6 février 1601)
Amico da Gallipoli, B., et al., Voyages en Égypte des années 1597-1601. Bernardino Amico da Gallipoli,
Aquilante Rocchetta, Henry Castela, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1974.
Le Toulousain Henry Castela est un religieux observantin à Bordeaux.427
p. [201]-[214] :
« Le lendemain seiziesme jour du mois de Janvier, le grand seigneur voulut qu’on commandast par toute la
ville d’Alexandrie, à tous les habitans de faire feste durant trois jours, avecques grande solemnité, en
mémoire de la prinse de Canisie (qu’est une province d’Ongrie apartenant à l’Empereur). Or parce que telles
publications me sembloient aucunement approcher aux feux de joye, & autres actes triomphans, desquels
on a accoustumé d’user parmy la Chrestienté, en pareil cas ; en signe de plus grande joye, les Chrestiens, &
autres Pelerins estrangers, qu’on avoit accoustumé les autres fois de tenir enfermés dans les fontiges, tout
ainsi que des pauvres prisonniers, ils furent mis en liberté durant ces trois jours é licentiez pour aller
esbattre, & voir la solemnité, sans aucun danger. Il n’y aura point d’inconvenient, d’inserer icy
consequemment les ceremonies, qu’ilz garderent durant la feste, jusques au troisieme jour qu’elle devoit
finir, suyvant l’Edict & proclamation, qui en fut faicte, qui furent telles.
Façon de proclamer les festes
Un Turc envoyé par un officier du Soub-Bacha (qu’on appelle entr’eux Cacaya) tel qu’est parmy nous un
Greffier ; à fin d’aller par tous les cantons & carrefours de la ville, sans obmettre aucun lieu qu’on est
accoustumé d’y tenir le marché. Lequel apres avoir faict assembler le peuple tout autour se soy, par un triple
frappement de mains, & semblable prononciation des mots que nous avons par cy-devant plusieurs fois
exprimé, qui sont Alla Cheric, Alla Cheric, Alla Cheric ; c’est à dire, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est
grand ; il commence à leur lire le mandement du Cacaya, suyvant la volonté des missives, que leur Bacha,
ou Soub-Bacha, ont receu auparavant du grand Seigneur, leur commandant de leur part, qu’ilz ferment
promptement leurs boutiques, & se resjouïssent publiquement, sans s’adonner à autre vacation pendant ce
temps là, sur peine de la vie, avec expresses inhibitions, de ne boire point de vin, pour eviter les scandales
qui pourroient interrompre les susdictes festes, s’ilz s’enyvroient : que si aucun contrevient à cela, & n’obeit,
tout aussi tost qu’il est adverty du commandement fait, on le condamne à souffrir tout incontinent cent coup
de baston sur le ventre.
Lors un chacun des habitans soit Chrestiens ou autres, commence de mettre au devant de sa porte les plus
beaux et riches paremens & tapis qu’ils ayent, & y pendre les lampes allumées, tout ny plus ny moings que
nous faisons dans noz Eglises. Que s’il y en a quelqu’un si pauvre qui n’ayt le moyen de ce faire, s’il ne peut
trouver de paremens ny lampes à crédit, il faut de necessité qu’il engage un de ses propres enfans (pour en
recouvrer) en defaut d’esclave ; autrement les rigueurs portées dans le mandement de leur grand Seigneur,
ne luy seront modérées.
On cria aussi par toute la ville, qu’à peine d’estre empalé tout vif, aucun ne fist desplaisir aux Chrestiens
estrangers, bien qu’ilz se pourmenassent entr’eux, pendant les jours de festes, autant de nuict que de jour.
Grande brutalitez commises aux festes
A raison de quoy, je me meslay souvent parmy eux : mais les incestueuses brutalitez, qu’ilz n’avoient honte
de commettre en pleines rües, & en la presence de tous, me donnerent un si grand mescontentement, que
je ne pouvois estimer à bon droict, sinon très-malheureux & detestables devant Dieu & les hommes, tous
ceux et celles de ceste nation, n’ayant rien (suyvant leur humeur) qui ne fust fort contraire à l’honnesteté &
pudicité, taschans à se surmonter les uns les autres, comme à l’envy, à qui pourroit monstrer aux assitants,
plus vilains actes de lubricité, les uns se despouillans tous nuds & se rüans ainsi parmy les femmes, au
signe qu’on leur en donnoit par le son d’une trompette, ou cornet, duquel un de leurs compagnons sonnoit,
apres lesquelles ces pauvres incensés couroient comme chiens. Tellement que beaucoup de ces femmes
ne s’en pouvoient retourner dans leur serrail, qu’on ne les y portast à demy mortes, à cause de la grande
presse qu’ils s’entredonnaient ainsi pesle mesle, en reïterant tousjours les mesmes impudences. Les
Santons mesmes, qu’ilz estiment saincts, estoient au prix des autres tant enragez & eshontés, que toutes
celles qu’ils attrappoient courant apres ny plus ny moins que des incensés, par tous les carrefours de la
ville : elles s’en estimoient bien-heureuses, & s’ils ravissoient encores la virginité de leurs filles, ce leur estoit
un tresgrand contentement, à cause de la participation qu’elles pensoient avoir euë de leur pretendue
saincteté.
Tous les autres qui estoient en leurs maisons, se festoyent entre’eux reciproquement, à qui mieux mieux ;
sauf qu’au lieu de vin, ils ne boivent en tous leurs repas, sinon de certaine eau noire, qu’ils font mixtonner
avec des drogues, pour leur breuvage ordinaire, lequel jamais tant qu’ils vivent, ne leur est defendu. Au
surplus, ils demeurent tousjours apres le repas, assis à leur mode, qui est d’avoir les jambes croisées, ayant
chacun derriere eux, un coussin ou oreiller, à fin d’y reposer leur teste (quand bon leur semble) ou bien un
traversier plus long, selon qu’ils se mettent pres les uns des autres : car alors j’en vis dormir trois sur un
mesme coussin.
Pluye advenue en Egypte en l’an 1601
A suitte de ce, je diray les autres choses que j’ay remarqué en la ville d’Alexandrie (qu’ils appellent entr’eux
vulgairement Scadaria) laquelle est située en un lieu tout sablonneux, & areneux, dont le terroir ne rend pas
grand fruict, estant trop sec ; car il n'y pleut que bien rarement ; ce neantmoins durant le séjour que j'y fis, en
attendant le despart des naves, où je desirois m'embarquer, il survint un tel deluge de pluyes continuelles
l'espace de huict jours, que plusieurs maisons en furent ruinées : dont les gens du pays esperoient une
cueillette de fruicts beaucoup plus abondante, qu’ils n’en avoient eu longtemps auparavant : & mesmes tous
les laboureurs plus experimentés en l’agriculture, le confirmoient. Toute fois on trouvoit l’air si intempéré428
dans la ville, que la plupart des habitans, qui avoient moyen de faire bastir dehors, quittoient la ville pour
aller vivre aux champs (reservé aux jours que le commerce y estoit plus grand) à la charge d’envoier querir
avec des chameaux l’eau des citernes, qui se remplissoient d’eau douce à chaque desbordement du Nil, par
un certain canal qu’ils appellent Caliphe, estant le fleuve esloigné de la ville environ vingt mille ; car
autrement aux environs on n’en sçauroit recouvrer une seule goutte qui ne fust salée.
Pour ce qui est de la ville, ses murailles sont doubles & assez fortes, ayant les portails couverts de
platines429 de fer par le dehors (comme sont aussi generalement toutes les autres que j'ay veu par tout ce
pays du levant) & deux grands chasteaux, un peu escartez, pour la defence du port, où les navires ont
accoustumé d'aborder ; le principal desquels, qui est vers le Midy, est tout quarré avec quatre tours, & une
eschauguette ou Fanal éminent au milieu, au haut duquel on met (toutes les nuicts) une grande lampe
allumée, pour servir de signe aux navires, qui vont & viennent ; & il me semble si imprenable, que les plus
forts ne le sçauroient faïre rendre, sans quelque avantageuse composition, à cause du defaut de vivres &
provisions, & sur tout de l’eau, qu’ils ne pourroient en aucune façon recouvrer, sinon de la mesme ville.
Quant aux pieces d'artillerie qui y sont, en passant par devant, j'en comptay pour le moins autour de ces
murailles, jusqu'à six vingts coulevrines, toutes flanquées à leurs canonnieres ; outrece, une cinquentaine de
doubles canons, qu'on voit par dessus les tours. Il y a encore un'autre chasteau pres le port vieux (qu'ils
appellent maintenant) mais il n'est point si bien entretenu, & est beaucoup moindre en forteresse que les
autres deux.
Dans la ville on voit trois montagnettes, où l’on trouve (comme on faict à celles du grand Caire, appelées
Scovatze) beaucoup de choses precieuses, ce que m’occasionne de dire, avec plusieurs autres, qu’elles
doivent avoir esté peu à peu amoncelées de quelques vieilles ruines, qu’on n’a tenu compte de faire
aucunement relever, depuis un fort long-temps.
Pour les choses de devotion, on n’y sçauroit remarquer autre chose, sinon que principalement le vendredy,
environ sur l’heure de Midy, quand les Turcs veulent aller faire leurs oraisons, ils vont fermer tous les
pauvres estrangers qui sont aux fontiges. Mais sçachant que S. Catherine y avoit esté decolée, je voulus
aller voir le propre lieu de son martyr, & aussi de son emprisonnement, qui me furent monstrez, par des
Caloyers Grecs, au devant d’une petite Eglise nommée S. Sabà, là où ils se tiennent avec leur Patriarche
(que tous les Grecs honorent presque comme un Souverain Pontife) lequel de sa grace me caressa autant,
que si j’eusse esté de leur propre nation &, m’estimoit h[e]ureux d’avoir fait ce S. voyage qu’il avoit pleu à
Dieu me faire entreprendre.
Maniere de celebrer la S. Messe entre les Grecs
Je luy vis celebrer la S. Messe en Pontifical, le jour de l’octave de l’Epiphanie, assisté seulement de six
Prestres, & un Diacre, Sous-Diacre, & Acolyte ; avec autant de solemnité, que nous y pourrions garder en
l’Eglise Romaine : ils n’en disent point sinon les Dimanches, & autres jours de festes principales, & au lieu
que nous disons Dominus vobiscum, ce Prelat Grec donnoit la benediction, par trois fois, tenant un
chandelier en sa main, qui estoit faict en triangle, auquel y avoit trois chandelles allumées.
Au mesme lieu qu’il celebroit, y avoit trois Autels regardans l’Orient, comme on les faict en l’Eglise Romaine,
desquels il se servoient indifferemment : car en celuy qui estoit vers le costé de la Tramontane, il fit les
ceremonies qu’ils ont accoustumé de faire en leur consecration ; & puis à l’autre du milieu il paracheva les
autres parties de la Saincte Messe, prenant le Saincte Sacrement, pour le faire adorer au peuple qu’il leur
monstre dans un calice, estant couvert d’un poile430 sur sa teste ; & finalement r’entra par une porte qu’il y
avoit au devant le troisiesme autel, devers la partie du Midy, où l’on ne tenoit aucune chose sinon les
burettes, servietes, pour essuyer les mains, & semblables choses requises & necessaires. Apres que le
commun peuple voulut aussi recevoir, un Prestre leur vint administrer avec un cueiller d’argent ; & faut
sçavoir, qu’ils font l’office ny plus ny moins qu’en l’Eglise Romaine, jaçoit qu’ils soient tenus sous la
domination du grand Turc, beaucoup plus estroictement que ne sont les Chrestiens Latins, qui peuvent
chanter pareillement la saincte Messe, en un autel qu’il y a en la susdicte Eglise de sainct Saba, à costé du
leur, qu’ils estiment le principal.
A l’entrée d’icelle Eglise, il y a une pierre de marbre blanc, marquée de certaines taches rouges, comme
sang, qu’on dit estre de celuy de la vierge & martyre saincte Catherine, qui y rejaillit quand elle eut la teste
tranchée, par le commandement du cruel Empereur Maxence ; elle a quatre piedz de hauteur en quarré, &
un & demy de largeur, & est tenuë fort precieusement par toute ceste nation Grecque, entre lesquelz il y a
quelques Religieux nommez Caloyers, qui font profession de servir Dieu, & de garder toute leur vie chasteté.
Les autres Prestres sont tous mariez, & leurs femmes servent d’Abbesses aux Monasteres de celles qui
voüent aussi à Dieu leur virginité ; ne s’adonnant jamais à apprendre aucune langue estrange (non plus que
les Hebrieux) estant contens que toute la jeunesse qu’ils ont, en face le semblable : soigneux au reste
d’ensuivre tousjours inviolablement les anciennes traditions de leurs ancestres & predecesseurs.
Maniere de baptiser entre les Grecs
Je vis encore baptiser (apres leur service) un petit enfant, mais d’une maniere un peu differente de la
nostre : car en faisant en premier lieu chauffer l’eau, de laquelle on voulut regenerer ceste petite creature,
les parrain et marraine, firent boire cependant du vin à tous ceux là qu’ils avoient invité. Et apres que leur
Patriarche eust beniste l’eau, en y mettant de l’huyle, il luy en jetta sur la teste, on y plongea dedans l’enfant
par trois fois, au nom du Pere & du Fils & du S. Esprit & cela faict, on l’enveloppa, & un Prestre tira du
S. Ciboire, le corps precieux de nostre Seigneur, lequel il donna à recevoir à l’enfant regeneré, sur la porte
qui est vis à vis de l’autel qui est au milieu des trois susmentionnés, luy estant presenté par les mesme
Patriarche le tenant entre ses bras.
On voit aussi en la mesme ville, le propre lieu où S. Marc l’Evangeliste eut la teste tranchée, aupres duquel il
y a quatre colomnes de marbre d’Ægypte, qui sont de couleur rousse & comme rouge. Pareillement un’autre
lieu dessous terre, ou S. Athanase composa son Symbole. Et pres de la susdite Eglise de S. Saba, il y a
deux obélisques ou aiguilles, qui sont tres belles, & si approchantes de celles qu’on voit à Rome, à cause
des lettres hierogliphiques qu’y sont, qu’il semble avoir esté tirées toutes d’un mesme lieu, & travaillées de la
main d’un mesme maistre : mais l’une de celles qui sont en Alexandrie, est couchée maintenant par terre, &
réduite presque en pieces.
Encore y a il une certaine Eglise de Chrestiens nommez de la Ceinture, en laquelle tous les Levantins
tiennent, comme un joyau bien precieux, la pierre qui y fut transportée par leurs ancestres, sur laquelle
S. Jean Baptiste fut decolé ; dont tous ceux qui entreprennent de s'asseoir temerairment, sont punis (par
permission divine) d'une telle façon, qu'estans saisis incontinent d'une gratelle, ils n'en peuvent jamais
guérir. Ils ont accoustumé de nommer ceste Eglise du nom de S. Jean, outre laquelle il y en a encores
plusieurs autres, servies des Chrestiens de diverses Religions, & mesmement l'on y voit converser entre
tous beaucoup de Juifs.
Le lac de Bouchiara
Deux mille loin de ceste ville, on voit un lac (environné de dattiers) nommé Bouchiara, qui est d’une grande
estenduë, & si abondant en toutes sortes de bons poissons, que tous les habitans & circonvoisins en
reçoivent une infinité de commoditez : joint que ces arbres en les enrichissent pas moins de leurs fruits.
Colomne de Pompée
Davantage, environ deux mille de la ville d’Alexandrie (qui veut revenir à demy lieuë de chemin, selon nostre
conte) on voit une colomne toute d’une piece (qu’on appelle la colomne de Pompée) plus admirable que
toutes les pyramides, colosses, pilastres, ny autres telles antiquitez que je puisse avoir remarqué en la ville
de Rome ; laquelle contient six vingt & six pieds de hauteur, & dixhuit de grosseur ou rondeur, estant assise
sur un piedestal de vingt pieds en quarré, qu’on a commencé du despuis à miner & mettre à bas d’un costé ;
parce qu’on pretendoit qu’il y eust au dessous quelque thresor caché, jaçoit qu’on aye recognu par apres le
contraire : ains seulement que ceste machine avoit esté merveilleusement eslevée par dessus ce siege
(presque comme en l’air) avec son chapiteau, faict selon la mesme proportion, n’estant le principal soutien
qu’une liaison de fer, ou de bronze, ensemble de grandes pierres quarrées. Ce qui est en fin chose bien
admirable à voir, & d’où l’on peut aisément descouvrir la mer d’un costé, & de l’autre le Lac appelé
Mareotis ; auquel endroit croissent annuellement une infinité de petits buissons & halliers, qui produisent les
capres, d’où les pauvres gens de ce pays là se prevalent grandement.
Accident arrivé à l’Auteur pour estre tombé dans la mer
Auparavant mon despart, il m'arriva un grand inconvénient, m'estant perdu, si Dieu ne m'eust aydé : car
allant visiter un vaisseau qui estoit au large, afin de composer pour mon port jusques en Ragouze, il advint
qu'à quarante pas de terre, je tombay la teste premiere dedans la mer, & fus perdu (au dire de mes
compaignons) pour le moins l'espace d'un quart d'heure, sans qu'ils eussent aucun moyen de me secourir,
bien que je m'efforçasse tant que je pouvois de me faire voir à eux en nageant ; mais Dieu qui est tout
misericordieux & pitoyable, voulut qu'à la troisiesme fois je m'appareusse à eux par dessus l'eau : & l'esquif
d'où j'estois tombé, se rencontra au pres de moy, sur le bord duquel ayant jetté les mains, je r'entray aussi
tost dedans. Mes compaignons me ramenerent au prochain fontige, & là m'ayant pendu par les piedz, ils me
firent rendre toute l'eau salée que j'avois veu, laquelle aussi me brusloit le coeur ; tandis qu'on mettoit peine
de faire secher mes accoustremens : tellement qu'il me sembla puis apres, que je n'avosr mangé ny beu de
long temps, tant j'avois faim.
Joye menée par les Turcs lors qu’on chastre un enfant
Deux jours apres, le Soub Bacha fit faire par la ville un grand triomphe au chastrement d’un enfant de l’age
de neuf à dix ans, qui luy avoit esté vendu par un certain Raïs, qui l’avoit desrobé à un Chrestien Georgien ;
& ce pour le rendre Ennuque, à fin de luy donner en garde par apres ses femmes, qu’il tenoit en son serrail.
Ayant donc esté taillé non sans grand tourment, ce miserable garçon fut mené par la ville, monté sur un
cheval, accompaigné de plusieurs autres garçons & quelques sonneurs de tambours, flustes, & autres divers
instrumens : mais il me sembloit admis que le pauvre enfant n’y devoit point prendre grand plaisir, veu la
douleur que sa playe encores sanglante luy faisoit. Quelques uns cognoissans, que j’admirois cela comme
une chose estrange, me dirent, qu’entre eux on avoit accoustumé de faire autant d’honneur ainsi
publiquement aux hommes qu’on rendoit Eunuque, comme l’on faisoit aux Chrestiens qui renioient leur
religion, pour faire profession de la loy de leur Prophete Mahomet, disants que [c]’estoit un grand honneur à
luy, ayant esté ainsi choisi pour garder les femmes d’un tel Seigneur qu’est un Bacha, ou SoubBacha, qui
sont en leurs païs comme les Mareschaux ou Lieutenant du Roy, en ce païs qu’ils representent en son
absence. »
p. [221]-[223] :
« Le jour estant venu que nostre navire vouloit faire voile, je prins attestation du Consul de la nation
Françoise, commis en ceste charge par le Roy, en tout le pay d’Ægypte, qui se nommoit Jean de
Coquerel431, & avoit le titre de Portemanteau du Roy Treschrestien ; lequel m’accomoda de toutes provisions
de bouche, qui me pouvoient estre necessaires, aux fins de repasser la mer, & m’en revenir ; apres avoir
convenu avec le Capitaine d’une nave Ragouzoise, pour me ramener avec tout mon petit bagage & hardes,
au port de Ragouze ; moyennant la somme de huicts ducats.
Nous partismes le sixiesme jour du mois de Fevrier, mil six cens un, les antennes estants levées, & tous
rangez dedans, le mieux qu’on peut. La nave se nommoit Saincte Marie de la grace, & le Capitaine qui lui
commandoit dedans Dom Segnor Joan Colende, Sclavon de nation.
Estans tous dedans, les gardes du Turc vindrent visiter, à fin qu’aucun esclave ny mist ses hardes pour
s’embarquer, (car telle est la coutume, & ne s’en partent nullement les susdictes gardes, que les ancres ne
soient levés. Les serviteurs du Cadi, avec les Genissaires, & telle canaille de Turcs, vindrent aussi visiter
tant les marchandises que les hommes, desquels ils prenoient le nom par escrit, les fouillant par tout, pour
sçavoir ce qu’ils portoient. Il fallut leur donner trente Sechins d’or pour le vin, avant qu’ils nous laissassent
aller.
Desquels par ce moyen ayant prins congé, apres que nostre canonnier eust salué les chasteaux de deux
coups d’artillerie, nous montasmes peu à peu en haute mer, par le soufflement d’un vent qu’on appelle le
Midy, qui nous fut du commencement assez favorable, pour sortir du port d’Alexandrie d’Ægypte : toutesfois
s’estant changé environ sur l’heure de minuict, la tormente ne cessa, despuis le septiesme jour du mois de
Fevrier, jusques au quatorziesme, estant si forte, que nous cuydasmes432 rendre l’âme à Dieu. »
- 359 - 363 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HENRY TIMBERLAKE (11 avril 1601)
Timberlake, H., A true and strange discourse of the travailes of two English pilgrimes to Jerusalem, Gaza,
Grand Cayro, Londres, 1603.
Henry Timberlake (m. en 1625/1626), originaire de Titchfield (près de Porthmouth), est un marchand.433
p. 26 :
« J’arrivai cette nuit aux murs d’Alexandrie où je passai toute la nuit dehors parce que les portes étaient
fermées. Le matin du 11 avril, j’embarquai sur mon bateau, le Troyance, en parfaite santé et en sécurité. »4434
433 Raiswell, R., « Timberlake, Henry (d. 1625/6) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, 2004 ;
[www.oxforddnb.com].
434 Traduction : C. Pillot (archives Sauneron, Ifao).
Une édition plus récente a été publiée : Timberlake, H., A true and strange discourse of the travailes of two
English pilgrimes to Jerusalem, Gaza, Grand Cayro, Amsterdam, 1974.
- 364 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MIGUEL MATAS (du 18 au 23 juillet 1602)
M., Peregrinacion a la tierra Santa, Gérone, 1616.
p. 6-9 :
« Chapitre troisième. Comment nous arrivâmes à Alexandrie et ce que nous y vîmes
Le dix-huit dudit mois de juillet, vers midi, nous arrivâmes à l’Antique cité d’Alexandrie d’Égypte. Cette ville a
été très grande et puissante d’après ce que montrent les ruines. Elle fut édifiée par Alexandre le Grand en
320 avant la venue du Christ notre Seigneur, (p. 6 verso) selon Justinien dans son livre second et en dixsept
jours on construisit six mille pas de muraille. Sa forme ou apparence aurait quelques trente stades, les
rues bien longues, du côté de la terre, il y a une muraille contre une muraille ; celle de l’intérieure est plus
haute que celle de l’extérieure, elle possède des tours et des portes contre des portes. Elle fut très
importante avant que les Romains ne la détruisent. Elle fut reconstruite par l’empereur Trajan en 1230. Cette
ville est une échelle franque pour toute sorte de gens, elle a deux ports, celui qui est dans la baie devant la
porte, là où tous les navires et autres vaisseaux ont l’habitude d’être. À ma droite, on va vers ce vieux port
qui est très important ; l’entrée est éloignée de la ville, car il y a peu de temps, cette partie fut réduite de
sorte qu’on a du mal à y entrer à cause d’une inscription qu’ils disent avoir trouvé dans leurs vieux livres qui
dit que par ce port cette ville sera prise au moment où ils y penseront le moins et qu’ils seront plus distraits.
Ainsi chaque nuit, ils enferment les Chrétiens qui se trouvent dans les fondigos et le lendemain matin, ils
vont leur ouvrir (les portes) à la pointe du jour. À l’entrée (p. 7) de la baie où mouillent les vaisseaux, il y a
deux châteaux. Bien que l’un n’est pas très fort, celui qui est dans la baie en entrant, à ma droite, est
raisonnablement fort jusqu’à la partie qui donne vers la mer ; il possède des pièces d’artillerie et il y a
toujours une garde de Genizeros. Cette forteresse se nomme le Pharallo qui est la clé de toute cette terre
parce que si ce château est pris, toute la ville et autres seront pris. Les maisons et la muraille de cette ville
sont si vieilles que tout petit à petit tombe en ruine. Les habitants sont si simples qu’ils réparent à peine une
pierre bien qu’ils voient que tout va en poussière. À l’intérieur de la ville il y a deux montagnes, faites
d’ordures des maisons en ruine. Sur une d’elle, il y a la tour de garde de la mer qui signale les vaisseaux qui
arrivent. On pose autant de drapeaux que l’on voit de vaisseaux qui viennent, comme c’est l’usage à Malte.
L’autre est proche du Palais de sainte Catherine. De nos jours, sont debout les deux grandes colonnes qui
comportaient les roues à lames pour le martyre de la glorieuse vierge. Proche d’ici, se trouve une église
(p. 7 verso) de moines grecs qui se nomme Saint-Saba ; face à la porte se trouve une colonne carrée en
marbre de six palmes de hauteur et d’un et demi de largeur avec une balustre de moyen-relief à chaque
angle de la dite colonne qui est carrée et au milieu de laquelle, il y a un trou circulaire dans lequel on peut y
entrer un peu plus que le poing. C’est le lieu où la sainte vierge Catherine fut découpée et décapitée ; dans
ce lieu, on voit clairement son sang et son lait comme s’ils l’avaient découpée dans le même point. Elle n’est
pas autant vénérée comme elle est par les chrétiens latins. Ce monastère est proche du palais de son père.
De là fut transporté son corps à la montagne du Sinaï où il est très vénéré ; (ce lieu) est fréquenté par les
pèlerins. Dans ce monastère d’Alexandrie, se trouve le Patriarche majeur des Grecs ; il possède la couronne
d’Alexandre le Grand. Avant d’arriver à ce dit monastère, à ma droite, on rencontre l’église de Saint-Marc
l’Évangéliste dans laquelle les chrétiens de la ceinture font leurs offices, ce sont les vrais Égyptiens. Dans
cette dite église, se trouve un (p. 8) trône circulaire de douze palmes de circuit et couvert de mosaïque noire
et blanche dans lequel le glorieux saint Marc a prédit, c’est ici qu’il fut martyrisé. C’est dans cette église
qu’on enterre les chrétiens latins qui meurent dans cette ville. Les Mores et les Turcs sont enterrés à
l’extérieur, dans un lieu, et, les Juifs sont enterrés dans une autre lieu. Un matin, un frère et moi allâmes à
l’extérieur de la ville, à deux tirs d’arquebuse, vers le midi, au sud-est, pour voir une immense colonne de
couleur porphyre, toute d’une seule pièce qui porte un chapiteau au-dessus, et qui surplombe toute la ville et
les tours de mosquées. Selon les gens, il ne s’en trouverait pas une autre dans le monde comme cette
colonne toute d’une pièce. On ne sait pas de quelle manière ils ont pu la dresser. Cette colonne s’appelle de
Pompeyo. Les Turcs et les Mores sont si peu soucieux de la conserver qu’un jour ils la laisseront tomber. La
cause en est que la base est carrée et en ce moment il n’y a que trois côtés. Cette colonne est située sur un
endroit plat. Dans la ville, devant le monastère de Saint-Saba, il y a trois aiguilles qui sont toutes d’une
pièce. L’une d’entre elles est sur pied et les deux autres sont en terre et sont toutes détruites. Dans cette
ville, il fait bon vivre parce qu’il y a des poules bon marché, de la volaille, des oeufs, et autres viandes. Le vin
est cher (p. 8 verso) parce qu’on doit le faire venir de loin par mer. Ni ici, ni dans les autres villes on nous
permet d’en boire. On paie les deux poulets quatre de nos diners pour le chemin, mais dans d’autres lieux
c’est six, les poules sont à dix-huit diners, et un real. La façon qu’ils ont de couver les oeufs est très
différente de la notre. Ils ne couvent pas les oeufs mais ils se servent d’un four et du soleil. En premier, ils
blanchissent à la chaux le four au-dessous duquel il y a une petite bouche en manière de foyer. Là ils
mettent un feu pas très ardent. À l’intérieur du four, on met quatre ou cinq cents oeufs, ceux qui veulent en
mettent peu, beaucoup de paille, des escréments de boeufs. Après quelques jours, les oeufs sont couvés, on
ouvre la bouche du four et les poulets sortent ; on les donne à un coq, muni d’un grelot, qui sert de couveuse
pour les élever. L’eau potable de cette ville vient des citernes qui conservent l’eau du Nil. Quand le Nil
déborde, on ouvre un passage par lequel l’eau va à la ville. Ce passage est comme une veine d’eau qui part
du grand fleuve ; par cette veine ou bras, on vient du Caire sur des barques chargées (p. 9) de
marchandises. Cette eau est nouvelle chaque année et au temps des grandes chaleurs, les champs et les
vergers sont irrigués. Si on boit à Alexandrie de cette eau nouvelle qui n’a pas reposé, cela cause des
fièvres et autres maladies. La raison est que cette eau passe par des lieux où on cultive le riz, prend des
choses mauvaises et des immondices.
Le 23 de ce mois, nous partîmes d’Alexandrie pour aller au Cairo en compagnie de cinq Genisseros et six
jeunes de notre nave pour accompagner la monnaie jusqu’à Roseto qui se trouve à dix-huit ou vingt miles
d’Alexandrie. Tous les Genisseros et le reste étaient armés de pièces de feu et d’une épée car nous avons
entendu qu’il y aurait des Arabes sur le chemin. »435
435 Traduction : M. Rosa, O. Sennoune.
- 365 - 366 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MARTIN SEUSENIO (du 24 septembre au 24 novembre 1602)
Muehlau, F., « Martinus Seusenius’Reise in das heilige Land i. J. 1602/3 », ZDPV 26, 1903.
p. 70-74 :
« Le 24 septembre, nous arrivâmes à Alexandrie qui est une grande ville à présent en ruine. Elle fut
construite, au bord de la mer Méditerranée, jadis par Alexandre le Grand qui lui donna son nom. C’était une
belle ville plaisante pleine de belles maisons et places comme en témoignent encore les ruines. Depuis que
la ville a été envahie par les Turcs, elle s’est détériorée, et si elle n’avait pas un si bon port ou rade avec des
bateaux venant de tous les pays qui y jettent l’ancre personne n’y habiterait (p. 71) à cause de l’air
empoisonné et malsain, raison pour laquelle la ville fut abandonnée. Une grosse partie de la population
habite devant les portes près de la mer sur une grande étendue où on a construit de belles maisons. La ville
est plus longue que large et possède quatre portes : 1) la porte du Caire 2) la porte du désert de Barcaru, à
l’occident 3) la porte du Peffer436 au midi 4) la porte du proer. Toutes sont recouvertes de fer. Alexandre le
Grand y avait un beau château et palais qui se trouvait dans la partie est de la ville, mais à présent il est
complètement détruit. À cet endroit se trouvent encore deux obélisques, d’une seule pierre dont un est
toujours dressé ; la hauteur mesure environ une centaine de mes pieds, et, la grosseur est de cinq de mes
Klaffter, j’ai mesuré la grosseur moi-même. (L’obélisque) est d’une pierre carrée et il est en marbre de
différentes couleurs à savoir blanc, noir et rouge pâle. L’autre (obélisque) est tombé et est brisé, il est
recouvert de terre.
Le 7 octobre, hors de la ville, un peu devant la porte du Peffer, on voit la colonne nommée Pompeana dont
on dit qu’elle fut construite par Jules César en mémoire de sa victoire sur Pompée. Cette colonne est ronde
et d’une pierre en marbre de la même couleur que l’obélisque précédent. L’obélisque cité précédemment
dont le pied est fait d’une pierre carrée en marbre construite comme une table ; chaque côté a une mesure
de dix-neuf et demi spanne, c’est-à-dire sept coudées et demi hollandaises, faisant une circonférence de
soixante-dix-huit spanne ou vingt-six coudées hollandaises que j’ai mesuré moi-même. Cette colonne est si
haute et si épaisse que celui qui la regarde se trouve émerveillé. On peut la comparer avec la colonne de
Rome de Nostradonna la rotonda. Pas très loin du palais délabré d’Alexandre le Grand se trouve le couvent
de l’ordre de Basile dans lequel habite le patriarche d’Alexandrie. J’ai pu parler à ce patriarche avant midi le
4 octobre, je lui ai transmis les salutations d’un noble hollandais nommé Giorgius Dousa. Ce patriarche, du
nom de Cyrillus, est né dans la ville de Candie, qui appartient aux Vénitiens ; il a été élu patriarche, il y a un
an, à la mort de son prédécesseur Meletius avec lequel le nommé Dousa avait de bonnes (p. 72) relations.
Je demandai en particulier (au patriarche) s’il s’entendait bien avec l’église romaine et s’il reconnaissait
l’évêque de Rome comme la tête des églises comme il le prétend lui-même ; il répondit que non et qu’on
l’affirmait de façon erronée, il loua le nommé Dousa parce qu’il avait écrit la vérité dans son récit de voyage
à Constantinople. Le 7, nous visitâmes l’église de Sainte-Catherine et nous vîmes la pierre où sainte
Catherine fut décapitée. C’est une pierre de marbre blanc qui a été dressée dans l’église du couvent ; quand
on y entre, du côté gauche de l’autel où les Italiens célèbrent leur messe, en se dirigeant vers l’autel, on
trouve la pierre du côté gauche. Sur la face supérieure de la pierre, se trouve un trou où on voit encore le
sang de la Vierge.
À Alexandrie il y avait un navigateur français qui transportait du poivre vers Ancône. Comme nous étions là
depuis longtemps et que le temps nous semblait long, nous l’abordâmes pour lui demander combien il
demandait jusqu’à Alcona. Il réclama douze ducats, mais il ajouta que si on ne voulait pas lui donner (au
moins) dix (ducats) on ne devait plus lui en parler. Sur quoi je retournai chez le patriarche nommé
précédemment ; je lui demandai son aide parce que j’appris qu’un bateau vénitien, dont le patron était Grec,
était chargé, et qu’il pouvait nous témoigner son amitié en parlant au (patron grec) de notre part pour savoir
s’il pouvait nous amener à Venise. Je lui dis que nous payâmes de Venise à Chypre cinq R. Daller. Monsieur
le patriarche nous dit que c’était encore trop cher, je répondis que si je pouvais donner moins à ce monsieur,
ça me conviendrait. Ainsi nous nous remîmes aux mains du patriarche qui devait s’accorder avec le patron.
Le 11, je retournai chez Monsieur le patriarche où j’appris qu’il (le patron grec) était d’accord pour le prix de
deux Daller par personne. Je remerciai chaleureusement Monsieur le patriarche. Le 15 vers midi le nouveau
consul de Venise arriva.
La ville d’Alexandrie est entourée de doubles murs et possède des tours flanquées assez fortes pour des
petits tirs. Elle ne possède pas (p. 73) d’eau douce, c’est pourquoi cette ville est creusée dessous et qu’on a
construit des citernes dans lesquelles coule l’eau du Nil au moment de l’inondation, c’est-à-dire en juillet.
Comme le Nil est loin de la ville d’Alexandrie, les anciens égyptiens ont construit un canal qui passe sous les
murs de la ville et qui remplit les citernes. Dans la ville, il y a trois collines que l’on peut comparer au mont
Testaccio ou Scorbeberus de Rome, et il paraît que (ces collines) sont faites à partir de la terre retirée des
citernes de la ville et mise sur cette colline. Alexandrie est environnée d’un sol sablonneux et infertile, c’est à
cause de cela que rien n’y pousse sauf quelques dattiers. Le reste doit être apporté depuis d’autres endroits,
malgré tout, les choses sont assez bon marché. Pour un madin qui correspond à un stuver et demi du
Brabant, on a un pain qui nourrit un homme pendant deux jours. Ils ont du poisson qui vient de la mer et
aussi quelques poissons du lac Buchiara qui se trouve à un quart de mile de la ville, c’est pourquoi c’est bon
marché. Le vin vient de Chypre, de Candie et de Zante.
Certains prétendent que saint Athanase aurait habité à cet endroit après avoir fui l’empereur à cause d’Arius,
mais le patriarche dit ne rien savoir à ce propos. Pas loin du lieu où sainte Catherine aurait été décapitée et
où se trouve maintenant une mosquée turque, il y a l’endroit où saint Marc l’évangéliste fut décapité et dont
le corps fut emmené par les Vénitiens à Venise avec la pierre. Pas loin de là, on peut voir les gros murs d’un
beau château ou palais de terre cuite en ruine. Dans l’église de Saint-Jean-Baptiste se trouvait la pierre sur
laquelle il fut décapité par Hérode à la demande d’Hérodias.
Dans cette ville, les chrétiens ont leurs fondiquen qui sont des grandes maisons dans lesquels habitent les
Français, les Vénitiens, les Anglais, les Saragossains et les Genévois. (Ces maisons) sont fermées chaque
soir par les Turcs de façon que personne ne peut sortir ; le matin, on les ouvre de nouveau. Les consuls de
France et de Venise disposent de Janitzeri ou de soldats comme gardes dans les fondiquen du Baccha. Le
vendredi, les Turcs ont leur jour de congé ou dimanche ; à midi, quand ils vont (p. 74) dans leurs mosquées
ou églises, les Turcs enferment les chrétiens dans ces maisons jusqu’à ce qu’ils reviennent de leurs
mosquées. Quand ils font la circoncision, ils mettent leurs enfants (quand ils sont riches) sur de beaux
chevaux ; de jeunes garçons et filles habillés de jolis vêtements, et accompagnés de flûtes et de tambours,
traversent la ville jusqu’au bain. De là ils se rendent à leur maison où ils sont circoncis comme on l’a vu à
plusieurs reprises. Le 28, le seigneur Nicolas vint à la maison anglaise pour recevoir de meilleurs soins ou
cure pour sa maladie.
Le 2 novembre, au milieu de la nuit le seigneur Matteus, un tailleur de pierres précieuses de Gênes décéda
dans le Frontique anglais. Le 4, j’ai embarqué, j’ai donné mon vin et mes biscuits aux seigneurs Andrea et
Alfonso de Venise qui avaient leur jubilé ; je mangeai et bu avec eux. Le 16, le seigneur Nicolas embarqua.
Le 23, le seigneur Nicolas donna trois zekin à André Dour pour lui acheter du vin pour son voyage. Le
seigneur Nicolas emprunta dix scriffi à un Juif contre son diamant, pour lequel il doit payer à Venise 14 (pour
le récupérer). Le 24, les cinq galions turcs, qui nous empêchèrent de voyager depuis un mois, mirent les
voiles très tôt le matin et nous les suivîmes à midi avec un vent sud sud-est, mais quand nous étions en
pleine mer, il y avait peu de vent. »437
436 Poivre.
437 Traduction : D. Kohn, G. Lodomez.
- 367 - 368 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇOIS SAVARY DE BREVES (du 15 septembre au 24 octobre 1605)
Savary de Brèves, F., Relation des voyages de Monsieur de Brèves, tant en Grèce, Terre Sainte et Ægypte,
qu’aux royaumes de Tunis et d'Alger ensemble, un traicte faict l'an 1604 entre le Roy Henry le Grand, &
l’Empereur des Turcs, Paris, 1628.
François Savary de Brèves, né en 1560, est issu d’une famille de Touraine. En 1582, il accompagne un
parent, nommé ambassadeur, à Constantinople. Devenu lui-même ambassadeur, il parvient à conclure un
traité entre Henri IV et le sultan Achmet en 1604. Il est l’un des plus importants représentants des rois de
France auprès des souverains du Levant et d’Afrique du Nord. Sa mission consiste à se rendre à
Constantinople afin que la Porte interdise aux potentats d'Afrique du Nord de pratiquer extensivement la
piraterie. En revenant en France en 1606, il devient gouverneur du frère du roi, puis premier écuyer de la
reine. Il meurt à Paris en 1628. Il rapporte du Levant des ouvrages turcs et persans.438
p. 231-240 :
« Le Ieudy quinzieme, ie m’embarquay pour Alexandrie, dans l’une de ces germes, en costoyant tousiours le
rivage, beau & planté de force Palmiers, mais au reste bas & dangereux, pour la multitude d’escueils qui
sont serrez au long, formidables d’autant plus, que la mer les couvre. A deux heures apres midy, nous
surgismes au port, & ayant mis pied a terre, nous acheminasmes à la ville, esloignée de sept ou huict cens
pas, du lieu où abordent les vaisseaux, telle estant la largeur d’une plaine (p. 232) sablonneuse, qui flanque
les murs de ce costé, & les separe de la mer.
Mais autant que passer outre, pour ne rien laisser en derriere, il sera bon de faire la description du port, que
la Turquie est contrainte d’avoüer le plus celebres de ces havres, tant pour estre l’abord de toutes les
marchandises, qui renduës au Caire par la mer rouge, sont portées en Alexandrie, que le marché de la mer
mediterranée, où toutes ses villes maritimes se fournissent d’infinies rares & exquises denrées.
Il est en forme de croissant, fort spacieux, mais peu net, & dangereux à qui n’en pratic, à cause de deux
gros escueils, l’un appelé le Diamant, posé à son entrée contre la corne de main droicte, s’efleurant en
pointe hors de l’eau : & l’autre au milieu, auquel le bris d’un vaisseau chargé d’espiceries, a donné par
ironie, le nom de Girofle. Sur chacune des cornes qui ferment la bouche dudit port, est bastie une forteresse,
dont celle de main droicte en entrant, edifiée sur le phare tant renommé dans Cesar, est la plus forte & la
mieux equipée, tant de gens de guerre, que d’artillerie, en ayant plus de cent cinquante pieces.
Au reste c’est une eschelle franche & libre, où toutes sortes de vaisseaux, tant d’ennemis que (p. 233)
d’amis, peuvent aborder & seiourner seurement, sans qu’il leur soit donné aucun destourbier. Derriere la
corne de main droitte, en entrant dessus le phare, il y a encore un autre port, dont l’acces n’est permis aux
vaisseaux Chrestiens, les Turcs se le reservant, pour leurs galeres.
Quand à la ville, elle est de figure ovale, mais comme un oeuf, plus grosse à un bout qu’à l’autre, située en
lieu plein, flanquée de la mer du costé de Tramontane, & vers le Midy, d’un grand & large palus, nommé
Mareotis, à costé duquel coule un canal du Nil, dont les rives voisines d’Alexandrie, sont embellies de force
iardinages de palmiers, orangers, citronniers, grenadiers, caffeiers, & carrubiers.
Il derrive d’au dessus de Foa, ville bastie sur le bord de ladite riviere du Nil, entre le Caire & Rossette : Et
ledit canal n’est navigable que depuis le mois d’Aoust, iusques au quatrieme Octobre.
Son principal & necessaire usage, est de fournir la ville d’eau douce, n’y en ayant point d’ailleurs.
De la fosse, non loin de la bouche par où il se desgorge en mer, sont tirez plusieurs aqueducs, qui parvenus
dans l’enclos des murailles, se (p. 234) dispersent en divers rameaux ou conduits, & coulent par dessous les
maisons, en chacune desquelles, & hors d’icelles encore, y a de certains puits quarrez, qui respondent dans
lesdits conduits, d’où l’eau se tire avec des rouës tournées par des boeufs, pour la mettre par d’autres
conduits, dans les cisternes, où elle se reserve tout au long de l’année, pour la boisson des hommes et du
bestail.
Quant à ces cisternes, ce sont les plus admirables ouvrages du pays, tant pour la force de leurs voutes, sur
lesquelles sont fondez les edifices, estant toute la ville creuse par dessous, ainsi que Cesar remarque en la
description qu’il en a faicte dans ses commentaires ; que pour la grande quantité presque innumerable, des
riches colomnes de marbre, dont elles sont remplies pour soustenir les voutes, qu’elles suffiroient à decorer
plusieurs grandes & fameuses citez : & y en a aucunes, selon les endroits plus hauts ou plus bas, qui ont
iusques à trois & quatre voutes l’une sur l’autre, soustenuës desdictes colomnes : & se peut dire que toute
la ville est une cisterne, s’il n’y avoit des separations, qui en font plusieurs, pour la commodité des maisons
& du public.
C’est ce qui reste auiourd’huy de plus entier (p. 235) d’Alexandrie, si celebre & renommée aux siecles
passez : tous les bastimens, tant publics que privez, estans esgalez au sol, & reduits en poussiere, fors la
closture des murailles, qui est encore en pieds, & quelques maisonnettes vers les portes de Rossette & du
Poivre, trois ou quatre mosquées, le bazar, ou marché, qui est une longue hale couverte, les fondics de
France, Genes, Raguse, & de Venise, logis publics, où se retirent les marchands Chrestiens, desquels les
Turcs ferment la porte à clef tous les soirs, & le Vendredy à midy durant leur priere ; & trois Eglises de
Chrestiens, scavoir, Saincte Saba, autrement, Saincte Catherine, Monastere de Religieux Grecs, voisin des
ruines du Palais de Coste Roy du pays, & pere de ladite Saincte Catherine, qui fut decapitée en ce lieu là ;
Sainct Marc, d’où les Venitiens ont enlevé le corps de leur Patron, qui y estoit enterré, & l’ont porté à
Venise ; & Sainct Michel, dans laquelle se voit son portraict, fait de la main de Sainct Luc.
Lesdites murailles, accompagnées de leurs fausses-brayes, & munies de deux en deux cens pas, de
grosses tours quarrées, capables chacune de loger deux cens soldats, furent iadis les plus belles & mieux
faicts de leur temps. (p. 236) Joignant icelles, à l’endroit où l’on dit qu’estoit le Palais de Cleopatra, se voyent
deux grands obelisques de marbre, gravez d’anciennes lettres & caracteres hieroglyfiques, l’un debout, &
l’autre couché par terre.
Il y a puis apres à la partie opposite, une grosse montagne, faicte toute de pots cassez, & une autre
semblable à l’opposite du phare, au sommet de laquelle il y a une eschauguette, où tout le long du iour
demeure une sentinelle, pour advertir quand quelques vaisseaux paroissent à la volte du port, ayant à cest
effect, des banderolles de deux sortes, les unes, taillées en flame, pour signal des galeres ; & les autres
quarrées, pour les vaisseaux ronds : & autant de voiles qu’il descouvre, il met autant de banderolles sur la
tour.
Dehors de la ville, à mil ou douze cents pas des murailles, non loin du Calis dont i’ay faict mention
cy-dessus, se void eslevé une haute & superbe colomne de marbre rouge, qu’on appelle la colomne de
Pompée ; à l’aventure une des belles & rares pieces, qui sont au monde. Sa base posée sur de grosses
pierres de quartier, gravées comme les susdictes obelisques, de vieux characteres Egyptiens, a vingt pans
en quarré, par chacune face : le corps de la (p. 237) colomne, sans ladicte base, iusques à son chapiteau,
quatre-vingts pieds de Roy de hauteur, & trente cinq femelles de circonference, qui font vingt-huict ou vingtneuf
pieds de Roy : le chapiteau doit avoir de hauteur & de largeur, autant que la base, au iugement de ceux
qui l’ont veuë.
Quelques-uns discourans de la matiere, nient que ce soit marbre naturel, & la tiennent pour masse,
composée d’un certain ciment, qui se faisoit au temps passé, avec du marbre pilé : toutesfois ie ferois de
contraire opinion, ayant ouy dire à tout plein de personnes, qui avoient voyagé autant dans l’Egypte, qu’aux
montagnes du Sahit, iadis la Thebaïde, qui font tout de marbre, il se void des lits & places, d’où ont esté
levées des pieces de pareille grandeur : n’y ayant pas d’apparence que pour les briser & en faire ciment, on
eust pris la peine de les couper ainsi grandes & entieres : & d’ailleurs, que le travail de tout un peuple,
n’eust pas suffy à briser assez de mortier, pour fabriquer tant de colomnes de marbre, qu’il y avoit iadis en
Egypte, aux despouilles de laquelle, toutes les provinces circonvoisines sont redevables de leurs ornemens.
Ces années passées, un bassa du Caire, à la (p. 238) persuasion d’un Dervis, qui l’asseuroit d’y avoir des
tresors cachez au pied de ladite colomne, la voulut faire abbatre : & ia les ouvriers avoient tiré trois ou
quatre des pierres qui soustiennent la base, quand vaincu des prieres d’aucuns siens amys, qui luy
remonstrerent que ce Dervis estoit un affronteur, & que de son advis il ne luy demeureroit qu’une honte de
sa credulité, accompagnée d’un repentir eternel, de voir la memoire de son avarice, à iamais signlée par la
ruine d’une si rare & excellente piece ; il quicta ce dessein. On n’a point encore remis d’autres pierres en la
place, de mode qu’il semble que la colomne soit en peril emminent, & quelle doit choir à la premier
bourasque de vent, qui la heurtera.
Pour le regard puis apres, de la qualité & temperament de l’air de ceste tant magnifique ville ; il est presque
tousiours mal sain, & si chaud, que si par speciale providence de la nature, il n’estoit rafraischy des vents du
Nort, qui y souflent d’ordinaire, & singulierement aux plus ardans iours de l’esté, on n’y pourroit vivre.
D’ailleurs, les eaux du canal & marais cy-dessus mentionnez, venans à baisser sur le printemps, & se
putrifier par la chaleur du (p. 239) soleil, il s’en efleve de mauvaises vapeurs, qui l’infectans, causent
presque tous les ans, des pestes cruelles & miserables. Il est vray qu’elles sont ordinairement de peu de
durée : Car du iour que le soleil entre au lion (comme au Caire, quand la goutte tombe) elles cessent &
s’arrestent tout court, l’extremité du chaut faisant icy, ce qu’en nos quartiers la rigueur du froid agist, purifiant
l’air, des malignes exhalations qui le corrompent.
L’Automne n’y est pas de meilleure condition que le printemps, ains tres-dangereux, pour les fiévres qui
l’accompagnent ordinairement, causées par la boisson des nouvelles eaux du Nil, non encore assez
rassises et espurées dans les cisternes.
Au reste, quant à ce que plusieurs autheurs escrivent qu’il ne pleut point en Egypte, l’experience & la veuë
du contraire, me dispensera de leur adiouster foy, ayant appris que les habitans d’Alexandrie, en
confirmation de ce que i’y ay veu durant mon seiour, que d’ordinaire, le mois de novembre se passe en
grosses & fortes pluyes, accompagnées souvent de tonnerres & grandes bourasques de vent : Mais apres il
ne faut plus redouter de voir le Ciel troublé, ains tousjours beau & serein, (p. 240) n’y ayant autre hyver, que
la fraicshe humeur de ces pluyes.
Or Monsieur de Breves ayant esté fort malade proche de ceste saison, & la plus-part des siens aussi, il
resolut de changer d’air, & d’aller au grand Caire : tellement que le vingt-quatriesme d’Octobre, apres midy,
nous partismes d’Alexandrie, & nous acheminasmes vers Rosette, pour là s’embarquer sur le Nil. Au sortir
de la ville, nous entrasmes en une grande & vaste planure de sables nitreux & salez, steriles de toutes
choses, fors d’une herbe, que les Arabes nomment Cali, laquelle ils bruslent, & des cendres en font grand
traffic avec les Venitiens, qui les acheptent pour faire des verres, & du savon. »
438 Bouillet, M.-N. et Chassang, A., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, 1878, p. 284.
- 369 - 371 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HENRI DE BEAUVAU (du 3 octobre au ? 1604)
Beauvau, H. de, Relation journalière du voyage du Levant en 1604 faict et descrit par haut et puissant
Seigneur Henry de Beauvau Baron du dict lieu et de Manonville, Nancy, 1615.
Le baron Henry de Beauvau, grand forestier de Lorraine, sert d’abord le duc de Bavière, puis devient
ambassadeur du duc de Lorraine à Rome. Il combat les Turcs sous le drapeau de l’empereur Rodolphe et,
en 1604, il accompagne à Constantinople l’ambassadeur François Savary de Brèves. De là, il se rend à
Jérusalem, puis en Égypte où il débarque à Aboukir. Il visite le Caire en premier lieu, puis Alexandrie en
parcourant le chemin de terre depuis Rosette.439
p. 168-170 :
« Le lendemain qui estoit le troisième d’Octobre nous arrivasmes de bonne heure en Alexandrie ville fort
ancienne. D’aultant qu’elle fust premierement bastie par Alexandre le Grand, & surnommée ainsi de son
nom.
Sa situation comme vous pouvez voire par le present dessein, est en lieu sablonneux & sur le bord de la
Mer, bastie en forme de croissant plus large que longue, partagée en deux, la vieille et la neuve, dont la
premiere a bien trois mille de long, ayant au dedans outre les choses rares que nous dirons cy apres, deux
montaignes de sable qui y sont encloses : les anciennes murailles qui l’enferment sont encor debout, mais le
dedans est quasi deshabité. Tous les batiments sont creux au dessoubs, & remplis de cysternes, qui sont
soustenues par tout de piliers de marbre, & cecy pour la necessité de l’eau, d’autant qu’on n’y en a point
d’autre, que celle que par certains canaulx l’on conduict du bras du nil, appellé Calis, pour remplir les dictes
cysternes, tous les ans une fois, qui est le quinsiesme d’Aoust. Il y a la de fort belles & grandes rues,
auquelles on peut voir plusieurs antiquitez & ruynes. Nous vismes aussi au long d’une rue le lieu ou Sainct
Marc fut decapité, & y a icy une Eglise ou se garde par les Goffites la pierre sur laquelle la teste luy fust
tranchée la chaise ou il preschoit & ou son corps fut enterré, qui depuis fut transporté a Venise. Encor il y a
une Eglise dediée a Saincte Catherine, ou l’on voit une colomne quarrée, sur laquelle ladicte Saincte fut
descolée. Pres des murailles du Port se voyent deux esguilles quasi semblables, & toutes gravées de lettres
hieroglyphiques, dont l’un est couchée & couverre de la plus part de terre, l’autre est haulte de dix toise hors
de terre, ayants unze pans de quarrure.
Plus haut l’on nous monstra la place ou estoit anciennement le Palais de Cleopatre qui avoit une gallerie
avanceant dans la Mer comme on peut voir par ses ruynes.
Hors de la ville se voit une colomne, que Cesar fit eriger en memoire de la deffaicte de Pompee, laquelle est
de marbre & haute, la baze & les chapiteaux de quatre vingt pieds de Roy, & vingt huict de tour. La baze en
a quatorze de hault & autant de quarrure & les chapiteaux de mesme, tellement que tous ensemble elle a
cent huict pieds de hault.
Quand a la ville neuve, elle est un peu plus plaisante, assise dans une plaine, ayant a main gauche le vieux
port, qui est deffendu d’un chasteau, qui est a la vieille ville : mais a cause de sa difficulté, l’on ne n’en sert
plus, que pour mettre quelque fois des galleres & galliottes.
A main droicte est le port neuf qui n’est qu’une plage combattue de la Tramontane, mais qui est deffendu de
part & d’autre de deux chasteaux, qu’ils appellent farilos, dont l’un est sur une petite Peninsule & fort
incommode d’eau douce & n’en a point d’autre, que celle qu’on y porte des cysternes de la ville. L’autre est
vis a vis, & faut que tous les vaisseaux passent a la mercy de l’artillerie de ces deux chasteaux & n’estoient
ces deux ports, la ville seroit en peu de temps deshabitée a cause du mauvais air qui y est. »
439 Carré, J.-M., Voyageurs et écrivains français en Égypte, t. I, Ifao, Le Caire, 1956, p. 11.
- 372 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
NICOLAS SCHMIDT (1605)
Schmidt, N., Reys-Beschryvinge (1605) na Constantinopolen en Egypten, Leyde, 1707.
Nicolas Schmidt, originaire de Dresde en Allemagne, entre au service de l’armée impériale pour combattre
les Turcs. En 1605, il est capturé par les Turcs qui l’emmènent à Constantinople où il devient esclave
galérien pendant cinq ans. En 1611, il parvient à s’échapper de sa prison et à regagner sa patrie.440
p. 21-22 :
« Ici à Tunis, la flotte fit provision de tout et, lorsque nos commandants étaient prêts, nous nous
embarquâmes pour nous diriger vers Alexandrie pour y arriver après huit jours pleins de labeurs.
La ville d’Alexandrie est bâtie sur un terrain très sablonneux. Rien ne reste de sa gloire et de sa splendeur
d’antan, sinon le mur d’enceinte très solide, garni d’un grand nombre de tourelles. Ainsi que quelques restes
et constructions, délabrés et en ruines, de bâtiments imposants, dont les pierres et la maçonnerie
manifestent encore l’ancienne richesse et gloire de cette ville. De nos jours on n’y voit que peu de maisons,
pour la plupart en mauvais état. Près de la porte se dresse un château, gardé par cinquante janissaires,
envoyés par le pacha du Caire et relayés une fois par an seulement.
Comme nous venons de le dire, on n’y voit rien qui vaut la peine d’être mentionné, excepté deux colonnes
de marbre. L’une d’elles est aussi grande que celle qui se trouve sur l’hippodrome de Constantinople et, tout
comme celle-là, elle est gravée de sculptures ; l’autre s’est écroulée et tombée en pièces. Au dire des
chrétiens qui y habitent, c’est pourtant près de cette colonne que la sainte martyre Catherine a été exécutée.
Dans la banlieue d’Alexandrie, et tout spécialement le long du Nil, il y a un grand nombre de jardins
délicieux, pleins de toutes sortes d’arbres fruitiers. La ville grouille de commerçants, venus en bateau, de la
chrétienté, de la Turquie, de l’Arabie et de Perse. Ils y jettent l’ancre pour vendre leurs marchandises et pour
les troquer contre d’autres. Un bateau battant pavillon anglais ou vénitien doit payer trente mille thalari
comme droit de douane. Cet argent est reçu par le Beig ou commandant en chef de la ville, qui doit remettre
annuellement trois cent mille ducats au pacha qui réside au Caire.
J’ai vu au marché d’Alexandrie un éléphant impressionnant, monté par un Maure qui portait dans sa main un
bâton de couleur blanche, muni d’un petit crochet de fer. C’était étonnant de voir avec quelle adresse il
savait diriger cet animal terrible.
Notre flotte restait mouillée dans le port d’Alexandrie. Mais nos marins louèrent de petits bateaux sur
lesquels notre général et quelques autres commandants turcs, en compagnie de quelques esclaves dont
moi, se rendaient sur le Nil au Caire. »441
440 La disquette contenant la traduction ainsi qu’une introduction et une biographie du voyageur réalisées par
Ch. Libois S. J. m’a aimablement été transmise par F. Servajean, alors adjoint aux publications à l’Ifao.
Schmidt N., Le voyage de Nicolaus Schmidt, par Ch. Libois S. J., Ifao, s. d.
441 Traduction : Ch. Libois S. J. (archives Sauneron, Ifao).
- 373 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BALTHAZAR DE ROME (1605)
Arce, P. A., Documentos y textos para la historia de Tierra Santa y sus santuarios : 1600-1700, Jérusalem,
1970.
p. 114-115 :
« Alessandria e cita di tre miglia di giro, con dui ordini de muro quasi tutti in ruvina per esser antichi ; dentro
non vi habita se non poveri, l altra gente habitano in una lingua di terra tra la cità e il mare, senza mura ne
altre guardie ; quivi stà il sangiacco con ducento cavalli ; ha dui porti assai grandi, ma non troppo sicuri, uno
verso affrica, l altro verso assai, nel affrico sorgano le galee ; ha un castello quadro, simile a una gran casa,
con pezzi picoli, di mura debile e antichi, l altro di assai ha un molo di mura ordinarie, e nel suo fine é un
gran castello lungho e non troppo largho, con un giro di muro anticho con le sue torre al antica, senza terra
pieni ne altre difese ; nel suo piano verso il mare ha certe porticelle dove sono alcuni pezzi boni sopra caretti
da nave per battere il piano del aqua, ha nell suo mezzo un maschio quadro con quatro torette piciole, alcuni
pezzi (p. 115) ordinari : cosi sta fornito da tutte le bandi, perche le mura non suportano pezzi grossi ; non ha
aqua, ma vi viene dalla cità ogni giorno con camelli ; vi stanno settenta soldati ; ha al suo riscontro un altro
castelletto quadro con quindici soldati, ed a sei pezzi di artellaria. »
- 374 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACOB BEYRLIN (avant 1606)
Beyrlin, J., Reis Buch : Das ist Linjak Schöne Beschreibung und Wegueyser eclicher Reysen, durch ganz
Teutschland, Ptolen, sie benbürgen, Dennemark, Engeland Hispanien Franckreich, Italien, Sicilien, Egypten,
Indien, Strasbourg, 1606.
p. 14 :
« Grande ville d’Égypte située au bord du Nil, elle est une fois et demie comme Nuremberg et son périmètre
est de 10 milles italiens. De là, on peut aller jusqu’au Caire en bateau sur le Nil. An nord, cette ville possède
un vaste port en forme de demi-cercle, devant lequel se trouve l’île de Pharos qui ferme presque le port. Les
Vénitiens y ont deux établissements commerciaux et les Génois en ont un. À l’extérieur de la ville, il y a de
nombreuses maisons de plaisance et des jardins remplis de plantes magnifiques. Près de là, on voit aussi
beaucoup d’autruches. À Alexandrie, on trouve toutes sortes de marchandises et d’animaux venant du
monde entier et qui sont envoyés de là en Italie et en Allemagne. C’est là qu’habita le très sage astronome
Ptolémée. Celui qui veut devenir un bon astronome doit lire ses livres. Il a aussi déterminé exactement la
circonférence de la terre.
Lorsqu’on quitte Alexandrie pour le Caire, on passe d’abord par de belles collines fertiles et à droite, on voit
une belle plaine. Il y a là beaucoup de salines brûlées par le soleil. C’est pourquoi cette région est toute
blanche comme si elle était recouverte de sel. Lorsque cette chaîne de collines, longue de 12 milles italiens,
est franchie, on arrive au Nil sur lequel on peut faire le voyage en bateau jusqu’au Caire en deux jours. Des
deux côtés du Nil, on voit de belles campagnes fertiles. D’un côté, c’est l’Asie et de l’autre, l’Afrique. Il faut
haler le bateau comme sur le Rhin. Les terres inondées et arrosées par le Nil sont riches et fertiles, mais là
où il n’arrive pas, le sol est sec et aride. Dans cette région, il y a des crocodiles ; leur taille est deux fois celle
d’un homme et ils mangent les gens. Ils ont tête horrible, leur corps est couvert d’écailles ; ils ressemblent
aux lézards. Le Caire est à 36 milles allemands d’Alexandrie. »442
442 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 375 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN WILD (1606-1610)
Wild, J., Voyages en Égypte de Johann Wild, 1606-1610, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1973.
Johann Wild est originaire de la grande ville commerciale de Nuremberg. Combattant avec les troupes de
Rodolphe II, il est fait prisonnier en 1604 avant d’être vendu comme esclave.443
p. [6]-[10] :
Description de la ville d’Alexandrie et du commerce que l’on y pratique
« La ville avait été bien grande, mais [elle] est maintenant toute dévastée et ravagée, et il n’y a plus rien de
remarquable à voir là.
Il y a aussi un fort en avant, près du port, [là] où les navires ont leur entrée. Il est gardé par cinquante
janissaires ou mamelouks qui sont délégués du Caire, avec un commandant, au prince [d’Alexandrie] et qui
sont chargés tous les ans, et cette garde a lieu jour et nuit. Et un baron qui gouverne la ville est nommé par
le pacha du Caire ; [le baron] est nommé par les Turcs Iskenderiye beg, et doit administrer tout à l’extérieur
et à l’intérieur de la ville. Il y a là une grande arrivée de navires de beaucoup de pays : de Constantinople, de
Venise, d’Angleterre, de la France, de la Perse et encore d’autres villes et [d’autres] pays. À cause de leur
négoce, les Vénitiens ont ici un délégué ou agent.
Il y a aussi dans la ville une haute montagne, sur laquelle se dresse une tour de guet dans laquelle
quelqu’un veille. Et s’il voit de loin un bateau, il se met à souffler [dans une trompette] et tend un drapeau
blanc dans la direction d’où vient le navire.
Elle [la ville] a aussi une colonne, longue rouge en marbre, gravée d’images bizarres, pareille à celle de
Constantinople, sur la place. Plus loin s’élèvent devant la ville, du côté de Misr deux colonnes de pierre,
mais l’une est tombée. Là, sainte Catherine aurait été martyrisée.
Il y a beaucoup de beaux jardins devant la ville, du côté de Misr, avec des plantes magnifiques et exquises.
Les marchandises d’Alexandrie sont toutes amenées de Misr ou le Caire, et sont revendues là. Surtout le
poivre, le lin, les cuirs de boeufs, les teintures indiennes et encore [d’autres] marchandises du même genre.
Les Italiens achètent aussi à Alexandrie chaque année quelques tonnes de câpres qui croissent là. En
résumé : les Turcs et les chrétiens y chargent et en emportent des marchandises [en quantité] immense.
Comme on me l’a aussi dit : quand un bateau vénitien ou anglais accoste à Alexandrie, on prélève environ
trente mille thalers de droits de douane et de taxes.
Le beg, qui réside à Alexandrie, doit aussi envoyer chaque année au pacha du Caire trois cent mille ducats
de tribut de la ville d’Alexandrie. [Cette somme] serait aussi plutôt plus grande que plus petite, comme on
me l’a affirmé. Et je le crois bien, car dans les bâtiments de la douane on prélève chaque année des navires
un argent immense. »
p. [92] :
« Les négociants de Constantinople n'apportent pas beaucoup de marchandises au Caire, mais la plupart du
temps ils font là des achats et les emportent à Constantinople. Toutefois ils apportent à Alexandrie et ensuite
même au Caire, du bois de charpente, de grands arbres, des planches, du bois [pour la construction] des
navires et d'autres choses du même genre, dont on peut faire des navires et des maisons. »
p. [94] :
« Car chaque année, plus de cent grands navires chargés partent d'Alexandrie à Constantinople, rien
qu'avec du riz, des épices, des lentilles, des fèves, des pois de Turquie nommés pois chiches, sans parler
du lin qu'on transporte du Caire à Constantinople [et] pour lequel quinze ou dix-huit [navires] ne suffisent
pas.
En outre, combien de milliers de thalers les Vénitiens et les Anglais apportent-ils chaque année à
Alexandrie ? De petits barils pleins [de thalers], qui sont transportés au Caire. Les thalers ont une valeur plus
grande que les ducats. Lorsque j'y étais, ils [les thalers] ont été interdits à plusieurs reprises, tant leur valeur
était montée. Mais on les a pris tout de même de nouveau pour la même valeur. Un thaler valait hamse
selasin444 nus, cela fait autant que quatre-vingt-quinze kreutzers. Parfois ils ont été donnés pour plus. »
p.[146] :
« Les Anglais, les Hollandais, les Français et les Italiens, qui font de grands voyages maritimes jusqu'en
Turquie, à Constantinople, à Alexandrie, au Caire, à Chypre, à Alep, à Chio, paient une double taxe et un
[double] droit de douane sur toutes les marchandises et les produits qu'ils introduisent [dans le pays], et
ensuite aussi sur ceux qu'ils achètent là et qu'ils emportent. »
p.[152] :
« J'ai vu en quelques endroits, comme à Alexandrie, à kekobata445 et à Sachas446, qu'au bord de la mer on
fait des trous et des rigoles où coule l'eau de mer. Puis la chaleur du soleil concentre cette eau et finalement
elle devient du sel. Et pour cette fabrication du sel on a besoin ni de bois ni de feu. Et il est terriblement amer
et ressemble à de l'alun. On emploie ce sel pour les câpres, comme je l'ai vu à Alexandrie. »
p.[164] :
« Peu après arriva, non seulement au Caire mais dans presque toute la Turquie, un grand et terrible
tremblement de terre, à Alexandrie, à Rechid, à Dimyat, à Circita, à Saida447, également de l’autre côté de la
mer, à Rhodes. »
443 Wild, J., Voyages en Égypte de Johann Wild, 1606-1610, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1973,
p. [I]-[III].
444 Plus exactement : ḫamsa wa ṯalāṯīn, trente-cinq en arabe. Toutes les notes de ce texte sont de
O. V. Vollkoff.
445 Peut-être la ville grecque de Kakovatos, sur la côte ouest du Péloponnèse, province d’Elias.
446 Peut-être pour Sakiz, un des noms de l’île de Chio.
447 Ville de Syrie, l’antique Sidon.
- 376 - 377 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GEORGE SANDYS (de la fin janvier au 2 février 1611)
Sandys, G., et al., Voyages en Égypte des années 1611 et 1612. George Sandys, William Lithgow, par
O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1973.
Poète anglais, George Sandys naît à York en 1577. Fils de l’archevêque de York, il étudie à Saint Mary’s
Hall (Oxford) et au Corpus Christi College. En 1596, il est admis au Middle Temple (conseil supérieur de
l’Ordre des avocats) avant d’entrer au Foreign Office (Ministère des Affaires Etrangères). Il parcourt le
Levant en curieux, visite Constantinople, la plaine de Troie, l’Égypte, la Palestine. Il meurt en 1643.448
p. [25] :
« Le lendemain nous entrâmes dans le port d’Alexandrie, récemment tombé en discrédit à cause d'un
[certain] nombre d'épaves qui, éparpillées çà et là, témoignaient lamentablement de la protection insuffisante
offerte par ce port. Car pas plus de deux nuits auparavant, les vents du nord, fouettant de toute leur force
l'entrée du port, des vagues violentes avaient arraché de leurs ancres les navires du premier [rang] ceux-ci
avaient heurté les autres et les avaient coulés tous ensemble, exactement vingt-deux en nombre, entre
autres ce grand navire de guerre appelé le "Lion Rouge", pris seulement l'année précédente aux chevaliers
de Malte. »
p. [95]-[114] :
Alexandrie : la ville ancienne. Le Phare
« Après qu’Alexandre eut soumis l’Égypte, ayant décidé de bâtir une ville qui pourrait conserver sa mémoire,
et de la peupler de Grecs, il choisit ce promontoire sur le conseil (dit-on) d’Homère qui dans un songe,
sembla prononcer ces vers :
Insula deinde quaedem est valde undoso in Ponto
Aegyptum ante (Pharum vero ipsam vocant).
Odyss. 1. 4.449
Par manque de craie, le plan en fut tracé avec de la farine, augurant ainsi son bonheur futur. [Il fut] dessiné
en forme de manteau macédonien et fut plus tard entouré de murailles par Ptolémée. Les côtés s’étendant
en longueur, contenaient, en diamètre, trois mille sept cents pas ; ceux [dans le sens] de la largeur, mille,
resserrés aux extrémités par d’étroits isthmes : limités ici par le lac, là par la mer ; l’architecte et le surveillant
des travaux fut Dinocrates. De la porte du Soleil jusqu’à celle de la Lune s’élevait de chaque côté de la route
des rangées de colonnes ; au milieu était une vaste place à laquelle aboutissaient un nombre de rues, si
bien que les gens qui la traversaient semblaient avoir entrepris, en quelque sorte un voyage. À sa gauche
s’élevait la partie de la ville nommée d’après Alexandre, étant pour ainsi dire une ville en elle-même, dont la
beauté était différente en ceci : car voyez à quelle distance les colonnes s’échelonnaient en ligne droite dans
la [ville] précédente ; ainsi faisaient-elles ici, mais étaient placées en diagonale. Si bien que l’oeil se perdait
parmi la multitude des voies, et[la vue], ravie par leur magnificence, pouvait à peine être satisfaite.
Un moment admirable à tout ceci étaient les Temples et les Palais royaux qui occupaient presque un quart
de la ville ; car chacun s’efforçait d’ajouter quelque ornement aussi bien aux maisons de leurs rois qu’aux
Temples de leurs Dieux : ceux-ci s’élevaient sur le côté Est de la ville, voisins et dépendants les uns des
autres. Parmi ceux-ci était le fameux Musée fondé par Philadelphe, et doté d’importants revenus ; on y
trouvait tout ce qu’il y avait d’éminent dans les sciences libérales ; ils y étaient attirés par les rétributions et
comblés de faveurs. Il rendit accessible aux étudiants la philosophie des Égyptiens (jusques-là réservée aux
prêtres) en l’exposant en grec. Il réunit soixante-dix des plus savants parmi les Juifs pour traduire la Bible,
appelée jusqu’à ce jour Septante. Et forma cette célèbre bibliothèque garnie de sept cent mille volumes [et]
brûlée longtemps après, par accident, quand César fut réduit à la dernière extrémité par l’assaut d’Achilles.
Reconstituée et agrandie par les empereurs romains, elle rayonna jusqu’à ce que les Mahométans eussent
soumis l’Égypte (…450).
À l’intérieur d’un sérail appelé Soma et appartenant au palais, les Ptolémées avaient leurs sépultures, avec
celles d’Alexandre le Grand,
Cum tibi sacrato Macedon servetur in antro,
Et regum cineres extructo monte quiescant.
Lucan. 1. 8.451
Car Ptolémée, fils de Sadus452, prit son cadavre de Perdiccas, qui, l’apportant de Babylone et se rendant en
Égypte avec l’intention de se saisir de ce royaume, eut la chance, à l’approche [de Ptolémée], de se réfugier
sur une île déserte ; mais il y tomba (percé de javelines) de la main de ses soldats ; ceux-ci apportèrent le
corps à Alexandrie et l’enterrèrent à l’endroit mentionné ci-dessus, enclos dans un sépulcre d’or.
Mais Cybiosactès le Chypriote ayant épousé la fille aînée d’Aulète, et devenu par elle maître du royaume
(dont elle avait été élue reine), dépouilla le corps de cette précieuse enveloppe ; mais étranglé aussitôt
après par Cléopâtre, il ne vécut pas pour jouir des fruits de sa cupidité. Ensuite il [le corps] fut recouvert de
verre et resta ainsi jusqu’à l’arrivée des Sarrasins. On voit jusqu’à présent ici une petite chapelle avec, à
l’intérieur, une tombe, très honorée et visitée par les Mahométans, où ils donnent leurs aumônes, supposant
que son corps repose en cet endroit ; lui-même passe pour un grand prophète, ainsi que leur enseigne leur
Alcoran.
En face de la ville s’élève l’île de Pharos qui était jointe au continent par un pont (qui servait aussi de support
à un aqueduc) sous lequel les bateaux passaient d’un port à un l’autre, les deux construits grâce à la
présence de l’île. Sur un de ses promontoires, sur un roc environné par la mer, Philadelphe fit bâtir une tour
d’une étonnante hauteur ; on y montait par des marches et elle avait beaucoup de lanternes au sommet,
dans lesquelles des feux brûlaient [pendant] la nuit pour [indiquer] la direction à ceux qui naviguaient sur la
mer, car les rives, sur les deux côtés étant rocheuses, basses et démunies de ports, ne pouvaient être
approchées sans grand danger.
Cependant à plus d’une reprise, la multitude des lumières apparaissant de loin comme une seule, et prise
pour une étoile, produisirent des effets contraires à la sécurité promise. Elle avait la réputation d’être la
septième merveille du monde, appelée d’après le nom de l’île. À présent c’est un nom général pour [les
bâtiments] qui servent à cet usage. Sostratus de Gnyde, fils de Dexiphanes, aux dieux protecteurs, pour la
sauvegarde des marins, qu’il recouvrit de plâtre sur lequel il inscrivit le nom et titre du roi : de façon que
celui-ci s’étant bientôt effrité, son propre nom, inscrit dans le marbre, puisse être glorifié éternellement. Ce
promontoire s’étendant jusque tout près de celui du continent opposé, forme une entrée étroite dans un port
dangereux appelé Port de la Tour ; devant lui, et à l’intérieur, il y a beaucoup de rochers, les uns invisibles,
les autres saillants, qui bouleversent continuellement l’eau agitée. Celui de l’autre côté, nommé Port abrité,
plus sûr que commode, est réservé seulement aux galères turques.
Alexandrie ancienne. Le lac Maréotis et le Labyrinthe
Sur le côté sud de la ville, et non loin d’elle, est le lac Maréotis, qui ressemblait jadis à la mer aussi bien par
son étendue que par sa profondeur. Fait de main d’homme, comme le conjecture Hérodote par les deux
pyramides, [placées] au milieu, [la partie] sous l’eau égale à celle au-dessus ; celle d’au-dessus s’élevant à
cinquante pas. Sur chacune d’elles s’élevait un colosse de pierre qui ajoutait encore à la hauteur de la
[partie] visible de la construction. C’étaient les sépulcres du roi Moeris et de sa femme, censé d’avoir creusé
ce lac qui ne produit pas d’eau par lui-même ayant un fond sec et sablonneux, mais est rempli chaque
année par les crues du Nil ; on le laissait entrer par divers canaux, dont l’embouchure comportait des
écluses pour régulariser l’excès des flux et des débordements qui montaient pendant six mois consécutifs, et
descendaient pendant un laps de temps égal. Un travail d’une envergure extraordinaire, et une oeuvre
incroyable.
Le Labyrinthe, qui ne lui cédait en rien, avoisinait cet ouvrage. En son milieu, il y avait trente-sept palais
relevant des trente-sept juridictions de l’Égypte (dont six étaient en Thébaïde, dix dans les Delta et dix-sept
dans la région médiane), et où se rendaient les trente-sept présidents pour célébrer les fêtes, de leurs dieux
(qui avaient, là, chacun leur temple ; de plus quinze chapelles contenant chacune une Némésis) et aussi
pour émettre leur avis dans les affaires concernant le bien-être général. Ses voies d’accès traversaient des
cavernes d’une longueur étonnante, pleines de sentiers sinueux, aussi sombre que l’enfer, et des chambres
[bâties] l’une dans l’autre, ayant beaucoup de portes pour troubler la mémoire et décontenancer, induisant
[ainsi] en des erreurs inexplicables : tantôt montant très haut, puis redescendant, souvent contournant des
murs revenant sur eux-mêmes et formant un dédale embrouillé, impossible à traverser ou à quitter sans un
guide. Le bâtiment [se trouvant] plus sous terre que dessus est tout en pierres massives, et construit si
adroitement que dans l’entière construction on n’a employé ni ciment, ni bois.
Arrivé à l’extrémité [du labyrinthe on trouvait] deux escaliers de quatre-vingt-dix marches qui conduisaient
dans un magnifique portique supporté par des colonnes de pierres thébaine : [c’était] l’entrée dans une
vaste salle (un endroit pour leurs réunions générales), toute de marbre poli, ornée de statues de dieux et
d’hommes, avec d’autres figurant des monstres. Les chambres étaient disposées de telle façon que les
portes, en s’ouvrant, faisaient un bruit pas moins terrible que le tonnerre. La première entrée de marbre
blanc était entièrement décorée à l’intérieur de colonnes de marbre et de statues variées. Elles figuraient
ainsi la vie embrouillée de l’homme, traversée et mêlée de multiples maux, l’un succédant à l’autre, à travers
lesquels il est impossible de passer sans les conseils de la sagesse et la pratique d’une force d’âme sans
défaillance. On dit que Dédale l’imita en celui qu’il bâtit en Crète ; mais n’y reproduisant à peine que la
centième partie.
Celui qui montait sur le sommet, voyait pour ainsi dire une vaste plaine de pierre et l’ensemble de ces
trente-sept palais environnés de solides murailles formées de pierres d’énormes dimensions. À l’extrémité
de ce labyrinthe se dressait une pyramide carrée d’une largeur étonnante et d’une hauteur correspondante :
le sépulcre du roi Ismandes qui l’avait bâtie. Au bout de ce lac croissaient d’excellentes vignes qui duraient
longtemps.
Gemmaeque capaces
Excepere merum, sed non Mareotidois uvae
Nobile sed paucis senium cui contulit annis.
Lucan. 1. 8.453
Ce lac offrait un autre port à la ville, plus avantageux que celui de la mer, par suite des marchandises de
l’Inde, du golfe arabique et des régions des hautes terres de l’Égypte, amenées grâce aux facilités
présentées par le passage dans des canaux maintenant complètement ruinés. Et celui-ci était relié par un
étroit passage à un autre lac beaucoup plus petit et plus près de la mer : jusqu’à présent il fournit en
abondance du salpêtre à toute la Turquie.
Alexandrie ancienne : le canal, les citernes
Entre le plus petit lac et la ville existe un canal artificiel qui leur fournit de l’eau (car ils n’ont pas de puits) en
temps de crue ; elle était amenée par des conduits dans de vastes citernes (maintenant la plupart d’entre
elles sont embourbées, car elles ne sont pas utilisées : une cause de beaucoup de maladies en été) et ainsi
préservée jusqu’à la crue suivante. Car Alexandrie était toute bâtie sur des voûtes, supportées par des
piliers taillés l’un sur l’autre et revêtus de pierres : à tel point qu’une grande partie d’elle était dissimulée sous
la terre, sans qu’on eût tenue compte du coût ou du nombre [de pierres]. Telle était la reine des villes et la
métropole de l’Afrique : mais
Heu ! quantum haec Niobe distabat ab illa…
Ovid. Met. 1. 6.454
Dont il ne reste rien sauf des ruines, et celles-ci [sont] d’infidèles témoins de ses beautés disparus,
annonçant plutôt que les villes, de même que les hommes, ont leurs époques [de splendeur] et leur
destinée. Seuls subsistent les murs qui furent bâtis (comme disent certains) par les Ptolémées : les uns à
l’intérieur des autres, crénelés et flanqués de soixante-huit tourelles plutôt imposantes que solides, si on les
compare avec les [murailles] modernes. Toutefois, par les anciennes descriptions et les ruines à l’extérieur,
celles-ci semblent n’avoir entouré qu’une partie de la ville.
Alexandrie depuis la conquête arabe. Aspect de la ville
Ensuite, détruite par les Sarrasins, elle resta vide pendant longtemps jusqu’à ce qu’un prêtre mahométan
promit (d’après les prophéties de Mahomet, disait-il) des indulgences à tous ceux qui la réédifieraient,
l’habiteraient ou verseraient de l’argent dans ce but avant une certaine date, [et ainsi] la repeupleraient en
peu de temps. Mais une destruction ultérieure fut infligée par les Chypriotes, les Français et les Vénitiens,
qui surprirent la ville par un massacre grandiose au temps où Louis IV fut libérée par le sultan. Mais ayant
appris l’approche du sultan (qui avait levé une grande armée pour la secourir) et ayant perdu l’espoir de
pouvoir la tenir, ils y mirent le feu et s’en allèrent. Le sultan répara les murailles aussi bien qu’il le put, bâtit
pour la défense du port le fort qui s’élève maintenant sur le Pharos, et lui donna l’aspect qu’il a maintenant.
Les ruines forment divers monticules, dont l’ascension est interdite aux chrétiens afin qu’ils n’obtiennent pas
une vue générale trop exact de la ville. Dans [ces monticules] on trouve souvent (surtout après un orage)
des pierres précieuses et des médailles, portant gravées les figures de leurs dieux et d’hommes, avec un art
si parfait, que celles gravées maintenant semblent, comparées à celles-ci, des imitations mal faites et
maladroites. Sur le sommet de l’un d’eux s’élève une tour de guet où se tient toujours une sentinelle pour
annoncer les voiles qui s’approchent. Il y a peu de restes d’antiquités : seulement un obélisque à
hiéroglyphes, de marbre thébain, presque aussi dur que du porphyre, mais d’un rouge plus foncé et
également tacheté ; il est appelé Aiguille de Pharaon, se dressant là où s’élevait jadis le palais d’Alexandre,
et un autre, gisant à côté et semblable [au premier], est à moitié recouvert de débris.
Hors des murailles, au sud-ouest de la ville, s’élève sur une petite colline une colonne de la même matière,
entièrement d’une seule pierre : elle a quatre-vingt-six palmes de haut et trente-six de circonférence (sic) – la
palme comprenant neuf inches et quart selon la mesure de Gênes, et d’après les mesures prises pour Zigla
pacha par un Génois : elle est placée sur un cube carré, (ce qui est digne d’admiration), moins large que la
moitié de la base de la colonne ; elle est appelée par les Arabes Hemadaflacor, ce qui signifie la colonne
des Arabes. Ils racontent une légende, comment un des Ptolémées l’érigea à l’extrémité du port pour
défendre la ville des incursions navales ; il plaça un miroir magique d’acier au sommet, ayant la faculté
(lorsqu’il était découvert) de mettre le feu aux navires qui passaient. Mais jeté à terre par les ennemis, le
miroir perdit ce pouvoir, et à sa place ils élevèrent de nouveau la colonne. Elle a été appelée Colonne
Pompée par les chrétiens de l’occident, et on dit qu’elle fut élevée par César en mémoire de sa victoire sur
Pompée.
Le patriarche d’Alexandrie a ici une maison avoisinant une église qui se dresse (comme ils le disent) là où
fut enterré saint Marc, leur premier évêque et martyr ; au temps de Trajan, il fut traîné avec une corde nouée
autour du cou jusqu’à la place nommée Angeles et fut brûlé là par les païens idolâtres pour le témoignage
qu’il rendait au Christ. Après cela ses os furent transportés à Venise par les Vénitiens, [car] il était le saint
patron de cette ville. À présent il y a deux patriarches, l’un des Grecs, l’autre des circoncis, le patriarche
oecuménique des Coptes et des Abyssins. Le nom du patriarche grec actuellement en fonction est Cyrille, un
homme savant, d’une vertu éprouvée, un ami de la religion réformée et s’opposant à l’autre religion : disant
que la différence entre nous et les Grecs ne concerne que l’écorce, mais qu’il y a des noyaux entre eux et
les autres. Nous parlerons encore de lui plus loin.
Les constructions existant maintenant, misérables et peu nombreuses, ont été érigées sur les ruines des
précédentes : seule la partie située le long du rivage est encore habitée, le reste est désert ; les murailles
sont presque quadrangulaires ; de chaque côté il y a une porte, l’une s’ouvrant sur le Nil, l’autre regardant le
Maréotis, la troisième les déserts de Barcha et la quatrième le port. Elle est habitée par les Maures, les
Turcs, les Juifs, les Coptes et les Grecs, plutôt à cause du commerce (car Alexandrie est un port franc, aussi
bien pour les amis que pour les ennemis) qu’à cause de la commodité de la place. Elle est située dans le
désert où ils n’ont ni labour, ni pâturages, à l’exception de ce qui avoisine le lac, [et représente un territoire]
bien petit et pas cultivé ; cependant ils gardent en réserve un nombre assez grand de chèvres qui ont des
oreilles pendant jusqu’à terre et qui paissent parmi les ruines.
Sur l'île du Pharos, faisant maintenant partie du continent, s'élève un fort qui défend l'entrée du port ; il n'y a
pas d'eau à l'exception de celle qui est apportée sur des chameaux des citernes de la ville.
Arrivée à Alexandrie
Comme c'est l'usage, nous le saluâmes à notre arrivée d'un coup de canon. [Tous], autant que nous étions
descendus à terre, nous fûmes menés à la douane pour être fouillés, ainsi que nos bagages. Là il faut payer
deux pour cent pour ce que nous avons, et ceci en nature, seul l’argent paye pour un et demi. Ils en
prennent un relevé exact, afin d’avoir une base pour l’évaluation des marchandises retournées ; ensuite ils
payent onze pour cent de plus, même pour les marchandises qui n’ont pas subi d’altération (sic). Cette
liberté de commerce est achetée à ce haut prix, les musulmans payant autant que les chrétiens. Les
douanes sont affermées par des Juifs, qui payent en retour au Pacha vingt mille médins par jour, trente
d'entre eux équivalent à un royal de huit.
Nous logeâmes dans la maison du consul français, sous la protection duquel se placent tous les étrangers.
Le khan est fermé par les Turcs l'après-midi et les nuits, par crainte que les Francs ne souffrent des
outrages ou ne les infligent [eux-mêmes]. Le vice-consul tient table [ouverte] pour les négociants ; le consul
lui-même, un noble de Venise, moins libéral de sa présence qu’occupé de ses plaisirs, est plutôt imposant
que fier, s’attendant aux [marques] de respect et méritant la bienveillance ; il était prêtre et aurait voulu être
cardinal ; avec cet espoir, dit-on, il nourrit son ambition. Il nous fournit un janissaire comme garde [pendant
notre séjour] au Caire, son traitement était de cinq pièces d’or, à part sa propre nourriture et celle de son
serviteur ; en plus [il exigea] une provision de poudre. Pour nos ânes (pour le voyage dans ce pays, ils ne
sont pas inférieurs aux chevaux) [il fallut payer] un demi sharif par bête ; pour nos chameaux, un [sharif]
entier. À la porte, ils prélevèrent un médin par tête, pour nous-mêmes et pour nos ânes : telle étant leur
indifférence à notre égard ! Nous ne pouvions passer sans un Tascaria du Cadi, le principal fonctionnaire de
cette ville.
Départ pour Rosette
Le deux février dans l’après-midi, nous commençâmes notre voyage, traversant un désert qui produisait ça
et là quelques palmiers non cultivés, des câpriers et une herbe appelée par les Arabes Kall. Ils l’utilisent
comme combustible, puis recueillent les cendres ; ils les vendent comprimées en une pierre, en grande
quantité aux Vénitiens ; ceux-ci, mélangeant [ces pierres] en proportions égales avec les pierres apportées
de Pavie par le fleuve Ticinum, en font leurs cristaux.
À notre gauche nous laissâmes divers bâtiments en ruines dont on dit qu’ils furent jadis le château royal de
Cléopâtre. Au-delà s’élève Bucharis, jadis une ville petite mais ancienne, maintenant ne montrant que ses
fondations ; là croissent beaucoup de palmiers qui nourrissent les nécessiteux vivant tout autour dans de
misérables cahutes. Là une tour sur un rocher dispense la nuit une lumière aux marins, car l’endroit est plein
de dangers. Peu après nous passâmes près d’une garde de soldats, placée là pour la traversée de ce
passage, et nous payâmes un médin par tête. »
- 378 - 382 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JULIEN BORDIER (du 10 au 22 septembre 1611)
Bordier, J., Partenant de Paris de monseigneur Le Baron de Salignac Ambassadeur pour sa majesté tres
chretienne a Constantinople (1604-1612), Paris, Bnf, Ms. Fr. 18076.
Né à Pluviers, village près de Nontron (Dordogne), Julien Bordier est issu d’une famille de vignerons. Il
s’engage dans la troupe qu’un des seigneurs du pays organise pour le compte du duc de Savoie. Durant
cette période, il fait de nombreux voyages dans la péninsule italique. Par la suite, il se rend à Constantinople
en tant qu’écuyer du baron de Salignac, Gontaut-Biron, nommé ambassadeur à la Porte ottomane
(1604-1610) par Henri IV. À la mort du baron, Julien Bordier revient en France par la Terre sainte et
l’Égypte. Plus tard, il repart à Alep, probablement en tant que chargé d’affaires de Philippe d’Harlay, comte
de Césy, ambassadeur de France à Constantinople de 1621 à 1630. C’est dans cette ville qu’il met au net
sa relation de voyage.455
Feuillets 736 à 743 :
De mon arrivée & sejour d’Alexandrie & singularité dicelle ville. Ch. 41
« Toute la caravane prit terre, chascun alant qui ça qui la, & moy fis porter mes hardes, au logis de monsieur
le Consul Farnoulx, suivant ce qui m’avoit chargé de faire, ou je fus le bien venu & resceu de monsieur
Aubert son agent ou commis, auquel je donnay la lettre du sieur consul, la recevant et moy aussy, avec
beaucoup de caresse & d’honneur, la ou apres quelques petis complimant, me fit acomoder une tres belle
chambre sur la terrasse de laquelle se peut voir la ville les champs & la mer ensemble, or est il qui ly a trois
ou quatre villes portant ce mesme nom d’Alexandrie, toutes fondée ou edifiée du grand Alexandre de
Macedoine dont je metré ycy la premiere du nombre, la ville d’Alexandrie d’Atropatie qui est proche la mer
Caspié que les Perses et Turcs appellent Derbant, ville du pays de servan lequel est entre la mer Caspié qui
luy est au levant & la grande Armenie qui luy est au ponant, l’autre est au territoire de Troye, dite Alexandie
de Phrygie qui souloit estre colonie & escolle des Romains, mais de celle cy dont veux je maintenant parler,
tandis que je suis au lieu mesme pour estre la plus renome & fameuse de toutes, combien que ceste cité
n’ait en faute de bons & tre excelants autheurs qui ont tres dignement louangé & exalté sa fameuse
renomee, ne fusse que son cher fils ou citadin, ce grand et merveilleux mathematicien Ptoleme qui naquist
en ycelle, comme aussy fit depuis ceste tres genereuse vierge & princesse ste. Catherine, fille du Roy
Coste, laquelle soufrit tres constamment martire en l’an de grace 307 le 25 de novembre, sous le tiran
Maxance, & son precieux corps porté par les Anges sur le hault mont de Sinay, ainsi qu’a esté dit au
ch. 29 & par ce que la plus part des Autheurs tiennent que ce fut ce grand Alexandre, qui premier fit planter
les fondemant de ceste cité, j’ay bien voulu ycy aleguer ce qu’en dit le grand sainct hierosme au 3e chapitre
du prophete Naun, disant qu’Alexandrie ne fut anciennement qu’un bourg appelle No, habitué de plusieurs
gens mais qu’Alexandre voyant ce beau lieu & plaisante assiete, le fit agrandir & fortifier de muraille, & orner
de beaux palais & edifices qui fut en l’an du monde 3640, & avant la venue du seigneur 326 & fut dont ceste
ville selon Plutarque desaignée par commandemant de ce grand Roy, d’un grand architecte appellé
Dinocrates, a 12 mil du Cap de Boquiri, sur l’embouchure du Nil appellé Canoby, mais y ly a deux fois plus
loing de l’un a l’autre, qui ne dit Pline en son 5e Li. Ch. 10, dit que son plan est rond, en forme d’un caban
estendu en terre, ayant 15 mil de circuit, qui seroit 5 lieue, ayant du coste de midy tirant au ponant,
(fol. 736v) le grand lac Mareotis dans lequel entre un canal artificiel d’eau du Nil pour rendre la ville plus
marchande & aussy pour l’abreuver n’y ayant autre eau & dit pluie qui la (sic) 30 mil de large & 600 de circuit
y ayant plusieurs isles, quelques uns ne le tiennent sy grand mais quoy que soit c’est la verité qui lest tres
grand & large, tant que la veue se peu estendre, la mediterrane est au septentrion de la ville d’Alexandrie qui
faict deux ports, l’un au bout de la ville du costé ponental qui n’est que pour les gallaires dont y a quatre
d’ordinaire pour la garde dicelle, l’autre pour est plus haut, du coté du levant a l’oposite du milieu de la ville
qui n’est nullemant seur de la bise ou tramontane pour les grands vaisseaux a l’emboucheure duquel sont
deux chasteaux ou forteresses, l’une plus grande que l’autre, qui servent de phanal la nuict pour les
naviguant, y ayant aussy quelque piece de canon dessus, mais voyons l’enceinte ou circuit de la ville qui est
de grande estendue, la muraille de laquelle estoit autrefois magnifique avec la fausse brais a lantour & par
dehors fort bien flanquée de tres grande quantité de tours rondes, beaux portails arcades, les mesmes dit on
qu’Alexandre fit fonder, combien qu’a presant pour l’antiquité, le tout est tellemant endomagé pour estre de
pierre, jusque a estre mince & pourie de la clarté de lune, de force que l’on voit quantité de grand trous ou
long & carré qui traverse la muraille a jour, principallemant ce qui regarde le midy, estans dont ceste ville
situee, selon Pierre Arien & Gemma Frison en son addition a 60 degré de longitude & 31 de Lat., or pour ce
qui est du dedans de la ville ce n’es maintenant que tristesse de tous costez tant de ruisne & murger de
pierres terre briques & autres materiaux que les edifices anciennes & maisons terrassee par quelque tremble
terre, mais principallement de cruelles guerres de tant de nations diverses, dont la plus doumageable fut de
Saladin, sultan d’Egypte, lequel voyant ne la pouvoir garder contre la puissance des Chrestiens, il fit razer la
plus part des murailles & toutes les maisons & lieux remarquable, comme j’ay dit ailleurs, sy bien qu’a
presant ne s’y voit que deux rue telle quelle ou se tient le marché ou basard qui est proche la marine, qui
sont petites maisonnettes & boutiques de marchants ou plus tost merciers qui vendent en destail car les
marchants estrengers qui viennent charger a Alexandrie se fournissent aux magasins ou se treuvent toutes
sortes de marchandises qui viennent du Caire, de Sirie & autres pays & abordent au port proche duquel est
une place de sable dur et uny, longue de 300 pas environ, large de 150 ou y a plusieurs maisons autour,
commerces en terrasse ou l’on couche l’esté dessus, ainsy qu’au Alep, Tripoly, Gaze & autre lieux, tant pour
eviter la chaleur de la nuict que de l’importunité des moucherons ou cousins qui tourmantent estrengemant
les personnes veillant ou dormant, ayant dont tout remarqué ce que dessus le sieur (fol. 737) Aubert
m’envoya querir pour le diner ou estoit quatre ou cinq honestes hommes tant des domestiques du sieur
consul que de marchants estant jour de poisson, dont se treuve quantité en Alexandrie tant de mer que
d’eau douce, le vin qui s’y boit vient la plus part de l’archippelle & autres isles comme Candie, Zantes,
Chypre & autres lieux car en Egypte ny a vignes bois ny tailles sinon quelques trailles de vignes par les
jardins qui produisent tres excellant resins. La grand chaleur estant passée, j’allay faire une promenade,
avec un tres honeste homme, du logis du sieur consul, par la ville, & me mena premier voir le lieu ou sont les
trois colonnes, belle & hautes, de marbre thebaine, lesquele ne sont que peu moindre que celle de la place
St Marc de Venise, & y en avoit quatre, mais l’une fut enlevée & portée ailleurs, les chretiens les ayant faict
dresser en ce lieu, qui est une rue passante ou se voit une pierre, laquelle l’ont (sic) tient qu’est la marque
du lieu, ou St Marc l’evangeliste eust la teste tranché, les Venitiens ayant faict ce qui l’ont peu pour avoir
ceste pierre a quoy les habitans de la ville & du pays n’ont jamais voulu consentir, bien qu’ils soient
mahometants, ayent conoissence de ce sainct personnage, sy ce n’est que par longue ensage, ils ayent
reconus, que de pere en fils, l’on a toujours conservé ceste pierre & colonnes, qui ont este mise la que pour
quelque grand sainct & mémoire de ce sainct martire pour les chrestiens, de ce lieu nous alasmes voir la
maison de Coste, Roy payen & pere de ceste tant saincte vierge Catherine, de brique dure & forte a
merveille & d’assé belle structure, mais maintenant, ne s’y voit que les murailles d’autour & du corps de
logis, sens portes fenestres ne commerces & demeure innutille, bien que ce lieu soit gracieux, nous nous
contantasme pour ce jour, retournant au logis, & l’apres soupee, nous nous promenasmes sur les terrasse,
prenant la fraicheur du vent marin, qui ne manque tous les soirs, devisant ou discourant, qui du’une chose
que du’une autres, le dimanche II nous ouymes la messe, dans ce fondic, qui est le mesme logis du sieur
consul Fernoulx, ou y a une chapelle gentillemant ornée par un religieux de St françois, que le reverand pere
gardien de Hierusalem envoye tous les ans aux Chappellenie, comme Tripoly, Baruth, Seyde, Alep,
Alexandrette & autre lieux de levant, frequanté de Chrestiens latins, & se trouva a ceste messe plusieurs
marchants provençaux & quelques honestes gens artisans, apres le service, nous alasmes six ou sept, voir
l’Eglise Saincte Saba, qui est un monastere des Grecs, & demeure de (fol. 737v) leur Patriarche
d’Alexandrie, qui y tient plusieurs caloyers, de l’ordre st Basille, en ceste Eglise y a grand devotion, tant des
Grecs que des latins a cause qu’en ce lieu, fut martirisé la saincte vierge Catherine, proche la porte de
l’Eglise, ou se voit pour marque du lieu, une pierre de marbre blanc, qui fut le 25 de novembre, en l’an du
seigneur 307, comme a esté dit, sous l’Empereur Maxance, grand tiran et persecuteur des Chrestiens, & son
precieux corps par graces Divines, porté par les Anges au mont Sinay, en ce lieu nous ouymes la messe
Grecque, pour voir les ceremonies delle, dont j’ay assé parlé ailleurs, laquelle estant finie, nous
retournasmes du costé des murailles de la ville, tirant à la Marine, ou me fut monstré un Obelisque ou
Eguille, de marbre ou pierre Thebayque, marqué a petis grains rouge, blanc & noir, mais paroist rougeastre,
ainsy que porfyre, elle est sur pied en terre, ne sçachant sy elle est levée sur pied destre ou quoy, sortant
hors ycelle terre de l’hauteur de 60 pied ou environ ou grosse par bas d’environ 5, ne pouvant juger de
combien elle est cachée avant en terre, estant de bas en haut, remplie de caractere egyptiens, ou lettre
hieroglifiques, proche icelle y en a une autre couchée en terre, dont la pointe y est cachée ou couverte, par
quoy ne se puis bonnemant juger de la longueur, estant de pareille pierre, mais peu plus blanchastre, & tout
unie sens caractere ou autre chose, les souhaitant pour les voir la innutille, l’une dressée au millieu de la
Place Royalle, l’autre a la Place Dauphin a Paris, nous retournasmes au logis, passant par un grand cartier
de la ville, ou ne se voit que ruisnes & desbris, d’Edifices & maisons, qui ont este mises le desus desous, ny
en ayant resté en tout ce cartier une seule entiere, n’estant plus que vray repaire de vils animaux, comme
serpant, scorpions, lesards, cameleons & autre vermine, & parmy cest vieilles maisons, se prand grand
quantité de cailles, qui viennent remetre & cacher dans cest desbris, ou y a plusieurs gens du pays aux
aguets pour les voir tomber en terre, laquelle est aussy tost comerce d’un fillet maillé qui se jecte desus,
ainsy que se faict d’un epervier ou autre fillet, pour prendre le poisson, & se treuve homme qui en prendra
quatre ou cinq dousaine le jour, car ces merveille de l’abondance, & grand quantité qui se treuve des
oyseaux la aux champs & a la ville, & arivasmes au logis avec deux douzaine de cailles, qui ne cousterent
que deux medins, qui estoit six blancs de nostre monoie, que nous avions veu prendre avec ce filet, qui les
faisoit treuver meilleure au disner apres lequel nous demeurasmes en chambre, a discourir de plusieurs
choses, & autres a jouer aux echecz, cartes & autres passetemps laissant passer la chaleur, qui estoit sur le
jour violante a merveille, pour moy qui n’ay jamais sceu m’adonné au jeu, je prenois plaisir a me faire
raconter des choses les plus remarquable des pays ou terroirs, m’enquirant a trois ou quatre du logis, gens
curieux & spirituels, de ce qui l’y avoit de plus signalé & remarquable, dans & hors Alexandrie, & me dit la un
de la compagnie, qui me falloit voir la colonne de Pompée, qui est chose digne d’estre veue, pour estre
du’une merveilleuse grosseur & haute sy bien que des lors, nous proposames d’y aller le landemain
ensemble.
(fol. 740456) De la merveilleuse Colonne Cesarienne & autre singularité d’Alexandrie, ch. 42.
Le lundi 12 nous nous treuvasme six ou sept honestes gens, qui fismes ceste promenade les uns pour
l’amour des autres qui fut hors la ville du costé du midy, passant par la campagne sablonneuse, toute pleine
de capriers hault de 5 & 6 pieds, & portent les capres grosses comme les plus grosses avelines, non si
bonnes que les petites, dont la tige se despouille l’hyvert & sont fort poingnante, ce que ne font ces grand
capriers dont je parle a presant, qui sont en tous temps verdoyant & feuillus & n’ont espines roingnentes, &
se treuve aussy quantité d’herbe appellée hermala ou souchet, comme aussy y a il force tamarins, & genetz
sauvage par tous ces lieux, ayant dont cheminé environ un mil nous arivasme au pied de ceste superbe &
admirable colonne que j’appelle Cesarienne contre tous ceux qui en ont escrit, & l’appellent Colonne de
Pompée, ce qui ne peut estre, puis que ce fut ce grand Octavie Auguste Cesar qui la fit en ce mesme lieu
dresser ou eslever, ou elles est encor a presant sur pied, tant en memoire de la signalle victoire qu’obtint le
grand Cesar son oncle en la bataille de Pharsale contre le grand Pompée qui fut en l’an du monde 3922 que
pour celle qu’il obtint aussy quelque temps apres contre Sex. Pompée fils dudit grand Pompée a rayson de
quoy elle doibt plus tost porter le nom de son fondateur vinqueur & triomphant, que du vincu fuyant comme
font les autres superbes colonnes Trajanne & l’Anthonine de Rome, & ceste admirable colonne historialle de
Constantinople, en laquelle sont depinte en petite figures, les victoires des Empereurs Constantins dont elle
porte aussy le nom, or cecy soit dit avec suportation du lecteur, puis que c’est la verité, au reste nous
arrivasme donc au pied de ceste huyt’yesme merveille, sy mest ainsy l’oisible de dire, chose veritablement
digne de regard, pour estre haute d’environ 12 thoise, & neuf a dix pied de diametre, tant que six hommes
pouvoint embrasser, & ne se voit rien de semblable neul lieu que ce soit, pour une colonne, laquelle est
du’une seulle pierre thebayde, qui est aprochant du porphyre presque ainsy rougeastre & fort unie &
luisante, estant un peu froté de quelque linge, ou autre chose car l’er & le serin luy oste son lustre, son peid
d’estal qui est de forme cubique est de pareille pierre, de l’hauteur de plus de plus de deux thoise, & trois de
chasque quadrangle, ou a esté faict de grandes ouvertures au dedans, dans laquelle il peu demeurer quatre
ou cinq personnes a comercé qui a este cavé pour l’opinion que l’on avoit, qui l’y eust quelque thresor caché
au pied de ceste colonne, le chapiteau est plus grand que le pied d’estal, fort bien elabouré a la corinthiene,
ou l’on tient que les Egyptiens avoient fait metre une statue de leurs Dieux, que fortemant ils adoraient, & est
ycy a noter, que la plus part des (fol. 740v) Obelisques, ou Eguilles, Colonnes, Piramides, ou autres telle
choses semblables tres anciennes que l’on voit a Rome, Venise, Caire, Alexandrie, Gaze, Tyr,
Constantinople, Mastric, Sinope, & tant d’autres lieux que j’ay veus, qui sont de mesme matiere & ont estez
transportez des lieux en autres, soit sur grands vaisseaux ou radeaux par grand artifices, & n’est ia besoing
de ses merveilles de voir de sy belle & longue pierre, comme se voit par tous ses lieux, car je puis dire avoir
veu des rochers par l’Arabie dont l’on eust peu tirer des pierres entieres de deux cent pas de long & plus, &
grosses tant que l’on voudroit, sy l’y avoit des Ptolomée, Sesostris, Feron, Cheops, Psametique, & autres
Roys d’Egypte encor a presant, pour ce faire, car c’estoit chose facille aux Egyptiens de tirer des carrieres,
tant d’Egyte que d’Arabie les pierres dont ils faisoient tant de merveilleux Colosses, Colonnes, Piramides,
Sphinx, Androphinx, Obelisque, & d’autres chose admirable, comme ce merveilleux cabinet d’Amasis, trois
du nom Roy d’Egypte, suivant ce qu’en dit Herodote, en son livre 2 d’Enterpe feuillet 64, disant que ce Roy
fit venir de la ville d’Elephantine, un cabinet d’une seulle pierre, lequel portoit hors d’oeuvre 18 coudée de
profond, large de 12 & hault de 5, pour lequel conduire a Saïs, au temple de Minerve, distant lu’une de
l’autre 20 journée, furent employé deux milles hommes, l’espace de 3 ans, & de plus fit metre a Menphys
devant le temple de Vulcan, un Colosse de 75 pied de long, dont ne se void rien, dez le temps que la ville fut
ruisnée. Combien qu’un certin Autheur ait efrontemant escrit depuis 20 ans, l’avoit veu, & dit Herodote que
durant le regne de ce Roy, le Royaume d’Egypte fut sy bien regy & gouverné que s’y treuva de son temps,
vingt mile ville bien habitée. Combien que Pline ne fasse mention que de mille seullemant, pour moy je
remets de diferand a eux, de ce qui estoit de ce temps la, mais pour le presant, je croy qui n’y en a pas trois
cents, & quand je devois la moitié moins, je croirois ne point mentir, d’autant que tout a esté reduit a rien, ou
simple vilages, puis que la tiranie des Sarasins & Mahometans, ont usurpé le pays d’Egypte, & autre qui
tient des Chrestiens, estant donc en ce lieu, & au pied de ceste Colonne, que j’appelle a bon droit
Cesariene, a contempler l’aspect de tout ce contour, nous voyons cleremant ce grand & fameux lac
Mareotis, qu’aucuns tiennent avoir 600 mil de circuit, qui veux dire deux cent lieues, ce que je ne croy
neulmant sy la veue ne me trompa lors, avec l’opinion de beaucoup, mais c’est la verité qui l’est des plus
grand & poissonneux a merveille, & la ? de tres grand reveneu, apres avoir demeure pres d’une heure au
pied de ceste superbe colonne, a deviser de plusieurs choses, pour le beau lieu & assiette ou elle est
dresse, nous retournasmes entourant les murailles de la ville par dehors lesquelle comme a esté dit, sont
grandemant endomagée de la lune (fol. 741) de l’air & du temps, & alames passer au lieu ou St Athanase fit
le simbolle, lieu fort désolé a presant, ou ne se voit que les vestiges d’une grotte ou masure, ou n’habite
personne, costoyant tousjours les muraille, nous passames devant la porte que les Latins et Italliens appelle
Porta del Pepe, ou Porte du Poyvre, par ce que par ycelle passoit toutes les Epicerie & aromates, qui
venoient des Indes & d’Arabie, & fume voir le calix ou canal qui vient du Nil, peu au dessous de Sindiou, non
du tout sy beau ny profond que celuy du Caire, bien qui fut faict par le grand Alexandre, avec la ville, & n’y
venoit pas beaucoup d’eau a lors, pour estre rompeu en plusieurs endroits, dont se plaignoient le peuple de
la ville et des champs, pour n’avoir autre eau a remplir leurs citerne, qui leur est distribuée par plusieurs petis
canaux & ruisseaux souterrins, faict de belle pierre de taille & voutez en force que rien ne peut gaster l’eau,
ce qui a tousjours duré, a ce qu’ils disent de puis le grand Alexandre, nonobstant les grand ruisnes de la
ville, en laquelle nous entrasme par la susdite porte du Pepe, & montasme une certaine bute ou montagne,
sur laquelle estant nous en visme deux autres devant nous, que l’on dit avoir esté faictes toute trois des
ruisne de la ville, qui furent aportée & emmoncelée en ces lieux d’ou ce voit toute la ville, le port dicelle, la
mer, le lac & tout le pays d’autour, embely en plusieurs lieux de palmiers, figuiers, cassiers, tamarins,
lauriers, orangers & plusieurs autres, ça & la, qui en rand la veue agreable, tant proche le lac que du canal
sudit, le rivage duquel est garny de quantité d’arbres papire, dont se faisoit anciennement, selon Pline le
papier, comme a esté dit, selon le raport de Varo, lequel assure en avoir esté treuvé l’invention en la
Conqueste d’Egypte par Alexandre, lors qui fonda la ville d’Alexandrie, ou se fit le premier papier, & sy ceste
jadis tant fameuse cité fut renomée pour avoir esté esdifié de ce grand Roy, aussy a elle esté sa sepulture
faict par Ptolomé lors gouverneur d’Egypte, qui fit metre le corps embaumé de ce grand Roy, dans un vase
de verre clos de tous costé, pour le mieux conserver, puis mis en un cercueil d’or, pour conserver ce vase,
qu’Auguste voulu voir, luy estant en Alexandrie, luy metant une couronne d’or sur le chef & parsema le corps
de fleurs qui fit puis remetre en son lieu, de ceste bute voulant retourner au logis du sr consul, me fut montré
le lieu, ou Ptolomé Phyladelfe Roy d’Egypte, fit translater la Bible par les 70 interprete, ou ne se voit que la
place du Palais Royal seullemant, non plus que de celuy de Cleopatra, lequel estoit sur le rivage marin, ou
ne se voit aussy que certins desbris, de vieils fraguemant de muraille fort haute, de pierre de taille, qui
desmontre en cest echantilon, quel devoit estre le meilleur de la pierre, plusieurs chose aurois je a raconter,
de l’ancienne magnificence de ceste opulante cité, dont tant d’Auteurs ont dignemant escrit, qui me fera taire
en ce (fol. 741v) lieu du reste, pour avant que sortir d’Egypte, faire une tres briesve naration des Roys dicelle
province, selon ce que j’en ay peu recueily, tant d’Herodote que d’autres Autheurs, n’ayant seulemant pris
que leurs noms, car pour leurs vie & faicts dicelle, je n’y touche point pour estre de trop longue halaine, &
n’aurois faict a temps pour m’embarquer, sur le vaisseau qui estoit prest a faire voille, pour Marseille comme
se verra cy apres.
…
(fol. 743v) De mon partemant d’Alexandrie & navigation pour le retour de France
Le Jeudy 22 de septembre, apres avoir sejourné 12 jours entiers en Alexandrie, je fis porter mes hardes en
la Poulacre, dudit patron Domergue appellée Ste Anne, & m’acheminay au port, acompagné de cinqc ou 6
honestes hommes du logis, qui me voulurent voir embarquer, sy bien qu’en mesme temps, le capitaine
Riquet, fut prest a faire voille ensemble de conserve, estant a l’encre l’un & l’autre, proche la grosse tour du
Phanal, qui est une bonne & forte place, l’ancinte de laquelle est de forme ronde, de bonne & grosse pierre
de taille, avec la tour du donjon, couverte en terrasse, sur laquelle y a quelque piece de canon pour
defandre le port, nos deux vaisseaux estant prest a faire voille, chascun se retire avec mille caresses, & fault
que je die avec la verité que j’avois le coeur seré, partie de joye de retourner a la patrie, partie de desplesir
de terminer mes voyages & quiter le pays ou Dieu m’avoit sy bien conduit. »
- 383 - 386 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN BOUCHER (1611)
Boucher, J., Le Bouquet sacré composé des plus belles fleurs de la Terre Saincte par le P. Boucher Mineur
observantin reveu, corrigé, augmenté et enrichi par l’Autheur d’un excellent discours de la noblesse sur la
creation des chevaliers du St. Sepulcre, Paris, 1620.
Jean Boucher (1558-1646), curé de Saint-Benoît, est un des plus fougueux ligueurs. Il est successivement
recteur de l’Université de Paris et prieur de Sorbonne.457
p. 61-66 :
« Or la premiere de toutes les villes d’Egypte qui restent encore aujourd’huy du costé de l’Afrique, est la
noble Cité d’Alexandrie maintenant appellee Scandaria par les Turcs : Alexandrie di-je, Ville iadis fameuse &
celebre, tant à cause de la grandeur & puissance de son fondateur qui fut Alexandre le Grand (lequel
ploreroit à chaudes larmes s’il la voyait en l’estat où elles est reduite maintenant) bastie en dix sept-iours
avec ses murailles lesquelles contenoient six mille, qui valent deux lieuës de circuit, au rapport de lustin livre,
tant aussi à cause de la beauté de son port, de la double enceinte de ses murailles enchaperonnees de
belles & fortes tours, larges, longues, & droictes, estenduë de son plan, de l’agreable diversité de ses Palais
anciens, & chasteaux surannez : de l’ingenieuse structure des logis qui estoient bastis moictié au dessous
de la terre ; tant en fin à cause de ses Aiguilles, Obelisques & Colomnes hautement eslevees, dont elle
estoit noblement enrichie.
Elle est donc tres fameuse à raison de son fondateur, qui s’est rendu par l’effort de son courage, & la force
de ses armes, seigneur & maistre de la meilleur partie de ce grand Univers.
Elle est celebre par la beauté de son port composé en forme d’un ieune Croissant, sur les deux pointes
duquel sont assis deux Chasteaux magnifiques, que nous salüasmes à nostre arrivée (selon la coustume
des Naviguants) de deux douzaines de tonnantes Cannonades.
Elle est belle, pour estre environnée d’une double ceinture de murailles encore à present toutes entieres,
ornees de leurs courtines & carneaux, & accompagnees d’un grand nombre de tours belliqueuses.
Elle est magnifique à cause de sa grandeur & situation, car elle a environ deux lieuës Françoises de
longueur, & est assize en une belle & aggreable planeure.
Elle est rare, à cause de ses Temples sacrez & Palais admirables, car là s’y void l’Eglise de Sainct Marc
(auiourd’huy possedée par les Iacobites, autrement appellez Nestoriens) dans laquelle se trouve la mesme
chaire, assez hautement eslevée de terre, où Sainct Marc, Sainct Athanase, & Origene ont presché, & un
peu plus avant est l’Eglise de Saincte Catherine, dans laqelle se voit un pilier de marbre haut d’une coudée
& demie seulement, sur lequel Maximin Empereur fit trancher la teste à ceste Saincte vierge, pour le
soustien & maintien de la foy de son cher espoux Iesu-Christ.
Là se voyent encore auiourd’huy les masures antiques du beau Palais de ceste vierge bienheureuse, les
ruines duquel n’ont encore peu effacer les vestiges de son lustre ancien.
Là se void aussi le Palais somptueux de ceste fameuse Magicienne Armide, les qualitez de laquelle sont
peut estre plus amplement que veritablement descrites par l’Arioste (surnommé le fleau des Princes & des
grands) & depuis par Torquato Tasso, en la mort duquel la Poesie Italienne a receu une playe incurable.
Pres de la ville restent encore les antiques murailles du Palais de la voluptueuse Cleopatre, laquelle pour
avoir trop obstinement suivy la loy de ses passions desreiglées, a mis presque tout l’Orient, & l’Occident en
confusion & desordre, dans lequel finalement elle perdit son Royaume, son honneur & sa vie. D’où nous
apprenons que ce n’est d’auiourd’huy que les fleurs d’un amour desreiglé ne manquent iamais à produire
des fruicts bien amers : c’est pourquoy, Non amor antiquo fuerat, fed amaror ab aevo dicendus, cum fit
semper amarus amor. Il falloit appeller amour amertume, & non pas amour, puisque l’amour est touiours
amer.
Nostre Alexandrie outre plus est fort singuliere, à cause des industrieuses fabriques de ses logis : Car
comme il paroist encore maintenant, elle avoit autant de bastimens dessoubs terre que dessus : les
bastimens de dessus servoient pour heberger les Citoyens de la ville au Prin-temps, à l’Automne, & à
l’Hyver (si d’aventure ie veux que les Egyptiens ayent un Hyver) & en Esté lors que les ardantes chaleurs
estoient en leur force & vigueur, ils demeuroient en ces logis soubterrains, afin d’estre moins travaillez des
cuisantes ardeurs du Soleil.
Elle est finalement recommandable à cause de ses Aiguilles parsemees de mysterieux hieroglyphes, &
Colomnes hautement eslevées : Entre autres i’en vis une pres du Palais d’Armide, nommée l’aiguille de
Ptolomee toute couverte de hieroglyphes, desquels fort laborieusement ie demandé l’intelligence à plusieurs
grands personnages que ie croyois la devoir posseder, & particulierement au Patriarche d’Alexandrie, qui se
nomme dans le pays Kyriou Kyrillou, homme tres docte, & fort versé aux sciences humaines & divines sur
tous les Orientaux : mais il me protesta n’avoir iamais sçeu trouver aucun qui en ait eu parfaicte
cognoissance.
Hors de la ville est erigée la Colomne de Pompée (ainsi appellée à cause que Cesar y fist mettre la teste
enchassée dans une urne precieuse) qui est fort grosse, haute, ronde & droicte, & est assize sur un si foible
fondement qu’elle faict peur à ceux qui s’en approchent, iugeans qu’elle va tomber sur leurs testes : car elle
est plus soustenuë par son poids que par toute autre chose.
Pour conclusion ie diray avec Herodian qu’Alexandrie du temps de son lustre, n’a cedé en orgueil à aucune
ville du monde, qu’à Rome seulement.
Or pour voir & contempler à mon aise les singularitez, & pour donner un peu de repos à mes membres
fatiguez sous le ioug des travaux de la mer, ie seiourné en ceste ville une sepmaine toute entiere, dans le
Dimanche de laquelle ie fus prié par Monsieur le Consul des François, (homme fort courtois, sage & discret)
de donner un sermon à la nation, ce que ie me proposé de faire librement : mais voyant mon audience
my-partie, estant composée d’une cinquantaine de marchands François, & d’autant d’autres qui estoient
Italiens, ie fus contrainct de diviser mon sermon, & dire la premiere partie en François, & la seconde en
langue Italienne, pour satisfaire à la devotion des uns & des autres. »
457 Bouillet, M.-N. et Chassang, A., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, 1878, p. 262.
- 387 - 388 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
WILLIAM LITHGOW (1612)
Sandys, G., et al., Voyages en Égypte des années 1611 et 1612. George Sandys, William Lithgow, par
O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1973.
William Lithgow (1582/1645 ?) naît à Lanark en Écosse où il reçoit une éducation à l’école de grammaire. Il
aurait quitté son pays peu avant ses 21 ans, suite à une aventure amoureuse qui lui vaut d'avoir les oreilles
coupées par les frères de la demoiselle qu’il courtisait. Il écrit toutefois qu’il est poussé à mener une vie de
voyageur car : « le voyage est la science du monde qui est supérieure aux autres disciplines de la
connaissance ».458
p. [329]-[333] :
« Alexandrie est le second port de toute la Turquie. Jadis c’était une ville des plus célèbres, qui fut bâtie par
Alexandre le Grand, mais maintenant elle est considérablement délabrée, comme il apparaît des grandes
ruines qu’y s’y trouvent. Elle a deux ports, dont l’un est puissamment fortifié par deux châteaux, qui
défendent à la fois la ville et le Porto Vecchio. Les champs alentours de la ville sont sablonneux, ce qui
produit un air pestilentiel, surtout au mois d'août, et c'est pourquoi les étrangers deviennent victimes de flux
de sang et d'autres maladies graves.
Pendant mon séjour ici, je reçus le conseil du consul de Raguse de garder mon estomac au chaud, de
m’abstenir de manger des fruits, et de vivre sobrement, d’un régime modéré. Je m’efforçai avec soin
d’observer cette règle de conduite ; de même dans tous mes voyages, je suivis le même système de régime
frugal, et qui était trop frugal à mon goût, mais grâce à quoi (Dieu soit loué) je ne tombai jamais malade
jusqu’à mon retour en France.
Cette ville s’est considérablement appauvrie depuis qu'[a cessé] le commerce des épices apportées en
Égypte par la mer Rouge et de là par [voie de] terre jusqu'à Alexandrie et son port de mer. De là les
Vénitiens les distribuaient dans toute la chrétienté ; maintenant elles sont apportées chez nous par l'arrière
de l'Afrique, par les Portugais, les Anglais et les Flamands, ce qui cause du tort aussi bien à Venise qu'à
Alexandrie, par manque de leur négoce de jadis et le commerce dans ces régions méridionales ; par suite
de quoi Venise devint la mère nourricière de toute l’Europe en ce qui concerne ces produits ; mais
maintenant elle est privée de ceux-ci, et ruinée par nos entreprises en occident, [nécessitant] un plus long
parcourt jusqu’à ces terre indiennes.
Cette ville est un centre de grande [activité] commerciale et fut élevée par le concile de Nicée [au rang] d’un
des quatre sièges patriarcaux. Les trois autres sont Antioche, Jérusalem et Constantinople. Ici à Alexandrie
était cette fameuse bibliothèque que Ptolémée Philadelphe remplit de 700.000 volumes ; c’est aussi lui qui
enjoignit aux 72 traducteurs de traduire la Bible. En face d’Alexandrie est la petite île de Pharos où, pour la
commodité des marins, le roi mentionné ci-dessus bâtit une tour de garde de marbre blanc qui était d’une
hauteur si merveilleuse qu’elle fut considérée comme l’une des sept merveilles du monde, les autres six
étant les Pyramides, le Tombeau de Mausole que la reine de Carie fit bâtir à Halicarnasse en l’honneur de
son époux ; [en outre on compte parmi elles] le temple d’Éphèse, les murs de Babylone, le colosse de
Rhodes et la statue de Jupiter Olympien ayant 60 coudées de haut, à Elis en Grèce, [statue] faite par
Phidias, un excellent artisan, passé maître dans le travail de l’or et de l’ivoire.
Séjour à Alexandrie et départ pour la « Chrétienté ».
Forcés d’attendre pour notre passage quinze jours à Alexandrie, les Français et moi nous dûmes supporter
une grande chaleur, si bien que pendant le jour nous ne faisions rien que nous asperger avec de l’eau dans
une chambre basse, et toute la nuit nous restions couchés sur le toit ou terrasse de la maison pour avoir de
l’air ; ayant enfin souhaité bonne nuit à notre hôte grec, nous nous embarquâmes sur un bateau slave qui
appartenait à Raguse, et nous nous dirigeâmes vers le nord, vers la Chrétienté ; dans ce bateau je fus traité
aimablement et chrétiennement, aussi bien [en ce qui concerne] la nourriture que [les conditions] de
voyage. Les vents nous favorisant un peu au commencement, nous levâmes les ancres et nous nous
dirigeâmes tout droit vers la mer, laissant à l’ouest la côte de Cyrène, située entre l’Égypte et la Numidie ou
royaume de Tunis. »
458 Garrett, M., « Lithgow, William (b. 1582, d. in or after 1645) », Oxford Dictionary of National Biography,
Oxford, 2004 ; [www.oxforddnb.com].
- 389 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVANNI PAOLO PESENTI (de la fin mai au 6 juin 1613)
Pesenti, G. P., Peregrinaggio di Gierusalemme fatto e descritto per Giov. Paolo Pesenti, Cavaliere del
Sss Sepolcro di Nostro Signore, Bergame, 1615.
Giovanni Paolo Pesenti (1572-1651), natif de Bergame, s’adonne aux voyages à travers l’Europe et l’Asie. Il
ne subsiste de ses écrits que son pèlerinage en Palestine.459
p. 154-158.
« Cette grande ville qui fut construite par Alexandre le Grand et appelée par son nom, et où on régné tant de
rois, et dans les ports de laquelle sont venues tant d’armées, est maintenant toute détruite, inhabitée ; les
maisons et les murs sont tombés ; bref, maintenant elle semble une ruine de pierres qui incite à
l’émerveillement et à la compassion.
La ville est réduite à deux bazars où l’on vend des vivres et des marchandises. Mais il y a de beaux et
grands ports au milieu desquels, sur certaines roches, et aidé par l’architecture, se trouve un beau et noble
château fort pour la défense des ports ; dans l’un d’eux, appelé le vieux port, il y a les galères des Turcs,
dans l’autre, qui est plus au levant, se trouve les vaisseaux à voile, soit turc soit chrétien, et ce port est
ouvert à tous les vaisseaux des marchandises des princes qui sont en trêve ou en paix avec le Turc.
Nous étant reposés pendant les heures les plus ennuyeuses de la journée, on alla le soir avec quelques
amis au port pour voir les navires et s’informer s’il y en avait un qui partirait, et on trouva que, des chrétiens,
il n’y avait que deux navires vénitiens qui étaient arrivés dans ce port quelques jours à l’avance, un navire
marseillais arrivé le jour même, et une petite polacre qui était sur le point de partir pour Messine.
Il n’y avait pas d’autre vaisseau chrétien au port car ils étaient tous partis quelques jours auparavant. Nous
nous arrêtâmes pour regarder les autres bateaux qui y étaient, et en particulier ceux d’entre eux les plus
grands et qui portent le grain chaque année à Constantinople et beaucoup d’autres encore qui chargent pour
diverses régions de la Turquie.
Hors de la ville, entre les ports, il y a un bourg de diverses maisons et un bazar où l’on vend toutes sortes de
marchandises ; et parce que l’air y est meilleur qu’en ville, beaucoup y vivent et y travaillent.
Nous retournâmes à la maison et étions pensifs et affligés puisqu’il fallait se résoudre ou à passer sur la
polacre, ou à attendre trois mois pour que les bateaux vénitiens soient chargés, et l’une comme l’autre
solution nous semblait pénible.
Chemin faisant chacun dit son opinion et nous rejoignîmes le logis réfléchissant chacun à ses affaires. Le
matin suivant, on alla tous voir les ruines de la ville et entre autres on nous montra, à côté des murs, près de
la mer, deux obélisques hiéroglyphiques dont un est sur pied et l’autre gît par terre, mais tous les deux sont
beaucoup plus grands et plus beaux que ceux que vantent Rome.
On alla encore hors de la ville, à dos d’ânes, à environ quatre milles, au château que fit anciennement
construire la reine Cléopâtre avec tant de frais et tant d’art. Mais que peut le temps ? Maintenant, il est tout à
fait détruit et on n’en voit plus que quelques parties des murs qui étaient tout autour.
Le porphyre, les statues et tout ce qui y était de valeur a été volé. On rentra en ville par des jardins très
fructifères, le pays étant encore plein de petits bois de câpriers, qui rendent la vue belle et dégagent un bon
parfum.
Lorsque nous arrivâmes près de la ville du côté du couchant, nous vîmes, sur une colline, la colonne qui fut
élevée en mémoire de Pompée le grand ; celle-ci est encore appelée la colonne Pompée. Elle est faite
entièrement de porphyre merveilleux. En hauteur et en grosseur, la colonne dépasse toutes les colonnes
romaines, nulle autre part j’en ai vu de semblable ; elle est toute d’un seul bloc et a vingt bras de hauteur et
huit de circonférence. Elle est vraiment merveilleuse, digne du nom de celui qui l’érigea, et digne de
maintenir sa gloire pour la postérité
De retour en ville, on nous conduisit à l’Eglise de Saint-Marc, où reposa pendant un certain temps le corps
de ce saint, et où des prêtres grecs font l’office.
On vit encore l’endroit où fut décapitée la glorieuse vierge et martyre sainte Catherine, dont le corps fut
admirablement transporté par les anges au saint mont du Sinaï.
De retour chacun à son logis, on se réunit le soir pour discuter et décider si on partait ou si on restait. Le
révérend commissaire dit qu’il ne voulait aucunement risquer sa vie sur une mer si haute et dangereuse, et,
sur un petit vaisseau si mal armé.
Mon compagnon décida qu’il profiterait de l’occasion, et qu’il irait sur les galères turques de la garde de Rodi
à travers l’archipel et de la à Constantinople.
Les trois outremontais qui avaient plus l’expérience des voyages de mer dirent qu’il valait mieux que le
vaisseau soit petit car c’est plus agile. De plus, en été, les petits vaisseaux vont plus vite que les grands à
cause des vents qui sont rares.
Moi, j’étais de cet avis d’autant plus qu’il me paraissait très étrange de rester dans ce pays à cause du
manque de conversation qu’on y observe et des galériens orientaux qui ennuyaient beaucoup les chrétiens.
J’étais également informé qu’au mois d’août, on souffrait d’une fièvre si maligne qui tourmente pendant des
années entières celui qui n’est pas du pays.
Le matin suivant, nous allâmes, bien décidés, tous les quatre chez ce vice-consul de France qui avait le droit
d’expédier le vaisseau, en le priant de nous autoriser à partir sur la polacre qui était prête pour le départ.
Celui-ci, courtois et bienveillant, nous dit qu’il aurait parlé avec le propriétaire et qu’il lui aurait dit de nous
prendre, ce qu’il fit.
Il le convoqua et l’informa de sa volonté et de la nôtre ; celui-ci nous accueillit volontiers à condition qu’on lui
payât douze dople espagnoles tous les quatre ; et il nous avisa qu’on fit faire notre provision de vivres et
qu’on envoya le tout sur le bateau qui partait le plus vite possible.
Le vice-consul remercié, nous allâmes faire les provisions habituelles de biscuits, fromage, poules, oeufs,
langues salées et diverses sortes de fruits, envoyant chose par chose sur le bateau aussi bien que trois
barils de vin de Zante qu’on acheta sur les deux navires vénitiens.
Le lendemain, le 6 juin, qui fut le jour glorieux du corps du Christ, nous partîmes après avoir assisté à la
Sainte messe. Nous quittâmes les amis pour aller au port d’où du bateau nous passâmes sur notre navire.
Je fus accompagné par beaucoup d’amis et en particulier par mon fidèle compagnon que j’aimais tant, avec
qui après les derniers tristes adieux, non sans larmes, restant les coeurs unis, on sépara les corps.
Les marins levèrent l’ancre, firent les voiles du mât de misaine et nous sortîmes peu à peu en pleine
mer. »460
459 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 377.
460 Traduction : F. Ez el-’Arab (archives Sauneron, Ifao).
- 390 - 391 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANS JACOB AMMANN (1613)
Combe, É., « Le Voyage en Orient de Hans Jacob Ammann », BSRGE XIV, 1926, p. 173-189.
Jacob Ammann (1586/1658) exerce la profession de chirurgien dans la petite ville zurichoise de Thallwyl. À
22 ans, il part pour l’Italie, puis pour Vienne d’où débute son voyage pour Constantinople, l’Asie Mineure, la
Syrie, la Palestine et l’Égypte.461
p. 185-188 :
« De la ville d’Alexandrie
Cette ville doit avoir été construite par Alexandre le Grand, dont elle porte le nom Alexandrie. Elle est située
sur les bords de la Méditerranée ; (p. 186) de fortes murailles assez étendues, consolidées par des tours
puissantes, l’entourent ; mais elles sont en partie ruinées et détruites, comme d’ailleurs la plus grande partie
de la ville elle-même, dont à peine le tiers est actuellement habité. Il y a deux beaux « Portus » ou ports
maritimes, bien défendus par de solides forteresses. C’est dans le Grand port ou port antérieur, qu’arrivent
et jettent l’ancre les bateaux des marchands chrétiens ; dans l’autre, qui en est voisin, se tiennent les
bateaux et les galères des Turcs.
Sur le côté de la ville touchant à la mer, on voit aussi des colonnes ou piliers sous les maisons ruinées ;
l’une d’elles est encore debout : quadrangulaire, assez élevée, pointue à son extrémité, couverte
d’inscriptions et de figures d’animaux sculptées. Les autres colonnes sont en partie renversées, et brisées
sur le sol. On montre aussi en cet endroit une grande construction en ruines, qui est, dit-on, le Palais
d’Alexandre. De là nous sommes montés vers une église tenue par des moines grecs ; c’est là que saint Luc
doit avoir prêché. Puis, continuant notre route vers la hauteur, nous sommes sortis de la ville ; à une petite
distance on voit sur un monticule une très grosse et très haute colonne, ronde, en marbre, placée sur un
piédestal carré de pierres assemblées. Je n’ai jamais vu une pareille colonne d’un seul bloc. On l’appelle
"Columne Pompeij". De là nous avons atteint rapidement un large fossé, profond, muré sur les deux côtés :
lorsque le Nil croît, il coule par cette voie vers Alexandrie, y remplit d'eau les citernes ou puits, et on utilise
cette eau jusqu'à la crue suivante : car il n'y pas d'autre eau douce dans la ville, mais il reste encore assez
d'eau dans le dit fossé pour arroser les jardins qui le bordent et les rendent fertiles. Un grand pont de pierre
est jeté sur ce fossé, et aussitôt qu'on l'a traversé, on arrive à un grand lac aux eaux salées, si large qu'on
n'en voit pas l'extrémité. Entre le lac et le fossé, il y a une étroite bande de terre cultivée, avec des jardins,
des arbres, et quelques maisons. Hormis ces quelques cultures, je n'ai vu aucun terrain productif aux
environs de la ville. En remontant le cours du fossé, nous sommes arrivés à un second grand pont de pierre,
d'une seule arche ou voûte, jeté sur le fossé cité, dans un endroit tout à fait sablonneux. De là la vue
s’étendait sur une contrée entièrement couverte de sel ayant l’aspect de la glace, environ d’un pied
d’épaisseur. On le découpe en morceau sur place et on le (p. 187) porte en ville. On nous a raconté que
jadis la mer avait abandonné ces lieux, que l’eau évaporée par la chaleur du soleil avait laissé tout ce sel, ce
qui arrive au reste dans d’autres endroits.
En continuant notre promenade, nous avons atteint non loin de la Méditerranée une ancienne et vieille
construction ruinée, qu’on dit être le palais du roi Ptolémée. Puis nous sommes rentrés dans la ville. Les
Alexandrins ne différent pas des habitants des villes que nous avons citées précédemment ; ils ne
s’adonnent guère au commerce et à l’industrie. Les Juifs ont pris ici aussi à ferme la douane au Grand Turc,
auquel ils paient une certaine somme, et ils molestent les chrétiens.
Ici notre voyage par terre a touché à sa fin ; depuis Gran, en Hongrie, jusqu’en Égypte, nous avons traversé
les terres du Grand Turc. Dans toute l’Égypte, comme en Terre Sainte et en Syrie, jusqu’à la hauteur
d’Antioche, les habitants emploient la langue arabe.
On doit aussi brièvement citer en exemple, qu’en cas d’épidémie de peste les Turcs ne s’abandonnent pas,
n’ont pas peur, ne fuient, ni ne s’éloignent, comme on pouvait le voir lorsque la peste a éclaté peu avant
notre départ pour Constantinople. Un tel amour pour son prochain chez les Turcs incrédules est d’autant
plus à relever que les chrétiens malheureusement ont une conduite tout à fait différente envers leurs
semblables en pareils cas ; ce qui est non seulement peu digne, mais encore absolument contraire aux
enseignements de Notre Sauveur Jésus-Christ (ici sont cités divers passages du Nouveau Testament sur la
charité chrétiennne).
Après avoir passé quelques jours à Alexandrie, les voyageurs cherchent un bateau pour les ramener en
Europe. Ils trouvent un petit bateau sicilien de Messine, chargé de marchandises, qui attendait un bon vent
pour mettre à la voile. « Il y avait aussi dans le port d’autres grands bateaux d’Europe, dont deux de Venise.
Mais comme il n’était pas encore prêt à partir, que peu de temps auparavant nous avions manqué un bateau
d’Ancône, et que de plus l’air de la ville était malsain, nous avons été obligés de nous embarquer sur ce petit
bateau ». Tous leurs arrangements pris et munis de provisions, ils montent à bord le 6 juin. « Aussitôt,
(p. 188) selon leur coutume, les Turcs montent à bord et visitent le bateau, afin de vérifier qu'aucun
prisonnier chrétien n'y soit caché. Ils ne trouvèrent rien et le patron leur donna un pourboire ; ils quittèrent
alors le bateau, et nous sortîmes du port avec un assez bon vent. »
461 Combe, É., « Le Voyage en Orient de Hans Jacob Ammann », BSRGE XIV, 1926, p. 174.
- 392 - 393 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BERNARDO ITALIANO ( ? au 20 décembre 1613)
Italiano, B., Viaje a la Santa Ciudad de Jerusalem, verdadera y nueva descipcion suya de toda la Tierra
Santa y peregrinacion al Santo Monte Sinay, Naples, 1632.
Bernardo Italiano naît à Garrovillas, dans l’Extremadure (ouest de l’Espagne).462
p. 484- 492 :
De la ciudad de Alexandria
« La primera ciudad de Egipto es Alexandria, llamada por los Turcos, Moros, y Alarabes Escarder, la qual
fue antiguamente muy noble, grande y potente, como de sus ruynas se conoce. Esta situada a la parte de
Libia, no muy lexos de la puerta del Nilo (llamada de algunos Heracleoticon, de otros Canopicon, y al
presente dicha Ressit) en el termino de la soledad arenosa ; de suerte, que fuera de las fortalezas de la
ciudad a la parte de Poniente se halla luego el disierto arenoso, donde no se puede sembrar ni cultivar. Es
esta ciudad la Diocesis de todo Egipto ; y segun las antiguas historias, fue edificada de Alexandro
Macedonio hijo de Felipe, a la qual puso su nombre, como dize Julio Solino : y fue fundata en la Olimpiada
centesima duodecima. Esta seis millas de la ribera del rio, y no por esso algunos braços de los que salen
del, quando crece, dexan de redundar dentro de la ciudad, (p. 485) con cuya agua se llenan las cisternas,
que para este efecto estan hechas. Sirve esta agua para todo el ano, y por algunos canales cubiertos riegan
los jardines despues que se llenan las cisternas : de los quales ay muchos en contorno de la ciudad. Es muy
acomodada para mercancias, porque tiene dos puertos, separado uno de otro, por una lengua de tierra muy
estrecha, en cuyo cabo ay una torre muy alta, llamada el Faro, la qual hizo fabricar Julio Cesar, viendo que
era necessaria y despues aca han edificado dos fuertes castillos. Baxan a esta ciudad de la tierra superior
de Egipto las cosas necessarias por el Nilo, y en particular ricas, y gruessas mercancias de especiera ; y
assi mismo piedras preciosas, como diamentes, perlas, esmeraldas, jacintos, y topacios, con todo lo demas
que dessear se puede. Vienen todas las cosas sobredichas de las dos Indias, Oriental, y Occidental, de
Sabba, de Arabia, de las dos Etiopias, de Persia, y de todas las Provincias conuezinas, por el mar Rojo
abaxo, a dar a un lugar llamado (p. 486) Aydebe, que esta situando encima de la ribera del mar, y de alli
baxan por el Nilo a dar a esta ciudad, la qual por ser escala franca, y aver en ella gran concurso de
mercancias, esta siempre llena de Levante y Poniente. Goviernase por quarteles, como el Cayro, y las de
mas ciudades de Turquia. Desta ciudad fue Patriarca S. Juan Limosnero, de quien tan heroycas virtudes se
leen en la vida de los santos Padres, y en ella esta sepultado ; y los Moros, para confusion de los
Christianos, han hecho la Iglesia deste santo fu mezquita mayor. Aqui fueron Obispos S. Atanasio, y
S. Cirilo, y en ella estan sepultados. Veese en medio de la ciudad una piedra de figura espherica a donde el
Evangelista S. Marcos, que fue natural de aqui, fue degollado : y assi mismo el lugar donde el fanto dia de
Pascua celebro una Missa, y los paganos le echaron una soga al cuello, con la qual le sacaron arrestrando
hasta un lugar llamado Buccoli, junto al mar, debaxo de unas peñas, donde fue martirizado, y sepultado.
(p. 487) Huvo aqui en tiempos passados una Iglesia fabricada en hontra deste Santo por los Christianos, en
la qual se vee oydia el pulpito donde predicava. El cuerpo deste Santo està al presente en la ciudad de
Venecia.
De aqui tambien fue natural la inclita Virgen, y Martyr S. Catalina, y en ella martirizada por el Emperador
Maximino. Veese junto a la plaça la carcel donde estuvo y en ellauna piedra con un agujero en medio, a
donde pusieron el palo en que estava la rueda de la navajas. Una milla de aqui ay otra piedra sobre una
colonna derecha, con un letrero, encima de la qual fue la santa degollada, subiendo su alma triunphante al
cielo. En este lugar fueron quemados aquellos cinquenta Filosofos que la Santa convirtio, junto con Porfirio
y sus compañeros, todos los quales murieron (como su historia dize) por le Fe Catolica, comprando con esta
vida corruptible la eterna, y siempre durable. En esta ciudad assi mismo se vee la casa de S. Maria
Egipciata, y otros muchos (p. 488) vestigios de muchos Monasterios, como el de S. Macario, y el de
S. Sabas, donde dizen predicava muchas vezes al pueblo el Evangelista S. Marcos. De esta ciudad fue el
gran cosmografo Tolomeo. Aqui estuvimos treinta y cinco dias con harto disgusto, y trabajo por la poca
comodidad que teniamos, porque no quiso recirbinos el consul de Francia, y assi era forçoso si aviamos de
comer, buscar la comida, y adereçarla : por lo qual saliendo yo a hacer estas diligencias, recebi no pocas
vezes algunos agravios y vexaciones, como palos, y pedradas de algunos santones de los Turcos que
andan en carnes bivas por las calles, y en la cabeça traen rebueltos muchos trapos blancos que dizen son
milagros que han hecho. Viven en el campo en cuevas, a donde les llevan todo lo necessario ; y quando
entran en la ciudad, salen a ellos con abundancia de comida, haziendosela tomar por fuerça porque tienen
por cierto, que Mahoma les acrecienta los bienes, y hazienda con esto ; y juntamente les besan las carnes
por (p. 489) donde pueden, y hazen otras muchas suziedades con ellos, que por serlo tanto las callo. Aqui
nos vimos a pique de perder la vida por cierta ocasion que al P. Godoy mi compañero se le offrecio de
reprehender sus lascivos, y desordenados apetitos en una fiesta que celebravan a su falso Propheta
Mahoma, que llaman Ramatan. Fue cercada esta ciudad de Almerico Rey de Ierusalem en el quarto año de
su reyno, y en el de la Encarnacion del Señor de 1167 y despues de muchos assaltos, y hechos de armas
hizieron pazes entre si. Parece por la antiguedad y ruynas estar este ciudad de baxo de tierra.
La moneda de plata y cobre que corre en la Provincia de Syria, Iudea y Egipto es differente de la de
Contantinopla porque en ella se llama la plata tallaros, medios tallaros, y asperos, para, y otras jaynes, y el
cobre mungurri, y en las sobredichas la plata platas, medias platas, maydines y el cobre solere. El oro todo
es cequies aunque con diferentes nombres, unos llaman sultaninos, otros abrahines y (p. 490) Venecianos,
figurado en estos la limpia Concecion y son de mas valor que los demas. »
(p. 491) Partida de Alexandria
« Aviendo estado en esta ciudad treinta y cinco dias como arriba queda dicho aguardando passage para
Micina al cabo dellos alcançamos licencia del Governador de la ciudad por cuyo orden avian estado
impedidos todos los baxeles que avia en el puerto por temor no diesen lengua y derrota que llevavan quatro
gruessas naves que cargadas de mercancias avian partido tres dias avia para Constantinopla de la Sultana.
Aviendo ajustado el flete y proveydo de matalotage nos embarcamos a 20 de diziembre con el Patron
Bastian Frances de nacion ; y con el desseo que teniamos de salir de Alexandria aunque el tiempo estavan
algo turbado, alçaron ancoras y haziendo salua a la ciudad y castillo con toda la artilleria, salimos del
puerto. »
462 Garcia-Romeral, C., Diccionario de viajeros españoles desde la edad media a 1970, Madrid, 2004,
p. 252.
- 394 - 395 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PIETRO DELLA VALLE (du 25 octobre au 1er novembre 1615)
Della Valle, P., Voyages de Pietro della Valle, dans la Turquie, l'Égypte, la Palestine, la Perse, les Indes
orientales et autres lieux, par E. Carneau et F. Le Comte, Rouen, 1745.
Pietro della Valle naît à Rome en 1586. Il embrasse d’abord la carrière militaire puis devient camérier du
Pape. Il s’embarque à Venise en 1614 pour Constantinople. Lors de ce voyage, il accomplit le pèlerinage en
Terre sainte au cours duquel il visite Alexandrie. Il se rend également en Perse et aux Indes. En 1616, à
Bagdad, il épouse une jeune assyrienne qui meurt en Perse en 1621. Il regagne Rome en 1626 et y meurt
en 1652.463
Son récit est écrit sous forme de lettres.
p. 295-301 (tome I) :
« Le soir du vingt-cinquième, entre les deux & trois heures de nuit, nous donnâmes fonds à l’embouchure du
Port d’Alexandrie, où le Galion pût approcher. Je serois trop long-tems à vous entretenir de ces oiseaux de
passage, & des autres choses que j’ai vûës sur la mer. Je vous dirai seulement, qu’après ce que j’en ai
observé, je suis dans le sentiment de Bélon qui dit que presque tous les oiseaux passent la mer ; excepté
quelque peu d’espèces particulières, lesquelles à cause de leur compléxion délicate, ne peuvent vivre
ailleurs que dans un païs qui leur est convenable, ou chaud, ou froid. Je demeurai cette nuit-là dans le
Vaisseau ; mais dès le matin, après avoir fait une décharge de nôtre artillerie pour saluer le Château qui
reçut nos civilitéz de très bonne grace, j'en sortis avec mes gens ; & sur le bord de la mer je trouvai le
Truchement et les Janissaires du sieur Gabriel Fernosi, consul de France, qui y réside, lequel aïant apris
mon arrivée, avait envoïé au-devant de moi ; de sorte que je fus conduit dans sa maison, où il me reçut avec
tous les honneurs et la civilité possibles.
Je demeurais peu à Aléxandrie, parce que l’air n'y est pas sain, et qu’il y a fort peu de choses à voir : mais
dans le peu de tems que j’y séjournai, j’y vis tout ce qu’il y avait de curieux, sous la conduite de M. le Consul,
qui ne m’abandonna jamais ; lequel comme savant qu’il est, & qui a vieilli dans le païs, depuis 15 ans qu’il
exerce cette charge, m’informa des particularitez qui ne me déplurent pas. La ville en dedans est toute
ruinée ; & ce qui reste de maisons est (p. 296) maintenant au-dehors sur le bord de la mer ; pour la
commodité du Port & de la Doüane. Les murailles sont celles-là mêmes qu’Alexandre fit bâtir autrefois, avec
de grosses tours qui les défendent : mais tout va en décadence, parce que les Turcs ne s’atachent jamais à
réparer de vieux bâtiments ; & quand un des leurs est ruiné, ils en font un autre pour y supléer. Ils aiment
mieux en édifier de nouveaux, quand bien même ce qu’ils font ne les vaudroit pas, & qu’ils pourroient les
rétablir à moins de frais : en sorte qu’aujourd’hui les maisons, les Eglises, & les autres édifices d’Alexandrie,
sont la moitié par terre ; ce qui est certainement une chose digne de compassion. Enfin, on n’y voit que des
murs abattus ; dans les ruës une poussière insupportable, qui n’est blanche que de la chaux & font croire
cependant qu’ils étoient magnifiques, pour la quantité de marbres, de colonnes, & d’autres semblables &
riches ornemens, qui s’y voïent rompus en divers endroits. Néanmoins je m’étonne fort d’Agathis, qui dit que
de son tems les édifices d’Alexandrie n’étoient ni solides ni spacieux, dans la description qu’il fait d’un
tremblement de terre qui y arriva ; vû même que par le débris qui en reste aujourd’hui, on en peut juger tout
le contraire.
Ce qui me plût davantage ce sont les cîternes, qui y sont en très grande quantité, fort amples, & si proches
les unes des autres, que l’on peut dire que la ville est toute en l’air en forme de voûte, soutenuë sur une
infinité de colonnes de marbre, qui est assurément quelque chose de beau à voir. (p. 297) Et parce qu’il ne
se trouve point de source en ce quartier, les cîternes se remplissent en certain tems de l’année, par le moïen
d’un bras du Nil, qui entre dans la ville, par des canaux soûterrains, & par lesquels, aux dépens du Prince,
qui y est obligé une fois l’an, l’eau étant un peu purifiée est portée dans les cîternes par de certaines rouës,
dont je ne parle point, après la description que Belon en a fait : selon moi, ce n’est pas une grande merveille
que ces sortes de machines-là, pour publier qu’Archimède les ait autrefois inventées en Egypte ; afin
d’arroser la terre, comme raporte Diodore Sicilien. Ce qui m’agrée fort encor, ce sont deux Pyramides, ou
deux obélisques en forme d’aiguille, dont l’une est toute entière, & fort enfoncée dans la terre ; mais
peut-être plus haute que celle de S. Pierre de Rome : pour l’autre, elle est entièrement ruinée. On y voit
aussi hors les murailles de la ville sur une petite éminence, la Colonne qu’ils nomment de Pompée, qui est
toute entière, avec son chapiteau, sa base & son piedestal, faite de même marbre que les Pyramides, &
beaucoup plus haute que celles du Portail de la Rotonde de Rome, & plus haute encor que celle que le
Pape Paul a fait élever devant Sainte Marie Majeure, & qu’aucune que nous aïons en nôtre païs.
Assurément c’est un beau morceau : mais pourquoi ils l’appellent de Pompée, je n’en sai rien, si ce n’est à
cause de la victoire que César remporta sur Pompée, & qu’elle y ait été dressée pour en conserver la
mémoire. De plus, j’ai vû la petite Eglise de S. Marc, qui étoit autrefois la Patriarchale, que les Chrétiens
Coftis ; c’est-à-dire, (p. 298) les Egyptiens, ocupent encor aujourd’hui, où vous remarquerez, s’il vous plaît,
que ce terme Egittio, qui signifie Egyptien, signifie aussi Guptios, si on en soustrait l’E, qui est au
commencement, & que l’on prononce le G, comme anciennement, & la lettre I, comme si c’étoit un V ; or au
lieu de Guptios ou Gubti, selon les Arabes ; les nôtres disent plus correctement, Cofto. Je vis aussi dans la
même Eglise le lieu où reposoit anciennement le corps de S. Marc, duquel les Venitiens firent une
translation chez eux, sans toutes les cérémonies que l’Eglise prescrit. Je vis aussi une croix dans une ruë,
où ils disent que ce grand Saint [saint Marc] fut décapité ; et dans l'église de Sainte-Catherine, une petite
colonne de marbre sur laquelle on lui trancha la tête. Vers le milieu de la ville, sur une éminence, on voit les
ruïnes d'un grand bâtiment ancien que quelques-uns attribuent au père de sainte Catherine ; d'autres disent
que c'était une église du tems des Chrétiens : quoi qu'il en soit, il est certain néanmoins qu'elle est
postérieure à cette belle église qui fut dédiée à saint Jean, que les Chrétiens bâtirent avec l'applaudissement
de tout le monde, sur les ruïnes de ce fameux Temple de Sérapis, duquel le cardinal Baronius fait mention
dans ses notes sur le Martyrologe, fondé sur l'autorité des anciens Auteurs.
Sur le bord de la mer, proche les murs de la ville, où sont les deux obélisques, on voit les ruïnes d'un
bâtiment superbe, considérable sur tous les autres, qui avance beaucoup dans la mer, qui a des issuës &
des fausses portes pour entrer et sortir de la ville par les murailles, d’où M. le Consul me (p. 299) dit, que je
pouvois juger & tenir de-là pour certain, qu’il avoit été autrefois le palais de Cléopâtre ; & il y a bien de
l’apparence, parce que cette maison Roïale d’Alexandrie, dont il est fait mention dans les Commentaires de
César, conjointement avec le Théâtre, qui devoit être au lieu où sont les deux Obélisques & avec les issuës
hors de la ville, que Strabon décrit aussi être à main gauche en entrant sur le grand Port, ne pouvoit être
mieux ni plus avantageusement située en quelqu’autre endroit de la ville que celui-là. L’isle de Pharo, dont
parle Strabon, & tous les autres anciens Auteurs, n’est plus reconnuë pour telle, parce qu’elle s’est unie à la
terre ferme, & n’est plus qu’un Continent.
Toute la longueur du tems peut changer toutes choses.
Pour leurs habits, je vous dirai que tant en Aléxandrie qu'au Caire et par toute l'Egypte, l'Arabie, & partout
ailleurs où j'ai voïagé jusqu'à présent, les habitants qui sont Arabes ou Mores, comme ils disent, et non pas
Turcs, vont vétus comme les peintres nous représentent dans les tableaux que les Apôtres l'étoient, mais le
plus souvent fort pauvrement et fort salement. Les femmes aussi sont vétuës comme on a acoûtumé de
nous représenter la Vierge, particulièrement dans les anciens tableaux. Seulement pour se conformer à la loi
de Mahomet, elles se couvrent le visage d'un morceau d'étofe qui a tout à fait du raport, selon Bélon, à un
capuchon de ces Pénitents du Jeudi-Saint. Je vous ferois un trop long discours, si je voulois vous raconter la
misère & la pauvreté de ces bonnes gens, qui vivent (p. 300) comme des bêtes par les campagnes sous les
tentes, & dans des cabanes. Je ne vous parlerai pas non plus de ces arbres qui portent la caffe, des
sicomores, qu’ils appellent figuiers de Pharaon, qui produisent des fruits qui nous sont inconnus, ni d’une
autre sorte de fruits, dont j’ai goûté, qu’ils nomment Mouz, dont la forme a beaucoup de raport à un de nos
petits concombres ; mais du reste fort semblables à nôtre figue : l’écorce en est verte extrêmement &
tendre ; mais sous l’écorce, le fruit est tout blanc ; & ouvert, il est tout rempli de petits grains colorez, il a une
saveur aigre-douce, avec une odeur aromatique, qui ne me plaît nullement, quoiqu’il soit les délices de mes
gens. L’arbre, ou la plante qui le produit, a de grandes feüilles à peu près comme une branche de palmier, si
toutes ses feüilles étoient jointes ensemble les unes aux autres, d’où ceux du païs veulent conclure
mal-à-propos, que ce fut d’un semblable figuier que nôtre premier Pere (après sa désobëissance) détacha
des feüilles dont il se fit un habit pour couvrir sa nudité. Je ne mettrai pas non plus fort en peine d’herboriser
en Aléxandrie, d’y chercher beaucoup d’autres plantes qui y naissent, & que nous estimons pour leur rareté,
parce que Bélon, à qui je me remets de tout cela, en a traité fort éxactement : c’est pourquoi je me
contenterai de vous dire qu’aïant satisfait ma curiosité dans Aléxandrie, je prie congé de M. le Consul, le
premier jour de Novembre après-dîner ; de sorte que sous la conduite d’un des Janissaires qu’il me donna
pour guide, nous partîmes sur nos chevaux, & avec quelques (p. 301) chameaux qui portoient nos hardes,
pour nous rendre à Reschid, ou Rossette, qui est sur une des embouchures du Nil, & à mon avis la
Canopique ancienne, où il faloit nous embarquer pour arriver au Caire ; vû que le bras du Nil qui passe par
Aléxandrie n’est pas navigable aujourd’hui. »
463 Della Valle, P., The travels of Pietro della Valle in India, par E. Grey, New Delhi, 1991, p. i-ix.
- 396 - 397 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SIMÉON DE POLOGNE (1615-1616)
Kapoïan-Kouymjian, A., L’Égypte vue par des Arméniens, Paris, 1988.
Siméon, né en 1584, est Arménien originaire de Zamostya (ancienne Pologne, actuelle Ukraine). Bien que
sa famille soit pauvre, il reçoit une bonne éducation. Il devient diacre et copiste. À la fin de 1607, il accomplit
un voyage en passant par Constantinople (1608) et Rome (1611-1612). En 1615, il s’embarque pour
l’Égypte et, de là, passe en Palestine. Il revient dans son pays natal vers 1618 et occupe le poste
d’instituteur à Lvov tout en continuant à exercer son métier de scribe. Nous ne connaissons pas la date de
sa mort.464
p. 210-214 :
« De Constantinople à Alexandrie :
Le jour de l’Assomption (15 août 1615) les pèlerins louèrent un navire ; moi-même, j’allai y retenir une place ;
je fis mes préparatifs de voyage et m’approvisionnai en vivres car on m’avait dit que le voyage par voie
terrestre comportait de nombreuses taxes de douane et était donc très coûteux.
Tout le monde avait des êtres chers, des parents ou des compatriotes ; moi, j’étais étranger et je n’avais
personne. Mais les gens de ce pays étaient pieux, miséricordieux, obligeants et hospitaliers ; me voyant
mélancolique et triste, ils me consolèrent et me réconfortèrent jusqu’à ce que je fasse leur connaissance et
me familiarise avec eux.
Nous nous embarquâmes ; un vent favorable se leva et nous amena en trois jours à Gallipoli car c’est là que
les bateaux passent le contrôle de la douane. Nous y restâmes trois jours pour nous approvisionner en eau
et biscuits. De là nous allâmes à Rhodes la Grande qui est un port important et une forteresse inexpugnable,
Khalîl Pacha s’y trouvait avec soixante bâtiments de guerre pleins de soldats. Nous y restâmes cinq jours
car nous avions peur des Francs. Cette ville avait un fort à trois étages et des tours compactes, solides et
imprenables. Il y avait des vignobles, des jardins et des vergers ; le raisin ainsi que d’autres fruits y étaient
en abondance. Les habitations étaient de style occidental. Le capitaine nous fit accompagner de trois
navires de guerre.
Ayant invoqué l’aide de Dieu, nous gagnâmes le large qui présente des obstacles. Monts et vallées
disparurent de notre vue et nous ne vîmes plus que la mer et le ciel. Il y avait cinq galions ; chacun d’eux
était semblable à un palais : il y avait trois étages de cales, à l’intérieur et sur le pont, qui contenaient tant de
marchandises qu’il fallait six mois pour les remplir et six autres pour les vider ; au cas où on ne trouvait pas
de marchandises on y mettait une grande quantité de bois de charpente, de pierres, de solives et de poutres
provenant de grandes maisons, sans arriver toutefois à les remplir. Chaque galion avait neuf voiles ainsi que
cent cinquante à deux cents serviteurs, marins, certains étant cuisiniers, d’autres masseurs, tonneliers,
calfats, secrétaires etc… Il y avait des cuisines dans trois endroits différents, trente à quarante cabines,
quinze boeufs, cinquante moutons, des chevaux, et bien d’autres vivres, mille barils d’eau sans compter
ceux contenant du vin et du vinaigre, et plusieurs centaines de passagers. Il y avait un bateau qui s’appelait
Kirk Arçin dont la vergue avait une épaisseur de deux brasses, une longueur de vingt-six brasses et une
extrémité semblable à un plateau où se tenait toujours un homme qui surveillait la surface de la mer pour
signaler les bateaux et avertir de se tenir prêts en cas de danger.
Et un jour le garde cria de toutes ses forces : « Au secours ! Attention ! » et il ajouta : « Voilà l’ennemi ! » il y
eut une grande agitation ; on chargea les canons, les soldats prirent leurs arquebuses, s’armèrent et se
tinrent prêts ; un tumulte s’ensuivit de pleurs et de cris. Mais qui pourrait raconter ou décrire cela. On nous
entassa dans les cales et on ferma les portes ; nous crûmes que nous allions y étouffer ; de nombreuses
personnes s’évanouirent. Les soldats montèrent au-dessus des cales, armés comme s’ils allaient à la
guerre, d’épées, de sabres, de lances, de hallebardes, de javelines, d’arcs et de flèches. Dieu eut finalement
pitié de nous car le vent souffla dans notre direction et à l’encontre de nos ennemis, c’est pourquoi ils ne
purent nous rattraper. Et nous arrivâmes à Alexandrie c’est-à-dire « Iskender » (Iskenderiya). Les trois
navires qui nous accompagnaient s’enfuirent en direction de l’île de Chypre mais l’un d’eux resta en arrière
car il était trop chargé et fut capturé par les Francs. Quel malheur ! Il y avait trois marchands arméniens à
bord. Nous sortîmes des cales ; nous immolâmes des animaux ; il y eut des réjouissances ; on tira des
coups de canon et on rendit grâce à dieu.
Alexandrie
C’est Alexandre de Macédoine qui construisit cette ville et qui lui donna son nom. C’est une grande ville
fortifiée mais la moitié en est déserte ; tout est mer ; seul un côté constitue la terre ferme où passe le Nil. Ici
nous bûmes l’eau du troisième fleuve du Paradis et vîmes au bord de la mer, la demeure des
soixante-douze traducteurs dont on pouvait encore voir les vestiges. Quatre bailes résident à Alexandrie. Il y
avait une église grecque et de vastes khans (caravansérails). On y trouvait des Grecs, des Coptes, des
Européens, mais pas d’Arméniens. Il y avait une église de pierre appelée Sava qui était miraculeuse et avait
un grand pouvoir sur la mer ; c’est pourquoi les marins imploraient son assistance. Nous y entrâmes, la
visitâmes et en sortîmes après avoir prié. Là, chacun de nous paya une taxe d’une pièce d’or, y compris les
prêtres ; mais on n’exigea rien des moines. Il y avait beaucoup de cailles très grasses et tendres ; on en
vendait cinq ou six pour un para. Nous ne pûmes les manger tant elles étaient grosses ; mais nous
préparâmes du pilaf avec leur viande. On trouvait également à Alexandrie du bon vin européen. Nous vîmes
les citernes souterraines qui sont de profondes constructions en pierre et à arcades ; elles sont remplies
d’eau douce car il n’y a ni puits d’eau de pluie, ni eau. Nous vîmes aussi de très hauts et de très beaux
dattiers. Un très petit canal venant du Nil passait par la ville. On dit que c’est le roi Alexandre qui fit venir
cette eau ici en faisant faire de grands travaux.
D’Alexandrie au Caire
De là nous commençâmes à pénétrer en Arabie Mineure. Les Arabes ne sont pas noirs comme les Indiens
mais sont bruns et basanés ; leurs femmes sont corpulentes.
Nous embarquâmes sur des bateaux qu’ils appellent dans leur langue djéra. En longeant la côte nous
arrivâmes en une demie journée à la ville de Réchit (Rosette) qui est un port commercial très agréable. »
464 Kapoïan-Kouymjian, A., L’Égypte vue par des Arméniens, Paris, 1988, p. 24-28.
- 398 - 399 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO CAPELLO (1620-1621)
Capello, A., Relatione d’Allessandria del N H Antonio Capello, Venise, Archive di Stato, coll. Rel. B. 31.
Antonio Capello (1578-1639), originaire de Venise, est consul à Alexandrie de 1620 à 1621.465
c.9 :
« La scala di Allessandria è principalissima di tutto il Levante : segno manifesto è le cose fatte per essa dalla
publica sapienza dentro, e fuori della Città, e tralasciando quelle, che sono notissime, de Magistrati ad essa
particolarmente destinati. Dico ; haver in Egitto importanti speditioni, come comportava la conditione de
tempi, non ad altro fine, che per fermare in quel ricco, et amplissimo Regno la Natione, con un Console, e
Magistrato, acciò quell’importante negotio caminasse con maggior regola, utilità, et reputatione : Per questo
trovo che V. Serenità fece speditione di principalissimi senatori per Ambasciadori. »
c.10 :
« Al soldano, all’hora Re dell’Egitto, et con quelle Ambasciata ottene lo stabilimento della Natione, molti
privileggi per il suo Rappresentante, et ricevè anco in dono fonteghi, fabriche molto honorevoli, et grandi per
habitatione sì del Console, come di tutti li Mercanti : onde hò con qualche ragione considerato, che
V Serenità habbia fatto sempre gran capitale della conservatione di questo traffico, e scala, et che
seguitando io à tutto mio potere di servire alla mente, et intentione publica, hò procurato di conservato non
ostante la mala conditione de tempi, et la revolutione come hò detto dell’Imperio tutte le cose nelle stato suo.
Soleva il Console, con tutta la Natione habitare in Allesandria, dove vi sono le fabriche publiche, mà perche
quell’antica, e nobilissima Città è riddotta dà certo tempo in quà si può dire in solitudine, restando sepolta
nelle proprie grandezze, né godendo manco aere molto salubre, per questo con gran prudenza fù ordinato,
che si trasferisse l’habitatione di Alessandria nel Cairo.
Queste due Città come sono state sempre le più principali di tutto l’Egitto, così per lungo tempo hanno
tenuto diviso il suo Imperio ; dominando li Tolomei in Allessandria, et li Faraoni nel Cairo in un medesimo
tempo : Ma doppo che il Romano Imperio fece l’acquisto dell’Asia et di tutto l’Oriente, riddusse anco l’Egitto
in Provincia, et di quelle fece un sol capo il Cairo, grandissima Città dell’Universo. Per studio di essa
parlarne, mà perche serve al presente [c.11] proposito, et di essa vien scritto cose molto lontane, ò inferiori
al vero, Mi sono risoluto per intelligenza della S. Vostra, et delle S.S.V.V.E.E. (Signorie Vostre
Eccellentissime) dirne alcuna cosa con brevità. »466
465 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 469.
466 Transcription : archives Sauneron, Ifao.
- 400 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PACIFIQUE DE PROVINS (du 18 au 22 juin 1622)
Pacifique de Provins, Le voyage de Perse contenant les remarques particulières de la Terre Sainte, Paris,
1631.
Le Père Pacifique de Provins, supérieur des capucins de Péronne, obtient du Pape Grégoire XV
l’autorisation de partir comme missionnaire à Constantinople. Il séjourne dans cette ville de mars à mai 1622
et revient par l’Égypte. À son retour, il rédige, pour le Pape et la Congrégation de la propagande, une
relation de voyage et en même temps une requête pour l’établissement de missions de Capucins à
Constantinople, Smyrne, Sidon et en Égypte. Mais c’est le Père Joseph, collaborateur de Richelieu, qui,
avec le titre de préfet des missions d’Orient, est chargé de recruter des missionnaires parmi les capucins de
France. Le Père Pacifique doit se contenter de fonder la mission d’Alep. Il meurt à Paris en 1653.467
p. 58-60 :
« La ville d’Alexandrie est une tres-grande ville, autrefois grandement renommée, speciallement par sainct
Hirosme dans la vie des Peres ; pour le présent ie n’ay rien remarqué de plus grand, que des insignes en
ruines, car ce ne sont que des maisons toutes razées, le peuple est si pauvre & ruiné qu’ils ne peuvent
restablir aucune maison, si peu qu’ils en font ils les bastissent au bas de la ville vers le port des gallares, &
du chasteau, auquel endroit la ville se peuple, & est assez belle.
Ce qui est de rare ce sont les Cisternes, & concavitez, toute la ville est creuse, & y a dessoubs terre les plus
belles Cisternes du monde, grandes comme des Eglises, admirableme(n)t voutées, pilliers sur pilliers,
lesquelles Cisternes s’e(n)plisent d’eau par le débordeme(n)t du Nil, & en font ainsi provision pour l’année.
Mais à présent les Canaux de la plupart estans rompus il n’y en a que quelques unes qui se remplissent, &
l’eau se tire par des boeufs, avec des rouës.
Les vestiges de l’antiquité beauté se voyent par la quantité de belles grandes & grosses colomnes de
Porphire qui restent encore debout, parsemée ça & là.
Pour ce qui est de la piété, & antiquité tout ensemble, il y a premierement une belle & grande Mosquée qui
estoit autrefois l’Eglise Cathedrale de sainct Marc qui fut premier Evesque ; il y reste pour memoire de luy la
chaire Episcopale dans laquelle il preschoit, qui est à present dans une petite Eglise de Chretiens Cophites,
nommée sainct Marc, c’est une belle chaire de marbre blanc & rouge de pieces rapportées, i’ay eu le
contentement & l’honneur d’entrer dedans. Dans la mesme Eglise il y a un coing à costé de l’autel où estoit
autrefois le corps de sainct Marc où il fut ensevely, & d’où il a esté transporté par les Vénitiens à Venise : ils
ont encore une autre pierre sur laquelle ils disent que sainct Marc fut décapité, & disent qu’ils la tiennent
cachée de peur que les Venitiens ne l’enlevent encore. Il y a une autre Eglise encore dediée à saincte
Catherine, tenuë par les Grecs, & où les François ont eu une chapelle, dans laquelle Eglise il y a un pillier de
marbre fort large, sur lequel saincte Catherine eut la teste tranchée, à ce qu’ils disent, & où encore on
remarque du sang.
Dans la ville non trop loing de là il y a les ruines du Palais saincte Catherine, i’ay esté dedans c’estoit un
tres-beau chasteau tout basty de brique, mais tout desmoly.
Il y a une autre petite Eglise dediée à sainct George, où il y a une image de l’Archange sainct Michel faict de
la main de sainct Luc, c’est une peice du tout rare, & n’en ay iamais veu de ceste façon.
Hors la ville d’Alexandrie en sortant par la porte qui va à Heracite ou Roussette, qui est une mesme chose ;
un peu esloigné de la ville sur une belle platte forme, il y a encore un vieil chasteau beau & grand comme
une petite ville, & estoit le chasteau de ceste tant belle & renommée Roine Cleopatra favorite de
Marc-Antoine : de ce chasteau le lo(n)g du chemin nous trouvasmes des vestiges com(m)e d’un fondement
de bastiment à fleur de terre, demanda(n)t ce que c’estoit, on nous dit que c’estoit une voute dessoubz
comme un conduit de fontaine, par où Cleopatra envoyoit de l’huile de son chasteau qui est près d’Heracite,
& de la mer iusques dans ce palais. En ce chasteau susdit estoit le miroir de Cleopatra dont ie parleray icy,
& non à celuy qui est pres de Roussette : elle voyoit de là partir les Vaisseaux de l’Isle de Candie.
Nous partismes d’Alexandrie le vingt-deuxieme de juin par terre, où il y a quelque unze lieuës de France, &
trouvasmes un pays si desert qu’il n’y a presque que du sablon, nous arrivasmes ce mesme iour à
Roussette. »
467 Clément, R., Les Français d’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, Ifao, Le Caire, 1960, p. 22-23.
- 401 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HEINRICH RANTZOW (1623)
Rantzow, H., Reisebeschreibung nach Jerusalem, Cairo und Constantinopel, Hambourg, 1704.
Heinrich Rantzow (1599-1674) est petit-fils de gouverneur.468
p. 81-84 :
« Vers cassara, ou l’heure des vêpres (heure ainsi appelée par les Maures lorsqu’ils vont prier), nous
arrivâmes à Alexandrie. Nous vîmes d’abord devant la ville la colonne Pompée en granit oriental, ronde et
très haute ; le pied et le chapiteau étaient faits de morceaux différents, mais de la même sorte de pierre. Elle
se trouve sur une colline.
Nous allâmes loger au fondeco de Gênes. On estime la distance entre Alexandrie et Rosette à trente milles
italiens, c’est-à-dire à une bonne journée de voyage.
Dans le couvent des patriarches appelé Saint-Sabas, nous vîmes la pierre où fut décapitée sainte
Catherine ; cet endroit appartient aux Grecs. À l’église Saint-Marc, qui appartient aux Coptes, nous vîmes
l’emplacement où se trouvait le corps de saint Marc. Il y avait là aussi une chaire où saint Marc aurait
prêché ; elle était en pierre incrustée de marbre blanc et noir dans les angles. Non loin de là se trouve un
vieux bâtiment délabré en briques rouges ; on dit que là fut le palais de sainte Catherine.
Ensuite nous allâmes à l’extrémité du mur de la ville où se trouve une grande colonne entièrement couverte
de caractères égyptiens. Un des côtés mesure neuf empans et demi de large, mais il ne le paraissait pas car
la colonne se trouvait en contrebas et on ne pouvait pas apercevoir le pied. Non loin de là, une autre
colonne était effondrée. Elle est en grande partie recouverte de remblai et elle est également décorée de
caractères égyptiens. Elle était aussi large que l’autre.
À différents endroits, on voit encore beaucoup d’anciennes colonnes toutes en granit oriental. Ceci prouve
que cette ville devait être magnifique ; aujourd’hui, elle tombe complètement en ruines. Dans toute l’Egypte,
on ne trouve pas de pierres semblables à celles avec lesquelles les Anciens firent de si grandes colonnes et
que nous appelons granit oriental. Toutefois, Marfut me dit au Caire, qu’il y en avait dans le sud au bord du
Nil à de nombreuses journées de voyage.
Au fondego de Gênes où nous logions, nous vîmes un ichneumon, animal qui rampe sur le ventre du
crocodile et le tue. Les Italiens l’appellent Sarso di Pharaone. Il ressemble à un rat mais a de longs poils
raides, comme une brosse, de couleur grise.
Dans ce fondego, il y avait aussi un oiseau du Nil, appelé en italien Sacco Marino. Il a un très long bec d’où
pend une membrane et peut avaler un grand poisson ; s’il ne l’avale pas tout de suite, il le garde dans sa
membrane qui sert de sac jusqu’à ce qu’il le mange.
Devant Alexandrie, s’étend un beau port bien abrité divisé en deux parties par une langue de terre sur
laquelle se serait trouvé le Pharus égyptien. Les galères se trouvent dans la partie externe et les bateaux
dans l’autre. Sur cette langue de terre, qui s’avance dans la mer, se dresse un château qui peut commander
les deux ports et, de l’autre côté, là où les bateaux sont ancrés, se trouve en face du château une autre
forteresse un peu plus petite. »469
468 Handelmann, G. H., « Rantzau, Heinrich », NDB 21, Berlin, 2003, p. 147.
469 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 402 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
YVES DE LILLE (du 7 mai au ? 1625)
De Lille, Y., « Itinéraires aux lieux saints du Père Yves de Lille (1624-1626) », Études Franciscaines XLIV,
1932, p. 677-697.
Le frère capucin Yves de Lille est natif de Maubeuge.
p. 677-678 :
« Arrives donc en Alexandrie le 7 de may veille de l'Ascension, le Jour suivant avons visite l'eglise de
Sainte-Catherine et y dit la sainte messe etc. ou se veoit la colonne sur laquelle elle eu (p. 678) la test
tranchee, et le lieu où elle fut emprisonnée par son père. Cette eglise est tenue des Grecs. On veoit aussi
leglise de Saint-Marc et la chaire de pierre bien faite dans laquelle icelui saint Marc a fait la predication, item
le lieu où il fut ensevely. Il se veoit un mil hors la ville la belle colonne de Pompè d'une piece en rondeur,
pollie et grosse et haute admirablement. Le soubassement de laditte colonne a 11 brasses en tour lequel est
quaree. Il y a encore abondance de colonnes en ladite ville restees droites des ruines de la ville et une
pyramide belle avec figures, lettres etc. qui est quaree et a 6 brasse de tour en bas. La ville d'Alexandrie a
este autrefois tres belle, magnifique, bien basty et emmuraillie de doubles murs, avec forces tours
correspondantes les uns aux autres a la portee de l'arc, ville grande avec beau port de mer en forme de
demy lune, elle est maintenant toute ruinee ou plustot boulleverse, les ramparts neantmoins avec ses tours
encore asse entiers. Et ce qui est remarquable dans la structure de ladite ville c'est qu'icelle par dessoubs
est toute basty sur colonnes de tres belle pierre come celle de Pompè, trois colonnes en hauteur les unes
sur les autres avec autant de voûtes qui est une chose belle et admirable a veoir, si bien que le Nil en son
tams venant a desborder par certains conduits souterrains qui se peuvent ouvrir vient à remplir toutes ses
concavités et lieux souterrains pour fournir leau à ladite ville qui n'en peut avoir d'autre parte, car rarement il
pleu en ces cartiers. Il y a deux citadelles aux deux endroits du port. »
- 403 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO DEL CASTILLO (du 2 mars au ? 1627)
Castillo, A. del, El devoto peregrino, viage de Tierra Santa, compuesto por el Padre Fray Antonio del
Castillo, Madrid, 1664.
Missionnaire franciscain né à Malaga à la fin du XVIe siècle, Antonio del Castillo meurt à Madrid en 1669.470
p. 112-113 :
« Le vendredi deux mars nous arrivâmes à Alexandrie, nous y restâmes quatre jours. Nous vîmes les
sanctuaires qui sont les palais de sainte Catherine, vierge et martyre ; l’église et le lieu où saint Marc
l’évangéliste fut enterré, la chaire même du haut de laquelle il prêchait et où je fus ; la citerne où vécut saint
Athanase pendant quatre ans ; la pierre sur laquelle fut décapitée sainte Catherine qui se trouve dans une
église grecque.
Alexandre fonda cette ville et il l’appela de son nom ; elle est de forme carrée et mesure neuf milles de
diamètre ; elle est entourée de puissantes murailles en briques qui sont aujourd’hui entières et belles, sauf
vers la marine où un morceau est à moitié détruit. Il y a deux ports très commodes ; dans l’un se trouvent les
navires qui viennent de la chrétienté et dans l’autre, ceux des Turcs et des Maures.
Dans le port des Chrétiens, se trouve un fameux et beau château. La ville est presque toute en ruines ; le
chiffre des habitants n’atteint pas mille. On voit de très grandes ruines, quelques mosquées des Maures dont
deux ou trois sont belles. Il y a deux Fondagos ou hôtels (comme on les nomme dans ces pays) où vivent
les chrétiens ; un Fondago puissant est pour les Français, l’autre pour les Vénitiens.
Il y a quelques pyramides comme à Rome mais de taille plus grande ; une seule est debout, les autres sont
couchées par terre. Il y a la colonne Pompée qui a cent cinquante paumes de haut, la base ou le piédestal
sur lequel elle est assise est très grand, ainsi elle s’élève beaucoup plus avec le piédestal et la colonne
seule mesure cent cinquante paumes. Pompée érigea cette colonne pour servir de guide aux navigateurs.
L’Égypte est un pays très plat, on ne voit la terre qu’au moment où on est dessus. On aperçoit cette colonne
de vingt milles et plus en mer. En arrivant à Alexandrie, il y a quelques rochers dans l’eau ; beaucoup de
navires seraient en danger s’il n’y avait pas cette colonne, mais en l’apercevant, on reconnaît le pays et on
peut approcher le port en toute sécurité.
Cette ville n’a pas d’autre eau que celle qui est fournie par le Nil venant de dessous terre par l’intermédiaire
de canalisations. Lorsque le Nil est en crue, les canalisations remplissent toutes les citernes qui sont
nombreuses et très grandes.
Dans cette ville, des religieux franciscains administrent les sacrements des chrétiens.
J’avertis le lecteur que tout n’est pas dit à propos de cette ville. Je ne parle que de certaines choses qui sont
les plus remarquables, mais je ne parle pas de celles qui ne le sont pas afin de ne pas trop m’étendre.
Certains auteurs ont déjà écrit longuement sur ce sujet, je renvoie à ces derniers pour les curieux. Je ferai
de même pour le reste de cet ouvrage. »471
470 Garcia-Romeral, C., Diccionario de viajeros españoles desde la edad media a 1970, Madrid, 2004,
p. 123.
471 Traduction : A. Lavaud (archives Sauneron, Ifao).
- 404 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AYMARD GUERIN (1627)
Chapart, I., « Le voyage en Éthiopie entrepris par le Père Aymard Guérin (de Romans) de la Compagnie de
Jésus et par quelques autres Pères de la même Compagnie, 1627 » dans A. Rabbath (éd.), Documents
inédits pour servir à l’histoire du christianisme en Orient, tome 1, Paris, 1907, p. 1-21.
Aymard Guérin naît dans l’une des plus honorables familles de Romans dans le Dauphiné. Il passe sa
jeunesse dans l’étude des Lettres à Tournon. Après avoir été bachelier en philosophie et Maître des arts, il
fréquente l’étude des lois à l’Université de Valence. Il entre par la suite dans la Compagnie de Jésus. En
1627, il est envoyé en Éthiopie, avec deux autres ecclésiastiques, un Sicilien et un Maltais. Cette relation est
rédigée après la mort du Père Aymard Guérin par le Père Ignace Chapart.472
p. 9-10 (tome I) :
« Partis de Candie, ils arrivèrent en peu de temps et sans mauvaise rencontre au port d’Alexandrie en
Egypte. Ils y rencontrèrent Monsieur le Consul de France nommé Mr Tarnoux473, ecclésiastique provençal,
autrefois secrétaire de Monsieur de Brèves lorsqu'il était ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte du Grand
Seigneur. Ses bons services furent récompensés du consulat d'Egypte où il réside, tantôt au Grand Caire,
tantôt à Alexandrie, ayant son palais garni magnifiquement en l'un et l'autre de ces deux villes. Tous les
marchands et autres chrétiens qui abordent de ce côté-là, portant la bannière de France, sont sous sa
protection. Il connaît seul de leurs différends entre eux, les décidant absolument et sans appel ; mais quand
ils plaident contre un sujet du Turc, alors un officier de la Justice turc lui est adjoint. Son grand habit de
pourpre ressemble fort à celui de nos cardinaux. Il a un certain nombre de janissaires à ses gages, partie
pour sa garde, partie pour l'exécution de ses arrêts.
Venice et Raguse (et maintenant les Etats de Hollande) peuvent naviguer sous les étendards de leur
République ; tous les autres chrétiens se devant ranger sous la bannière de France ; à peine de confiscation
de leurs vaisseaux et marchandises. »
472 Chapart, I., « Le voyage en Éthiopie entrepris par le Père Aymard Guérin (de Romans) de la Compagnie
de Jésus et par quelques autres Pères de la même Compagnie, 1627 » dans A. Rabbath (éd.), Documents
inédits pour servir à l’histoire du christianisme en Orient, Paris, Leipzig, Londres, 1907-1911, p. 3.
473 Il faut lire Farnoux.
- 405 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CÉSAR LAMBERT (mai 1632)
Lambert, C., « Relation du sieur Cæsar Lambert de Marseille, de ce qu’il a veu de plus remarquable au
Caire, Alexandrie & autres Villes d’Ægypte és années 1627. 1628. 1629. & 1632 » dans Relations veritables
et curieuses de l'isle de Madagascar et du Brésil avec l'Histoire de la dernière Guerre faite au Bresil entre les
Portugais & les Hollandais. Trois relations d'Egypte, k une du Royaume de Perse, présenté par C.-B.
Morisot, Paris, 1651.
César Lambert (1616- ?) est un négociant marseillais.
p. 44-51 :
« La ville d’Alexandrie, bastie selon divers autheurs, par Alexandre le Grand, est le port de mer de l’Ægypte
le plus commode, le plus facile & frequenté : y ayant deux ports, le vieil et le neuf. Le premier nommé, de
difficile entrée pour les navires & propre pour les galeres. L’autre, où les navires de quelque nation que ce
soit, sont les biens venus, moyennant qu’ils apportent des marchandises & de l’argent, autrement ils
accusent tous les vaisseaux des Francs d’estre corsaires, & par ce moyen les veulent perdre sans la
diligence que les Consuls y apportent. Je le sçait à mes despens à cause d’un navire de sainct Gilles en
Poictou qui me fut adressé, qui outre la despens me causa bien de la peine, ce neanmoins ie le chargeay, &
comme il fut sur son depart ils le vouloient confisquer : dont le capitaine adverty qu’ils menaçoient de le
vouloir faire brusler, & mettre ses gens à la chaisne, prepara secretement son navire, & la nuict il partit sans
estre apperceu ; & lors qu’il fut hors du port, il tira forces cannonades contre les forteresses, dont les
gouverneurs furent en peine pour avoir manqué à leur devoir. Nostre Consul accomoda tout, & n’en fut autre
chose que de l’argent qu’il fallut (p. 45) donner. Ce navire rencontra quatre ou cinq iours apres quatre
navires corsaires, qu’il ruina & mit en tel estat, qu’ils furent contraints de la quitter, & arriva puis apres à bon
port au Haure de grace.
Pour aller du Caire en Alexandrie on s’embarque sur des Germes à Boulac pour faire quarante lieuës de
chemin sur le Nil iusques à Rosette belle & riche ville. Delà on prend des mules pour faire douze lieuës par
terre. A la moitié du chemin on se repose au lieu dit la Madie, Okelle, propre pour la retraite des passans. On
porte avec soy les necessitez du manger, boire & coucher. L’on passe là un petit bras de mer, qui fait un
grand golphe, & l’on suit le chemin pour aller en Alexandrie, sur lequel on trouve quelques petits villages, &
hameaux de maisons. I’y ay fait divers voyages pour l’expedition des navires qui m’estoient addressez, &
quoy que mes occupations fussent grandes, ie pris le loisir, le vendredy matin vingt-& uniefme May mil six
cent trente-deux, accompagné de quelques amis, du Chancellier Laugeyret, & du sieur de la Garde pour
aller voir la colomne de Pompée, & ce qui sera marqué cy-apres.
Ladite colomne est à l’opposite de la porte dite du Poricre, & à deux mille pas environ (p. 46) en un lieu
quelque peu relevé, posée sur une grande platte forme de pierre de taille relevée de terre de trois ou quatre
pans, sur laquelle l’on monte par degrez, un du costé de ladite porte, & l’autre de la riviere dite le Cally. Son
pied d’estal d’une piece d’environ nonnante pans de circonference, sur lequel est une autre piece, qui faict
un second pied d’estal, & la base de la colomne. Cette piece est peu moindre en circonference que la
premiere, mais aussi haute.
Laquelle colomne posée sur ces deux pieces, qui en representent trois, paroist comme elle droite, entiere &
tres-belle, ayant de grosseur sur la base trente-six pans, c’est à dire en sa rondeur avec son chapiteau au
dessus enrichi de corniches & feuillages, ayant depuis le bas du premier pied d’estal iusques au dessus de
son chapiteau, environ cent trente pans de hauteur, ledit chapiteau entier & bien fait, comme est ladite
colomne, n’ayant l’antiquité rien amoindry de sa perfection, qu’en un endroit proche de la base, d’où s’est
levée une piece de la colomne d’environ un pan en biaisant de peu despoisseur, & qui ne paroist gueres.
Ces quatres pieces sont d’une mesme matiere comme d’un marbre meslé, de canelé verd & rougeatre par
petites marques, ainsi (p. 47) que les colomnes de pierre qui se dit fonduë : neantmoins, c’est une pierre
venuë du Sait, où l’on voit semblables colomnes commencées à tailler dans le roc. Il s’en voit aussi au mont
de Sinaï, mais differentes de couleur. Cette colomne-là a esté portée du Sait en Ægypte, par le Nil à
Rosette, & delà par mer en Alexandrie. Chose facile hors de la pesanteur, & grandeur ; car il a fallu
conserver à force de bois, rare de ce costé-là, car l’on le porte en Ægypte de Scio, de l’Arcipelago &
d’Afrique.
De-là nous passasmes le Cally, qui vient du Nil & porte l’eau en son temps de Septembre & Octobre dans la
ville d'Alexandrie par les deux conduits de pierre de taille, proche de deux ponts aussi de pierre sur ledit
Cally, l'un à l'opposite de la dite colomne, & l'autre qui commence de ce costé-là le chemin pour aller à la
porte de Rosette, par laquelle nous retournasmes en Alexandrie pour voir les vestiges du palais de
Cleopatre, qui estoit basti dans les murailles doubles de ladite ville sur le bord de la mer, duquel l’on ne voit
que des ruynes & vestiges. Le plus entier est une tour ronde, dont la voute d’en bas est soutenuë d’un rond
de pierres enrichies de corniches, & soustenu par le passé de quatre colomnes en quarré peu esloignées
(p. 48) l’une de l’autre. A present il n’en reste que trois. La voute prend la naissance sur ce rond, d’où
l’oracle faisoit ses responses suivant le dire des anciens & modernes.
Ce palais avoit une porte du costé de la mer pour sa commodité, elle se voit inutile à present, & toute ruynée
comme le reste du bastiment, devant lequel il se voit une forme de place, occupée à present de ruines, entre
lesquelles & proche du palais, on voit une éguille droite & quarrée de neuf pans par le bas d’un angle à
l’autre, en tout de trente six pans de circonference, & denviron cent vingt pans de hauteur, sans comprendre
ce qui est en terre. Car il n’y parest aucun pied destal ny platte forme sur quoy elle doit estre posée, à cause
des ruynes, qui l’environnent, & le sable ; le sommet d’icelle en forme de pointe & quarrée bien entiere, &
enrichie à plain de toutes parts de lettres hieroglyphiques, qu’on diroit particulierement du costé de la mer,
estre faites à present, ayant esté cette rare piece si bien conservée par l’antiquité. Aussi est elle d’une pierre
fort dure, diaprée de rouge, blanc & tanné, obscur par petites pieces comme quarrées, qu’on diroit jointes
ensemble.
A vingt pas de ladite éguille s’en voit un autre de mesme estoffe, enrichissement & grosseur, pour la
longueur, elle ne se peut iuger, pour estre couchée & ensevelie dans des ruynes, ne se voyant que le pied,
qui faict comprendre ce que c’est, & qu’elle doit estre conforme à la susdite, ie l’ay fait mesurer en sa
grossuer, elle est semblable à ce qui est marqué de l’autre cy-dessus.
Les trois colomnes de la tour sont de mesme matiere que la colomne de Pompée, & mesme nombre
d’autres colomnes qui se voyent dans les ruines de cette ville.
On voit encores les vestiges du palais de saincte Catherine Reyne d’Egypte, qui eut la teste trenchée sur un
petit pilier de marbre qui se voit dans l’Eglise sainct Marc, où nostre nation a une chapelle, & les Venitiens
une autre.
L’on voit aussi le lieu au milieu de la ville où sainct Marc l’Evangeliste fust decapité, cela est comme une
petite chapelle avec quelques colomnes.
Hors la ville se voit le lieu où demeuroit sainct Athanase pendant les persecutions des Arriens.
Les murailles doubles de cette ville tant renommée sont encores entieres & enrichies de diverses tours
quarrées & rondes assez spacieuses, embellies, comme toutes ses murailles de merlets (crenaux,) en
quelques (p. 50) endroits ses tours sont ruinées, celles des portes sont les plus entieres.
Il reste peu de maisons dans cet enclos, quelques Mosquées, Bazars, & Eglises de Cophtes et Nazeranis.
Proche le grand Bazar encores entier se voient les fondiques de France, Venise, Genes, & des Catalans. Le
nostre, le plus entier & mieux entretenu, avec son Eglise dedans assez spacieuse. Monsieur le Consul
Fernoux à present de par delà pour la nation Françoise, comme des Flamens, & Anglois qui vont sous la
banniere de France, a enrichi ce fondique d'un beau bastiment à la Françoise capable de loger un Prince. Il
y fait sa demeure quand il est en Alexandrie, ce qui arrive peu souvent, car l'air du Caire est plus doux, et la
demeure plus agreable pour diverses considérations.
Outre ce bastiment, il y a nombre de chambres pour les marchands avec des magazins capables de
contenter chacun pour ce qui leur en faict besoing, et un grand iardin pour la promenade, avec force eaux et
toutes commodités.
Outre l’Eglise sainct Marc, il y a encore saincte Catherine, c’est là où nous avons nostre chapelle, puis sainct
Michel, & quelques autres petits lieux de devotion.
Cette ville est toute pleine de cisternes, (p 51) dans lesquelles l’on va par sous terre par de grandes ruës
voutées, & soutenuës de plusieurs pilliers de marbres.
Le sable a tellement ruiné cette ville, que les habitans en ont fait bastir une autre à l'opposite du port et de la
doüane.
Des eaux superfluës du Cally se forme tous les ans un lac tellement remply de poissons que c'est chose
incroyable. Il est au dessous de la colonne de Pompée.
Aux environs l’on voit nombre de capriers sans espines en forme d'arbres petits, qui portent nombre de
capres grandement estimez en France.
Le sel croist au tour d'Alexandrie blanc comme neige et à bon marché. Cette ville est gardée de deux
chasteaux dits Phanaiglons grand & petit, qui sont sur l’embouchure du port neuf, bastis sur deux pointes qui
enferment ce port en forme de croissant.
Il y doit avoir deux cent Genitzaires à la garde ; par fois il n’y a que de pauvres Maures pour allumer le feu
des Phanaiglons, & demander le Qui va là ? Cette garde est negligée, quoy que de grande importance,
comme sont toutes les affaires du grand Seigneur en ce pays-là. »
- 406 - 407 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACQUES ALBERT (1634)
Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974.
Les données biographiques sur Jacques Albert sont pratiquement inexistantes. Jean Coppin (voyageur de
ce corpus) mentionne que le sieur Albert vécut 35 ans au Caire.474
p. [94]-[95] :
« Il y a quatre chasteaux à Alexandrie. Le premier est le Faraillon presque-isle, & qui s'isole en couppant le
pont. De ce chasteau en depend un autre petit dans lequel le gouverneur du Faraillon, qui se fait appeller
Aga et un Soubassy avec trente hommes pour y commander. Dans ce Faraillon il y a trois cens mortes
payes.
Au delà du port vieil, il y a deux chasteaux opposez l'un à l'autre, le plus grand qui est spatieux, & bien muny
d'hommes, s'appelle Rouch, l'autre qui est moindre dépend du plus grand ; la garde est de soixante & quinze
hommes.
(…)
La despense des Chasteaux d’Alexandrie, Rosette, & Bokier est de douze mil six cens piastres.
(…)
Les arsenaux sont celuy du Caire, d’Alexandrie, & de Suhez. »
p. [96] :
« L'on envoye des Genitzaires du Caire soixante en Alexandrie, & autant en chacune des villes de Rossette,
Damiette & Suhez. »
p. [110] :
« La seconde doüane est celle d'Alexandrie qui comprent Rossette & Bikier. Le doüanier donne de present
au Bassa trente bourses, & dix aux Agas du Bassa. Il paye au Roy cent vingt bourses tous les ans, &
environ douze mille piastres pour l'entretien de la garde des forteresses d'Alexandrie, Bekir, & Rossette. Il
doit aussi trois cent vingt-huict quintaux d’huile d’olive pour la Mecke, & douze à quinze mille piastres en
draps de soye, & de laine pour vestement une fois l’année au Bassa, & à ses gens à leurs Pasques de
Ramadzan. Les six vingt se payent au Roy de quatre mois en quatre mois. Ce doüanier prend de toutes les
marchandises qui viennent de Chrestienté vingt-&-un pour cent ; de celles des terres du Grand Seigneur dix
pour cent. Du bois qui vient de la mer noire, il prend vingt pour cent. Ce doüanier est encore maistre de la
police touchant les poids, & mesures dont il tire douze à quinze bourses tous les ans. »
474 Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974, p. [81].
- 408 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HENRY BLUNT (1634)
Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974.
Né en 1602 dans le comté de Hertford, Henry Blunt fréquente l’Université d’Oxford, puis occupe des postes
importants dans l'administration. Dans son récit, il expose les raisons qui le poussent à entreprendre un
voyage dans l’empire ottoman. La visite des pays européens ne lui montre que ce qu’il sait déjà. Or, il
s’intéresse spécialement aux Turcs : « le seul peuple moderne, grand par ses actions et dont l’empire a si
soudainement envahi le monde ».475
p. [19]-[26] :
« Le lendemain matin nous partîmes pour Alexandrie d’Égypte, accompagnés de dix galères ordinaires de
Rhodes, et de trois vieilles galères qui devaient être vendues comme bois de chauffage. Le vent, quoique
bien en poupe, devint si fort, que les trois vieilles galères périrent, deux pendant la nuit, avec tous leurs
gens, la troisième pendant le jour, sous nos yeux ; mais [quoique dans une situation] desespérée par
moments, elle s’approcha [néanmoins] d’un galion [qui était] près du nôtre, et l’on put sauver ceux de ses
hommes qui n’étaient ni enchaînes, ni autrement empêchés [de se mouvoir]. Après trois jours de [navigation
à] pleines voiles, nous arrivâmes au port. Alexandrie, d’abord construite par Alexandre le Grand fut ensuite
embellie par plusieurs [souverains], mais surtout par Pompée ; elle garde encore les monuments de son
ancienne gloire : des piliers en grand nombre et de grandes dimensions aussi bien sur le sol que dessous, la
plupart de porphyre, et d’un autre marbre aussi compact. Les anciens Égyptiens avaient la coutume,
maintenant tombée en désuétude, de faire la partie de la maison sous terre aussi grande que celle du
dessus. Celle du dessous était la plus luxueuse avec des piliers, et de riches dallages pour conserver la
fraîcheur, car c’était leur habitation d’été ; la partie supérieure avait des piliers plus grands, pour la montre,
mais pas les mieux taillés ; par-dessus tout, il y en a trois [de ces piliers], très au-dessus de tout ce que j’aie
jamais vu ailleurs : celui de Pompée où furent déposés ses cendres, sur le rivage rocheux tout près [de
l’endroit] où il fut tué dans un bateau en mer ; il est rond, tout d’une seule pièce, une sorte de marbre
gris-rougeâtre, si admirablement grand, que [je me suis senti obligé] de saluer sa mémoire avec le salut
prophétique du poète : Templis auroque sepultus vilior umbra fores476. Il est placé sur un fondement rocheux
carré, sur le côté de la ville, à l’extérieur des murailles. À l’intérieur [de la ville] au nord, en direction de la
mer, il y a deux obélisques carrés, chacun d’une seule pierre, recouverts de hiéroglyphes égyptiens, l’un
debout, l’autre tombé, chacun d’eux, je pense, trois fois aussi grand que celui de Constantinople ou [comme]
l’autre de Rome, et à cause de cela laissés [ici] comme trop lourds pour être transportés. Près de ces
obélisques sont les ruines du palais de Cléopâtre placé haut sur le rivage, avec la porte privée où elle reçut
son Marc-Antoine après leur défaite à Actium. À deux jetées de pierre plus loin, seul un autre rocher sur le
rivage, il y a encore une tour ronde, partie du palais d'Alexandre, où subsiste encore dans les murs une
cavité en tuyaux de briques, partie d'un tuyau d'aération.
La ville n’est maintenant presque rien qu’un amas blanc de ruines, surtout les parties Est et Sud. Les murs
sont hauts et souvent munis de petites tourelles, mais pas très fortes, à l’exception du côté de la mer, où
elles sont placées sur de grands rochers abruptes. Le Nord et l’Ouest sont lavés par la mer, qui forme deux
ports, chacun de la forme d’une demi-lune : entre eux court une longue et étroite langue de terre réunie jadis
par un pont [à la terre ferme], mais transformée maintenant [elle-même] en terre ferme, avec ce qui était
alors une île appelée Pharos, un endroit qui selon l’opinion de César, commandait aussi bien le port que la
ville ; les Turcs partagent maintenant ce point de vue, et c’est pourquoi, contrairement à leur pratique
habituelle, ils ont bâti là un beau château qui fait pendant à un autre petit château sur un autre point du port ;
ils commandent l’entrée, large d’au moins un mille et demi ; mais je me demande comment on pouvait le
faire, comme l’affirme César, avant que n’apparût l’artillerie. Les rivages ne sont pas devenus plus larges
avec le temps, comme il ressort des murs et du vieil ensemble des bâtiments debout sur le bord. Sur le côté
ouest du Pharos, et par là même sous sa protection, est l’autre port réservé aux galères, étant trop plein
d’écueils et de récifs pour des [bateaux] à grand tirant d’eau. L’eau fraîche est amenée à Alexandrie par un
canal grand et profond, creusé à main d’homme sur presque quatre-vingts milles, à travers le désert
jusqu’au Nil ; ce canal est sec jusqu’à ce que le fleuve déborde, puis [l’eau] court dans la ville, mais si bas
qu’on est forcé de l’élever avec des seaux sur des chaînes, et des roues actionnées par des boeufs ; [Elle]
est ainsi amenée et gardée dans des citernes dont il n'en reste maintenant que six cents, des deux mille au
début. Avec la terre extraite de ces citernes, on a fait deux belles collines sur l’une desquelles est une tour
de guet, pour avertir [lors de l’arrivée] des navires. Au sud de la ville s’étend cette vaste plaine sablonneuse
dont une grande partie est occupée par le lac salé de Maréotis. »
p. [61]-[62] :
« Un jour j'allai voir ici le port des galères, mais cela était sévèrement défendu ; ceci [me] semblant contraire
à l'habituelle liberté [régnant] en Turquie, me fit soupçonner que le port avait quelque grave défaut, dont [un
ennemi] pourrait profiter plus tard. Sur quoi j'y allai le jour suivant, secrètement, jusqu'aux restes d'une haute
tour en ruines ; [je franchis] le mur et [j'allai], vers ce port, pour l'examiner à loisir ; mon arrivée avait été
suivie par un Egyptien, je pense l'un de la garnison toute proche ; sa violence causa un accident qui me fit
oublier tous mes autres projets, et je m'enfuis, pour sauver ma vie, dans un petit navire français qui, je le
savais, devait partir ce jour-là pour la Sicile. »
475 Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974, p. [3]-[4].
476 « Même enseveli dans les temples et dans l’or, tu aurais moins de valeur qu’une ombre. » Note de
O. V. Volkoff.
- 409 - 410 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVAN BATTISTA BONAGENTE (1634)
Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 429-615.
Giovan Battista Bonagente, originaire de Vicence, est médecin de la nation de Venise au Caire de 1634 à
1641. La lettre qui suit est adressée à son oncle Giovan Battista Benassuti. Il meurt à Jérusalem.477
p. 474-475 :
Alexandrie le 28 septembre 1634,
« Quanto alla città d’Alessandria, io havrei che scivere molte cose se sapessi come esprimerle, e come darle
ad intendere ; basterà sol questo, che le vestiggie, diro cosi, di quelle, si come hora la rendono degna di
compassione, cosi la dimostrano già degna d’admiratione ; le belle colonne, gl’artificiosi volti, le vestiggie de
gran’palaggi, il bel cinto di mura, benchè in gran parte dirupato testificano la sua magnificenza, del che tutto
piacendo a Dio gli discorrero una volta a bocca : dell’abundanza del vivere non si puo dir tanto che basti, che
altro non vi manca che il vino vicentino ; perchè s’hanno le quaglie a un soldo l’una ; (p. 475) le pernici
cinque, sei soldi l’una ; gl’altri ucceleti pelati come devono stare, quindeci o venti soldi il cento ; tralascio il
polame, et altre ottime carni in abbundanza : di pesce, è meglio che tacia, che scriverme poco ».
477 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 474.
- 411 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ROBERT FAUVEL (du 25 au 27 octobre 1635)
Stochove, V., Voyage en Égypte. Vincent Stochove, Gilles Fermanel, R. Fauvel, par B. van de Walle, Ifao,
Le Caire, 1975.
Robert Fauvel, désigné plus tard comme seigneur d’Oudeauville (ou Doudeauville, au sud de Calais),
appartient à une famille de robe dont plusieurs membres se sont illustrés comme conseillers au Parlement
de Normandie. Après avoir rempli les fonctions de Maître de la Chambre des Comptes de Normandie, il
meurt à Rouen en 1661.478
p. [138]-[139] :
« Nous partismes du Cayre le 21e d’octobre pour aller à Alexandrie avec une germe que nous prismes
environ a 16 mille du Cayre, nous laissasmes le bras du Nil qui va a Damiette, et prismes celuy qui va
s’emboucher à Rosette ou nous arrivasmes avec le courant que nous avions favorable en 3 journées, qui
sont 250 mille ; la ville de Rosette est presque de même façon que celle de Damiette, mais une fois plus
grande, et extremement peuplée à cause du grand trafic qui s’y fait, nous ne tardasmes point dans la ditte
ville a cause qu’il n’y a rien de remarquable, nous prismes des montures pour aller à Alexandrie éloignée
d’une journée de Damiette ; nous y arrivasmes le 25 d’octobre.
La ville d’Alexandrie a esté de tout temps fort renommée tant à cause de son antiquité que pour avoir
toûjours esté le principal port de toute l’Egypte, elle n’a pas laissé de perdre avec le temps aussi bien que
les autres villes beaucoup de sa splendeur, les Romains lors qu’ils en estoient maistres y firent bastir
quantité (p. [139] de superbes edifices, et entr’autres une tour qui y seroit le phare de laquelle on ne void
plus que les ruines, et de toutes les antiquitez, on n’y void plus en son entier que la colonne de Pompée que
nous fusmes voir a un quard de lieue de la ville du costé de Barbarie ; nous vismes encore quantité de
voûtes soûterraines qui servoient autrefois de cisternes.
Le port de cette ville est un des plus faciles et assurez de tout le Levant. La ville comme elle est a present
peut avoir quelque trois mille de circuit, et les maisons sont basties comme celle de Boulacq, enfin n’estoit la
grande quantité de vaisseaux qui y abordent, je croy que cette ville seroit entierement abandonnée, mais le
grand commerce qu’il y a la fait subsister. Les consuls de France et Venise y ont leurs maisons ou
demeurent les viconsuls, car d’ordinaire ils font leur résidence au Grand Cayre.
Nous esperions trouver en Alexandrie un embarquement pour retourner en Chrestienté, mais voyant qu’il n’y
avoit que de petits vaisseaux de nulle défense contre les Corsaires qui sont en grand nombre dans la Mer
méditerranée, nous prismes résolution de retourner a St. Jean d’Acre, qui en est esloignée de 500 mille ou
nous estions assurez de trouver deux grands vaisseaux du Grand Duc. Après que nous eusmes resté deux
jours en Alexandrie pour ne perdre l’occasion des dits vaisseaux qui estoient a St. Jean d’Acre, nous
loüasmes une fregate qui nous y porta en cinq jours pendant lesquels nous fusmes presque toûjours terre a
terre a cause du vent de septentrion que nous eusmes toûjours qui nous fit aller a la Boline. »
478 Stochove, V., Voyage en Égypte. Vincent Stochove, Gilles Fermanel, R. Fauvel, par B. van de Walle,
Ifao, Le Caire, 1975, p. [XVII].
- 412 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GEORGE CHRISTOFF VON NEITZSCHITZ (du 1er au 2 juin 1636)
Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974.
Nous savons seulement que notre voyageur remplit la charge de marguillier et d’aumônier à la cour de
Glücksbourg.479
p. [195]-[204] :
« Exactement le 1er juin st.n., qui était un dimanche, nous sommes arrivés à Alexandrie, autour de laquelle la
contrée est, pour la plus grande partie, une belle plaine, quoique sablonneuse, si bien que nous ne pûmes
pas voir la terre avant d’avoir vu la ville elle-même. Et lorsque nous arrivâmes au port, nous fûmes accueillis
par deux coups de canon tirés par deux polacres ou navires, coups de canon auxquels nous répondîmes par
trois coups, dont l’un fut tiré, selon la coutume, dehors près du château.
Alexandrie est une ville très ancienne en Égypte, bâtie encore par Alexandre M., duquel elle a reçu le nom,
et dont encore maintenant la forteresse royale et le château sont visibles là même, pas loin de l’enceinte de
la ville, mais à tel point ruinés qu’il n’en reste plus rien qu’une vieille bâtisse délabrée s’étendant très loin.
Après la mort d’Alexandre M., un autre roi, Ptolémée Philadelphe, a régné là ; c’était un souverain très
instruit qui a créé une magnifique université et, à son usage, une bibliothèque publique de sept fois 100.000
livres ; notamment il a fait aussi traduire dans la langue grecque, par 72 traducteurs, l’Ancien Testament.
Comme alors tout devait être encore écrit à la main, il faut souligner combien de peine et de dépenses a
coûté ce travail, et combien ce roi, digne de louanges, a servi les études. Voudrait-on trouver aujourd’hui un
tel souverain, cela exigerait beaucoup d’efforts. Maintenant on ne voit rien de tout cela, si ce n’est l’endroit
où s’élevait la maison. Tout est détruit.
La ville elle-même est déserte et en grande partie détruite, et pleine de tas de débris et de tas de pierres,
que les Turcs déterrent et emploient pour d’autres constructions. La ville est double, il y a une vieille ville et
une nouvelle ville très grande, et elles sont situées toutes les deux tout près de la Méditerranée et sont
disposés presque en forme de croissant. La vieille ville a des murailles doubles, qui sont encore entière et
en bon état, si bien que la ville est très forte, particulièrement du côté de la mer, où l’on peut se promener
agréablement sous les arcs boutants ; et de plus elle est ornée de beaucoup de tours élevées, comme il n’y
en a pas dans la nouvelle ville. Toutefois, celle-ci est plus agréable que l’ancienne.
Dans la vieille ville il y a quelques églises qui sont une curiosité parce qu’elles sont construites en terre, et du
côté de l’église de Saint-Athanase il y a une montagne de terre sur laquelle il y a une haute tour de guet,
toujours occupée par un guetteur, pour que celui-ci puisse surveiller, et le fasse effectivement, la terre et la
mer. Dans cette vieille ville, il y a aussi à voir quelques pyramides, ou colonnes pointues en haut,
entièrement en marbre, d’une hauteur et d’une épaisseur extraordinaires, faites entièrement d’un seul bloc ;
là se trouvent gravées toutes sortes d’images de cigognes, de chats de chiens, et d’autres images du même
genre, car les anciens Égyptiens avaient jadis l’habitude d’écrire et d’exprimer ainsi leur opinion, de même
que l’on fait aujourd’hui avec des lettres. Et comme elles [les colonnes] existent sans aucun doute depuis
plus de 2000 ans, une partie s’en est effondrée, [tandis que] une partie reste encore debout, quoique la terre
se soit accumulée en assez [grande quantité] en bas autour des pieds ; peut-être fut-elle accumulée par le
vent. Les rues ne sont pas pavées mais sont parsemées de sable, pour qu’il n’y ait pas de boue si
d’aventure il pleuvait. Les maisons sont aussi sans toits, mais en aucun endroit la ville n’a été aussi bien
bâtie que près du château, comme on peut le voir.
L’église Sainte-Catherine qui est assez enfoncée dans le sol, –ce qui fait qu’on doit descendre beaucoup de
marches– vaut la peine d’être vue. En elle est un bloc de marbre carré qui a au milieu un trou, mais pas à
travers toute la pierre ; sur lui [ce bloc] sainte Catherine aurait été décapitée. Et près de cette église est le
canal qui amène l’eau douce dans la ville. On y montre aussi la chaire d’où Marc, le saint évangéliste, aurait
prêché, car il fut le premier évêque de cette ville ; [on y montre aussi] la pierre sur laquelle il fut finalement
décapitée. Après lui, le célèbre professeur Athanase qui a composé le Symbole [des Apôtres] et le Credo
bien connu, y fut aussi évêque et a fidèlement répandu l’enseignement apostolique.
À l'extérieur de la ville, il y a beaucoup de jardins agréables [avec] des oranges, des figues, des dattes et
d'autres fruits délicieux ; on y trouve aussi notamment les pommes d'Adam ou figues de Pharaon qui seront
décrits plus loin, dans [la description de] la ville de Baruth. À l’extérieur, devant la ville, s’élève aussi une
haute colonne, en marbre, brune, ronde et d’une seule pièce. La base a deux toises et trois empans
d’épaisseur, [et est faite] de gros marbre. Sur celle-ci se trouvait alors une grande pierre carrée ; un
morceau qui avait sept aunes d’épaisseur s’en était détaché et se trouvait en bas, d’où l’on pouvait conclure
quelle [énorme] pièce devait être tout le bloc. Et cette colonne est nommée par les uns [colonne de]
Pompée, par les autres colonnes de César, parce que l’empereur Caïus Jules l’avait fait ériger comme signe
de victoire lorsqu’il eut vaincu Pompée.
Il faut particulièrement louer ici, à Alexandrie, le nouveau fort extraordinairement solide, qui se trouva être au
coin de la ville, à notre droite, lors de notre entrée [dans le port] à la voile : il est nommé Torre del Pharro. Il
est bien défendu par de grandes et fortes murailles. Il est vrai qu’il s’élève à une grande distance dans la
mer, sur un rocher, mais il est relié par deux grandes et fortes murailles à travers la mer à la ville, et sur ces
murailles se dressent seize tours. Et quand les vaisseaux entrent dans le port, ils doivent amener les voiles
et les baisser en l’honneur du fort, autrement le chef du fort a le droit de tirer un coup de canon sur un tel
navire. Aucun chrétien n’est admis dans un tel fort, car ils y craignent la trahison et d’autres désagréments.
Autour d'Alexandrie, et dans cette même contrée, croît une herbe de petite taille, ou plutôt un petit arbuste,
que les habitants réduisent en cendres en [le] brûlant, et vendent ces cendres, car elles sont souvent
emportées à Venise où on en fait du savon.
À Alexandrie, comme aussi dans d'autres endroits en Égypte, il y a un ordre [de derviches] particulier qu'on
appelle santons. La plupart du temps ils vont [tout] nus, ou quelques-uns se suspendent un [morceau de]
tissu devant les parties honteuses. On les tient pour des gens saints, et après leur mort on construit en leur
honneur des églises ; beaucoup des gens y placent leur [propre] tombeau et y font placer des chats pour
lesquels ils fixent, par année, une certaine somme d'argent avec laquelle on les nourrit, et [on] les entretient
[pour qu'ils] gardent leur tombeaux, car les Égyptiens placent les chats au dessous des autres animaux.
Ici, tout autour d'Alexandrie et en Égypte [en général] il y a une grande quantité de câpres ; elles poussent
en liberté dans les champs, et elles fleurissent et sentent presque comme le pavot. Les feuilles ont presque
la forme d'un coeur. Au temps de mon séjour là, certains étaient mûres, d'autres fleurissaient encore ; j'ai vu
aussi qu'on en a enlevé de [celles qui étaient] mûres pour les confire.
Au commencement du mois de mai [selon le] nouveau calendrier, on trouve déjà à Alexandrie des fruits
mûrs et notamment en grande quantité les melons. Il faut seulement s'étonner que ni les cerises, ni les
pommes ne croissent ni là ni à Rosette.
À Alexandrie j'ai vu aussi chez le consul vénitien deux jeunes autruches qui étaient déjà assez grandes et
fortes, et qui étaient nourries avec de l'orge. Les naturalistes attribuent à cet oiseau [la faculté de] pouvoir
digérer les fer, ce que je n'ai pas vu, quoi que j'aie souvent désiré [le voir]. »
479 Blunt, H., et al., Voyages en Égypte des années 1634, 1635 & 1636. Henry Blunt, Jacques Albert, Santo
Seguessi, George Christoff von Neitzschitz, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1974, p. [177]-[178].
- 413 - 414 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ARCANGIOLO CARRADORI (1630-1638)
Lumbroso, G., Ritocchi ed Aggiunte ai « Discrittori italiani dell’Egitto e di Alessandria », Reale Accademia dei
Lincei CCLXXVI, Rome, 1892, p. 185-252.
Arcangiolo Carradori, franciscain de Pistoïa, est envoyé en tant que missionnaire au Caire de 1630 à 1638. Il
compulse en 1635 un dictionnaire en turc-italien et un autre en italien-nubien. À son retour en Italie, il obtient
la chaire de langue arabe à Pise où il enseigne pendant quelques années. Il meurt en 1652.480
p. 20-23 :
« Relatione delle cose che ha possuto veder frat’Arcangelo da Pistoia Minor Oss.te Missionario nell’Egitto dal
1630 fin’al 1638 ».
« Circa la fede cattholica di Xpto nostro Sig.re in quelle parti non si trova se non in quei pochi mercanti
venetiani e franzeci che habitano in Alessandria e nel Gran Cairo, li quali hanno le lor chiese nelle case o
fondachi de consoli nelle quali posson’convenire tutti li christiani a lor’beneplacito ; e benche nelli tempi
passati in Alessandria vi fossero quattro nationi cioe Franzeci, Venetiani, Genovesi e Ragugei e
ciascheduna natione haveva il suo palazzo, o fondaco con’gran’claustro, et appartam.ti per habitationi delli
Consoli, e delli mercanti, et ogni nationi haveva la sua chiesa ; in questi tepi per mancam.to di negotii se
bene li fondachi sono in piedi benche molto rovinati, non vi habita se non le due nationi predette, e se altri
d’altra natione vi arriva, dimorano per lo più sotto la tutela del Consolo franzese per certe capitolationi che
stanno fra loro et il Gran Turco.
Queste due nationi vanno pero con li loro cappellani a celebrar’la messa a certe cappelle che hanno fatte
nelle chiese principale delle nationi scismatiche, come nella chiesa di S. Caterina V.e et M.re dove si vede
una colonna sopra della quale si crede finisse il suo martirio la s. verginella, vedendosi anco in questi tempi
in essa alcune goccie di sangue. Questa è chiesa, e convento tenuto dalli Greci ; ma le due nationi ci hanno
ciascheduna la sua cappella, et altare, li Venet.i di S. Caterina e li Franzesi di S. Anna ; li Venetiani tengono
ancora una cappella nella chiesa di S. Marco, dove sta ancora il pulpito sopra del’quale predicava
l’Evangelista ; et una cappella nella chiesa di S. Michele Arcangelo, alla qual cappella sta un’immagine
dell’Arcangelo in tavola si crede di mano di S. Luca, e queste due chiese son’possedute dalli Cofti ; et una di
S. Giorgio fuora della città.
Quanto alla fede di queste nationi perche si vede nelli libri stampati, diro solo (p. 21) che li Greci oltre
all’essere ostinati contra la S. Chiesa, e fede catholica le lor’funtioni ecclesiastiche, e sacramentali, come
messe, confessioni, matrimonii, licentie di non digniunare, o far’quadragesima, o assolutione di peccati non
le danne, e non l’esercitano senza ricever’prima tal’ somma di dinari, o senza la conventione al’meno.
Li Cofti poi se bene son’più familiari nel’praticar con li cattholici, lo sono più per interesse (essendo essi per
mo più poveri) che per amore.
Li dogmi loro della fede sono che vogliono una sola natura in Christo, una sola volontà, et una sola
operatione, tengono per dannato il concilio gele calcedonense e tutto quel che in esso fu determinnato,
tengono S. Leon Papa che confirmo per scomunicato, e Dioscoro dal conc.o condannato, lo tengono per
Santo, e ne fanno commemoratione nella messa et ofitii ecclesiastici. Celebrano in lingua egitiaca, o cofta, e
lette l’Epistole, et Evangelio in lingua cofta subito leggono l’istesso in lingua arabica materna in voce alta
voltati al popolo ; Molti si circoncidono, e’molti lassan’di circoncider li maschi, ma le femmine le circoncidono
avanti che si maritino ; celebrano in fermentato (se ben’questo non fa caso) e fanno molte Quadragesime.
Questi Cofti sono sparti per tutto l’Egitto et arriveranno in tutto a dugento mila anime, essendo solo circa
venti mila quelli che pagano la taglia della testa di quattro scudi l’anno al Gran Turco e questi sono solo gli
homini atti a guadagnarsi il vitto con la fatica come homini da diciotto anni sin’a sessenta o più, oltre de quali
vi sono li putti maschi e femine, li vecchi decrepiti, gl’infermi, stroppiati, e ciechi, li frati e le donne ; questi
Cofti ne sono alcuni pochi in Cipri, et altri per la Soria detti pero Soriani quali ofitiano in lingua caldea ma rito
cofto.
Le lor funtioni ecclesiastiche, come messe, battesimi, e sposalittii le fanno di notte congregandosi la sera in
chiesa, se porta poi che sia fornito di giorno non importa, ma quando digiunano aspettana a celebrar la
messa doppo mezo giorno, et la quaresima grande doppo Vespro tanto che sia fornito al’tramontar del’sole
perche sin’a quell’hora stanno digiuni senza pigliar ne anco geccia d’acqua che in altra maniera tengono per
guasto il digiuno.
Dicono una sola messa il giorno, et in particolare sopra un’altare et in un’istesso non dicono mai due messe,
si che con dificultà una volta lassorno che frat’Arcangelo là miss.rio aplico celebrasse sopra l’altare dove essi
havevan celebrato e forse celebro che li preti non se n’avveddero essendo a desinare, che in alto tempo gli
lassavano preparare un’altare portatile.
Dentro alle lor’chiese non si vede mai donne in viso, come ne anco per le strade andando sempre coperte
con un velo negro, e quelle di qualche consideratione o facolta non vanno fuora di giorno ne anco a casa li
parenti, ma di notte, et in chiesa stanno in appartam.to di essa serrate e con certe grate a modo di monache.
Questi non si confessano mai in chiesa, ma in casa e rarissime volte, e di quelli una sol volta in vita ; si
communicano in chiesa dell’istess’hostia del’sacerdote quando si dice la messa, per in altro tempo non
possono non tenendo il santiss.mo conservato, né mai s’e visto portarlo agl infermi ; l’estrema untione la
frequentano ogni volta che hanno un poco di dolor di testa facendo la beneditione di detto olio volta per
volta, e lo benedice ogni sacerdote.
Alcuni di questi Cofti habitanti nell’Isola del’Delta dalla parte di Damiata (p. 22) alcuni anni sono forse a tepo
di Grego, 13 presero la correctione de’giorni, e cosi fanno la pasqua con noi, e poco obediscono all’lor
Patriarca se bene si stima lo faccin’più per vincere una gara, e vivere a lor’modo, che per zelo di salute, e
cognitione, o accetation’della verità.
Tornando da’principio, la città d’Alessandria è fatta in quadro, e sara intorno a cinque miglia di contenuto
tutta destrutta, e rovinata piena di colletti che son’le rovine de palazzi, e quartieri, si vede pero molte colonne
in piedi, et una guglia in piedi et una cascata tutte piene di Gieroglifici, si d.o (dice ?) che la citta si possa
tutta caminar sotto terra fatta con artifitio da Allessandro. Le muraglie attorno son’quasi tutte in piedi con li
suoi merli, e bastioncelli all’antica et è murus ante murale si che fra di essi potria caminar’esercito in
ordinanza, e nel’veder la citta di fuora mostra gran’bella cosa tanto più che vi è campagna aperta e pianura
dalla parte di Levante verso mezo giorno, da Garbino son’montagne non molto alte ma tutto spogliato ;
Fuora della citta mezo miglio da mezo giorno vi è una colonna dell’istessa pietra delle guglie di Roma, eretta
sopra la sua base, e col’suo capitello in cima, tutta d’un’pezzo e più grossa et alta traiana di Roma, quale si
dice fusse eretta da Pompeo ; Dentro come dissi son’poche case solo dalla parte inverso il mare vi sono le
chiese e case de’Christiani Greci, e cofti, et Ebrei, e Mercanti catholici, ma pochi turchi habitan dentro per la
mala aria causata dall’acqua annuali he vengono del Nilo, che riempiendo le parti sotterranee della citta
al’Porto dove, e la dogana et il traffico, il porto è volto a tramontana, et ha due fortezze, una alla punta del
faro, l’altra fuora della citta da levante, e fra questo castello, e la citta nel’porto dicono fosse il palazzo di
Cleopatra dove si vedono anco molte colonne rovinate in mare, ma si allargava molto in terra verso levante.
Il faro d’Allessandria è una lingua di scoglio quale spiccandosi da terra s’allarga in mare tanto che forma un
gran porto, e sicuro tirando la sua punta verso ponente dove fa la boca del porto, nel’quale stanno le galere
sicure, nell’altro vi stanno li vascelli di Mercanti e Corsari dove ne vengono in gran’numero di Constantinopoli
di Barberia, e di Christianita ; Ma ogn’anno vi se ne fracassano per la fortuna havendo per traversia la
tramontana ; In questo scoglietto detto il faro si dice che stettero, e scrissero li settanta interpreti ; ma hoggi
non vi è vestigio alcune ne memoria di questo.
Dentro alla citta è un gran Moschea forse nella casa di S. Atanasio dove quando si adunano li Turchi il
venerdi sul’mezo giorno, rinserrano li Christiani cattolici nelli loro fondachi a chiave come fanno anco ogni
notte, e le chiavi la notte, e nell’hora dell’oratione stanno appresso del Bascia, o in Castello.
Da Allessandria, a Rossetto verso levante si camina quaranta miglia in circa appresso alla marina, et meza
strada si trova la bocca di un’lago che dal’mare entra in terra e s’alloga forse due mila scudi l’anno per le
pesce che vi fanno di cefali per salarli, dove passata questa bocca con barca vi è un’osteria disabitata dove
si fermano alle volte di notte li passeggieri per fuggir’li pericoli de gl’assassini Arabi ; Avvicinatosi che si lassa
la marina per andare a Rossetto, e cosi se ne trovano sin’dieci lontani (p. 23) uno da l’altro quanto si puo
scoprir di vista per rispetto della notte caminandosi per arene dove li venti coprono la strada. »
480 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 403.
- 415 - 416 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN COPPIN (1638)
Coppin, J., Voyages en Égypte de Jean Coppin, 1638-1646, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1971.
Jean Coppin (vers 1616-vers 1690) est capitaine de cavalerie. En 1638, il s’embarque pour l’Égypte et
séjourne deux ans au Caire. Alors qu’il rapporte à Marseille de l’or et des pierres brutes, il est pris par des
pirates et dépouillé de ses biens. En 1640, il repart à Tunis, puis se rend en Syrie pour visiter les Lieux
saints. En 1644, les consuls de France et d’Angleterre le nomment consul à Damiette où il y séjourne
jusqu’en 1647. Entre temps, il est nommé syndic pour recevoir les aumônes des fidèles par les Pères de
l’observance de la Terre sainte. Lorsqu’il revient en France, il prent l’habit des ermites de
Saint-Jean-Baptiste au diocèse du Puy dans le désert de Chaumont. En 1665, il présente à la cour ses
mémoires composés lors de ses voyages pour montrer la faiblesse des Turcs et indiquer la manière de leur
faire la guerre. Jean Coppin demande également audience au pape qui approuve son zèle. Puis il écrit à
tous les princes chrétiens pour les inviter à une union générale contre l’ennemi commun, mais les affaires
d’Europe empêchent l’aboutissement de ce projet. Plus tard, on l’encourage à publier son ouvrage qui est
imprimé en 1686 sous le titre de Bouclier de l’Europe ou la Guerre Sainte.481
p. [15]-[28] :
« Alexandrie qui quitta le nom de Nô pour prendre celuy du Conquérant de l'Asie, me parut d'abord fort
grande mais assez désagréable ; ses rues ne sont point pavées & sont fort obscures pour estre presque
toutes couvertes à cause des grandes ardeurs du Soleil ; on les arrose fort souvent, ce qui les rend
glissantes & incommodes à marcher.
La premiere chose que nous fimes fut d’aller rendre visite à Monsieur Laurens Chef des François en cette
ville, mais qui ne prend que la qualité de Vice-Consul, & est seulement comme le Lieutenant du Consul de
nostre Nation qui reside au grand Caire éloigné d’environ quarente lieuës d’Alexandrie. La maison, où logent
les Vice-Consuls, s'appelle Fondique & appartient au Grand Seigneur qui fait fournir de ses revenus une
certaine somme de Medins toutes les années pour en entretenir les bâtiments ; elle est grande & spacieuse,
environnée de murailles où il y a deux portes-cochères, & au dedans de la cour, qui est tres-belle, nous
trouvames le logement tout semblable à un Couvent de Religieux. Au bout de la cour nous montames par
quelques degrés dans une salle qui sert de Chapelle, & après y avoir rendu graces à Dieu de nostre arrivée,
nous allames saluer le Vice-Consul dans sa chambre qui estoit un homme âgé de cinquante ans & tout
remply d'honnesteté. Je luy presentai des lettres de recommandation pour moy de plusieurs de ses amis, ce
qui obligea plus particulierement de me recevoir d’une maniere fort obligeante, & de me faire offre de tout ce
qu’il avoit en sa disposition.
Il estoit encore d’assez bonne heure quand nous le fumes voir, ce qui fut cause qu’il fallut diner avec luy, &
parce que c’étoit la fête de la purification de la Vierge l’on ne fit rien décharger de nostre Navire. Ce n’est
pas que les Officiers de la Doüane tous Juifs ou Turcs, & le Capitaine du Vaisseau qui professoit le
Lutheranisme, eussent ce respect, mais d’autant que les marchandises appartiennent à des Catholiques de
Marseille, le Vice Consul & ceux qui en avoient le soin ne voulurent pas consentir à les faire transporter ce
jour-là, bien qu’il y eut beaucoup de risque à les laisser dans ce Port qui n’est couvert que des vents du Midy
& de Labeche482, & qui est exposé presque à tous les autres. Comme il n’y a rien de plus agreable que de
discourir des perils que l’on a échapez, nous ne manquames pas de parler au Vice Consul de la tourmente
que nous avions soufferte, & il nous raconta une invention assez nouvelle d’un Capitaine Anglois pour
sauver un beau Navire de quarente pieces de canon qu’il commandoit, qui se trouva au port d’Alexandrie le
jour de cette horrible tempête. Ce Capitaine qui avoit moüillé quatre ancres pour assurer son Vaisseau,
voyant enfin que tous ses cables estoient rompus par la longueur de l’orage, & que son bâtiment poussé du
vent s’en alloit contre des rochers qui sont vis à vis de l’ancien Palais de Cleopatre, fit faire en diligence une
grande ouverture à fonds de cale comme il passoit en un endroit peu profond, & s’estant bien-tôt rempli il
demeura engravé moitié dans la Mer & moitié au dehors. Par cette presence d’esprit l’Anglois sauva son
Navire, & bientôt apres nôtre arrivée nous le vîmes tirer de l’eau pour le racommoder.
Le lendemain de la Purification chacun de nous fit décharger promptement à la Doüane tout ce qu'il avoit à
bord, & l'on acquitta aussitost ce qui devoit subside au Malhem483. Mais ce ne fut pas sans un grand
étonnement de ma part de l'excez de ces impositions & de la maniere de les exiger, car il fallut mesurer les
draps & apres les estimer, & sur le prix il prît vingt pour cent, c'est à dire un cinquième, non seulement des
draps mais aussi de toute autre sorte de marchandise. Il se fit payer sur le champ de tout ce qui luy estoit dû
en argent, excepté du papier qu'il prit en espece, à cause du grand cours qu'il avoit alors dans ce Païs-là.
Voilà comme l’Othoman tire des sommes immenses du commerce que les Chrestiens font chez luy, pendant
qu’eux pour gagner peu exposent beaucoup, & par la quantité des Corsaires sont dans un continüel danger
de la perte de leurs biens & de leur liberté, & bien souvent de celle de leur vie.
Comme nos marchands ne vouloient pas demeurer à Alexandrie, & avoient destiné leurs marchandises pour
le grand Caire, ils en mirent une partie dans des barques qu’ils appellent Germes pour les conduire jusqu’à
Rousset qui est une petite Ville sur le Nil à quatorze lieuës de là ; & dans ce Bourg il y a des Marchands
Chrestiens qui les reçoivent, & les font remettre dans des barques d’une autre sorte pour remonter au grand
Caire.
Mais ce ne sont que de choses grossieres que l’on envoye par cette voye, car l’on fait porter jusqu’à
Rousset ce qui est d’une plus grande valeur sur des chameaux qui sont des mulets de l’Egypte, parce
qu’outre que les Germes ne sont pas couverts, la coste qui est assez dangereuse à cause du dégorgement
du Nil, fait apprehender d’y hazarder des marchandises d’un prix considérable. Ce fut par cette voiture que
nous fimes partir ce que nous avions de meilleur dans l’intention de le suivre bien-tost apres, mais
auparavant que de quitter Alexandrie, il faut representer en peu de mots l’état où elle se trouve
presentement.
Description d’Alexandrie, & des plus remarquables choses qui s’y voyent
J'ay deja commencé de dire que cette Ville ne me parût pas agreable à sa premiere venüe, mais elle ne
m'obligea point à changer d'avis apres l'avoir bien examinée ; l'air en est mauvais, & bien qu'elle soit un peu
relevée de la plaine, l'assiete en est fort mélancholique, parce que l'on ne découvre à l'entour d'elle que des
campagnes de sable & quelques palmiers. Quoy qu'elle soit encore grande, elle ne l'est pas la quatrième
partie de ce qu'elle estoit autrefois ; elle n'a plus rien de ces pompueux édifices, n'y de cette magnificence
qui en a rendu le nom si celebre ; parmy son enceinte d'aujourd'huy l'on voit presque autant de ruïnes que
de maisons, & pour une Ville de commerce, dont le Port est si renommé, il n'en fût jamais de moins peuplée,
& dont les habitants soyent si miserables.
Sa figure est en forme de croissant, & dans le sein ou creux que font les murailles où est la porte qui va de
la Ville au Port elle s’éloigne environ cinq cens pas de la mer, mais les deux extrêmitez qui font comme les
cornes du croissant reviennent jusqu’au bord du rivage. Sur celle qui regarde l'Orient, estoit assis le palais
de Cleopatre où l'on ne voit que les ruïnes de quelques galeries, qui s'entendoient au long de la mer avec
une tour ronde qui est encore en son entier. Elle est toute de marbre blanc, sa hauteur contient plusieurs
salles, & dans ce qui est en bas il se voit une tres-belle voute qui vient reposer sur une masse de bâtiment
solide qui est dans son milieu. Tout au tour de cette épaisseur, il y a diverses niches en égale distance qui
sont ornées des colomnes aussi de marbre, sur qui la voute se vient terminer en berceau, & l'on croit que
c'estoit dans ces niches que Cleopatre avoit fait mettre les simulachres de ses fausses divinitez.
Un peu plus loin au dedans de la Ville est cette haute colomne dont j’aye deja fait mention, & non seulement,
c’est la plus rare antiquité qui soit dans Alexandrie, mais il me sembla que c’estoit une des plus
merveilleuses choses que j’eusse encore veuë. Elle est posée sur sa base, & ornée de son chapiteau, & elle
est toute d’une seule pierre haute de plus de cent pieds, & grosse de vingt-un ; Cesar la fit eriger en
memoire de la défaite de Pompée, & c’est pour ce sujet que l’on luy a donné le nom de ce dernier.
L’on trouve encore dans cette Capitale de l’Egypte deux illustres monuments de la grandeur de ses anciens
Roys, ce sont deux obélisques en forme de Piramide, dont l’une est plantée sur son pied d’estail, & l’autre
est couchée par terre ; elles sont toutes remplies de Hierogliphes, & qui est droite à soixante coudées de
hauteur. On dit par tradition que vingt mille personnes avoient esté employées pour la mettre en place, &
que le Roy qui la faisoit dresser, (qui estoient un des Pharaons,) craignant que les maîtres de l’ouvrage ne
fussent negligents à bien prendre leurs mesures, & à disposer leurs machines, fit lier son propre Fils sur la
pointe, afin que les ouvriers se rendissent plus soigneux d’une chose, en qui il remettoit le salut de l’heritier
de la Couronne. Il y en avoit encore un grand nombre d’autres, mais elles ont esté transportées à Rome ou
à Constantinople, & quelques-unes ont esté brisées dans les saccagements que la Ville a éprouvez
plusieurs fois. Il se voit encore en dedans de ses murs deux petits monticules que les Romains ont fait
élever de ruïnes & de terres rapportées, on ne sçait si c’estoit pour pouvoir regarder dans le Pharalion à
dessein de déscouvrir dans la haute mer, mais aujourd’hui il y a une tour sur l’un d’eux pour prendre garde
aux Vaisseaux qui paroissent.
Ce qui est de plus curieux pour un Chretien, sont les mazures du Palais du Pere de Sainte Catherine, dont il
reste des vestiges de quatre pieds de hauteur ; le Vulgaire appelle cet endroit le Palais du Roy Coste, bien
que l’histoire nous apprenne qu’en ce tems-là l’Egypte obeïssoit aux Romains, & qu’il ne pouvoit estre qu’un
Prince descendu de famille Royalle. L’on y montre le lieu où l’illustre Vierge fût décapitée, & la pierre qui
servit pour lors d’appuy à sa précieuse tête, est encore dans une des Eglises des Chretiens d’Alexandrie où
je l’ay veuë, aussi bien que la Chaire dont saint Marc se servoit pour prêcher, & une Image de saint Michel
faite de la main de saint Luc.
Voilà les Antiquitez saintes & prophanes que j’ay remarquées dans cette Ville ; il n’y a point d’autre eau que
celle du Nil que chaque maison reserve au tems de l’inondation dans de grandes cîternes soutenües de
colomnes, & pour ses fortifications elle n’a que des murailles sans aucun fossé avec des vieilles tours qui
sont ruïnées en plusieurs endroits. L’on voit par quelques restes qu’elle avoit une double enceinte
anciennement ; les murs qui sont du côté de la mer n’ont guerres moins de vingt pieds de hauteur, mais ils
ne sont pas épais, & outre les tours il n’y a aucuns travaux pour les assurer.
J'ay deja dit que dans le sein484 que fait le circuit de la Ville en se retirant du rivage il y a une plaine d'environ
cinq cens pas ; elle est habitée de Mogrebins qui sont campez sous de méchantes tentes, & vêtus comme
des Bohemiens, & qui gagnent leur vie à faire secher des cuirs & d'autres Marchandises au Soleil.
La maison de la Douane & quelques autres qui servent à mettre à couvert les choses que l'on débarque,
sont dans cette plaine du côté qui approche la Mer, & tout sur la derniere extrêmité de la terre, est une
maniere de grande tour quarrée, qui commence à tomber en rüine, qui n'a que quelques pieces de canon, &
qui m'a semblé de nulle défence, & c'est ce que l'on appelle le vieux château. De là jusques à la pointe de la
Ville, qui est à l’Occident, la Mer fait comme une ance, & c’est là le vieux Port d’Alexandrie, mais comme il a
peu de profondeur, il n’y peut moüiller que de petits Vaisseaux & des Barques.
Du vieux Château en remontant vers le Palais de Cleopatre, & un peu au dessus de la maison de la Doüane
l’on trouve une maniere de pont ou de chaussée qui s’avance environ 250 pas dans la Mer, soûtenu de
petites arches de pierre qui n’ont pas beaucoup de hauteur, parce que l’eau n’y est pas profonde. Au bout
de ce parchemin paroissent quelques rochers où l’on a bâti le Pharalion, dont j’ay dit quelque chose dans les
Livres precedents, mais avant que d’entrer dans sa description, il faut observer sur le sujet du pont qui y
conduit que la distance n’en est pas la moitié si grande que tous les Autheurs anciens qui en ont parlé la
marquent ; comme ils s’accordent neantmoins dans l’éloignement qu’ils mettent, & qu’il y en a plusieurs de
dignes de foy, il faut conclurre ou que la Mer occupoit autrefois davantage de cette plaine qui est entre le
port & la Ville, ou bien que les Roys par magnificence avoient fait conduire le pont bien avant sur la terre,
ainsi qu’on le voit pratiqué à Madrid, & en beaucoup d’endroits de l’Espagne. Le Château du Pharalion où
l’on éclaire encore aujourd’huy les Vaisseaux est le Phare si célèbre de l’antiquité, qui estoit au rang des
merveilles du monde ; Sostrate Gnidien en estoit l’architecte, & Ptolémée Philadelphe avoit dépensé huit
cens talents qui sont près de 500 mille Ecus pour le faire bâtir. Un corps de logis de marbre blanc
agreablement ouvert en faisoit le premier étage ; au dessus s’élevoit une tour quarrée toute du même
marbre, & d’une hauteur extraodinaire ; c’estoit comme une quantité de galeries balustrées l’une au dessus
de l’autre, qui estoient soûtenuës par de riches colomnes, & la grosseur (p. 49) de la tour des deux tiers en
haut alloit en diminüant jusque vers son sommet. L’on dit encore à present en ce Païs-là qu’il y avoit des
miroirs si ingenieusement disposez dans les plus élevées de ces galeries que l’on y voyoit representez tous
les Vaisseaux qui approchoient du port, mais c’est une de ces opinions avancées par le menu peuple qui ont
mieux l’apparence de fables que de veritez. Au lieu de ce bâtiment si pompeux il se voit aujourd’huy le corps
d’un Château assez grand & de figure irreguliere à cause de la disposition du rocher. La place où il est assis
n’est pas plus relevée que la plaine qui le regarde ; il a pour sa premiere enceinte une fausse braye de sept
pieds de haut, & au dedans est une muraille plus élevée toute garnie de crenaux qui environne le corps du
Fort, mais l’une ny l’autre ne sont point terrassées, & suivent seulement l’inégalité du terrain sans estre
flanquées de tours ny de bastions.
Du milieu du batiment il sort une haute tour qui sert de Phare, mais qui n'a rien des beautez de l'ancien, &
dans les différentes embraseures qui paroissent dans les murs il y a quatre-vingts pieces de canon en
batterie qui regardent des côtés de la mer. Celuy qui en est gouverneur est toujours une personne
considerable ; la garnison en est assez forte pour quelques Vaisseaux, estant ordinairement de trois cens
hommes, & ce Chateau domine toute la côté d'Egipte, & en est le seul boulevard. Pour s’en rendre maître
avec peu de difficulté, il est necessaire de débarquer au dessus d’Alexandrie, & de venir s’emparer de la
Ville qui n’a pas dequoy faire resistance ; les deux monticules qui y ont fait les Romains l’on battra aisément
le Pharalion en ruine, de la tour qui est sur l’un d’eux l’on verra tout le dedans, & s’avançant à la faveur des
batteries du côté du pont, ou la mer est fort basse, on pourroit l’emporter par escalade. Il ne faut pas songer
d’y aborder des autres endroits, parce que les rochers qui sont parsemés à l’entour en deffendent
l’approche, mais sans se mettre beaucoup en peine, comme il n’y a point d’autre eau que celle qu’on y porte
sur des chameaux, en gardant quelques jours les avenuës il faut necessairement qu’il soit abandonné de
ceux qui le gardent. Entre ce Chateau & le Palais de Cleopatre, dans la plaine où sont les tentes des
Mogrebins, il y a une tour où l'on renferme les munitions de poudre pour le Grand Seigneur ; & c'est depuis
le travers du Pharalion jusqu'à cette tour qu'est le meilleur encrage pour les grands Vaisseaux, bien que,
comme j'ay deja dit, il n'y en ait point qui ne soit fort exposé.
(…)
Voyage d’Alexandrie à Rousset
Apres avoir demeuré quelques jours dans Alexandrie j’en sortis en la compagnie de deux Marchands
François, & nous menions avec nous un Janissaire que nous avoit donné le Vice-Consul, & à qui nous
avions promis sept piastres pour nous faire escorte jusqu’au grand Caire, car il ne faut point marcher en ce
Païs-là sans avoir quelqu’un avec soy, si on veut estre exposé à tous moments à des accidents
tres-facheux. »
- 417 - 420 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SAMUEL JEMSEL KARAITE (octobre 1641)
Jemsel Karaite, S., « Itinéraire de Samuel Jemsel Karaite », dans E. Carmoly (éd.), Itinéraires de la Terre
Sainte des XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe, Bruxelles, 1847.
Juif lituanien né à Troki, Samuel Jemsel s’embarque à Eupatoria (Crimée) pour Constantinople et, de là, à
Alexandrie. Ensuite, il gagne Le Caire par le Nil, y passe un mois et demi, avant de repartir pour Jérusalem.
Il meurt dans son pays en 1648 lors d'un massacre.485
p. 519 :
« Il y a cinq cents milles de l’île de Rhodes à Alexandrie. Quant à cette dernière, c’est une des plus grandes
cités ; mais la majeure partie des édifices qui ont été élevés par les soins d’Alexandre le Grand ont été
renversés et détruits. Il y a à Alexandrie des constructions qui ressemblent à celles que l’on peut voir à
Rhodes, c’est-à-dire faites au moyen de pierres quadrangulaires. Il y reste en outre debout de magnifiques
palais remarquables par leurs colonnes de marbre et par la variété de leurs couleurs ; il serait difficile de les
compter, tant il y en a une grande quantité. Les rabbinistes y ont trois synagogues et écoles ; les
mahométans y possèdent des mosquées, parmi lesquelles on en distingue une qui repose sur mille
colonnes de marbre. Nous consacrâmes trois jours au repos. »
485 Jemsel Karaite, S., « Itinéraire de Samuel Jemsel Karaite », dans E. Carmoly (éd.),Itinéraires de la Terre
Sainte des XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe, Bruxelles, 1847, p. 501-502.
- 421 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GABRIEL BRÉMOND (du 10 novembre au ? 1643)
Brémond, G., Voyage en Égypte de Gabriel Brémond, 1643-1645, par G. Sanguin, Ifao, Le Caire, 1974.
Gabriel Brémond est originaire de Marseille. On suppose qu’il naît autour de 1610-1620, mais rien ne nous
est connu de sa vie jusqu’en 1643, date à laquelle il s’embarque pour l’Égypte. Les raisons qui le poussent à
parcourir pendant quatorze ans le bassin méditerranéen sont inconnues, mais Georges Sanguin émet
l’hypothèse d’une mission commanditée par le Pape.486
p. [17]-[36] :
D’Alexandrie et de ses anvirons
« Pour dire quelque chose en particulier des villes considérables de ce pais, comancerons par Alexandrie,
qui a esté l’une des plus fameuses villes de l’antiquité et un des tesmoignages de la somptuosité des Grecz,
ayant esté fondée par Alexandre le grand, et mise à son plus haut lustre par les Ptolémées, qui l’avoyent
choisie pour leur capitalle de l’ampire ; elle fust bastie et choisie avec grande prudence, en une très belle
asiette, sur une poincte ou advance(ment), en la mer, comode de deux bons ports ; est esloignée au ponant
du Nil de 40 mil. Sa figure est oblongue, en ovalle, de l’oriant au couchant, toute la plaine ; mais com(m)e à
présant tout le dedans est en ruine, il s’y tr(o)uve plusieurs petits monts d’icelles et tets qui rand la veuë
difforme et bien pitoyable. Le circuit des murailles subsiste ancore, pour n’estre antiere(ment) ruinée ; celles
qui sont du costé de terre ferme se voyent ancore doubles, y ayant une espace notable antre les deux, la
première du dehors plus basse, la 2me plus haute, garnie de 50 en 50 pas de tours à l’antiq(ue), et le haut en
marlets, acomodés pour albalestriers ou tireurs &c ; elle aura deux bons mil de tour, du costé de terre ferme,
car, du costé de la mer, ne se peut dire, à cause des ports escartés et ne se mesuran(t).
Des portes
Elle a quatre portes ; l’une au levant, dicte Bab-allou et de Roset ; une au midy a obiect du lac dict Buchaira,
où l’eau vient du Nil ; la 3me au ponant, qui tourne vers le désert de Bacra, ou de Libye ; la 4me est vers la
mer, antre les deux ports, où il y a une grande plaine d’un mil, et, au bout, la douane, et en suitte une langue
d’habitat(ions) ou maisons, contenuës toute(s) en une rue basties nouvelle(ment).
Ceste plaine tire du midy au nord où demeurent ordinairement les Bédouins, gens tous neuds487, qui se
tienent soubs de méchantes cabanes, avec leurs femmes et enfants qu'on voit courir tous nuds sur le sable
de la mer, et les femmes laver leurs petits, d'abort qu'ils les ont mis au monde elles mesmes, sans autre
cérémonie ; ces gens gaignent leur misérable vie prinsipallement en fesant seicher les cuirs de boeufs et
beufles, que les Frans acheptent en grande quanité en ce pais, pour chrestiens. Ceste porte est double,
belle, et le plus fort lieu de la ville ; et lors qu'il y a des galères, on y faict porter leur gouvernails et rames
pour leur plus grande asurance, antre ces portes, où sont anferméz, de peur que les forsats ou esclaves ne
s'en saisissent, ainsy comme il ariva en l'an 1643 que ces pauvres esclaves chrestiens estant mal traictés,
en mettant un navire, en mer, au port proche le château se soubslevèrent ; et ancore qu’il(s) n’eussent
aucunes armes, ayant rompu leurs chesnes, vindrent en ce lieu se saisir des rames, et gouvernail d’une
galère, que en dépit de la milice turque ; s’estants retirés au vieux port, s’acomodèrent du plus
possible(ment) en une galère ; et la sortirent par miracle ; où faut, au sortir, aller en deux androicts soubs les
forts qui y comandent, d’où on tiroit sans sesse sur heux ; se sauvèrent en Candie, à 400 mil de là, sans
voille et armes ; ce subiect a esté partie la cauze de la guerre entre les Vénitiens et Turcs.
Des ports
En ceste ville se voit deux ports, séparés par une langue de terre, qui s’advance com(m)e y’ay dict, du midy
au nord, où sont à présant tous les nouveaux bastiments, et où les prinsipaux chefs y demeurent, comme le
cady ou chef de la justice, l’aga ou lieute(nant) du bacha de l’Aegipte, com(m)e le bey ou seig(neur)
d’Alexandrie, qui a faict bastir un beau loge(ment) au vieux port, pour la comodité de ces galères, estant [à]
cause de ce titre et seig(neurie) obligé d’en entretenir sinq, qui estoyent destinées pour garder les costes de
mer de ce pais ; mais à présant, le grand Seig(neur) s’en sert à ses guerre(s). Toutes les maisons susdictes
sont comprises en 2 ou 3 ruës en long, où au milieu y a un bazar, ou lieu de vante ouvert, pour merchans.
La douane et ses maguezins, com(m)e ceux de marchands, sont vers le rivage du grand port, où se font les
desbarque(ments) des marchandises et non en aucun autre lieu, com(m)e l’embarque(ment) de celles qu’on
envoye pour les drois.
Du vieux port
Le vieux port, où se tiennent les galères, armes, lieu couvert pour les esclavës, et provisions, com(m)e
aus(s)y y a loge(ment) pour les soldats et comend(ants), e(s)t à l’occident de la ville ; qu’il s’estant du levant
au ponant, où est son antrée. Il est faict en forme d’une longue ovalle, d’un bon mil de circuit. Il ne sert à
présant à autre usage que pour les galères ; aus(s)y ne seroit guiere propre à autre parce qu’il est presque
tout comblé ; et pour y antrer faut le faire en serpantant avec la rame ; est esloigné de la ville d’un mil ; les
galères y sont rare(ment). Il a deux forts, en forme de château, à ses flancs, l’un vers le midy et l’autre au
nord, où il faut s’y aprocher, à cauze des bas fonds, yusques contre les murs qui sont garnis de quelques
canons et fauconeaux.
Du port marchantil
L’autre port, très bon et beau, est en la figure d’un croissant, ayant son antrée au nord et à ses poinctes,
deux forteresses ; celle du costé de l’occident est eslevée sur les rochers assès émine(nts), au bout de ceste
langue de terre, de ce costé où y a un chasteau fortifié à son pied, à la moderne, bien flanquié tout au tour,
où y a double baterie de canons, une à fleur d’eau qui domine l’antrée et tout le port par ces bastions ; et où
y a ordinaire(ment) trois cens genissaires de garnison et leur aga, qui est chef de tous les genissaires de
ceste ville et anvirons ; au dessus du donjon du château, y a un fanal, qui doibt fournir de lumière la nuict ;
c’est pour ceste raison qu’on le nom(m)e fanaile, quant on vient d’autre mer. C’est la première chose qu’on
descouvre, parce que tout ce terrain est extrêmement bas et sans montaignes ; ce qui donne bien de peine
aux pilottes pour le recognoistre ; et ne savent bien souvant où il(s) en sont du lieu ; mais quand il(s) sont
proches de la terre, il(s) le recognoissent en l’eau de la mer, qui est trouble et de couleur blanchastre, et
sondënt le fond.
Du petit fanaillon
A l'oposite, au levant, et à l'autre extremité du croissant, il y a un autre fort ou château, mais non sy
considérable, ny en fortification ny en garde, ny aussy n'est sy advancé en mer ; est plus bas en plain et le
terrain contigu à l'antrée de ce port ; presque au milieu, il s'y trouve deux rochers, qui la rendent difficille et
dangereuse. L'un est dict le gerofle, qui est eslevé sur l'eau, et l'autre le puyvre, à fleur d'eau ; les pilottes y
pranent bien garde, sur tout quand le vant est viste, où y faut de l'adresse, le passage estant tortu et estroit.
Il y a deux lieux pour ancrer en assurance : l'un est au dernier, et à l'abri du grand château, où les vaisseaux
des mohomettans s'y logent fort comodement et où y a, au devant, une place pour en fabriquer et acomoder,
au besoing ancrent tout contre terre, sont anfermerz antre la douane, le château et logement de l'aga ou
gouverneur, afin que, y venant des corsaires, ne puissent fere rumeur. L'autre est au fonds du port, vers son
midy, où les vaisseaux francs se tiennent, qui sont assès esloignés de terre, mais sans craincte de péril ny
de voleries, fesant garde et estans les maistres dans leurs bords.
Du lieu où estoyent les palais Royaux
Tout au devant qui est au midy et au milieu de l’ancienne ville, et antre les murailles, où y avoit une porte
(mais à présant est murée), s’y voit ancor des restes du fameux mausolée de Cléopatra : reste ancor
d’antier, au dessoubs d’une tour ruinée, une voûte en octogone, le haut faict en domo où, à chasque angle,
y a de niches, et quelques pièces de beau marbre délabrée, qui dénottent assez de la valeur de l’ouvrage ;
au pied, dans la mer, s’y voit quantité de pièces de colomnes renversé(es) et autres orne(ments) de beaux
marbres et pierres esquizes, chapiteaux &c. Tout au tour, n’y a que de ruines, que font assès juger de leur
débris, que c’estoit le carrier des palais royaux en leur qualité.
Des aiguilles
Au dedans des murs de la ville, vis à vis ces ruines, environ à 50 pas vers son midy, sy voit ancor deux très
belles aiguilles ou obélisques, les deux historiées de gérogliphes aegiptiens, des plus grandes qui se voyent,
et de beaucoup plus que celles de Rome, d’une semblable matière, toute d’une pièce, d’une esgalité en
chaque carré. L’une est sur pied, mais presque toute anterrée dans les ruines et sable. L’autre est par terre,
aus(s)y à demy ensevelie. Il n’y paroit aucun pied d’estail, ce qui faict yuger de leur grandeur et leur
espoisseur proportionée à leur extrémité, ce que indubitable(ment) a esté la cauze que les Romains ne les
firent transporter. Tous ces environs, com(m)e en tout les androicts de la ville presque, s’y voyent force
colomnes et orne(ments), de marbre, porfires &c, à demy rompus, et plusieurs ruines maignifiques très
considérables.
Des lieux soubs terre
Mais ce qui est de plus remarquable sont les lieux soubs terrains, ceste ville estant toute voûtée, où il n’y a
aucun doubte qu’il n’y aye plusieurs belles choses, s’il se pouvoyent voir espécifié(es), mais les ruines y sont
sy grandes que très dificile(ment) il se pouroit, et, de plus, que de celles qui sont en estat estant acomodées
pour servir de cisternes, qui est pour toute l’année à y conserver l’eau, il(s) ne se peuvent voir que peu
souvant, et le reste on n’oze sy fier, y ayant double péril, tant pour les ruines que pour avanies.
Du desbarque(ment)
Les embarque(ments) et desbarque(ments) des marchandises ne se faict qu'au devant de la douäne, estant
déffandu en tout autre androict ; qui est très rigoureuse et grande, car font payer vingt pour cent de toute
marcha(ndise), ce qui ne se pratique en autre part du Levant. Les Juifs la tienent (d‘)ord(inaire). La douane
est antre les deux lieux d'ancrage, où il y a un molle advancé en mer, qui est nécéssaire pour la comodité
des ambarque(ments). Le séjour de la ville est mal sain. La cauze en est, partie, l’abondance de lieux
soubsterrain, cloaques, ruines qui sont presque générale(s). Les ruës sont couvertes de terre blanche
provenant du débris de murail et vieilles masures. Lors qu’il pleut, on y tr(o)uve parmy des médailles &c. Les
eaux la randent aus(s)y mal saine, car venant une fois l’année du Nil, et après que la provision en est faicte,
les conduicts pour la fere passer en la mer n’estant libres, elle reste croupissante qui se corompt et gaste
l’air auparavant qu’il ce puisse seicher.
Des eaux
Elle vient par un bras du Nil : à son acroisse(ment), les gens du pais le noment calil, ancienne(ment) dict
buchaira, qui coulle durant trois mois, dans lequel tamps toutes les cisternes se remplissent pour s’en servir
toute l’année ; l’eau y est portée par des conduicts soubs terrains, que chascun a soing tenir nets pour ce
qui leur touche, et chas(c)un en prant sa provis(i)on par ordre ; et ainsy, à chasque maison, on y voit deux et
trois cisternes, du moings à l’ord(inaire) ; de là, on peut yuger com(m)e ceste ville est voûtée en tous les
androi(cts). Ces cisternes sont soubstenuës, en des androicts, par des beaux piliers et colomnes, qui sont
souvant à doubles rangées, les uns sur les autres.
Des fondiques
Les plus belles abitations, au dedans de la ville, sont les fondiques, com(m)e on les nom(m)e en ceste ville :
crois [que] c'est un nom imposé par les Francs, là où on met à force marchandize. Il(s) les nom(m)ent
auquelles ordinairement ; aux autres lieux du Levant, on les nomme camps, où abitent les Francs,
marchands et depandens ; où il(s) s'enferment et sont en suretté en ceste ville, y en a quatre, deux pour
l'abitation des François, un pour les Vénitiens et celuy dict de Gênes, que les Anglois, du tamps y estois,
obtindrent, s'estant séparés du consolat de France. Ces fondiques sont bastiments, faicts au carré
ordinaire(ment), en la fasson des cloistres, garnis au dessoubs de maguezins et au dessus des chambres et
loge(ments). Le milieu est une grande cour, où pre(s)que par tout le Levant y a abondance d'eau en
réservoirs. Ceux d'Alexandrie sont donnez du grand seig(neur) (aux) Francs, sans rien payer ; aux nactions
susdictes et leurs conseulz, ont une payée de 2000 medins tous les ans, pour l'entretien et acomodage
d'iceux ; et sont obligés à les tenir en bon estat, et les rendre logeable(s) ; à celuy de France, les conseulz a
faict bastir au dessus un tres beau loge(ment) consulaire, qui est à son seul usage et beau régalle, pour y
voir de bien loing en la mer, et voir aborder les vaisseaux, estant vis à vis de l'amboucheure du port, proche
des ruines des palais susdicts, où y a un petit yardin qu'on arouse des eaux des cisternes qui sont cinq en
nombre, dans cest anclos, car des fontaines, il ne s'en voit poinct en toute l'Aegipte de considérable. Ces
eaux se tirent avec des rouës, qu'on verse dans des auges, par des pots attachés à des cordes qui les
anvironnent, et ce vuident et ramplissent au mouvement qu'on faict de ladite roue, alternativement. Les
marchands habitans dans ces fondiques, leur estant donné le logement, ont grand soing de les randre bien
acomodés et aniolivés.
Des bazars
Du reste de la ville, ce qu'il y a de plus considérable est le bazar, comme ils apellent, ou rüe couverte, qui
est le lieu où se vandent les marchandises en destail, soit toilleries, bourts, qui sont toilles rayées de diverse
couleur, qui s'en faict nottablement en ce pais ; drogueries mesme ; ces boutiques des artisans y sont de
tous arts &, ces ruës ou basars se ferment la nuict des deux extremités ; et les marchands et artisans ne s'y
tiennent que de your, ayant leur maison ailleurs, au dedans cest enclos ; y sont aus(s)y les principaux
maguezins de marchandises requises et de prix, gardés ce qui se pratique par tout le Levant, et aux lieux où
ces bazars ne se peuvent fermer. Il y a des personnes destinées pour y fere la garde, qui respondent des
vols qui s'y pourroyent fere la nuict.
Des serrures
Toutes les serrures de ce pais sont de bois, avec nombre de chevilles de fer qui antrent en des trous faicts
en la pièce qui ferme, et, quand on veut ouvrir, on y met dans sa concavité une clef qui a aus(s)y la quantité
de cloux pour aus(s)er justement les premiers desdicts trous, et ainsy s'ouvre ; elles sont toutes differentes,
en nombre ; situation des chevilles, et grandeur et force, suivant la porte en lieu ; outre, au bezoing, y
mettent des cadenatz ; dans la ville il y a une grande ruë traversante du levant au ponant, où il y a quelques
honnestes maisons, qui sont toutes, au plus, hautes de deux estages ; et au dessus la terrasse, où se
refrechissent et dorment l’esté. Il y a plusieurs autres ruës, où abitent les chrestiens assez honeste(ment)
logés.
Des chrestiens aegiptiens
Ces chrestiens sont pour la plus part coftis : que veut dire naturels aegiptiens suivant l’opinion de Dioscore :
ignorens et opiniastres en leurs herreurs, estiment pour toute raison estre grande vertu de suivre la faute de
leurs pères et s’y attachent forte(ment) ; disent : ainsy l’avons receuë, ainsy voulons mourir. Il s’y tr(o)uve
aus(s)y plusieurs Grecs, et assès de leurs religieux, comme dirons.
De la matière des colomnes de granite
Par toute la ville, s’y voit force colomnes, et antières et rompuës, qui sont d’une mesme matière, semblable
au porphire en couleur et bigarure ; com(m)e toutes celles qui ont esté transportées de ce pais, et à Rome et
ailleurs, sont semblables, et les obélisques aus(s)y, on est en doute, où est provenu une sy grande quantité
de semblable pierre, car en toute l’Aegipte, il n’y a aucune montaigne ny manière à en fournir tant soit peu ;
y’ay eu veu disputer de personnages bien antandus, en ce faict qu’anfin, après avoir bien recherché tout ce
qui s’en pouvoyt dire, dem(e)uroyent d’accord que ceste pierre n’est naturelle, mais un meslange faict, ou
ansien ciment, de pierres fonduës ou plusieurs matières, dont s’en est perdu la manière de le faire, car il est
visible que tant d’obélisques d’une sy démesurée grandeur, estant toutes d’une pièce antaillées
d’hiéroglifiq(ues), qui ce voyent moulés dans la matière, ne peuvent estre de seulle pierre, aus(s)y bien
com(m)e tant de grandes colomnes, toutes de mesme matière, car pour ce qu’on croit que il puisse avoir
esté tiré de la Thébaïde, en ces déserts ne sy tr(o)uve aucune pierre semblable, et le marbre qui s’en tire est
bien différant, en tout, à cestuy cy, com(m)e dirons, et des montaignes du mont Sinay com(m)e de l’Arabie
pierreuze. Il est impossible qu’on puisse tirer de ceste grandeur et poix, surtout sy on y met au rang la
colomne dicte de Pompée, dont nous parlerons, qui est de la mesme matière, et qui n’a peu estre dressée
que par fonte.
De la colomne de Pompée
Hors la porte du midy, tout entre le bras du Nil où lac s’y faict de ces eaux, s’y voit ceste très grande
colomne qu’on la nom(m)e de Pompée, qu’on dict que Cézar lui donna ce nom en mémoire de ce grand
homme, pour imortalizer sa clémence, la dédiant en mémoire de son enemy. Elle est plantée sur une petite
coline, estant d’une seule pièce ; elle a sa base pied d’estail et son chapiteau très bien proportionnés. Je ne
crois pas qu’on en puisse voir une plus grande, car elle a une très grande circonférence, et son hauteur de
la force d’un traict. Les mahomettans en font un conte : dizant qu’elle fust dressée par un roy d’Alexandrie
pour rendre ceste ville inespuignable ; fezant poser sur son haut un grand miroyër d’acier qui avoit telle vertu
que tous les navires ennemis qui passoyent devant ce port, estant à l’oposite de ce miroyër, estoyent
ambrazés en le découvrant contre. Ils la nom(m)ent hemas du lator, bruslant les morts.
De l’églize patriarchal(e)
Il y a une mémoire de l’église patriarchalle de St. Marc, par ce peu qu’il en reste, qui est tenuë de ces
chrestiens coftis, ou aegiptiens, où y officient à leur mode, apuyés sur des bastons, et avec musique de
cliquetis de bois asses extrange et bien anuyante en cérémonie. Il(s) monstrent le lieu où repesoit son saint
corps qui fust enlevé des Vénitiens, et y a une croix en la cour, où il(s) disent qu’il fust descapité ; s’y voit
aus(s)y la chaise patriarchalle de se successeur(s).
De Ste. Catherine
L'église Ste Catherine en est peu esloignée, beaucoup plus belle et mieux tenuë par les Grecs, religieux de
l'ordre de St. Basile, ou caloiers. Nos François y ont une chapelle, bien ornée et servie, où on y dict messe,
et ont dans le cloistre leur cimetière, aucuns dans ladite chapelle. Tout vis à vis de l’antrée en l’église, y a
une demy colomne de marbre anchassée dans un pilier de la voutte et fermée d’un trelis de fer, sur laquelle
on dict que Ste. Catherine heust la teste tranchée. Il s’y voit ancore quelques marques de sang, en plusieurs
androicts d’icelle ; dans l’anclos qui est en carré, ces caloyers ont loge(ment) et ses comodités.
Et des Francs
Nos Francs ont chascun en leurs fondiques une églize, les Vénitiens ont, dans le leur, où, l'ospice des
Gr(an)ds Pères Observantins, de la famille de Jérusalem, où, venant de chrestienté, attandent là leur
obédiance. Les François ont une très jolie église, où officient et sonnent la cloche par privilège ; font des
processions et autres cérémonies dans l'anclos. Il y a aussy une petite église de St. Michel dans la ville, où il
y en a un très beau et ansien pourtraict estimé, qu'on n'a peu ancor tirer de là, estant gardé.
Du palais du père de Ste. Catherine
Presque au milieu de la ville, sur un lieu relevé, s’y voit les reliques d’une grande fabrique antique, que le
vulgaire croit estre les restes du palais du père de Ste. Catherine, et la plus probable opinion, des restes
d’une belle église qu’on dict avoir esté bastie sur les ruines du tample de Sérapis ; ce qu’il s’en peut dire de
plus assuré est qu’il estoit basti presque tout de briques, et en voûte, et, au dessus, eslevé en estages
d’assez grande estanduë, en carré, de très bonne masonerie. Tout au devant, qui a veuë sur la mer, y a un
mont assès haut eslevé, faict des ruines des édifices, où paroit y avoir heu plusieurs beaux bastiments dont
ce mont est composé de ses ruines, de briques &c ; on s’y va souvant promener, pour youir bien à l’aize de
la veuë de la mer.
Du mont Testatius
De mesme hors la ville, entre le vieux port et la porte du ponant, y en a un assès haut, qui est semblable au
mont Testatius de Rome, faict tout de pots cassés et taillés ; au dessus y en a une tour, où y a une garde,
qui y est pour descouvrir les voiles qui viennent et passent, pour en donner advis aux douaniers et officiers,
qui la salarient de ses diligence(s).
Du sépulcre d’Alexandre
Il se voit proche la porte de Bab-allou488, les restes d'un tample ruiné que les mahomettants honorent fort,
disant que le sépulcre d'Alexandre le grand y est, qu'ils estiment St. et prophette, et y vont en dévoction.
Le terroir d’Alexandrie est de peu de raport, estant tout sablon(n)eux. Il s’y tr(o)uve très peu de vigne, et
quelques petits yardinages vers l’eau. Les fruicts n’en valent guière ; et qui en mange imodére(ment), le faict
malade.
Des gumeiz ou sicomore
Tout ce qu'il y a de plus abondant sont ces arbres que les Arabes nomment gumeiz, de la grandeur de nos
noyers, le bois comme celluy de nos figuiers, la feuille plus petite et presque ronde ; produisent leurs fruicts
en abondance, non au bout des petites branches, à l'ordinaire, mais au gros du tronc et grandes branches,
attachées en bouquets ; ce fruict est comme nos plus petites figues, plus fermes, doucestres, de couleur
tirant sur le roux. Ils y ont au milieu la graine jaune ; la chair est ferme, comme celle des melons ; c'est le
fruict des pauvres, qui ne leur couste que cuillir ; c'est l'ausmosne que donne publiquement le Turc, parce
que tout autre arbre doibt tant pour pied ; et celuy cy ne paye rien.
Du maus, ou fruict d’Adam
Il s'y trouve aussy la plante ou arbriseau qui produict le maus, ou mous, que nous disons figues d'Adam, qui
est un fruict fort doux et gentil ; ceste plante est comme une espèce de cane, grand et grosse, qui ne faict
aucunes branches à sa tige, de l'autheur d'un homme ; son escorce semble estre cirée, vert jaune. Les
feuilles sont larges d'un bon palme et longuës d'une couldée et davantage, et sont recourbées en forme de
penaches, comme l'escolopendre tachettées mais lisses comme les canes. Le fruict vient en grape,
ordinairement trois, qui est faict comme une navette de tisseran ; a son escorce comme celle des grosses
figues, un peu plus espaisse, de la grosseur d'un sombre ; quand on le cuilit l'escorce est verte, et, mis dans
la paille, viennent jaunes ; ostant ceste pelicule, le dedans reste blanc ; et estant coupé à travers, à chasque
pièce représente très bien le crucifix ; sa saveur et bonté est très agréable, doux au possible, comme
confiture. On le nomme avec raison fruict d'Adam, tant à cauze de ses feuilles, qu'on croit soyent celles qu'il
se couvrit sa nudité, ne s'en trouvant aucune autre plus propre, ny sy grande ; mais encore de l'image qu'il
porte, qui ne se peut mieux, pour représenter le remède contre son péché qui le fesoit vergogner.
Des hermodat
La terre sabloneuze des anvirons d'Alexandrie produict les harmodattes489, qui est une racine, comme les
oignons des fleurs. Il produict l'herbe longuë, avec une fleur jaune, que sy on ne le saict bien cognoistre, il y
en a qui sont poisons fâcheux. »
- 422 - 426 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BALTHAZAR DE MONCONYS (du 1er au 31 janvier 1647)
Monconys, B. de, Voyage en Égypte de Balthasar de Monconys, 1646-1647, par H. Amer, Ifao, Le Caire,
1973.
Balthazar de Monconys (1608/1665) naît à Lyon dans une famille aisée. En 1628, afin d’éviter la peste, il
part à Salamanque pour finir ses études. De là, il projette de partir pour les Indes et la Chine, mais il doit
remettre à plus tard ses plans. Rentré à Lyon, il acquiert la charge de Conseiller du Roi. À Paris, il fréquente
l’Académie des Sciences où se réunissent les hommes les plus éminents. De 1646 à 1649, il voyage en
Italie, en Égypte, en Terre sainte et à Constantinople. Ses qualités sont si appréciées qu’il devient un
personnage célèbre. D’après son fils, Balthazar de Monconys a « plus d'inclination à pénétrer les causes, et
chercher les raisons naturelles des curiositez que son frère ramassoit avec soin ».490
p. [12]-[24] :
« Le premier janvier à deux heures du matin, nous apperceusmes le Fanal d’Alexandrie où nous arrivâmes à
huit heures du matin : je reconnus le vol qu’on m’avoit fait d’une masse de corail : M. Jordan me vint prendre
au vaisseau, & me mena chez lui au fondigue des François : le soir je fus voir une esguille carrée qui a dix
pans & demy de face, elle est à rais de chaussée, & je pense que son pied d’estal est couvert de la terre ;
elle est extremement haute, & toute gravée de Ierogliphes Egyptiens, bien entiere & toute d’une piece :
proche il y en a la partie d’une de pareille façon & grosseur, qui est ou rompuë, ou ce qui manque est
ensevely sous terre : l’on tient que le Palais de Cleopatre estoit basty en cét endroit qui est proche des
murailles à l’extremité du port.
Nous vismes plusieurs colomnes qui sont restées debout en divers lieux sur des bases quarrées de marbre
blanc, la matiere de ces colomnes & des esguilles est d'une pierre, que plusieurs personnes disent estre
pierre fonduë, tant à cause de leur matiere qui est de petites pieces rouges ou blanches, reunies avec une
matiere noire qui se froisse aux doigts, & semble estre un lien des autres pierres qui sont plus fortes &
petites, comme si on les avoit cassées ; de plus elles ne reçoivent pas un poliment parfait ; le noir varie le
tout en forme de jaspe, la grandeur fait aussi douter qu'elles soient d'une piece, quoy qu'au Mont Sinaï on
voit les places où l'on en a taillé de semblables, & il y en a encor d'autres qui sont restées imparfaites,
ausquelles il ne manque que peu pour estre taillées entierement : on me disoit cela, mais je l’ay trouvé faux
estant sur les lieux au Mont Sinai ; voyez ce que j’en ay escrit alors.
Nous vismes aussi des cisternes qui sont au dessous par toute la ville, qui est toute en l’air : il y en a de
plusieurs estages soutenuës & traversées de colomnes & de poutres de pierres : Alexandre l’avoit ainsi fait
bastir & c’est ce qui reste seulement de son temps ; car les murailles faites comme celles de Rome que
Bellissaire bastit, font juger qu’elles sont du temps des Empereurs d’Orient.
Sa figure est à peu pres d’un croissant, le terroire comme toute l’Egypte est plain & bas, la Mer forme un port
en croissant, dont les deux bouts sont garnis de deux forts, celuy d’Occidant ou de main droite en entrant
nommé Farissor, est joli à l’antique, où l’on dit qu’il y a force artillerie : les murailles de la ville sont doubles &
chasqu’une est toute faite en petites voûtes les unes sur les autres, & de 50 en 50 pas il y a des Tours,
rondes & d’autres quarrées à toutes les deux enceintes : les portes avoient beaucoup de grandeur & de
majesté, mais il n’y a plus rien que de vilains restes de quelque chose de beau : toutes les maisons sont
rompuës, & ne sont que de petites pierres quarrées & de bois, avec des terrasses au dessus ; pour des
fenetres il n'y a que des trous & rarement des treillis de bois, qui sont les seules grilles des mosquées ; les
serrures ne sont aussi que de bois, si bien qu'on ne les sçauroit connoistre sans les grands clochers ou
tours qu'il y a au dessus avec quelques potences de bois, & le tout blanchy comme des colombiers : il y a
trois ou quatre montagnes dans la ville faites des terres qu’on a tirées des cisternes qui s’estoient comblées,
elles sont remplies d’un bras du Nil nommé le Calis.
Le 2. Je fus boire du cavé491 avec M. Locussol Chancelier. Je m’allay promener à la marine, où est le port
tousjours plein [p. 15] d’une infinité de basles de lin, & de cuirs salés, qui est le plus grand commerce avec
du Natron, qui se fait à un lac proche S. Macaire. M. Locussol me donna trois médailles ; nous fusmes
accompagner Mrs. Matriche & Mathias Palbiski de Nemits en Pomeranie, qui alloient au Caire, jusqu’à une
portée de canon hors de la porte de Rousset sur des asnes : il y a sur le panchant d’une petite eminence qui
est de terre une Idole au haut du grand chemin qui est une Venus de marbre blanc, dont le visage est
presque tout mangé de l’air ; nous passasmes par le Bordes qui est un lieu horrible.
Le 3. Par curiosité je fus le matin voir un santon pour apprendre des nouvelles de mon valet : l’apresdiné
chez un Juif qui me promit de me donner toute satisfaction ; je vis des pierres gravées & des medailles.
Le 4. Je fus le matin chez le Juif qui m’ordonna l’abstinence des femmes, des bains & du porc. Il me leut un
manuscrit Hebreu où il disoit qu’il y avoit trois herbes.
Lenaria, que je crois être Linaria, Bocabathla, qui estoient griffonnées en forme de Lunaria minor, &
Pigadiora, & que chasqu’une avoit la vertu de congeler le 492.
J’eus ma veste qui me cousta deux piastres.
Le 5. Je pris chambre au Fondi, & fis marcher avec M. Mouton à sept piastres le mois : j’escrivis au Caire &
l’apres[di]né je vis un de ces Eschillons en l’air ; c’est une nuë noire d’où sort une queuë tres-longue qui va
diminuant par le bas & semble à une trompe d’Elephant : je fus voir Hibrain ; il fit fort froid le soir & grand
vent. Le jour je fus Roy.
Le 6. Il fit fort & plût comme il avoit aussi fait le jour precedent : j’oüys Messe au Fondi, puis fus chez Hibrain,
& l’apresdiné aussi. Il tient493 la transmigration des ames, toutes les loix bonnes, & que l’on ne peut périr ;
mais qu’il faut que les ames se purgent, & qu’il n’y a que les nettes qui ne retournent point au monde, que
les Anges sont moins que les hommes, & que la vertu des parfums faisoit descendre les Anges, qui ne sont
que feu, sur les victimes.
Le 9. Hibraim eust les parfums, & je n’y demeuray que peu le matin : en y allant M. Estienne Cheron
Chirurgien de nostre vaisseau me donna les noms de ceux du vaisseau, mais on me renvoya jusqu’au
l’endemain. M. Guillenc me dit :
Que les aloës qu’il a dans sa chambre y estoient depuis 7 ans, qu’ils croissent pendus en l’air, qu’estant
cuits à la braise & mis sur les bubons, poulains, & cors, c’est un remede souverain, & que les sorciers ne
pouvoient rien dans les maisons, où il y en avoit ; les Arabes les apportent.
J’achetay 4 pierres de Sainte Marie, un oeil de vache un quart de piastre.
Le 10. Je fus le matin porter les noms qu’il enveloppat & mit dans de petites boules de farine de mesme
poids, & puis les jetta dans une écuelle pleine d’eau qu’il remuoit parfois avec le doigt, disant tou haut un
assez long-temps des mots arabes ou Barbares, inconnus, & six billets vindrent en haut estant sortis de leur
enveloppe ; il en resta en bas d’autres sans estre developpés, & le reste enveloppé. L’apresdiné je fus voir
un autre Arabe pour le mesme sujet, qui me promit de me satisfaire : le soir j’écrivis en France, & à
Ligourne494, par Arnaud Bitori : j’achetay une ametiste où est gravée un Silene 3 quarts de piastres.
Le 12. Je fus en marine voir entrer un vaisseau : l'apresdiné je fus voir les Tours des murailles, proche
lesquelles sont une infinité de voûtes les unes sur les autres, & le milieu est ouvert, si bien que les voûtes se
soutiennent en une Tour sur un seul pilier qui est au milieu, & en l'autre sur 4 je remarquay qu'entre le pied
d'estal d'une colomne & la frise de l'autre, ils mettoient de grosses pieces de bois quarrées en croix jointes
ensemble avec de gros clous, & dans leurs murailles de toise en toises des planches de bois : il y a grande
quantité de colomnes rompuës en Mer : Delà je fus vers le Turc qui me remit en longueur, à deux heures
après minuit 3 Mores ou Turcs vindrent voler le Fondi, me tindrent le poignard à la gorge & me pindrent
jusques à mon matelas, puis se sauverent.
Le 13. Je fus si-tost que la porte fut ouverte chez Hibrain qui ne me satisfoit point sur mes pertes, & que ce
Turc me renvoya : l’apresdiné je fus à l’Hospice, où les Peres me presterent un matelas et une couverte, & je
couchai chez M. Coral : l’on prit 3 Bedoins soupçonnés du vol.
Le 15. Je pris quelques Alphabets d’Ibbrain, & achetay un bonnet 32 medains, & l’apresdiné une veste trois
piastres. M. Guillon qui me dit que pour arrester la ch. p.495 il falloit.
Boire au matin une demy escuelle de jus de plantin, & continuer trois matins, & laissant un jour de repos
entre-deux, & si l’on veut on le clarifie ou bien on y met un peu de sucre.
Le 16. Il pleut tout le jour plus qu’il n’avoit fait le precedent ; les Mores commencerent la Feste qu’ils
celebrent du Sacrifice qu’Abraham fit d’Isaac, & tiennent que ce fut Ismaël lequel est leur Prophete. Ils font
des escarpolettes dans les places ornées de feüillages, où des jeunes garçons se branlent496. Je fus chez
Abrain, où luy & un autre me dirent leurs croyances, ou plustost leurs blasphemes de Jesus-Christ & de la
Vierge, à sçavoir.
(…)
Le 17. Comme toute la nuit, il plût de mesme tout le jour avec tourmente, gresle & esclairs ; le Soubachi le
soir vint faire la ronde, comme il avoit fait le soir precedent autour de nostre fondigue ; au dehors duquel il
s’enfonsa dans la terre plus de 12 pieds.
Le 18. Le mesme temps continua, tous les logis estoient en eau. Il faisoit fort froid & comme le jour
precedent je demeuray au logis.
Le 19. Ayant plû toute la nuit, il plût encor beaucoup le matin. L’apresdiné je fus à la chasse au Calis : c’est
un canal qui est tout pavé dans le fond, & dont les bords estoient autrefois garnis de bastimens, & d’espace
en espace il y avoit des lieux comme reservoirs qui se remplissoient, & d’où par le moyen des norias l’on
donnoit de l’eau aux jardins & maisons prochaines : il y en a encore un qui va jusques dans Alexandrie,
lorsque le Nil (d’où vient la dite eau) est creu, & de ce conduit toutes les cisternes d’Alexandrie se
remplissent pour toute l’année : ce canal se descharge dans la Mer. Je vis en passant la colonne Pompée.
Le soir Don Mathieu Evesque de Chrysopoli, vint du Caire pour passer à Rome.
Le 20. Apres la Messe je fus en marine avec M. de Guillenqui : puis voir Hibrain qui me dit que Isaac Leon,
truchment des Anglois au Caire estoit tres-habille homme, & qu’il faisoit la transmutation de l’argent en or,
mais frangile. L’apresdiné je fus avec les Peres voir l’obelisque & mesuray les colonnes qui restent proche
nostre Fondi, qui ont 11 pieds de circonférence.
Le 22. Je fus le matin chez Hibrain : au retour je sceus que le vaisseau Flamand estoit venu de Marseille &
l’on envoya les lettres au Caire ; la nuit les voleurs nous donnerent la peur.
Le 23. Je fus le matin chez Hibrain : l’apresdiné en marine & aux Basars voir toutes les boutiques parées de
leur plus beaux meubles & carreaux, avec quantité de lampes qui esclairent toute la nuit ; les fondigues
aussi parés : & le soir l’Aga du Bacha, le Soubachi des Janissaires, & celuy du petit Chasteau les vindrent
visiter, & l’on leur offrit du café, & du sorbet & à leurs gens. C’estoit une réjoüyssance qu’ils appellent Zine,
pour la prise de Retimo en Candie497 : l’on m’offrit à acheter une des choses que l’on m’avoit volé, mais
Laurens Vice-consul, ne voulut pas m’assister pour le recouvrer.
Le 24. J’acheptay une pierre 6. medains : puis fut en marine. L’apresdiné chez Hibrain & au retour j’ecrivis
en France ; la feste des Turcs dite Zine, dura encor tout le jour & la nuit.
Le 25. Je fus le matin chez Hibrain, qui me dit.
De passer une esguille dans un corps mort pour gagner au jeu.
Puis j’eus lettres du Caire ; l’apresdiné j’entretins un Juif qui me fit une ridicule instance contre la volonté que
Jesus-Christ eust de mourir apres qu’il l’eut injurié & deshonoré à cause qu’il dit Eli, Eli, &c.
(…)
Le 26. Je demeuray le matin au logis : l’apresdiné je fus mesurer la colomne de Pompée, qui est à portée
d’un mousquet de la ville, sur un petit cube de massonerie de seize pieds en quarrée, et de deux pieds de
haut, sue lequel est un autre quarré de pierre de taille, qui sert de pied d’estal à cette colomne, & qui a onze
pieds trois pouces en quarré, & douze pieds de hauteur ; & sur cela est la colomne d’une piece, de cent
treize pieds & cinq pouces, & de huit pieds de diametre ; qui font vingt-cinq pieds un pouce & huit lignes.
De là je fus mesurer l’esguille, qui a cinquante-huit pieds six pouces, & a sept pieds en quarré en bas : puis
je fus sur la Montagne de terre rapportée qui est au milieu de la ville, d'où elles se descouvre toute ; & il n'y a
plus que quelques petites maisons de Coftis en deux ou trois endroits, tout le reste estant en bosse de
cimetiere : toutes les murailles doubles s'y vont aussi ruinant, quoy que le circuit y soit encore & toutes ces
tours, mais ruinées. On passoit dessous entre les deux murailles, & outre ce l'on alloit sur les murailles à
couvert des creneaux : la ville est fort longue & beaucoup moins large. A present on bastit dehors à la
marine sur une langue de terre qui separe le port neuf du vieux. Apres j’allay au jardin de Cassan Bacha, qui
n’est qu’un meschant potager des nostres.
Le 27. Je fus à la petite & basse Eglise de Saint Marc tenu par les Coftis, où est la chaire de Saint Marc, à
huit faces, de pieces de marbre raportées, qui est fort peu de chose : puis chez Hibrain, & au retour je
trouvay Martiche arrivé du Caire avec Monsieur Mathias Palbiski. L’apresdiné je fus voir la Marine avec
Monsieur de Guillenqui, qui me pria de luy donner mon sentiment de la Creation du Monde, & de luy
communiquer le discours que j’en avois fait au General Portugais en presence de mes amis, de quoy je luy
avois parlé.
(…)
Le 28. Je fus tout le matin en marine : l’apresdiné j’y retournay & achetay une Agate d’un Juif 28 medains,
une ceinture, & 19 pierres gravées 4 piastres.
Le 30. Je fus le matin en Marine où Olivier valet de Monsieur d’Antoine Vice-Consul de Rousset, me donna
l’envie d’aller au dit Rousset par Mer, pour voir l’embouchure du Nil, qui entre dans la Mer plus de 6. milles
sans mesler son eau, qu’il conserve douce au milieu de la salée, ce que plusieurs autres François me
confirmerent estre vray & l’avoir eux mesme esprouvé : neantmoins à cause du danger qu’il y a en cette
embouchûre à cause d’un banc de sable mouvant qui diversifie tous les jours l’entrée, & que chasque année
il s’y pert plusieurs hommes ; je changeay de volonté, M. Lescussol me dit :
Que les pommes de cedre avoient cette propriété d’empescher que les artes ne mangeassent les habits
dans les garderobbes où l’on mettoit de ces dites pommes.
Je m’estois levé deux heures avant jour & empaqueté mes coraulx.
Le 31. Je fus le matin en marine acheter une boëte 7 medains : l’apresdiné je fus sur la Montagne qui est au
bout presque de la ville du costé de marine, d’où j’observay mieux le plan de la ville.
Le soir je mis par escrit mes remarques de l’accroissement du Nil, que je coucheray icy en mesmes termes
que je les escrivis dix ou douze ans apres à Monsieur Bernier en Egypte. »
- 427 - 430 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MARIANO MORONE DA MALEO (1647)
Morone da Maleo, M., Terra Santa nuovamente illustrata, Piacenze, 1669-1670.
Le frère Mariano Morone da Maleo de la province de Milan est commissaire apostolique en Orient. Sous ce
titre, il séjourne en Égypte en 1647. Il est également à la tête de la communauté de Jérusalem de 1651 à
1658.498
p. 460-465 (t. I) :
Della famosa città d’Alessandria
« E’ commun parere de’ scrittori, e particolarmente di Plinio lib. 5 cap. 10 che la città d’Alessandria havesse
l’origine da Alessandro Magno, che dal suo nome la chiamo Alessandria, & in corrispondenza del Gran
Monarca, riusci appunto maestosa la città, e forte di maniera, che Amiano lib. 2 ardi chiamarla cima delle
cittadi, & Herodiano oso dargli il primo luogo doppo Roma ; e dalle reliquie rimaste, e ruine, che si vedono a’
Monti, fra le quali si camina le miglia, ben si conosce quanto fosse ampla ; la cinse quel Rè con fortissime
mura, armare con Torrioni, che furono rispettate da Cesare Imperatore, & da altri ancora per honore dell’
Autore.
Era questa fabricata e sotto, e sopra terra, e forsi sotto habitavano le cittadini nell’Estate per iscansare il
gran caldo, che vi regna, & il verno sopra : distrutte poi l’habitationi superiori, e fabricata la nuova
Alessandria, tra la vecchia, & il Mare, gli habitatori si servirono di quei luoghi sotterranei per cisterne,
facendoli riempire d’acqua nel crescente del Nilo, quale si rischiara, e rinfresca, onde non v’è città, che beva
cosi bene.
In questa Alessandria nuova tocca di sopra, sono alcuni diversorri, ove habitano Francesi, Veneti, Inglesi, &
altri Mercanti d’Europa Catolici ; quali sono serviti da’Padri nostri loro Curati, che habitano in un’Hospitio
entro la città vecchia distrutta ; come anche fanno li Greci Religiosi, e Gofti : li Francesi pero hanno il
cappellano frate nostro, appresso nel loro diversorio.
Fu Nido de’Regi, ove fra gli altri tenne il Scettro, quel Savio Tolomeo Filadelfo, che l’amplio, & assicuro con
una fortezza a mare, alla quale si passava per un Argine, o ponte di 7 stadii : e quivi dalle settantadue
Interpreti separati l’uno dall’altro in 72 giorni fece tranlatare la Bibbia, cioè Testamento vecchio, e riusci una
sola translatione. Alzovi appresso questo Rè una Libraria, nella quale congrego da cinquantamilla libri, cosa
veramente notabile, tanto piu per non essere in quei tempi invio la stampa, e questo scrive fra (p. 461) gli
altri Gioseffo Hebreo nel Lib. 12 dell’Antichità cap. 2.
Hoggidi non si vede questo luogo in essere, vi se trova ben si il porto di mare assai amplo, capace d’ogni
legno, e guardato all’Occidente dal Castello, e dall’Oriente da una Torre armata, ove approdano Vascelli
d’Europa con mercantie, per le quali il Turco ne cava un Dacio grossissimo.
Altre volte dal Nilo sotto al Cairo, usciva un canale, che portava acqua a questa città tutto l’anno, ma hora
essendosi riempiuto di terra, solo fà questo nel crescente del fiume. V’era appresso una strada piu corta che
andava da qui al Cairo per il Deserto, ma hoggidi non si usa per tema de gli Arabi, ma si va al mare, a mare
sino a Rosetto, strada di 40 miglia e paese arido, eccetuatone un poco vicino ad Alessandria, & inhabitato,
nè altro si trova, che una moschea, e certo piccolo diversorio, ove habitano alcuni pescatori, che con nave, o
porto traghettano li passagieri, oltre ad un canale, o fiume qual’esce da un lago, e sbocca in mare, e qui
pigliano pesci cesali innumerabili da quali cavano la Bottarga, e poi li salano ; verso Rosetto non si vede se
non campagne d’arena, con certi pilastrelli senza molta, che servono a viandanti per guida dovendo
caminare a drittura di essi, altrimente profondariano nell’arena stessa, nè meno devono fermarsi quivi di
notte, perchè il vento alle volte porta tanta arena, che li sepellisse. Da Rosetto poscia al Cairo si va per
acqua.
Delle Chiese di Alessandria
Mentre, che la città d’Alessandria fu posseduta da’Cristiani Catolici, fiori in Santita, e pero anche da pietose
mani vi furono alzate molte chiese, che da’Saraceni poscia vennero con la città distrutte, da tre sole in poi,
che rimasero in piedi a consolatione de’Fedeli.
La prima, è quella di S. Marco Evangelista posseduta, & officiata da Gofti, ove pero li Mercanti nostri hanno il
ius di sepellirsi, e farsi celebrar la messa, acquistatosi con esser concorsi alla restauratione della fabrica ; e
vi guadagnano l’Indulgenza di sette anni.
Li medesimi Gofti mostrano in detta chiesa un pulpito di pietra viva & ornato di marmo & affermano che
sopra di esso predicasse (p. 462) S. Marco, che pero è tenuto in veneratione per honore del Santo che pure
quivi fu sotterrato, e sin’hora si riverisce il di lui Sepolcro, entro del quale riposo dall’anno 45 di Christo, sino
all’ottocentoventi, quando che fu translato in Venetia, come nota Baronio all’anno sudetto 3 & 11 onde l’anno
699 passato cola S. Arcolfo, vi trovo ancora il Santo interrato come attesta Adamnano, che descrisse
appunto il sito, e chiesa, come pur’hora si ritrova, dicendo : Item de parte Aegypti advententibus, & urbem
intrantibus Alexandrinam, ab aquilonari latere occurrie grandis Ecclesiæ constientio, in qua Marcus
Evangelista humatus iacet, cuius Sepulcrum, ante Altare in Orientalem eiusdem quadrangula loco Ecclesiæ
memoria superposita marmoreis lapidibus constructa monstratur ; e non erra lo scrittor, con dire, che quella
chiesa fosse grande, trovandosi appena degna di essere annoverata fra le mezane ; perche in quei antichi
tempi che fu alzata, li Christiani erano poveri, e pero impotenti a fabricare sontuosi Tempii, perilche il sudetto
potevasi dire de’maggiori.
Questo Santo Evangelista fu Hebreo di natione, & uno delli 72 Discepoli di Christo, spedito da S. Pietro in
Egitto a predicare il Vangelo, che egli medesimo scrisse ; ove doppo di havere prima di ogn’altro esercitato
la carica di Patriarca 19 anni, morte lui Martire, come ne fanno sede S. Girolamo, Baronio all’anno 64 T
primo ; e li Greci nel loro Menologio, che distesero il di lui martirio, come qui sotto vedi : Marcus primus
omnium Alexandriæ Christi annuncians Evangelium, cum instituisset Ecclesiam Alexandrinam, insuper &
alias Collegisset ex Lybia, Marmarica, Pentapoli, & Armoniaca-Regione, Thebaide, ac universa propè
Aegipto, tandem Dominico die cum Missam ageret, Gentiles in eum irruentes atq. tenentes, ligato fune ad
collum eius trabebant eum raptantes per faxa ad locum Buco I, iuxta Mare ; sicque carne eius undique
lacerata, atque contusa, penè spiritum redditurus in carcere detrulus, apparente sibi Domino cum Angelis, ad
futurum certamen instauratur. Mane autem facto, rursum de carcere eductus, pariter, ut ante per scabra loca
perir actus, cum ageret Deo gratias, atque diceret ; In manus tuas Domine commendo spiritum meum,
impollutum Deo reddidit ipsum spiritum, sepuliusque est cum honore a discipulis eius. Al presente non si
nota precisamente il luogo del martirio di questo Santo, ma dalla parola Bucoli, si congettura sis quei terreno
vicino al Mare, che si trova all’Oriente della città ; atto a placere li Bovi o Vitelli, che s’uccidevano ne’Macelli ;
perche Strabone lib. 7 vuole, che quella parola Bucoli, derivi da quest’altra Bubricis ; Bisolchi, (p. 463) che
curavano gli animali come si disce ; e vaglia il vero, che cola intorno alla città non si vede altro terreno piu
atto a questo servitio.
La seconda chiesa è quella dell’Arcangelo Michele, officiata pure da Gofti, quali mostrano quivi un’Imagine
della Santissima Virgine dipinta (dicono essi) da S. Luca ; ma io ne dubito assai perche questa è molto
dissimile dall’altre dipinte dal medesimo Santo, che si trovano autentiche in Roma, & in Venetia, e le
osservai io diligentemente.
La terza chiesa è dell’Infante Reale S. Caterina Vergine e martire posseduta da Greci, con il convento
annesso, ove habita il loro Patriarca e 25 calogeri ; fu prima detta chiesa di S. Saba ma poi di S. Caterina
con maggior ragione, perche quivi fu decollata la Santa ; in fede di che mostrano ivi una base di colonna,
con alcune macchie de sangue, sopra della quale fu piantata la Ruota, che doveva fare in pezzi il purissimo
corpo della Virgen ; o per dir meglio, ove gli fu troncato il capo : si perche da sani intelletti, quel falso è
giudicato incapace di sostenere una machina quale era ruota ; come anche per le gocciole di sangue, che vi
si vedono ; stante che, ove fu la Ruota non sparse sangue, ma ben si ove fu decollata.
Vicino alla detta pietra, li Signori Mercanti Veneti hanno una Capella, nella quale ben spesso fanno celebrar
la Santa Messa da nostri Religiosi, come pure vi celebrai io l’anno 1647 a sette di Luglio quando quivi da
Livorno approdai in 13 giorni passando la seconda volta a Gierusalemme ; e vi si guadagna l’indulgenza di
sette anni, e non molto lungi di qua si vedono le reliquie del Palazzo della Santa si grosse, che
ben’argomentano quanto fosse maestoso.
D’alcune cose curiose di Alessandria
Fra l’altre curiosità, che si vedono in Alessandria sono due belle Piramidi, l’una stessa per terra, e l’altra in
piedi, alta palmi Romani 116 e larga nella base dieci, misurata da Valesio l’anno 1556 sono amendue tutte
scolpite con lettere e gieroglifici in idioma Gostose ; e dicono esservene dell’altre, ma sepolte nell’arena.
La seconda curiosità che ivi pure s’ammira fuori della città mezo miglio è la Colonna di Pompeo, tutta d’un
pezzo di porfido è di circonferenza braccia sedici, & alta a proportione, e vedesi in piedi (p. 464) sopra il suo
piedestalo, machina in vero conspicua.
Alcuni vogliono si dichi di Pompeo, perche questi quivi fu vinto da Cesare ; ma se questo folse, doveria piu
tosto nomarsi Colonna di Cesare ; come che a Cesare si doveva il trionfo e poi Pompeo non morse qui, ma
in Damiata tradito da Aquila, e Fotino, per opera di Tolomeo, e pero la Colonna, cola piu tosto si doveva
alzare per troseo ; rispondono, con tutto cio altri, che difendono l’opinione, che quivi non morse veramente
Pompeo, ma ben si fu presentato a Cesare il di lui capo, quale come clementissimo vedutolo, si diede a
piangere dirottamente, ordinando fosse ivi sepolto, e alzata la colonna in memoria ; il che hà piu del
credibile.
Li Greci sognano, che si dica di Pompeo perche fu fatta per comando di suo padre, ma non trovandosi
Ingegniere alcuno a chi bastasse l’animo d’alzarla sopra la base ; per il che molto si lagnava, il Figlio
compassionandolo, una notte con li suoi schiavi, l’alzo ; sogno (diffi) impercioche Plutarco accuratissimo
scrittore de’fatti illustri di Pompeo, non haverebbe trascurato questo, quando ne scrisse de’piu inferiori.
Io per me darei piu tosto sede, a quanto scrissero Pietro Appiano, e Bartolomeo Porta499 nell’Inventioni della
Sacrosanta Antichità in Idioma Greco, che questa Colonna alzata da Democrito famosissimo Architecto per
ordine del sudetto Monarca ; che pero v’aggiunsero la seguente inscritione.
In Alessandria Aegypti in Columna miræ magnitudinis
DEMOCRATES
PERICLITUS
ARCHITECTUS ME
EREXIT IUSSU
ALEXANDRI
MACEDONUM
REGIS
Non si nega pero, che in progresso di tempo la colonna pigliasse diverse denominationi ; come di Pompeo
per havervi Cesare fatto sepellir li vicino il capo di Pompeo medesimo &c.
Si osservano finalmente per la terza curiosità, le riune indicibili dell’antica Città, fra le quali si trovano certe
pietruccie, come di (p. 465) Agata con lettere antiche scolpite, che penso servissero per sigillo legate ne gli
Anelli, e veramente sono belle. »
- 431 - 433 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇOIS LA BOULLAYE LE GOUZ (1650)
La Boullaye Le Gouz, F., Les voyages et les observations de sieur de la Boullaye le Gouz, gentilhomme
angevin où sont décrites les Religions, Gouvernements, & situations des Estats & Royaumes d’Italie, Grece,
Natolie, Syrie, Palestine, Karamenie, Kaldée, Assyrie, grand Mogol, Bijapour, Indes Orientales des
Portugais, Arabie, Egypte, Hollande, grande Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, Isles & autres lieux
d’Europe, Asie & Affrique, où il a séjourné, le tout enrichy de Figures, Paris, 1653.
François La Boullaye Le Gouz naît à Baugé (Anjou) vers 1616. En 1643, il se rend en Angleterre pour offrir
ses services au roi Charles 1er. Ensuite, il projette de parcourir le monde et va jusqu’à Rajepour où le
gouverneur hindou le met en prison. François La Boullaye s’embarque pour Bassora en 1649, puis passe
par la Syrie et l’Égypte avant de regagner l’Europe. À Rome, il remet au cardinal Capponi les lettres que le
patriarche maronite du Mont-Liban lui a confiées. Le cardinal propose de l’engager comme cosmographe
apostolique, mais à la nouvelle de la mort de son père, François La Boullaye rentre en France. À Paris, le roi
qui a lu le journal de ses voyages l’invite à se présenter à une audience vêtu de l’habit persan. En 1664, la
compagnie des Indes envoie François La Boullaye auprès du Grand-Mongol et des rois des Indes, mais
notre voyageur meurt à Ispahan la même année.500
p. 370-375 :
« Alexandrie que les Turcs appellent Iskendria, prend son nom d’Alexandre le grand Macedonien qui
ordonna qu’elle fust bastie, d’où l’on peut inferer son antiquité, elle a esté saccagé par plusieurs nations, les
Romains l’avoient un peu réparée, mais par le differend des Croisez & des Mansulmans, elle a esté ruïnée
de fond en comble, & ne reste que les cysternes qui ont communication les unes aux autres, & sont aussi
grand nombre qu’il y avoit de maisons dans cette ville, l’on devroit plutost l’appeller le lieu où Alexandrie
estoit, parce qu’il n’y reste de tous les magnifiques Palais que quelque ruïnes, & vieilles colomnes à demy
consommées par le temps, avec l’enclos de ses murailles, qui peuvent avoir une lieuë & demie de tour,
lesquels se sont concentrées en leur entier avec les tours, & les bastilles qui estoient faittes à l’espreuve du
belier, où i’ay remarquay qu’aux divers estages l’on a mis des colomnes de marbre renversées au lieu de
poutres, lesquelles desbordent d’un pied hors la meuraille, afin que l’on ne la pût sapper ny brusler.
Il y a deux ports, celuy des galleres est au Sud, & celuy des vaisseaux au Nord, lequel est fait en forme de
croissant : A ses deux cornes il y a deux petits pharillons ou chasteaux, dans lesquels il y a desux ou trois
petites pieces de canon qui ne sont pas montées, de façon que ces deux chasteaux que l’on a descrit
prodigieux, ne pourroient pas tenir contre deux galleres ; il est vray que le lieu est tres beau pour y bastir
deux belles forteresses, mais les Turqs n’édifient iamais rien, se servant de ce qu’ils trouvent tout fait &
fabriqué, & pleust à Dieu que les Princes Chrestiens en conneussent la foiblesse, & eussent tous les zele de
S. Louys pour l’accroissement de leur Religion.
Il y a plusieurs Iuifs, Grecs, & Coftes qui habitent cette ville ; les Coftes sont Chrestiens Schismatiques, &
tiennent les mesmes erreurs que les Armeniens, Iahoubites & Ethiopiens, suivans en tout l’opinion de
Dioscore, & Eutiches, que nous avons descrite au Chap. 41 de la 1 Partie ; & au Chap. 58 de la 2 Partie.
Raretez d’Alexandrie. Chap XIII
L’on voit une piece de marbre blanc dans Alexandrie de quinze poulces en quarré, percée au millieu, sur
laquelle fut tranchée la teste de Saincte Catherine, par le commandant de l’Empereur Maximin ; & proche
l’Eglise des Grecs où l’on garde cette rareté, sont les ruïnes du Palais du pere de cette Saincte, laquelle
prefera les choses Spirituelles aux temporelles, & abandonna les delices de la ville d’Alexandrie pour aller
ioüir de la presence de son maistre, lequel estima si peu les pompes de ce monde qu’il ne daigna se
deffendre ny respondre devant Pilate, de l’accusation que les Iuifs avoient faussement intentée contre sa
personne.
L’on y voit aussi les vestiges du somptueux Palais de Pompée, que quelques uns disent avoir esté de
Cleopatre, il n’y a pas de difficulté que ceux qui n’avoient qu’une volonté, n’eussent qu’une demeure, ce qu’il
y avoit de plus remarquable en ce Palais estoit une gallerie de colomnes, sous laquelle ces deux amans
alloient se promener à couvert de la pluye, & du Soleil sur une gallere ; de cette gallerie il ne reste que
quelques colomnes dans la mer.
L’air de cette ville est extremement mauvais pestilentieux, à cause de la qualité des cisternes d’où sortent
des vapeurs grossieres, que le Soleil esleve facillement, à cause qu’il n’y a plus de maisons, & en infecte
l’air ; l’on n’y peut habiter que l’hyver, si l’on n’y veut mourir : hors la ville il y a de beaux iardins vers le Kalis
ou chaussée, que l’on coupe pour faire emplir les cisternes d’eau, lors que le Nil est en son Plain ; il y a dans
ces iardins beaucoup de caffiers, mais non en si grande abondance, qu’à Damiette.
Proche le port d’Alexandrie l’on voit deux aiguilles remplie de lettres hieroglifiques d’une prodigieuse
longueur, dont l’une est couchée, & l’autre est droicte d’une seule piece ; elle a douze pieds en chacun des
costez de la base, qui font 48 pieds de tour, & 60 pieds de haut, de façon que la superficie de sa base est de
30 pieds en quarré, & la superficie dans l’air est de 360 pieds en quarré, sa circonférence de 36 pieds, & son
solide total de 600 pieds cubes d’une seule pierre. Hors la ville du costé du Su Suouest à un demy mille des
murailles, l’on voit la colomne de Pompée, que l’on dit que Iules Cæsar luy fit eslever apres sa mort.
Elle est de marbre pastiche ou fusible, comme l’on dit assez improprement, dont l’on pretent avoir perdu le
secret, elle a trente pieds en rond de circonference, & 70 pieds dix poulces de haut sans le pied d’estail, elle
est d’une seule pierre, son diamettre est de neuf pieds dix poulces, sa superficie exterieure de 2400 pieds
en quarré, & son solide est de 6000 pieds cubes.
[p. 374 : gravure de la colomne de Pompée et d’une aiguille hieroglifique.]
Dans Alexandrie il y a deux montagnes artificielles, qui ont esté faites de la terre que l’on tiroit des cisternes,
lors qu’on bastit cette ville, l’une est à l’Est, l’autre à l’Ouest, & servent aux vaisseaux pour remarquer la
coste d’Egypte, & aux Egyptiens pour descouvrir les vaisseaux Corsaires.
De la Religion des Iuifs. Chap. XIV
Je ne dois pas obmettre que dans Alexandrie il y a quantité de Iuifs, lesquels comme par toute l’Egypte, y
font la meilleure partie du negoce, & comme ie n’ay voyagé que pour voir & prattiquer les plus habilles gens
des lieux où le sort ma porté, i’ay eu plusieurs conferences avec les Rabis de Smirne, d’Hispahaam, Alep &
le Kaire, ie frequentois en Alexandrie un Docteur appelé Aaron Ben Levy, qui signifie Aaron fils de Levy natif
de Barbarie de parents Portugais, homme sçavant, & de grande probité, lequel s’en alloit à Constantinople
sur l’un des gallions du Sultan & attendoit son passage en Alexandrie, ie luy fus dire adieu à mon depart
d’Egypte, & ne veux oublier un dialogue de la Religion des Chrestiens & des Iuifs que nous eusmes à nostre
separation. »
500 Eyriès, J.-B., « Gouz, François de la Boullaye Le », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.),
Biographie Universelle ancienne et moderne 18, Paris, 1817, p. 216-217.
- 434 - 435 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MUḤAMMAD B. ‘ABD ALLĀH AL-ḤUSAYNĪ AL-MŪSAWĪ (première moitié du XVIIe siècle)
Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Ḥusaynī al-Mūsawī, Kabrīt, Riḥla al-šita’ wa al-sayf (1012-1070 H), Beyrouth,
1965.
L’auteur, né à Médine, vit sous le règne d’Amurath IV, vers 1630. Il accomplit d’abord le pèlerinage à
La Mecque avant de visiter l’Égypte, Constantinople, l’Asie Mineure et la Syrie.501
Remarque : texte incomplet.
p. 111-119 :
« J’embarquai sur le Nil sur un petit bateau en direction d’Alexandrie. Nous restâmes à al-Burǧ pour
s’enquérir des vents (p. 112) annonciateurs d’espoir. Al-Burǧ se trouve dans une palmeraie, au bord du
fleuve. Le Nil le relie à la Méditerranée. On a dit à son propos :
Le Nil et la mer viennent à la rencontre l'un de l'autre tels deux rois au milieu de leurs troupes.
[...]
Quand le soleil se leva, les vents d’est se mirent à souffler. Nous étions à peine partis que nous pénétrâmes
dans une mer déchaînée, les vagues s'entrechoquant les unes contre les autres, à notre effroi et grand
malaise. Comment aurait-il pu en être autrement ? Celui qui prend la mer est perdu et celui qui en revient est
comme un nouveau-né.
Poème
Les vents en colère juraient de nous transmettre (p. 113) l’agitation de la voile. L'inquiétude couvrait nos
âmes et nous transperçait les entrailles. Les sensations de ces événements sont des blessures. Il semblerait
que nos esprits se soient éparpillés. Le coeur remue dans l’ardeur de la peur.
Poème
Au coucher du soleil, nous jetâmes l'ancre sur la côte d’Alexandrie. Notre humeur était sombre à cause de
cette frayeur et de cette mauvaise situation. Nous passâmes la nuit sur cette côte jusqu’à ce que nous nous
réveillassions dans un brouillard qui empêchait de voir ces maisons.
Poème
Lorsqu'il fit grand jour, nous allâmes vers ces maisons. J’y restai sans avoir quoi que ce soit et sans
connaître mon chemin. Je me promenai tout autour et ne vis que des amas du côté ouest, alors j’y allai
déambulant, me déplaçant sous ses ombres, mais [la ville] me repoussait et me ferma les portes de la
sérénité.
Poème
J'avais entendu d'après des expériences antérieures que le voyage est le miroir des merveilles, jusqu’à ce
que je vis que le temps entier est [composé de] merveilles. Il ne me reste plus d’étrangetés à désirer voir.
Poème
Je restai encore à Alexandrie sans compagnon et sans ami intime vivant dans la solitude et la tristesse en
pensant au jugement du Créateur matin et soir. Je n’y trouvai pas d’ami parmi les personnes dotées de
perfection, ni ne rencontrai de compagnon qui se pare d’actions vertueuses.
(p. 114) Poème
Tantôt je restais enfermé, taraudé par l'esprit malin, tantôt je sortais au grand jour, au milieu de la foule. Je
ne trouvais sur la côte que des Chrétiens et des Juifs. Je ne voyais que des Barbares et des Turcs en
délégation. Je revenais alors vers cet endroit retiré et je me rappelai les raisons de la quiétude.
Poème
Je restai ainsi une longue période de plusieurs jours vivant tout seul avec une soif violente et dure. J’ai bu
des verres de nostalgie, j’ai désiré ardemment l’ivresse et les vanités. Quand le désir se développe et
augmente, la passion arrive et le suit. Souvent, je passais mon temps avec Al-Ǧāmi` al-Maḫtūm502. Je me
promis de m’échapper de ce sort fatal.
Je dis que le revers de fortune va, vient et s’arrête, puis s’arrête et revient.
Poème
Durant ces jours, je me dérobe de la proximité des gens, je me promène au milieu de ces arbres et je me
distrais du chant des oiseaux.
Poème
(p. 115) Quant à cette ville, elle est la dernière de l’occident sur le bord de la mer d’al-Šām. Il y a des
monuments extraordinaires. Leurs tracés témoignent d’une force et d’une sagesse de la part de ceux qui les
ont construits. Les murs de la ville sont impénétrables. Il y a beaucoup d’arbres. Il n’y eut pas sur terre une
ville comme elle, ni une contrée qui lui ressemble. Elle est le lieu vers lequel convergent les marchands qui
viennent par voie de terre et par les mers. On charge des marchandises d’Alexandrie vers toutes les
contrées comme on y apporte des marchandises dans les temps nouveau et ancien. Le Nil entre dans
Alexandrie par des galeries souterraines jusqu’à ses édifices. L’eau se répand et se partage dans les
maisons. Cette technique est extraordinaire et d’une sagesse étrange. [Les galeries] sont liées entre elles
d’une façon admirable car ses constructions ressemblent à un échiquier. Quelle ville ! Tout ce qui se trouve
dans cette ville est merveilleux. Comme sa beauté occulte les vertus des autres villes ! Une des merveilles
du monde est le phare qui n’a pas son égal dans les pays, il se trouvait à un mille de la ville. J’ai dit
également dans le Ḫarīda503 que le plus beau dans cette ville est son temple humain.
Poème
Al-Suyūṭī a raconté dans son livre Al-Muḥāḍara, tiré de Mabāhiǧ al-fikr que parmi les merveilles était le
phare d’Alexandrie construit avec des pierres, provenant de ruines, scellées avec du plomb. [Le phare] est
posé sur des arcades en verre. Les arcades sont posées sur le dos d’un crabe en cuivre. Il comporte près de
trois cents pièces [disposées] les unes sur les autres. Une bête de somme peut y monter avec son
chargement. Dans les pièces, il y a des fenêtres à partir desquelles on voit la mer. Il y a désaccord sur
l'identité de son constructeur. On dit que sa hauteur est de mille coudées. Au sommet, il y avait des statues
de cuivre, dont une montrait le soleil avec son index droit ; où qu’il soit dans le ciel, elle tournait avec lui là où
il tournait. Face à la mer, se trouve une autre statue, quand un vaisseau s’approchait à une distance
d’environ une nuit, on entendait une voix effrayante venant de la statue qui informait la population de la ville
de l’arrivée de l’ennemi. Une troisième statue émettait un chant harmonieux à chaque heure de la nuit.
(p. 116) À son sommet, il y avait un miroir permettant de voir Constantinople et l’étendue de la mer entre les
deux [villes]. À chaque fois que l’armée de Rūm se préparait, le miroir la voyait. À propos du miroir, al-
Mas`ūdī raconta qu’il était en place jusqu’à ce que les musulmans conquissent [Alexandrie]. Puis le roi de
Rūm rusa pour le détruire sous Al-Walīd b. `Abd al-Malik en envoyant un homme, accompagné d’une suite,
à quelques villes frontières d’al-Šām. Ce dernier montra le désir de se convertir à l’islam. Il montra des
trésors qui étaient enterrés à al-Šām et ceux qu’Al-Walīd amassa. C’est pour cette raison que [Al-Walīd] crut
cet homme qui affirmait que sous le phare se trouvaient l’argent, les trésors et les armes qu’Alexandre avait
enfouis. Le calife le prépara avec sa suite et celle d’Al-Walīd pour se rendre à Alexandrie. Un tiers du phare
fut détruit et le miroir tomba. Les gens comprirent que c’était une ruse. L’homme pressentit [le danger] et
s’enfuit sur un bateau qui était là pour lui. Dieu est le vainqueur de cet acte. [Le phare] s’est transformé non
seulement en un monument sans grande valeur, mais également en vestige de ce monument. Que Dieu
bénisse les nuits.
Poème
(p. 117) Parmi les merveilles d’Alexandrie il y a la colonne des colonnes. Al-Maqrizī dit que c’est une pierre
rouge de granite tachetée qui est invulnérable. Il y avait tout autour d’elle quatre cents colonnes qui étaient
toutes immenses. Le wālī d’Alexandrie Farāǧā les cassa au temps du sultan Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf b. Ayyūb. Il
jeta ces colonnes au bord de la mer pour rendre son accès difficile à l’ennemi. On raconte aussi que cette
colonne des colonnes était une des colonnes du portique d’Aristote qui y enseignait la sagesse. C’était la
maison de la science. On dit que la hauteur de cette colonne est de soixante-dix coudées et que son
diamètre est de cinq coudées. On dit aussi que sa hauteur avec sa base est de soixante-deux coudées et un
sixième. La hauteur de la base inférieure est de douze coudées et la base supérieure est de sept coudées et
demi. C’est ainsi dans les Ḫiṭaṭ504. Cette colonne existe toujours au moment où ces lignes sont écrites. Elle
se trouve à demi mille de la porte de Sidra, extra-muros. Beaucoup de colonnes immenses sont à l’intérieur
de la ville, quelques-unes sont debout, d’autres sont couchées.
Poème
Récit amusant : Al-Suyūṭī dit : "je vis cette colonne quand j’entrai entra à Alexandrie au cours de mon
voyage. Le pourtour de sa base était de quatre-vingt-huit empans. La population raconte souvent que celui
qui s’en approche en fermant les yeux puis se dirige vers elle ne la rencontre pas, mais passe à côté. On dit
que personne ne la rencontre jamais. (p. 118) Beaucoup de gens essayèrent plusieurs fois, ainsi que moi,
sans jamais la rencontrer". Al-Suyūṭī dit dans Al-Muḥāḍara : à propos de son canal, on diverge à propos de
son constructeur, mais il n’est pas nécessaire de diverger, ça n’apporte rien. On sait peu de choses à son
propos. Al-As`ad a dit dans Qawānīn al-Dawāwīn que le canal d’Alexandrie possède beaucoup de petits
canaux. Sa longueur à partir de la bouche du canal est de 30 600 qasaba et sa largeur est entre 2,5 qasaba
et 3,5 qasaba. L’eau reste dans le canal selon le niveau du Nil. Quand le Nil est haut, l’eau y reste pendant
plus de deux mois. C’est ainsi dans les Ḫiṭaṭ. Ibn al-Wardî raconta qu’Alexandrie mesurait sept qasaba. Mais
la mer la rongea et il ne reste d’elle qu’une seule qasaba. À propos des mosquées, on en dénombra une fois
20 000. On dit que celui qui construisit Alexandrie est celui qui construisit aussi les pyramides. On dit aussi
que c’est Ya`mur b. Šaddād. D’autres disent que c’est Alexandre Ier, Ḏū al-Qarnayn le Grec, qui voyagea sur
terre et qui atteignit les ténèbres, l’occident et l’orient. Il ferma aussi le chemin de Yāǧūǧ et Māǧūǧ. D’autres
disent que c’est Alexandre II ibn Dārā al-Rūmī qui les construisit ; il ressemble à Alexandre Ier car il alla aussi
en Chine et en occident. Il est mort à 32 ans. Alexandre Ier était croyant tandis qu’Alexandre II suivait la
doctrine de son professeur Aristote. Entre le premier Alexandre et le second, il s’écoula une longue période.
On dit aussi qu’Alexandrie fut construite par les Djinns pour Sulaymān – que la paix soit sur lui ! Les maîtres
de l’éloquence disaient que c’était une oeuvre de Djinns à chaque fois qu’ils voyaient une merveille. On dit
aussi qu’il y avait 12 000 boutiques où on vendait des légumes. Al-Kindī dit : "Les gens disent de manière
unanime qu'il n'y avait pas au monde une ville qui a trois niveaux comme à Alexandrie. On dit qu’Alexandre
le Grec la construisit en trois cents ans. Est-il un prophète ou un roi ? Les opinions divergent, mais la
dernière [hypothèse] est la meilleure. Les gens ne marchaient pas de jour dans la ville sans avoir un chiffon
noir entre leurs mains, ils avaient peur pour leur vue à cause de la blancheur [de la ville]. On continua à agir
ainsi pendant soixante-dix ans. On dit aussi qu’elle est Iram Ḏāt al-`Imād qui n’a pas son pareil dans les
pays. Ce rivage a été englouti et causa la destruction rapide de la ville."
Poème
(p. 119) On dit que sur le peuple [d’Alexandrie] souffle le vent d’est qui améliore leur vie, affine leur caractère
et augmente leur volonté. Jadis, on l’a décrit comme étant avare, toutefois il n’a pas moins de défauts
maintenant.
Poème
Histoire : Ce n’est pas à classer au chapitre du reproche, mais on raconte d’une chose à l’autre des
digressions [au lieu] de ce qui convient. Je sortis un jour par la porte de Sidra pour me promener et j’ai vu
une assemblée de gens autour de la colonne des colonnes. Je m’approchai d’eux et découvris un
funambule, un Rūm d’Alep, qui avait une taille délicate et des paroles douces ; sa bouche était comme l’eau
de la vie, sa moustache était encore jeune et n’avait pas atteint l’âge mûr. [Le funambule] avait accroché une
corde au sommet de la colonne et y monta. Il fit preuve d'une habileté artistique surprenante qui surprit les
esprits et dérouta les pensées. Puis il dit : "Ô habitants d'Alexandrie ! Aidez-moi à voyager et je réaliserai
pour vous d'étonnantes performances". Quand il descendit parmi eux pour collecter quelque chose de ce
monde, [les gens] se sauvèrent comme les Arabes envoutés. »505
- 436 - 438 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ABŪ SĀLIM AL-`AYYĀŠĪ (1653-1654)
Abū Sālim al-`Ayyāšī, Al-riḥla al-`Ayyāšīya mā’ al-mawā’id, Fès, 1977.
Né dans la tribu berbère des Ayt dans le Moyen-Atlas marocain en 1628, Abū Sālim al-`Ayyāšī est littérateur,
traditionniste, jurisconsulte et savant soufi. Il accomplit deux pèlerinages, le premier en 1649 et le second en
1653/1654, au retour duquel il écrivit cette relation de voyage. Il meurt de la peste au Maroc en 1679.506
p. 362-368 (tome II) :
« La ville d’Alexandrie est parmi les villes-mères citées dans le monde. C’est le royaume des maisons
égyptiennes où vécut Mūqawqis durant la période préislamique. De même, on ne peut omettre de signaler la
splendeur du règne de son fondateur Alexandre, sa célébrité et ses conquêtes sur les royaumes. Les
chroniqueurs relatent sa vie ainsi que les circonstances de l’édification et de la construction de cette ville. En
effet, il l’a transformée en deux villes : l’une est souterraine et la seconde, visible, est au-dessus d’elle.
Pendant les jours de la crue du Nil, la ville d’en bas se remplit pour que les habitants de la ville d’en haut
s’abreuvent. Ses vestiges demeurent encore aujourd’hui. Parmi ses merveilles, il y a la colonne connue
comme la colonne des mâts qui demeure jusqu’à aujourd’hui penchée en l’air. Son architecture embarrasse
les opinions. On a prétendu qu’il y avait quatre colonnes surmontées d’une coupole. Parmi ses merveilles, il
y a le célèbre phare qui a disparu et à propos duquel il ne reste maintenant qu’une forme circulaire. Je
demandai à notre ami le cheikh Bākir de me montrer sa localisation ; il m’apprit qu’il était dans la mer qui
avait envahi une grande partie de la ville. Il dit avoir vu des dessins entre les mains de personnes, sur
lesquels un espace commercial, des maisons, des boutiques et des fondouks apparaissaient autour du
phare, mais tout ceci a été envahi par la mer. Je fus émerveillé de ce que les chroniqueurs racontèrent sur
sa splendeur et sa grandeur. Toutefois, je ne vis que peu de choses qui subsistait. Alors quand mon ami
m’en parla, j’appris ainsi que la mer avait endommagé beaucoup de ses vestiges.
Pause
Notre ami, le pèlerin Bākir, m’informa que le sultan Selim l’Ottoman, quand il entra à Alexandrie en venant
du Caire, monta un jour sur la colline qui donne sur la ville ; le peuple d’Alexandrie y vint et lui dit : “Ô sultan,
la ville est dominée par les ruines comme tu la vois. Nous voulons une entière générosité de ta part, que tu
aies pitié de nous et que tu prêtes attention à l’urbanisation de cette contrée qui a une bonne réputation
parmi les villes du monde. Il se pourrait qu’elle retrouve un peu de son premier état grâce à ton intervention.”
[Le cheikh] affirma que le sultan resta silencieux pendant une heure et qu’il était troublé. Ensuite il [le sultan]
releva la tête vers eux et leur dit : “Dieu décida que cette ville soit ainsi, moi je ne peux restaurer ce que Dieu
a permis de laisser en ruines.” Puis les gens le quittèrent. (p. 363) Le cheikh Bākir dit que ce roi observa
avec un regard de connaisseur et pensa profondément aux détails minutieux de la sagesse de Dieu qui se
trouve dans son royaume. Il semblerait que ce roi prit en compte l’aménagement de cette ville pour qu’elle
réponde aux besoins nécessaires de la vie, au maintien d’une qualité urbaine grâce à sa place au centre des
royaumes islamiques. Elle regroupe à la fois des particularités terrestres et maritimes, ainsi que des
populations bédouines et urbaines. À l’est, sa porte est reliée à la campagne égyptienne qui est le champ du
monde et qui n’a pas son pareil. Sa porte ouest est reliée au désert de Barqa qui sépare les pays de l’est et
de l’ouest. Il n’y a pas de désert dans le monde qui s’en approche par la grandeur de son étendue, il n’y a
pas d’aussi bon pâturage et il n’y a pas d’air aussi sain. La porte de la Mer est en face du territoire de Rūm,
source d’importation des marchandises précieuses. Si Alexandrie réunissait tous ces avantages, en ayant
de nombreuses raisons pour développer son urbanisation, la destruction de la ville ne peut avoir comme
raison que celles de la volonté de Dieu et de Son observation, d’une rigueur divine, sur cette ville
orgueilleuse et arrogante envers les autres pays. C’est par Sa volonté qu’aucune chose ne s’élève que pour
être anéantie par un seul mot : soit. L’Homme sera sans doute incapable de l’urbaniser, car Dieu a permis
qu’elle soit détruite. Sur ma vie, c’est une bonne vision et une étrange pensée. Évidemment, ceci n’est pas
étonnant puisque le sultan Selim – que Dieu l’accueille dans sa miséricorde ! – était connu dans le royaume
pour l'acuité de son analyse, la sagacité de sa pensée et son bon discernement. L’empire ottoman est
devenu grand sous Selim qui a conquis les royaumes d’al-Šām, d’Égypte, du Ḥiǧāz et d’autres pays encore.
Parmi les lieux saints que nous visitâmes à Alexandrie, il y a le tombeau de l’imam qui a réuni les deux
illustres hommes, le cheikh Abī Bakr al-Ṭurṭūšī – que Dieu soit satisfait de lui ! Ce tombeau est l’un des lieux
saints les plus célèbres à Alexandrie. Notre cheikh, le savant Abū Bakr al-Saqatānī – que Dieu soit satisfait
de lui ! – au moment où nous visitâmes avec lui ce tombeau en 1060507, nous informa sur les prodiges de ce
cheikh. Il dit que lorsqu’Al-Ṭurṭūšī s’installa enfin à Alexandrie, il trouva un accueil favorable pour propager le
savoir et y devint célèbre ; quelques envieux le dénoncèrent auprès du sultan d’Égypte qui le somma de
venir. Le cheikh lança alors des imprécations contre le sultan qui se gonfla jusqu’à devenir gros comme une
outre. Le sultan envoya une lettre au cheikh pour s’excuser et pour lui demander de prier pour lui. Mais le
cheikh dit : “Je ne prierai pas pour lui sauf s’il me donne tout son royaume.” Alors le sultan lui donna tout son
royaume. Le cheikh alla voir le sultan et le frappa à coups de pied, après quoi le sultan péta et se dégonfla.
Le cheikh dit au sultan : “Je me fiche de toi et ton royaume qui a une valeur de pet. Comment un sage
pourrait-il désirer [ton royaume] ?” Ainsi nous réprimâmes le sultan. Le cheikh sortit et sa valeur aux yeux du
roi grandit depuis ce jour. Parmi les lieux pieux, il y a aussi le tombeau de Sidī `Alī al-Badawī – que Dieu soit
satisfait de lui ! – ainsi que le tombeau d’Al-Ḫazraǧī, célèbre ici pour sa nisba, mais je ne sais pas s’il s’agit
de l’auteur de la prosodie. Est-ce lui le poète ou est-ce un autre ? À côté de lui, se trouve le tombeau de
l’imam Al-Fākahānī. Il y a aussi le tombeau du cheikh pieux Sīdī `Abd al-Razzāq, le plus vénérable des
élèves de Sīdī Abī Madyan – que Dieu soit satisfait d’eux ! – le meilleur parmi ceux qui ont propagé (p. 364)
sa tarīqa après lui. Les gens s’inspirèrent de sa tarīqa dont sa valeur est attestée parmi eux. Nous visitâmes
la citadelle d’Abī al-Ḥasan al-Šāḏilī qui était un refuge pour lui et ses compagnons. Cette grande forteresse
est dans le rempart Est de la ville où se trouvent de nombreux habitats. La communauté de la Šāḏiliyya –
que Dieu soit satisfait d’elle ! – s’y rend une nuit spéciale de l’année jusqu’à maintenant. [Ses membres] y
dorment, y mangent, y invoquent Dieu-le-Puissant et lisent. Ensuite, ils se séparent pour se retrouver à la
même date l’année suivante. Parmi les lieux sacrés, il y a le tombeau de Sidī Aḥmad al-Manārī qui est
célèbre pour sa bénédiction. Je n’en dis pas plus sur la raison de cette appellation que ce que le cheikh
Bākir me rapporta. Lors de sa visite au cheikh Al-Maġribī, Manārī l’informa de la raison de son appellation.
Lorsqu’il arriva dans la ville avec son ânesse, il demanda aux gens : “Où pourrais-je passer la nuit ?” Les
gens lui montrèrent le phare en se moquant de lui. Il dit : “Au nom de Dieu !” puis monta avec son ânesse
jusqu’au sommet. Les gens se réunirent autour de lui et le regardèrent avec inquiétude. Cela est très peu
comparé à ce que l’on doit aux amis de Dieu-le-tout-puissant, mais je ne suis pas certain de cette histoire en
raison de son ancienneté. Notre ami susmentionné nous informa aussi que le cheikh Sidī ‘Alī al-Anṣārī,
quand il vint à Alexandrie, visita les lieux pieux et sortit par la porte escortée de ses compagnons
alexandrins, se frotta le visage contre la porte en leur disant : “Priez pour moi ici. Combien de walīy508 et de
compagnons sont passés par cet endroit !” On dit aussi que le cheikh Al-Anṣārī emprunta les paroles de son
cheikh Sīdī Muḥammad b. Abī Bakr al-Dalā’ī qui dit à ses proches : “Si vous allez visiter le cheikh Abī Ya‘za
et si vous passez par le chemin sultanien qui mène de Fès à Marrakech, arrêtez-vous y pour lire la Fātiha.”
Beaucoup de walīy et de compagnons passèrent par cet endroit. Mais il ne fait aucun doute que de
nombreux visiteurs et honnêtes hommes du monde passèrent par la porte d’Alexandrie plutôt que par le
chemin [sultanien], parce qu’elle était, dès le début de l’islam et jusqu’à présent, un lieu de paix.
Notre ami nous informa aussi qu’Alexandrie, dans les temps anciens, n’avait ni détritus et ni ordures sur les
chemins et que les portes des maisons portaient un talisman. À la porte de la Mer, il y avait une maison
fermée qu’un certain roi ouvrit. Il y trouva une sculpture d’un homme aux manches retroussées tenant dans
ses mains un morceau de fer. À partir de ce jour heureux, le roi annula le talisman.
Pause
Quand j’entrai dans le mausolée du cheikh Abī `Abbas al-Mursī – que Dieu soit satisfait de lui ! – j’y trouvai
le poème, que j’avais envoyé lors de notre arrivée, accroché au mur du côté ouest près du mihrab. Autour, je
trouvai un autre de mes poèmes que j’avais écrit ici en 1064509. À côté, se trouvait un poème pour le cheikh
éloquent et ardent Muḥammad al-Ǧāḥiẓ b. Ǧamāl al-Dīn al-Maqdisī al-Qāḍī de Bahnasā qui fait des
louanges au cheikh [Al-Mursī] – que Dieu soit satisfait de lui ! – pour solliciter les fidèles de Dieu de lui
accorder les choses de première nécessité. Quand [Muḥammad al-Ǧāḥiẓ] passa par Alexandrie en allant
aux pays de Rūm, il eut peur de la mer ; il écrivit des poèmes et les accrocha à côtés des miens ; qu’ils
soient répétés pour être bénis par celui qui loua le cheikh – que Dieu soit satisfait de lui !
Poèmes
(p. 367) Parmi les lieux saints d’Alexandrie, il y a la zāwiya510 d’Abī Muḥammad Ṣāliḥ que les Maghrébins
visitent et dans laquelle ils ont des waqf-s511. On y trouve des armes suspendues dont les gens invoquent la
bénédiction car ils croient que ce sont les armes des compagnons du Prophète qui conquirent la ville. Mais il
n’y a pas de fondement à ceci. Parmi les saintetés, il y a aussi un grand Coran dans sa grande mosquée ;
les gens prétendent que c’est un des Corans que ‘Uṯmān b. ‘Afān – que Dieu soit satisfait de lui ! – envoya
vers des contrées lointaines. Mais il n’est pas juste de lui attribuer ceci.
Parmi ses constructions merveilleuses, il y a le grand hammam qui n’a pas son pareil au monde et que les
docteurs louent. Les chroniqueurs disent que de tous les hammams au monde, il est unique par son
ampleur, sa belle apparence et sa construction splendide. Mais la plupart de la ville s’est détériorée et il ne
reste que peu d’édifices autour du hammam. À ce temps-là, les constructions furent déplacées à l’extérieur
de la ville au-delà de la porte de la Mer. Entre cette porte et la mer, se trouve la plupart des marchés et des
khans. De façon générale, c’est une belle femme des villes, elle possède autant de biens que de fortunes.
Mais le temps abîma sa jeunesse, déchira sa robe et mangea sa substance (p. 368). Il ne reste que ses
murs et ses portes. Dans ses cours, poussent des herbages et des plantes, tandis que le hibou fait son nid
dans ses constructions. On y marche plus d’un demi mille sans rencontrer une personne qui va ou vient.
C’est une leçon pour celui qui en fait cas et c’est un renoncement au monde pour celui qui réfléchit. C’est le
meilleur témoignage pour celui qui nie la fin suprême. Les ruines désertées et hors d’usage nous
renseignent sur les siècles passés, il ne reste de ses monuments merveilleux, comme témoignage de la
splendeur des royaumes, que la colonne nommée la colonne des mâts réconciliant les ennemis du fléau du
temps et des troubles. Cette colonne, de plusieurs pierres, se tient penchée en l’air. Elle est fichée dans la
terre et résiste aux tempêtes. À son sommet, se trouvent des pierres carrées ressemblant à une assise
posée sur un cercle de trente coudées. Nous n’avons pas vu de merveille aussi haute et splendide que cette
colonne. Qui posa ces pierres à son sommet ? Quelle force humaine pourrait l’atteindre ? Quelle ruse ou
quelle raison nous ferait parvenir à cet endroit ? On l’aperçoit de loin comme un palmier très haut rivalisant
avec [la constellation des] Gémeaux. Globalement, elle est parmi les constructions étranges du monde et
parmi les oeuvres de cette ville merveilleuse.»512
506 Ben Cheneb-[Ch. Pellat], M., « Al-`Ayyāshī », EI2 I, Leyde, Paris, 1991, p. 818.
507 1650-1651.
508 Le rapproché d'Allāh, l’équivalent du saint.
509 1653-1654.
510 Blair, S. S., « Zāwiya », EI1 X, Leyde, 1934, p. 505-506. Ce terme possède plusieurs significations, il
s’agit soit d’un oratoire, soit d’un édifice destiné à accueillir les voyageurs et les membres d’une confrérie
locale.
511 Powers, D. S, « Waḳf », EI2 XI, Leyde, 2005, p. 65-109. « En droit musulman, l’acte de fondation d’une
institution charitable, d’où l’institution elle-même ».
512 Traduction : T. Daghsen, S. Renaud, O. Sennoune, H. Zyad.
- 439 - 441 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FAOSTINO DA TOSCOLANO (du ? au 26 avril 1654)
Toscolano, F. da, Itinerario di Terra Santa, par W. Bianchini, Spolète, 1992.
Frère Faostino da Toscolano (1595–Trevi/1679).
p. 87-95 :
« Descrittione d’Alessandria et ogn’altro particolare osservato et in quella occorsomi
Cinque giorni per concludere gli miei affari mi convenne dimorare in questa città d’Alessandria, e
prevalendome dell’occasione osservai ogni convenevole curiosità in essa.
Questa città fu hedificata da Alessandro Magno in mezo d’un arenario e pianura, alla riva del mare,
circondata da dupplucate e fortissime muraglie per 8 miglia circolari, quasi quadrangolare, che pur hoggi si
vedono in piedi ben che mezo diroccate, nelle quali si potrebbe nascondere un grosso essercito per la
concavita s’esse e torrioni.
Vi sono quattro porte, l’una verso il levante, al mezo giorno l’altra, al ponente la 3° et al mare verso il porto
l’ultima, quali ben che antichissime si vedono nondimento fabricate con artificioso ingegno di polite, grosse e
ben lavorate pietre, quali, more solito, le serrano et aprono.
Dentro, la sodetta città è quasi tutta destrutta, né si vedono altro che diroccamenti, monticelli d’essi e
reduttioni di pietre, che quasi diventano polvere bianca come calce.
L’habitato poi è verso ponente, mare e in altre due luoghi e strade come borghi, le cui case paiono fabricate
di terra, tutte con la sua cuppula con terrazzi senza vedersi tegole, che da lontano sembrano tante cappelle
o chiese.
Le quali per ordinario tutte son fondate sopra certe colonne, volte o caverse come cisterne, che
all’inondatione annua del fiume Nilo, mediante un ramo ch’ivi passa, s’empiono di quell’acqua di cui si
servono tutto l’anno, e la causa pessima aria.
E in dette habitationi dimorano turchi, mori di bassa conditione, hebrei, greci, copti, et signori mercanti
francesi, venetiani e siciliani.
Li turchi civili e di comando hanno fabricato le lor case vicino al mare e fortezza, fuori della città, per
megliorar d’aria, ove è fatto un (p. 89) borgo grandissimo e tra gl’uni e gl’altri fanno un numeroso popolo,
quali d’aspetto brutti, paiono scottali dal sole, massime la gente bassa e villani, che quasi ignudi malamente
vestiti si vedono come animali di poca ragione. Vestendo d’ordinario d’una longa, larga e grossa camiscia di
cottone o bambasce, sopra la quale portano una vesta con meze maniche, travisata de più colori e longa a
meza gamba, cinti con una centura di corame larga un mezo palmo, e ne’piedi un par di scarponi, o pure
sealzi vivono.
Li civili poi con un par di calzoni gionti alle calzette, che con gran larghezza fanno più pieghe sopra la gamba
e scarpine costile alle medessime calze, con un paro di scarpe aguzze e senza calcagno una sottile e larga
camiscia, che fuori da detti calzoni pendente se li vede con maniche larghe, che presso la mano la girano
più volte un gioppone di buon panno overo incontonato e ben bottonato d’argento o d’ottone, cinto poi con
una man di corde colorite, e con una longa et aperta veste di meze maniche, questi vestono con molta
maestà e gravita.
In testa poi portano una mediocre longa berretta incotonata sotto la quale ne tengono una o altre due sottile
et d’intorno alla superiore aviluppano un finissimo bianco telo, che più volte il girano sara sopra dieci braccia
di tela qual chiamano il turbante che mai si levano servendosi per loro riverenze poner una mano al petto et
un’inchino profondo di testa senza’altro moto di capello.
Il vestir delle donne vili non differisce dalli loro huomini villani eccetto che nella testa portano un piccolo
panno che se lo legano sotto la barba et pasno poi coprendo la barba e mezo naso.
Le civili vestono calzoni uniti con le calzette e scarpe con giuppone e camiscia sopra come gl’huomini ma
più stretti e nelle gambe ordinariamente portano certi stivaletti di pelle gionti con li scarpini havendo le
scarpe senza calcagno, come gl’huomini la veste soprana ben che un poco più stretta e pero simile a quella
de medesime loro huomini.
In testa poi portano una forte berretta tutta smaltata o argentata sopra la quale stendono un candito e bianco
telo come lenzuolo che fin in terra da quello vien coperta tirandolo parimente davanti con le cui falde
s’aviluppano anche le mani e tirandoselo avanti la faccia con un rado tafeta negro che il cuopre gl’ochi, in tal
modo che non si vedono a dette donne mai una punta de dito.
Portano poi le maritate catena o anello d’argento della grandezza d’un grosso dito al collo alle braccia et alli
colli de’piedi.
(p. 90) Parimenti tutti li loro capelli li riducono in una sol treccia pendente dietro, alla punta della quale
giongono alcuni ori o argento, che toccandosi strepitano come campanelle.
All’orecchio pure hanno qualche anelletto, et in questo modo vedonsi vestire le donne turche.
Le christiani scimatici o del propio paese vestono un poco più positivamente e più stretto, ma non
differiscono da’turchi eccetto che nella testa sive turbante, che non lo possono portar bianco, ma nel bianco
trevisato di color negro o rosso.
Le donne poi vestono parimente come le turche, e quelle che non hanno tante argentarie si servono di verti
cerchietti di terra o verto nelle braccia e gambe per loro hornamento.
De hebrei poi non vi è altra dissuggualità nel vestire, che non portano vestimenti grandi e larghi, ma simili a
quelli de christiani, eccetto nel turbante, che tutti portano una berretta longa poco più d’un palmo, senza
cos’alcuna per giro, o pure una semplice teletta com’un fazzoletto bianco.
Di tutte le sopradette genti vidi et osservai in Alessandria, nella quale per la cattiva aria a’tempi non habitava
più quasi nessuno.
Si non che un santone turco s’invento un’astutia, publicando per l’Eggitto che Maometto concedeva molte
gratie et indulgenza a quelli che habitavano e facevano elemosina in Alessandria, e con tal modo si è
talmente popolata che vi sono tutte le sopradette nationi in molto numero.
Incontrai un gran comitiv de turchi, et m’informai che era un sponsalitio, e curiosamente di cio dimandai, e
me fu riferito che dopo essere convenuti di prezzo, per che il sposo, la maggior parte de quali convertono in
hornamenti della medesima sposa.
Compariscono il sposo e padre della sposa avanti del casi, e narratoli del lor comun consenso, le dona il
placet con una polisa scritta e sigillata al sposo, qual sodisfa con una paga d’un scudo incirca.
Publicato poi al parentado, all’una e l’altra casa de sposi, per alcune (p. 91) ne sere fanno e gridori
d’allegreza con raccontare le bellezze faccoltà e virtù de sposi. Al tempo debito poi fanno la publica
demonstratione con strepiti, gridori, suoni et giuochi, conducendo il sposo alla casa della sua sposa.
La sera nelle 3 hore di notte, con la comitiva d’ambe li parentadi, suoni di tamburi, flauti ed altri strepiti
conducono gl’huomini il sposo e le donne la sposa, ambedue coperti con un bianco lenzuolo, ciascheduno
alla casa del sposo con torcie e lanterne, ove gionti, cibbati al modo loro fanno diversi giuochi e moresche e
la sposa condotta in una camera, ivi la va a ritrovare il suo sposo, ove consumano l’atto matrimoniale. Dopo
il quale ritorrna il medesimo sposo nella, ambedue coperti con un bianco lenzuolo, ciascheduno alla casa del
sposo con torcie e lanterne, ove consumano l’atto matrimoniale. Dopo il quale ritorna il medesimo sposo
nella comune ricreatione alla vista di ciascheduno, con un candido panno cinto, machiato de sangue per
segno della rotta virginità della sua sposa, del che facendosi singolar gridore da tutti dicendo : « Era
vergene, era vergene ».
Né possono altrimenti fare non solo li turchi, ma anco li christiani senza taccia di gran disshonore.
Maritandosi con zitelle che con vedere o corrotte, non fanno altra dimostratione che la semplice scrittura del
cadi, e subito in vigor di quella s’accompagnano come corrotti.
Vidi parimente un’altra compagnia de turchi, che andavano ad una moschea vecina al mare, per devotione
di un santone ivi sepolto, con suoni di tamburi et altri strepiti a circoncidere un figliuolo di 6 o poco più anni,
quale sopra un bello et adornato cavallo se ne stava tutto adornato e ben vestito.
In detta moschea dicevano esser un turco andando io per diporto al mare, vidi che il bei o governatore di
quel luogo, stando in una moschea a far la sua oratione nell’hora di mezo giorno, era quivi da’una gran
comitiva de turchi aspettato, e da un circolo di 6 tamburi e molti flauti, cimbali et alcuni piatti d’ottone, che
con certi legnetti li percuotevano insieme, sonando facevano un gran strepito, et uscito con molta gravità e
maesta, il sodetto bei fu da quella e suoni accompagnato alla propia casa, dicendomesi che ogni venerdi in
tal hora si fa simil fontione et applauso.
(p. 92) Vi è poi una bella e monita fortezza, anticamente da nostri christiani fabricata e situata tra li due porti
di mare, l’uno de vascelli e navi, tanto de cristiani quanto de turchi, et l’altro per le sole galere de turchi.
Non vi manca in Alessandria cos’alcuna, ma abondantissimamente si trova il tutto per la condotta della
navigatione, che provede de ogni sorte de legnami, per non esservene quivi, eccetto che palme e dattoli et
alcuni giardinetti de limoncello salvatici. Come de vino per le christiani, che dalla Candia et altre isole molto
buono vien condotto. Di grano, riso, legumi, pesce, carni, galline e simili n’è abondantissima, per che dal
centro dell’Egitto per il Nilo e dalle convicine terre se ne conduce quantità.
Non producendo per molte miglia d’Alessandria altro che arenarii, quale è pianura, né colle o monte si vede
quivi, eccetto un piccolo montecello situato dentro la città, ab antico fatto dalli cavamenti di case, et è simile
al monte Testaccio di Roma.
Nella sumità del quale hanno fabricata una piccola torre in cui sta continua guardia, che con bandiere avisa
la dogana la venuta de vascelli che in alto mare vede, et anco mantiene un fanale tutta la notte accesso,
ascio li naviganti vedano ove trovar possono Alessandria.
Per terra dentro la città fra casamenti si vedono molte e bellissime cuglie, colonne et altri massicci, ma simile
a quella di Pompeio, che inpiedi risplende, non ho vista, la quale è tutta d’un pezzo e di color mischio a
porfido, bellissima et alta a proportione, che uno per buon braccio con tiro di pietra difficilmente giongera la
sua somità.
Parimente si vedono li vestigii del palazzo del re Costa padre di santa Caterina vergene et martire, tutto
dirocatto, ove inpiedi stanno alcune belle e grosse colonne a color di porfido, sotto le quali vi è una grotta
mezo ripiena, e dicesi che questa fusse la carcere ove da suo padre fu retenuta santa Caterina, e che quivi
si ritrovasse la colonnetta di marmo sopra la quale fu tagliata la testa alle medesima santa. In giorno di
domenica, con li signori consoli francese e veneto, mercanti et tutti le schiavi della galera d’Alessandria
cattolici, andai a San Sabba, convento de calogeri e patriarca greco-alessandrino, quali celebravano la
domenica delle Palme all’antica, non convenendo con noi altri cattolici.
Ove sta un’honorata e devota chiesa da sodetti seismatici manutenuta nella quale sono due adornate e belle
capelle a nostro uso, de francesi l’una e de venetiani l’altra, nelle quali confessati tutti detti (p. 93) schiavi
devotamente celebrassimo e si comunicorno per disponersi a viaggi mortali di mare e di peste, tra quali
schiavi due erano chierici religiosi de Serviti l’uno et Domenicano l’altro che virtuosi e di buona condotta
cantorno le Messa in canto fermo, rendendo gran devotione.
In questa chiesa et in un pilastro fra le sodette due capelle si conserva la sopracennata colonnetta di
finissimo marmo, sopra la quale fu tagliato il capo a santa Caterina Alessandrina.
Qual colonna è di 4 piedi e mezzo alta e per quadro poco più d’un palmo, et d’ogni faccia di detto quadro vi è
una crocetta intagliata.
Nella sumità poi di detta colonna vi è una picciola concavità machiata di color sanguineo, e dalle bande
latteo, e dicesi che quivi, nel tagliar la testa alla santa, restasse quel benedetto sangue e latte che dalla ferita
scaturi. Quale miracolosamente senza potersi cancellare si conservi fin hoggi.
Il propio giorno e festa di San Marco andai a celebrar Messa nella chiesa d’esso santo, tenuta dalla natione
copta, nella quale parimente vi è una bella capella de signori veneti ed il propio pulpito ove il santo predico e
fondo la scuola della sacra scrittura. Dietro all’Altare Maggiore si conserva ancora il sepolcro di detto santo,
di dove li veneti lo rubborno e trasportorno poi a Venetia.
In detto giorno parimente vidi molte redicole cerimonie di detta natione scismatica nella celebratione della
loro Messa, alla quale il popolo risponde e fa tutte le attioni et moti che all’altare fa il sacerdote. Gl’huomini
stanno sempre inpiedi, ciascheduno appoggiato ad un bastone o crocciola, et li ministri appresso l’altare
tengono al collo un stretto, colorito e longo sciugatoio con alcuni stromenti in mano, come certi sottili piatti di
rame, martelletti, bachette, e alcuni sonagli che di quando in quando urtandoli insieme fanno strepito
redicoloso.
Poco lontano dalle mura della città d’Alessandria si vede un’antica chiesa di S. Giorgio Martire, e dicesi che
quella fusse sua casa mentre il detto santo ivi habitava.
Parimente poco più lungi e verso il mare si vede un diroccamento di fabriche, e dicesi sia ivi stata la casa di
S. Antonio Abbate, nel qual luogo si venera una cappelletta a devotione del Santo.
In mezzo la città d’Alessandria poi si vede il superbo tempio et arcivescovato di S. Anastasio, qual appare di
fuori nobilissimo per la vista d’un grand’inclaustro, sostenuto all’intorno da quantità e bellissime colonne, con
una chiesa di vaga bellezza, e questa è la principal (p. 94) moschea che quivi hanno li turchi, il cui santone
è tenuto da essi in molta veneratione, il cui conseglio prevale ad ogn’altro.
Molte altre moschee si vedono per Alessandria nelle quali non vi è cosa considerabile non tenendo dentro
che quantità di lampade e poche n’accendono et un nichietto o segno verso levante o sepoltura di Maometto
lor falso profeta, voltandosi a quella parte facendo la lor oratione.
In dette moschee nessun christiano puol mai entrare, sotto pena o di rinegar la fede o d’esser brugiato.
E cio fanno per non lasciar contaminare quelli loro santuarii da persone infedeli ove non permettono
s’accosti nè cane, nè altra sorte d’animale bruto.
Nè li medesimi turchi entrano con le scarpe, nè vi sputano o scatarrano, et occorrendo con destrezza il fanno
nel propio fazzoletto per riverenza del luogo.
Habbiamo poi l’ospitio o convento con tutte le necessarie comodità per frati habitanti e passagieri vivendosi
d’elemosina di quei mercadanti cattolici religiosamente.
Qual convento è racomandato a veneti nel cui è una devota chiesa con gl’apparati per il culto divino.
Unito poi a questo convento sta l’habitatione o casamento delli signori consoli e mercanti veneti ove
residono per mercantare.
Parimente li signori francesi hanno una grande e comoda habitatione con la loro chiesa officiata da un nostro
padre, capellano di quel console e mercanti francesi che quivi christianamente habitano e mercanteggiano.
Non men devota che antica è la capella che sta nell’habitatione de sicilliani e genovesi officiata parimente da
un nostro di quando in quando.
Quali habitationi sono 3 in un medesimo borgo, poco lontano l’una dall’altra fabricata a modo di conventi con
la sua forte porta qual ogni sera per rispetto d’una falsa profetia d’un santone che ha lasciato detto che li
christiani di notte prenderanno quella città, un turco dalla parte di fuori serra le sodette porte, e la mattina al
levar del sole l’apre.
A cui anco per cio pagano un tanto l’anno.
Avicinandosi la nostra partenza, il signor console francese, homo molto poi e devoto, volse honorar me con li
miei padri compagni d’un convito lautissimo, nel qual fece portare d’ogni sorte di varie (p. 95) vivande, pesce
e di carne con molti regali e cortesie per porta per nostro nutrimento per la strada, e del tutto riverentemente
ringratiatolo me licentiai.
Andai parimente al navilio ove ero stato condotto, et affetuosamente ringratiai quelli marinari, con offerta di
raccomandarli al Signor nelli santi luoghi per la loro remuneratione di tanta cortesia e carità fattaci nel
condurci ivi benignamente.
Dal signor Pietro nostro procuratore me fu contato e restituito tutto il danaro consegnatoli per portar in
Gerusalemme nella propia specie et ciascheduno di noi quattro compagni, cintosi la pettorina de zecchini, si
diede ordine per la partenza, dandomi detto signore la notta delle spese per la dogana, et alcuni che
portorno dal mare al convento le nostre robbe, che furono in tutto piastre 55, et altre 15 piastre me consegno
per li venturi bisogni per fin al gran Cairo.
Trovo poi un cavallo per ciascheduno et un camello per la robba e danaro in argento con un ben fedele et
armato giannizaro per nostro difensore e conduttieri, di cui quelli egittii temono assai, e per esser soldati regii
hanno molto ordine, e sono altre tanto fedeli. »
- 442 - 445 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ÉCOSSAIS ANONYME (1656)
Écossais anonyme, Record of a pilgrimage from Scotland, through France, to Jerusalem, 1655-1656,
Londres, British Museum, Sloane Ms. 3228.
« Le mercredi 23 janvier [qui était] aussi le 23e jour de notre départ de Marseille, nous débarquâmes à
Bicaire [où] il y a un château fort avec une garnison ; lorsque nous fûmes descendus à terre, on nous fouilla
[pour savoir si nous portions] de l'argent ou des armes, car [sur] tout ce que l'on apporte [on] paye une taxe
de 1 1/4 %. On nous fournit des ânes et des mulets ; nous [dûmes] payer un demi bocelpee ou dollar au
lion513 pour chaque mulet et trois dollars à un janissaire pour nous conduire à la ville d'Alexandrie. En y
entrant nous payâmes un médin par personne ; c'est une pièce de monnaie, dont 36 équivalent à une pièce
espagnole de huit.
On nous conduisit à la douane principale où nous fûmes de nouveau fouillés pour [voir si nous avions] de
l'argent [sur nous] et de là nous allâmes nous loger au fondique français, car c'est ainsi qu'on [y] appelle les
maisons. Là résident les Francs ; il y en a seulement trois de ce genre [de bâtiments] : le fondique de
France, celui des Hollandais et le fondique de Venise ; [dans chacun] réside un habile consul, avec toutes
les personnes de la même nation, qu'elles soient résidentes [à Alexandrie] ou [seulement] de passage. On
nous amena chez les Français parce que nous venions de France et ne pouvions converser qu'avec eux.
Pour notre pension nous avons payé dix dollars par mois.
On compte dix milles anglais de Bicaire à Alexandrie. Le chemin est plein de palmiers et de câpres, mais [on
voit] peu de blé ou de bétail dans toute la région autour d'Alexandrie. Tous les deux milles nous trouvâmes
des cavités pleines d'eau et des citernes [creusées] dans la terre [et] remplies d'eau, avec des gobelets pour
que les passants et les voyageurs [puissent] boire. Près de plusieurs de ces cavités, il y a des gens qui
puisant l'eau pour ceux qui demandent. Ils le font par charité. Toutes ces cavités sont remplies par le Nil
quand il déborde, et ainsi le pays est fourni [en eau] jusqu'à l'année suivante.
Alexandrie est maintenant entourée de deux murailles distantes l'une de l'autre de vingt pieds. La muraille
intérieure a 28 pieds de haut, l'extérieure [en ayant] seulement 22. Il y a quatre grandes tours carrées sur la
muraille intérieure, chaque tour [ayant] trois étages avec des voûtes. Il y a là [en outre] 200 petites tours, et
beaucoup d'autres sur la muraille extérieure, où beaucoup de sections sont en ruines faute de réparations. Il
n'y a rien à voir ici qui ait gardé sa forme première, à l'exception de quelques-uns des nombreux réservoirs
qui servent à garder l'eau. Jadis il n'y avait pratiquement pas de place dans la ville qui n'eût une cavité
voûtée souterraine, si bien qu'on peut se demander lesquels étaient les plus grands : les bâtiments sur la
terre ou dessous. Ces réservoirs ont 18 pieds de profondeur, sont voûtées, et sont construits avec des
pierres de taille ; ils ont de piliers de la même [matière] et d'autres [pierres de taille] posées en travers,
comme des poutres de bois pour rendre l'ensemble plus solide. L'ouverture de ces réservoirs est ronde, [elle
est] entourée de marbre blanc, ce dernier étant d'une seule pièce découpée en forme d'anneau. Quand le Nil
déborde, l'eau est amenée dans ces réservoirs par des conduits cachés installés sous terre. [Les habitants]
s'en contentent jusqu'à l'année suivante, car, à part le Nil, on ne trouve ni sources ni rivières dans ce pays.
Et quoique à l'encontre de l'opinion de beaucoup de gens, il y a ici parfois en hiver des pluies très
abondantes, le terrain sablonneux l'absorbe aussitôt, à l'exception de ce qu'on recueille dans des récipients
avant [que l'eau] ne tombe par terre.
Sur le côté sud de la ville, il n'y a maintenant rien à voir, sauf les ruines d'une cité ; il n'y a pas non plus de
restes d'anciens bâtiments encore debout à l'intérieur de la ville, à l'exception de deux rues où les
commerçants ont leurs magasins. L'une des rues est recouverte de bois et est pavée. Les Francs sont
obligés de vivre [dans l'espace compris] entre les murailles. Chaque nuit, un fonctionnaire qui vient du
château fort, ferme les fondiques à six heures. Après quoi, personne ne peut ni sortir, ni entrer, jusqu'à ce
que le fonctionnaire vienne ouvrir le portail, ce qu'il fait à cinq heures du matin.
Les Juifs, les Turcs et les Maures habitent à l'extérieur des murailles, près du rivage, à côté du port, pour
pouvoir embarquer et débarquer plus commodément les marchandises, car pour toute marchandise qui est
apportée ici, on paye [en taxes] un cinquième [de la valeur] en nature. Il y a un cadi qui réside à Alexandrie
et qui administre la justice.
Il y a deux ports ; celui sur le côté ouest de la ville, appelé le nouveau [port] et ayant la forme d'un croissant,
est ouvert aux vents du nord qui, lorsqu'ils soufflent, sont très dangereux, comme [en fit l'expérience] un
grand galion de 1000 tonnes chargé de lin, appartenant à un Turc. Par la violence du vent, il fut chassé vers
la côte [illisible] malgré la présence de seize ancres, et fut brisé en morceaux ; les hommes se sauvèrent
grâce à un navire turc, non sans [illisible] pour ceux qui risquèrent leur vie, dans le long bateau, pour sauver
les autres. De chaque côté de l'entrée du port, il y a un château fort pour protéger le port. Le port à l'ouest,
est réservé aux galères du Grand Seigneur et des Turcs. Les Francs ne sont pas autorisés à y jeter l'ancre.
Après avoir visité la colonne Pompée, l'église Sainte-Catherine « ou les Grecs et les Latins ont chacun un
autel », et l'aiguille de Cléopâtre, notre Ecossais inspecte de nouveau les murailles.
Les murailles514 en ruines sont couvertes de tas de débris. Il y en a deux [de ces murailles] qui dépassent les
autres ; l'une [est située] vers l'extrémité orientale de la ville ; sur son sommet, on a préparé un emplacement
pour la sépulture des morts. Du haut de chacune [de ces collines artificielles] on a une bonne vue sur la ville
et le port, le lac et les alentours. Sur le sommet de la colline située vers l'extrémité occidentale de la ville, il y
a une petite tour où l'on place un drapeau à l'approche de tout navire [qui se dirige] vers le port ou la côte.
Le 30 janvier nous fûmes invités par un homme important, appelé [jadis] Don Philipo Gambine, mais qui est
redevenu musulman. Il est le fils du roi de Tunis. Nous allâmes à sa maison où nous nous attendions à
dîner. Après une heure de conversation en italien, il nous emmena, à bord d'un petit bateau, en emportant
une bonne quantité de provisions pour le dîner. Nous allâmes, à la rame, le long de l'extrémité occidentale
de la ville, jusque dans le port vieux. Lorsque nous nous fûmes un peu éloignés [du rivage], il dit à un
esclave de quitter [le bateau] ; ce dernier plongea aussitôt jusqu'au fond et, y ayant rampé, il attrapa une
sorte de crustacé en forme de moule, long d'un quarter515 et large d'un demi-quarter, qu'il transporta sous un
bras [tout] en nageant avec l'autre, et l'apporta à bord [du bateau] ; il ne l'eût pas plutôt remis, qu'il
redescendit au fond, après s'être reposé un peu, accroché au bord du bateau. Il le fit quatre fois, jusqu'à ce
que nous ayons autant [de poissons] que nous en voulions pour notre repas.
Nous débarquâmes à l'extrémité sud-ouest de la ville, à une distance de deux furlongs516 à l'ouest de la
colonne Pompée ; une table y avait été dressée dans une grotte taillée dans le rocher sur le rivage de la
mer. Au premier abord, nous ne pûmes comprendre pour quel usage une grotte eut été creusée dans cet
endroit ; mais en y réfléchissant et en cherchant tout autour, nous en trouvâmes encore un grand nombre, et
nous comprîmes, [en examinant] leur forme et [en comptant] leur nombre, que c'étaient des sépulcres
destinés aux morts ; il y avait là des cercueils, taillés dans le roc, pour des hommes, des garçons et des
enfants ; c'étaient, semble-t-il, des sépulcres de l'ancienne ville ; on pouvait en voir plus de 300, quoique la
mer en eut dégradé un grand nombre par la violence de ses vagues, contrairement aux intentions des
premiers maîtres qui pensaient conserver le corps puis qu'ils ne pouvaient y retenir l'âme ; et c'est étrange
de voir certaines de ces tombes à seize pieds à l'intérieur de la mer, [elle] qui était, probablement, jadis à
seize pieds de là.
Mais pour en revenir [à mon récit] - de crainte que je n'oublie notre dîner. Notre table était placée haut, pas
selon la coutume turque [suivant laquelle] on s'assied par terre. Mais lui [Don Philipo] par courtoisie, s'était
conformé aux coutumes franques au lieu de nous obliger à suivre [ses coutumes] à lui, et avait fait apporter
des chaises. On nous servit deux plats de viande avec notre crustacé comme dessert (sic). Nous dinâmes
copieusement ; puis on nous divertit avec une harpe et un cornet, ce qui transforma le sépulcre adjacent en
salle de musique.
Nous y restâmes quatre heures, passant notre temps à parler de l'Angleterre et d'autres contrées de la
chrétienté que Don Philipo connaissait bien, ayant vécu deux ans en Espagne où il se faisait passer pour
chrétien et recevait 2.000 pièces de huit du roi d'Espagne. Mais persuadé par son père, [un homme] très
riche et roi de Tunis, il revint dans son pays et à sa religion, mais conserva toutefois du respect et de la
sympathie [pour les chrétiens et les rapporta sur] tous les esclaves chrétiens qui le servaient ; [lorsqu'il] était
obligé d'en vendre quelques-uns, il ne les vendait qu'à un chrétien. Pendant notre conversation, il dit que [le
fait], pour le peuple anglais d'avoir exécuté son roi517 était une action détestable et qui avait suscité
l'étonnement dans le monde entier.
Le soleil s'étant couché, nous nous rembarquâmes et retournâmes à la maison où nous passâmes la nuit,
car il ne voulut pas nous laisser sortir si tard. Malgré le copieux dîner que nous avions fait, la quantité de
nourriture qu'on nous donna au souper fut aussi abondante et fut servie de la même manière [que le dîner].
Il [Don Philipo] but largement [à notre santé], cassant [ensuite] les verres, ce que nous fîmes également.
Nos lits furent de belles couvertures, posées par terre sur des tapis persans, et recouvertes de draps de
batiste, bordées d'argent, comme ils ont l'habitude de les tisser dans ces contrées.
Le matin, ayant bu une timbale d'eau-de-vie, et ayant reçu en présent [illisible], nous partîmes, pour
[entreprendre] le voyage [à destination] du Grand Caire. »518
513 C’est une monnaie qui portait une tête de lion et que les Égyptiens (croyant que c’était une tête de chien)
appelaient abu kelb. Toutes les notes de ce texte sont de O. V. Volkoff.
514 Le mot muraille signifie ici colline.
515 Neuf inches : environ 23 centimètres.
516 400 mètres environ.
517 Charles 1er fut exécuté le 9 février 1649.
518 Traduction : K. M. Pickavance (archives Sauneron, Ifao).
- 446 - 447 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN DE THÉVENOT (du 1er au 16 janvier 1657)
Thévenot, J. de, Relation d’un voyage fait au Levant, Paris, 1664.
Jean de Thévenot (1633/1667), en possession d’une fortune considérable, peut assouvir sa passion des
voyages à peine ses études achevées. Ayant une grande facilité pour les langues, il maîtrise le turc, l’arabe
et le persan. La fin de sa vie se résume en une suite de voyages qui le conduisent jusqu’en Inde. Épuisé, il
meurt dans une petite ville d’Arménie en 1667.
Jean de Thévenot accomplit deux voyages à Alexandrie, du 1er au 16 janvier 1657 et du 14 au 18 février
1664, voir infra.519
p. 225-231 :
D’Alexandrie
« J’ai dit dans le livre précedent comme nous arrivâmes après une longue navigation à Alexandrie, où on
vient de Chio ordinairement en sept ou huit jours, j’attendis à Alexandrie quelques jours que le tems fut bon
pour passer avec la Saïque à Rosette : mais voiant que le vent ne changeoit point, & qu’apparemment la
Saïque ne pourroit passer à Rosette d’un mois, je débarquai mes hardes, & résolus d’y aller par terre : avant
que de partir je vis tout ce qu’il y a de beau à Alexandrie, cette ville appelée des Turcs Skenderia, autrefois,
si fameuse, si riche, & si belle, est à present tellement ruïnée, qu’elle n’est pas elle même : on n’y voit que
des masures entassées les unes sur les autres, & les amas de pierres & de terre qui y sont de tous côtez
sont plus hauts que les maisons. Les François y sont logés dans un fondic, qui est une grande maison
comme un Han, il y a encore d’autres fondics pour les Anglois, les Flamands, les Venitiens & autres, & ils ne
païent rien pour ce logement, au contraire, les consuls reçoivent tous les ans de l’argent du Grand Seigneur
pour y faire les réparations nécessaires. On ferme tous les soirs ces fondics par dehors, & on en porte les
clefs à l’Aga du Château, qui a soin de les renvoier tous les matins. On les ferme encore, & aussi la porte de
la Marine tous les vendredis durant la priere de Midi, comme au Caire la porte du Château, & on fait ainsi en
tous les endroits de l’Empire Turc où il y a des Francs, parce qu’ils disent avoir une prophetie qui les menace
que les Francs se doivent rendre maîtres d’eux un vendredi durant la priere du Midi. Il ne reste presque plus
rien sur pié de l’ancienne Alexandrie, que les murailles, & quelques bâtimens, la plupart ruïnez, vers le
fondic des François, car les bâtiments qui sont à present vers la marine ne sont point anciens, mais ils ont
été bâtis par les Turcs comme il est aisé de le voir à la façon, étant toutes maisons basses & malfaites. Cette
ville a trois ports, dont le premier est appelé le vieux port, il est assez grand, mais peu de vaisseaux y
entrent, parce que son entrée est difficile ; il y a deux Châteaux qui en défendent l’abord, un de chaque côté,
& tous deux biens gardez, les deux autres ports sont plus haut, & sont divisez l’un de l’autre par une petite
ile autrefois plus éloignée de terre ferme qu’elle n’est à présent, & anciennement appelé le Phare, elle est
maintenant jointe à la terre ferme par un pont de pierre de quelques arches, sous lesquelles passe l’eau.
Cette ile s’avance assez loin en Mer, il y a une tour quarrée au milieu qui sert pour mettre les poudres du
Grand Seigneur : au bout de cette même ile est un bon Château appelé Farillon, & situé au propre lieu où
étoit jadis ce Phare tant renommé, qui fut estimé une des sept merveilles du monde, celui qui est à sa place,
est assez beau, & bien garni d’artillerie, avec trois cent soldats, & un Muteferaca qui y commande, mais il n’y
a point d’autre eau que celle du Nil, qu’on y apporte de dehors sur des chameaux : le premier des deux ports
divisez par le Phare, est celui des galeres, & il n’y entre aussi que des galeres, & l’autre est le grand port, ou
le port neuf, dont la bouche est gardée d’un côté du Farillon, & de l’autre côté, à son entrée par un autre petit
Château, qui n’est pas si bon que le Farillon, cependant on y tient encore plusieurs soldats, & ces deux
Châteaux se secourent facilement l’un l’autre ; tous ces deux ports sont fort dangereux, à cause des pierres
& des écueils qui y sont, & pour y entrer il faut avoir quelqu’un qui soit pratic des passages, le grand port
souffre beaucoup du Gregal ou Nord-est, & de la Tramontane ou Nord ; le port des galeres est plus sur, mais
il n’a pas grand fond, aussi ne sert-il qu’aux galeres, comme j’ai dit : sur le bord du grand port est le bureau
de la Doüane d’Alexandrie, de laquelle dépend celle de Rosette, on la donne en parti à un Turc, qu’on
appelle pour cela Multezin ou partisan, il en rend au Grand Seigneur trois cent bourses par an, qui font deux
cent vingt-sept mille deux cent soixante douze piastres vingt-quatre maidins, cependant il n’en a point de
peine, car il la fait exercer par un Juif, auquel il donne une bourse par an, qui font vingt-cinq mille maidins :
on appelle le Juif a cet emploi Maalem, & il tient encore sous lui d’autres Juifs, pour le soulager : le Juif qui a
cet emploi est puissant, & il peut bien servir ou nuire à plusieurs par ses intrigues : comme ce sont les Juifs
qui tiennent la Doüane, il ne s’y fait rien le Samedi, par ce que c’est leur Sabath, & cependant on ne peut
charger ni décharger aucun vaisseau, que la Doüane ne soit ouverte. Il y a encore un autre Bureau de la
Doüane, qu’on voit à main droite en allant du fondic des François à la marine, assez près de la porte de la
Marine, on l’appelle la vieille Doüane, elle est éloignée de la mer de plus de quatre cent pas, quoi
qu’autrefois la mer en batoit les murailles : on y tient encore des Janissaires à la porte, pour prendre quelque
chose sur toutes les marchandises qui passent, afin de ne pas perdre point leurs droits. Il y a dans
Alexandrie deux petites montagnes, faites de ruines assemblées, l’une desquelles se voit fort bien du fondic
de France ; sur le haut de laquelle est une petite tour quarrée, où il y a toûjours un homme en sentinelle, qui
fait banniere aussi-tôt qu’il découvre quelque voile, & on tire quelque droit sur chaque vaisseau qui entre
dans le port, pour entretenir cette garde. Alexandrie dépend du Beglerbey ou Bacha d’Egypte, qui fait sa
residence au Caire ; & il y a dans la dite ville d’Alexandrie un Aga qui represente sa personne, & y
commande ; il y a aussi un grand Cadi ou Moula, qui a d’autres Cadis sous soi, il y a encore deux
Sous-Bachis, l’un de la ville, & l’autre de la marine : tous les Agas des Châteaux d’Alexandrie dépendent
aussi du Bacha d’Egypte, qui y met qui il veut.
Des murailles d’Alexandrie, de la colonne de Pompée, k autres antiquitez
J’ai dit ci-devant qu’Alexandrie est tellement ruïnée, qu’il est arrivé à plusieurs étrangers de demander où
elle étoit lorsqu’ils étoient au milieu : mais parmi ces ruïnes on trouve de si beaux restes, qu’ils font bien
connoître que cette ville a été des plus riches & des plus superbes, une des plus plus belles choses qu’on y
voie sont ses murailles, qui quoi ruïnées, sont encore si magnifiques, qu’on est forcé d’avouër, qu’elles n’ont
jamais eu leurs pareilles, il y en a même une bonne partie en son entier, & il faloit qu’elles fussent bien
bâties, pour avoir tant subsisté ; ces murailles ont leurs fausse braies, & sont flanquées de grandes Tours
quarrées, éloignées d’environ deux cent pas l’une de l’autre, & entre deux il y en a une petite : ces belles
murailles sont bâties de telle sorte, que dessous il y a des casemates magnifiques, qui peuvent servir de
galeries & de promenade : j’avois toûjours souhaité passionnément d’entrer dans quelques-unes de ces
tours, pour en bien considérer la beauté, mais je n’avois encore osé, crainte d’avanie ; un jour étant entré
avec un autre François dans la vieille Doüane, dont j’ai parlé ci-dessus, & qui n’est qu’une grande place
sans bâtiment, y aiant trouvé un Turc qui paraoissoit de bonne volonté, nous le priâmes de nous mener dans
les tours des anciennes murailles qui sont là proches, ce qu’il nous accorda fort volontiers ; nous entrâmes
donc dans deux de ces tours, qui sont faites l’une comme l’autre, il y a dans chaque tour en bas une grande
sale quarrée, dont la voute est toute soutenuë de grosses colonnes de pierres Thebaïques : en haut on y
voit plusieurs chambres, & tout au haut est une grande plate-forme quarrée de plus de vingt pas ; enfin
toutes ces tours étoient autant de palais, elles sont capables de tenir chacune deux cent hommes, leur
muraille est épaisse de plusieurs piez, par tout il y a des embrasûres, dans chacune de ces tours il y a
plusieurs cîternes, de sorte qu’il faloit une armée à chaque tour pour la prendre : toute la ville ancienne étoit
entourée de ces belles murailles, garnies par tout de semblables tours, qui sont maintenant la plupart
ruïnées, celles où nous entrâmes étoient assez entières : il y a danger d’aller voir ces tours, car les Turcs y
trouvant des Francs, prennent sujet de leur en faire une avanie, disant que ce sont des espions, ou autres
choses semblables, & il n’y a que l’argent qui les en puisse tirer, & ainsi on païe bien sa curiosité ; pour moi,
lorsque j’y allai, j’étois avec un François qui avoit si grand’peur que nous n’y fussions surpris, qu’il n’avoit
aucune satisfaction, quoi qu’il y eut plusieurs années qu’il étoit dans le païs ; ce qui nous assûroit un peu,
c’étoit le Turc qui alloit devant nous. Après ces murailles la plus belle des pièces antiques qui ont resisté au
tems, est la colonne de Pompée, qui est éloignée de la ville d’environ deux cent pas, elle est sur une petite
éminence, ce qui fait qu’elle se voit de fort loin, & elle est posée sur un piedestal quarré, haut de plus de
sept ou huit piez, & ledit piedestal est sur une base quarrée, large d’environ vingt piez, & haute de deux ou
environ, mais faite de plusieurs grosses pierres, pour le fut de la colonne, il est tout d’une pièce de granite si
haute, qu’elle n’a pas au monde sa pareille, car elle a dix-huit cannes de haut, & est si grosse, qu’il faut six
personnes pour l’embrasser ; au haut est un beau chapiteau. Il y a eu des personnes qui ont cru que cette
colonne étoit de trois pièces, l’aiant ouï dire aux Mores, qui y comptent trois pièces, savoir le piedestal, le fut
& le chapiteau, comme ils m’ont dit eux-mêmes, mais le fut est tout d’une pièce, comme on le voit bien
clairement : je ne sai pas qu’elles machines ils avoient en ce tems-là, avec lesquelles ils pussent élever une
telle pièce, & peu s’en faut que je ne croie avec plusieurs autres qu’elle a été faite d’un certain ciment &
pêtrie sur le lieu même, quoi qu’il se trouve assez de personnes qui nient cela absolûment, disant que les
anciens Egyptiens prennoient ces colonnes, & ces aiguilles, (qui se voient en tant d’endroits d’Italie, & sont
de même matière,) au Sahid, où ils prétendent qu’on en a taillé plusieurs, & qu’ils les amenoient sur le Nil ; si
cela est, il faloit qu’ils eussent des barques ou des trains fort extraordinaires, pour conduire un tel poids, &
en si grand volume : il est vrai aussi que s’ils avoient le secret de pêtrir ou fondre les pierres, nous l’avons
perdu, & aucun des Anciens n’en à parler. Ces sortes de pierres sont fort belles, car elles sont grisâtres &
marquetées de plusieurs couleurs & extrêmement dures, leur superficie semble couverte toute de petits
grains. On dit que Cesar fit dresser cette colonne en mémoire de la victoire remportée sur Pompée : à
quelques pas de la est le Palais de Cesar tout ruïné, seulement on y voit quelques colonnes de porphyre en
leur entier & sur leur pié, & la face du Palais en est encore assez entiere, qui est une fort belle chose : à côté
de cette colonne, à soixante ou quatre vingts pas de là, est un Hhalis ou canal du Nil, que les anciens
Egyptiens firent creuser pour conduire l’eau du Nil à Alexandrie, n’aiant point d’autre eau à boire : ce canal
qui est environ aussi large que celui qui passe par le Caire, dont nous parlerons ci-après, commence à
environ six lieuës au dessus de Rosette au bord du Nil & vient de là à Alexandrie, & lorsque le Nil est cru, on
lui donne passage par ce Hhalis, en rompant une digue, comme nous dirons à celui du Caire, & cette eau
remplit les cîternes, qui sont faites exprès sous la ville, & sont très-magnifiques, & de grande étenduë, car
tout le dessous de l’ancienne Alexandrie est creux, étant tout une cîterne dont les voutes sont soutenuës de
plusieurs belles colonnes de marbre, & sur ces voutes étoient bâties les maisons d’Alexandrie, ce qui a fait
dire à plusieurs qu'il y avoit en Alexandrie sous terre une ville aussi grande que dessus, & quelques
personnes m'ont assûré qu'on peut encore à présent aller dessous toute la ville d'Alexandrie par de belles
ruës, dans lesquelles on voit encore des boutiques, mais les Turcs ne permettent pas qu'on y descende.
L'eau du Nil qui entre ainsi dans ce Hhalis, sous la ville, sert pour boire toute l'année, car chaque maison en
fait tirer par des pousseragues qui la versent dans la cîterne particulière de la maison à mesure qu'ils la
tirent. Ces pousseragues sont des rouës où il y a une corde en chapelet sans bout, l'entour de laquelle sont
attachez plusieurs pots de terre, qui remontant toûjours pleins d'eau, la versent dans un canal, qui la conduit
où on veut. Mais dans le mois d'Août & de Septembre, qui est le tems qu'on emplit les cîternes, cette eau
nouvelle est mal-saine, & il y a peu de ceux qui en boivent, qui eschappent de quelque maladie ; c’est
pourquoi plusieurs en gardent de celle de l’année précedente, pour jusqu’en novembre. Outre cette
incommodité, durant les mois de Juillet, d’Août, de Septembre, & d’Octobre, l'air d'Alexandrie est si mauvais,
que beaucoup de ceux qui couchent en terre durant ce tems-là, y gagnent des fievres quartes, qui durent
quelquefois plusieurs années, aiant connu de telles personnes, qui les ont gardées huit ans. Ceux qui
couchent dans les vaisseaux, quoi qu'ils soient dans le port, ne prennent point ce mauvais air. Mais pour
retourner au Hhalis, il est bordé de jardins, qui sont remplis de limoniers & d’orangers, il y a aussi grande
quantité d’arbres portant de certains fruits semblables à des oranges, mais qui sont si gros, qu’on ne les
peut empoigner des deux mains. Ces fruits ne sont pas bons à manger cruds, mais ils en ôtent la peau, puis
les coupent en quartiers, & en aiant ensuite ôté l’aigre, les confissent, & ces confitures sont très excellentes.
Pour les limons, il y en a de deux sortes, de fort gros qui ne sont pas bons à manger, & de petits comme des
noix, qui sont les meilleurs, parce qu'ils ne sont que jus, ayant la peau fort mince, on se sert de leur jus sur
les viandes, & on en tire aussi le jus des pressoirs, dont on emplit plusieurs muids qu'on envoye à Venise et
autres lieux. Ce jus sert aussi pour faire le sorbet. Il y a dans ces jardins des caffiers, et des carroubiers, &
plusieurs autres semblables arbres, la campagne d’Alexandrie est remplie de palmiers & de capriers. Après
avoir vû ces choses, je rentrai dans la ville par la porte de Rosette, où il y a plusieurs belles colonnes de
porphyre, & j’allai voir l’Eglise de Sainte Catherine, tenuë des Grecs ; on y voit la pierre sur laquelle cette
Sainte Vierge eût la tête coupée. Cette pierre est comme un morceau de colonne ronde, elle est haute de
près de deux piez, & percée d’un bout à l’autre d’un trou à mettre le poing ; les Grecs disent que ce fut
justement sur ce trou qu’on lui coupa la tête, comme on peut voir par les marques qui sont dans ledit trou,
lequel est tout taché de sang & de graisse tout à l’entour par dedans ainsi que je l’ai vû fort clairement : cette
pierre est sur pilher de marbre haut d’environ quatre piez, que les Grecs ont fait faire exprès pour mettre
ladite pierre dessus, ensuite j’allai voir l’Eglise de Saint Marc, tenuë par les Cofftes, dans laquelle se voit la
chaise où montoit ledit Saint pour prêcher, comme aussi un tableau de Saint Michel qu’on dit avoir été fait
par Saint Luc. Saint Marc fut le premier patriarche d’Alexandrie, & il y fut martyrise l’an 64 son corps fut
conservé dans cette Eglise, jusqu’à ce que des Marchands Venitiens le transporterent à Venise. Après cela
passant sur le chemin de Rosette dans la ville, on me montra les restes du Palais du pere de Sainte
Catherine, qui ne sont presque plus rien : on voit aussi en cet endroit tout du long du chemin quantité de
belles colonnes de porphyre : d’un autre côté je vis deux fort belles aiguilles de granite, comme celles qui
sont à Rome en plusieurs places, & figurées de hieroglyphes de même : il n’y en a qu’une debout sans
piedestal, l’autre est enfoncée en terre, & ne s’en voit dehors que le pié, de la longueur d’environ dix piez,
elles sont toutes deux chacune d’une pièce, & de même grosseur, & peut-être plus grosses que celles de
Rome : là proche de ces aiguilles se voient les restes du Palais de Cleopatre qui est tout ruïné. Ils ont là tant
de marbre, de porphyre & de granite qu’ils n’en savent que faire, aussi en garnissent-ils leurs portes, celle de
la Marine est garnie de quatre belles pierres Thebaïques ou de granite, une de chaque côté, une en haut de
travers, & une en bas, & cependant cette porte est fort haute & large, aussi n’ont ils qu’à ôter la terre qui
couvre ces belles piéces, & les transporter : il se trouve encore parmi les ruines de cette ville certaines
pierres fort curieuses, ce sont toutes petites pierres comme des medailles qui sont de corniole, agathe,
granats, émeraudes & autres semblables, elles sont toutes gravées, l’une d’une tête, ou d’une idole, l’autre
d’une bête, & ainsi toutes de differentes choses, qui ont servi autrefois de medailles ou de Talismans,
c’est-à-dire, charmes, mais la plupart de ces gravûres sont si excellentes, qu’assûrément on ne sauroit
aujourd’hui si bien faire que sont certaines que j’ai vûës, & dont j’ai quelques-unes, de sorte qu’il faloit qu’ils
eussent en ce tems-là d’habiles graveurs, & même je trouve qu’on peut douter s’ils n’avoient point quelque
secret pour fondre, ou au moins amollir ces pierres, car il y en a de si petites, qu’à peine les peut-on manier,
& toutefois elles sont parfaitement bien gravées. Quand il pleut, les Mores en vont chercher parmi les ruïnes,
& ne manquent jamais d’en trouver, ensuite, ils les viennent vendre aux Francs pour peu de chose, si ce
n’est depuis quelque tems, qu’ils les tiennent un peu plus cheres à cause de la presse qu’y apportent les
Francs qui y viennent mettre l’enchere l’un sur l’autre : pour voir toutes ces antiquitez, on monte sur des
petits ânes, qui vont fort vîte, & d'un bon trot, qui ne tracassent point, et galloppent même quand on veut, car
les Chrêtiens Francs ou non, ne peuvent pas en Egypte aller dans les villes sur des chevaux, mais à la
campagne ils peuvent aller à cheval s'ils veulent. On trouve dans les ruës ces ânes tout prêts, & on n'a qu'à
monter dessus, et on se promène toute une après-dinée sur ces ânes pour environ sept ou huit sous
chacun, savoir la moitié pour l’âne, & autant pour un More qui va derriere à pié, batant & piquant l'âne de
tems en tems, pour le faire aller.
Ayant vû à Alexandrie ce que je croiois y devoir voir, je pris des montures pour aller à Rosette, & je partis
d’Alexandrie le Samedi sixiéme Janvier au matin avec un Janissaire que le Vice-Consul François me donna
pour m’accompagner jusque-là. »
- 448 - 451 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LAURENT D’ARVIEUX (1658)
Arvieux, L. d’, Mémoires du chevalier d’Arvieux contentant ses voyages à Constantinople, dans l’Asie, la
Syrie, la Palestine, l’Egypte et la Barbarie, par J. B. Labat, Paris, 1735.
Laurent d’Arvieux, né à Marseille en 1635, a, dès son enfance, une grande passion pour les études de
langues et pour les voyages. Il séjourne douze ans, de 1653 à 1665, dans les différentes Échelles du Levant
pour y apprendre le persan, l’arabe, l’hébreu. C’est au cours de cette période qu’il visite l’Égypte. À son
retour à Marseille, l’Intendant de Provence le charge d’accompagner un émissaire royal à Tunis afin de faire
libérer près de quatre cents Français détenus comme esclaves dans la Régence. Suite à ce succès, Laurent
d’Arvieux décide de rejoindre la cour royale de Paris. En 1669, un émissaire extraordinaire de la Sublime
Porte est délégué en France afin de régler plusieurs questions ayant trait au commerce du Levant. Laurent
d’Arvieux est choisi pour être son interprète. À cette occasion, il s’attire la bienveillance du ministre Colbert
qui lui propose d’être à la tête de l’ambassade de Constantinople. On choisit néanmoins à sa place le
magistrat de Nointel. Mais quelques mois plus tard, suite aux obstacles rencontrés par cette ambassade, on
décide de charger le chevalier d’Arvieux d’une mission extraordinaire auprès de la Sublime Porte. En
attendant d’obtenir une fonction, Laurent d’Arvieux est précepteur pour la famille des princes d’Enrichemont.
Son second séjour au Levant débute en 1679, date à laquelle il est nommé consul à Alep où il reste jusqu’en
1686. Puis, il rentre en France pour vivre dans la région de Marseille sans activités publiques jusqu’en 1702,
année de sa mort.520
p. 174-213 (tome I) :
« Description d’Alexandrie
Tout le monde connoît le Fondateur de cette ville, ce qui me dispense d’en parler ; d’autant qu’il n’y a
là-dessus aucune contestation entre les sçavans. Elle étoit si grande, si magnifique, & si peuplée, qu’elle a
été pendant bien des siecles la capitale de toute l’Egypte, la résidence de ses Princes, ou de ceux qui
gouvernoient cet Etat, après que les Romains en eurent fait la conquête. Ce ne fut qu’après qu’elle cessa de
joüir de cet avantage, & que le siege royal fut transferé au Caire. Elle souffrit tant dans cette (p. 175) prise,
qu’excepté ses murailles, la plûpart de ses édifices publics, qui étoient en grand nombre, & d’une
magnificence extraordinaire, furent ruinez de fond en comble. Ceux des particuliers eurent le même sort, une
quantité prodigieuse de peuple fut réduite en esclavage, son commerce se perdit ; & sans son port, dont
l’Egypte & les autres païs ne pouvoient se passer, il y a bien des siecles qu’on auroit peut-être oublié son
nom & sa situation.
Ses premieres murailles sont encore sur pied, malgré le grand nombre de siecles qu’il y a qu’elles ont été
élevées. Excepté les bréches qu’on y a faites, quand elle a été assiégée, elles sont encore assez entieres.
La ville est ovalle ; elle est située dans un terrain uni, qui a la mer au Nord, le grand Lac Maréotis au Midi, à
l’Est le grand canal appellé le Calis, par lequel on conduit l’eau du Nil dans toutes les cîternes de la ville
pendant les mois d’août et de septembre, qui est le tems que l’accroissement des eaux de ce fleuve inonde
les campagnes, & rend l’Egypte le païs le plus fertile qu’il y ait au monde. Ce tems passé, le Calis est à sec.
Le côté de l’Oüest est occupé par des (p. 176) jardins, ou plûtôt par des vergers plantez de palmiers,
d’orangers, de citronniers, de grenadiers, de figuiers, de caroubiers, & autres arbres.
Le grand commerce qui se fait encore à Alexandrie, que les Turcs appellent Scandarona, y attire toutes les
Nations de l’Europe ; elles y ont toutes leurs Fondiques, qui sont de très-grandes maisons comme les Kans,
ou Karavan-Serails. Ils ont au milieu une cour spacieuse, toute environnée de portiques, par lesquels on
entre dans les appartemens des Marchands. On ne paye rien pour le logement ; on m’a assuré au contraire,
que les Vice-Consuls qui y resident reçoivent tous les ans, ou doivent recevoir une somme, que le Grand
Seigneur leur fait donner pour l’entretien de ces bâtimens.
L’on ferme tous les soirs à une heure marquée les portes des Fondiques, & l’on en porte les clefs à l’Aga du
château, chez lequel le portier les va reprendre tous les matins pour ouvrir aux Marchands.
On les ferme encore aussi bien que celles du château, de la ville, des bazards ou marchez, & des autres
lieux publics, les vendredis avant midi. Le vulgaire croit, & tâche de persuader (p. 177) aux Etrangers, qu’ils
ont une prophetie parmi eux, qui assure qu’un jour de vendredi les Chrétiens surprendront l’Empire Ottoman,
lorsque les Turcs seront à la prière de midi. Il est plus probable qu’ils prennent cette précaution, afin que tout
le monde se trouve à la priere, comme nous obligeons les Artisans et les Marchands de fermer leurs
boutiques les jours de Dimanches & de Fêtes.
On pourroit distinguer Alexandrie, en vieille & nouvelle. La vieille est renfermée dans l’enceinte de ses
superbes & très-anciennes murailles, & ne contient que des masures, des cîternes, & des monceaux de
ruines, très belles à la vérité, mais qui font gémir les curieux.
La nouvelle a été bâtie par les Turcs, depuis qu’ils en ont fait la conquête.
Dans les tems passez, la mer baignoit les murailles de l’ancienne ville. Elle s’est beaucoup retirée, & a laissé
un fort grand espace entre son rivage & les murailles. C’est dans cet espace que sont bâties les maisons,
qui composent à présent la ville neuve.
Le port par la même raison a changé de situation. Il ne laisse pas d’être (p. 178) encore fort vaste ; mais il
n’est ni bien net, ni bien sûr, & ne laisse pas de recevoir tous les jours un nombre presque infini de bâtimens
de toutes les especes, & de toutes les Nations d’Europe & de l’Asie Mineure, qui y apportent des
marchandises de leur Païs, & en chargent du cru de l’Egypte, ou qui viennent de la Perse, de l’Arabie & des
Indes, soit par terre, soit par la Mer Rouge.
Ce vaste port a la figure d’un croissant. Il est difficile d’y entrer, sans de grands risques, à moins qu’on ne
soit conduit par un pilote du pays, habile & expérimenté, pour faire éviter deux écüeils dangereux qui sont à
son entrée. Celui qui est devant la corne droite du croissant s'appelle le Diamant ; l'autre, qui est à quelque
distance, se nomme le Gérofle ; ils s'élèvent l'un et l'autre en pointe au-dessus de la surface de la mer.
On dit qu'un vaisseau chargé d'épiceries s'étant brisé contre le dernier a été l'occasion de le nommer le
Gérofle. Il y a apparence qu'ils avoient d'autres noms dans l'antiquité qui ne sont pas venus jusqu'à nous.
Le reste de ce grand espace, est partagé par une Isle qu’on appelloit (p. 179) autrefois le Phare, c’est-à-dire,
la Tour de Lanterne, où l’on mettoit des lumieres pendant la nuit, pour guider les vaisseaux qui vouloient
entrer dans le port. Cette tour étoit si superbe, qu’on la comptoit parmi les sept merveilles du monde : il y a
long-tems qu’elle est détruite. Elle étoit fort avant dans la mer, elle est à présent jointe à la terre ferme, par
un pont de pierres sous lequel l’eau de la mer passe.
Cette Isle partage le port en deux. Celui qui est à la gauche s’appelle le vieux port. Il est peu frequenté,
parce que son entrée est difficile. Celui de la droite se nomme le Port-Neuf. Il est bien plus frequenté que les
deux autres. C’est un flux & un reflux continuel de bâtimens qui y entrent, & qui en sortent, quoiqu’il soit
exposé aux vents du Nord, qui sont fort furieux dans certains tems.
Vers le milieu de cette Isle, est une Tour quarrée, où l’on conserve les poudres du Grand Seigneur ; & au
bout qui regarde le Nord & la mer, est un château bâti, à ce qu’on croît, sur les ruines de l’ancien Phare, qui
est assez fort pour le païs, bien garni d’artillerie, avec une bonne garnison de Janissaires commandez par
un Aga. On (p. 180) l’appelle le Pharillon, ou le petit Phare : il est vrai qu’il a un défaut considérable, il
manque d’eau absolument, & il n’a que celle du Nil qu’on y porte sur des chameaux.
Le vieux Port est destiné pour les galères, & autres bâtimens qui ne tirent pas beaucoup d’eau. Le Port Neuf
est pour les vaisseaux, qui y sont en sûreté, étant défendus par le Pharillon. L’autre port est aussi défendu
par un Château, qui n’est pas si bon, & où il ne laisse pas d’avoir un Aga & une garnison. Ces deux
châteaux se peuvent défendre l’un l’autre, & empêcher les Corsaires de venir insulter les vaisseaux & la
ville.
La Doüanne est située sur le rivage du Port Neuf. Celles de Rousset & de Boular en dépendent. Le Grand
Seigneur la donne à un partisan, qui lui en rend mille piastres par jour, c'est-à-dire trois cent cinquante mille
piastres par an : on l'appelle Multezin. Il a un premier commis, qu'on nomme le Mahalem c'était ce juif fripon,
appelé Abrahim, dont j'ai parlé ci-devant, qui a sous lui plusieurs commis et gardes de la Doüanne, de même
religion et aussi méchants que lui : c'est à cause d'eux qu'on ne charge ni ne (p. 181) décharge aucunes
marchandises le samedi. Il y a encore la vieille Doüanne, proche de la porte de la ville, où l'on paye aussi
quelques droits pour les marchandises ; mais ils sont legers, & on ne les paye à présent que parce qu'on les
payoit autrefois, & pour n'en pas abolir la coûtume.
On voit du fondique de France une petite tour quarrée, bâtie sur une des deux collines que les ruines de la
ville ont formées. Il y a un garde qui met des bannieres toutes les fois qu'il apperçoit quelque bâtiment en
mer. Il retire pour son droit d'avis quelque chose des bâtiments qui entrent dans le port.
La ville, la marine et les châteaux ont des Agas, des Soubachis, & autres officiers qui sont comme des
gouverneurs particuliers des différens quartiers de la ville. C'est le Pacha gouverneur de toute l'Egypte
résidant au Caire qui les nomme, qui les établit et les destitue de leurs emplois, quand il juge à propos, & qui
selon les apparences, a toûjours des raisons de le faire afin d'en tirer de l'argent.
Il y a un grand Cadi, que l'on appelle Moulla dans le langage du païs : (p. 182) c'est le Juge Souverain de la
police et de toutes les affaires civiles et criminelles de la ville et des environs. Il a sous lui d'autres Cadis ou
juges dans les quartiers. La justice se rend sommairement : les parties disent elles-mêmes leurs raisons, il
n’y a pas la misericorde de Dieu, ni Sergens, ni Procureurs, ni Avocats : les jugemens s’executent sans
déplacer. Si on a d’assez bonnes raisons pour obtenir un délai, il faut payer au bout du terme. Si on le laisse
passer seulement de quelques heures, le débiteur est sûr d’avoir cent coups de bâtons sous la plante des
pieds, pour lesquels il faut qu’il paye cent piastres, & quelque autre reconnoissance à ceux qui les lui ont
donnez. Le jour suivant, il en a deux cens, & ainsi en augmentant chaque jour, jusqu’à ce qu’il ait satisfait,
ou qu’il soit mort dans la peine, & pour lors le creancier perd sa dette.
Les principales denrées que l'on tire de l'Egypte sont le lin, les cuirs de buffle, les cuirs de boeuf, le cotton
filé, les toiles de lin, la casse, le caffé, le natron, le ris, les legumes, les drogueries. On transporte toutes ces
marchandises en Chrétienté, & dans les Etats du Grand Seigneur. Elles viennent (p. 183) à Alexandrie sur
des saïques ou des germes. Ces derniers bâtimens n'ont point de pont, ils sont longs à peu près comme
ceux qui apportent le bois à Paris.
Les germes ont des voiles latines taillées en tiers-point comme celles des galères : leurs vergues ou
antennes sont fort longues. On ne les amene point pour ferler les voiles, les Matelots sont obligez de monter
dessus pour les ferler. Il en arrive tous les jours un si grand nombre à Alexandrie que j'en ai compté
quatre-vingts dans un seul jour ; marque assurée du prodigieux commerce qui s'y fait.
Quoique l’ancienne ville renfermée dans les murailles, qui subsistent encore aujourd’hui, ne soit qu’un amas
confus de ruines, au travers desquelles il est cru un grand nombre de palmiers, & d’autres arbres qui font
une espece de forêt : les curieux ne laissent pas d’y trouver des choses sans nombre, qui meritent toute leur
attention. J’étois, je l’avouë, dans un âge où l’on m’auroit pû passer le peu de curiosité que je devois avoir
de ces sortes de choses ; mais j’étois naturellement curieux, j’avois déjà du goût, & j’aimois les belles
choses. Je trouvois à me satisfaire en (p. 184) visitant ces excellentes ruines. Je prenois avec moi un
Janissaire & un Juif, qui étoit le meilleur Antiquaire de tout le païs, & assez honnête homme pour un Juif.
C’étoit sous la conduite de ces deux personnages, que je visitois sans crainte & avec toute l’exactitude qui
m’étoit possible ces venerables antiquitez. Sans mon Janissaire j’aurois été insulté cent fois par la canaille
du païs, qui est sans contredit la plus méchante qu’il y ait au monde.
Ces gens s’imaginent que les Francs ne visitent ces ruines, que pour y trouver des trésors, qu’ils ont des
secrets pour les découvrir, & pour les emporter sans qu’on s’en apperçoive, & ils ont là-dessus des traditions
ridicules de pere en fils, qu’ils débitent comme des choses bien averées, qui servent de fondement aux
avanies, qu’ils ne manquent pas de vous faire, quand on n’a pas la sauve-garde d’un Janissaire. Mais un de
ces soldats avec son bâton à la main tient en respect un millier de ces canailles. Il est vrai, qu’il est assez
difficile d’empêcher qu’ils ne disent des injures. Quand on est las de les entendre, il n’y a qu’à glisser
quelques medins dans la main du Janissaire, il tombe sur (p. 185) eux, & leur rompt les bras & la tête sans
s’émouvoir, & sans qu’il en soit plus parlé.
Les murailles, je le repete encore, sont ce qu’il y a de plus beau à voir : elles sont fort hautes, & si épaisses
qu’il y a en-dedans des casemattes comme de longues galeries, qui vont d’une tour à l’autre, dans
lesquelles les troupes seroient très-bien logées, & qui servent aujourd’hui à se promener à couvert du soleil
& de la pluye.
Les Tours sont de plus d’un tiers plus hautes que les murailles. Elles ont des fausses-brayes, aussi bien que
les courtines. Elles sont quarrées ; leurs murs sont si épais, qu’on a pratiqué des escaliers en limaçon dans
les angles qui regardent la ville. Leur rez de chaussée est occupé par une grande salle quarrée, dont la
voûte en lunettes est soûtenuë par des grosses pierres de Thébaïde. Le dessous est occupé par une grande
cîterne, que le Nil remplit pendant son inondation. Le dessus de la salle contient trois étages de chambres
fort belles, dont les vûës principales sont du côté de la ville, avec des meurtrieres du côté de la campagne.
Tous ces étages sont voûtez & soûtiennent une plate-forme, sur (p. 186) laquelle on pourroit placer près de
deux cens hommes, avec un mur tout au tout percé de creneaux, & fortifié de machicoulis, par lesquels on
peut défendre le pied de la Tour.
La distance d’une Tour à l’autre est d’environ deux cens pas ; & comme on s’est apperçu que cette distance
rendoit la défense plus difficile, on a fait d’autres Tours plus basses au milieu de chaque courtine, entre les
grandes Tours, qui augmentent la défense, & rendent l’approche des Tours plus difficile : car c’étoit
principalement les Tours qu’on s’efforçoit de prendre.
Les portes qui restent sur pied sont très-magnifiques, elles sont d'une hauteur & d'une largeur qui impriment
du respect pour le lieu où elles donnent entrée. Leur baze n'est pourtant composée que de quatre grandes
pierres quarrées, dont la première sert de seuil, les deux autres de piédroits, & la quatrième d'architrave. Il
n'est pas nécessaire de dire qu'elles sont d'une très haute antiquité. Il y a bien des siecles que l’on ne se
sert plus de ces masses de pierres, & qu’on ne bâtit que par assises. Il faut seulement admirer la maniere
ingenieuse dont ces anciens tiroient ces lourdes masses des (p. 187) carrieres, les transportoient sur les
lieux, & les mettoient en place.
Je scai qu’il y a bien des gens qui croyent que ces pierres se faisoient par jet, & qu’elles n’étoient qu’un
amas de petites pierres, mêlées dans un ciment excellent, que l’on couloit dans des moules de bois sur le
lieu où elles devoient être placées, & que quand elles avoient pris corps & qu’elles étoient seches, on ôtoit le
moule par pieces, & on n’avoit plus qu’à ragréer l’ouvrage. Mais si cela s’est fait autrefois, il est certain que
le secret est perdu, & qu’on ne l’a pû trouver, quoiqu’on ait bien fiat des épreuves pour y réüssir, & toûjours
inutilement.
D’ailleurs on voit encore vers le Saaid des carrieres, d’où il est très-probable que ces grandes pierres ont été
tirées. On en voit qui sont à demi détachées de la masse, d’autres d’une énorme grandeur qui sont
demeurées par terre, & des vestiges de celles que l’on a tirées, d’où l’on peut conclure que les anciens
Architectes travailloient d’une autre maniere que nous, & qu’ils avoient des machines bien au dessus des
nôtres pour la force & la solidité.
Les ventaux de ces portes sont (p. 188) composez de plusieurs gros madriers d'un bois excellent, joints
ensemble par de fortes traverses de fer et de grands cloux rivez. Elles sont couvertes de grosses lames de
fer, mais leurs serrures ne sont que de bois. Quelle bizarrerie ! Presque toutes ces portes sont doubles &
laissent entre elles une ouverture en coulisse qui donne passage à une herse de fer ou de bois, que
quelques-uns nomment Sarrasine, comme on en voit encore en beaucoup de portes de ville en Europe.
Les portes sont exactement fermées tous les soirs, et les vendredis pendant la prière de midi.
L’espace renfermée dans ces murailles est plein de ruines, qui forment dans certains endroits des collines
assez élevées. On voit par tout des amas confus de colonnes, de bazes, de chapiteaux de marbre, de pierre
Thébaïques, des monceaux de briques plus longues, plus larges, & plus épaisses que celles dont nous nous
servons à present, & liées ensemble avec un mortier, ciment ou mastic, si fort & si tenace, qu’il est plus aisé
de rompre les briques en pieces, que de les séparer les unes des autres.
J’ai entré dans des voûtes d’une (p. 189) beauté surprenante. Elles servent de demeure à quelques Arabes
Bédoüins, qui s’y retirent avec leurs troupeaux. Ce sont d’assez bonnes gens.
On pourroit aller dans beaucoup d’autres de ces souterrains, & même dans les cîternes, quand on est bien
accompagné ; mais outre qu’on y respire un très-mauvais air, produit par les eaux du Nil, & qui n’ont pû s’en
retirer, & dont on deviendroit la curée. A ce prix là, il faut moderer sa curiosité.
Mon Juif Antiquaire ne manquoit pas de me nommer les bâtimens superbes, dont nous visitions les ruines ;
mais il s’en falloit tenir à ce qu’il disoit.
Je fus un jour avec mon petit cortege visiter la colonne de Pompée. Elle est à douze ou treize cens pas hors
des murailles, sur une petite éminence, située dans un païs uni, ce qui la fait paroître de fort loin. Son piedd’estal
qui est quarré, a huit pieds de Roi de hauteur. Il est posé sur un socle d’environ trois pieds de
hauteur, & de vingt pieds de face, qui est de plusieurs grandes pierres si bien cimentées, que les joints ne se
sont point encore (p. 190) ouverts, ce qui marque la bonté du massif, qui porte cette pesante masse. Le fust
de la colonne est d’une seule piece de quatre-vingt-six pieds de hauteur, & d’environ dix pieds de diametre.
Son chapiteau est dans les regles de la bonne architecture ; mais les moulures ont souffert des injures du
tems, & de la longue suite des siecles qu’il y a que cette belle piece a été mise en place. On dit d’elle
comme des portes de la ville, des obélisques, & des autres grandes pieces que l’on y voit, qu’elle est de
pierre fondue, parce qu’elle est tachetée de plusieurs couleurs. Je crois que cela est faux, d’autant que si le
secret de fondre les pierres avoit été connu des Romains, il ne se seroit pas perdu, & seroit venu jusqu’à
nous.
Ce qu’il y a de plus certain, c’est que cette colonne a été dressée par Jules Cesar, pour y perpetuer la
mémoire de la bataille fameuse, dans laquelle il défit Pompée aux environs d’Alexandrie. C’est une des plus
belles antiquitez & des plus entieres qu’il y ait.
On dit qu’un fameux voltigeur ayant attaché une ficelle à une flèche, la tira par dessus le chapiteau, &
qu’ayant attaché une grosse corde au bout de la (p. 191) ficelle, il la tira dessus le même chapiteau, &
qu’ayant bien roidi & attaché les deux bouts de cette corde, il monta sur la colonne avec un âne qu’il avoit
sur les épaules, qu’il laissa sur le chapiteau, où ce pauvre animal passa toute la nuit. Le lendemain matin ce
voltigeur retourna par la même voye chercher son âne, & le descendit. Les gens du païs accoûtumez à ces
tours d’adresse & de force, ne s’en étonnerent pas plus que de raison ; mais ils admirent la patience & la
sagesse de l’âne qui étoit demeuré seul dans ce lieu si élevé, sans se précipiter. Je crois qu’ils en
remercierent bien affectueusement leur Prophete, qui étoit d’un naturel si doux & si compatissant pour les
animaux, qu’il les a tous placez en Paradis excepté les femmes.
On voit à quelque distance de la colonne de vastes & magnifiques ruines d’un palais, que l’on dit avoir été
celui de Cesar. Il n’y reste plus que quelques colonnes de porphire, qui sont encore sur pied, & qui sont
d’une grande beauté. Il est surprenant que les Anglois qui sont si curieux, n’ayent pas encore trouvé le
moyen de les acheter, & les transporter chez eux.
Le Calis dont j’ai déjà parlé passe (p. 192) assez près de ces ruines. C’est un ouvrage, à ce qu’on croit, des
anciens Egyptiens. Je m’étonne qu’on n’en fasse pas present à Joseph l’Hebreu, comme on fait de tous les
autres grands ouvrages qui sont dans l’Egypte, quoiqu’une bonne partie soit plus moderne de plusieurs
siecles que ce Patriarche.
Quoiqu’il en soit, ce canal étoit absolument nécessaire à Alexandrie, pour y porter l’eau du Nil, qui est la
seule que l’on puisse avoir pour boire dans une ville si grande & si peuplée.
Il commence à cinq lieuës au-dessus de Rosset. Son ouverture est fermée par une digue que l’on ne rompt,
que lorsque le Nil est arrivé à une certaine hauteur. L’on fait cette ouverture avec beaucoup de cérémonie ;
c’est le Pacha du Caire en personne qui donne le premier coup de béche. Des ouvriers destinez pour cela
achevent d’abattre le reste, & le Nil courant avec rapidité entraîne tout ce qui s’oppose à son passage, & va
remplir les cîternes & les autres souterrains.
Si on en croit les Turcs, toute l’ancienne ville est creuse & partagée en vastes cîternes soûtenuës par de
gros piliers, & des colonnes qui portent les souterrains, que l’on dit être partagez (p. 193) de maniere qu’il y
a des ruës, des boutiques, & d’autres lieux convenables à une ville. Je ne sçai pas pourquoi ils ont oublié d’y
mettre des marchandises & des acheteurs. Il faut les en croire sur leur parole : car ils ne permettent à
personne de descendre dans ces lieux. Je n’ai vû que les cîternes de quelques Tours, encore m’a-t’on dit
que je m’étois beaucoup exposé, en me confiant à la bonne foi de mon Janissaire.
Ce qu’on voit de ces lieux, c’est par le moyen des trous par lesquels on tiroit l’eau, qui sont de differentes
grandeurs, comme les ouvertures des puits ordinaires. En quelques endroits, au lieu d'ouvertures rondes, il y
en a de longues qui servent à passer des rouës garnies de pots de terre, que l’on fait mouvoir par des ânes
ou des mulets : par le moyen de ces rouës on puise l’eau jusques dans le fond des cîternes, & on la fait
entrer dans d’autres cîternes supérieures, où il est aisé de la purifier avec des seaux. Mais la plus grande
partie de ces cîternes est à present inutile, parce que, comme je l’ai déjà remarqué, l’ancienne ville n’est
point habitée.
Ce sont ces eaux qui causent les (p. 194) maladies, dont la ville est presque continuellement attaquée. Elles
croupissent dans ces souterrains, & corrompent l’air, & causent une infection, qui produit des fièvres
chaudes & malignes, & même la peste.
Outre ces maux, on est assailli d’une multitude innombrable de cousins & autres insectes, qui se répandent
de tous côtez dès que le soleil se couche. Ils remplissent l’air : les chambres en sont pleines. On peut dire
d’Alexandrie à bien plus juste titre que Boileau ne l’a dit de Paris ; ce n’est qu’à prix d’argent qu’on dort dans
cette ville. En effet, il faut avoir des lits bien environnez de moustiquaires, c’est ainsi qu’on appelle les
rideaux de gaze, ou de fine toile de cotton dont on environne les lits, & dont on replie les extrêmitez sous les
matelas avant le coucher du soleil, après les avoir bien secouez pour en faire sortir ces insectes
incommodes ; & quand on se veut mettre au lit, on a soin de faire porter la lumiere dans une chambre
voisine, dont on laisse la porte ouverte, les cousins suivent la lumiere, & pendant leur absence on se met au
lit, dont on fait mettre le bout des rideaux sous le matelas. A ce prix on (p. 195) dort sans être picqué. On a
seulement l’inquiétude de les entendre bourdonner au tour du lit ; mais sans qu’ils y puissent pénétrer.
On a la même incommodité à Malte, & par la même raison, c’est-à-dire, à cause des cîternes qui sont dans
toutes les maisons, & on se sert du même remede pour s’en exempter en tout ou en partie.
On pourroit dire que la chaleur immoderée du païs cause ces cruelles maladies qui y regnent, si les gens du
païs ne s’opposoient à un jugement si raisonnable, en disant, que c’est la chaleur qui purifie l’air, comme le
froid le purifie dans les climats froids. Je ne dois pas entrer avec eux dans une relation qui ne les ameneroit
pas au point de juger plus sainement ; mais je penserai toûjours que la chaleur de ce païs est presque
insupportable aux gens qui n’y sont pas accoûtumez, & que si le vent du Nord ne rafraïchissoit pas l’air, le
païs seroit inhabitable pour les Etrangers nez dans des païs plus temperez.
Les vents de la bande de l’Est y sont extraordinairement chauds. La raison se presente d’elle-même ; ils
passent sur les sables brûlans du desert ; & (p. 196) quand ils ne seroient pas chauds d’eux-mêmes, ils
contracteroient assez de chaleur dans ce passage pour devenir brûlans.
Ceux qui demuerent dans les vaisseaux ne sont pas si incommodez de la chaleur que ceux qui demeurent à
terre, & ont moins de cousins. Ils en ont pourtant assez pour n’être pas à leur aise, à moins qu’ils n’ayent
des moustiquaires. Ils sont aussi moins sujets aux maladies ordinaires du païs.
La saison qui produit plus de maladies & de plus dangereuses, est à cause de la chaleur ; mais encore à
cause des fruits cruds, que l’on mange avec avidité, & des eaux que l’on boit, qui ne sont pas encore bien
reposées.
Il est pourtant vrai que les fruits y sont excellens, & que s’ils causent des maladies, ceux qui en sont
attaquez ne doivent s’en prendre qu’à leur intempérance.
Les cannes à sucre y viennent naturellement, elles sont très-bonnes & très sucrées. On n’en fait aucun autre
usage que de les succer dans les rues & dans les maisons. C’est une espece d’amusement qui ne blesse
point la politesse.
(p. 197) Outre presque tous les fruits qui y croissent en perfection, il y a des figues pendant toute l’année,
les differentes especes se succedent les unes aux autres.
Il y a une quantité prodigieuse de certains petits citrons, qui ne sont pas plus gros que des noix vertes, qui
ont l’écorce extrêmement fine, & qui sont tout jus. On en consomme une quantité incroyable à faire du
sorbec, boisson délicieuse & fort en usage dans tout le Levant ; & outre ce qui se consomme dans le païs, &
aux environs on en envoye tous les ans des bâtimens chargez à Constantinople & à Venise, après les avoir
laissé éclaircir le jus avant de le mettre dans les tonneaux.
Il y a encore de certains citrons appellez poncires. Ils sont fort gros, ont l’écorce extrêmement épaisse & peu
de jus. C’est de l’écorce seule dont on se sert. On la fait confire entiere, ou coupée par tranches, ou bien on
la rappe, & on en fait de la marmelade qui est excellente quand elle est bienfaite, & avec de bon sucre. Les
Turcs la font assez bien ; mais ils y mettent tant d’aromats qu’elle échauffe (p. 198) extrêmement. On fait
aussi confire ses gros citrons au miel & au raisiné, c’est un mauvais régal pour ceux qui n’y sont pas
accoûtumez.
Les oignons de Smirne sont très-bons, je l’ai déjà remarqué ; mais ceux d’Egypte les surpassent infiniment.
Après en avoir mangé, je n’ai pû trouver mauvais que le peuple Hebreux les regrettât.
On trouve des palmiers partout & par conséquent des dattes en abondance. Il y a pourtant du choix dans ce
fruit. Celui qui vient dans une bonne terre & près de l’eau n’est jamais si bon, si doux & si pectoral que celui
qui naît dans le desert & dans les sables les plus brûlans. On ne connoît point en Egypte de palmiers mâles,
qui ne portent point, & qui ne servent qu’à rendre les femelles fécondes. Il est vrai qu’il y a quelquefois de
ces arbres, qui par maladie ou autre accident cessent de porter une année ou deux, & qui rapportent ensuite
au double & au triple. Seroit-il possible qu’ils fussent devenus mâles pendant ce tems-là, & qu’ils ayent
ensuite repris leur sexe, ou bien sont-ils hermafrodites ? Je n’ai eu garde de proposer mes doutes là-dessus
aux gens du païs, ils se seroient (p. 199) mocquez de moi, & auroient eu raison. Les dattes, les figues, les
raisins, les caroubes se transportent dans les autres païs, & on en charge tous les ans un très-grand nombre
de bâtimens. Le ris vient à merveille dans tout ce païs, il est très-bon, & fait le fond d’un très-grand
commerce, aussi bien que quantité d’autres choses dont j’ai parlé, & dont on peut dire que l’Egypte est un
des païs du monde les plus fertile & le plus abondant. Il en est redevable à l’inondation du Nil, qui se
répandant sur ces vastes plaines, les engraisse par le limon qu’il y laisse, & par l’humidité qu’il leur
communique. Ces plaines venant ensuite à être échauffées par le soleil, produisent tout ce qu’on veut leur
faire porter.
Il faut ajouter à cela les rosées abondantes qui tombent toutes les nuits. Quoique cela soit commun à tous
les païs chauds, on peut dire que l’Egypte semble avoir un droit de retenue & de préférence sur tous les
autres païs.
C’est une erreur de dire qu’il n’y pleut jamais. Des Ecrivains très-anciens l’ont assuré, & des Modernes l’ont
dit après eux, les uns & les autres se sont trompez. J’ai vû pleuvoir à Alexandrie, à (p. 200) Rosset & à
Damiette abondamment & assez souvent, pendant les differens séjours que j’ai fait dans ces villes, & je puis
assurer comme témoin oculaire, qu’il a plut & qu’il pleut dans ces lieux, & par conséquent qu’il pleut dans les
autres lieux de ce Royaume. Il est vrai que ces lieux sont plus voisins de la mer que la haute Egypte, & que
les exhalaisons qui s’élèvent de la mer, & se réduisent en pluye, y contribuent beaucoup ; mais toute
l’Egypte est traversée par un grand fleuve, qui produit des exhalaisons, & par conséquent des pluyes. Elles
peuvent à la vérité être moins abondantes & moins frequentes ; mais elles ne sçauroient manquer tout-à-fait,
& par conséquent c’est une erreur de dire qu’il n’y pleut jamais.
Lorsqu’on revient de la colonne de Pompée, & qu’on entre dans la ville par la porte de Rosset, on trouve une
Eglise dédiée à Sainte Catherine Martyre. Elle appartient aux Grecs. Ils me montrerent une petite colonne
ronde, percée dans son milieu, & haute environ de deux pieds, sur laquelle ils prétendent que la Sainte a eu
la tête coupée. Cette colonne, ou morceau de colonne, est placée sur une colonne de marbre (p. 201) de
quatre pieds de hauteur. Le corps de cette Sainte repose encore à present au Mont Sinaï, où l’on tient par
tradition qu’il fut transporté par le ministere des Anges. Les Religieux Grecs ont un fameux Monastere & une
Eglise en cet endroit, dont plusieurs voyageurs ont fait la description.
L’Eglise de S. Marc est dans l’enceinte de la vieille ville. Elle est desservie par les Chrétiens Coptes. On y a
conservé la Chaire où ce saint Evangeliste prêchoit, & un tableau de S. Michel que l’on dit avoir été peint par
S. Luc. S. Marc a été le premier Evêque ou Patriarche d’Alexandrie, il y a été martyrisé, & son corps a été
conservé dans cette Eglise, jusqu’à ce qu’il ait été transporté à Rosset.
La maison, ou comme on dit dans le païs, le palais du pere de Sainte Catherine est assez près de cette
Eglise ; mais ce n’est plus qu’un monceau de ruines, où il est impossible de rien démêler.
On voit tout proche le couvent des Coptes deux belles aiguilles de marbre, ou de pierres fondues, ou plûtôt
de pierre Thebaïque, elles sont toutes couvertes de caracteres hieroglifiques. Une des deux est encore
debout. Son (p. 202) piéd’estal, si elle en a un, ne paroît point, ou est entierement enterré. Elles sont toutes
les deux d’une seule pierre, de même marbre, même longueur & même diametre. Si un ambassadeur les
demandoit au Grand Seigneur, je ne crois pas qu’il les refusât. Elles meriteroient bien la peine d’être
transportées en Europe, & orneroient bien une place.
Le palais vrai ou supposé de Cleopatre, est tout auprès de ces aiguilles. Il est entierement ruiné. Il n’y reste
que des voûtes soutenues par de très-belles colonnes, qui en marquent la magnificence ; mais qui font
présumer que les appartemens étoient vastes, puisqu’ils avoient eu besoin d’être soutenus par des
colonnes, ou qu’ils étoient étroits, supposé qu’il y eût des séparations entre ces colonnes, ce qui ne paroît
point du tout.
On trouvoit autrefois dans toutes les ruines qui inondent cette grande ville, une infinité de pierres gravées en
creux & de relief. Presque toutes étoient fines, comme cornalines, grenats, lapis lazuli, agathes, émeraudes
& autres. Elles avoient des têtes, des animaux, des idoles, des caracteres Egyptiens, que nos plus habiles
(p. 203) Antiquaires auroient de la peine à déchiffrer. Les gens du païs les cherchoient pendant les pluyes
d’orages, & les déterroient. Ils en trouvoient alors beaucoup, & les donnoient à bon marché. Elles sont à
présent fort cheres, soit qu’ils en connoissent mieux la valeur, soit par l’empressement que les voyageurs
curieux & les marchands ont eu de les rechercher. Il faut pourtant être connoisseur pour n’y être pas
trompé : car en ce païs plus qu’en aucun autre, il faut être sur ses gardes, & les gens qui paroissent les plus
simples, ne sont pas ceux dont il faut moins se défier.
Tous les Francs qui demeurent en Egypte sont habillés de long à la turque. Ils doivent pourtant observer de
ne point porter de couleurs éclatantes, sur tout du rouge ou du verd. Cette dernière couleur est réservée
pour les descendans de Mahomet, & le rouge n'est que pour les Grands Seigneurs et pour les Consuls par
une concession particulière. »
Tous les Francs portoient, quand j'y étois, la barbe & les cheveux longs. Ils n'en avoient pas meilleure mine.
Ils se contentent à présent d'avoir deux belles & épaisses moustaches. Ils ont (p. 204) la tête couverte d'un
bonnet de velours noir, dont on dit que l'invention est venue de Venise. Ils environnent le bord de ce bonnet
d'une légère écharpe de soye ou de lin, de diverses couleurs, pour les distinguer des Turcs, qui portent leurs
turbans tout blancs & fort gros. Leurs souliers ne sont que des espèces de chaussures de maroquin, sans
talon, qu'ils mettent dans des pantoufles, à cause qu'ils le ôtent quand ils entrent dans des appartemens qui
sont couverts de tapis.
Il n’y a dans toute l’Egypte, parmi les Francs, que les seuls Consuls qui ayent droit d’aller à cheval dans les
villes ; encore est-ce une grace qu’on leur fait, qui n’est pas même du goût des Musulmans zelez, qui ne
peuvent s’empêcher de gémir & de dire, quand ils voyent un Franc sur un cheval : quel peché a commis cet
animal, pour être obligé de porter un Infidèle ?
Tous les autres Francs ne vont que sur des ânes : Il y a des Marchands qui en entretiennent chez eux ; ils
sont grands, bienfaits, bien pensez, ils ont des housses, des selles & des brides fort propres, & vont
naturellement l’amble ou le petit galop, comme des (p. 205) Guildins d’Angleterre.
Ceux qui n’en ont point, en trouvent à louer tant qu’ils veulent, pour sept à huit sols par jour ; & cela est
absolument necessaire, sur tout quand il faut aller de la ville à la marine, qui est fort éloignée. Il en coûte un
maidin pour aller, & autant pour revenir. Ceux qui les louent suivent leur bête, de quelque façon qu’on la
fasse aller.
Ceux qui louent ces ânes sont de Bedoüins, sorte d’Arabes, qui parmi leurs compatriotes, sont à peu près ce
que les Bohémiens sont chez nous, c’est-à-dire des voleurs habiles, mais qui ne volent jamais ceux qu’ils
servent ; aussi les employe-t-on pour les gros ouvrages dans les maisons. Ils sont laborieux, sobres, ne
gagnent gueres, & sont preque sans religion. Ces sortes de gens se retirent avec leurs familles sous de
vieilles voûtes, ou dans des huttes qu’ils font sur le bord de la mer. Leurs habillemens ne les empêchent
point de courir, ni de travailler : ils consistent qu’en une longue piece de barakan ou d’étoffe de laine fort
legere, dont ils passent un bout sur leur tête, & ils environnent leurs bras, leurs corps & leurs cuisses
(p. 206) avec le reste, qu’ils serrent avec une ceinture de cuir ; de sorte que sans rien couper ni coudre, ils
se font des frocs, des manches, des robes & des calçons.
Ils aiment l’argent, & ne peuvent comprendre où les Francs en peuvent trouver la grande quantité qu’ils en
voyent débarquer tous les jours. Il y en a d’assez simples pour croire que les Francs ont le corps rempli
d’argent : opinion fort impertinente, puisqu’il pourroit un jour arriver aux Francs en Egypte, ce qui arriva aux
Juifs après la prise de Jerusalem, à qui les Romains fendoient le ventre, pour chercher l’or qu’ils
s’imaginoient qu’ils avoient avalé, pour le sauver des mains de leurs vainqueurs.
La simplicité de ces Bedoüins va encore plus loin. Ils croient sans hésiter un conte que les Francs leur ont
fait, que la monnoye croît sur des arbres comme les dattes croissent dans leur païs. Ils raisonnent là dessus
selon la portée de leur esprit, qui ne peut être plus borné qu’il est ; mais quoiqu’ils aiment extrémement
l’argent, on n’a vû aucun d’eux, qui ait voulu passer en Europe pour considerer de près une merveille si
surprenante.
(p. 207) Il y a dans Alexandrie un grand nombre de Mosquées, & un grand nombre d’Imans, de Moulas, &
d’autres gens de Loi qui assemblent le peuple, le prêchent, & font des prieres aux heures marquées. Les
Turcs n’y manquent jamais, & quand leurs maladies, ou des affaires indispensables les empêchent de sortir
de chez eux, ils les font dans leurs maisons. Dans quelque lieu qu’ils les fassent, ils se purifient auparavant
en se lavant le visage, la bouche, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, & les essuyent avec leurs
grands mouchoirs. Ils ne se dispensent pas de ces devoirs, quand ils sont en voyage sur terre & sur mer.
Comme il est quelquefois impossible de trouver de l’eau dans les deserts, où elle est très-rare, & qu’il faut
conserver précieusement celle que l’on porte pour l’usage de la vie, leurs Docteurs leur ont appris qu’on
peut alors se purifier avec du sable ou de la terre. Cela emporte toutes les impuretés légales, & les met en
état de se présenter devant Dieu avec plus de confiance, & d’obtenir l’effet de leurs demandes.
C’est pour cette raison qu’on ne voit (p. 208) point de mosquée qui ne soit accompagnée de fontaines
naturelles ou artificielles, où on va se laver ; après quoi on laisse ses babouches ou pantoufles à la porte,
afin de ne pas salir le plancher, ou les tapis dont il est couvert. C’est une précaution sage, mais qui doit être
incommode, quand il faut que chacun reconnoise ses babouches lorsqu’il sort de la mosquée.
L’Empire du Grand Seigneur est tout rempli de Derviches ; ce sont des especes de Religieux, qui
reconnoissent, à ce qu’on dit, un Superieur. L’Egypte en a plus que tout le reste de l’Empire. On doit dire
d’eux, sans craindre de se tromper, qu’ils sont faineans, hipocrites, vicieux au dernier point, &
très-dangereux quand ils trouvent quelque Franc, lorsque leur zele emporté les agite ; car alors ils ne font
point de difficulté de lui proposer de se faire Turc, & de le poignarder, s’il le refuse. Ces meurtres passent
dans le païs pour une action de zele ; ils n’en sont point inquiétez, au contraire on les en loue. Quand je
n’avois point de Janissaire avec moi, ce qui étoit assez rare, j’entrois dans une boutique, dès (p. 209) que je
voyois quelqu’un de ces furieux.
Ils sont vêtus d’une maniere extraordinaire : les uns ont des habits tout chargez de guenille de toute sortes
de couleurs ; les autres sont tout couverts de plumes ; d’autres sont réellement tout nuds, avec la barbe &
les cheveux herissez. Quand ils ont faim, ils prennent au marché & dans les boutiques ce qui les
accommode, & on n’a garde de les en empêcher. On regarde au contraire cela comme un honneur, & on en
attend la récompense de dieu. Ils entrent librement par tout, même chez les grands Seigneurs. S’ils y
trouvent compagnie, ils prennent place, & tirant un chapelet de gros grains, de deux ou trois brasses de
longueur, ils l’étendent sur toute la compagnie, & prenant un grain, ils disent dessus quelque attribut de
Dieu, comme, Dieu est grand ; le grain passe à un autre, qui repete ce que le Derviche a dit, & fait ainsi toute
la rone. Il dit ensuite sur le grain suivant ; Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est misericordieux ; &
parcourant ainsi les attributs de Dieu, ils finissent leur chapelet. Après quoi on leur presente le sorbec, ou le
caffé, & ils (p. 210) se retirent avec aussi peu de ceremonie qu’ils en ont fait en entrant.
Ces gens sont pour l’ordinaire des espions en titre d’office, qui entrent librement par tout, écoutent ce qui se
dit, & voyent ce qui se fait, & le rapportent à ceux qui les employent.
On dit qu’il y a des ministres des Princes Chrétiens qui pour avoir des espions fidèles dans cet Empire, ont
fait circoncire de jeunes enfans, qu’ils ont ensuite fait élever dans les Langues Turque & Arabe, sans leur
faire changer de religion, & qui ayant embrassé ce genre de vie, ont rendu des services considérables à leur
Nation, en découvrant ce qu’il y avoit de plus secret parmi les Musulmans.
J’ai dit ci-dessus que ces sortes de gens étoient vicieux au suprême degré. La stupidité des peuples leur
donne beau jeu. On est persuadé que tout ce qu’il font leur est inspiré de Dieu : les actions mêmes les plus
brutales, bien loin d’être regardées comme telles, sont applaudies. En voici un exemple entre mille qui en
fera juger.
Un de ces marauds, nud comme un ver, rencontra une troupe de femmes qui alloient par dévotion prier au
(p. 211) cimetiere un vendredi, selon la coûtume. Les femmes steriles croyent devenir fecondes en se
mettant à genoux devant ces infâmes. Un de ces coquins se voyant environné d’une bande de ces dévotes,
en prit une, la jetta par terre au milieu du chemin, & commit avec elle une action brutale qui fait rougir mon
papier. Dans tout autre lieu, une femme se seroit laissée égorger plûtôt que de s’y soumettre, & ses
compagnes l’auroient défendue au péril de leur vie. Il n’arriva rien de cela ; la femme choisie se soumit
humblement, & ses compagnons firent un cercle autour de ce beau couple, étendirent leurs grands voiles, &
poussant des cris de joye, elles célèbrerent par des chansons le bonheur de celle que le prétendu Saint
avoit ainsi choisie. Cet exemple suffit pour faire voir la folie & l’imbecillité de ce peuple, & que s’il ne cherche
pas à present les crocodiles & les singes pour les adorer, comme faisoient leurs prédecesseurs, ils ne sont
pas plus sages qu’eux. En effet, ils regardent comme saints les fols, les imbeciles, les lunatiques, & ceux qui
tombent du mal caduc.
Il n’y a d’autre monnoye dans (p. 212) l’Egypte que celle que les Francs y apportent, soit d’or ou d’argent, &
particulierement les piastres, excepté des sequins d’or qui valoient en 1658 six livres dix sols monnoye de
France, & de petites pierres d’argent dont il en falloit trente deux ou trente-trois pour faire un piastre. Il y a
encore quelques monnoyes de cuivre, du poids à peu près, & de la grandeur des liards de France, qu’on
appelle boubes & forles, qui sont de la même valeur ; tous les comptes se font en piastres.
L’affaire du Consulat de M. Begue ayant été examinée, comme je l’ai dit ce devant, & n’ayant plus qui nous
retînt à Alexandrie, nous songeâmes à continuer nôtre route, & à nous rendre au lieu de notre destination.
M. Bertandier jugea à propos que je prisse les devans avec un de nos valets, & notre bagage, & que je
l’allasse attendre à Rosset : cela n’étoit pas facile. Les portes étoient gardées, & on ne laissoit embarquer
aucun François, à cause des grandes sommes que la Nation avoit empruntées des Turcs & des Juifs, dans
la poursuite de cette mauvaise affaire. Les creanciers vouloient que toute la Nation en fût (p. 213)
responsable, avec d’autant plus de raison, que la plûpart des négocians avoient souscrit les billets.
J’allai trouver l’Aga du château ; je lui representai que quoique François, nous ne devions point être
regardez comme du corps de la Nation, ni comme des Negocians ; mais comme des voyageurs, qui
n’étoient point entrés dans les engagemens de nos compatriotes. Mes raisons appuyées d’un present furent
trouvées bonnes, & l’Aga me fit expedier un passeport pour me retirer où je voudrois, avec permission de
prendre un Janissaire pour ma sûreté. Il eut encore l’honnêteté de me donner des lettres de
recommandation pour les Agas de Rosset & de Damiette, ou, comme on dit dans le païs, Damiate. Je ne
voulus pourtant point présenter, de crainte de quelque supercherie, chose assez ordinaire dans le païs, & je
me contentai de mon passeport. Je fis mes adieux ; je fis charges nos bagages sur des chameaux, &
montez sur des mulets avec mon Janissaire & mon valet, je partis d’Alexandrie. »
- 452 - 460 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
EDUWARD MELTON (du 15 juin au ? 1663)
Melton, E., Eduward Meltons, Engelsch Edelmans, Zeldzaame en Gedenkwaardige Zee-en Land- Reizen ;
door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, Amsterdam, 1681.
Ce voyageur qui serait d’origine anglaise est vraisemblablement fictif. Le texte flamand traduit en français au
cours de la préparation de la thèse a permis de constater que ce récit est celui de Michael Vansleb (1672).
Se référer à la synthèse, chapitre « Mise en garde ».
p. 62-68 :
« Départ de Rosette vers Alexandrie.
Le 14 du même mois, nous partîmes à l’approche du soir de Rosette vers Alexandrie et nous arrivâmes vers
minuit au passage que les Arabes appellent Maadie d’où, après avoir pris un petit repos, dans le Han ou
l’auberge qui se trouve là, nous poursuivîmes notre route vers Alexandrie à la lumière de la lune, où nous
arrivâmes le lendemain matin entre huit et neuf heures.
De Rosette à Alexandrie, il y a au moins dix heures de trajet, dont une bonne partie de ce trajet se fait le
long de la plage de telle façon que les animaux ont du marché les pieds dans l’eau un certain temps.
Le pays est tellement plat et monotone que les voyageurs n’y rencontrent aucun inconvénient. Mais à
l’exception du Han ou auberge qui se trouve à mi-chemin, on n’y trouve aucun village, aucun arbre, aucune
végétation parce que ce n’est rien d’autre qu’un grand champ stérile et sablonneux.
Les chrétiens qui font ce voyage sont tenus de payer, à la porte d’Alexandrie, que l’on nomme la porte de
Rosette, trois paras ou Meidins dont chacun de ces paras vaut environ un et demi stuiver hollandais, la
moitié aux Beduins ou Boemirs, l’autre moitié aux Janitzaren parce qu’ils font la garde à cet endroit.
Maison des 70 interprètes.
La maison des 70 interprètes qui traduisirent la bible de l’hébreu en langue grecque se trouve encore dans
cette ville, elle est encore presque intacte avec les cellules qui servirent de bureau à ces hommes instruits.
Les Turcs en ont fait une mosquée à laquelle (p. 63) ils donnèrent le nom de Giama il Garbie ou la Mosquée
de l’Ouest.
Les salines du grand seigneur et le bon sel de l’eau du Nil
Le 19 juin, j’allai visiter les salines du grand seigneur qui se trouvent à l’extérieur de la ville proche du Kalitz
ou canal de Cléopâtre qui alimente Alexandrie en eau douce quand le Nil déborde. Ici je me suis aperçu de
deux choses qui sont dignes de mes observations ; la première, l’eau du Nil est la plus douce des eaux du
monde produisant un sel qui est non seulement le plus blanc mais aussi le plus parfait que j’ai jamais vu. La
seconde est que ce sel a l’odeur et le goût de violette.
Ceux qui ont été chargés de produire de ce sel laissent, pendant que le Nil court dans ce canal, couler une
certaine quantité d’eau dans les salines et après quatre ou cinq jours, cette eau comme on l’a dit plus haut,
est changée dans le plus beau sel qu’on puisse voir. Après quoi, ils le mettent à sécher au soleil dans des
corbeilles ou paniers et le vendent par la suite.
Sel amer.
On peut aussi tirer du sel du lac Sebaka appelé par l’écrivain latin ancien Palus Mareotis qui s’étend au sud
de cette ville, mais son eau est salée et son sel est amer, c’est la raison pour laquelle on ne veut pas y
consacrer d’effort.
Palus Mareotis.
Ce lac est formé à partir de l’eau du Nil qui court dans cette direction quand le Nil est en crue ; comme il ne
trouve aucune issue, il demeure à cet endroit. Il n’est pas très profond mais exceptionnellement grand et
étendu parce qu’on ne peut à peine discerner d’un côté l’autre bout du rivage.
Tableau de saint Michel fait par l’évangéliste Luc. Miracle ridicule concernant ce tableau.
Les Coptes d’Alexandrie conservent dans leur église de Saint-Marc un tableau de l’archange saint Michel
fait de la main de l’évangéliste Luc selon leur tradition.
Certains chrétiens romains ont pu nous raconter que les Vénitiens, il y a quelque temps, prirent cette pièce
hors de l’église et coururent par cinq fois en dehors du port sans qu’il leur soit possible d’avancer d’un mile
comme si à chaque fois qu’ils essayaient d’avancer, ils étaient retenu par une force mystérieuse, jusqu’au
moment où ils ramenèrent le tableau à sa première place.
La rumeur de ce miracle ayant été répandue dans la ville, les Beduins ou Boëmiers ont décidé de voler la
pièce dite pour la revendre aux chrétiens. Dans ce but, ayant, une nuit, brisé la porte de l’église, et ayant
décroché la pièce de sa place ils pensaient l’emporter, mais il leur fut impossible de sortir de l’église de telle
façon qu’ils étaient tenus comme les Vénitiens de la remettre en place. Ce tableau est encore actuellement
dans cette église où j’ai pu le voir à plusieurs reprises.
Ces bons catholiques romains nous assurèrent qu’il ne fallait douter en aucun cas de cette histoire ; ils
ajoutèrent comme preuve de vérité qu’en ce temps-là, ils vivaient eux-mêmes à Alexandrie.
Pourquoi l’eau des citernes d’Alexandrie est salée.
Dans l’eau des citernes, je vis aussi une chose bizarre, (p. 64) l’eau est toujours salée ce qu’on ne penserait
pas vu qu’elle sort d’un fleuve si doux comme le Nil. Mais cette différence vient du sol riche en salpêtre, ce
qu’on peut voir apparemment lorsqu’on met un morceau de terre au soleil, parce qu’immédiatement ce
morceau, à l’endroit où le soleil frappe, devient blanc comme neige.
La colonne de Pompée
Le 21 nous allâmes visiter la colonne ou le pilier de Pompée et les autres curiosités situées aux environs.
Nous sortîmes par la porte qu’on appelle Bab Issidr, à l’extérieur de laquelle fut dressée la colonne sur une
petite hauteur vers le sud. En m’approchant, je vis qu’elle penchait un peu d’un côté ; ceci arriva lorsque les
Arabes, croyant qu’il y avait un trésor enterré dessous, creusèrent sous le piédestal et y retirèrent plusieurs
grands morceaux de pierres qui soutenaient la colonne. Sans aucun doute, elle serait tombée à un certain
moment, s’ils n’avaient pas trouvé plus profondément des pierres d’une grandeur extraordinaire que ni eux,
ni personne, n’auraient pu extraire.
Après avoir vu suffisamment cette colonne, nous prîmes le chemin des grottes qui sont dans le même
champ, à l’est-sud-est de la porte par laquelle nous sortîmes. Pour y arriver, on doit descendre douze à
treize marches par un couloir très large creusé dans le roc qui est à présent ouvert par le haut, probablement
parce que la voûte s’est effondrée avec le temps. Dans ce couloir, se trouvent quinze grandes ouvertures
creusées de la même façon dans le roc à la manière de portes, sept d’un côté et huit de l’autre, par
lesquelles on entre dans les grottes mentionnées ci-dessus.
Description des anciens cimetières d’Alexandrie.
Nous y entrâmes guidés par un Janitzar que nous prîmes à cette fin à notre service avec nos torches
allumées dans quatre de ces grottes où nous trouvâmes des trous creusés dans la roche de haut en bas à
même distance l’un de l’autre, ils étaient si longs et si hauts qu’ils ne pouvaient contenir qu’un cercueil.
Plusieurs de ces grottes furent percées pour parvenir à d’autres par ces ouvertures. Le seul inconvénient
que nous rencontrâmes est qu’elles étaient presque toutes pleines de terre et de sable, ce qui ne nous
empêcha pas de visiter tout ce qui est digne d’intérêt.
Alors que nous étions dans une des grottes qui se trouve à main droite au fond du couloir, un des nôtres
remarqua, avec la lumière des torches, qu’un de ces trous donnait dans une autre grotte ; ceci excita notre
curiosité de savoir si nous allons y trouver quelque chose de rare. Quoi que ce trou fût exceptionnellement
petit et difficile, nous prîmes notre courage à deux mains et nous rampâmes sur le ventre avec nos torches à
la main l’un après l’autre jusqu’à l’autre bout où nous vîmes une des plus remarquables et amusantes
grottes que nous ayons découvertes jusqu’à présent.
Description d’une belle grotte.
Elle était plus grande, moins abîmée ou détériorée, et plus propre qu’aucune (p. 65) (des grottes) où nous
étions allés auparavant. Elle était de la forme d’un carré allongé, et, à l’intérieur, elle était couverte de
calcaire. Des deux côtés du mur, formé par la roche même, se trouvaient trois rangées de trous semblables
à ceux que nous vîmes dans les autres grottes. En longueur, il y en avait quinze dans chaque rangée,
placés les uns au-dessus des autres, ce qui fait quarante-cinq. Les deux côtés qui sont les plus courts
avaient pareillement trois rangées, et, dans chaque rangée, trois trous. Ces trous étaient tous vides, propres,
et, dans la grotte, on ne sentait aucune mauvaise odeur à l’exception d’un trou où se trouvait le squelette
desséché d’un humain.
Usage de ces grottes.
Je vois bien que le curieux voudrait savoir immédiatement mon opinion sur ces grottes et sur ces trous, et,
aussi à quelle fin elles ont été faites. Je leur répondrai qu’il est très difficile de l’expliquer correctement car
même Makrizi, qui décrivit par ailleurs très méticuleusement tout ce qui est digne d’intérêt en Égypte, n’en
fait pas mention. Néanmoins, on voit bien qu’elles n’ont pu servir à aucun autre usage que comme lieu
d’inhumation ; on remarque ceci à la forme des trous qui sont juste assez longs, hauts et larges qu’il est
nécessaire pour y mettre un corps. En outre, comme toutes les autres grottes qui se trouvent en Égypte,
elles n’ont servi à aucun autre but, il est aussi probable qu’elles aient été faites pour le même usage. Je
laisse le lecteur juger.
Entre temps, je ne réfute pas qu’elles aient pu aussi servir aux chrétiens comme lieux pour prier Dieu en
secret par peur des Romains qui les persécutèrent. Je trouve cette pensée justifiée chez Seid ibn Patrik,
patriarche melkite d’Alexandrie, dans son Histoire comme on peut le voir à la page 399.
Ceux d’Alexandrie appellent ces grottes suk ou le marché, mais il n’y a aucune preuve qu’elles n’aient
jamais servi à cet usage.
Le roc dans lequel elles sont creusées est, à l’intérieur, complètement pointu, anguleux et effrité par le
temps. Aussi, les cavités sont ainsi, en particulier celles qui se trouvent le plus près de la porte et qui sont
par conséquent plus exposées à la lumière. Elles reçoivent aussi quelque lumière par certains trous
rectangulaires faits expressément au-dessus dans la voûte.
Promenade dans la ville.
Le jour suivant, nous nous promenâmes dans la ville pour visiter les murs et les tours ; nous sommes entrés
dans les six principales. La première était celle qu’on rencontre en arrivant à la porte Bab il-achdar ou la
porte Verte. Elle est ronde, et, à l’intérieur, (la tour) repose sur trois rangées de pilier de pierre rouge dont
chaque rangée en a sept (piliers).
Après être sortis de cette tour, nous allâmes à la porte du vieux port qui est actuellement muré car que le
port n’est plus en usage. De cette porte, nous allâmes à la mosquée des Magrabijnen et de là au vieux
château d’Alexandrie appelé Borg Mustapha Pacha, ou château de Mustapha Pacha qui servait jadis à
défendre le vieux port et qui (p. 66) est actuellement encore occupé par trois cents Janitzaren.
Jusque-là, nous étions allés régulièrement vers l’ouest, mais dès que nous quittâmes le château, nous
tournâmes en direction de l’est ; nous y trouvâmes ensuite une grande tour où nous montâmes, non pas par
un escalier mais par un large chemin qui monte obliquement jusqu’en haut de cette tour.
Après cette tour, nous arrivâmes à la porte appelée Bab Issidr, à l’extérieur de laquelle se trouve la colonne
de Pompée, de là, nous nous promenâmes en direction d’une autre porte Bab Irrascid ou la porte de Rosette
en poursuivant régulièrement notre chemin le long des murs de la cité. De là nous sommes allés voir
l’endroit où le Nil entre dans le canal à partir duquel les citernes d’Alexandrie sont remplies et dont je vais
donner une description ici après.
Après avoir vu les choses que nous désirions tellement, nous retournâmes vers la ville et nous continuâmes
jusqu’à la tour des Indiens à laquelle on a donné son nom parce que des pèlerins de ce pays y séjournent
depuis quelques années. Nous y entrâmes et nous trouvâmes qu’elle était magnifiquement construite.
Ensuite, nous allâmes à la tour de la vieille douane ainsi nommée parce qu'à l’époque lorsque la mer
frappait les murs de la ville, les entrepôts de la douane se trouvaient là. Mais depuis que la mer s’est retirée,
on a fermé la porte qui se trouvait là, et, on a déplacé les entrepôts à l’endroit où ils se trouvent
actuellement.
Cette tour est très grande, elle est soutenue à l’intérieur par quatre rangées de colonnes. Il y a une multitude
de pièces, aussi bien des greniers que des chambres et des salles, mais de nos jours, une grande partie
tombe en ruine et est détruite. C’était la dernière tour que nous visitâmes au cours de notre promenade qui
nous a pris quatre heures y compris le temps pour visiter les murs et pour monter dans les tours.
Le canal qui alimente la ville en eau douce.
Maintenant je reviens sur le canal ou tuyau d’écoulement qui alimente les citernes de cette ville en eau.
Ce canal ou tuyau d’écoulement se trouve à l’extérieur de la porte de Rosette, il est d’environ de la hauteur
d’un homme et à l’intérieur il fait en voûte. À un quart de mile de la ville, il arrive au Kalitz de Cléopâtre qui a
son cours à cet endroit-là et qui donne une partie de son eau qu’il reçoit du Nil même, pour la conduire
jusqu’aux murs où ayant rencontré un autre canal, qui ne se trouve pas loin de cette porte, par un système
ingénieux il a une connexion avec toutes les citernes qui se remplissent de son eau.
Il faut pourtant savoir que l’embouchure de ce canal, bien qu’elle soit aussi haute que le reste du canal, a
presque les deux tiers muré de bas en haut de telle façon qu’il ne reste qu’une petite ouverture par laquelle
l’eau du Kalitz entre comme par un trou ou fenêtre. Mais parce que les trois premiers jours (p. 67) elle est
très salée et que les citernes seraient remplies d’ordures si on la laissait couler librement pendant ce temps ;
c’est pourquoi ceux qui ont la charge, pour parer à cet inconvénient, murent ou bouchent l’ouverture
complètement et la laissent pendant trois jours dans cet état. Après quoi, accompagnés par une multitude de
gens, ils ouvrent à nouveau (le canal) pour laisser couler l’eau aussi longtemps jusqu’à ce que les citernes
soient remplies. Le jour de cette ouverture est un jour de grande allégresse pour toute la ville.
Les portes d’Alexandrie
La ville a six portes dont trois sont ouvertes, à savoir celle qui se trouve au sud qui est appelée Bab Issidr ;
celle qui se trouve à l’est s’appelle Bab Irascid ou porte de Rosette ; celle au nord-est est appelée porte de
la Mer. Les trois portes fermées sont celles de l’ancienne Douane, la porte Verte, appelée en arabe Bab il
Achdar et celle du vieux port.
Si les murs sont les mêmes que ceux qu’Alexandre fit construire.
Je ne peux m’exprimer avec assurance si les murs et les portes que l’on voit actuellement sont les mêmes
que ceux qu’Alexandre le Grand fit construire ou ceux que les Kalyphs ont fait faire par la suite. Je crois que
la dernière (supposition) est la vérité, bien que tous les autres voyageurs sont d’un autre avis.
Les fondements de mon opinion sont, 1. qu'on n’y trouve aucune inscription grecque, mais plutôt quelquesunes
en arabe écrite en coufique et d’autres en lettres arabes communes qui nomment le Kalyphs les ayant
fait bâtir, ou du moins restaurer, ainsi que l’année dans laquelle cela a été fait. Mais à cause de la hauteur
des portes où ces inscriptions furent gravées, et, l’art avec lequel les lettres furent agencées, ne m’ont pas
permis de les distinguer donc je ne peux pas en parler avec certitude. 2. La manière avec laquelle elles
furent construites le montre clairement, c’est avec la même façon qu’on construisit les portes du Caire dont
on ne peut nier qu’elles sont le travail des Kaliphs qui ont vécu beaucoup de siècles après Alexandre.
Ports.
Il y a deux ports dans cette ville, le premier est nommé le vieux port où les bateaux qui naviguent avec le
vent de l’ouest font escale ; mais de nos jours il ne sert plus que pour mettre à l’abri les bateaux qui vont de
l’est vers l’ouest quand le mauvais temps les surprend en cours de route les obligeant à y entrer. L’autre est
nommé le nouveau port, dans celui-ci tous les bateaux jettent l’ancre de nos jours.
La course du Maure.
Le 23 de ce mois, j’ai vu revenir un Maure d’une course qu’il avait fait pour montrer sa dignité et qu’il avait
assez de force pour être admis au nombre des porteurs de lettres d’Alexandrie jusqu’au Caire.
Cette course de celui qui aspire à être messager ou porteur de lettres d’Alexandrie consiste à porter sur ses
épaules un feu allumé dans une corbeille en fer, faite à la manière d’un grand (p. 68) réchaud, qui est
attachée au bout à un bâton (mesurant) la hauteur d’un homme et d’où pendent plusieurs anneaux en fer qui
pèsent trente-six rotols qui font environ trente-deux livres hollandaises. Avec ce paquet, il doit faire une
course de vingt-sept mille pas sur la route de Rosette et revenir le même jour dans la ville avant le coucher
du soleil ce qui fait en tout cinquante-quatre mille pas étant chargé en permanence de ce même paquet. S’il
y parvient, il n’est pas seulement admis au nombre des messagers, mais il gagne également les paris que
les autres ont fait contre lui. Au contraire, si les forces lui manquent, il perd sa dignité et n’est pas admis au
nombre (des messagers).
Celui que je vis rentrer dans la ville ce jour-ci et qui termina sa course avec gloire parce qu’il lui restait
encore deux heures de soleil, gagna le pari de quinze piastres valant chacun trente Medins et fut admis
parmi les messagers et collecta encore plus de huit piastres parmi ceux qui étaient témoins de son retour
triomphal. Il transpirait si fort qu’il semblait sortir d’un bain, il était suivi d’une multitude de gens à pied et à
cheval dont certains avaient porté le bois pour entretenir son feu et d’autres de l’eau pour le rafraîchir. Avant
d’en connaître la cause, je pensais qu’il y avait eu une émeute dans la ville.
Départ d’Alexandrie pour Rosette.
Après être resté aussi longtemps à Alexandrie qu’il nous semblait nécessaire pour assouvir notre curiosité,
nous partîmes de nouveau pour Rosette le jour des apôtres Pierre et Paul. Nous voulions faire ce chemin
par (la voie de) l’eau cette fois-ci et nous montâmes à cette fin sur une Germe qui nous amena en cinq
heures à Rosette. Ceci n’était pas sans danger de faire naufrage à l’embouchure du Nil parce que l’eau
frappe avec une telle force les vagues de la mer que cela fait même trembler le pilote le plus expérimenté
d’Égypte. »521
- 461 - 464 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN MICHAEL VANSLEB (1663)
Vansleb, J. M., Relazione dello stato presente dell'Egitto, nella quale si dà esattissimo ragguaglio delle cose
naturali del paese, del governo politico, che vi é, della religione de'Copti, dell'economia delli Egizii e delle
magnifiche fabriche, che ancor'hoggidì visi ci veggono, Paris, 1671.
Né en 1635 en Thuringe (centre de l’Allemagne), Johann Michael Vansleb est le fils d’un pasteur luthérien
d’Erfurt et l’élève de l’orientaliste Job Ludolph. Ce dernier persuade le duc Ernest de Saxe-Gotha d’envoyer
Michael Vansleb en Éthiopie pour une mission à la fois politique et religieuse. Michael Vansleb part en 1663,
visite l’Égypte et revint en 1665. Mais au lieu de rentrer en Saxe, il se rend à Rome où il prend l’habit de
dominicain en 1666. Par la suite, il suit l’évêque Bosquet de Montpellier qui l’amène à Paris en 1670 et le
présente au ministre Colbert. Ce dernier le charge d’une mission en Éthiopie. À son retour en France en
1676, Michael Vansleb est disgracié. Il meurt près de Fontainebleau en 1679.522
(p. 280) :
« Della colonna di Pompeo
Questa colonna vien’detta di Pompeo, credendosi da tutti, che Giulio Cesare l’habbi drizzeta in memoria di
detto Pompeo. Ella stà fuori di Alessandria, verso (p. 281) Scirocco, in campagna aperta, sopra un sito
rilevato, vicino al capo de’condotti, che provedono d’acqua le cisterne d’Alessandria, vicino al lago Meoti.
Non pare, che sia gran’cosa, sinche la persona non sauuicina ; mà poi approssimata che si è, gli riesce sì
alta, e grossa, che ne resta maravigliata. E della medesima pietra dell’Aguglie, liscia però come un’specchio,
e solamente comincia à scagliarsi un poco verso Tramontana ; & è alta conforme la misura di Gio : Teils,
130 piedi, fatta dell’ordine Corinto, dal che facilmente possono giudicarsi l’altre parti. I Mori da poco tempo in
quà hanno cominciato à scavarse sotto il piedestallo : e guardand’io in detta cava, viddi alcune inscrittioni
con caratteri, de quali à gran’pena (p. 282) si conosceva l’impressione.
Ne detti contorni anticamente ve’erano nobilissimi Palazzi, come lo dimostrano le ruine. Mà queste contrade
un’tempo sì nobili, hoggi giorno altro non sono, che ricoveri d’Arabi, ch’è una sorte di gente la più indegna
che possa trovarsi.
La città d’Alessandria è piena di simili anticaglie, sì di fuori come di dentro. Stanno ancora in piedi molte
colonne di granito, e d’altra sorte di marmo finissimo, alcune delle quali sono alte cinquanta piedi, molte
sono rotte, e molte sepolte nelle ruine. Quì si trova qualche residuo di Palazzo, & altrove alcuni magazzini, &
in ciascun’luogo monti intieri d’anticaglie cadute, si che convien’tal’volta caminar’gran’tempo per arrivare da
una casa all’altra. Et è veramente spettacolo, che muove à maraviglia, e (p. 283) compassione insieme in
vedere, e considerare una città sì illustre, e potente, ridotta in questo stato sì desolato ; ove vedonsi
muraglie grossissime, e torrioni intorno alla città di puri travertini artificiosamente commessi, & hora
consumati à guisà di tarmato legno. Se poi si considerano gl’innumerabili condotti, e cisterne, benche in
gran’parte rovinate, e le gran’spese in fabricarle, non può capirsi, nè le richezze respettivamente, che
pottessero havere quelle genti, di che hora appena ne vive la memoria. Deve ciò dunque servir’d’essempio,
non esser’al mondo pompa, ò magnificenza, per grande che sia, stabile, ò permanente ; mà transitoria, e
caduca. »
522 Eyriès, J.-B., « Wansleb, Johann Michael », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie
Universelle ancienne et moderne 50, Paris, 1826, p. 184-185.
Omont, H., Missions archéologiques françaises en Orient, aux XVIIe et XVIIIe siècles, t. I, Paris, 1902,
p. 54-174.
Pougeois, A., Vansleb, savant orientaliste et voyageur, sa vie, sa disgrâce, ses oeuvres, Paris, 1869.
- 465 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN DE THÉVENOT (du 14 au 28 février 1664)
Thévenot, J. de, Suite du voyage de Levant ; dans laquelle après plusieurs remarques tres singulieres sur
des particularitez de l’Egypte, de la Syrie, de la Mésopotamie, de l’Euphrate et du Tygre, il est traité de la
Perse et autres Estats, Paris, 1674.
Se référer à sa notice biographique présentée précédemment.
p. 10-15 :
« De quelques curiositez remarquées durant la navigation k dans Alexandrie.
J’appris dans cette navigation une chose que j’avois luë dans le Voiage de Monsieur de Breves, mais que
j’avois peine à croire, parce que je n’en avois jamais entendu parler, c’est que lorsqu’on approche de la terre
d’Egypte, & qu’aiant jetté la sonde, l’on ne trouve que quarante brasses de fond, c’est une chose assurée
que l’on est justément à quarante milles de la terre, le nombre des brasses de fond, depuis quarante, en
décendant, jusqu’à un, marquant au juste le nombre des milles qu’il y a, depuis le lieu où l’on sonde, jusqu’à
la terre : Mais sous le nom de terre d’Egypte, on doit entendre seulement la terre qui est depuis Damiette
jusqu’à Rosette, entre, les deux branches du Nil, cette règle n’étant que pour cette étenduë de terre.
Outre les Murênes dont j’ai fait mention nous primes encore dans ce voiage deux autres poissons, à savoir
un Marsouin, qui fut pris avec un Trident au dessus de Malte, vis-à-vis de Cap Passaro, il étoit long d’environ
cinq piés, & gros presque comme un homme, il étoit sans écailles, livide par le dos, blanchissant sous le
ventre, sa tête d’environ un pié & demi, & d’un bon pié de diamêtre ; ses yeux gros comme ceux d’un
homme, & entre deux yeux, ce poisson a un trou comme celui que les hommes ont à la tête, qu’on appelle la
fontaine, & c’est par là qu’il attire & rejette l’eau, en faisant comme une couronne ; il a deux joües qui ne sont
que du lard épais de deux pouces, elles commencent aux yeux, & viennent finir presque en rond sur le
museau, qui a de longueur, depuis la fin des joües jusqu’au bout, environ cinq pouces, & est fait à peu près
comme un bec d’oye ; sa langue est blanche épaisse d’un doigt, & large de deux ; il avoit cent soixante &
seize dents toutes fort-petites : Sa queuë est autrement tournée que celle des autres poissons, à qui une
des pinnes répond au dos & l’autre au ventre ; à celui-ci elles répondent toutes deux à ses côtez, il a le
membre & les testicules de même grosseur & longueur que les verats, les entrailles toutes semblables à
celles des pourceaux sa peau est tout lard épais d’un doigt, dont on fait de l’huile pour les lampes, la chair
est semblable à celle du beuf, & est fort-bonne, j’en ai goûté, & à la vuë & au goût, on la prendroit toûjours
pour du beuf, il n’a que des os et point d’arêtes, il a grande quantité de sang, qui est aussi chaud que celui
d’un animal terrestre, il se plaint & gémit comme un homme, il ne meurt pas si-tôt qu’il est hors de la mer,
mais il bat fort de sa queuë, où est la plus grande force.
L’autre poisson qui fut pris aussi avec le trident, est nommé des Provençaux Fanfre, ils étoient alors deux
ensemble, mais il y en eut un qui esquiva le coup. Ce poisson est fait comme un Maquereau & a la même
longueur & grosseur : je n’y ai rien trouvé de particulier, il a tout le dos ceint de bandes larges de deux
doigts, dont l’une est de couleur violette presque noire, & l’autre bleuë, & ainsi alternativement depuis la tête
jusqu’à la queuë, & le ventre en est blanc. Les mariniers disent que ce poisson s’étant une fois acosté d’un
vaisseau, il le suit toûjours sans le quitter, jusqu’à ce qu’il soit au port, & deux jours après en aiant pris un
autre, ils assûroient tous, que c’étoit le camarade du premier qui n’avoit point discontinué de suivre le
vaisseau. Au reste ce poisson est fort-bon à mon goût, & à celui de tous qui en avoient goûté autrefois, & qui
gouterent de ceux-ci.
Comme il y a peu de choses à Alexandrie que je n’aie remarquées dans mon premier voiage, je ne me suis
guères mis en peine d’en charger beaucoup mes memoires dans celui-ci. Cette ville est justement au trente
& uniéme degré de latitude, & de Rosette au trente-un & demi, au moins un Capitaine Flamand qui en avoit
pris les hauteurs me l’a assûré. De tout ce qu’il y reste de l’antiquité, la chose la plus considerable est cette
fameuse colonne de Pompée, dont je me souviens d’avoir dêja écrit : néanmoins comme j’ai été bien-aise
de la voir encore plusieurs fois, possible que les curieux ne seront pas fâchez que je leur fasse part de mes
observations. Je mesurai son ombre, à l’heure que les ombre sont égales aux corps qui les causent, & je
trouvai soixante & quinze piés de Roi, du fût seulement, sans compter ni pié d’estal ni corniche, mais l’ombre
étoit sur une étenduë de terre, qui alloit fort en décendant : Un autre jour lorsque les ombres des corps
étoient doubles, je trouvai près de cent soixante piés, du fût seulement, & huit piés de largeur ou de
diametre, & je remarquai que le pié d’estal a près de douze piés de haut. Chacun sait que la corniche de
cette colonne est à la Corinthienne.
Je vis aussi ce même jour une chose assez considerable à quoi je n’avois pas fait assez de reflexion dans
mon premier voiage. Etant sorti avec quelques personnes par la porte del Pepe, qui va entre le midi & le
couchant, à un millier de cette porte, allant entre le midi & le couchant, tout droit vers le Palus Maréotis,
laissant à main gauche la colonne de Pompée, vimes des grottes creusées dans le roc : nous entrâmes
dedans une, tout courbez, & comme l’on dit, à quatre pattes avec des cierges allumez ; étant dedans, nous
trouvâmes que le plancher étoit de plus de dix piés de haut & taillé fort-uni, & de tous les côtez nous vimes
des sepulcres taillez dans la muraille, qui est le roc même ; & il y en a quatre étages l’un au dessus de
l’autre, & d’un rang à un autre & d’étage en étage, il n’y a que demi-pié de distance, de sorte que les
entre-deux paroissent autant de piliers, qui soûtiennent ceux de dessus, leur profondeur va jusqu’au fond
des sepulcres, & ainsi ils servent de murailles pour separer les uns d’avec les autres. Nous vimes dans ces
sepulcres plusieurs os de morts que nous maniàmes, & ils étoient aussi frâis, & aussi durs, que s’ils eussent
été de gens morts un jour auparavant : Il y en avoit quelques-uns à terre devant l’ouverutre de la grotte,
qu’on y avoit jettez ; j’en maniai & rompis une partie, & je trouvai qu’ils s’étoient pourris à l’air, mais ils ne se
reduisoient pas en poussiere, seulement se rompoient en long, comme du bois blanc pouri, & ils étoient
humides aussi en dedans & avoient même une espêce de moëlle.
Etant sortis de cette grotte, nous entrâmes dans une autre qui est vis-à-vis, où nous vimes des sepulcres
comme à l’autre, nous y trouvâmes au fond un chemin qui alloit fort-loin, mais parce qu’il falloit aller courbez,
de la maniere que nous avions entré dans la premiere grotte, & marcher en cette posture, du moins aussi
loin que nous pûmes voir à la clarté de nos cierges, nous jugeâmes à propos de n’y point entrer, & de nous
contenter d’entendre dire, qu’il alloit plus de deux lieuës loin : C’est sur ce sujet tout ce que nous pûmes tirer
des Turcs, qui étoient avec nous, & qui nous dirent encore, que les anciens habitans d’Alexandrie avoient
creusé ces lieux, pour mettre leurs morts, il y a bien de l’apparence que cela est ainsi, & que c’étoit-là
quelque cimetiére. Je considerai en-suite le Palus Maréotis : il s’étend en largeur à perte de vûë, & n’est
éloigné que de quelques centaines de pas du Khalis, qui a son cours entre ce même Palus Maréotis, & la
colonne de Pompée, mais ils n’ont aucune communication ensemble.
Je montai un autre jour la montagne, où est la tour, dans laquelle se tient ordinairement une sentinelle, pour
faire baniere, si tôt que quelque vaisseau paroît : de là découvris facilement toute la ville, & la mer, avec le
Palus Maréotis, & tous les environs. En étant décendu, je fis à pié le tour des anciennes murailles
d’Alexandrie, commençant par la porte de la marine, qui regarde le nort, & allant droit au nort durant quelque
tems ; après quoi la muraille se détourne en angle droit, vers le levant ; & après une cinquantaine de pas, se
retourne vers le nort, jusque vis-à-vis le Palais de Cleopatre, qui étoit sur les murailles à l’opposite de la
bouche du port, aiant une galerie en dehors soutenuë de plusieurs belles colonnes, dont on voit encore les
restes sur le bort de la mer : Cette galerie venoit, ce dit-on, & même avec quelque apparence, jusque dans
le Palais, en sorte que l’on s’y pouvoit embarquer.
La auprès, l’on voit dans une tour, trois colonnes sur pié, qui soutiennent un petit dôme, qui étoit autrefois
soutenu de quatre, mais il y en manque une, je ne sai à quoi pouvoit servir ce petit dôme, qui est dans une
lieu où il n’y a point de jour, peut-être qu’il étoit au dessus de quelque citerne qui est bouchée à present. A
dix ou douze pas de cette tour, l’on voit une citerne, où il y a deux étages de colonnes, & l’on y voit en
plusieurs endroits des citernes soutenuës de même ; si bien qu’il semble que la plupart de la ville fût
soûtenuë de colonnes.
A quelques pas de là, l’on voit deux obélisques de pierres Thebaïques, dont l’une est couchée & ensevelie
en terre. & il n’en paroît que le pié ; l’autre est toute droite, mais il faut que la terre se soit bien haussée en
cet endroit ; car il y a de l’apparence que cette obélisque est sur son pié d’estal, dont on ne voit rien, non pas
même le pié de l’obelisque.
Vis-à-vis de cet endroit, la muraille se détourne encore vers le levant, & fait avec l’autre pan, un angle
rentrant presque droit, & après un assez long espace se replie en dedans, faisant un quarré, & après une
centaine de pas, elle retourne assez loin vers le gregal, tirant vers le nort ; en-suite faisant un angle aigu,
elle vient entre le levant & le siroc, jusqu’à la porte de Rosette, qui est au levant ; & de là tire bien loin droit
au midi ; après quoi elle fait un angle obtus, & va entre lebêche & le couchant. On voit le long de ce côté-là
le Khalis, & à quelques pas au delà, le Palus Maréotis, qui lui est parallele ; il est si large, qu’à peine voit-on
aucune terre de l’autre côté. Lorsque l’on est arrivé vis-à-vis de la colonne de Pompée, qui est au midi, on
trouve la porte del Pepe ou Sitre, qui est opposé au lebêche & couchant ; en-suite la muraille, qui est repliée
en dedans en cet endroit, pour faire la porte, continuë vers lebêche & couchant, jusqu’à un château neuf, qui
paroît être bien fort, & auprès duquel, peu loin de la porte del Pepe, le Khalis entre sous la muraille, dans les
conduits de la ville, d’où chacun en tire l’eau dans sa citerne par le moien des Pousserasgues.
Après cela la muraille tourne droit au nort & passe le long du vieux port, à l’opposite duquel, on voit à main
droite les Aqueducs, qui portoient autrefois l’eau du Khalis, du château du vieux port, au Bouquer. En-suite
la muraille vient droit, entre le gregal & le nort, jusqu’à la porte de la marine. Nous fûmes deux heures à faire
le tour d’Alexandrie, dont l’enceinte s’étend en long, du levant au couchant, mais elle est fort étroite. »
- 466 - 467 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANCESCO MARIA LEVANTO (avant 1664)
Levanto, F. M., Prima parte dello specchio del mare, Gênes, 1664.
Le Génois Francesco Maria Levanto, cartographe, navigue pendant 20 ans. À la fin de son ouvrage, il donne
la représentation de la côte maritime de l’Égypte et un dessin du port d’Alexandrie.523
p. 149 :
« Il porto d’Alessandria è una grande e rotonda Baya, & all’entrata non è molto largo ; su le due punte della
boca sono due castelli e quello da Ponente è piu grande e venendo presso di essi bisogna salutare almeno
con un tiro.
Dritto al Levante del Castello piu Occidentale giace un scoglio rotondo e nero fuori d’acqua e fra esso & il
Castello v’e brutto e sassoso à segno che non vi si puo passare fra mezzo ma a Levante del sudetto scoglio
assai vicino ad esso è la vera entrata, poiche del Castello Orientale esce un seccagno di scogli sotto acqua
verso il sudetto scoglio a segno tale, che fra questo e quelli non v’è molta distanza, ma nel piu fondo dell’
entrata sono 6 passa d’acqua come dal suo disegno si puo vedere, e fuori dell’entrata sono 8. 10. e 12.
braccia, e venendo dentro ritornano in 7. o 8. ed’ivi poi in 6. 4. e 3. passa di fondo.
Avanti della città è una ringhiera de scogli la punta Orientale de quali è sopra acqua e l’Occidentale sotto :
Da questi verso Mez. v’è buon sorgere per Vascelli piccioli. Parimente nel porto giace una secca quasi
quattro piedi sotto acqua, dietro la quale è la miglior posta in tre passa e mezza d’acqua, ma sopra tutto in
questo porto vi sono segadori e percio bisogna sostentar le Gomene con legni o berrili, e ben fasciarle : si va
dietro la sedutta secca giacente sotto acqua con queste osservationi e sono quattro buchi nelle mura della
città come se fussero porte, hor tenendo la piu grossa Torre della Città contro detti buchi, all’hora non
potrete mai investire sopra la secca.
Alla parte Orientale dentro del Porto è per tutto brutto di seccagni, come parimente alla parte Occidentale.
Dritto all’indentro del piu Occidentale Castello giacciono ordinariamente le Vascelli Turcheschi, mai i piu
grossi sorgono a Po giusto dentro l’entrata guardando le sue Gomene, come s’è detto, dalli segadori.
Quando voi venite avanti dell’entrata del P. e che sia tempo a quell’hora d’entrare li Piloti vengono sempre a
bordo, e vi conducono dentro.
A Ponente della città evvi anchora un porto, ma non è propio per Vescelli grandi, ma solamente per Galee
Turchesche. »
523 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 483.
- 468 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHRISTIAN VON WALLSDORFF (1664)
Wallsdorff, C. von, Reisebeschreibung durch Ungarn, Thracien und Egypten, s. l., 1664.
p. 21-23 :
« Nous nous rendîmes à Chios où je m’embarquai ; j’arrivai en même temps que les bateaux hollandais et
anglais à Alexandrie, ville appelée “Scanderia” par ses habitants.
Cette ville se situe à l’extrémité de la Méditerranée, non loin de l’embouchure du Nil. Elle possède le port le
plus important de tout le pays d’Égypte. D’un côté de la ville, au couchant, est la mer ; de l’autre côté, au
septentrion, en direction du Nil, se trouvent nombre de beaux jardins ; au levant, il y a un terrain désert et
sablonneux ; au midi, non loin, il y a un grand lac. Un peu plus loin de là, le Nil se jette dans la mer ; à cet
endroit, un grand fossé va dans la ville. Près de ce fossé, se trouvent de plaisants jardins arrosés et fertiles.
La plupart des jardiniers sont Mores (des gens pauvres) qui habitent dans des huttes faites en branches de
dattier ; certains ont tendu d’un arbre à l’autre un drap sous lequel ils s’abritent, avec femmes et enfants, le
jour, de la chaleur du soleil, et la nuit de la rosée et de la pluie.
La ville est très étendue ; l’intérieur est entouré d’une muraille flanquée de nombreuses et hautes tours. Bien
que chaque jour elle tombe de plus en plus en ruines, les habitants y font peu de restaurations.
A l’intérieur du mur d’enceinte, la ville est en grande partie déserte, pas même le quart y est construit ou
habité, le reste est fait de vieux bâtiments ruinés et de tas de cailloux. Certains bâtiments pourraient, à peu
de peine et à menus frais, être réhabilités en habitations confortables. Ceci montre que jadis, elle avait dû
être une ville fort magnifique et belle.
Lorsqu’on vient de la mer, en entrant dans la ville par la Porte de la Mer et en passant devant une longue et
haute maison de commerce (dans laquelle toutes les marchandises qui arrivent sont inspectées et taxées),
on arrive à une porte spéciale dans une longue ruelle qui est construite comme une ville même. Alexandrie
n’a que trois sorties ou portes qui sont bien gardées et qui sont fermées chaque soir. Dans cette ruelle il y a
peu de maisons d’habitation, il y a surtout des boutiques et des magasins dans lesquels les chrétiens, les
Juifs et les Turcs vendent toutes sortes de marchandises. Dans cette rue se trouvent aussi les fondachi des
Français, des Vénitiens, des Ragusains, des Génois, des Grecs et des Indiens ; ce sont des comptoirs. Les
habitants n’autorisent pas que les chrétiens étrangers habitent dispersés dans la ville. Ces derniers ne
possèdent que des Fondachi à deux étages (dans lesquels on y habite en haut et l’on y vend en bas).
Chacun de ses Fondachi n’a qu’une sortie ou porte (donnant sur la ruelle mentionnée) qui est fermée ou
ouverte par un More qui en a la charge. Le soir, lorsqu’il ferme les Fondachi, il frappe, à l’aide d’un marteau,
plusieurs fois contre la porte sur un morceau de fer spécialement fait à cet usage afin d’avertir les personnes
qui sont encore dehors. Personne n’a le droit de sortir la nuit.
Parmi les maisons ruinées, du côté de la mer, non loin de la muraille de la ville, on trouve sur une place
quatre belles colonnes en pierre dont trois sont encore entières, la quatrième est brisée ; elles sont assez
grandes et épaisses. À cet endroit se serait élevé le palais ou château d’Alexandre le Grand (construit à sa
mémoire et appelé de son nom comme l’affirme Justin lib. IX). Par sa situation, ceci est bien probable car il a
une belle allure du côté de la mer et de la terre. On trouve sous les maisons en ruines plusieurs pièces dont
le côté intérieur des murs en pierre ainsi que le sol est incrusté et soigneusement pavé de toutes sortes de
marbre coloré.
En dehors de la ville, vers la mer, lorsqu’on veut aller au Caire par voie de terre, on rencontre un très haut
mur construit sur plan carré dans lequel on peut encore voir de nombreuses fenêtres et portes faites de
beau marbre blanc. Ce bâtiment, jadis superbe, est selon l’opinion le palais du roi Ptolémée.
Il est étonnant que dans tout Alexandrie on ne trouve pas de mosquées ou d’églises belles ou bien
construites. Ils ne disposent que de petites et étroites constructions ; ils font leur prière surtout à l’extérieur.
En dehors de la ville, vers la mer, sur un côté, en direction du sud, il y a, comme dans un faubourg, plusieurs
centaines de petites masures chétives, construites très misérablement de pierre et de terre. Les Turcs et les
Juifs y habitent ; aucun Juif n’a le droit d’habiter à l’intérieur de la ville où la majeure partie des habitants est
composée de chrétiens et de Mores. À côté de ces masures, il y a une maison particulière à deux étages,
tout en pierre, qui est la résidence du Samaco : il s’agit du premier gouverneur de la ville. Près de ce dernier
habitent en grand nombre les janissaires et les spahis.
À l’extrémité de ces petites maisons commence une haute et forte muraille qui s’étend très loin dans la mer
jusqu’au château ou fortin situé dans la mer pour la protection du port. Ce dernier est de forme arrondie
naturellement, en demi-cercle ; pour cette raison, le port est beau à voir. Le château est bien fortifié par une
enceinte et il est protégé au milieu par une haute et forte tour. On peut aussi y entrer à pied en marchant sur
la muraille qui s’étend de la terre jusqu’à ce fortin de mer.
En entrant dans ce port, la coutume veut que les bateaux des Turcs et des Mores se rangent sur le côté
dudit fortin, tandis que les bateaux des chrétiens ancrent au milieu du port. Les galères et les bateaux de
guerre mouillent derrière le fortin dans un autre petit port. »524
524 Traduction : U. Castel (archives Sauneron, Ifao).
- 469 - 470 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTONIO GONZALES (hiver 1665)
Gonzalès, A., Voyage en Égypte du père Antonius Gonzalès, 1665-1666, par Ch. Libois S. J., Ifao, Le Caire,
1977.
Antonio Gonzalès (1604/1683), de père espagnol, naît à Malines, ville de Belgique située en région
flamande dans la province d’Anvers. En 1629, il est ordonné prêtre chez les Franciscains Récollets à
Bootendael, près de Bruxelles. On ignore les fonctions qu’il exerce, mais il est probablement prédicateur. À
l'occasion d'un pèlerinage en Terre sainte, il passe huit jours à Alexandrie.525
p. [310]-[337] (tome I) :
« Vers midi nous arrivâmes - grâce à Dieu - sans inconvénients, sains et saufs et avec un bon appétit, dans
cette ancienne ville royale d’Alexandrie. Nous étions restés à jeun pour pouvoir encore dire la messe dans
notre résidence, mais du fait qu’il était presque midi et que nous étions bien fatigués après un voyage de
sept lieues, et pour ne déranger personne, nous avons remis la messe au jour suivant car, d’ailleurs, ce
n’était pas un jour de précepte.
Cette ville fameuse est appelée Alexandrie d’Égypte, car elle a été fondée au bord de la mer, sur le littoral
africain, par Alexandre le Grand, trois cent vingt-neuf années avant la naissance du Christ, d’après Pline
dans son livre. Pour la distinguer d’autres villes du même nom, fondées dans d’autres royaumes et pays,
elle a la spécification : Alexandrie d’Égypte.
Par la suite, Ptolémée a agrandi et amélioré la ville.
Alexandre le Grand est mort à Babylone ; son corps fut transporté par Ptolémée à Memphis et quelques
années après à Alexandrie. Lorsque l’empereur Auguste vint à Alexandrie après sa victoire sur
Marc-Antoine, il visita avec grand respect le tombeau et, voyant le corps d’Alexandre le Grand, plus jeune
que lui, des exploits dont le monde fût plein.
Cette ville fut jadis la plus belle et la plus forte de toute l’Égypte. Elle était pourvue, comme on peut encore le
constater d’après leurs restes et ruines, de doubles murailles dans lesquelles se trouvèrent cent cinquante
tours, dont quelques-unes sont encore intactes, d’autres à demi conservées et d’autres encore réduites à
leurs fondations seulement. Les remparts et murailles sont également en majeure partie détruits.
La ville avait des temples splendides pour les idoles, et ensuite (ils serviront aux) chrétiens. Elle disposait de
plusieurs palais royaux dont il ne reste presque rien. La ville entière est pleine de tas de pierres, de ruines,
vrai miroir de l’instabilité du monde. Alexandre le Grand y tint sa cour à cause de sa belle position et de son
excellente situation pour une place forte. Car d’un côté s’étend la Mer Méditerranée, de l’autre un vaste lac
d’eau stagnante, et sur le troisième côté, de beaux jardins. Son port est excellent et admirable. Sur un lieu
avancé en mer, se dresse un très fort château, appelé Pharos parce qu’il est construit sur les fondations de
la tour Pharos, comptée parmi les sept merveilles ou miracles du monde. Ce château est imposant, construit
de pierres blanches, montant à partir du fond de la mer, – la profondeur y est de dix brasses, chaque brasse
de six pieds ; cela fait soixante pieds –. Jadis, cette tour se dressa sur une petite île particulière, à l’écart de
la ville. Mais au moment où ce château fut construit, Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte, le relia à la ville
au moment d’une digue très solide, forte et longue, de huit cent soixante-quinze pas, afin de pouvoir y arriver
par terre. Sur cette digue, on peut actuellement arriver par terre jusqu’à ce château. Tant de terre s’est
déposé sur les flancs de cette digue, qu’elle est transformée en un grand et large boulevard, ayant de ses
deux côtés un vaste port excellent et sur la pointe ledit château. L’espace jusqu’à la ville prend un quart
d’heure et il est rempli de bâtiments admirables, – construits avec l’aide des matériaux de l’ancienne ville –,
de grands entrepôts, si bien que la ville actuelle dépasse l’ancienne Alexandrie.
Cette ville fut jadis extrêmement riche à cause du commerce qu’on y faisait, car ce lieu est avantageux et
pratique pour le commerce, étant situé entre les Indes Orientales et l’Europe. Tous les produits précieux qui
poussent aux Indes : épices, drogues, remèdes, sont transportés, par mer, des Indes jusqu’à la Mer Rouge à
Memphis ou le Caire, (ils parcourent) une petite distance, trois jours seulement, environ trente-six lieues. Ils
sont ensuite transportés sur le Nil à Alexandrie et de là en Syrie, en Grèce, en Italie, en Espagne, etc. La
ville fut pleine de richesses et de palais. Mais, au bout de quelques temps, cette magnificence a décliné à la
suite des guerres, des luttes intestines et autres misères, de telle manière qu’elle n’est plus que le spectre
ou l’ombre de l’ancienne Alexandrie. Et non seulement cette ville, mais aussi la Sicile, Messine et Venise ont
subi des pertes sensibles depuis l’arrêt des transports de ces marchandises précieuses par Alexandrie,
après que les Portugais eurent découvert une autre route, par laquelle ils transportaient les marchandises
tout droit des Indes en Espagne et de là à d’autres places. Les Hollandais, en possession de la plupart des
îles dans les Indes orientales, font de même actuellement.
La ville fut spécialement fameuse dans les temps apostoliques après la glorieuse Ascension du Seigneur,
non seulement par la multitude des nations étrangères qui s’y installèrent, venant de partout, mais
principalement à cause de l’éclat des hommes extraordinaires, éminents en sainteté et en sciences, des
martyrs, des papes, des confesseurs et des vierges. Elle fut honorée d’un siège patriarcal, le premier après
celui de Rome. Dans cette ville rayonnèrent saint Marc l’Évangéliste, saint Aman, saint Clément, saint
Athanase, de nombreux évêques, Didyme, Théophile, dont saint Jérôme fait mention dans le livre De viris
illustribus.
L’Alexandrie actuelle est pour une très grande partie construite sur des arcades et des colonnes ; dans ces
parties souterraines elle a l’air d’être une autre ville. Sous terre, j’ai remarqué plusieurs constructions avec
des colonnes précieuses de marbre, de porphyre, de jaspe, etc. Tous les jours on découvre encore de
pareilles constructions. On nous montra entre autres une bâtisse, trouvée récemment, qui ressemblait à un
cloître carré avec des arcades reposant sur de belles colonnes de porphyre, hautes de huit pieds. J’eus
l’impression que c’était un palais royal. On prétend que de nombreux trésors de valeur ont été trouvés sous
les ruines, mais que leurs découvreurs ne le crient pas sur les toits pour ne pas être spoliés.
Cette ville ne dispose pas de fontaines mais elle se contente de citernes, qui se remplissent d’eau lorsque le
Nil monte, grâce à quelques conduites souterraines. De cette eau du Nil les champs et jardins sont
également tous arrosés.
En de nombreux endroits de cette ville on aperçoit, soit debout, soit gisant par terre, d’élégantes et grandes
colonnes de marbre de toutes les couleurs. Parmi d’autres monuments splendides, on nous montra la
cathédrale et l’ancien palais adjacent des patriarches d’autrefois, de saint Athanase, etc. C’est un bâtiment
magnifique, fait de trois rangées de hautes colonnes de marbre. Mais comme le palais était à moitié détruit
et dans un état délabré, on a tracé une route à travers celui-ci. De l’autre côté du chemin, on constate
encore sous les ruines, la présence de plusieurs citernes dont l’ouverture visible est faite d’un marbre blanc
et très dur, dans lequel des croix sont creusées, – quatre sur chaque margelle – auxquelles les Turcs ne
touchent pas, quoiqu’ils remarquent tous les jours que les chrétiens les vénèrent, les baisent et ont de la
dévotion pour elles.
Voilà une chose que les novateurs ne nous permettent pas, et dont ils n’admettraient plus la présence. Ils
sont pires que les Turcs. Ce n’est pas cela que les vénérables Pères ont enseigné, eux qui, en mémoire du
Christ crucifié, ont placé des croix presque partout, sur les clochers, sur les églises, sur des pierres et dans
les lieux publics. Ils y mettaient leur gloire, comme l’écrit saint Chrysostome.
Sur les églises de Sainte-Catherine et de Saint-Marc à Alexandrie
Dans cette ville d’Alexandrie il y a une église illustre et fameuse, dédiée à la sainte vierge et martyre
Catherine. Un couvent, qui appartient aux Grecs de l’ordre de saint Basile, lui est adjacent. Ce couvent est le
siège patriarcal des Grecs ; le patriarche d’Alexandrie y résidait habituellement avec vingt-six ou trente
religieux. Mais il habite actuellement à Moscou. Ici il n’a que son vicaire et quelques moines. Par
quelques-uns cette « abbaye est appelée Saint-Saba, abbé » mais les catholiques latins et romains
appellent cette église « l’église de Sainte-Catherine ». Je suis d’avis qu’elle doit être appelée ainsi, puisque
sainte Catherine est en grand honneur et vénération parmi les Grecs et les Latins. Les Grecs – comme il
appert de leur ménologe – célèbrent cette fête de sainte Catherine avec un office double. Dans le temps,
lorsque les marchands de Venise y vivaient encore, ils ont ajouté, pour cette raison, une chapelle vaste et
magnifique en l’honneur de cette sainte vierge, et l’ont pourvue d’ornements et de tout le nécessaire. Nos
pères en ont la charge et assurent le service. Parce que sainte Catherine est née à Alexandrie et a subi le
martyre en cette ville, il est plausible que cette église soit érigée en sa mémoire par les chrétiens dévoués,
car aucune autre église dans la ville que celle-ci ne porte son nom, ou comment cette église fut appelée
autrefois. Il me suffit qu’elle soit actuellement appelée l’église de Sainte-Catherine.
J’ai célébré la messe dans la chapelle des Vénitiens ; elle donne sur l’endroit où on chante l’évangile, dans
la grande église que les Grecs desservent. On montre près de la dernière colonne, qui sépare chapelle et
église, un reste d’une colonne ou pierre de marbre blanc à laquelle – d’après des dires de quelques-uns –
étaient fixées les roues qui déchirèrent le corps de cette frêle vierge. D’autres prétendent que cette sainte
vierge s’est agenouillée sur cette même pierre lorsqu’elle fut décapitée. On y distingue encore quelques
taches qui paraissent être le sang de cette vierge. Cette dernière (tradition) est plus probable car il n’y avait
pas d’effusion de sang avant la décapitation. Car on lit ce qui suit dans le martyrologue romain au vingt-cinq
novembre : « La naissance de sainte Catherine, vierge et martyre, qui ayant confessé la foi à Alexandrie,
sous l’empereur Maximien, fut d’abord jetée en prison, puis très longtemps fouettée avec des scorpions ;
enfin ayant eut la tête tranchée, elle consomma son martyre. Les anges portèrent son corps sur le mont
Sinaï, où il est honoré par un grand concours de chrétiens qui viennent l’invoquer. » Le bréviaire romain
parle en sa fête, de sa sagesse et sa science, et dit comment elle a converti au Christ les cinquante
philosophes qui essayèrent de lui faire renier la vraie foi, et qui ont eux-mêmes courageusement supporté le
martyre.
Concernant la véracité de ce qu’on dit au sujet des taches de sang de cette sainte vierge, encore
apparentes sur la pierre, je dis qu’il se peut effectivement que Dieu ait permis et permette jusqu’à ce jour,
qu’on distingue encore les taches, en mémoire éternelle de son martyre courageux. – Car nous lisons que la
même chose eut lieu dans le temple de Jérusalem à la mort de Zacharie, que les Juifs ont tué entre le
temple et l’autel, d’après l’enseignement de notre sauveur en saint Matthieu –. En sa mémoire nous
vénérâmes et baisâmes ce sang comme des reliques précieuses, ce qu’elles sont en réalité.
Après avoir célébré la messe, nous visitâmes le couvent. Le très révérend vicaire du patriarche nous reçut
avec tous les affections et honneurs, et nous montra le couvent et le jardin entiers. Il est assez grand mais je
n’ai pas l’impression qu’ils commettent des excès ou qu’ils vivent dans le luxe, comme dans quelques
abbayes de la chrétienté. On vit à peine une chaise ou un banc, un plat ou un pot, dans le couvent ou la
cuisine. D’après les bruits répandus parmi les catholiques, ils vivent très pauvrement et ascétiquement. Ceci
fut suffisamment visible d’après les habits rapiécés des moines et du vicaire. Ils nous offrirent avec grande
cordialité de prendre un repas ; mais étant donné qu’il était encore tôt dans la journée, nous partîmes de là
avec de nombreux remerciements.
Au sujet de l’église de Saint-Marc : il est étonnant qu’elle soit encore restée aux chrétiens. Aux temps où
fleurissait la foi du Christ dans tout son éclat dans la ville, les fidèles dévots érigèrent de très nombreuses et
belles églises en l’honneur de Dieu et de ses saints. Mais après que cette ville fut tombée sous la coupe des
infidèles et la tyrannie des Turcs, la foi fut pour ainsi dire expulsée de là. Les églises chrétiennes furent
tantôt changées en mosquées pour les Turcs et les Maures, tantôt elles tombèrent en ruines ou furent
détruites par les guerres, par la vétusté ou par la haine des infidèles. Parmi les quelques églises encore
demeurées entre les mains des chrétiens, on en trouve deux qui sont restées en l’honneur, la première, celle
de Sainte-Catherine dont nous venons de parler.
Cette église de Saint Marc a un couvent, ou mieux une maison contiguë, auparavant habitée par les Coptes
qui ont encore la charge de l'église. Mais d'après ce que j'ai pu constater, personne n'habite plus dans cette
maison, car on ne remarquait, à l'intérieur, le moindre mobilier ou ustensile. Maintenant ils ont la résidence
de l'autre côté de la rue. Après des coups réitérés de notre part – en vain – à la maison comme à l'église, un
Turc qui passait nous indiqua leur domicile. Là, nous trouvâmes les religieux et les clefs de l'église avec
celles de la maison. Tout de suite, ils nous accompagnèrent pour tout nous montrer. L'église n'est pas très
grande mais elle convient au peuple et de même aux religieux ? Nous y célébrons la messe autant de fois
que nous désirons. Car les Coptes ne sont pas aussi fanatiques que les Grecs qui ne veulent pas nous
permettre de célébrer la messe sur leurs autels ; eux, de leur côté, ne voudront pas dire la messe sur un
autel où un prêtre romain aura célébré, disant que l'autel est profané. Mais, comme j'ai déjà dit, les Coptes
l'autorisent partout, et aussi les Arméniens, comme à Jérusalem dans l'église de Saint Jacques, dans l'église
de la maison de Caïphe, etc.
L'objet vénérable, dans cette église et la cause pour laquelle elle est visitée, est la chaire fixée au mur – à la
même hauteur que le sont habituellement les nôtres – d'où Saint Marc lui-même a annoncé l'évangile,
d'après l'ancienne tradition commune parmi les habitants. Elle semble réparée à quelques endroits, et elle
en avait bel et bien besoin. Car à cause du zèle indiscret des pèlerins qui en détachent des fragments, elle
était ici et là endommagée. C'est l'origine de la perte de nombreuses choses saintes et des reliques. Bien
que les papes eux-mêmes l’aient interdit sous peine d’excommunication, cela arrive néanmoins, soit parce
que les pèlerins ne s’en soucient pas, soit parce que la conscience leur fait défaut, de telle manière que, si
chaque pèlerin se permettait d'enlever un morceau, cette chaire de Saint Marc serait réduite à rien et
oubliée, comme rien ne reste de nombreuses choses saintes, à l'exception de la tradition et de la mémoire
qui, finalement, disparaissent aussi.
La chaire est ronde, ressemblant à celles de notre pays, mais sans ornement. Sous la chaire paraissent se
trouver quatre corps saints restés intacts, mais dont les noms sont inconnus. Nous n'avons pas pu les voir,
parce que le souterrain n'est jamais ouvert en l'absence du patriarche. Derrière l'autel se trouve l'endroit où
fut autrefois le tombeau de l'évangéliste Saint Marc. Son corps pourtant a été enlevé de cette église et
transféré à Venise, où il est hautement vénéré dans la cathédrale construite en son honneur à très grands
frais. Cependant, son ancien tombeau est également vénéré par les fidèles, à cause du grand trésor qui y
était enseveli et qui était un temple du Saint Esprit.
Pour la meilleure connaissance de ce qui est arrivé à saint Marc – qui a illuminé cette ville et l’a rendue
illustre par sa science, sa sainteté et ses miracles – il faut remarquer que saint Marc l’Évangéliste, d’après
l’opinion commune des docteurs, fut un des soixante-dix disciples du Christ, né Juif, de la classe des prêtres,
et un des prêtres qui ont cru au Seigneur après l’Ascension du Christ, dont saint Luc dit dans les Actes 6 : 7 :
« Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. » Il était très aimé par saint Pierre et, ayant suivi Pierre à
Rome, il exerçait auprès de lui l’office de secrétaire. L’Évangile qu’il y a prêché, il l’a mis par écrit à Rome, à
la demande des fidèles et par ordre de Pierre. Celui-ci l’a relu et approuvé, jugeant qu’on pouvait librement
le lire et prêcher avec fruit. Que celui qui désire en savoir davantage, consulte les Annales de Baronius,
tome I, sub Anno Christi 45.
Saint Pierre ne cherchait pas sa propre commodité ni le profit qu’il tirait de saint Marc, mais le profit de
l’Église sur laquelle il était placé comme chef par le Christ Notre Seigneur. Il savait bien qu’en Égypte une
moisson abondante attendait d’être recueillie dans les greniers du Seigneur et que, dans ces temps,
Alexandrie était la ville principale vers laquelle affluaient différentes nations de toutes les parties du monde.
Afin que la grâce du Saint Esprit pût être répandue sur elle, (saint Pierre) envoya à sa place son disciple
bien-aimé, Marc, pour y prêcher l’évangile – parce que d’innombrables hommes y étaient rassemblés,
(venus) de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe, comme dans un théâtre mondial, - et pour y fonder une Église,
l’instruire par ses prédications, la diriger par son autorité, l’inspirer par son exemple, l’enflammer en amour et
l’orner par son martyre glorieux.
Saint Marc, comme il est dit brièvement dans le Ménologe du cardinal Baronius, Tome I, ad annum Christi
46, fut le premier qui prêcha l’évangile à Alexandrie. Après qu’il eut implanté ici l’Église et rassemblé d’autres
de Libye, de Marmarique, de la Pentapole, de Thébaïde et de presque toute l’Égypte, les infidèles l’ont pris
un dimanche alors qu’il célébrait la messe ; ils mirent la main sur lui, nouèrent une corde autour de son cou
et le traînèrent sur les rochers et pierres jusqu’à un lieu en dehors de la ville au bord de la mer, appelé
Bucoli. Sa chair et son corps furent entièrement meurtris et il rendit presque l’âme. Là, ils le poussèrent en
une prison où Notre Seigneur vint avec les anges le réconforter, en lui donnant du courage en vue de la lutte
prochaine. Le lendemain matin, ils le firent sortir de la prison et le tirèrent comme la veille sur le lieux
pierreux et âpres, tandis qu’il louait et remerciait Dieu. En disant : « Seigneur, je remets mon esprit entre tes
mains », il remit son âme immaculée aux mains de Dieu et fut enseveli avec tous les honneurs par ses
disciples. Ceci est emprunté au ménologe des Grecs, avec lequel celui des Latins concorde.
Étant donné que saint Marc, au nom de saint Pierre, a fondé à Alexandrie cette noble, multiple et sainte
Église, l’Église d’Alexandrie est la première après celle de Rome, d’après le témoignage du Pape Gélase, In
Decret. de lib. Apocryph., avec les mots : « Le deuxième siège est consacré et fondé à Alexandrie au nom
de saint Pierre, par Marc, son disciple et l’évangéliste. Car il fut envoyé par Pierre en Égypte où il a prêché la
parole de la vérité et consommé le martyre. » Ainsi témoigne Gélase.
J’ajouterai à ce propos ce que dit le Cardinal Bellarmin, Tom. I, Controv., Lib. I, De Roman. Pontif.,
Chap. 24 : que dans l’antiquité, il n’y eut que trois sièges patriarcaux, ceux qui existaient les premiers.
L’Église de Rome occupait la première place, celle d’Alexandrie la seconde, celle d’Antioche la troisième,
d’après plusieurs anciens conciles légitimes. Afin d’expliquer pourquoi il y en avait trois et pas plus, et
pourquoi ils sont placés dans cet ordre, laissant d’autres de côté, il est dit que ces trois seulement sont les
sièges premiers et patriarcaux, à cause de Pierre qui, placé comme chef et pasteur suprême de tous les
autres, avait fondé et dirigé ces Églises, soit en personne, soit par d’autres. À Antioche et à Rome, Pierre a
occupé le siège ; à Alexandrie, il l’a occupé (en personne), d’après Nicephore, lib. 14, chap. 8, ou par son
disciple saint Marc qu’il a envoyé pour fonder en son nom une Église, d’après l’enseignement de saint
Grégoire, lib. 6, Epist. 37, Ad Eulogium Alexandrinum.
La raison de cette succession prescrite est la suivante. Quoique les trois sièges relèvent de saint Pierre, il a
néanmoins occupé celui de Rome jusqu’à sa mort, celui d’Alexandrie par l’intermédiaire de saint Marc, et
celui d’Antioche par Evodius ; et de même que saint Pierre est plus grand que saint Marc l’Évangéliste, de
même Marc est plus grand qu’Evodius qui ne fut ni apôtre ni évangéliste. Également l’Église romaine
dépasse en autorité et dignité celle d’Alexandrie qui, a sont tour dépasse celle d’Antioche.
Dans les derniers temps, les sièges de Constantinople et de Jérusalem sont aussi comptés parmi les Églises
patriarcales sans que personne ne s’y soit opposé. D’où il appert que, en l’honneur de saint Marc, le siège
patriarcal d’Alexandrie vient à juste raison après celui de Rome, mais avant les autres.
On montre aussi à Alexandrie, dans l’église de Saint-Marc, le bras de saint Georges, martyr, contenu dans
une petite colonne. À part ces deux églises, les catholiques, les Français et les Vénitiens, disposent à
Alexandrie de leurs propres églises et oratoires, où nos religieux assurent le service des âmes et exercent la
fonction de curés.
Sur la colonne de Pompée, les pyramides et les colonnes d’Alexandrie
En dehors de la ville, sur un monticule ou une colline, à environ deux cents pas de la ville, se dresse une
colonne –ou pilier– appelée « colonne de Pompée », que personne jusqu’à maintenant n’a pu déplacer. Elle
est taillée d’un marbre dur, d’une hauteur et épaisseur peu communes. Elle est haute de cent trente pieds à
partir de la terre, et sa circonférence mesure seize pieds. Elle se dresse encore intacte, avec chapiteau, fût
et piédestal. Quelques-uns veulent prétendre que cette colonne – comme plusieurs autres – est fondue, car
ils ne peuvent pas comprendre qu’on ait pu transporter une telle colonne d’une seule pièce, et qu’elle ait
toutes les couleurs comme le vrai porphyre. Mais il est impossible d’admettre que cette colonne soit fondue,
car elle est extrêmement dure et polie comme un miroir. Elle ne serait pas restée tant de siècles debout, et
n’aurait pu supporter tant de tempêtes et orages. Le piédestal sur lequel cette colonne se dresse, a une
largeur de seize pieds de chaque côté, c’est-à-dire soixante-quatre au périmètre. Elle se tient en outre sur un
endroit élevé, de sorte qu’on la distingue de très loin en mer, et de près elle ressemble à une haute tour. La
colonne est célèbre à travers le pays entier et elle met dans l’étonnement tous ceux qui la voient ou l’ont
vue. Ainsi on la montre à tous les pèlerins étrangers.
Plusieurs fois j’ai cherché pour quelle raison elle s’appelle « colonne de Pompée », mais je n’ai rien pu
découvrir chez un auteur quelconque qui décrit la vie de Pompée.
Quelques-uns ont dit que Pompée est mort en ce lieu, et que cette colonne fut érigée à sa mémoire éternelle
et dotée de son nom. Qu’il ait été tué à Alexandrie, est écrit par Dolionius dans le résumé de son livre sur
l’histoire, écrit en italien, parte 1, anno mundi 3911, mais cela est faux à n’en pas douter. Car Jules César
dans son De bello civili, liber 3, qui mérite plus de confiance, (nous) apprend que Pompée fut
ignominieusement assassiné près de Péluse sur le Nil, par les amis de Ptolémée – qui régnaient en fait sur
le pays à cause du grand âge de Ptolémée –, lorsqu’il croyait être reçu à Alexandrie par le roi, du fait de
l’ancienne amitié qui l’avait lié à son père, et qu’il fuyait Jules César.
Le patriarche d’Alexandrie, qui était très au courant des antiquités et traditions de ces pays, écrit que cette
colonne fut appelée ainsi, parce que le père de Pompée l’avait fait couper et tailler, et avait voulu ériger cette
colonne en mémoire éternelle, comme les grands de ce monde. Mais vu le poids et la pesanteur
exceptionnels, il n’arriva pas à trouver un moyen. Pompée l’apprit, et pour satisfaire au désir de son père qui
aurait ainsi un grand renom, s’en acquitta d’une telle intelligence et de tels moyens, qu’il la dressa une nuit
avec l’aide des prisonniers de son père, dans l’état où on la voit encore. À la suite de cette érection, elle a
toujours été appelée depuis ce temps : « Colonne de Pompée ».
Mais cette explication est également considérée comme une invention et un rêve des Grecs. Cela à juste
raison, car Plutarque, qui a magistralement décrit toutes les oeuvres de Pompée et de nombreux autres
(hommes) de moindre importance, ne fait cependant pas mention de l’érection de cette colonne. Pierre
Belon dans ses Observations livre deux, chap. vingt-et-un, donne une autre explication de l’érection de cette
colonne, en décrivant les circonstances, avec les paroles suivantes : « Le jour après allasmes voir la haute
colonne de Pompée, hors de la ville, dessus un petit promontoire, à demy quart de lieue d’Alexandrie. La
colonne est d’admirable espoisseur et de desmesurée hauteur, plus grosse que mille autre qu’ayons jamais
veue. Les colonnes d’Agrippa au Panthéon de Rome n’approchent en rien de son espoisseur et grosseur.
Toute la masse tant de la colonne, du chapiteau que de la forme cubique, est de pierre Thébaique, de la
mesme pierre dont furent faits tous les obélisques qui ont été retirez d’Egypte. L’on dict que Caesar la fit
eriger là pour la victoire qu’il obtint contre Pompée. Ceste colonne est si grosse, qu’il serait maintenant
impossible de trouver un ouvrier qui par engins la peust transporter ailleurs ». Ainsi dit Belon.
Mais cette raison alléguée par Belon, a ses inconvénients. Car si la colonne était érigée par César, elle
aurait dû porter le nom « Colonne de Jules César ». En outre, elle fut érigée à la mémoire de la victoire qu’il
avait obtenue sur Pompée. Pourquoi cette colonne n’est-elle pas dressée sur les lieux mêmes de sa vistoire,
d’abord en Macédoine, ou bien en Thessalie, où Pompée fut battu près de Pharsale, ou enfin à Rome où
ces stèles de triomphe furent érigées et les vainqueurs firent leurs défilés triomphaux en gloire et grande
pompe ?
Cela paraît aussi être contraire à ce que nous lisons de César, qui a très mal pris la trahison et la mort de
Pompée. On dit que quand César l’apprit en Égypte, il pleura et il punit de mort les traîtres et assassins
Photinus et Achillus. Lorsqu’on lui montra la tête de Pompée, il se tourna et ne put la regarder. Il fit enterrer
Pompée à Alexandrie dans un faubourg avec tous les honneurs, et lui dédia un petit édifice.
En outre, à toutes les opinions précédentes, s’oppose ce qui suit. Dans le livre de Petrus Appianus et
Bartholomeus Porta526, In inscriptionbus sacrosanctae Vetustatis, est mentionnée une des inscriptions de
l’Afrique, gravée ou taillée dans cette colonne, je n’y ai pas fait attention, mais je la reproduirai ici en latin car
elle sert de notre propos :
« À Alexandrie d’Égypte se trouve une colonne d’une hauteur admirable sur laquelle est écrit : « Democrates
Pericletus Architectus me erexit iussu Alexandri Macedonum Regis », c’est-à-dire : Democrates Pericletus,
architecte (ou constructeur), m’a érigée par ordre d’Alexandre, Roi des Macédoniens. »
Si ce qui est mis par écrit est vrai, dans ce cas les opinions précédentes ne peuvent pas être justes, mais
c’est Alexandre le Grand, -qui fonda la ville d’Alexandrie en Égypte-, qui a érigé, à cette occasion, cette
grande colonne à sa gloire perpétuelle. En conséquence, elle ne put être érigée ni par Pompée, ni par Jules
César, qui vécurent longtemps après Alexandre.
Peut-être est-elle appelée : Colonne de Pompée, parce que la tête de Pompée y serait enterrée, étant donné
l’existence de la petite chapelle dédiée à lui, comme nous disions.
Ou aussi, comme pensent quelques-uns, parce que le corps d’Alexandre y fut déposé ou enseveli par
Pompée, c’est pour cette raison, qu’elle est appelée : Colonne de Pompée, car dans les environs de cette
colonne on distingue de nos jours encore les ruines d’un temple magnifique, à une distance de deux portées
de flèches à peu près –à moins que ce ne soit la dite chapelle de Pompée-.
Je rapporte ce que j’ai vu, entendu et lu, car on ne peut savoir exactement ces choses.
De là on jette un regard à perte de vue sur le lac Buchaira et la Mer Méditerranée. Ce lac est très vaste et
large comme une mer, mais pas très profond. Car un vieillard m’a raconté que plusieurs années il l’a vu à
sec.
À partir de cette colonne jusqu’à la ville, s’étend un grand espace désert, où l’on remarque les débris et les
tas de pierres d’anciennes constructions. Sans aucun ordre y pousse une abondante quantité de câpres, si
bien que non seulement elles suffisent amplement à la consommation dans la ville, mais qu’on en expédie
aussi de pleins tonneaux au Caire et à d’autres villes en Syrie et à la chrétienté, Rome, Venise, Gênes, etc.,
comme une curiosité, car les câpres d’Alexandrie dépassent en qualité et grosseur toutes celles qui
poussent ailleurs. À cause de cette copieuse abondance, elles se vendent bon marché, puisqu’elles
poussent dans les terrains vagues où chacun peut les cueillir.
Un autre jour, nous nous sommes promenés pour aller voir le port, où se construit la nouvelle ville, car
l’ancienne ville n’est presque plus une ville à cause des diverses destructions qu’elle a subies à différentes
époques. Mais aucune dévastation ne l’a autant détruite que celle de 1524 (vide Africa, fol. 74) par les
pirates de Barbarie, qui circulent en grand nombre dans la Mer Méditerranée, attaquant chacun pour le piller,
sans distinction de nation. Ces brigands et pirates attaquèrent comme des loups furieux cette ancienne ville,
qu’ils dévastèrent et réduisirent en cendres. Pour cette raison on n’y voit, de nos jours encore, que des murs
écroulés, des maisons et des bâtiments ensevelis sous la chaux et les pierres. Depuis ce temps-là, quelques
maisons encore ont été construites, dans l’ancienne ville, mais la plupart des maisons sont actuellement
construites au bord de la mer à cause de la bonne position du port. Progressivement une ville nouvelle et
splendide en sortira. Non seulement on y trouve les maisons importantes, mais aussi les boutiques et
marchés principaux, qui sont pourvus de tout.
Rentrant de là en ville, le long de la mer, on aperçoit de très nombreux piliers de marbre et des constructions
magnifiques qui s’élèvent dans la mer, au lieu où fut autrefois le palais de la reine Cléopâtre. J’ai
l’impression que ce sont quelques centaines de piliers qu’on voit debout ou couchés, aussi bien dans la mer
que par terre, soit dans la ville, soit en dehors.
On voit encore près de l’ancien palais d’Alexandrie deux obélisques ou pierres tombales, ayant la hauteur de
cent pieds et la largeur de huit pieds, d’une seule pierre thébaine, tacheté de diverses couleurs. Ils sont
carrés, et pointus au sommet. De nombreux lettres et signes sont gravés sur eux. Ils sont sans piédestal,
mais plus hauts que ceux de Rome. Quelques-uns disent qu’il y en a quatre, deux debout et deux gisant par
terre. Mais j’en ai remarqué deux seulement, l’un debout, l’autre par terre et cassé en deux. Je ne pense pas
qu’il y en ait plus. Car j’ai suffisamment interrogé les vieux habitants qui doivent le savoir. Cela concorde
avec une estampe gravée chez Valesius à Venise. On y voit encore un (obélisque) debout et intact, et un
autre par terre, cassé en deux. (Sur la gravure) il est ajouté que la hauteur de celui qui est debout, est de
cent seize paumes romaines, sur un piédestal de dix paumes, mesures faites le vingt-cinq juillet 1556 ; on a
le droit de supposer que celui qui a pris soin de les décrire si minutieusement, aurait mentionné les deux
autres, s’ils existaient. Le socle de dix pieds, qu’il décrit, n’est plus visible. Je crois qu’il est enfoncé, ou
recouvert de sable, puisqu’une pièce si mémorable n’est pas dressée sans piédestal. Sans aucun doute
plusieurs autres obélisques et d’innombrables colonnes sont encore sous la terre ou couverts de sable.
Cela, je l’ai appris de ceux qui ont vécu longtemps à Alexandrie et disent qu’on en trouve quotidiennement
encore.
En outre, nous avons vu deux autres colonnes encore debout, splendides et précieuses, chacune de
cinquante pieds.
En dehors de la ville ou dans le faubourg, on voit un endroit où saint Athanase se cacha pour échapper aux
persécutions des Ariens.
En dehors de la ville, près de l'ancien port, existe une montagne, élevée non par la nature, mais amoncelée
du fait des décombres de la ville. Sur cette montagne se trouve une tour qui sert pour voir arriver de loin les
bateaux. On arbore sur cette tour un drapeau par lequel on peut savoir en ville, quel bateau arrive. Si le
bateau est turc, on pavoise rouge ; si le bateau est français, moitié blanc, moitié bleu, etc.
À partir de cette montagne on voit parfaitement la position des murailles de l’ancienne ville, tout
l’aménagement de la nouvelle ville et les deux ports. On dit que les murailles autour de la ville entière
comprennent une lieue et demie.
Tous les bateaux qui sont chargés ou déchargés, restent dans le port entre le château et la ville. Ils peuvent
partir pour le vieux port après avoir été inspectés et avoir obtenu les permis nécessaires, s'ils veulent
poursuivre leur route dans la nuit. De là ils peuvent continuer leur chemin, au moment voulu ou si le vent est
favorable.
Quoique l’état de la ville ne soit plus comparable à son état ancien, il y a cependant un défilé ininterrompu
de bateaux pour le commerce, venant de plusieurs pays. Ces pays y ont leurs consuls pour gérer leurs
intérêts et aplanir les différends qui peuvent surgir entre les habitants et leurs propres ressortissants.
En ce qui concerne les produits et la fertilité de la terre autour d'Alexandrie, la ville est située dans un désert
sablonneux, inapte à être semé. Néanmoins on y remarque quelques petits jardins. À part les câpres,
poussant en abondance, il y a de nombreux tamaris, et une herbe appelée "anthillis", nommée par les
Arabes "kalli". Il y a trois sortes de ce kalli. Les deux premières existent en Europe, mais la troisième est
propre à l'Egypte, et elle a peu de feuilles. De ces trois sortes, séchées au soleil et brûlées ensuite, on fait
une cendre qui est exportée de là, à Venise, et elle sert à faire des verres transparents de Venise, du savon
fin et d'autres choses.
Pour le reste, je n’ai rien entendu de spécial dans cette ville ni vu autre chose, que ce que j’ai raconté
maintenant. Une conclusion évidente s’impose : c’est que cette ville royale, qui ne devait sa place à aucune
autre ville du monde, a bien perdu cependant, par les guerres et les révoltes internes, son ancienne
splendeur.
Après avoir passé à Alexandrie huit jours très agréables chez nos religieux, nous nous proposions de rentrer
au Caire par terre. »
- 471 - 477 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JACQUES-FLORENT GOUJON (1668)
Goujon, J.-F., Histoire et voyage de la Terre Sainte, Lyon, 1672.
Jacques-Florent Goujon (1621-1693), natif de Dijon, prend l'habit de Cordelier en 1636. En 1666, il se rend
en Terre sainte où il est nommé commandant du Saint-Sépulcre. Il n’en revient qu'en 1669. Par la suite, il
devient aumônier au régiment de Dragons.527
p. 321-322 :
« Visite d’Alexandrie
Ce n’a pas esté mon dessein de descrire toutes les villes & beaux bourgs qui sont en Egypte sur tout sur le
Nil depuis le grand Cayre à Alexandrie & à Damiette : il y en a une si grande quantité que l’on en void
presque de demie lieuë en demy lieuë, entourés de petits bois de palmier, qui font de si agreables
perspectives à l’abord de ce beau fleuve qu’il ne se peut rien voir de plus agreable, comme il n’y a rien de
particulier à remarquer, ie les passeray sous silence, pour aller à Alexandrie.
C’est l’une des premieres villes de l’Egypte, qui passoit mesme le Cayre, non en grandeur, mais pour la
magnificence des palais, le siege des Roys, sa force, & son eschole si florissante qu’elle ramassoit &
contenoit ce que l’Univers avoit d’hommes des plus Illustres. Elle fut bastie par Alexandre, lorsqu’il retourna
de prendre conseil de Iupiter Ammon, touchant ce qui luy devoit arriver, & ce fut l’an 329 auparavant la
venue Bien-heureuse de Iesus-Christ nôtre Sauveur. Il y mena quand & soy une colonie de Macedoniens
taschant de la rendre par là, la plus florissante en armes comme il la faisoit la Capitale de tout le Royaume. Il
y fut ensevely quoy qu’il mourut en Babylone d’Egypte nommée le vieux Cayre & de là transportée en cette
ville. Cesar voyant son sepulchre ne put s’empescher de regretter la mort d’un si grand Homme & de rendre
quelque honneur à ses cendres éteintes.
Il en reste encore assés pour iuger de son ancienne beauté & qu’elle estoit enceinte de doubles murailles,
dont il y en a encore quelque reste entre lesquelles le chemin est si beau & si parfaitement applany & large
que 4 chariôts y rouleroient de frond fort à l’aise ; toute bastie en voute dessus & à fleur de terre : il n’y a rien
de plus artistement travaillé. Ce que i’y ay admiré de plus merveilleux est la porte qui conduit à la mer du
côté de l’Occident qui est composée seulement de quatre pierres & qui a trente-cinq ou quarante pieds de
hauteur & 18 pour le moins large.
On y void de fort belles ruines comme le palais de Cleopatre, le château du Pere de sainte Catherine, &c.
Mais sur toutes les choses que l’on y void de plus remarquables, c’est la colonne de Pompée qui a de
hauteur 275 pieds ; de diametre 7 & 21 de circonference, la baze en carré de tout côté en a 16 & le
chapiteau à la corinthiene en a 14 toute d’une piece depuis la base iusqu’au dessus.
Elle est placée au Midy sur une petite monticule, qui regarde au couchant la Mediterranée, entre le levant &
le Midy un grand bras de mer appelé meotis ou Maria, droit à l’Oriant, une belle grande pleine & au
Septentrion le chemin de Rosette. Son port est fort fameux qui rend ordinairement au grand Seigneur par
iour, deux cents 66 escus, sans l’extraordinaire. Il est fait en demy cercle, dont l’un coûta 800 talens à
Ptolomée. Elle estoit autrefois une isle : mais Cleopatre la joignit à la ville par cette belle langue de terre de
875 pas.
Cette ville estoit anciennement la plus florissante escole de l’Univers : elle avoit aussi une bibliotheque
conforme à ces illustres personnages qui s’y assembloient, dont Aristote fut le premier employé à y
ramasser & ranger les livres de toutes sortes montrant aux Roys l’ordre qu’il y falloit observer. Dieu toutefois
permit qu’elle fût brûlée pour punir ces sçavants homme qui ne le reconnoissoient pas, comme ils le
connoiscoient : ce qui arriva un peu de temps auparavant la venuë de Iesus-Christ.
Messieurs les Chevaliers de S. Iean de Ierusalem y vinrent mettre le siege, la prirent, y demeurerent 2 ans &
enfin la mes-intelligeance les en chassa comme de saint Iean d’Acre, & de Damiette, &c. où saint Louys
perdit la pluspart de ses meilleurs soldats. »
527 Hoefer, J. C. F., Nouvelle biographie générale, t. XXI-XXII, Copenhague, 1966, p. 401.
- 478 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANZ FERDINAND VON TROILO (hiver 1668)
Troilo, F. F. von, Orientalische Reise-Beschreibung, wie dieselbe aus Teuschland, uber Venedig, durch das
Konigreich Cypren, nach dem gelobten Lande, insonderheit des Stadt Jerusalem, von dannen in Aegypten,
auf den Sinai, und vielen andern entlegenen Morgenlandischen Oerten mehr, etc., Dresde, Leipzig, 1733.
Franz Ferdinand von Troilon, dont les dates de naissance et de mort sont inconnues, naît dans une famille
noble du Tyrol. Il reçoit une éducation dans diverses écoles et Universités. Pendant quatorze ans, il voyage
en Allemagne et en Italie. Par la suite, il devient soldat dans l’armée espagnole avant d’entreprendre un
pèlerinage en Terre sainte au cours duquel il est fait chevalier de l’ordre de la tombe sainte. En 1673, il se
rend à Dresde pour proposer ses services à la cour. Il commence comme écuyer et porte-étendard de la
garde royale de l’infanterie, puis parvient au titre de lieutenant avant de devenir commandant du château-fort
de Stolpen.528
p. 793-815 :
« Le jour suivant, dès que les portes furent ouvertes, je n’hésitai pas longtemps à me mettre en route avec
mon Muccaro pour entrer dans la ville d’Alexandrie. Je logeai au fondique des commerçants de Messine et
de Venise où je fus recommandé.
La ville fut construite en 320 avant J. C. sur ordre d’Alexandre le Grand, qui donna son nom à la ville, par
l’ingénieux architecte Democratem. Je ne peux vanter la contrée pour sa fertilité car il n’y pousse pas de
plantes de jardin ou de champs à cause de la mauvaise terre ; on fait venir les céréales de plus de trois
milles. C’est la plus vieille ville marchande et commerçante de ce royaume ; en tant que ville marchande, elle
est bien située à savoir sur la Méditerranée et aussi sur « l’Ostio Nili Canopico ». Son pourtour est assez
grand, mais elle est plus longue que large. Elle a un mur d’une double épaisseur du côté terrestre et un
simple du côté de la mer. Autour du mur intérieur se trouvent 260 grandes et fortes tours carrées ainsi qu’un
fossé appareillé de taille petite qui n’est pas creusé à tous les endroits. L’enceinte a quatre portes : une au
levant qui va vers le Nil, une autre au midi vers le lac « Buchiar », la troisième au couchant vers le désert de
« Barca » et la quatrième se situe du côté de la Méditerranée où se trouve un beau port formant
naturellement un demi-cercle qui est plaisant à voir. Du côté de la ville, se situe la maison de la douane
donnée en bail par le Grand Turc aux juifs qui doivent lui verser 800 piastres par mois. Pour en tirer assez
de profit, je ne vous décrirai pas comment ces vauriens tracassent tous les chrétiens qui arrivent. Les
douaniers fouillent non seulement toutes les marchandises mais aussi les vêtements que l’on porte ; ils
taxent aussi bien les marchandises que la moindre monnaie qui est transportée.
De ce côté là de la muraille, il y a aussi deux autres portes entre lesquelles, à main droite, se trouve une
belle et plaisante promenade, et à main gauche, directement au bord du port “Masael”, s’élève sur un rocher
une forteresse solidement construite et bien protégée par un chemin de ronde et par une tour ronde au
milieu appelée “Burgi” dans laquelle une garde importante est toujours montée. (Cette forteresse aurait été
construite par Ptolémée et les Interprètes y auraient traduit la Bible). À l’intérieur, il y a quantité de gros
canons qui peuvent tirer dans le port tout entier. Les principaux bateaux d’Europe entrent dans ce port : des
Vénitiens, des Génois, des Messinois, des Napolitains, des Français, des Livournais et beaucoup d’autres.
Lorsque j’attendais l’embarquement, je comptais plus d’une vingtaine de bateaux qui y mouillaient. Ces
derniers étaient tous retenus pour porter secours aux Turcs à Candie ; 6000 hommes devaient être
transportés à Canæa, les bateaux furent obligés de les attendre. Moi-même fut contraint d’y rester pendant
trois mois ; durant cette période, j’eus très envie de revoir la chrétienté que je désirai tant. Dans ce port
mouillent aussi de nombreux bateaux turcs et grecs : de Constantinople, de Chypre, de Tripoli, de Beyrouth,
de Jaffa, de Saint-Jean-d’Acre, de Sidon. Ils commercent et font du négoce d’épices exquis, des aromates,
des médicaments, des pierres précieuses, de l’argent, de l’or et d’autres métaux ainsi que toutes sortes
d’articles en soie, en coton, en lin etc. Ils font également du négoce d’animaux amenés d’Arabie et de Libye
tels que des tigres, des lions, des chats du Tibet, des autruches etc. que l’on peut acheter à bon marché. Ce
port est le plus important port du Levant. D’autre part, il y a un second port, Marsa el-Silsilah, dans lequel
mouillent les bateaux de Barbarie, à savoir de Tunis, de Tripoli et d’Alger. Ces deux ports rapportent
annuellement une somme d’argent colossale aux Turcs et aux juifs.
Non loin du port, se trouve une très haute colline qui ressemble au “Mons Testatius” à Rome, le
“Scheiben-Berg”, sur laquelle s’élève une haute tour lisse en pierre. Un garde se trouve toujours sur cette
colline pour observer attentivement les bateaux qui arrivent ; il perçoit une rétribution pour chaque bateau
signalé à la douane. Afin que les habitants et tous les commerçants puissent prendre leurs dispositions, ils
doivent savoir quel bateau le gardien aperçoit de loin ; ce dernier le signale en plantant en haut sur la
plate-forme un drapeau ou un fanion de la même couleur que celle portée par le bateau selon la coutume de
son pays. Aussitôt beaucoup de monde accourt dans le port, surtout les gens de la même nation que la
banderole, pour attendre avec impatience l’arrivée du bateau.
A l’intérieur du mur d’enceinte, la ville est en grande partie détruite ; pas même le quart de la ville est
actuellement construit et habité. On aperçoit des bâtiments en ruines qui ressemblent à des tas de pierres.
Les Turcs, par grande paresse, ne restaurent pas, ni ne reconstruisent ces bâtiments qui sont pour la plupart
des maisons qui pourraient être refaites à peu de frais. Lorsqu’on se dirige de la mer vers l’intérieur de la
ville en passant par la Porte de la Mer, on arrive à une grande et haute maison qui mesure deux stades de
haut529 et qui porte une terrasse sur laquelle on peut se promener. Au milieu il y a une très vaste cour et de
nombreuses petites pièces en haut et en bas. Là, on doit décharger toutes les marchandises qui arrivent par
voie de terre et de mer. Cette inspection est à la charge des juifs qui contrôlent et estiment les marchandises
selon leur humeur et en prélèvent une taxe. À partir de cette maison, on continue et on arrive par une porte
spéciale dans une longue ruelle construite comme une propre ville ; cette dernière ne possède que trois
portes qui sont bien gardées et fermées chaque nuit. Il y a très peu d’habitations dans cette ruelle ; on y
trouve surtout des caves voûtées et des échoppes dans lesquelles les Chrétiens, les Juifs et les Turcs
proposent et vendent toutes sortes de marchandises. Les fondiques sont dans ces ruelles ; il s’agit des
maisons de commerce dans lesquelles habitent les Français, les Vénitiens, les Messinois, les Génois et
d’autres nations d’Europe. Les Turcs ne permettent pas aux Chrétiens étrangers d’être dispersés dans la
ville. Chaque nation possède un fondique, ou maison, où on reste ensemble. Chaque nation, comme il est
coutume dans les ports et les villes de commerce, a son propre consul appelé “Bailo” par les Mores ; la
nation subordonnée lui doit obéissance en cet endroit. Lorsqu’une personne arrive, il descend dans le
fondique de sa nation et verse au consul le prix d’une pension habituelle ; il sera bien reçu et bien traité en
dégustant des aliments et des boissons comme le délicieux muscat de malvoisie.
Ces fondiques ou maisons de commerce sont toutes carrées mais de taille inégale. Celui des Français est le
plus grand et possède une très belle vue au couchant en direction de la mer d’où l’on peut voir aussi bien les
bateaux qui mouillent dans le port que ceux qui arrivent au loin. Les autres fondiques comme celui des
Vénitiens (dans lequel je logeai), des Ragusains et des Génois sont un peu plus petits. À l’étage inférieur, se
trouvent des pièces dans lesquelles ils peuvent entreposer et garder leurs marchandises. Les fondiques sont
couverts d’une terrasse, comme toutes les autres maisons de la ville, sur laquelle on peut se promener et
avoir une vue dégagée sur la mer et sur toute la ville. Les fondiques n’ont qu’une seule porte, donnant sur la
ruelle mentionnée, par laquelle on entre et on sort. Un More est spécialement désigné et payé pour fermer
cette porte le soir et pour la réouvrir tôt le matin. Afin que personne ne soit laissé dehors, le More nous
avertit avec l’aide d’un grand fer qui ressemble à un marteau et qui est toujours suspendu, après quoi
chacun rentre. Ces fondiques ne se trouvent pas dans la vieille ville d’Alexandrie mais dans celle
nouvellement construite ; la vieille était tout près comme on peut s’en rendre compte aujourd’hui à cause du
terrain.
Dans une autre ruelle où les Mores vendent toutes sortes de fruits et d’aliments. Sur une placette, on me fit
visité une petite salle étroite et basse construite en pierre dans laquelle la vierge et martyre sainte Catherine
aurait été emprisonnée. À côté de cet endroit misérable, s’élèvent deux colonnes basses en pierre, près
desquelles se trouvait jadis en l’honneur de cette vierge, une petite église transformée maintenant en
mosquée turque. Vers la mer, on observe sous les bâtiments en ruines trois colonnes de porphyre assez
hautes et larges ; le porphyre est une pierre tachetée de rouge et de blanc, bien lisse et claire, comme du
marbre. En marchant dans une autre ruelle, on arrive à une grande église, bien construite, appelée Saint-
Marc, dans laquelle les moines coptes, qui sont adeptes de la religion grecque, montre une chaire blanche
en marbre sur laquelle saint Marc aurait prêché. Les Chrétiens étrangers d’Europe qui meurent là sont
enterrés dans cette église.
En continuant vers la mer, on trouve près de la muraille, sur une place, deux belles pyramides hautes et
imposantes dont l’une est détruite ; les morceaux gisent au sol. La seconde est encore entière et debout,
elle mesure 116 empans romains de long, 10 de large à la base. Les deux pyramides sont couvertes de
toutes sortes d’oiseaux, d’animaux et de caractères étranges en langue copte, selon la vieille tradition
égyptienne. Ces pierres sont également tachetées de rouge et blanc. Entre ces deux pyramides, on voit
encore quatre belles colonnes de la même pierre dont trois sont encore debout et la quatrième gît parterre.
Cet endroit aurait été le “Palatium” d’Alexandre le Grand. A l’extérieur de la ville, vers la mer, en arrivant du
Caire, on aperçoit un grand mur carré décoré de nombreux encadrements de fenêtres et de portes en beau
marbre blanc qui sont le témoignage d’un magnifique et précieux bâtiments anciens ; ce dernier aurait été le
palais du roi Ptolémée.
Non loin de là, hors les murs, dans la vieille ville, se trouvent l’église Sainte-Catherine et un monastère qui
appartiennent aux Grecs ; cet ensemble est habité par un patriarche et vingt-cinq moines. L’église fut
appelée jadis Saint-Saba, mais la vierge Catherine fut décapitée à cet endroit, elle reçut donc le nom de
cette martyre. On nous montre comme témoignage, un morceau ou une base de colonne au milieu de
laquelle se trouve un trou rond et profond où l’on voit quelques gouttes de sang ; là fut placée la roue qui
aurait dû la dépecer. Dieu, n’ayant pas permis cet acte, empêcha cette torture par le biais du tonnerre et en
exterminant de nombreuses personnes qui étaient rassemblées. Sainte Catherine aurait été condamnée et
décapitée par le tyran Maximo. Ce lieu est grandement vénéré par les Grecs ; non loin de là, les
commerçants vénitiens, avec l’accord des Turcs, construisirent une chapelle dans laquelle les pères
franciscains célèbrent la messe.
Il y a, dans la vieille ville entre de vieilles murailles en ruines, une autre église dédiée à l’Archange saint
Michel dans laquelle les Coptes rendent justice. On nous montre le panneau de la sainte vierge Marie que
saint Marc aurait peint. Ce dernier est très différent d’un autre panneau que je vis et que j’eus observé
attentivement à Rome sur le maître-autel d’Ara Coeli ainsi qu’à Venise à l’église Saint-Marc et également sur
l’île de Zante au Monte Biscopo.
Après avoir visité cette église, je me rendis aussi à l’église principale dédiée à saint Jean l’Evangéliste dans
laquelle le pieux Athanase, le fondateur, est enseveli. Actuellement cette église est transformée en mosquée
turque et il n’est permis à aucun chrétien d’y pénétrer. Concernant l’architecture ou exécution, cette église
est vraiment très belle, raffinée et magnifique à voir ; le milieu est ouvert et sans toit, et autour un
déambulatoire ou promenade est décoré de belles colonnes de marbre pas très élevées. La partie haute
comprend quatre travées, à savoir deux de chaque côté. La partie basse est constituée uniquement de
colonnes. À ciel ouvert, il y a des palmiers et citronniers et au milieu des petites salles décorées de grilles
dans lesquelles les Mores se lavent pour faire leur prière. Cette église principale est assez grande, elle
mesure 93 pas simples de longueur sur 86 de largeur. Les quatre angles sont décorés de belles tours
hautes et raffinées. Aux fenêtres sont posées des grilles en métal qui dit-on furent ramenées ici du Colosse
de Rhodes par les Sarrasins.
Le monument qui me plut le plus fut la colonne Pompée qui s’élève non loin de la ville à main gauche sur
une haute colline. Elle est faite d’un seul morceau de porphyre dont le soubassement ou piédestal sur lequel
elle repose mesure 16 aunes de haut ; ce dernier est de forme carrée et mesure 9 aunes de côté. La
colonne est également en porphyre tacheté de rouge et blanc. La partie ronde qui repose sur le piédestal
mesure 60 aunes de haut et 4 brasses de circonférence. Le chapiteau et son tailloir carré mesure 10 aunes
de haut. L’ensemble de la colonne mesure au total 86 aunes de haut. Jadis, au sommet, il y aurait eu une
statue, ou représentation de Pompée, très belle et raffinée, en métal que les Turcs auraient fait descendre
pour la fondre selon leur mauvaise coutume.
Les histoires varient sur l’identité de celui qui érigea cette colonne et également pour savoir en l’honneur de
quelle personne cette colonne tient lieu. Je suis de l’avis de Pietro Appiano et de Bartholomaeo Porta530 qui
affirment que ladite colonne est une oeuvre d’Alexandre sur ordre duquel le célèbre architecte Démocrate l’a
dressée. Sur le piédestal qui supporte le poids de cette colonne est gravée l’inscription suivante :
DEMOCRATES PERICLITUS ARCHITECTUS
ME EREXIT JUSSU ALEXANDRI MACEDONIUM REGIS.
Je ne conteste pas pour autant le fait que plus tard la colonne ait reçu des noms différents tel celui de
Pompée dont la tête fut ensevelie par l’empereur près d’ici etc.
À l’intérieur de la ville, il y a dans presque chaque maison une grande citerne construite avec de grosses
colonnes et des voûtes. Autrefois, l’eau du Nil arrivait en continu par des canaux ou conduits souterrains du
Caire. Maintenant en raison des conduits qui sont entièrement bouchés par le sable et la terre, l’eau n’y
arrive plus, sauf à l’époque où le Nil grossit et monte. Cet événement se produit seulement une fois par an
comme je l’ai déjà mentionné. L’eau est trouble et boueuse mais comme il n’y a pas d’autre eau à boire, elle
occasionne en temps d’été de nombreuses maladies parmi le peuple.
On voit dans la vieille ville beaucoup de ruines, comme les murailles et les maisons, qui ressemblent à des
tas de cailloux ou à des écueils. Sous ces ruines, les Bédouins ou paysans arabes, aussi bien que les Mores
et les Turcs, trouvent beaucoup de choses rares comme différentes monnaies en métal, or et argent, sur
lesquelles sont frappées des images des empereurs païens et de leurs insignes. On y trouve des pierres
précieuses et rares sur lesquelles sont incisées de couleurs différentes toutes sortes de silhouettes et des
caractères. À mon opinion, les païens les utilisèrent comme cachets et sceaux ; ces pierres ont la même
forme qu’un sceau. J’en vis beaucoup et j’en ramenai quelques-unes ; on peut les acheter à Alexandrie
auprès des Bédouins pour quelques groschens.
Au cours de l’été, l’air est très nuisible et même malsain surtout pour les étrangers. Ceci dure jusqu’en
automne quand il commence à pleuvoir. Beaucoup de gens, comme des Turcs distingués, des Mores et des
commerçants quittent la ville pendant cette période pour habiter au port. Tout le monde a l’air malade, leurs
visages ont une véritable couleur de cadavre à cause de l’air qui est très malsain. On ferme les volets et on
veille à ce que l’air nuisible ne rentre pas dans les pièces et provoque des maladies, en particulier la nuit,
comme à Rome à cause du Tibre. J’en eus l’expérience en ayant de fortes lourdeurs au ventre et en
souffrant d’une forte fièvre suivie d’une longue période où j’eus toujours mal à la tête. On pense que cela
vient des citernes souterraines qui s’assèchent en été et dans lesquelles beaucoup de vermines, en
périssant, provoquent une puanteur épouvantable et infectent l’air. Ces citernes auraient en premier lieu été
de beaux palais souterrains, comme on peut encore en voir aujourd’hui, dans lesquels les gens y
séjournaient pendant l’été à cause de la forte chaleur. La plupart de ces citernes qui tombaient en ruines peu
à peu furent restaurées et réparées. Comme je l’ai déjà mentionné, à l’intérieur, l’eau du Nil arrive du Caire
lorsqu’elle monte ; on s’en sert pour la cuisine et pour boire. Comme l’eau est très trouble et épaisse, on la
verse d’abord dans de grands et hauts récipients et dans des jarres en terre où elle se purifie ; elle devient
ensuite claire et pure à boire, mais elle reste malgré tout très fade et sans goût.
Étonnement, je demandai à plusieurs personnes pourquoi on ne récoltait pas dans les citernes, comme
ailleurs, l’eau de pluie des terrasses, afin de les utiliser pour la nourriture et la boisson ; l’eau serait
beaucoup plus fraîche et plus claire. On me répondit que cette eau fut déjà essayée de nombreuses fois,
mais elle ne se garde pas et devient plus pourrie, plus épaisse et boueuse que l’eau du Nil. À propos de la
pluie, j’ai souvent entendu dire avant de venir en Egypte, qu’il ne pleuvait pas du tout dans ce pays.
Toutefois, j’ai pu voir de mes propres yeux, même s’il ne pleut pas ailleurs en Egypte, qu’il pleut à Alexandrie
durant deux à trois mois, généralement en automne et en hiver ; époque durant laquelle j’étais à Alexandrie
et où je constatai que les choses sont différentes de celles que l’on me raconta.
Lorsque je fus à Alexandrie, des agissements étranges eurent lieu. De nombreux chrétiens de différentes
nations qui habitent cette ville sont tracassés par les Turcs qu’ils font vivre grâce à leur commerce florissant
qui en quelque sorte leur donne le pain que ces derniers mangent. Les Turcs cherchent par n’importe quel
moyen de les prendre à défaut pour les déposséder d’une grande somme d’argent ou pour porter malheur
d’une façon quelconque. Cela m’arriva à moi-même et à un commerçant messinois de Sicile chez lequel je
logeai dans le fondique des Vénitiens. Ce dernier prit un jour son fusil et me demanda de l’accompagner à
l’extérieur, dans la vieille ville ruinée. Je l’accompagnai avec grand plaisir. Nous marchâmes un bon bout de
chemin entre les maisons en ruines et détruites, et les tas de cailloux là où les tourterelles ont l’habitude de
se tenir en grande quantité. Généralement chacun est libre de tirer sur ces dernières ; nous en rencontrâmes
quelques-unes sur lesquelles le commerçant fit feu et en tua deux. L’une mourut sur place et l’autre qui fut
touchée à l’aile commença à s’enfuir. Mon compagnon lui courut après et la poursuivie assez longtemps
entre les vieux murs et les endroits déserts. Par chance, je restai au même endroit. Tandis qu’il courait après
les pigeons, des femmes bédouines étaient assises derrière un monticule de pierres recouvert d’herbe. Ces
femmes étaient toutes nues et découvertes, soit pour réparer leurs chemises soit pour se laver ; en voyant
surgir le commerçant d’une manière si imprévue, elles eurent peur et commencèrent à crier à tue tête. Elles
ne prirent pas le temps de se revêtir mais saisirent leur chemise par la main et s’enfuirent nues. Le
commerçant, plus effrayé que les femmes elles-mêmes, oublia à l’instant son pigeon et revint en courant
vers moi en me racontant en tremblant ce qui lui arriva de si inattendu. Nous nous dépêchâmes de rentrer
au plus vite à la maison car nous pressentîmes un malheur auquel nous ne pûmes échapper malgré tout ; le
passage fut barré de tous côtés.
Entre-temps, non loin de là, des Turcs rencontrèrent ces femmes courant nues et demandèrent ce qui leur
arriva pour courir ainsi ; elles racontèrent ce qui se passa, le visage voilé et le corps nu. Ils nous cherchèrent
mais ne purent nous trouver à cause de l’étendu de ces endroits déserts. Ces oiseaux furent si rusés qu’ils
nous attendirent à la porte de la nouvelle ville pour ne pas leur échapper ; ainsi ils étaient sûrs de nous avoir.
Lorsque nous arrivâmes, ils se ruèrent sur nous mais surtout sur le commerçant qui tenait le fusil à la main.
Ils lui arrachèrent de force et lui demandèrent lequel d’entre nous avait tiré le pigeon. Le commerçant, qui
habitait ici depuis 12 ans comme “Factor” des commerçants messinois et qui parlait bien la langue, répondit
que c’était lui et demanda quelle en était l’importance puisqu’on versait la taxe annuelle au pacha et que
tous les chrétiens ont l‘accord de ce dernier pour tirer sur ce qu’on voulait. Ils ne répondirent rien, mais nous
conduisirent tous deux dans la ville, non loin du château, où ils nous jetèrent dans un trou sombre et puant.
Le jour suivant nous fûmes convoqués devant le cadi auprès duquel nous fûmes accusés d’avoir couru
après les femmes bédouines pour en abuser. Il s’agit d’une affaire importante pour eux ; le cadi s’emporta
terriblement. Ce dernier ainsi que ceux qui nous accusèrent étaient très avides d’argent ; tout fut uniquement
dirigé en vue d’une avanie ou amende. Le cadi nous menaça d’abord par le feu et le sabre et de la façon
dont il allait nous traiter. Dès que les chrétiens des autres nations apprirent notre situation, ils arrivèrent et
demandèrent que l’on nous pardonne car ce n’était pas notre intention et que nous ne savions pas que ces
femmes étaient assises là. Mais ni les prières et ni les supplications ne nous aidèrent ; la sentence fut
prononcée et chacun de nous fut condamné à douze jours de prison. De plus, celui qui avait tiré et couru
vers les femmes devait verser 2000 piastres d’amende ; nous ne pouvions sortir de prison tant que cette
somme ne fût verser. Nous restâmes donc dans ce trou puant, tandis que les autres commerçants, par le
biais de bons amis, réussirent à contenter le cadi de 100 piastres, somme qui fut versée le jour de notre
libération par le commerçant messinois. Cet événement fut pour nous tous un avertissement profitable pour
le futur et j’appris en particulier à bien faire attention lors de mes promenades. Peu avant mon départ, deux
commerçants français allèrent à l’extérieur de la ville pour visiter la colonne Pompée. En passant devant une
mauvaise maison, un Turc, assis en train de fumer du tabac, appela l’un des deux commerçants qu’il
connaissait et l’invita avec son compagnon à fumer une pipe de tabac dans sa maison. Les deux
commerçants entrèrent puis le Turc leur offrit une pipe de tabac ainsi qu’un verre de café ; ce dernier les pria
de ne pas s’impatienter et qu’il reviendrait bientôt avec des fruits frais pour leur en faire cadeau. Mais ce fut
des fruits de très mauvais goût, comme ce qu’il nous arriva avec les deux tourterelles. La maison dans
laquelle le Turc les pria d’entrer se trouvait une personne douteuse. (Aucun chrétien ne peut s’aventurer à
visiter une maison où se trouve une personne douteuse sans prendre le risque soit de perdre la vie, soit la
religion, ou bien, d’être taxé d’une forte avanie ou amende). Ledit Turc, sous l’apparence de son invitation
polie, voulut soutirer de ces deux hommes de l’argent comme il en advint.
Le Turc courut auprès du cadi en dénonçant que deux chrétiens étaient dans une maison où se trouvait une
femme douteuse dans laquelle ils s’amusaient et étaient de bonne humeur. Le cadi peut envoyer quelqu’un
pour le constater. Le cadi dépêcha aussitôt quatre de ces janissaires ; on amena les deux commerçants et
on les mit en prison. Ces derniers en perdirent la parole, ne surent ce que cela signifiait et pour quelle raison
on les fit venir et arrêter. Le Turc, une personne hypocrite, vint les voir en prison en se lamentant sur leur
malheur et en faisant semblant de ne pas être au courant de toute l’affaire. Les deux commerçants durent
rester vingt jours entiers attachés aux chaînes en fer jusqu’à ce qu’ils versent 1500 piastres d’amende.
Chacun doit se méfier de ces lieux et ne pas tomber dans les griffes de ces oiseaux avides d’argent qu’ils
guettent et cherchent jour et nuit.
Lorsque les corsaires ou pirates de Tripoli, en Barbarie, d’Alger et de Tunis mouillent dans le port pour leurs
négociations à Alexandrie (cela arriva lors de mon séjour), aucune personne que ce soit un chrétien, un juif,
un Turque, un Arabe, un Bédouin, ni autre, ne doit se faire voir ou être aperçus dans les ruelles car il les
ruent de coups. Si quelqu’un se trouve sur la terrasse de sa maison, ils lui tirent au moins quatre à cinq
coups de feu dessus. Ce sont pour la plupart des renégats ou des chrétiens de différentes nations du monde
qui ont abjuré leur foi et vivent en toute liberté comme des animaux ne s’occupant ni de Dieu ni du diable ;
c’est pourquoi ils commettent de telles insolences sur le territoire du Grand Turc. Partout où ils arrivent, ils
ne rendent pas service aux Turcs. Ils volent, pillent, maltraitent comme il arriva à ce moment-là. Ils étaient
arrivés au port au moment où le secours turc était à Candie avec les bateaux des chrétiens. Le vice-roi
d’Egypte leur ordonna de rentrer avec ces derniers afin de l’accompagner pour plus de sécurité ; l’Armada
vénitienne avait pris la mer en même temps pour empêcher le secours.
Quand tous les soldats furent à bord et que tout fut prêt et disposé pour le départ, on tira du château un
premier coup de canon afin d’avertir ceux qui étaient encore à terre de se rendre aussitôt sur le bateau. On
tira un second coup de canon pour hisser les voiles. Finalement, un troisième coup suivit pour tendre les
voiles et partir. Quelques 20 grands « Orloch » et « Vaschallen » appartenant aux commerçants chrétiens
venus d’Europe pour commercer, et qui furent retenus comme je l’ai déjà dit, sortirent bientôt du port. Les
Turcs tirèrent des salves de mousquets et ils prirent la haute mer. Lesdits corsaires auraient dû les suivre
mais n’eurent pas envie de s’embarquer ; ils se conduisirent très mal et firent de telles bêtises que presque
aucun Turc ne put aller en sécurité dans la rue sans se faire fouiller et se faire prendre ce qu’il a sur lui. Le
pacha fit donner de nouveau un avertissement par un coup de canon afin qu’ils suivent les autres bateaux,
mais ce fut en vain. Il fit contacter le capitaine de leurs bateaux (il y avait bien cinq bateaux et plus de 1800
hommes d’équipage) et se plaignit de ses hommes, mais cela n’aida pas.
Enfin le pacha prit une résolution ; il monta à cheval, fit donner l’alarme et les livra aux paysans bédouins,
qui sont les Arabes, pour qu’ils leur tapent dessus, tout en commandant de tirer à partir du château pour les
faire sombrer s’ils ne voulaient pas sortir du port. Il fallait voir le tumulte et le vacarme dans la ville, en
particulier venant du port, lorsque les paysans arabes se ruèrent sur les corsaires avec leurs gros gourdins
et leurs lances ; ces derniers les chassèrent de force jusque dans l’eau et sur leurs bateaux. Les corsaires
nagèrent les uns sur les autres et l’on vit beaucoup de coiffes rouges maintenues par des étoffes blanches
qu’ils avaient soit sur leur tête soit flottant à côté d’eux, soit ils devaient les abandonner comme butin aux
Arabes. Celui qui pouvait bien nager et arriver rapidement sur le bateau était sauvé. Ceux que les Bédouins,
ou paysans arabes, ne pouvaient plus atteindre avec leurs gourdins ou leurs bâtons, étaient accompagnés
de cailloux jusqu’au bateau. À cette occasion, plus de quinze personnes furent tuées et davantage y seraient
restées si finalement le pacha ne les avait pas protégées de la grande furie des paysans bédouins et des
Mores et n’avait pas sérieusement interdit d’en tuer. Cela aurait entraîné une grande effusion de sang, et le
pacha aurait eu une lourde responsabilité vis-à-vis de la Porte si lesdits corsaires avaient eu sur eux leurs
armes à feu, leurs sabres, leurs pistolets et d’autres fusils qu’ils avaient laissés par malheur sur leur bateau.
Quelques temps après, nous apprîmes que les corsaires étaient tombés entre les mains des Vénitiens qui
leur avaient fait sombrer deux bateaux à coups de canon et en avaient capturé un ; le reste n’avait
probablement pas échappé.
Après que cette racaille fut partie nous recommençâmes à sortir et nous nous rassemblâmes comme avant
au bord de la mer autour de la maison de la Douane. Là nous nous retrouvâmes entre nous très
amicalement, l’un racontant ceci, un autre cela, ce qui lui était arrivé entre-temps, ce que les mauvais gens
lui avaient joué et fait. En somme la ville devint à nouveau très paisible si bien que chacun put faire son
commerce et son négoce librement et en sécurité. Je dois passer outre ce qui arriva encore lors de mon
séjour à Alexandrie. Il me tarde d’arriver dans la chrétienté et au terme de mon voyage. »531
- 479 - 484 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ARND GEBHARDT VON STAMMER (1670)
Stammer, A. G. von, Morgenlandische Reisebeschreibung nach Constantinopel, Egypten und Jerusalem,
Gera, 1670.
p. 79-82 :
« La ville d’Alexandrie est au bord de la mer et son rivage est très beau. Beaucoup de bateaux y arrivent de
la chrétienté ; aussi bien les amis que les ennemis peuvent y commercer. Le port est gardé par deux
châteaux forts par où entrent les bateaux. L’un est construit sur l’île de Pharos. Cette ville fut construite par
Alexandre le Grand. Autrefois elle fut grande et puissante, mais aujourd’hui, elle est beaucoup plus petite et
a peu d’habitant à cause de son air malsain. En outre, beaucoup de maisons s’écroulent chaque jour si bien
que de nombreux endroits sont déserts et inhabités.
Elle est en grande partie construite sur des citernes souterraines, il en existe encore plusieurs centaines,
mais elles étaient bien plus nombreuses auparavant. Quand le Nil déborde, les citernes se remplissent de
son eau qui doit suffire aux habitants pendant toute l’année car il n’y a pas d’autre eau.
Les maisons sont toutes de pierre blanche ; on les voit briller de loin. La ville est entourée de deux murailles
assez belles. Vers la mer, près des murailles se trouvent deux aiguilles, ou colonnes de pierre rouge,
recouvertes de hiéroglyphes. Elles sont assez grandes, l’une est debout tandis que l’autre est couchée par
terre. À l’extérieur de la ville, on peut voir la colonne Pompée qui est très grande et très belle ; elle est
entourée de cassiers, de figuiers d’Aaron et d’autres arbres fruitiers.
À Alexandrie, il y a un consul vénitien et un consul français qui résident dans un fondique où peuvent loger
tous les étrangers. Toutes les marchandises venant de la mer Rouge et du Caire, à destination de la
chrétienté, arrivent ici car l’Égypte n’a pas d’autre port praticable.
Nous logeâmes chez le consul français car nous lui étions recommandés par l’ambassadeur de
Constantinople. Mais ce consul était un rustre arrogant et grossier qui ne nous témoigna pas la moindre
courtoisie ni amitié. Nous restâmes ici trois jours et nous poursuivîmes notre voyage. »532
532 Traduction : G. Hurseaux (archives Sauneron, Ifao).
- 485 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVANNI ANTONIO SODERINI (du 8 au 28 mars 1672)
Soderini, G. A., Viaggi in Cipro, Egitto, Hyerusalem etc. del N. H. Gio. Ant. Soderini scritti da fermo Carrara
suo cameriere, raccolti e preservati dal N. H. Ruggier Soderini suo figlio, Venise, Museo Civico, Codex
Cicogna 1245.
Le Vénitien Giovanni Antonio Soderini (1640-1691) est un collectionneur de médailles rares. Il séjourne une
longue période à Chypre.533
Non paginé.
« Lontano da Alless(andri)a 3 miglia in c(irc)a a sopra la collina à man destra viddi certe ale altis(si)me
antichis(si)me ruinate in diverse parte che denota(va) no fosse qualche gran castello. Facessimo un poco di
salita in mezzo di queste colline, et nel discendere scoprissimo Allessandria lontana 1 m(iglio) vi entrassimo,
che dovevano essere 22 hore et andassimo ad alloggiare nel fontaco de Veneti. Allessandria e citta d’Egitto
sopra il lido sul mare chiamato Egotiaco, una volta tanto famosa per grandezza, et habitatione de popoli, che
come dice Herodiano à Roma sola cedea, gloriosa per il fondatore monarcha, che fra le citta del mondo non
sorti cosi nobili natali si per belleza come per antichita fatta 320 anni inanzi la venuta di K(ris)to, Regina si
puo dire d’Africa terrore sotto mare Antonio e Cleopatra d’Europa, che fu sufficiente, se non à far cader à
traballare almeno il vasto impero di Roma. Hora à chi la vede riccordandosi dele gloriose prerogative, come
havesse veduto il teschio di medusa resta incensato, e intastito ; qui altro non si scorge, che una gran selva
di collonne ruina(ta) scomposte montagne de marmi, Palazzi abbattuti. Torri dirroccate, et a luochi tanto solo
di mure, che basta à far sapere, che è l’infelice avanzo d’un superbis(si)mo tempio la citta è ruinatis(si)ma, et
quella poca habitatione che vi resta è tutta redotta alla marina fuori dalle mura per la comodita del porto e
della dogana, perche li habitanti della citta sono pochi e credo che non vi si annoverano 8milia anime, e tutti
sostentandosi con le mercantie, fà di bisogno stijno vicini al mar.
Le mure di Allessandria sono tutte fabricate de pietre di marmo, e sono doppie, e con 24 grand(issi)mi
castelli, senza moltis(si)me torre, et dentro vi sono archi attacati alla med(esim)a mura che formano un largo
ponte sopra del quale attorno si caminava e ben si crede che furono fatte senza risparmio, si mantengono
ancora in piedi belle e sane in molti louchi, in molti altri pero sono dirroccate ; ha 4 porte una delle quali
varda il porto Vecchio, comeche non sij uso è murata, l’altra è quella che và alla marina, la terza che porta
alla collonna di Pompeo, la 4a e quella la quale va verso Rossetto ; è cosa maravigliosa il mirar quelle
antichis(si)me porte, che erano tutte coperte di Lamine di ferro, con grossi chiodi conficcatte, hora veder il
ferro tutto corroso, et il legno bello, e intatto dopo il corso di tanti secoli ; il legno al mio credere è cedro del
Libano. Questa si famosa citta e tutta fabricata sopra altis(si)me colonne et archi di marmo superbis(si)mi,
tutta concamerata, di modo tale, che per alti condotti sottera(neamen)te visi puo in ogni parte caminare, et
hora non vi hà dubio, che è di gran lunga piu mirabile e piu bella di sotto, che di sopra ; perche di sopra altro
non è che un cumulo di pietre, di mura mezze abbattute, ruinata ; fu fabricata in questa forma All(essandri)a,
perche ritrovandosi ivi una pianura, in cui non vi si trova aqua, conforme è tutto l’Egitto, non haverebbero
potuto mantenersi gli habitanti che pero All(essandr)o havendo questo riguardo la fece tutta concamerare,
accio che potesse ricevere l’aqua del Nilo alla sua crescente, et ivi imprigionandole, servirsene al bisogno, et
cosi fanno anco gli habitanti, perche non vi è casa nella citta vecchia, in cui non vi sij la sua cisterna, quali si
empiscono sotteranea(men)te, quando il nilo è cresciuto che all’hora capite in un rampo assai bene in
All(essandri)a, in resto passato mezzo il mese d’ottobre il ramo resta assiutto ; onde, se non s’havesse
raccolto aqua All(essandri)a farebbe mestieri restare senza aqua, tutte le cisterne hanno comunicatione
sotteranea l’une con l’altra, et per le strade della citta ogni venti passi se ne trova una, et à luoghi due, che
servono per il comodo d’ogni uno.
Dalle parte della marina à destra del porto novo si vede ancora torreggiare una parte del palazzo di
Cleopatra, che pero ridotto al ultimo và di momento dirroccando. Nelle fonda(men)te di esso hà strade, che
portano con ciechi condotti fuori della citta alla marina, hà una montagna altissima di collonne, altre
spezzatte altre cadute, e mezze sepolte. Si tiene per infallibile, che quivi fosse la Regia ; di piu si vede un
misero avanso di un teatro, che dove una volta stringeva nel suo cerchio un mondo d’homini a veder
spettaccoli di meraviglie, ora che è ruinoso non vi si passa che con timore, et il med(esim)o è fatto spettacolo
di compassione, mi rampai sopra uno di questi muri ruinati et veddi il mare, che batte vicino ; vi è una
quantita infinita de marmi bellis(si)mi e finis(si)mi poco lontano da queste ruine si vedono doi Agulie tutte
ripiene di geroglifici, una di esse è in piedi, l’altra resta mezza pepolta. Poco discosto dal Palazzo di
Cleopatra si vedono le fond(amen)te d’una bellis(si)ma machina che dicono quivi fosse la casa del
glorios(issi)mo Santa Cattarina, nel tempo fu fatta morire. Poco piu avanti si vede la Chiesa dedicata alla
d(et)ta Santa, officiata da Greci, et li Consoli Veneti tengono quivi una capella, nella quale si và à celebrare
ogni lunedi. Nella detta chiesa si vedono diverse sepolture de christiani, fra le altre notai questa di un
Venetiano che veniva in Alless(andri)a con una nave d’oglio, et si ruppe in un scoglio quivi vicino dette del
pevere et resto annegato. Gli fu fatta una sepoltura ordinaria sopra la pietra di marmo con questa inscrittione
Hic iacet Marcus Venetus ab oleo
qui navim rupit in pipere
et vitam perdit in sale
AN. NAT. Christi. 1530.15 mensis. Martis.
Quivi vedessimo con grandis(si)ma divotione la pietra sopra la quale fu tagliata la testa à S(an)ta Cattarina ;
questa pietra è di altezza di un brazzo di marmo bianco, nella parte di sopra nel mezzo si vede è
rosseggiare il sangue in un foro, dinanzi tiene effiggiata una croce, e posta nel muro e da quei calogeri e con
riverente devotione custodita. Usiti dal tempio di questa santa per la strada che porta al fondaco de
Venetiani si osserva un tempio, che era di S. Attanasio, hora e convertito in moscheta, pero piu à basso si
vede il tempio dove stava S. Marco che fu Patriarca d’Alle(ssandri)a et il primo che quivi predicasse
l’Evangelio, il pergamo sop(r)a il quale predicava l’evangelio. Poco fuori della porta dette della collonna si
vede la colonna detta di Pompeo, quale è di maravigliosa altezza et grossessa dell’istesso marmo, che e
l’Agulia et simil marmo se ne ritrova per tutta Alles(sandri)a questa collonna e fondata sop(r)a una grossa
base quadra la sua altez(za) la base, mà col capitello è cubiti 66, la grossezza have d’ambito cubiti 24, le
facciate del pedestalo sono 24 per facciata. Molti dicono che cosi questa collonna come l’agulia sij d’una
certa pasta, mà ne habbiamo fatto esperienza col metterne un pezzo in una fornace, se fosse statta di pasta
si sarebbe fonduta, mà si calcino percio concludessimo sij di marmo. Poco discosto vi è un tempio de Gentili,
che fu convertito in moschea hora e tutto ruinato. Perche si chiami colonna di Pompeo, molti judicano sij
statta eretta da Cesase (sic) per honorar la virtu di tal Cap.o, havendo anco fatto rizzare le statue del
med(esim)o Pompeo in Roma.
Stando in mare la citta pare un Anfiteatro hà sopra doi colli due castelli fabrica di antico moderno piu di
belezza, che di fortezza. Dentro la citta vi sono tre monti, il p(rim)o verso il mare, vi è sop(r)a la guardia del
mare con una torreta, li altri doi sono dentro della citta sop(r)a di questi si vedono diverse ruine, anzi mi fu
detto, che sij statti di ruine.
In Allessandria oltre m/8 turchi in c(irc)a vi saranno qui di 400 hebrei. Vi saranno m/600 tra Gianizzeri e
Asapi di Guardia.
Il Castello è fuori della citta nova, che batte il porto novo, et il mare, è fatto di fabrica nova, vi sono dentro
canoni, mà per quello ho veduto al di fuori e poco forte, et dall’informatione prese, poco ben munito, siche
serve solo per metter timore.
In quanto à Comand(an)ti sono li med(esi)mi che in Damiata, et Rossetto. Li Franchi sono sarrati ne suoi
fontaghi à hora 23.
Alla Dogana sono rigorosis(i)mi, quelli che vi attendono sono la maggior parte hebrei, che sono
perfidis(si)mi. Guardano adosso minutamente niuno si puo imbarcare ne partite fuori della Citta senza
licensa dell’Aga. Doppo essere statti 20 giorni in Allessandria adi 28 doppo pranzo si partissimo verso
Rossetto per ritornar in Cairo, pigassimo la compagnia di 1 Gianizzero, oltre il nostro dragomano Turcho, et
un Arabo, che veniva à custodire le mule, havava di piu l’Ill.mo condotto seco da Allessandria Gio(vanni)
Batt(ist)a Armeno Band da Ven(eti)a con pensiero di tenerselo per suo dragomano, e licentiare quello
havevamo, come subito in Cairo poi fece, perche oltre l’altre impertinenze era ladro perfetto. »
533 Donazzolo, P., I viaggiatori veneti minori : studio bio-bibliografico, Rome, 1927, p. 107.
- 486 - 487 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN MICHAEL VANSLEB (du 15 au 29 juin 1672)
Vansleb, J. M., Nouvelle relation, en forme de Journal, d'un voyage fait en Egypte par le P. Vansleb en 1672
et 1673, Paris, 1677.
Né en 1635 en Thuringe (centre de l’Allemagne), Johann Michael Vansleb est le fils d’un pasteur luthérien
d’Erfurt et l’élève de l’orientaliste Job Ludolph. Ce dernier persuade le duc Ernest de Saxe-Gotha d’envoyer
Michael Vansleb en Éthiopie pour une mission à la fois politique et religieuse. Michael Vansleb part en 1663,
visite l’Égypte et revint en 1665. Mais au lieu de rentrer en Saxe, il se rend à Rome où il prend l’habit de
dominicain en 1666. Par la suite, il suit l’évêque Bosquet de Montpellier qui l’amène à Paris en 1670 et le
présente au ministre Colbert. Ce dernier le charge d’une mission en Éthiopie. À son retour en France en
1676, Michael Vansleb est disgracié. Il meurt près de Fontainebleau en 1679.522
p. 177-213 :
« Le 14 de juin je partis sur le tard de Rosette, pour aller à Alexandrie. J'estois avec un More, que m'avoit
donné pour guide le Vice-Consul François de cette ville ; nous étions tous deux montés sur des mules, dont je payé dix-sept Meidins pour tout le voyage.
Nous arrivâmes à minuit au trajet, que les Mores appellent Maadie et après nous estre un peu reposez dans
le Han, ou logis qui y est, nous continuâmes nostre route à la clarté de la lune, vers Alexandrie, où nous
arrivâmes le lendemain, entre huit & neuf heures du matin.
Il y a de Rosette à Alexandrie, tout au moins dix heures de chemin, pour un homme de cheval. On en fait
une bonne partie le long du rivage de la mer ; de sorte que les montures ont pendant un long trait de
chemin, les pieds dans l’eau.
Le pays est si uny, qu’il n’y a aucune (p. 178) incommodité pour les voyageurs ; & à la reserve du Han, qui
est à la moitié du chemin, on ne trouve point de village, pas un arbre, pas une herbe ; & ce n’est qu’une
campagne vaste, sterile, & sablonneuse.
Les Francs qui font ce voyage, sont obligés de donner à l'entrée de la porte d'Alexandrie, qu'on nomme la
porte de Rosette, trois paras ; moitié aux Beduins, ou Boëmiens, & moitié aux Janissaires, parce qu'ils y font
la garde.
Si-tost que je fus arrivé à Alexandrie, qui fut le quinzième de ce mois, j’allay salüer Monsieur Laurens, Vice-
Consul François de cette ville, & il me fit toutes les honnestetés que je pouvois esperer d’un homme aussi
genereux, & aussi honneste que luy. Il m’offrit avec beaucoup de civilité, sa table, & une chambre dans son
appartement : mais comme Monsieur Brousson, Facteur de Messieurs de la Compagnie du Levant, m’avoit
tres-particulierement recommandé à Monsieur Sabatery, son bon amy, & Facteur aussi ; & qu’il avoit un
appartement fort commode, qu’il m’offrit ; (p. 179) pour les contenter tous deux, je logeay chez Monsieur
Sabatery, & je mangeay pendant le temps que je fus à Alexandrie, à la table du Vice-Consul.
De là je fus voir un de mes bons amis, avec qui j’avois contracté une amitié toute particulière dès mon
premier voyage en Egypte. Il s’appelloit Komos Jean ; il estoit Archiprestre de l’Eglise de S. Marc des
Coptes ; c’est un habile & fort honneste homme, & qui m’a donné beaucoup de lumieres touchant les
affaires d’Egypte.
J’ay appris des Marchands François de cette ville, que leur Fondego a esté bâti par ordre des Grands
Seigneurs de Constantinople, pour leur servir de logement ; & que depuis leur établissement, les Empereurs
Turcs avoient payé aux Consuls François, tous les ans deux cens écus, pour l’entretien de cette Maison ;
mais que depuis quelque temps, ils ne les reçoivent plus ; dont on n’en sçait pas bien la veritable raison.
Le 16 de ce mois, j'allay chez un Hebreu, à dessein de marchander une pierre Hieroglyphique, fort curieuse,
qui (p. 180) sert de seüil à la porte de sa maison.
Elle est de marbre noir, longue environ d'une aulne & demie, & large d'un pied de Roy ; sur laquelle il y a
trois lignes de lettres Hieroglyphiques en fort petits caractères gravées dessus ; lesquelles on lit de la
gauche à la droite.
Cette pierre avoit déjà esté marchandée, il y avoit quelque temps, par Monsieur Thévenot ; lequel, à ce
qu'on me disoit, avoit offert trente piastres à cét Hebreu ; mais que celuy-cy en avoit demandé cent.
Tous les Levantins generalement ont cette folle coûtume, de faire les rencheris, quand ils voyent qu’un
Franc a envie de quelque chose ; & ne fust-ce qu’une bagatelle, ce leur est une raison pour croire qu’elle est
inestimable. Ils la mettent alors à un prix si haut, qu’ils rebuttent ceux qui la veulent acheter. Ils sont mesme
assez fols pour aimer mieux que la marchandise leur reste & se gaste, que de la vendre à un Franc pour le
mesme prix qu’ils la donneroient à un Levantin.
Cependant, comme je croyais que (p. 181) l’Hebreu pourroit avoir changé de sentiment depuis ce temps-là ,
je luy fis offrir le mesme prix que cét autre Franc luy avoit offert ; mais voyant que cette offre le rendoit
encore plus glorieux, & qu’il se tenoit ferme dans sa premiere pretention, je ne le pressay pas davantage.
Le Conclave des LXX Interpretes, qui firent la version Grecque de la Bible Hebraïque, est encore sur pied
en cette ville, & presque en son entier, avec les cellules qui servoient de cabinet à ces Sçavans Traducteurs.
Les Turcs en ont fait une Mosquée, à qui ils ont donné le nom de Giama il garbié ou la Mosquée du Ponant.
On la peut voir moyennant de l'argent : En effet Monsieur Bruë, premier Truchement du Consul François du
Caire y est entré.
Le dix-neufième de Juin un samedy, j’allois voir les Salines du Grand Seigneur, qui sont hors de la ville,
proche du Calitz, ou Canal de Cleopatre, qui la pourvoit d’eau douce, lors que le Nil déborde ; & proche du
Jardin d’un More, assez frequenté des Marchands Francs, qu’on appelle (p. 182) Gheit il chavagie, ou le
Jardin du Marchand.
J’y ay remarqué deux choses qui me parurent assez curieuses, l’une étoit, que l’eau du Nil, qui est la plus
douce de toutes les eaux du monde, fait un sel, non seulement le plus blanc, mais aussi le plus parfait du
monde ; & l’autre, que ce sel a l’odeur & le goust de violette.
Ceux qui ont le soin de le faire, laissent pendant que le Nil court dans ce Canal, couler une certaine quantité
d’eau dans les Salines ; & quatre ou cinq jours après, elle est convertie en un sel, comme j’ay dit, le plus
beau qui se puisse voir ; après quoy ils le transportent dans des corbeilles au soleil, le font seicher, & ensuite
ils le vendent.
On peut tirer aussi du sel du Lac Sebaca, nommé par les anciens Autheurs Latins, Palus Mareotis, qui reste
au Midy de cette ville ; mais son eau est salée, & son sel est amer : C’est pourquoy on n’en fait point.
Ce Lac se forme des eaux du Nil qui s’y écoulent, lors qu’il déborde, & qui y restent, à cause qu’elles n’ont
(p. 183) point d’issuë. Il n’est pas fort profond, mais très-grand, & à peine peut-on d’un costé discerner le
rivage opposé.
Les Coptes d’Alexandrie gardent dans leur Eglise de Saint Marc, un Tableau de l’Archange Saint Michel, fait
par la main de Saint Luc, selon leur Tradition.
Monsieur Lucasole, Chancellier de la Nation Françoise en cette Ville me dit, que les Venitiens, ayant enlevé
ce Tableau, il y a quelque temps, ils partirent cinq fois du Port, sans qu’il leur fût possible d’avancer dans
leur chemin ; se trouvans arrestez par une secrette force, toutes les fois qu’ils voulurent faire voile, jusqu’à
ce qu’ils eussent remis le Tableau en son premier lieu.
Le bruit de cette merveille s’estant répandu par la ville, les Beduins, ou Boemiens, comme nous les
appelons, resolurent de l’enlever, & de le vendre aux Francs : Et comme ils avoient une nuit enfoncé la porte
de l’Eglise, & arraché le Tableau du lieu où il étoit, & qu’ils le voulurent emporter ; il leur fût impossible d’en
sortir ; de sorte qu’ils furent obligez de le (p. 184) remettre, comme les Venitiens ; & il est encore
jusqu’aujourd’huy dans cette Eglise, où je l’ay veu plusieurs fois.
Monsieur Lucasole m’assura, que cette chose estoit tres-vraye, & que luy-mesme s’estoit trouvé pour lors en
Alexandrie.
Touchant les eaux des Cisternes d’Alexandrie, j’ay leu dans le Livre de Monsieur de la Ch. fait sur les
causes du débordement du Nil, qu’elles deviennent salées environ le mois d’Avril, & de May ; & que la nuit
que la goutte tombe, elles reprennent non seulement leur premiere douceur, mais commencent encore à
croître quelque peu, & contiennent aussi tant que le Nil croist.
Bien que je ne pretende pas nier absolument une chose qui peut estre veritable, & que Monsieur Burattini,
cité de Monsieur de la Ch. dit avoir esté observée par plusieurs personnes : J’ose pourtant dire, que
nonobstant que j’aye fait deux voyages en Egypte, & sejournay plusieurs fois en Alexandrie, & en de
differentes Saisons de l’année, & fait des observations aussi exactes que l’on puisse sur (p. 185) toutes
choses : Il est pourtant vray que je n’en ay jamais entendu parler, ny que les eaux de ces Citernes
devinssent salées, ny qu’elles crussent avec le Nil, & reprissent leur premiere douceur.
J’ay pourtant observé avec étonnement, qu’elles sont toûjours quelque peu salées ; de sorte qu’il ne paroist
aucunement qu’elles viennent d’une riviere si douce.
Cette difference vient du Terroir nitreux ; & l’on connoist cette qualité, en ce qu’exposant quelque morceau
de terre, & de celle des environs d’Alexandrie au Soleil ; elle devient incontinent blanche comme la neige, à
l’endroit où le Soleil a donné.
De la Colomne de Pompée, k des Grottes qui sont auprès d’Alexandrie, de ce costé-là
Le vingt-unième du courant j’allay voir la Colomne de Pompée, & les autres curiositez qui sont aux environs,
accompagné de Monsieur Truillard l’aîné, Marchand François, (p. 186) & du Janissaire du Vice-Consul.
Nous sortîmes de la ville par la Porte qu’on appelle Bab issidr, hors de laquelle cette Colomne est plantée
sur une petite eminence, en tirant vers le Sud.
En m’approchant je remarquay qu’elle penchoit d’un costé, quoy que huit ans auparavant que je l’eusse
veuë, elle estoit fort droite : Cela vient de ce que les Arabes croyans qu’il y a quelque grand Tresor caché
dessous, ont creusé sous son pied d’estal, & en ont levé plusieurs grosses masses de pierres qui la
soûtenoient, ce qui la fait pencher un peu d’un costé. Ils l’auroient entierement renversée, s’ils n’eussent
trouvé plus avant des masses de pierres d’une grandeur si épouvantable, que ny eux, ny personne ne
pourront jamais les tirer.
On trouve la description, & la mesure de cette Colomne dans le Livre des voyages de Monsieur Thévenot :
C’est pourquoy je n’en dis rien icy, pour ne pas charger ce Journal de choses communes, & déjà parlé
suffisamment.
Après avoir consideré à loisir (p. 187) cette Colomne, nous allâmes tout le long du Calitz, jusqu'au lieu où il
répond aux murailles de la ville, pour voir comment le passage des eaux est fait. Nous allâmes à ce dessein
de l'autre costé du Calitz, par le petit Pont qui en est proche ; & estant arrivez aux petites arcades qui sont
sous les murailles, par où le Nil entre dans la Ville ; & ayant veu ce que nous voulions voir ; nous prîmes le
chemin des Grottes qui sont dans cette campagne au Oest-Sud-Oest, du costé de la porte par où nous
étions sortis ; & après que nous eûmes fait un quart de lieuë de chemin, ou environ, en nous avançant vers
le Lac Sebaca ; & laissez au Oest-Nort-Oest une Mosquée en rase campagne, où est enseveli un certain
Schech de Mores, appellé Side gams il gabbari, nous arrivâmes aux Grottes.
Pour y entrer, il nous fallut descendre une douzaine de marches dans une allée fort large, creusée dans le
roc, mais qui est découverte vers le Ciel ; peut-estre que sa voute est tombée par la longueur du temps. Il y
a dans cette allée quinze grandes (p. 188) ouvertures taillées aussi dans le roc en forme de grandes portes,
sept sont d'un costé, & huit de l'autre, par lesquelles on entre dans les dites Grottes.
Nous entrâmes en quatre, avec nos flambeaux alluméz, & conduits par nostre Janissaire. Nous y trouvâmes
tout autour des murailles, qui sont le roc mesme, depuis le haut, jusqu'en bas, des trous taillez dans le roc,
d'un ordre fort régulier, & d'une longueur et hauteur propre à tenir un cercueil & plusieurs Grottes étaient
percées pour donner passage aux autres. Il y avoit seulement cela d'incommode, qu'elles estoient presque
toutes remplies de terre & de sable ; ce qui nous obligea de nous y tenir sur les genoux ; mais ces difficultés
ne nous empêcherent pas de considérer tout ce qu'il y avoit de curieux.
Et pendant que nous estions dans une qui est au bout de l’allée à main droite en arrivant, un de nostre
troupe s’apperceut à la saveur de la clarté des flambeaux, qu’un de ces trous donnoit passage à une autre
Grotte ; ce qui nous donna envie de sçavoir s’il n’y avoit rien de curieux : Et quoy que (p. 189) le trou fort
petit, & fort mal aisé ; prenans courage, nous nous mîmes sur le ventre, & avec nos chandelles à la main,
nous passâmes l’un après l’autre de l’autre costé, où nous vîmes une des plus bizarres, & plus curieuses
Grottes que nous eussions veu jusqu’à lors
Elle estoit plus grande, plus entiere, & plus nette qu'aucune des précédentes, faite en quarré long, & bien
enduite de chaux en dedans. Il y avoit à chaque costé de la muraille ; que est le roc mesme, trois rangs de
trous, semblables à ceux que nous avions veus dans les premières. Au longs costez, il y en avoit quinze à
chaque rang, placez l'un au dessus de l'autre, ce qui faisoit en tout quarante-cinq : Les deux costez qui sont
les plus courts ; en avoient pareillement trois rangs, où il y en avoit trois à chaque rang ; ce qui faisoit en tout
neuf trous par costé ; Ils estoient tous vuides, bien nets, & dans la Grotte on ne sentait aucune mauvaise
odeur, à la reserve d'un trou, où il y avoit le squelette d'un homme déseiché.
Je vois bien que les curieux (p. 190) voudront d'abord sçavoir mon sentiment sur ces Grottes, & sur ces
trous, & à quelle fin je pense qu'elles ayent esté faites. A cela je leur répondray, qu'il est fort difficile de le
dire au juste ; veu que Macrizi, qui d'ailleurs a fort exactement décrit tout de qu'il y a de curieux en Egypte,
n'en fait aucune mention. Neanmoins, on voit bien qu'elles n'ont pu servir à d'autres usages qu'à des
Cimetieres. On connoist cela de la forme des trous, qui sont justement aussi longs, hauts & larges qu'il faut
pour y mettre un cercueil. Et depuis, toutes les autres Grottes qui sont en Egypte n'ayant servi que pour
cela, il est vray-semblable, que celles-cy ont esté faites pour la mesme fin. Et c'est dequoy je laisse le
jugement au Lecteur.
Cependant, je ne nie pas qu'elles n'ayent pu servir aussi aux Chretiens de lieu pour prier Dieu en cachette,
crainte des Romains, qui les persecutoient ; & mesme je trouve cette pensée confirmée par Seid ibn
Patrick534, Patriache Melchite d'Alexandrie, dans son Histoire, comme on le peut voir à la page 399.
(p. 191) Ceux d'Alexandrie appellent ces Grottes le Suk, ou le Marché ; mais il n'y a nulle apparence qu'elles
ayant jamais servy à cét usage.
Le roc dans lequel elles sont taillées, est tout carrié en dedans, & rongé par le temps ; les trous le sont aussi,
& particulierement ceu qui sont les plus proches de la porte, & par consequent les plus exposez à l’air. Elles
reçoivent aussi quelque peu de lumiere par de certains trous quarrez, qu’on a fait exprés au haut des
voutes.
Le 22. du courant je fis le tour de la ville, pour considérer ses murailles & tours. J'entray en six des
principales. La première estoit celle qu'on trouve en sortant du Fondego des François, avant que d'arriver à
la porte nommée Bab il achdar, ou la porte verte. Elle est ronde, soûtenuë en dedans de trois rangs de
colomnes de granite rouge, dont chacun en a sept.
Après cette Tour, nous allâmes à la porte du vieux Port, qui est à présent murée, à cause que ce port n'est
plus fréquenté ; l'une et l'autre sont droit au couchant de la Ville. De (p. 192) cette porte nous arrivâmes à la
Mosquée des Magrabins, appellée en arabe Giama el garbie, nous passâmes ensuite le vieux Château
d'Alexandrie, appellé Borg Mustapha Pacha ou le château de Mustapha Pacha, qui servoit autrefois pour
défendre le vieux port, & où il y a encore à présent une garnison de trois cens Janissaires.
Jusqu'alors nous avions toûjours marché vers le couchant ; mais depuis que nous eûmes quitté ce Château,
nous nous tournâmes vers l'Est, & trouvâmes ensuite une grande Tour, où nous montâmes sur la
platte-forme, non pas par un escalier, mais par un large chemin fait en Talut.
Après cette Tour nous arrivâmes à la porte nommée Bab issidir, hors de laquelle est la colomne Pompée :
De celle-cy nous passâmes à une autre nommée Bab irrascîd, ou la Porte de Rosette, en continuant
toujours nostre chemin le long des murailles de la Ville ; & de-là je sortis sans autre compagnie que celle du
Janissaire, pour voir l'endroit où le Nil entre dans le Canal qui répond aux Cisternes d'Alexandrie, & dont je
donneray la description (p. 193) cy-après.
Après avoir veu ce que je souhaittois, je rentray dans la Ville, & j'allay joindre les autres de nostre trouppe,
qui m'attendoient à l'ombre ; & continuant ensemble nostre promenade, nous arrivâmes à la Tour des
Indiens, à qui on a donné ce nom, à cause qu'il y loge depuis quelque temps, quelques Pelerins de ce Pays.
Nous y entrâmes, et son architecture nous parut admirable.
Nous allâmes ensuite à la Tour de la vieille Doüane ; ainsi nommée parce que lorsque la mer battoit les
murailles de la Ville par cet endroit-là, les Magazins de la Doüane y estoient. Mais depuis que la mer s'est
retirée, on a fermé la porte qui est auprès d'elle, & transféré le bureau de la Doüane dans l'endroit où il est
aujourd'huy.
Cette Tour est très vaste, soûtenuë en dedans par quatre rangs de colonnes de Granite. Il y a grand nombre
d'appartements, tant magazins, que chambres et salons, quoy qu'à présent une grande partie en soit ruinée.
Ce fut la dernière Tour que nous vîmes dans nostre promenade, où nous (p. 194) employâmes quatre
heures de temps, en comptant encore ce qui s'estoit passé à considerer les murailles, & à monter sur les
Tours.
Je reviens maintenant au Canal, par lequel les Citernes de cette Ville sont pourveuës d'eau.
Il est hors de la porte de Rosette ; il est de la hauteur d'un homme, & en dedans fait en voûte. Il répond à un
quart de lieuë de la Ville, au Caliz de Cleopatre, qui y passe, & luy donne une partie des eaux qu'il reçoit du
Nil mesme, pour les conduire ensuite jusqu'aux murailles ; où ayant rencontré un autre conduit, qui n'est
guère loin de cette porte, & qui par une ingenieuse pratique a communication avec toutes les Citernes, les
remplit.
Il faut pourtant sçavoir que son embouchure, quoy qu'elle soit de la hauteur de tout le Canal, a presque les
deux tiers de son ouverture murez de bas en haut ; de façon qu'il n'en reste qu'une petite, par où les eaux du
Calitz entrent, comme par un trou de fenestre. Mais parce qu'elles sont les trois premiers jours fort sales,
(p. 195) & que les Cîternes seroient bient-tost remplies d'ordures ; si on y laissoit entrer librement l'eau
pendant ce temps-là : pour prévenir cet inconvenient, ceux qui ont le soin de donner de l'eau à la Ville ; font
tout à fait murer le trou de ce conduit, & le laissent en cet estat pendant trois jours ; après lesquels ils vont à
la bouche du Canal, accompagnez d'une foule de Peuple pour le déboucher, & laisser entrer l'eau, jusqu'à
ce que les Cîternes soient remplies. Le jour de cette ouverture, est un jour de grandes réjouyssance pour
toute la Ville.
La Ville d'Alexandrie a six portes, dont trois sont ouvertes ; à sçavoir ; celle qui regarde le Sud, & s'appelle
Bab issidr, celle qui est à l'Est, & s'appelle Bab irrascîd, ou la porte de Rosette ; celle qui est vers le Nordest,
& s'appelle la porte de la Marine. Les trois fermées sont, celle de la vieille Doüane ; la porte verte,
nommée en arabe Bab il achdar ; et celle du vieux port.
Je ne sçaurois dire positivement, si les murailles & les portes qui y sont aujourd’huy, sont celles mesmes
(p. 196) qu’Alexandre le Grand a fait bâtir, ou bien si les Califfes du depuis les ont fait faire. J’estime
pourtant, que ce sont les Califfes qui les ont fait bâtir, & non pas Alexandre, quoy que tous les autres
Voyageurs soient d’un autre sentiment.
Les fondemens de ma conjecture sont, 1. qu’on n’y voit aucunes inscriptions Grecques, mais plusieurs
Arabes, quelques-unes écrites en lettres Cufiques, & quelques autres en caracteres Arabes ordinaire, qui
marquent le Califfe qui les a fait bâtir, ou tout au moins rétablir, & l’année que cela s’est fait. La hauteur des
portes sur lesquelles ces inscriptions sont gravées, jointe à l’artifice avec lequel les lettres y sont
entrelacées, ne m’ayant pas permis de les bien distinguer, je ne puis pas aussi plus assertivement parler.
2. La maniere dont elles sont bâties, prouve encore cette verité ; parce qu’elle est la mesme que celle des
portes du Caire, qu’on ne sçauroit nier estre l’ouvrage des Califfes, qui ont esté plusieurs siecles après
Alexandre.
Il y a deux Ports dans la ville (p. 197) d’Alexandrie, dont l’un s’appelle le vieux, où les vaisseaux entrent en
poupe avec le vent du Ponant ; mais il ne sert aujourd’huy, qu’à mettre à couvert les bâtimens, qui vont du
Levant au Ponant, lors qu’en passant, le mauvais temps les oblige d’y entrer. L’autre s’appelle le nouveau :
C’est là où abordent à present tous les bâtimens, & où ils moüillent l’ancre.
Le trafic que les Marchands François font dans cette ville, est le plus considerable qu’ils ayent en tout le
Levant : car il n’y a point d’échelle en Turquie, où abordent tant de voiles Françoises, qu’en celle-cy. Et
depuis le commencement de l’année 1672. jusqu’au mois de Juin de la mesme année, il y estoit arrivé
dix-neuf bâtimens françois : & dans le seul mois de Juin que j’y demeuray, j’en contay quatorze.
Quoy que ce nombre semble estre considerable, il est pourtant tres-petit, eu égard au nombre des
Vaisseaux qui y venoient autrefois : Car Monsieur Lucasole, qui y faisoit l’office de Chancelier de la Nation,
m’a dit, qu’il se souvenoit d’y en avoir veu en une (p. 198) seule année nonante quatre.
Et puis que je suis sur la matiere du trafic, je mettray icy, pour la satisfaction des Marchands François, une
tres-exacte liste de toutes les marchandises qu’on transporte de l’Egypte en Chrestienté, & qui viennent de
là en Egypte soit par la voye de Marseille, soit par celle de Ligorne, ou par celle de Venise, avec leur prix
courant en l’année 1673.
Les Marchandises que l’on transporte d’Egypte en Chrestienté, sont pour l’ordinaire
Gommes.
Comme Benjoin, dont 110. rotols coûtent 75. piastres.
Bdellion, dont le quintal coûte 50. piast.
Arabic, dont 133. 1. 3e. de rotols du Caire coûtent 6. Abukelbs.
Adragant, dont le quintal de 110. rotols, coûte 10. piast.
Lacque, dont le quintal de 110. rotols coûte 15. piast.
Turique, dont 130. rotols coûtent 9 Abukelbs.
(p. 199) Myrrhe Abyssinic, dont 110. rotols coûtent 40. piast.
Storax, dont…
Sucs.
Comme Aloë Cicotrin, dont le quintal coûte 80. piastres.
Dit Epatique, dont 150. rotols coûtent 28. piast.
Opium, dont le quintal de 110. rot. Coûte 120. piast.
Indigo, dit Serquis, dont 130. rot. Coûtent 70. piast.
Dit de Bagdat ; mais il ne vaut rien.
Dit Balludre ; mais il ne vaut rien aussi.
Cassanade, dont le quintal coûte 5. piast.
Sucre en gros pains, dont le quintal coûte 16. 1. 2e. piast.
Dit en petits pains, dont le quintal coûte 16. piast.
Dit Candy, & coûte 28. piast.
Dit Soltani, & coûte autant.
Sorbet, dont le quintal coûte 20. piast. (p. 200)
Bois.
Comme Sandal blanc, coûte 33. piastres.
Dit Citrin, coûte 25. piast.
Dit Turbit, coûte 30. piast.
D’Ebene, coûte 41. piast.
Du Bresil coûte 28. piast.
Ecorces.
Comme cannelle de Conchi, dont 150. rotols coûtent 60. piast.
Dite Malabari, coûte 25. piast.
Dite Zeilani, coûte 100. piast.
Fruits & semences.
Comme la Caffe, coûte 20. piast.
Coco de Levant, dont 133. 1. 3e. rotols coûtent 23. piast.
Coriandre, dont le quintal coûte 3. pist.
Caffé, dont le quintal coûte 25. piast.
Dattes, dont le quintal coûte 3. piast.
Mirabolans Kebus, dont 150. rotols (p. 201)coûtent 20. piast.
Dit Balludri, coûtent 23. piast.
Dit Citrin, coûtent 6. piast. mais ils ne valent rien.
Noix de Muscades, dont 110. rotols coûtent coûtent 200. Abulebels.
Noix vomiques, dont 110. rotols coûtent 7. piast.
Cardamome, dont le quintal de 139. rotols, coûte 140. piast.
Ben, fruit des Indes, dont la mesure d’un rot. Coûte 7. 1. 2e. piast.
Tamarindis, dont 110. rotols coûtent 15. piast.
La Coloquinte, dont le 100. coûte 10. piast.
Poivre, dont 100. rotols coûtent 22. 1. 2e. piast.
Giroffles, dont 125. rotols coûtent 25. piast.
Herbes.
Comme Lin peigné, dont le quital de 110. rotols, coûte 5. piast.
Lin du Menuf, de 6. à 7. piast.
Lin, dit Squinanti, dont la schive coûte 10. piast.
Lin noir, dont la schive coûte 10. piast. (p. 202)
Lin de Fium, dont la schive coûte 8. piast.
Lin de Forfette, à 7. 1. 4e. piast.
Lin d’Oleb des Besatins.
Sené, le quintal coûte 40. piast.
Fleurs.
Comme Spiquenard, dont 133. 1. 3e. de rotols coûtent 120. piast.
Saffran nambrosi, dont 110. rotols coûtent 12. piast.
Saffran de Said, coûte 6. piast.
Cotton, dit inramo, coûte 6. piast.
Cotton filé fin, coûte 20. piast.
Cotton ordinaire, coûte 10. piast.
Racines.
Comme Hermodattes, dont le quintal de 110. rotols coûte 3. piast.
Cine fine, coûte 200. piast.
Gingembre, dont 133. 1. 3e. rot. coûtent 25. piast.
Cretonart, dont 110. rot. coûtent 15. piast.
Rheubarbe, dont le rot. coûte 5. piast.
Salsepareille, dont 110. rotols coûtent 200. piast. (p. 203)
Dents.
Comme d’Elephant fines & grandes, dont 110. rot. Coûtent 25. piast.
Laines.
Comme Laine sale, dont 200. rot. gerovins coûtent 6. piast.
Lavée, dont le quintal coûte 10. piast.
Plumes.
Comme d’Aûtruches de la premiere & seconde sorte, dont le rotol coûte 24. piast.
Des queuës, dont quatre rot. Coûtent 24. piast.
Des noirs, dont 4. rotols coûtent autant.
Aigrettes, dont 1100. coûtent 1. 1. 2e. piast.
Des Airons, dont 100. coûtent 6. piast.
Poissons, k autres choses qui viennent de la mer.
Comme Stinc Marin, ou Lezard (p. 204) vert, dont les 1100 coûtent 30. piast.
Nacres de perles, dont les 1100. coûtent 10. piast.
Boutargue, dont 200. nets coûtent 25. piast.
Mommies.
Dont le quintal de 110. rotols coûtent 2. Abukelbs.
Sels.
Comme Armoniac, dont le quintal de 204. rotols coûte 16. piast.
Nitrum, espece de sel nitre, dont 140. rotols nets coûtent un piast.
Alum de roche, dont le quintal à 139. rotols, coûte 9. piast.
Toiles.
Comme bleuës, dont la piece de 40. picques de Caire coûte 65. meidins.
D’Alexandrie, la piece de 40. picques coûte 55. meidins.
De Menuf, la piece de 83. picques, coûte 80. meid.
Grande d’Inbab, la piece de 30. (p. 205) picques, coûte 150. meid.
Petite bleuë de Caire, la piece de 12. picques, coûte 19. meid.
D’Alexandrie, la piece de 12. picques, coûte 14. meid.
De Col, la piece de 20. picques, coûte 15. meid.
Peintes, coûte 60. meid.
Battanones, la piece de 28. picques, coûte 20. meid.
Magrabines, dont la piece coute 55. meidins.
Messaline, dont la piece coûte 80. meidins.
Lizarde, dont la piece coûte 120. meidins.
Cambrasine, dont la piece coûte 5. piast.
Etoffes.
Comme Bordats du Caire, la piece coûte 18. meid.
De Damiette, coûte de 25. à 28. meid.
D’Alexandrie, coûte 24. meid.
Ceintures fines de Rosette, la douzaine 14. meid.
Ceintures ordinaires, la douzaine coûte 10. meid. (p. 206)
Mouchoirs fins, à 18. à la botte, coûtent 24. meid.
Mouchoirs ordinaires, à 18. à la botte, coûtent 12. meid.
Autres ordinaires, à 10. à la botte, coûtent 10. meid.
Vescies.
Comme Musc, dont la dragme coûtent un piastre.
Tapis.
Comme Tapis fins, dont la picque coûte de 1. & demy à 2. piast.
Tapis gros, à demy piastre la picque.
Les marchandises qui entrent de la Chrestienté en Egypte, avec leur prix courant en 1673. sont
Mineraux.
Comme Agaric, dont l’ocque vaut un piastre.
Arsenic blanc, dont le quintal de 125. rotols vaut 9. piast.
Arsenic jaune, vaut 14. piast. (p. 207)
Archifu, dont 150. rotols valent 8. piastres.
Orpiment, dont la caisse vaut 25. piastres.
Antimoine, dont le quintal vaut 200. piast.
Le Sublimé, le rotol vaut un & demy piast.
Le Vif-argent, dont 102. rotols valent 100. piast.
Vitriol, dont le quintal vaut 70. piast.
Vermillon, dont 110. rotols valent 14. piast.
Cinabre, dont le quintal de 102. rot. vaut 150. piast.
Salsepareille, dont 110. rot. valent 200. piast.
Cine fine, vaut 200. piast.
Fleurs et Herbes.
Comme Nard Celtique, dont le quintal de 110. rot. vaut 55. Abukelbs.
Spique nard, dont 110. rotols valent 150. piast.
Fer, Acier, Laiton, Plomb, & Etain.
Comme fil de laiton, dont 105. rot. du grand coûtent 60. piast. (p. 208)
Et le petit, 50. piast. L’archal, 20. piast.
Fer blanc, le baril 40. piast.
Acier de Venise, 110. rotols valent 15. piast.
Plomb, dont 130. rotols valent 12. piast.
Etain, dont 102. rotols valent 45. piast.
Semences.
Comme de Cochenille535, dont l’ocque vaut 20. piast.
Papier.
Dont la balle de 24. rames vaut 20. piast.
De 14. rames, 22. piast
.
De 12. rames 24. piast.
Etoffes de soye.
Comme satin de Florence, dont la picque vaut 60. meid.
Draps.
Comme Draps, dit Londrine, dont (p. 209) la picque vaut 5. Abukelbs.
Dit à Bucioche, dont la picque vaut 60. meid.
De Saint Pont de Roman, dont la picque vaut 50. meid.
Forastiers à la façon d’Hollande, dont la picque vaut 80. meid.
D’écarlatte, la picque à 90. meid.
Bonnets ordinaires de Marseille, dont la douzaine vaut 5. piast.
Bonnets, dits demy Fes, & la douzaine vaut 10. piast.
De Fes entiers, vaut 14. piast.
Corails.
Comme Brutes de Messine, dont le quintal geroin vaut 100. piast.
Taraille, vaut 25. piast.
Corails travaillez dont 100. rotols de Caire valent 400. piast.
Tartre blanc, dont 125. rotols valent 14. piast.
Tartre rouge, dont 125. rotols valent 12. piast.
Bresil, dont 110. rotols au quintal valent 30. piast.
Alum de roche, dont 139. rotols valent 10. piast. (p. 210)
Et parce que nous avons fait mention dans cét endroit de plusieurs poids & monnoyes qui sont en usage en
Egypte ; il est necessaire d’en expliquer icy la valeur, afin que le Lecteur se puisse servir avec plus de
satisfaction de ce Journal.
L’ocque, est de 400. dragmes.
Le rotol, est de 144. dragmes.
Cent dix rotols du Caire font 108. livres de Marseille
Le quintal geroüin, est de 217. rotols du Caire.
L’Abukelb, qui est le Daller d’Hollande, avec l’impression du Lion, vaut en change 33. meidins, mais en
espece 38. & quelquefois davantage.
La piastre courante, avec laquelle nonobstant qu’elle soit imaginaire, on trafique en Egypte, & fait tous les
payemens, vaut toûjours trente meidins.
Les Reaux d’Espagne, valent en échange 33. meidins ; mais en espece 40. & quelquefois davantage, selon
qu’ils sont recherchez.
Le Sequin, ou Ducat d’or de Venise, qui est après les Reaux d’Espagne la meilleure monnoye qu’on puisse
avoir en tout l’Empire du Grand Seigneur ; (p. 211) vaut en trafic & usage 100. meidins ; mais le Divan du
Caire ne les prend que pour quatre-vingt-cinq.
Le Meiden, ou le Para, qui est la mesme chose, est une petite piece d’argent faite des Pachas du Caire, au
nom du Grand Siegneur, qui a cours par toute l’Egypte, & avec laquelle on fait tous les payemens ; il vaut un
sol & demy monnoye de France.
Une Bourse est de 25000. meidens, qui font 500. écus de France.
Le 23. de ce mois ; je vis revenir un More d’une course qu’il avoit faite, pour montrer sa vigueur, & qu’il avoit
assez de force pour estre mis au nombre des Porteurs de lettres d’Alexandrie au Caire.
Cette course de celuy qui pretend estre fait Messager d’Alexandrie, consiste en ce qu’il doit porter sur ces
épaules un feu allumé dans un pannier de fer, fait en forme d’un grand réchaut, qui est fiché au bout d’un
bâton de la hauteur d’un homme ; & auquel sont attachés plusieurs cercles de fer, du poids de 36. rotols ; &
avec ce fardeau, il doit faire une course de vingt-sept milles sur le chemin de (p. 212) Rosette, & revenir le
mesme jour à la ville avant le coucher du soleil ; ce qui fait en tout 54. milles, toûjours chargé du mesme
fardeau ; & s’il en vient à bout, il est non seulement receu parmy les Messagers, mais il gagne encore la
gageure que les autres ont fait contre luy : Et au contraire, si les forces luy manquent, il perd sa vigueur, & il
n’est pas receu dans leur corps.
Celuy que je vis revenir ce jour-là à la ville, & qui avoit achevé sa course avec gloire, parce qu’il avoit encore
deux heures du soleil de reste ; gagna une gageure de 15 piastres, fut receu dans le corps des Messagers,
& amassa de plus huit piastres ou environ, de ceux qui estoient les spectateurs de son glorieux retour ; mais
il suoit si fort, qu’on auroit dit à le voir, qu’il sortoit d’un bain. Il estoit suivy d’un si grand nombre de gens à
pied & à cheval, dont les uns avoient portés du bois pour entretenir son feu, & les autres de l’eau pour le
rafraîchir, qu’avant que d’en sçavoir la cause, je crûs qu’il y avoit quelque émotion dans la ville.
(p. 213) Après avoir séjourné dans Alexandrie autant de temps que mes affaires le demandoient, & me
sentant enfin libre, graces au Ciel, de la fièvre quarte qui m’avoit travaillé seize mois tous entiers ; Je partis
fort content pour Rosette le jour de la Feste des Apostres de Saint Pierre, & Saint Paul. Je voulus faire ce
voyage par mer l’ayant fait tant d’autres fois par terre. Je m’embarquay sur une germe, & en cinq heures de
temps, nous arrivâmes à Rosette ; mais cela ne fut pas sans risque de faire naufrage à l’embouchure du Nil,
ses eaux se choquans continuellement avec tant d’impetuosité contre les vagues de la mer, qu’elles font
trembler les plus habiles pilotes de l’Egypte. »
- 488 - 496 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
EDWARD BROWN (du 9 janvier à août 1673)
Brown, E., Voyage en Égypte d’Edward Brown, 1673-1674, par S. Sauneron, Ifao, Le Caire, 1974.
Le médecin anglais Edward Brown (1644-1708) voyage pour acquérir des pierres précieuses, notamment
des émeraudes, pour les vendre sur les marchés d’Europe.536
p. [3]-[25] :
« Le 7 le temps était beau, et dans la soirée, le capitaine annonça qu’il pensait être à environ 80 lieues
d’Alexandrie. Bien qu’il y eût peu de vent, la mer était assez mauvaise et nous n’osions pas mettre trop de
voile, quel que fût notre désir d’arriver au port. Le 8, le vent nous fut favorable et nous couvrîmes une grande
partie de la distance. Le 9, la terre fut en vue et aux environs de midi nous entrâmes dans le port
d’Alexandrie.
Les compagnons d’Edw. Brown
Monsieur Perez, moi-même et notre domestique Antonio, allâmes loger pour l’heure chez un certain
Veneroni que notre capitaine connaissait. Le seigneur Altoviti y vint aussi et visita avec nous tout ce que la
ville et ses environs pouvaient offrir d’intéressant, restant bien persuadé toutefois qu’aucun objet n’était plus
digne d’intérêt et d’admiration que lui-même. Il se faisait passer pour un voyageur que la seule curiosité avait
conduit en Égypte, mais il parlait de tout avec une telle aisance et une apparence de savoir qu’il était difficile
de croire que son voyage n’ait pas eu de but plus précis. Il était remarquablement doué pour découvrir le
caractère, les goûts, les qualités de chacun et s’y adapter, et c’est ainsi qu’il devint très vite l’ami de coeur du
docteur Salviati, de Mr. Perez, de notre capitaine ; le mien et même celui d’Antonio aux dépens duquel il
savait nous faire rire sans jamais le blesser, ce qui n’était pas facile !
Il adorait dépenser, acceptait toutes les propositions dont il pensait tirer quelque plaisir mais payait toujours
sans marchander comme un homme de qualité. Le jeu était une de ses distractions favorites et sans
pourtant y montrer de talent particulier, il gagnait souvent. Il ne misait jamais de grosses sommes mais il y
consentait volontiers lorsqu’il s’agissait de réconforter un joueur malchanceux. Il fallut une occasion tout à
fait exceptionnelle, alors que je le connaissais depuis longtemps déjà, pour que je découvrisse que le jeu
était sa pierre philosophale et la mine d’où il tirait ses moyens de subsistance. Il ne devait pas avoir plus de
cinquante ans à l’époque dont je parle, mais il était tellement connu à travers l’Europe qu’il avait été obligé
de prendre le large et, pour employer le langage des mineurs, de s’attaquer à un filon encore inexploité !
Le docteur Salviati, lui, venait en Égypte pour y exercer sa profession. Deux frères, courtiers à Alexandrie, lui
avaient demandé de venir vivre avec eux, et prendre soin de leur santé. Le docteur avait 46 ans environ,
tout le raffinement italien, beaucoup de bon sens et cette sincérité de sentiments qu’on est en droit
d’attendre d’un ami. Il se rendit immédiatement chez ses producteurs qui le reçurent autant d’affectueux
empressement que s’il avait été leur plus proche parent. Ils lui donnèrent un vaste appartement dans lequel
ils firent transporter toutes ses affaires et mon propre bagage comme il le leur avait demandé. Bref, ce qu’ils
firent pour lui aurait satisfait l’homme le plus exigeant du monde et il était loin de l’être ! Le docteur n’avait
qu’un défaut : il aimait le jeu, c’est ce qui l’amenait chez nous tous les jours malgré tout l’argent qu’il y
perdait et il aurait toujours perdu si le Napolitain n’avait eu l’habileté de perdre lui-même de temps, parfois
même des sommes doubles de celles qu’il venait de gagner.
Début de la quête des pierres rares
Dès notre arrivée tout alla pour le mieux. Le seigneur Altoviti s’attirait toutes nos faveurs en nous procurant
avec beaucoup de régularité des pierres gravées, des médailles et autres curiosités qu’il savait acheter bien
moins cher que nous, et qu’il nous laissait au prix où il les avait payées, nous prenant pour des gens
fortunés qui cherchaient à enrichir leurs collections. Le docteur, qui ne partageait pas notre intérêt pour les
choses anciennes mais se passionnait pour la physique et la chimie, nous faisait souvent les mêmes
faveurs. Quant à Antonio, avec les sept ou huit piastres que nous lui donnions, il se procurait en deux ou
trois jours de véritables chargements dans lesquels nous trouvions presque toujours quelque chose de
valeur.
Dés notre arrivée, je remarquai que Mr. Perez ne s’adressait pas volontiers aux Juifs. Il semblait même
éprouver à leur égard les sentiments de crainte que l’on devait éprouver pour l’Inquisition. Il ne s’en expliqua
jamais mais en rassemblant tout ce que je pus lui entendre dire je crois avoir compris que les Juifs ne
tolèrent aucun laxisme et se réservent le droit de châtier tout homme qui dans sa façon de vivre ne respecte
pas scrupuleusement la loi de Moïse. Chaque fois donc que j’eus avec les Juifs des relations d’affaires, je
veillai à ne jamais les mettre en présence. Cela ne posa aucun problème, Mr. Perez, étant homme
d’honneur, n’aurait jamais imaginé qu’un homme qui se disait son ami pût faillir à l’honneur au point de le
tromper et comme j’étais parfaitement conscient de la confiance qu’il plaçait en moi, je fis toujours tout ce
qu’il fallait pour servir nos intérêts et ne jamais lui déplaire.
Mésaventures avec un trafiquant juif
Ces gens, je veux dire les juifs, assurent la plus grande partie du commerce qui se fait en Égypte ; dès que
l'on touche au commerce on a donc forcément affaire à eux. Par l’intermédiaire de Mr Fetherstone, nous
avions été recommandés à un certain Abraham et en arrivant je m’estimai heureux d’avoir à traiter avec lui. Il
parlait italien, français et espagnol à la perfection. Il était non seulement connu du Consul de Venise et du
Vice-Consul de France mais aussi des officiers turcs, civils et militaires et avait avec eux des relations
d’affaires ; il était capable, raffiné et plus cultivé qu’aucun Juif de ma connaissance, rabbins exceptés. Avec
toutes ses qualités, c’était bien un des plus habiles et des plus rusés coquins qui aient jamais existé !…
Beaucoup s’en doutaient mais rares étaient ceux qui osaient faire part de leurs soupçons car il était si
influent et ses machinations étaient si subtiles que celui, quel qui fût, qui l’offensait échappait rarement à
quelque accident funeste.
La première affaire que je traitai avec lui fut la vente d’un lot de corail tiré par Mr. Fetherstone. C’était un
corail d’excellente qualité et très finement travaillé. Les échantillons que je lui montrai lui plurent au point
qu’il se déclara aussitôt prêt à se charger de tout ce que nous avions, ce qui représentait un peu de deux
quintaux. Je fus tout à fait satisfait de la façon dont il traita l’affaire puisqu’il vendit le tout mille piastres alors
que les marchands vénitiens chez qui le docteur Salviati habitait m’avaient assuré que cela ne dépasserait
pas 850. Avant de faire les comptes, mon juif me fit voir quantité d'objets anciens et curieux dont certains
étaient authentiques, mais dont la plupart étaient faux de toute évidence. Le prix qu'il proposa pour les
pièces de quelque valeur était nettement trop élevé et il eut l'air passablement mécontent quand je refusai
de les prendre. Cependant, quelques jours plus tard, il m'apporta des pierres de couleur : des chrysolithes,
des améthystes et surtout des émeraudes dont on trouve quelques beaux spécimens en Egypte. Il y en avait
deux entre autres qui auraient été de très grand prix si elles avaient été absolument pures. Il demanda
300 piastres pour l'une et 200 pour l'autre. Je lui offris 250 pour la plus belle ; il fit quelques difficultés mais
finalement accepta.
En rentrant à la maison je montrai la pierre à Mr. Perez et lui demandai ce qu’il en pensait ; il me dit qu’elle
pourrait peut-être se vendre 150 piastres mais que personnellement il ne la paierait pas ce prix-là. Je lui dis
alors que je l’avais achetée pour moi et que je comptais l’envoyer en Angleterre en cadeau. « Je regrette,
me dit-il ; nous sommes bien obligés de vendre les pierres telles que nous les trouvons, qu’elles aient des
défauts ou non ; mais quand il s’agit d’un cadeau il me semble qu’une pierre doit être absolument parfaite ».
Je souris alors en lui disant que c’était là un scrupule bien espagnol mais que beaucoup de personnes
préféreraient de grosses pierres à d’autres plus petites et de plus grand de valeur.
En réalité, j’avais acheté cette émeraude dans l’intention d’essayer le secret que j’avais pour la débarrasser
de ses imperfections mais je découvrais en même temps que le Juif me l’avait fait payer plus du double de
sa valeur bien que j’aie accepté de lui laisser pour la vente du corail une commission supérieure d’un demi
pour cent à celle qu’il est de coutume de donner. Par la suite, il fut si mécontent en constatant que nous ne
lui confions pas toutes nos affaires qu’il ne put s’empêcher de nous jouer de méchants tours que nous ne
méritions aucunement, et dont Antonio nous aurait vengés à sa façon si je ne l’en avais empêché.
Médailles alexandrines
Pendant notre séjour à Alexandrie – qui fut plus long que nous ne l’avions d’abord cru nécessaire et qui fut
beaucoup plus court qu’il aurait dû être, puisque aucun endroit ne pouvait mieux nous convenir – il nous
arriva bien une étrange aventure. Cela se passa trois mois environ après notre arrivée et nous donna une
très haute idée de la chance que nous avions. Cela nous poussa aussi à prendre beaucoup de risques
inutiles dans l’espoir de rencontrer une chance plus grande encore –ce qui serait certainement arrivé si nous
n’avions jamais quitté la ville.
Voici… Chaque fois que je m’éloignais d’Alexandrie, je louais l’âne d’un vieil arabe ou plus exactement un
Bédouin, comme on les appelle ici. Cet homme parlait une sorte de lingua Franca et nous arrivions, non
sans difficultés, à nous comprendre. Parce que je lui donnais de temps en temps un peu plus que son dû
pour la location de la bête – ce n’était vraiment pas grand’chose ! – cet homme s’était attaché à moi,
d’autant plus, il me semble, que j’étais plus réservé, plus sérieux que ne sont couramment les « Francs »,
puisque c’est ainsi qu’ils appellent les Européens. Ce pauvre garçon ayant pris froid un certain jour se
plaignit de violentes douleurs d’estomac ; je parvins non sans mal à lui faire absorber un peu d’un cordial
contenant de la rhubarbe ; cela le soulagea aussitôt. Quand nous fûmes de retour il me dit qu’il m’apporterait
le lendemain une partie du trésor des Francs, il entendait par là des médailles et autres pièces curieuses
que les voyageurs recherchent généralement en Égypte. En effet le lendemain, il m'apporta de quoi remplir
un chapeau, le tout enveloppé dans une étoffe grossière. Je n'examinai pas les différentes pièces de très
près car je m'étais aperçu au premier coup d’oeil qu'elles étaient authentiques et curieuses et je voulais
d'abord savoir ce qu'il allait en demander. Il m'en demanda vingt piastres et cela lui paraissait une très
grosse somme. Je lui en donnai douze et il me quitta non pas satisfait mais transporté de joie.
Ces pauvres gens vivent dans des grottes au milieu des ruines de la vieille cité ; ils ont ainsi de grandes
chances de découvrir des médailles, des pierres, des idoles de terre verte et toutes sortes de curiosités. Peu
avant notre arrivée il y avait eu apparemment un violent orage et l'eau, en ravinant le sol, avait mis au jour
tous les objets que l'Arabe m'avait vendus avec beaucoup d'autres qu'il conservait précieusement dans sa
grotte en attendant de trouver l'occasion de les vendre.
Quand je montrai ces différentes acquisitions à Mr. Perez, il voulut y voir un heureux présage ; il est vrai qu’il
y avait entre autres choses deux médailles en argent de Lysimaque, une médaille en cuivre de Cléopâtre,
qui étaient objets de valeur ; il ne s'y trouvait rien de faux, et rien qui fût de peu de valeur. Il y avait
également trois tablettes de cornaline, beaucoup plus dures et plus foncées qu'elles ne le sont d'ordinaire,
prêtes, semble-t-il, à être gravées mais restées vierges pour on ne sait quelle raison. C'étaient vraiment les
plus belles tablettes que j'aie jamais vues. Nous les envoyâmes à Mr. Fetherstone avec beaucoup d’autres
choses. Il nous assura en retour que judicieusement répartis et envoyés à qui il fallait, nos achats nous
vaudraient des profits tout à fait substantiels.
Notre Napolitain avait réalisé maintenant ce qu’était notre commerce et insistait auprès de Mr. Perez pour
qu’il se rendît au Caire. Quant à lui, d’après ce qu’il nous dit de ses propres affaires, il était grand temps qu’il
partît. Nous n’avions pas tellement de raisons de changer et je n’y aurais même pas songé si Mr. Perez
n’avait insisté en m’assurant que nous y trouverions notre compte. Le Napolitain fut tout de même obligé de
partir sans nous ; il avait gagné une grosse somme d’argent d’un Juif qui ne semblait pas accepter sa perte
avec toute la résignation souhaitable. Nous restâmes un peu plus longtemps à cause d’une méchante fièvre
qui me fatigua beaucoup, d’autant que je fis une rechute. Pour aider à mon rétablissement, le docteur
Salviati me fit partager son appartement dans la demeure de ses protecteurs et avec leur consentement.
Expérience d’épuration des pierres
Je trouvai là l’occasion de faire l’expérience que je voulais tenter sur l’émeraude que le Juif m’avait vendue,
grâce à un petit fourneau que je pouvais utiliser. Malheureusement je n’obtins pas le résultat escompté, bien
que la qualité de la pierre s’en trouvât grandement améliorée. Je recommençai l’expérience avec deux ou
trois grosses topazes tellement chargées d’impuretés qu’elles paraissaient givrées, et cette fois je réussis
au-delà de toute espérance, car elles devinrent parfaitement pures et d’une très belle couleur. Je fis aussi
quelques expériences sur des améthystes et des chrysolithes mais sans aucun résultat. Quand je fus rétabli,
je me laissai convaincre par mon ami Perez d’aller à Rosette et de là au Caire bien que ce fût à contrecoeur.
Histoire d’Alexandrie
Pendant le temps que nous passâmes à Alexandrie – c’était pendant la belle saison – j’eus toutes les
occasions souhaitables de m’instruire dans l’histoire passée et présente de cette ville célèbre entre toutes, et
n’en manquai aucune. J’essayai aussi, dans la mesure de mes moyens, de tirer des conclusions à partir de
ce que j’entendais, voyais et lisais et d’en faire le meilleur profit. Je m’amusai ainsi souvent à me représenter
les diverses situations qui se succédèrent dans cette partie du monde, à imaginer la puissance, la grandeur,
les richesses des différents souverains qui régnèrent sur l’Égypte ou en firent une province de leur Empire.
Après mûre réflexion je suis persuadé, et je crois que je pourrais convaincre toute personne raisonnable,
que les rois d’Égypte qui ont précédé Alexandre étaient, et de loin, les princes les plus puissants et les plus
respectables que le pays ait connus. À première vue cela peut paraître étrange de tirer cette conclusion
après avoir découvert et étudié Alexandrie, qui n’a été édifiée qu’après leur disparition ; réfléchissons
pourtant que, si les anciens souverains d’Égypte ne s’étaient pas souciés de donner à cette région les
avantages que la nature lui avait refusés, elle aurait été si loin d’offrir la situation qui convient à la capitale
d’un grand empire qu’il n’y aurait même pas eu un village, que dis-je, pas une seule maison, en cet endroit
ou dans les environs.
Conditions géographiques antérieures
Les cartes d’Égypte que nous possédons sont tellement inexactes qu’il est vraiment très difficile de
comprendre ce que veulent dire les voyageurs quand ils parlent de ce pays et bien souvent, à ma grande
surprise j’ai trouvé que, dans le même ouvrage, cartes et textes étaient en totale contradiction lorsqu’il
s’agissait de situer un lieu. Alexandrie la ville dont je parle, s’étend au-delà du Delta du côté du désert de
Libye. On ne peut imaginer sable plus stérile, moins propice à la culture, plus totalement privé d’eau que
celui qui l’entoure.
Pour remédier à cela et faire de ce désert une région habitable les anciens rois d’Égypte trouvèrent le
moyen d’y amener de l’eau, et comme il en fallait une quantité considérable, ils firent creuser un lac profond
et vaste à quelques kilomètres de la mer, réservoir destiné à alimenter les canaux qu’ils avaient également
fait creuser, lorsque ceux-ci ne pourraient recevoir leur eau directement du Nil. Ce lac reste un témoignage
de leur grandeur et de leur sagesse et s’appelle Maréotis. Il fut rempli grâce à deux canaux, l’un issu du lac
Moeris, l’autre amenant les eaux de Basse-Égypte. Partant du lac Maréotis un autre canal menait à la mer
avec plusieurs dérivations aussi utiles à l’agriculture qu’à la navigation. C’est ainsi que cette région devint
habitable, qu’elle se couvrit peu à peu de villages et que, jouissant d’une situation favorable au commerce,
avec les Grecs en particulier, elle devint un lieu d’échange pour les marchandises venues de Haute-Égypte
et même d’Éthiopie et les produits européens.
La création d’Alexandrie
Voilà ce que trouva Alexandre le Grand, et avec beaucoup de sagesse, il s’attacha à édifier une ville
destinée à être le siège des Gouverneurs grecs et une sorte de poste de contrôle sur le reste du pays.
Quiconque connaît bien l’histoire de ce grand homme se rend compte que parmi tous les pays dont il se
rendit maître il n’en est aucun qu’il ait acquis avec autant de facilité que l’Égypte. La raison en est que les
Égyptiens souhaitaient tout naturellement se libérer du joug des Perses, et préférèrent se soumettre à lui
plutôt qu’à un autre. Leurs anciens maîtres les avaient toujours traités avec une grande dureté et
s’opposaient ouvertement à leurs croyances. Les Grecs, au contraire, étaient de vieux amis, à peine moins
supertitieux qu’eux.
Cependant, Alexandre tenant à conserver ce qu’il avait conquis, réalisa très vite qu’on ne pouvait faire
confiance aux Égyptiens et que ce serait faire courir un risque inconsidéré à ses vétérans que de les laisser
s’établir en garnisons éparpillées dans le pays ou dans une grande ville de l’intérieur puisque, en cas de
troubles, ils seraient rapidement enfermés et affamés avant qu’on puisse leur porter secours. Ce n’est donc
ni par orgueil ni par vanité qu’Alexandre entreprit la construction de la ville, ce fut une décision politique, et il
mit à la réaliser autant de sagesse et de perspicacité qu’il en avait mis à la concevoir. Je sais parfaitement
que les écrits des Anciens ne sont pas tous de cet avis, mais quiconque fera preuve d’intelligence et
s’attachera plus à un point de vue dicté par la raison qu’aux explications séduisantes proposées par certains
historiens, tels que prodiges ou interventions miraculeuses, trouvera mon explication tout à fait
vraisemblable.
Cette ville donc, dessinée par Dinocrate sur l’ordre d’Alexandre, s’étendit entre le lac Maréotis et la mer,
offrant toutes facilités pour joindre la Haute et la Basse-Égypte. Tout fut prévu pour l’installation d’une solide
garnison et d’une colonie nombreuse et prospère, ouverte sur la Grèce d’où viendraient, si le besoin s’en
faisait sentir, les secours nécessaires non seulement pour assurer sa protection mais pour maintenir
l’hégémonie grecque sur l’Égypte entière. Fondée par un des plus grands princes de la terre elle fut tout de
suite dotée des monuments publics les plus imposants, grâce au géni grec pour l’architecture, qui était alors
à son apogée, et grâce à toutes les richesses venues de l’Est. Jusqu’à sa mort, le grand conquérant
manifesta une tendresse particulière pour cette ville qu’il avait créée, lui accordant des privilèges et l’entoura
de tels soins qu’à peine bâtie elle fut peuplée, et cela en un temps si court que nous aurions quelque peine à
le croire si nous ne savions que l’entreprise avait été menée par celui-là même qui tenta et réussit, avec
36 000 hommes, la conquête de la patrie la plus importante du globe.
Son successeur dans cette partie de l’Empire, Ptolémée Lagus, n’était ni fils de Philippe ni frère d’Alexandre
mais fit d’Alexandrie sa capitale et employa tout son règne, qui fut long et prospère, à la fortifier, à l’embellir
et à l’étendre : c’est lui qui fit du port une des merveilles du monde et fit élever sur une île artificielle, le
Pharos, un palais somptueux dont les auteurs parlent avec un étonnement émerveillé.
Ses successeurs agirent de même, ils développèrent et embellir la ville autant qu’ils le purent, y attirant peu
à peu tous les arts grecs. Ils firent édifier cette bibliothèque célèbre qui abrita finalement 500 000, certains
vont jusqu’à dire 700 000 volumes et que le feu détruisit, dit-on, quand Jules César occupa la ville, bien que
ni dans les « Commentaires » ni dans leur suite, écrite par le Consul Hirtius, il n’y soit jamais fait la moindre
allusion. Cléopâtre, dernier souverain grec d’Égypte, dépensa une énergie considérable pour que les
bâtiments construits sous son règne l’emportent en magnificence sur tous ceux édifiés jusqu’alors, et les
ruines de son Palais (si c’est bien de son palais qu’il s’agit) sont encore visibles de nos jours.
Alexandrie romaine
Lorsque l’Égypte devint une province romaine, Alexandrie perdit un peu de sa grandeur d’antan mais
demeura, si l’on en croit les auteurs romains, la deuxième ville après Rome, avec un million environ
d’habitants de toutes sortes, et pas moins de 300 000 citoyens. Son commerce, sa situation agréable et
commode, en firent la capitale de l’Afrique et attirèrent un tel afflux de richesses et de produits de luxe que
« deliciae Alexandriae », les délices d’Alexandrie, devinrent proverbiales, si l’on en croit Quintilien. À partir
de ce moment, Alexandrie partagea le destin de l’Empire Romain ou plus exactement de l’Empire de
Constantinople dont elle faisait partie, jusqu’au jour où elle fut envahie par les Sarrasins du Calife Omar
comme tout le reste de l’Égypte et endura dès lors toutes les calamités que l’adversité et la barbarie peuvent
infliger, aussi cruelles pour les monuments que pour les hommes : ceci n’étant vrai qu’au moment où ils
envahirent l’Égypte car après s’être installés et avoir goûté aux bienfaits d’un gouvernement civil, paisible et
prospère, ils devinrent progressivement tout autres !
Alexandrie arabe
Leurs successeurs qui en étaient venus à apprécier la culture grecque, ne purent cependant remettre en état
les édifices que leurs prédécesseurs avaient abattus ni faire revivre les innombrables oeuvres littéraires qu’ils
avaient détruites. Car, de même que tous les Princes qui régnèrent sur Alexandrie s’efforcèrent d’en faire le
berceau des muses en même temps que le siège du gouvernement, de même les bibliothèques qu’ils se
flattèrent de créer connurent toutes un destin tragique. De la première, j’ai déjà parlé ; la deuxième,
commencée par Cléopâtre et continuée par le Princes et les gouverneurs romains, fut détruite – par le zèle
des prêtres chrétiens qui estimaient qu’un savoir païen ne peut qu’engendrer des supertitions païennes. Ce
qui fut sauvé de ces destructions tomba entre les mains des Sarrasins qui là, comme au Caire, chauffèrent
les fours et leurs bains avec quantités de manuscrits inestimables. Alexandrie eut beaucoup à souffrir des
guerres qui affligèrent l’Égypte presque sans interruption lorsqu’elle fut passée sous le joug de ses
nouveaux maîtres.
Enfin, un des successeurs de Saladin, puisque c’est ainsi que les Européens l’appellent, entoura une partie
de la ville de murs flanqués de tours qui sont encore debout. Tout ce qui se trouvait à l’extérieur de cette
enceinte fut détruite, tant pour se procurer les matériaux de construction nécessaires à l’entreprise que pour
éviter que les ennemis puissent trouver de quoi dresser une place forte devant la ville.
Bien des voyageurs ont affirmé, je le sais, que les murs que l’on voit encore de nos jours ont été bâtis par
Alexandre ; mais c’est l’explication que j’avance qui est la bonne non seulement parce que c’est celle
donnée par les historiens arabes mais parce que les restes d’anciens édifices qui ont servi à faire ces murs
portent des inscriptions arabes nettement postérieures. On dit aussi que, sous les Mamlouks, Alexandrie, ou
plutôt les ruines somptueuses de cette ville souffrirent de nouvelles déprédations. Ces hommes cupides
étaient persuadés que tous les obélisques qu’ils voyaient couverts d’hiéroglyphes avaient été dressés en
raison de leur valeur de talisman, pour protéger des trésors enterrés au-dessous. C’est ainsi qu’ils brisèrent
tous ceux qu’ils purent après les avoir jetés à terre ; ils mutilaient également toutes les statues dès qu’ils
imaginaient qu’elles pouvaient être creuses.
Alexandrie ottomane
Une fois devenus les maîtres, les Turcs suivirent la même politique et il est difficile d’établir si c’est à détruire
tous les vestiges de l’Antiquité qu’ils mirent le plus d’ardeur ou à édifier de nouveaux monuments qu’ils en
mirent le moins ! La véritable raison de cette méchante politique est qu’ils considéraient l’Égypte non pas
comme un État, mais comme un domaine à exploiter, domaine qu’ils risquaient de perdre un jour ou l’autre
et dont il fallait tirer le maximum de profit tant qu’ils en avaient la jouissance.
Mais nous avons tout à fait tort de voir dans les Turcs un peuple borné et de peu de sens car, en fait, ils sont
tout autres ; les choses qui nous poussent à ces conclusions ont des causes que nous ne soupçonnons
même pas et, ces causes une fois établies ce ne sont pas eux qui paraissent stupides mais nous. En effet si
nous prenons pour règle la maxime qui veut que « seules les choses vertueuses sont sages » nous
condamnerons les Turcs, mais ne pourraient-ils pas nous rendre la pareille ? D’autre part, si la course aux
richesses est considérée comme un but louable en soi –et notre propre conduite ne devrait-elle pas nous
pousser à admettre cela ? –ils passeront alors, j’en suis persuadé, pour aussi sages que nous le sommes.
Pour ne pas trop m’éloigner de mon sujet, je dirai qu’ici, dans le port d’Alexandrie, le Grand Seigneur
applique la politique de n’importe quel prince européen puisqu’il impose des taxes sur toutes les
marchandises étrangères. Si ses sujets veulent faire commerce du superflu ils doivent lui payer des droits,
mais il encourage autant qu’il le peut la vente des marchandises locales ; ainsi la balance commerciale
penche toujours en leur faveur ; le puits est ainsi toujours approvisionné en eau, aspirée d’abord par des
éponges de rang inférieur qui sont, à leur tour, pressées dans la citerne sans fond du Trésor Impériale, et
cette richesse prise au peuple sert à l’opprimer. Cela paraîtrait tout à fait incroyable si ce n’était pas chose
commune.
Mais, pour en revenir à la ville, sa splendeur passée n’apparaît que très partiellement dans les beaux
édifices construits en surface car elle fut bâtie sur des voûtes au plan remarquable et d’une merveilleuse
beauté. De même que navigation et agriculture n’auraient pu exister sans les nombreux canaux que j’ai déjà
mentionnés, de même la vie quotidienne exigeait des réserves d’eau très proches, et proportionnées au
nombre d’habitants. Cette eau était fournie par des aqueducs souterrains et ce sont ces mêmes aqueducs
qui la fournissent de nos jours car il n’y a pas une goutte d’eau dans la moderne Alexandrie qui ne soit tirée
des antiques citernes qui se remplissent une fois l’an au moment de la crue du Nil – époque à laquelle l’eau
restant dans ces vastes réservoirs se décompose, rendant l’air que l’on respire malsain et la ville
nauséabonde.
L’ancienne ville d’Alexandrie représentait un carré d’environ une lieue de côté mais ses faubourgs
s’étendaient loin en direction de la tour des Arabes d’une part et de Rosette d’autre part. Elle était entourée
de tous côtés de vergers agréables remplis des fruits les plus délicieux. La ville n’est plus entourée de murs
et s’étend au bord de la mer ; elle avait décliné progressivement et s’était presque transformée en village, il y
a une quarantaine d’années ; mais elle a repris vie depuis et croît de jour en jour, l’expérience ayant appris
aux Turcs que rien ne pouvait leur être plus profitable pour accroître leurs revenus.
Vestiges antiques
Les anciennes constructions sont encore ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville nouvelle, et la plus
intéressante d’entre elles est celle que les chrétiens désignent sous le nom de Palais du Père de sainte
Catherine. Il est situé à peu près au centre de l'espace délimité par les murs actuels ; c'est une colonnade
splendide dont on admire autant les dimensions extraordinaires que le travail ; elle s'étend maintenant sur
500 pieds mais de nombreux piliers sont complètement détruits, quelques-uns sont brisés à mi-hauteur, un
seul est encore entier. On peut également deviner les traces d'une autre rangée de colonnes de part et
d'autre des deux premières de sorte qu'un espace de 500 pieds sur 200 se trouvait ainsi délimité. On pense
qu'au centre se trouvait une fontaine, ce qui permet à certains esprits curieux d'affirmer que là se trouvaient
des bains publics bâtis par les Romains.
En face de ces ruines impressionnantes se dresse une des plus belles églises d’Égypte, dédiée autrefois à
saint Athanase et transformée en mosquée par les Turcs. De l’intérieur nous ne connaissons que ce qui peut
être vu par certains espaces libres au-dessus des portes : tout ce que nous pouvons dire c’est que le toit est
soutenu par quatre rangées de piliers de porphyre de toute beauté. Les églises ou plutôt les chapelles qui
sont aux mains des Chrétiens sont loin d’être extraordinaires.
Quant au port, tout ce qu’il peut avoir de bien, tant pour la sécurité que pour l’harmonie, il le doit à ses
anciens maîtres. À l’heure actuelle, il y a des fortifications turques sur l’île où se trouvait l’antique Pharos.
Les Francs les appellent Farillon. Elles ne sont ni très solides ni très belles, mais répondent assez bien au
besoin qui les a fait édifier. Il y a là deux ports, chacun protégé par une jetée. Celui qui est appelé le Vieux
Port est vaste, commode et sûr, mais seuls les galères et autres vaisseaux turcs peuvent y pénétrer ; l’autre
le nouveau, est loin de posséder les mêmes qualités ; il pourrait pourtant les avoir si les Turcs voulaient y
mettre le prix, mais il ne faut pas y compter.
Les obélisques
À tout cela j’ajouterai seulement quelques détails sur deux autres vestiges de l’Antiquité, l’un situé à
l’intérieur, l’autre à l’extérieur des murs d’Alexandrie. Le premier est l’obélisque, que les Francs appellent
l’Aiguille, et nos marins l’Aiguille de Cléopâtre. Il y en a deux en réalité, l’un est debout, l’autre couché sur le
sol. Celui qui est dressé n’a pas de piédestal et très vraisemblablement une bonne partie est enterrée. Il est
pointu du haut, ses quatre côtés sont couverts d’hiéroglyphes et il est taillé dans une pierre admirable ; la
partie visible doit atteindre 56 pieds de haut. Celui qui est presque enfoui dans le sable est à une dizaine de
mètres environ et lui ressemble tout à fait. J’ai vu ailleurs en Égypte plusieurs de ces aiguilles de pierre et je
pense qu’il y a des ressemblances entre les caractères gravés sur leurs parois, ce qui m’amène à penser
que les anciens rois d’Égypte les avaient fait élever pour apprendre certaines choses à leurs sujets qui
concernaient l’intérêt commun ; car je ne peux concevoir que les Égyptiens aient exposé les mystères de
leur religion sur les grands chemins. Je me trompe peut-être mais l’érudit qui chercherait à me contredire
pourrait bien se tromper aussi ; laissons donc au temps le soin d’éclaircir cela, et aux amateurs d’antiquités
qui prétendent s’y connaître.
La colonne de Pompée
L’autre vestige est la célèbre colonne de Pompée, à environ un demi-mille de la ville, en direction du lac
Maréotis. C’est d’abord la plus belle colonne non seulement d’Égypte mais du monde entier. Il ne
m’appartient pas de dire si le nom qu’on lui donne est justifié ou non. Quelle que soit la date de son érection,
ce fut l’oeuvre d’un très grand architecte puisqu’elle enchante l’oeil de tous ceux qui la contemplent et aucune
critique n’a pu être faite quant à ses proportions bien qu’elles ne correspondent à aucun de nos canons.
Deux ingénieurs français ont mesuré sa hauteur avec beaucoup de soin pendant que j’étais sur place. L’un
affirmait qu’elle avait 94 pieds de haut, l’autre 106. Je pense que tous les deux se trompent, je dirais moi
qu’elle fait 110 pieds en mesures anglaises. Un saltimbanque qui grimpa jusqu’en haut avec une
merveilleuse aisance s’aperçut que le sommet était creux. Il se peut que quelque chose y ait été fixée à
l’origine. Les Turcs ont, selon leur habitude, défoncé ses fondations à la recherche d’un trésor mais sans
succès. Ce genre de monument nous donne la mesure de l’habileté et du talent des Anciens et de leur
supériorité sur nous, car je n’ai jamais entendu dire que quelque chose de semblable soit susceptible d’être
exécuté par un artiste européen. La colonne étant parfaitement lisse, on peut raisonnablement penser
qu’elle a été élevée pour célébrer la mémoire de quelque événements extraordinaire, ce qui rend les érudits
assez sceptiques quant à la justesse du nom qu’on lui a donné ; en effet, à cet égard, il semble lui convenir
assez bien, mais sous d’autres aspects on la ferait remonter plus volontiers à l’époque grecque.
Quant aux habitants d’Alexandrie, je m’interdis d’en parler avant de parler des Égyptiens en général. Je dirai
seulement que nos marins appellent cette ville Scanderani qui est une traduction du nom grec, liberté
d’autant plus acceptable que les Grecs eux-mêmes en usent largement, transformant toujours les noms des
endroits qu’ils découvrent aussi bien dans leurs guerres que dans leurs voyages.
Départ pour Rosette
Nous quittâmes cet endroit célèbre afin de nous rendre à Rosette par voie de terre, notre bagage étant parti
par mer. Nous étions 21 dont le docteur Salviati qui se rendait à Rosette pour ses employeurs. Nous
longeâmes un très grand lac relié à la mer par un canal. Toute cette région étant au niveau de la mer, il
arrive nous dit-on, que celle-ci pénètre avec une violence tout à fait extraordinaire. »
- 497 - 503 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ALBERT JOUVIN DE ROCHEFORT (avant 1676)
Jouvin de Rochefort, A., Le voyageur d’Europe où est le voyage de Turquie qui comprend la Terre Sainte et
l’Égypte, Paris, 1676.
Albert Jouvin de Rochefort est trésorier de France et cartographe.
p. 10-19 :
Alexandrie d’Egypte
« A nostre arrivée nous saluâmes la ville de toute nostre artillerie, & en mesme tems on nous en envoya des
gardes, qui demeurent au vaisseau pendant qu’on dechargeoit les Marchandises, & quelques quaisses
pleines d’argent, qui paya un pour cent, pour le droit du Seigneur ; en suite on nous fit descendre à la
grande Doüane pour nous visiter & voir si nous n’avions rien dans nos valises de contrebande, soit aussi
quelque argent qui nous pût fatiguer à le porter dans un si long voyage, le tout par un motif de charité
turque, d’où plusieurs Marchands François nous conduisirent au fondique de la nation Françoise.
Ce fondique est un grand bâtiment en façon d’un cloistre, où le Vice-Consul & tous les François demeurent,
y ayant autant de fondiques qu’il y a de differentes nations en Alexandrie ; quatre grands corps de logis
renferment une grande cour quarrée avec autant de galleries qui donnent entrée à plusieurs chambres &
aux magazins de marchands de la nation qui y font leur demeure, & qui ne peuvent en sortir si ils ne veulent
encourir un grand danger de leur vie, où du moins de quelque avanie tres-considerable ; c’est pour cela qu’il
y a toûjours quatre Janissaires à la porte à qui le Vice-Consul paye tous les jours à chacun quatre médins,
qui le deffendent contre les insultes qu’on luy pourroit faire à la ville, où ces janissaires le conduisent lors
qu’il veut s’y promener, ou quelqu’un de ce mesme fondique, qui est fermé tous les soirs, & les clefs avec
celle de la porte de la Marine sont portées à l’Aga du chasteau pour remedier au danger dont la Prophetie
les menace d’estre un jour sous la domination des Francs.
La ville d’Alexandrie appellée des Turcs Scandera du mot de Scander, qui veut dire Alexandre son
fondateur, est située en un païs sablonneux & fort gras assez proche de la mer qui y fait une rade
tres-bonne & ses ports tres-assurez, quoy qu’ils ne soient pas des plus profonds, en l’un sont les saïques &
galleres turquesses, & en l’autre toutes sortes de vaisseaux étrangers. On peut faire plusieurs parties
d’Alexandrie, & principalement deux considerables, sçavoir la vieille, & neuve ville ; bien differentes dans
tout ce qu’elle renferment, & de ce qu’elles ont esté autre-fois ; Car Alexandrie qui a esté la plus renommée
Ville de tout l’Univers pour les Empereurs & Roys d’Egypte qui l’ont gouvernée & qui y ont demeurez un si
long-tems, & pour les superbes palais & bastimens magnifiques par leur marbre, & les pieces rares qui
faisoient l’admiration de tous les hommes, n’est plus à présent qu’un amas de pierres & de ruines de tous
ces Palais entre lesquelles on a de la peine à en découvrir quelque chose d’entier, si nous exceptons ses
murailles qui sont en quelques endroits fort belles, estant bâties de grosses pierres, & deffenduës de deux
cens, en deux cens pas, de grosses tours quarrées, larges & distinguées en dedans de belles chambres
capables d’y loger fort commodement ; & en d’autres elles sont presques à demy ensevelies dans les ruines
des bastiments, ainsi que nous l’observâmes tres-bien, lors que nous fismes le tour de cette vieille ville, sous
la conduite d’un Janissaire de nôtre fondique, moyennant huit medins pour une après-disnée, à condition de
nous fournir à chacun un asnes, qui est la monture permise aux Chretiens dans la ville, comme celle d’un
chaval à la campagne.
Bien que ce Maure, nostre conducteur, allât d’un pas fort gaillard nous trouvâmes à nos montres que nous
avions esté plus d’une heure & demie à faire le tour de ces belles murailles, où nous remarquâmes quatre
portes gardées par les Turcs pour y recevoir le droit des entrées des Marchandises qui viennent du Caire, de
Rosette & d’autres lieux. La plus belle est celle de la Marine par où nous entrâmes pour voir proche le
fondique François, deux obelisques de marbre granites couvertes de lettres hyeroglifiques, dont l’une est
haute de 50 pieds, & l’autre est plus grosse, mais elle est renversée & presqu’à demy ensevelie dans les
ruines des bastimens.
C’est chose déplorable lors qu’on se promene dans cette ville d’y voir tant de grands Palais tous ruinez sur
lesquels on a eslevé quelques maisons qui font les rues fort étroites, & mal propres, & où l’on ne voit rien de
beau que quelques fondiques, quelques colomnes de marbre qui ont resisté aux injures du tems, & qui sont
les restes des Palais des Empereurs & des Roys d’Egypte ; ceux du Palais de Cleopatre Reyne d’Egypte
paroissent proche les obelisques, & assez proche le fondique des françois, les ruines de la maison du pere
de sainte Catherine auprès de laquelle il y a une Eglise que les Grecs deservent, où on voit une colomne de
marbre blanc sur laquelle ladite sainte eust la teste tranchée & son corps porté par les Anges au Mont Sinay,
où ces bons PP. la conservent dans une chasse d’argent fort riche, où nous l’avons veu.
Dans cette Eglise de Sainte Catherine il y a une Chapelle pour les François, & une autre pour les Venitiens
où l’on dit la messe toutes les bonnes festes ; Les Coftes ont l’Eglise de saint Marc premier Patriarche
d’Alexandrie, où il a presché fort long-tems ; sa chaire & un tableau de saint Michel fort miraculeux depeint
par saint Luc, sont des choses à voir dans cette Eglise, où le corps de saint Marc qui fut martyrisé en
Alexandrie l’an 64 fut conservé jusques à ce que quelques Marchands Venitiens le transporterent à Venize,
où on le conserve dans une Eglise du mesme nom.
La ville neuve
L’autre partie d’Alexandrie est la ville neuve, qui s’étend du côté de la mer entre le port neuf & le vieil, qui
sont de douze cens pas, dont l’entrée est fermée par un pont qui la rend une isle, au bout de laquelle est le
chasteau fort du Farillon en la place du superbe fanal, qui estoit une des sept merveilles qui deffend l’entrée
du grand port, qui est le port neuf, avec l’autre petit chasteau qui luy est opposé & à l’autre bord du mesme
port où se retirent les gros vaisseaux d’Alexandrie, qui appartiennent à des Marchands qui trafiquent
ordinairement à Constantinople. Sur cette langue de terre isolée est une tour qui est le magazin des
poudres.
Le vieux port, qui sert de retraite aux galeres & aux saïques, est deffendu de deux chasteaux, où il y a
garnison de 80 hommes ; & un peu plus au dessus on void l’arsenal, le grand quay, les bazars, qui sont des
lieux où on vend toutes sortes de belles marchandises, un amas de maisons mal bâties quasi toutes de
terre ; couvertes d’une terrasse & par tas ça & là, distinguées de petites rurës mal faites, qui sont cependant
une assez bonne ville, qui n’est point close de murailles, estant bâtie depuis peu ; & la Doüane où les
marchandises payent le droit d’entrée, qui est si considérable que le Turc qui en fait la recepte, une bourse
par an pour ses peines. Cette bourse veut dire vingt-cinq mille medins, ou six cens piastres.
Ce que nous trouvâmes plus étrange en arrivant en Alexandrie fut le changement d’habits, car il nous falut
d’abord quitter les modes Françoises & prendre le Doliman, la Veste, les Babouches, & le Calpas, par lequel
on distingue un Chretien d’avec un Turc (Nous parlerons des vetements Turcs en leur lieu) ce qui nous
sembla fort embarassant, & ces souliers sans talons fort incommodes à marcher, quoy que cela ne nous
empescha pas d’aller voir ce qui est de plus beau aux environs d’Alexandrie accompagnez de quelques uns
de nos amis. Entre autres choses, la colonne de Pompée de marbre granite, l’une des pieces rares
d’Egypte, qui fut là dressée en l’honneur de César, en memoire de la victoire remportée sur Pompée : Cette
colonne est élevée sur un pied destail de douze pieds de haut, & autant de largeur, qui est de mesme
marbre, en telle sorte que plusieurs ont cru que ce n’estoit qu’une mesme piece avec le chapiteau, qui est
aussi de granite ; mais à la vérité il n’y a que la colonne d’une seule piece haute de soixante pieds & de
diametre sept, qui me fait dire qu’en toute l’Europe où j’ay voyagé je n’en ay point veu de plus haute ni de
plus grosse ; je dirois mesme de plus belle, si je ne craignois d’offenser les Espagnols, qui me
reprocheroient de n’avoir pas bien considéré celle que j’ay veuë dans la place de la Mercy à Grenade en
Espagne.
Le lieu de cette colonne estant élevé, fait qu’on a la veuë agreable sur le port, & d’un autre côté à un demy
mil sur le grand lac Mareotis, qui a cent milles de circuit, estant bordé de quantité de palmiers d’une hauteur
prodigieuse, de carobiers, & cassiers, ce qui fait un tres-beau païsage. Et du côté du midy sur les deserts de
Barca & de saint Maquier, & d’un autre sur la ville, qui n’en est éloignée que de cinq cens pas, en telle sorte
que ce lieu nous parut un des plus remarquables des environs d’Alexandrie.
Nous allâmes à quelques cens pas de là voir l’ancien & superbe palais de Cesar, dont il ne reste plus que
quelques colonnes, & un peu de la façade de ce grand bâtiment, il y a peu de chemin à faire jusqu’au lieu où
est l’entrée du canal du Nil qui en conduit des eaux dans Alexandrie, où il entre par deux conduits sous
terre, qui portent ces eaux par toute la ville dans des sisternes qui sont creusées au dessous de la ville, &
soutenuës de colonnes d’un très-beau marbre ; ce qui a fait dire à quelqu’un qu’en Alexandrie il y avoit deux
villes l’une sur l’autre ; en effet cela est curieux à voir, & d’autant plus remarquable, qu’il faut observer la
saison de faire entrer cette eau dans ces sisternes, & le tems de la boire, estant tres-dangereux d’en user
peu après qu’elle y est conduite, qui est environ au mois d’Aoust, ainsi que nous le dirons en parlant du Nil.
C’est sans doute que l’air d’Alexandrie est mal sain aux Etrangers, principalement à la fin de l’Esté, qui y
cause des fièvres quartes, & autres maladies qui proviennent du lieu bas & du voisinage de la riviere & de la
mer, où Alexandrie a sa situation ; mais en recompense de cela les denrées y sont à si grand marché, que
l’on y donne communément vingt oeufs pour un medin, qui vaut dix-huit deniers ; une poulle, trois medins ;
un mouton vingt medins ; le fruit de toutes sortes, & le poisson de mer & d’eau douce, qu’on y apporte du Nil
& du grand lac Mareotis, quasi pour rien. Il n’y a que le vin qui y est cher, à cause qu’il n’y en croist point &
qu’on l’y apporte de France, de l’Archipel, ou de Cypres.
Gouvernement & Monnoye d’Alexandrie
Le Bacha du Caire l’est aussi d’Alexandrie, où il envoye un Aga pour y commander en sa place, outre lequel
il y a deux sous bachis, l’un pour la ville & l’autre pour la marine ; Le Cadis, qui a sous luy ses Vice-Cadis,
est un Juge de la ville à peu près comme un President dans nos Parlemens. Preque toutes les belles
Charges d’Alexandrie sont tenuës par les Turcs, & la plupart des Marchands sont Juifs, Grecs, Coftes &
quelques François qui ont leur Vice-Consul, qui releve du Consul du Caire, qui sont tous Etrangers, car les
gens du païs, les Maures, sont fort peu entendus dans le trafique, joint la difficulté qu’il y a, & le danger de
transporter leurs denrées par mer à leurs voisins.
Les sequins Turcs, Venitiens, Hongrois & Maltois y ont cours avec les piastres, principalement les
Seviliannes qui y valent quarante medins, & le sequin quatre-vinft-dix medins ou deux piastres & un quart.
Le medin est une petite piece d’argent à peu près comme une piece de quatre sols, qui porte pour marque
quelques lettres Arabes. On bat cette monnoye par toute la Turquie, où elle est la plus commune, & en telle
quantité, que dans toutes les receptes on en reçoit autre monnoye ; & de vray elle est fort commode,
revenant à peu près à dix-huit deniers de nostre monnoye.
On trouve parmy les ruines d’Alexandrie certaines petites pierres en façon de medailles, sur lesquelles sont
représentées des testes, des Idoles, des bestes, & autres semblables, qui servoient de charmes aux anciens
Egyptiens, le tout d’un travail si parfait, que les plus sçavans en gravure & les curieux les acheptent ce que
les Maures qui les vendent leur en demandent ; ces pierres sont fines, y en ayant des émeraudes, grenats,
agates & cornioles.
Ayant demeuré en Alexandrie quinze jours nous en partismes pour aller au Caire & allâmes prendre la
commodité d’une barque à Rosette, qui en part tre-souvent, c’est pourquoy ayant loué des chevaux & un
Janissaire pour nous escorter sur le chemin, nous payâmes à la sortie d’Alexandrie un cafar, qui est un droit
que le grand Seigneur tire des passans sur les chemins : car à dire vray, il n’y a point de païs où il y ait plus
de tyrannie pour les Etrangers qu’en Turquie ; c’est ce qui me fait dire que le Voyageur a besoin icy plus
qu’en aucun lieu du monde, d’argent, & de la patience. Ce cafar estant payé nous entrâmes en un large
chemin, laissant à main gauche quelques palmiers & caroubiers, & deux ou trois hameaux, & à main droite
un grand lac, qui nous conduisit au bord de la mer, & sur une longue chaussée où est le Bouquier b 10 avec
un chasteau qui en deffend la rade, où il y a quelques petites Isles à l’abry desquelles les vaisseaux
Chretiens viennent se ranger. Il y a bonne garnison dans ce chasteau & quantité de gros canons, qui
deffendent non seulement cette rade, mais encore le Bouquier des descentes des Corsaires. »
- 504 - 506 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVAN BATTISTA DE BURGO (1678)
Burgo, G. B. de, Viaggio di cinque anni in Asia, Africa & Europa del Turco, Milan, 1681.537
L’Irlandais Giovan Battista de Burgo (1647-1650) appartient à l’illustre famille des Burgh, comtes de
Clanricarde. Il exerce les fonctions de vicaire apostolique du comté de Clare en Irlande. Après avoir été
persécuté comme catholique sous Charles II, il se réfugie en Italie où il publie sa relation de voyage.538
p. 187-192 (tome I) :
« Descrittione del porto, e Città di Alessandria d’Egitto
Questo è il piu conveniente e piu addattato Porto della Cristianità, al Levante, etiando di Venetia. Nella boca
del Porto vi sono due Castelli, con sua artigliera distesa in terra ; mentre una volta, per ricevere il bassa
d’Egitto, hanno fatto montare l’artigliera sopra la muraglia, la quale collo sbarro del cannone resto rouinata
del tutto. Qui si trova di ogni sorte di mercatantie ; lino in grandissima quantità, che in tutto il mondo non se
ne trova altretanto, per la grande abbondanza e bontà del lino : onde si caricherranno piu di 300 imbarcationi
all’anno di lino solamente.
Viè grande quantità di seta, lana, zafferano per tintura, si come anche zafferano fino : d’ogni sorte di
mercatantia fina, la quale viene (p. 188) dall’Indie alla Mecca, si come anche da Goa e Brasile a Sues, Porto
del mar Rosso. Dlambedue questi luoghi si porta la mercantia al Gran Cairo della Mecca, una volta all’anno
con la gran caravana ; e due volte l’anno a sues, per essere il mare di Goa cattivo da navigare, essendo
costretti alle volte di restare due, o tre mesi gli vascelli in mezzo all mare senza potersi muovere : cosi mi
conto un capitano rinegato in Sues : mi disse pero non esservi pericolo alcuno di perdersi ; ma non si sa la
causa del ritardo : dicono che sia la Remora. In questa città stanno gli ViceConsoli per tutte le Nationi, le
quali trafficano in Egitto ; come sono francesi, Inglesi, Hollandesi, Genovesi e Venetiani : vi trafficano ancora
gli Messinesi e Maiorchini. Gli Consoli tutti vivono nel Gran Cairo, residenza del Bassa e di la mandano le
mercantie per il fiume Nilo a Bicchieri, bocca di esso fiume e per l’alto mare in Alessandria, discosta dalla
Fortezza di Bicchieri sudetta 20 miglia.
Nel Porto, gli Turchi hanno il suo posto appresso il Castello e gli Vascelli Christiani a mano manca del
Turco : vi e ancora un altro Porto, detto il Porto Vecchio, per le imbarcationi piccole degli Mori e Turchi. Qui
si paga l’entrata e uscita ; ma poca cosa.
La Città d’Alessandria sara di 200 case novamente fabbricate fuori della muraglia, al lido del Mare, dove
sono gli Bazzari d’ogni sorte di mercantia.
La città vecchia non consiste al presente (p. 189) in altro, che nel medesimo muro habita il ViceConsole e
torrioni fabbricati da Alessandro Magno 270 anni avanti la venuta di Cristo ; e due Chiese schismatiche una
detta S. Cattarina, dove si mostra la Colonna, sopra la quale fu decapitata la santa. Qui si seppellivano
prima gli Franchi : ma al presente si sono rititati da coloro, per la maladetta loro avaritia conciosiache
volessero tanto del povero, come del ricco : percio si sono aggiunstati con gli Papassi della Chiesa di S.
Marco de Cristiani detti Cofti gli Cattolici si seppelliscono da una parte e gli settarij dall’altra.
La chiesa di S. Atanasio resta in piedi convertita in Moschea & è prigione di Spay e Giannizzeri.
Vi sono piu di 2000 cisterne, le quali si riempiscono dell’acqua del Nilo sottoterra quando viene l’inondatione
dello stesso Nilo, il che acade ordinariamente nella vigilia di S. Gio. Battista ; a cui dopo S. Giorgio portano
gli Mori piu rispetto e divotione : ma in Terra Santa è piu riverito che nessun altro Santo, e lo tengono per
padrone nella città di S. Giovanni, e in tutta la Giudea, sino al fiume Giordano. Fuori della città vi è la Chiesa
di S. Giorgio, parimente degli Greci schismatici : e fuori della Porta di Rosetti si truova quella famosissima
Colonna di Pompeo ; nè si vede cosa piu stuporosa in tutto il Levante, eccetto le Piramidi appresso al Gran
Cairo, le quali sono descritte piu a basso. Non si sa di qual materia sia fatta : questa è distante della Porta
della città un buon mezzo miglio, (p. 190) & un tiro di carabina da quel fomuoso Palazzo di Cleopatra di cui
non resta altro in piedi che le rouine.
La sudetta colonna è cotanto grossa, che sei persone, dandosi le mani non la possono stringere : la
lunghezza è tanta, che a gran stento si arriva con la vista alla cima : ella è fabbricata a modo di Piramide, nè
mai col ferro si è potuto levare la minima cosa : gli Mori dicono, che sia fatta di pasta, per arte magica, piu
dura che il Diamente. Due miglia fuori de la città al settentrione, si vede il fiume Calessi, il quale non si stima
bocca del Nilo, per non essere navigabile : a un mezzo miglio fuori della città dalla parte del Porto Vecchio,
si mostrano le Mumie assai inferiori a quelle del Campo Sahid, 35 miglia dal Gran Cairo lontano, sicome
vedra il Lettore in questo libro.
La Sinagoga, e cimeterio degli Hebrei è fuori della città : e morto uno di loro, lo imbarcano per mare verso il
ponente, accompagnato dalla Natione in diverse barchette.
Dentro la città, vi è un Palazzo vecchio di Cleopatra con bellissime colonne di marmo ; sicome anche si vede
quel gran Palazzo del Prencipe Zelebi, padre della gloriosa vergine e martire S. Cattarina con bellisime
colonne di marmo fino ; delle quali Amurat IV, avo del regnante Mahomet IV, ne diede quatro al Prete Giani
Imperadore degli Abissini e Re di Etiopa.
Mando Caraskan Catzu padre del regnante Prete Giani 400 huomini per pigliare le dette (p. 191) colonne ;
gli quali per miracolo della Santa restarono mostri tutti, & altretanti mandati da Amurat : con che restano
hoggi giorno in piedi poco discoste dal Palazzo e nessun Turco ardisce toccarle.
Nella città vecchia si truova il fondaco degli Venetiani, dove habita il ViceConsole & un padre & un laico di
Terra Santa. Poco discosto, si truova il fondaco d’inghilterra, e Hollanda, & in mezzo due Bazari, cioè
mercati, e botteghe fatte nelle rouine delle case : di notte vanno alle loro case gli mercanti Turchi, e Mori,
serrando gli due Capi delle contrade, con que restano serrati dentro gli Cristiani. Il console delle due nationi
d’Inghilterra, & Hollanda è un Cavaliere Messinese, chiamato Sig. Gasparo Arezzi, Biscaino di
descendenza : da quattro anni si ritruova in Levante : si veste di porpora, sicome fanno tutti gli Consoli. Parla
perfettamente Turchesco, Moro, e Greco volgare : la sua famiglia in Biscaia è chiamata Orezzi : hà sotto di
le due mercanti Inglesi ; uno Thomas Giffard nato Cattolico, l’altro Protestante Onofrio Blorror. Dentro la città
si vedono le rouine di quel gran Palazzo d’Arminda Maga : restavano ancora in piedi del detto Palazzo due
bellisime colonne, della medema fattura di quelle di S. Gio. Laterano di Roma, con la scrittura Geroglifica ; le
cui lettere sono Bestie, Uccelli, Pesci, & altre cosetali ; e vi sono tra coloro alcuni, gli quali sanno leggere
detti caraterri.
Il fondaco della natione Francese, è nella (p. 192) città nuova : gli costo sei mila crosoni : fu un Serraglio
lasciato da un divoto Turco, per dare da bere agli cani : questa natione hà la sua Capella, e Capellano a
parte.
L’Agà del Datio di questa città in tempo dell’ Autore era un Cavagliere Francese fatto Turco : suo padre è
Cavaglierizzo del Rè di Francia : hebbe l’Autore alcune volte occasioni di parlarli per il Datio, che fanno
pagare per gli danari, sicome vedrete piu a basso, egli mi ascoltava mentre parlano Francese, ma mi
rispondetta per via d’un Hebrero suo dragomano : D’Alessandria a Rossetti sono 35 miglia per terra e 60 per
acqua : bisognarà pigliare un Arabo, o due a cavallo per icorta : questi portano un baraccanino, che
chiamano, a foggia degli Cingari : corrono velocissimi e accompagnano sino ad un braccio di mare chiamato
l’Amadea, dove s’imbarca per spatio d’un tiro di sasso : è la si truova un canserraglio ; e mangiare quello che
portate : nè là si truova altro, che la coperta ; prima d’imbarcarsi, si paga agli Arabi poca cosa cioè due
Maidini per testa, che valetanno due soldi Francesi : di là si passa il medesimo giorno a Rossetti : e da per
tutto si truovano boschi grandissimi di Palme. »
537 Il existe une édition plus récente : G. Battista da Burgo, Viaggio di Cinque Anni in Asia, Africa e Europa
del Turco, Milano 1689, par G. Cossuto, Istanbul, 2003.
538 Passano, G. B., I novellieri italiani in prosa, Turin, 1878, p. 214.
- 507 - 508 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ELLIS VERYARD (1678)
Veryard, E., et al., Voyages en Égypte pendant les années 1678-1701, E. Veryard, J. Pitts, J. Ovington,
R. Huntington, Ch.-J. Poncet, W. Daniel, par O. V. Volkoff, Ifao, Le Caire, 1981.
p. [3]-[11] :
« Alexandrie a emprunté son nom à son fondateur, Alexandre le Grand, dont on dit qu’il l’a construite en
forme de chlamyde macédonienne, vêtement militaire avec plis et replis. C’était la capitale de l’Egypte dont
la splendeur et la magnificence étaient à peine inférieures à celles de la Rome antique, bien que, en vérité, il
n’en reste, à part son nom, que quelques misérables traces de son ancienne grandeur. Elle est
agréablement située dans une plaine. Les vieilles murailles doubles flanquées de tours sont encore debout,
mais la cité à l’intérieur est considérablement délabrée et la plupart de ses palais somptueux sont
entièrement ruinés. On dit que les murailles et les portes sont les mêmes que celles qui furent construites
par Alexandre ; toutefois les inscriptions coptes et arabes témoignent qu’elles sont l’oeuvre de plusieurs
califes. Dans l’église Ste Catherine, nous vîmes un pilier de marbre sur lequel, dit-on, la main (sic) de la
sainte fut tranchée. Dans l’ancienne église Saint Marc, desservie par les Coptes, on nous a montré la
célèbre chaire où, dit-on, St. Marc, St. Athanase et Origène ont prêché ; elle est tenue en grande vénération
par les chrétiens de ces contrées. De même, on nous a montré une image de St. Michel l’Archange que
Saint Luc aurait faite. Nous avons également vu les ruines du palais du père de Ste. Catherine, ainsi que
quelques piliers de marbre et des obélisques, encore entiers, gravés de hiéroglyphes. La cité, pour autant
que nous pûmes en juger, doit avoir une longueur de 8 milles, mais en divers endroits, elle est très étroite.
Les principaux monuments antiques que nous avons remarqués à l’extérieur des murs de la ville sont 1°) les
ruines de l’imposant palais de l’infortunée Cléopâtre. 2°) la colonne de Pompée élevée par Jules César [en
mémoire de] la défaite [de Pompée]. 3°) les grottes appelées Suk, situées un peu à l’extérieur de la porte
Issidir, où nous sommes descendus, par quelques marches, dans un long vestibule. Là, nous avons trouvé
quinze entrées (huit d’un côté, sept de l’autre) donnant sur autant de chambres taillées dans le roc. Sur tous
les côtés, nous avons vu des rangées de Loculi ou niches creusées dans la paroi, de bas en haut,
semblables à celles des catacombes de Rome et d’une dimension suffisante pour y recevoir le corps d’un
homme de la plus grande taille. Mais elles étaient toutes vides. Ceux qui passent pour être érudits chez les
Coptes, croient qu’elles ont été le refuge des premiers chrétiens durant la première persécution des
empereurs romains ; ils y tenaient leurs assemblées en secret et s’y cachaient aussi souvent que les
circonstances le réclamaient. Mais je suis tenté de croire que c’était le lieu de sépulture des Anciens
Egyptiens qui avaient coutume d’embaumer les corps et de les conserver dans des grottes ou cavernes
semblables que l’on trouve dans toutes les régions du royaume.
Les citernes, grâce auxquelles la cité est approvisionnée en eau, sont remplies au moyen d’un canal qui
amène l’eau du Nil au moment de l’inondation. Lors de l’ouverture du canal (qui a lieu le troisième jour après
le début de l’inondation) des milliers de personnes de toutes les classes et de tout âge s’assemblent là en
grande cérémonie pour assister, à l’ouverture, avec de la musique, des danses, des chants et tous les
témoignages habituels d’une joie universelle. Cette eau se conserve bien, sans la moindre putréfaction ou
altération ; ceci est dû aux particules mitreuses qu’elle contient, comme en témoigne le goût salé de celle qui
est contenue dans les citernes. L’eau du Nil elle-même, bien qu’apparemment douce et sans la moindre
trace de produit salin, est néanmoins merveilleusement imprégnée de ce même sel, comme en témoigne
l’immense quantité qui en est produite tous les ans, au moment de l’inondation. L’eau est amenée du canal
dans certains réceptacles ; le soleil en fait évaporer une partie, le sel y est précipité en quatre ou cinq jours ;
séché par le soleil, il devient très blanc et a le parfum et le goût de la violette. Le sel est plus perceptible [au
goût] dans l’eau de la citerne que dans celle du fleuve, du fait de l’évaporation dans le cas de l’eau
dormante, qui libère les particules de sel, lesquelles agissent plus intensément sur l’organe [du goût]. C’est
le natron des Anciens qu’ils s’efforcèrent également d’obtenir des eaux du Lac Sabaca, anciennement Lac
Mareotis, lequel ne s’assèche pas après le repli des eaux. Mais le sel y est apporté au début de l’inondation
et qui, en se déposant, se putréfie et infecte les eaux du Lac. Divers auteurs prétendent que l’eau contenue
dans les citernes fermente lors de la tombée de la rosée qui précède l’inondation, mais je n’ai pu ni voir, ni
entendre parler d’un tel phénomène. Le port pour bateaux est en forme de demi-lune, avec un château à
chaque extrémité pour sa défense. »
- 509 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ALESSANDRO PINI (du 9 mars au 16 mars 1681)
Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 429-615.
Alessandro Pini (1653/1717) obtient le grade de docteur en philosophie et médecine à l’Université de Pise.
En 1681, par l’intercession de Francesco Redi (médecin, biologiste et poète, 1626-1697), il est chargé par le
Grand Duc de Florence d’une mission scientifique et surtout politique qui le conduit au Caire, Jérusalem et
Alep du 22 mars au 29 décembre 1681. Lors de son voyage, Alessandro Pini écrit plusieurs lettres à Redi
dont une où il décrit la ville d’Alexandrie.539
p. 490 :
Il Cairo, li 27 marzo 1681
« Partitomi di Livorno il 22 di febbraio, sabato, arrivai in poco piu di 15 giorni in Alessandria, essendo entrato
in porto la domenica sera dei 9 marzo. Grandissime cortesie ho ricevuto quivi dalli Ebrei. Dai Francesi
ancora, per non vi si ritrovare altri Italiani che il console di Venezia, che è uomo da non si poter praticare. Ho
visto le anticaglie di quella città. Il tutto ho notato puntualmente come V. S. vedrà a suo tempo.
D’Alessandria partitomi il di 16 marzo per germa arrivai con buon viaggio al Cairo sabato sera dei 22 non
avendo consumato in far 200 miglia altro che casi 3 giorni, dove in 35 ne aveva spesi 3. »
539 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 489-490.
- 510 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CORNEILLE LE BRUYN (du 8 juin au 9 juillet 1681)
Le Bruyn, C., Voyage au Levant, c'est-à-dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les îles de
Chio, de Rhodes, de Chypre, etc. de même que dans les plus considérables villes d'Egypte, de Syrie et de la
Terre-Sainte, enrichi de plus de Deux cens Tailles-douces. Le tout dessiné d'après nature par Corneille Le
Brun, Paris, 1714.
Corneille Le Bruyn, originaire des Flandres, naît à la Haye en 1652. Il est avant tout peintre de paysage, sa
relation de voyage est à ce propos « artistement illustré ». Il meurt à Utrecht vers 1726.540
p. 241-245 :
« Description de la Ville d’Alexandrie & de ce qui est aux environs
Avant que de venir à la description de la ville d’Alexandrie, j’ai envie de donner au Lecteur celle de la
Colonne de Pompée, qui est une piéce qui apres tant de siecles ecoulez, ne laisse pas d’etre encore debout.
Cette Colonne qu’on croit qui a été elevée par Jules Cesar pour etre un monument de la victoire qu’il
remporta sur Pompée, est à deux cens pas de la ville sur une hauteur ou un côteau. Le 12 de Juin j’allai
accompagné d’un Janissaire et d’un Drogueman, voir cette piece d’Antiquité, & en prendre le dessein. Je fis
la même chose de la ville dans cet endroit là méme, & je l’achevai quelques jours apres. Elle paroit telle
qu’on la voit N° 96.
Pour ce qui est de la Colonne, elle est sur un Pied-d’estal quarré haut de sept ou huit pieds & large de
quatorze à chacune de ses faces. Ce pied-d’estal est posé sur une base quarrée haute d’environ un demi
pied, & large de vingt, faite de plusieurs pierres massonées ensemble. Le Corps de la Colonne méme n’est
que d’une seule pierre, que quelques uns croient étre de Granit, & d’autres, que c’est une espece de pâte ou
de ciment qui avec le temps a pris la forme de pierre. Pour moi je croi que c’est une vraye pierre de taille, du
moins autant que j’ai pû le reconnoitre par l’épreuve que j’en ai faite. Et si cela est vrai, comme personne
presque n’en doute, il y a sujet de s’étonner comment on a pu dresser une pierre de cette grandeur ; Car
apres l’avoir mesurée j’ai trouvé qu’elle a quatre vingt dix pieds de haut, & que sa grosseur est telle que six
hommes peuvent à peine l’embrasser, ce qui revient selon la mesure que j’en ai prise, à trente huit pieds. Au
haut il y a un beau chapiteau proportionné à la grosseur de la Colonne, mais fait d’une piece séparée.
Pendant que j’etois occupé à dessiner la ville, il vint une Caravane s’arréter au lieu où j’etois & y dresser ses
Tentes, de la maniére que cela est représenté dans la figure. Aussi tôt quelques Arabes commencerent à
s’en séparer pour aller voir la Colonne, & regardant en méme temps ce que je faisois (car il n’est pas
nécessaire de rien faire ici secretement, parce que c’est un lieu tout ruiné & au sujet duquel les Turcs n’ont
aucune deffiance) l’un de la troupe qui me regardoit & qui consideroit attentivement mon ouvrage, demanda
aux autres s’ils comprenoient bien ce que je faisois, & comme tous lui répondoient que non, il leur dit en
portant son doigt à son front, qu’il falloit que je fusse un homme d’un grand esprit, parce que j’etois occupé à
faire quelques caracteres par le moien desquels je pusse découvrir les trésors qui étoient cachez sous ces
ruines pour les enlever lors que j’en trouverois une occasion favorable. Dès que ces Arabes se furent retirez
je demandai au Drogueman quelle pensée ils avoient euë de moi, & quand il me l’eut dit je lui répondis que
j’etois fâché de ce qu’ils ne s’entendoient pas mieux à deviner.
Un jour ou deux heures apres je dessinai une vuë de dedans la ville, elle représente une entrée d’Alexandrie
par à côté, par une bréche d’un pan de muraille & de quelques Tours qui sont tombées, cela se voit N° 97.
on voit de là la pleine Mer avec les deux Chateaux qui en gardent l’entrée, l’un à main droite & l’autre à main
gauche ; Cela est marqué aux Lettres A. B. Ces deux Châteaux sont placez si juste l’un à l’opposite de
l’autre, que, comme on me l’a dit, lors qu’ils tirent ensemble, les boulets se rencontrent quelque fois & se
brisent en pieces l’un contre l’autre.
L’on voit aussi de cet endroit les restes d’un Palais de Cléopatre qui étoit au bord de la Mer ; on juge par les
morceaux qui en sont demeurez, & par quelques restes de chambres & d’appartemens, que ça été un
bâtiment fort superbe & magnifique. Il est marqué de la lettre C.
Assez prés de ce Palais il y a un Obélisque tout rempli de Caracteres Hieroglyphiques ; ou le voit représenté
N° 98. du côté que je me donnai la peine de le dessiner avec toutes ses figures, telles qu’elles paroissent
sur l’Obelisque. Il y en a seulement deux ou trois qui ne sont pas bien marquées, ce qui vient sans doute de
ce qu’elles ont été usées par la longue suite du temps. Quoi qu’il en soit je les ai représentées telles que ja
les ai trouvées : Car comme je ne sçavois pas ce que ces Caracteres signifoient, je n’y ai rien voulu changer,
non plus que dans tout le reste, & j’en laisse l’explication à ceux qui s’y entendent, supposé qu’on la puisse
trouver. Plusieurs s’étonneront sans doute de ce que les figures du haut sont si grosses, & qu’elles se voient
aussi distinctement que celles du bas : Mais comme elles servoient autre fois d’ecriture, on les aura sans
doute fait plus grosses à proportion de la hauteur, afin qu’on les pût lire aussi facilement. Quoy que je n’aye
representé qu’un côté de l’Obelisque, il ne faut pas s’imaginer que les trois autres soient unis : ils sont tous
marquez de caracteres & de figures extraodinaires, & je suis fâché d’avoir à me reprocher de ce que ma
négligence en a frustré le Lecteur.
Aupres de cet Obelisque on en voit un autre de la méme forme, & sans doute aura été de la même hauteur ;
Mais il est renversé à terre, & l’on n’en sçauroit reconnoitre qu’environ la longueur de dix pieds, le reste est
pour la plus part enfoncé en terre. La pierre dont sont faites ces deux Aiguilles ressemble beaucoup à celle
de la Colonne de Pompée.
Pour mieux représenter le Palais de Cléopatre, je le dessinai de dessus une Tour ruinée qui est aupres, & je
le peignis tel qu’il paroît de là renversé en partie dans la Mer, avec beaucoup de differens morceaux de
Colonnes &c. comme on le voit N° 99. où l’on voit aussi l’aiguille dont nous venons de parler avec une des
Collines qui sont dans la ville ; où il y en a deux qui s’y sont faites des ruines & des masures entassées les
unes sur les autres.
Les Murailles de cette ville sont admirables, & elles paroissent encore si superbes, quoi qu’elles soient en
grande partie ruinées, qu’il n’y en a point au monde qui leur soient comparables.
Les grosses tours quarrées qui y ont été bâties pour les deffendre, & qui sont à la distance de deux cens pas
les unes des autres, ne causent pas moins d’admiration. Mais si ce qu’on en voit par dehors attire les
regards des spectateurs, le dedans n’est pas moins digne de leur curiosité. Je suis entré dans quelques
unes, & j’ai remarqué qu’elles sont toutes bâties d’une manière differente. C’est ce qui m’a obligé d’en
donner trois représentations, telles qu’on les peut voir N° 100. 101. & 102. Elles ont communement deux
voutes l’une sur l’autre chacune soutenuë par quelques Colonnes qui sont elevées au milieu. Ces Tours,
quoique d’une structure differente dans leur divers appartemens, ont pourtant cette conformité, qu’elles ont
chacune un puits ou Citerne comme j’en ai représenté un elevé au dessus de terre N° 100. à côté droit au
bout d’un pan de muraille qui est rompu.
Dans la derniere que j’allai voir & que j’ai representée N° 102. je trouvai la colonne au milieu d’une quantité
de pieces comme autant de trenches rondes mises les unes sur les autres, autour desquelles il y avoit un
degré à limace où l’on voit encore quelques degrez qui sont demeurez.
Chacune de ses Tours qui avoient au haut une plate forme de plus de vint pas en tous sens, pouvoit
contenir un nombre considerable de personnes armées, & sans doute qu’autrefois la ville pouvoit par ce
moien faire une grande resistance. Car les murailles de ces Tours ont plusieurs pieds d’epaisseur, & il y
avoit tout au tour des embrasures larges par dedans, mais qui alloient en etrecissant par dehors, comme on
le voit dans une que nous avons marquée dans la figure 101. C’est dommage qu’on entretienne pas ces
ouvrages, car sans doute que tant de Tours qui environnent la ville doivent avoir été autant de boulevarts.
Je n’ai jamais vu nulle part de plus belles ruines, car on y en rencontre de tous les côtez, & l’on ne sçauroit
presque se tourner que la vuë ne soit toujours frappée de quelque nouvel objet. On peut juger par les deux
que nous donnons N° 103. & 104. de la beauté de tout le reste.
Pour ce qui regarde l’etat present de la ville d’Alexandrie elle est par dedans presque toute ruinée & sans
bâtimens n’ayant que quelque peu de maisons qui sont habitées. On y voit encore l’Eglise de St. Marc qui
est possedée par les Chrêtiens Cophtes. C’a été autre fois une fort grande Eglise, mais aujourd’hui ce n’est
pour ainsi dire, qu’une petite Chapelle ronde. On y montre encore quelques degrez & une partie de la Chaire
où l’on pretend que St. Marc a prêché. Elle est encore presque dans sa rondeur, & par dehors elle est
revétuë de pierres de diverses couleurs. On voit aussi dans cette Eglise un morceau d’un tableau qu’on
pretend qui a été peint par S. Luc, il represente S. Michel l’Archange ; ce n’est qu’une figure un peu plus
qu’a demi corps, avec une epée à la main, tout à fait à l’antique, il n’y paroit aucun art, comme on le peut
juger par la figure qui est N° 105. Sans parler du ménagement des couleurs où il y a trop de bigarreure.
Outre ce Tableau dont on ne seroit aucun cas sans l’honneur qu’on lui a fait de dire qu’il a été peint par
S. Luc l’Evangeliste, on montre un morceau d’Autel qui est asseurement de meilleur goût & qui y a été
apporté d’Europe il y a quelques années par un Consul François. Il represente la Vierge Marie avec notre
Seigneur. Le corps de S. Marc premier Patriarche d’Alexandrie qui y a souffert le martyre l’an 46. de la
naissance de Jesus Christ, a reposé dans cette Eglise jusqu’au tems que quelques marchans Venitiens
revenant de la Terre Ste. le transporterent à Venise.
On me mena aussi dans l’Eglise de Ste Catherine où l’on garde encore la Colonne où on lui coupa la tête. J’y
vis plusieurs peintures, & entre autres il y en avoit quelques unes qui étoient assez bien faites.
Je dessinai aussi ici un More Arabe, pour faire voir l’instrument dont ils jouent, cela se fait avec un morceau
de cuir qu’ils ont entre les doigts, avec lequel ils raclent les cordes. Cela est représenté N° 106.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville ou pour mieux dire dessous, ce sont les Cisternes qui y sont
en si grande quantité que presque toute la ville d’Alexandrie est sur des Colonnes sur lesquelles aussi est
posée la voute qui lui sert de fondemens. Ces Cisternes sont remplies par le moien d’un Canal qui est hors
de la Porte de Rozette, & qui environ à un quart de lieuë de la ville reçoit son eau de Khalits de Cléopatre
qui la conduit là dans le temps du débordement du Nil. On ne boit point d’autre eau à Alexandrie, & c’est
pour cela que ces Cisternes qui ont communication avec ce Canal par une invention fort spirituelle, sont
d’une grande necessité à cette ville.
On compte six Portes à Alexandrie, mais il n’y en a que trois qui servent, les trois autres sont fermées.
Les Trois Ports qui y sont la rendent encore considérable ; Mais le premier qu’on nomme le Port vieux & qui
est médiocrement grand, n’est gueres frequenté, parce que les Vaisseaux ont trop de peine à y entrer. Ce
port est muni des deux côtez d’un Fort où il y a toujours une bonne garnison pour empécher les vaisseaux
ennemis d’en approcher. Les deux autres Ports sont un peu plus hauts, l’un au côté droit, & l’autre au côté
gauche d’une petite Isle qui en fait la séparation. Cette petite Isle étoit autrefois plus loin de la Terre ferme à
laquelle elle est à present jointe par un pont de quelques arches, & on l’appeloit en ce temps là pharos ou le
Fanal. Elle est assez avant dans la Mer & elle sert au Grand Seigneur de Magasin à Poudre, qui est est
gardée dans une grosse Tour quarrée qui est au milieu de l’Isle. A l’un des bouts on voit encore un Château
qui porte le nom de Phare (les François l’appellent Farillon) qu’on prétend être bâti au même endroit ou l’on
voioit ce fameux Phare, qui étoit une des sept Merveilles du monde. De ces deux Ports qui sont séparez par
l’Isle, le premier qui est le plus seur ; ne sert pourtant que pour les Galeres, parce qu’il n’a pas assez de
profondeur, l’autre qu’on appelle le nouveau Port, qui est bien plus grand & plus profond, sert aux grands
vaisseaux, qui s’y retirent, & qui y sont deffendus par le Fort que nous avons dit, & encore par un autre plus
petit qui est de l’autre côté.
Sur le bord du grand Port est la Douane, aupres de laquelle il y a encore quelques autres maisons. Cette
Douane est affermée par le Grand Seigneur à des gens qui lui en font une grosse somme, parce qu’il y a
continuellement des vaisseaux qui abordent à Alexandrie & qui en partent. Pendant que j’y étois il y arriva le
17. de Juin un vaisseau Marchand Anglois, le 18. cinq Galeres de Constantinople, le 19. un vaisseau
Anglois en partit pour Ligourne. Le 23. il arriva un vaisseau François de Marseille, le 26. encore un
François : le 27. deux vaisseaux de France ; le 30. une barque du même lieu, & il en partit aussi un vaisseau
Anglois &c. Chaque Nation y a ordinairement son vice-Consul : De mon temps c’etoit un Messinois qui faisoit
les affaires des Anglois & des Hollandois. Les François y avoient aussi le leur, de même que la République
de Venise.
Hors de la ville il y a quantité de Grottes & de Caves sous terre, qui peut-être ont été pour la plus part des
lieux à enterrer les morts.
Avant que de quitter Alexandrie il faut que j’ajoute ce mot, que le 6. de Juin au matin l’Aga m’envoia querir
pour servir de Truchement à un Flamand, mais lors que j’arrivai on me dit que l’affaire étoit déjà reiglée. Je
n’ai jamais pû sçavoir qui étoit celui pour qui l’on vouloit se servir de moi. »
540 Carré, J.-M., Voyageurs et écrivains français en Égypte, t. I, Ifao, Le Caire, 1956, p. 66.
Bruwier, M.-C., Présence de l’Égypte, Namur, 1994, p. 93.
- 511 - 513 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
EVLIYĀ ÇELEBĪ (1672)
B. DERVĪŠ MEḤMED ẒILLĪ
Evliyā Çelebī, D’Alexandrie à Rosette d’après la relation de voyage d’Evliyā Çelebī, Institut Français
d’Études Anatoliennes, traduit par J.-L. Bacqué-Grammont et R. Dankoff, janvier 2001 (version
polygraphiée).
Evliyā Çelebī541 naît en 1611 à Istanbul. Son nom est inconnu, Evliyā est un pseudonyme qu’il adopte par
vénération pour son maître, l’imam de la cour, Evliyā Meḥmed Efendi. Il fréquente pendant onze ans l’école
coranique où il reçoit une formation de récitateur de Coran. Il reçoit également une formation dans le
domaine de la calligraphie, de la musique et de la grammaire arabe. Pendant une période de quarante et un
ans (de 1640 à sa mort), il entame une série de longs voyages dans l’empire ottoman qu’il entreprend aussi
bien à titre privé qu’officiel. Le titre de son ouvrage, qui compte dix parties, s’intitule Seyāḥatnāme (Livre de
voyage). Le tome X concerne l’Égypte où Evliyā semble avoir séjourné pendant une dizaine d’années entre
1670 et 1682. Il meurt en 1684.542
Remarque : texte incomplet.543
« LXIV. DESCRIPTION DE L’ANTIQUE CITE ET DE LA DEMEURE ANCIENNE, LA SOLIDE PLACE FORTE ET LA MURAILLE
PUISSANTE COMME CELLE D’ALEXANDRE, LA FORTERESSE D’ALEXANDRIE SEMBLABLE AU JOYAU ENCHASSE DANS LA
BAGUE.
1. C’est une antique cité de vaste construction. Plusieurs milliers de chroniqueurs ont écrit la description de
cette forteresse d’Alexandrie, muraille semblable à celle de Magog. Mais les plus dignes de crédit entre
toutes sont les chroniques de Coptes (d’après lesquelles,) après la chute d’Adam sur la terre, le calame fut
donné à Monseigneur Enoch. Depuis lors et jusqu’à nos jours, le peuple copte n’a cessé de noter tous les
événements au jour le jour. Quant aux mécréants, en aucun temps fausseté ni obscurcissement
n’émanèrent d’eux, c’est pourquoi leurs chroniques sont estimées (chez les gens de) toutes les religions.
Comme le calife Me’mun, de la dynastie des Abbassides, avait quelque penchant pour les chroniques, il vint
au Caire, fit ouvrir les Pyramides, mit au jour plusieurs milliers d’ouvrages d’Enoch et de Daniel, et les
traduisit en langue arabe. Il traduisit aussi plusieurs centaines de chroniques coptes de la langue copte et en
arabe.
2. Selon ce que disent ces chroniques, celui qui, à l’origine, (construisit) cette Alexandrie après le Déluge fut
Bayzar, fils de Cham qui était le frère de Sem. Ce Bayzar se détourna des autres enfants du prophète Noé,
pria, eut des descendants, devint maître de l’Egypte, bâtit Alexandrie et prit Menuf pour capitale.
3. En ce siècle-là, le nom de la ville d’Alexandrie était Rukuda. Actuellement, en pays allemand, on appelle
Alexandrie Rukuda. Mais, en langue grecque ancienne, on l’appelle Aleksandire. Comme tout le peuple
copte descend (de Bayzar), on appelle celui-ci « le Père des Coptes ».
4. Il eut trente enfants, Son fils aîné était Misra’im qui était maître (de tout le pays), depuis Aris jusqu’à
Assouan du Soudan. Par la suite, son père Bayzar fils de Cham mourut et on l’enterra dans les
Deux-Sacrées, auprès du roi Hürmüs qui était mort avant le Déluge.
5. Ce fut Bayzar fils de Cham qui fut le premier enterré en Egypte après le Déluge. Ensuite, son fils Misra’im
devint empereur en toute indépendance. Il appréciait le climat d’Alexandrie que son père avait construite, et
il rendit celle-ci très prospère.
6. À l’époque où Zülka fille de Me’mun était reine de l’Égypte, le peuple des Amalécites apparut et se rendit
maître de l’Egypte. C’étaient des descendants de Cham. Leurs rois étaient des enfants de l’impureté. Ils
ravagèrent le royaume des Coptes, construisirent et agrandirent Alexandrie. Comme le peuple des
Amalécites était composé d’hommes de grande taille, ce furent eux qui la construisirent avec les grands
blocs de pierre qui se trouvent à Alexandrie.
7. Celui qui la construisit ensuite fut Ya’mur fils de Seddad qui répara avec des blocs de pierre d’une
effrayante énormité ce qu’on appelle le bâtiment de Seddad. Ensuite, après le Prophète Salomon, Carud le
Renversé construisit, à l’intérieur et à l’extérieur de la ville d’Alexandrie, des oeuvres entièrement ornées de
colonnes faites avec un art accompli et qui sont des exemples admonitifs. Les vestiges que l’on voit à
présent sont ses oeuvres. Vingt années avant le Pharaon de Moïse, la reine nommée Delüke fille de Zibak
régnait sur l’Egypte et avait fait de Munuf sa capitale. Pour jouir du climat, elle aussi fit rebâtir cette
Alexandrie au point qu’en mer, d’une distance de cent mil, les yeux des spectateurs étaient frappés de
stupeur devant ses bâtiments dorés.
8. D’après ce que dit le chroniqueur universel Mehemmed fils d’Ishak, huit cent quatre-vingt-deux années
avant la naissance de Monseigneur le Refuge de la Révélation, Alexandre le Grand agrandit extrêmement
cette forteresse par rapport à son état précédent, lui donna prospérité et ornements, et y produisit merveilles
et marques talismaniques au point que, sur le visage de la terre, jamais une grande ville comparable n’avait
été construite. Toutes les langues des nations venaient la contempler.
9. Celui qui la construisit était Alexandre le Bicornu qui, par sa généalogie, était fils de Rumi, fils de Nabati,
fils de Na’iman, fils de Tarac, fils de Japhet, fils de Noé – sur lui soit le salut ! Selon une autre version, il était
Alexandre fils de Darab, fils de Behmen, fils d’Isfendiyar. Dieu est Omniscient !
10. Monseigneur Hizir –sur lui soit le salut !– faisait partie des troupes de cet Alexandre le Bicornu qu’il
accompagna jusqu’à la muraille de Magog. Ensuite, à l’endroit où, à proximité de cette Alexandrie, le Nil béni
se jette dans la Méditerranée, Monseigneur Hizir et Monseigneur Moïse devinrent compagnons de route.
Ensuite, ce verset de vénérable noblesse atteste du fait qu’ils se séparèrent : « Il dit : « Ceci (marque la)
séparation entre toi et moi. Toutefois, je vais te faire connaître l’explication de ce dont tu n’as pas eu la
patience (de découvrir la cause.) » Dans leurs commentaires de ce verset, tous les commentateurs ont écrit
leur histoire de manière détaillée. À présent, l’endroit où Monseigneur Hizir et Monseigneur Moïse se sont
séparés s’appelle la Prairie des Deux-Mers (Mercu-l-bahreyn). C’est le détroit du port de Rosette où le Nil
béni se jette dans la mer. Par voie de terre, il y a douze heures de route jusqu’à Alexandrie, et (---) mil par
voie de mer.
11. Mais, au sujet de cet Alexandre, le peuple grec, c’est-à-dire la gent des Roméïques, dit : « C’était notre
empereur. Il vécut mille ans, ou selon une autre version, six cents ans. Il régnait du Kaf au Kaf et construisit
la muraille de Magog. C’est un prophète. » Il était le fils du roi Merzibe qui était un descendant de Japhet.
Son nom est Merziba et son surnom Alexandre. Selon une autre version, on appelle cette (ville) Alexandrie
parce que, cent vingt années après que Nabuchodonosor détruisit la ville de Menuf, Alexandre fils de Filïs, le
Mahzuni la construisit avec les biens des butins faits en Perse.
12. Mais, de cette manière, il y a quatre Alexandre le Grec. Cela est cause de nombreuses controverses, car
tous les quatre ont bâti cette Alexandrie. À présent, les dates auxquelles chacun d’eux l’a construite sont
inscrites sur les tours. (Alexandre) mourut en Perse, au retour de la muraille de Magog, en l’année
881 (1481-1482) avant la naissance de Muhammed sur lui soit le salut ! On dit que son corps repose à
Alexandrie, dans le couvent de Merkab. Cela est vrai, car les chroniques des Grecs anciens sont également
dignes de crédit : elles ont toujours enregistré des affaires du monde.
13. D’après ce que disent les Grecs anciens, trois cent cinq années avant l’Hégire de Monseigneur
Muhammed, Alexandre de Roum, fils du philosophe Philippe, devint empereur dans la grande ville de
Kavala, qui se trouve à proximité de Salonique, dans le pays de Roum. Il prit dans la poignée de sa
conquête (les pays) du Roum, de la Perse, de l’Arabie, de l’Inde et du Sind. A l’endroit appelé Dara Dere, à
proximité de la forteresse de Nusaybin qui est proche de Bagdad, cet Alexandre de Roum mit en déroute le
chah de Perse Darius, devint maître du pays d’Iran et fit établir la famille et la maisonnée du chah Darius
dans l’estivage de Darahiyye, dans le sandjak du Mentese. À présent, on appelle Darahiyye ce district
judiciaire (dont la prospérité ne cesse de) croître.
14. Ensuite, grâce à la richesse de ses butins, Alexandre, avec deux mille bâtiments, arracha Alexandrie des
mains du roi Surid, qui était le roi des Coptes et qui partit vers le Caire dans les gémissements. (Alexandre)
prit aussi le Caire et fit des rois coptes des chefs de tribus. Tous les malfaisants Arabes nomades furent
soumis aux gens du Roum et se détournèrent des Coptes.
15. Ensuite, Alexandre constitua l’Egypte en bien de mainmorte au bénéfice du monastère de
Sainte-Sophie, à Constantinople. Il fit prélever chaque année seize fois cent mille pièces d’or (sur les
revenus) de l’Egypte et les fit envoyer à titre de biens votifs aux religieux de Sainte-Sophie.
16. Entre l’époque de félicité de Monseigneur le Refuge de la Révélation et le califat de Monseigneur Omar,
Jérusalem, Tripoli, Saïda, Beyrouth, Acre, Ramla, Gaza, Tine, Damiette, Rosette, Alexandrie, le Caire et
toutes les forteresses qui se trouvent au bord de la mer étaient aux mains des néfastes mécréants francs et
roméïques. Ensuite, à la date de l’année 595 de l’ère d’Alexandre le Grand, le roi Denkildiyanos, c’est-à-dire
le roi Takyanos, massacra, parmi les chrétiens, tous ceux de la communauté messianique qui se trouvaient
dans son antique capitale d’Antioche, à Alep, à Damas et au Caire, et détruisit de fond en comble plusieurs
milliers de leurs églises. Ce roi était un tyran superbe, dévoyé dans l’idolâtrie. Parmi les césars du Roum qui
étaient idolâtres, le dernier fut ce Takyano.
17. Ensuite, grâce aux biens abondants des chrétiens qu’il avait massacrés, il rassembla des troupes
immenses comme la mer et marcha sur Alexandrie. À Alexandrie, il fit mettre à mort l’un de ses hommes,
nommé Cile, qui s’était rebellé, et devint le maître d’Alexandrie.
18. Ensuite, il ravagea de fond en comble le climat d’Egypte, l’un de ses généraux alla dans le pays de
Perse, livra une grande bataille au chah Sapor, tua celui-ci, fit passer tous ses soldats au fil de l’épée et
envoya à Takyanos la famille et la maisonnée de Sapor, ainsi que tous les trésors de ce dernier. Avec ces
richesses abondantes, Takyanos bâtit la forteresse d’Alexandrie. Finalement, Takyanos fut un roi malfaisant
pendant vingt années et connut la rétribution du sang qu’il avait injustement versé : lorsque sa peau et ses
gencives se furent répandues et qu’il mourut, son fils Ferniyal devint roi à sa place et mourut à son tour au
bout de deux années. Constantin le Grand devint roi à la place de celui-ci.
19. Ensuite, lorsque, par un décret secret de Dieu, la religion muhammedienne apparut et que, dans la
dix-septième année de sa prophétie, Monseigneur le Refuge de la Révélation conquit La Mecque la
vénérée, Il envoya Monseigneur Halid ibn-i Velid avec vingt mille Compagnons d’illustre grandeur contre le
seigneur de Damas, le césar Harkil. Par l’ordre de Dieux, (Halid) prit (Damas) dans la poignée de la
conquête et l’heureuse nouvelle en parvint au Refuge de la Révélation.
20. Pour sa part, l’Envoyé de Dieu, Muhammed Mustafa, envoya encore dix mille hommes de troupe pour
protéger (la Syrie). Parmi ceux-ci se trouvait ‘Amr ibnü-l-‘As qui, alors qu’il était encore dans l’ignorance (de
la Religion), alla, en qualité d’homme de service, avec les troupes jusqu’à Jérusalem et y demeura.
Jérusalem de vénérable noblesse était encore aux mains des Roméïques.
21. Lorsque les troupes parvinrent à Damas, ‘Amr ibnü-l-As faisait du commerce à Jérusalem. Un jour, alors
qu’il se reposait à l’ombre d’un arbre et qu’un homme était plongé dans le sommeil à côté de lui, un serpent
apparut soudain. Au moment où ce serpent énorme comme le su’ban se jetait sur cet homme pour
l’attaquer, ‘Amr tira son arc et une flèche et combattit le su’ban. L’homme endormi sortit alors de son
sommeil et vit que ‘Amr tuait un énorme serpent. L’homme endormi lui dit avec force marques d’obligation :
« Puisse ton combat pour la foi être vigoureux ! Ce serpent, tu l’as bien tué avec la flèche du décret du
destin ! La force soit dans ta main et dans ton bras ! » Le serpent était mort et fut laissé aux fourmis comme
allocation de subsistance. Cet homme qui dormait demanda à ‘Amr : « Comment as-tu pu affronter ce
serpent ? » ‘Amr ibnü-l-‘As dit : « Par Dieu ! Ce su’ban a voulu te faire périr ! Moi, j’étais éveillé et toi, tu ne
t’es pas réveillé, tu étais dans l’obscurité (du sommeil). J’ai mis la main à la poignée, ai frappé le serpent
avec le bois hadeng du décret du destin et l’ai tué. C’est à ce moment que tu t’es réveillé. »
22. Alors, cet homme baisa les mains et les pieds de ‘Amr et, après l’avoir interrogé sur ce qu’il faisait pour
l’heure, il lui dit : « Eh, l’homme ! d’où es-tu ? » ‘Amr dit : « Je suis Mecquois et je suis venu faire du
commerce à Jérusalem. La plupart du temps, le seul chamelon que j’ai ne peut devenir deux. Telle est ma
situation. » L’homme dit : « Je suis Hace Semmas et j’habite la ville d’Alexandrie, dans le pays d’Egypte. Je
suis venu à Jérusalem en pèlerinage. Louange à Dieu ! Tu m’as sauvé de la calamité de ce serpent ! Je vais
te faire beaucoup de bienfaits qui seront la contre-partie du fait que tu m’as sauvé ! Viens avec moi, allons à
la ville d’Alexandrie. Je te donnerai deux mille pièces d’or coptes, beaucoup de richesses et de biens, des
tentes et des pavillons, des esclaves mâles et femelles. Avec l’argent des butins, je t’enverrai au Caire et, de
là, à La Mecque ! » promit-il.
23. ‘Amr, pour sa part, eut le coeur plein de reconnaissance. Il alla de Jérusalem à Alexandrie en dix jours et
y fut l’hôte de Hace Semmas en sa demeure. Le hace ne revint pas sur sa promesse, combla ‘Amr de
bienfaits, au-delà de ce à quoi il s’était engagé, et lui offrit une robe d’honneur. ‘Amr et Hace Semmas
allèrent au terrain de Mel’abe, qui est le lieu de récréation de la ville et, tandis qu’ils le regardaient et
contemplaient, par un décret secret de Dieu, (il se faisait que) tous, vieux et jeunes, jouant là au polo, une
balle de polo sortit du terrain et vint se poser sur la tête de ‘Amr ibnü-l-‘As.
24. Tous ceux qui étaient présents s’émerveillèrent et demeurèrent interdits dans le monde de la
stupéfaction. C’était comme si ces gens d’Alexandrie avaient entre eux une antique coutume voulant que
quiconque sur la tête duquel se posait une balle devait devenir l’empereur de cette Alexandrie. Aussitôt, tous
se mirent à rire et à sourire en disant : « Faut-il que ce Mecquois, cet Arabe nomade habitant les lits des
torrents à sec, devienne roi ? » Hace Semmas amena aussitôt ‘Amr ibnü –l-‘As dans sa demeure, inspecta
son destin par la science de l’astrolabe et vit que ce ‘Amr devait devenir le sultan de l’Égypte. Avec encore
une infinité de biens abondants et dix files de chameaux chargés de marchandises, il l’envoya au Caire et,
de là, dans le Hedjaz.
25. En doublant étapes et relais, ‘Amr parvint à La Mecque, retrouva tous ses amis et apporta en présent à
Monseigneur le Refuge de la Révélation une partie des marchandises d’Alexandrie. Lorsqu’il vit la beauté de
l’Envoyé de Dieu, il leva la main, fut délivré de l’ignorance (de la Religion) et eut l’honneur d’embrasser
l’Islam. À ce moment, Monseigneur le Refuge de la Révélation lui dit en présence de tous les Compagnons
de généreuse illustration : « Ô ‘Amr ! Bonne nouvelle pour toi ! tu seras le conquérant d’Alexandrie et celui
du Caire ! tu seras ‘Amr aux deux vies ! » Ce fut ainsi qu’il annonça à ‘Amr la bonne nouvelle de la conquête
d’Alexandrie. ‘Amr, quant à lui, commença à faire, pour les Compagnons choisis, l’éloge du climat et des
abondantes richesses d’Alexandrie. Monseigneur le Refuge de la Révélation, pour sa part, daigna éveiller
dans leur communauté de tous les Compagnons de généreuse illustration le désir de conquérir Jérusalem
de vénérable noblesse, Alexandrie et le Caire, et formuler quelques Traditions de vénérable noblesse.
26. Finalement, en la sixième année de l’Hégire prophétique (627-628), après l’expédition victorieuse de
Hudeybiye, Monseigneur le Refuge de la Révélation envoya le général en chef Ebu Zerr et Belika Ogli Hatib
auprès de Mukavkis, qui était le roi d’Egypte, avec des lettres invitant celui-ci à embrasser la Religion. Selon
un récit, le roi Mukavkis pressa sur son ventre la lettre ornée de perles d’éloquence de Monseigneur et eut
l’honneur d’embrasser l’Islam. Il envoya en ambassade auprès de Monseigneur la fierté des créatures
Zü-nnun l’Égyptien avec une lettre et, à titre de présents, une mule appelée Düldül, un sabre appelé Zülfikar,
et une odalisque appelée Marye ainsi que trois odalisques coptes. Zü-nnun remit les présents à
Monseigneur et, en contemplant le Prophète de Dieu, dont la beauté était parfaite, il eut l’honneur
d’embrasser l’Islam et devint le premier médecin de Monseigneur (le Refuge de) la Révélation.
LXV. DANS LEQUEL EST EXPOSEE LA CONQUETE DE LA FORTERESSE D’ALEXANDRIE
1. Les paroles véridiques de tous les chroniqueurs écrivent et notent que dix-huit années après le décès de
Monseigneur le Refuge de la Révélation (29/649-650), sous le califat de Monseigneur Omar – que Dieu
l’agrée ! –, celui-ci prit lui-même, à la force du bras, Jérusalem de vénérable noblesse sur les mécréants
roméïques et les Francs aux mauvais stratagèmes. Ensuite, il désigna ‘Amr ibnü-l-‘As comme général pour
conquérir l’Egypte avec quatre mille cinq cents cavaliers et quatre mille fantassins. Lorsque, doublant étapes
et relais, les troupes de l’Islam parvirent entre ‘Aris et Refih, un messager arriva de la part de Monseigneur
Omar. Quand la lettre (dont il était porteur) fut lue, ce que signifiaient les mots était : « Lorsque ma lettre
arrivera, si ton pas a foulé la terre de l’Egypte, marche et que Dieu rende ta tâche aisée ! Sinon, si ton pas
ne l’a pas foulé, reviens et prends part à la campagne sainte du Oman, contre les Kharidjites ! » Aussitôt,
‘Amr ibnü-l-‘As interrogea les gens du pays, qui dirent : « Ce ‘Aris est sur la terre d’Égypte ! » Sur le champ,
‘Amr envoya auprès de Monseigneur Omar un messager avec une lettre disant : « Nous sommes sur la terre
de l’Egypte ! » et, pour sa part, se dirigea vers le Caire. Il conquit quelques forteresses dans les environs du
Caire, puis mit le siège devant la forteresse d’Alexandrie. Le siège dura neuf mois et il y eut une grande
bataille.
2. Finalement, en l’année dix-neuf de l’Hégire (640), le roi maudit nommé Harkil étant mort à Césarée, la
calamité s’abattit sur les mécréants roméïques d’Alexandrie qui étaient assiégés du côté de la mer. Alors, les
armées de ceux qui professent l’Unicité de Dieu lancèrent l’assaut aux endroits qui avaient été démolis par
les catapultes. Un vendredi dans le mois de muharrem de la vingtième année de l’Hégire (XII-640 – 1-641),
la forteresse, séjour paradisiaque, d’Alexandrie bâtie de pierre fut conquise. Les combattants musulmans de
la Foi prirent les richesses du butin par chamelées entières. Chacun des Compagnons de généreuse
illustration devint riche et il échut à chaque homme quarante milliers de pièces d’or de butin. Quant au
compte exact des autres biens, des provisions et des prisonniers, Dieu le Conquérant le sait ! ‘Amr envoya la
nouvelle (porteuse) d’allégresse de cette conquête des conquêtes à Monseigneur Omar, à Médine la
radieuse, par l’intermédiaire de Necab, avec des lettres. (Omar), quant à lui, envoya vingt mille hommes de
troupe en renfort. Il est écrit plus haut de manière détaillée comment ils assiégèrent le Vieux-Caire. Ces
distiques ont été composés au sujet de la conquête d’Alexandrie :
Dis : « La victoire nous est envoyée
Et Dieu nous ouvre (la porte). »(...)
LXVI. DANS LEQUEL EST EXPOSEE LA CAUSE DE LA RUINE DU PHARE ET DE LA TOUR DE VIGIE D’ALEXANDRIE
1. Cette Alexandrie est passée par les mains de nombreux rois (des temps) passés. Mais, après les califes
bien-guidés, qui sont les Quatre-Amis commandeurs des croyants, elle entra en la possession des
Omeyyades et devint extrêmement prospère et peuplée. Tous les rois des nations messianiques la
convoitaient, mais ils criaient d’effroi de tous côtés devant la constante magnificence des Omeyyades et les
armées musulmanes. Ceux-ci effectuaient des conquêtes de tous côtés, lancèrent leurs troupes contre
Constantinople et contre l’Espagne, et conquirent Galata à la pleine d’Islam ainsi que Roma en Espagne.
2. Finalement, les mécréants dont la bassesse est à ras de terre, qui ont l’enfer pour résidence et sont
maîtres dans l’art de la fuite, usèrent d’un stratagème. Le roi d’Espagne envoya auprès de l’Omeyyade
‘Abdü-l-Melik, fils de Mervan, un ambassadeur qui remit à celui-ci à Damas les lettres (dont il était porteur).
Lorsque la lettre fut lue, l’ambassadeur maudit fit montre de sincérité, ouvrit la main, leva le doigt du
témoignage en présence de ‘Abdü-l-Melik et eut l’honneur d’embrasser l’Islam. Il fut agréé et recherché par
‘Abdü-l-Melik et il ne s’éloignait plus un instant des côtés du roi.
3. De cette manière, il entra dans les bonnes dispositions de ‘Abdü-l-Melik et dit à celui-ci : « A Alexandrie, il
y a des trésors d’une telle immensité que les langues ne sauraient les décrire. Depuis Monseigneur Adam et
le second Adam, c’est-à-dire Noé le confident du secret, plusieurs centaines de sultans et plusieurs milliers
de devins possesseurs de sciences nombreuses y ont enterré des trésors avec des talismans. Si tu agis
selon ce que je sais et si tu m’accordes ta confiance, je mettrai au jour ces trésors grâce à la force de ma
science et tu les prendras dans la pognée de ta possession. Avec ces richesses abondantes, tu accompliras
toutes sortes d’actes de bienfaisance. Tu mèneras des armées contre tous les empereurs du monde.
D’abord, tu détruiras le peuple et le pays d’Espagne. Ensuite, tu ravageras la ville de Constantin et en
réduiras les maisons en poussière. Ensuite, tu seras maître de plusieurs milliers de nouveaux trésors, de
telle manière que tu réduiras les chahs du Monde à être tes palefreniers, que ton nom fortuné sera
commémoré jusqu’au Jour de la Vraie Religion et que tu seras dans les chroniques (un personnage de)
légende. » ‘Abdü-l-Melik était un homme rempli d’une convoitise extrême. Il ne savait pas que l’ambassadeur
maudit allait détruire Alexandrie et la livrer aux mains des mécréants.
4. ‘Abdü-l-Melik était naïf en matière de stratagèmes. Il se fia au fait que l’ambassadeur était venu à l’Islam.
À l’ambassadeur qui simulait être musulman, il donna tant de milliers d’hommes de troupes. Celui-ci partit de
Damas de vénérable noblesse, doubla les étapes et arriva à Alexandrie. Sans crainte ni peur, il détruisit par
la force de la science la tour de vigie qui était le Miroir d’Alexandre et prit celui-ci. Ce miroir était tel que si un
ennemi arrivait par mer contre Alexandrie, tous ses bâtiments s’embrasaient sous le feu rayonnant du miroir,
et celui-ci rendait visibles tous les bateaux qui naviguaient sur la mer. Il était à ce point doté d’un immense
pouvoir talismanique. Aujourd’hui, son soubassement est toujours visible. On l’appelle le rocher de
Meymuncuk. Il se trouve à l’entrée du Port-aux-Galions. Comme il est situé à un endroit défavorable,
certains bateaux, en entrant dans le port, viennent heurter ce Meymuncuk et sont mis en pièces. Il leur faut
aller au large de la forteresse. D’extrêmes précautions sont nécessaires. Ensuite, (l’ambassadeur) tira de ce
phare et de cette tour de vigie des richesses pour quarante millions.
5. En bref, en quarante jours, il découvrit plusieurs centaines de trésors, en fit remplir des navires, ravagea
çà et là la ville d’Alexandrie, embarqua avec les troupes qui dépendaient de lui et donna l’ordre de mettre le
cap sur le pays d’Espagne. De ce côté-ci, à Damas, ‘Abdü-l-Melik entendit indirectement cette nouvelle. Le
calife fut pris de beaucoup de regrets et se fit des reproches. Il se trouva honteux devant le peuple et
s’abstint de liesse et de réjouissances, mais à quoi bon ?
6. Finalement, il donna l’ordre de faire réparer et restaurer les endroits d’Alexandrie qui avaient été détruits.
Beaucoup de richesses abondantes furent dépensées. Comme un défi à l’ennemi, (la ville) fut rendue
encore plus peuplée qu’elle ne l’était auparavant et radieuse comme une perle semblable (en blancheur) à
un oeuf. Mais il n’y avait pas la crypte d’Alexandre, ni les objets talismaniques de Deluke, ni les signes de
Surid le Devin, ni le trésor de Misra’im, ni aucun vestige de lumière dans le Miroir d’Alexandre. Trois années
passèrent de la sorte. Au cours de la quatrième année, l’ambassadeur maudit qui avait fui en Espagne avec
les richesses des trésors réunit en Espagne, avec l’aide de tous les mécréants et grâce à ces richesses des
trésors, trois fois cent mille hommes de troupe. Avec une quantité innombrable de navires, il jeta un jour
l’ancre dans le port d’Alexandrie. Aussitôt, les troupes étrangères débarquèrent et envahirent à l’improviste
la forteresse d’Alexandrie, la prirent dans la poignée de leur possession, s’y établirent une année entière,
ouvrirent les trésors qui restaient encore et se rendirent maîtres de richesses incalculables, dignes de celles
de Coré.
7. De ce côté-ci, ‘Abdü-l-Melik partit de Damas avec des troupes, immenses comme la mer, d’hommes en
nombre infini. De ce fait, l’ambassadeur maudit et le roi maudit entendirent dire que la splendeur
muhammedienne arrivait, emplirent à ras bord les navires avec les richesses des trésors, ravagèrent et
pillèrent avec les troupes d’associationnistes l’Egypte, les villages et les bourgades aussi loin qu’ils purent
les atteindre, détruisirent dans Alexandrie des objets talismaniques porteurs d’exemples admonitifs ainsi que
des oeuvres merveilleuses et curieuses, et s’enfuirent en Espagne à bord des navires. À présent, l’Espagne
est devenue prospère grâce à ces richesses abondantes, au point qu’ils ont appelé l’une de leurs grandes
villes Medine-i Kübra et, dans le Maghreb, une autre Cordoue, et une autre Tanger. Ces villes sont le regret
des rois : elles sont devenues prospères et Alexandrie a été ruinée par cette blessure. Mais, à présent,
quelques milliers d’oeuvres insignes, porteuses d’exemple admonitif et qu’il faut avoir vues, sont de nouveau
visibles et évidentes, dont la plus grande manifestation est la forteresse, perle semblable (à l’oeuf) en
blancheur.
8. Ensuite, lorsque ‘Abdü-l-Melik pénétra dans Alexandrie avec des troupes de l’Islam innombrables et
infinies, il vit que, semblables à des navires jetés à la côte par le choc de la mer, les maisons détruites
étaient des espaces sens dessus dessous, livrés aux fourmis et aux serpents, avec des toits réduits en
poussière, dont les habitants avaient rôti dans le feu de la séparation et gisaient, inertes, sur la terre de
l’avilissement.
9. Sur le champ, ‘Abdü-l-Melik ordonna : « Pendant sept années, Alexandrie sera ma capitale. Je suis parti
pour tirer vengeance de l’ennemi ! » Pendant une année, il rassembla des troupes immenses comme la mer
et, avec deux mille navires à voile, conquit Medine-i Kübra dans le pays d’Espagne et, sur la terre du
Maghreb, Cordoue, Tanger et plusieurs centaines de villes. Il y laissa des troupes et les prit dans la poignée
de sa conquête. Sur les richesses du butin, il dépensa trois mille coffres de pièces d’or et fit d’Alexandrie et
de la mosquée des Omeyyades, à Damas de vénérable noblesse, des lieux dignes du paradis.
Actuellement, la prospère communauté de Muhammed qui vit dans le pays d’Espagne est composée
d’hommes de Dieu qui descendent des troupes de ‘Abdü-l-Melik.
10. Puis, toujours avec ces troupes, il conquit Constantinople par composition et la soumit à un tribut annuel
de cinq fois cent mille pièces d’or. Toutes les troupes de l’Islam firent leur entrée dans Alexandrie, saines et
sauves et chargées de butin. Cela faisait sept années entières que ‘Abdü-l-Melik n’avait pas laissé le temps
d’ouvrir l’oeil aux mécréants dont la bassesse est à ras de terre. Il avait ravagé de fond en comble leur
peuple et leurs pays, ainsi que ceux d’autres rois mécréants, il avait fait rôtir le foie des associationnistes.
Toutes les troupes de l’Islam et les autres de la nation de Muhammed devinrent riches grâce au butin. À
présent, en pays arabe, c’est devenu un proverbe qui a cours parmi les gens (que de dire) : « Je vais te faire
quelque chose que (même) l’Omeyyade ‘Abdü-l-Melik n’a pas fait aux mécréants. »
11. Ensuite, cette Alexandrie passa entre les mains de beaucoup de rois. Sous le califat de Tahir Baybars,
les mécréants l’envahirent de nouveau. Conformément au verset « A qui sera la royauté en ce jour ? À Dieu,
l’Unique, l’Invincible », Dieu fit don de la manufacture de cette antique cité dominée par ses murs à de
nombreux rois. Elle fut si souvent prise, rendue et ravagée que l’humble auteur demeure interdit devant ce
cas. L’éternelle volonté qu’exprime la yas’alu amma yaf alu fa’ilun muhtarun li-Llah vaut pour cela puisque ta
ala sa’ndhu wa amma nawalahu wa la ilaha gayrihi. Conformément au contenu du distique :
Bien des milliers d’oeuvres se gâtent, bien des agitations s’apaisent.
Cette oeuvre-ci est porteuse de merveille car celui qui l’a faite ne se montre pas.
Il n’est point d’oeuvres de ce genre qui se fassent sur le marché du monde.
12. Ensuite, à la date de l’année 562 (1166-1167), alors que l’Abbasside el-Müttaki bi-Llah était le calife
d’Egypte, l’empereur fatimide du Maghreb appelé ‘Azudü-devle l’emporta. Lorsqu’il se rendit maître de la
forteresse d’Alexandrie, le calife d’Egypte el-Müttaki bi-Llah nomma aussitôt général Esedü-ddin sir-kuhi à la
tête d’une troupe de cent mille hommes pour marcher sur Gaza depuis le Caire. Il nomma comme généraux
Sina, cousin de Sir-kuh, Salahu-ddin Yusuf b. Eyyüb, neveu de Nuru-ddin le Martyr et, depuis Damas la
noble, les envoya contre Alexandrie avec une troupe de quarante mille hommes. Les troupes du Caire et de
Damas firent leur jonction, délivrèrent les forteresses d’Ascalon, de Jaffa et de Damiette des mains des
Francs. Ensuite, ils prirent, par composition, Alexandrie des mains de ‘Azudü-ddevle et envoyèrent la bonne
nouvelle à Nuru-ddin, à Damas.
13. Ensuite, Saladin l’Ayyoubide devint seigneur d’Alexandrie. Cette année-là, ‘Azudu-ddevle se concerta
avec les mécréants francs et assiégea Saladin dans Alexandrie. Finalement, Saladin tint conseil avec Saver,
vizir de ‘Azudu-ddevle, et lui livra Alexandrie par composition. Les autres, pour leur part, donnèrent
annuellement cinquante mille pièces d’or à Saladin.
14. Saladin livra Alexandrie à ‘Azudd qui, pour sa part, donna la moitié d’Alexandrie aux Francs qui étaient
venus le renforcer. Cette année-là, les Francs envahirent l’Egypte et il le donna (...). Cela jusqu’à ce que, à
la date de l’année 564 (1168-1169), les mécréants dont la demeure est l’enfer arrivassent en renfort de tous
côtés et prennent en leur possession le climat d’Egypte et fissent d’Alexandrie leur principal lieu de refuge.
15. Finalement, à la date de l’année 915 (1509-1510), l’empereur circassien Sultan Guri le sans-droiture,
acheta l’Egypte, mère du monde d’ici-bas, au marché des révolutions des sphères célestes, sans donner or
ni argent, ni une pièce d’argent et demie, ainsi qu’en usa Züleyha l’Égyptienne à l’égard de Joseph.
S’enorgueillissant de la parfaite beauté de sa fortune, non seulement il étendit la main (de l’ambition) contre
les rois des rois des Sept-Climats mais, alors qu’il était le Serviteur des Deux Lieux Sacrés, il fit affaire avec
le chah de l’Iran et du Touran nommé Sah Isma’il. Il lui envoya en renfort douze mille arquebusiers montés
sur des chevaux pie ainsi que douze mille arquebusiers à pied. Sultan Selim Han 1er (étant arrivé) avec ses
troupes dans la plaine de Cildir, les deux chahs en personne s’affrontèrent là. De prime abord, les troupes
de la Perse eurent le dessus (mais), alors que les Ottomans étaient sur le point d’être mis en déroute, on fit
allumer avec la même mèche par Ayas Pasa, agha des janissaires, trois cents canons bal-yemez pleins de
chaînes. La racaille des Têtes-Rouges mal-vivantes mésusaient de la vie et, jusqu’à ce que les janissaires à
pied eussent déployé tous leurs efforts pour passer leurs têtes au fil de l’épée rayonnante de feu, il y eut
sept heures de chaude bataille contre l’Iran et de guerre contre les troupes de la terre du césar.
Accompagné de sept hommes et sans entrer en courroux contre ce monde épineux comme l’acacia, Sah
Isma’il (quitta) le marché du terrain de Cildir et prit la fuite vers le pays de Kazvin. Tout le marché de son
camp, les instruments transportables pour les réjouissances ainsi que le trésor en numéraire furent mis au
pillage, les armées de ceux qui professent l’Unicité de Dieu et des musulmans s’enrichirent grâce à ces
tributs. L’épouse non canonique du chah, tomba même aux mains des troupes de l’Islam et fut remise à
Selim Han, triomphateur à l’instar d’Alexandre, qui dit, pour sa part : « Quel que soit le respect qu’on ait pour
elle, elle est l’épouse du chah ! », et il la confia en dépôt au pacha chancelier, Tac-zade Ca’fer Celebi, avec
trois cents têtes d’odalisques.
16. Ensuite, Selim Han alla contempler la plaine du marché de la bataille et vit que beaucoup des soldats
vaincus et tués faisaient partie des troupes d’Egypte. Il releva sur le champ le pan de son vêtement et, au
nom de Dieu, dit : « L’intention est de mener la guerre sainte contre Guri du Caire ! » Victorieux et
triomphants, sains et saufs et chargés de butin, ils revinrent de la plaine de Cildir.
17. Lorsqu’ils se dirigèrent vers Kayseriyye, il parvint à l’ouïe auguste de Selim Han que le Zu-l-kadiride
‘Alaü-ddevle, seigneur de Mar’as et qui dépendait du chah, s’enorgueillissait de sa fortune et ne cessait de
harceler et de piller les troupes qui allaient et venaient. Il envoya alors Ferhad Pasa marcher contre Mar’as
avec soixante-dix mille hommes. ‘Alaü-ddevle, pour sa part, (se trouvait), avec cent vingt mille Turkmènes
sans religion ni opinion, à l’estivage de Göksün. Les deux troupes s’y livrèrent, comme il se devait, une
grande bataille qui dura sept heures. Par l’ordre de Dieu, ‘Alaü-ddevle fut mis en déroute. Sa tête tranchée,
ainsi que celles de soixante-dix chefs de tribus, fut apportée avec les richesses du butin en la présence de
Selim, dans la capitale de Kayseriyye. Telles des balles de polo, leurs têtes roulèrent devant le pavillon
(impérial). Les têtes des quatre fils de ‘Alaü-ddevle, celles de soixante-dix bannerets qui avaient réchappé au
sabre et celles de ‘Alaü-devvle et des beys furent envoyées au bout de piques au Caire, au sultan Guri, avec
des lettres.
18. Lorsqu’ils arrivèrent, la lettre fut lue, dont la signification était : « Nous qui faisons partie des troupes de
l’Islam, alors que nous étions des combattants de la Foi sur le chemin de Dieu, le seigneur de Mar’as et
bandit de grand chemin ‘Ala l’abandonné de la fortune, qui était sous ta juridiction, a commis contre nous
des actes de brigandage. De ce fait, il fallait qu’il disparaisse. Conformément à ce qu’ordonne, au surjet de
ce genre de malfaisants, le verset « Tranché fut le dernier reste du peuple, de ceux qui furent injustes.
Louange à Dieu, Seigneur des Mondes », il a été mis à mort avec tous ses malfaisants, et ceux qui adorent
Dieu ont été délivrés de leur malfaisance. Pour toi qui es le Serviteur des Deux Lieux Sacrés, il n’est point
digne d’un disciple de Muhammed de prêter secours à la racaille des Têtes-Rouges. À présent, nous avons
entre nos mains des attestations et des preuves (émanant des cadis) des quatre rites, ainsi que des fetva,
sûr moyen d’approche (de Dieu). Sois prêt pour ton heure ! Au printemps marqué d’heureux auspices, si
Dieu, le Clément, le veut ! nous ferons avec toi dans le marché du Caire un marché de la bataille. Sois prêt
pour ton heure ! »
19. À la date de l’année 921 (1515-1516), (Selim Han) passa de la Bonne ville, c’est-à-dire de
Constantinople, à Üsküdar avec des troupes immenses comme la mer. En doublant étapes et relais, il
parvint à la plaine appelée Merc-i-Dabik, à proximité d’Alep, là où Monseigneur David – sur lui soit le salut ! –
combattit le roi Goliath. Merc-i-Dabik, où Goliath fut vaincu, est une immense plaine. Au sujet du combat qui
s’y était livré, le Seigneur Eternel a fait descendre sur Son bien-aimé à titre d’anecdote le verset suivant :
« David tua Goliath. Dieu donna (à David) la royauté ». C’est là le verset décisif qu’Il fit descendre.
20. Dans cette vallée, Selim Han, quant à lui, défit avec quatre-vingt mille guerriers parfaitement accomplis
et équipés le sultan Guri qui avait deux fois cent mille hommes de troupes. Dans la bataille, Guri Sultan
atteignit le fond des abysses, laissa son sultanat sur ce champ de bataille et s’enfuit à Alep, puis à Damas,
puis au Caire.
21. Vainqueur et triomphant, Selim Han arriva à Damas et donna l’ordre d’y prendre les quartiers d’hiver. Au
printemps, il agit avec justice et s’en remettant à Dieu et en marchant sur le Caire. Selim Han traversa avec
cent mille hommes de troupes la terre de Hasan, qui est le désert de Katiyye et de Ümmü-l-Hasan, et parvint
à la ville de Belbeys. C’est alors que, depuis l’embuscade des monts ‘Abbas, avec cent mille cavaliers
montés sur des chevaux arabes et cent mille arquebusiers à pied fort capables, le sultan Guri se jeta à
l’improviste sur les troupes ottomanes. Du lever jusqu’au coucher du soleil furent livrés la bataille sultanienne
et le combat khakanien. Finalement, la fin s’abattit sur les troupes de Guri et leurs têtes roulèrent sous les
dents des sabres. Quant à Guri, du fait de son orgueil, on retrouva, au coeur de la mêlée, son corps décapité
étendu sur un tapis de prière. On dit qu’il passa de la demeure de l’orgueil à celle de l’enfer et qu’il atteignit
les abysses de l’heure fatale.
22. En résumé des mots et des souhaits, la conquête de l’Egypte par Selim Han a été écrite plus haut de
manière abrégée. En bref, Selim Han conquit l’Egypte après avoir livré vingt batailles rangées. Il nomma
pacha de l’Egypte Hayre Beg qui avait été antérieurement vizir de Guri, et Kemal Pasa-zade Ahmed Efendi
kadi-asker et juge. Lui-même descendit le Nil béni avec vingt mille hommes de troupe et un millier de
bateaux, et parvint à Rosette. Ensuite, par terre et par mer, il assiégea la forteresse d’Alexandrie avec ses
troupes. A ce moment, les troupes circassiennes, hébétées demandèrent : « Merci, ô toi, l’élu de la famille
de ‘Osman ! », ils apportèrent les clefs à Selim Han et rendirent (la place) par composition. A la date de
l’année 923 (1517) la forteresse d’Alexandrie conquise de la main de Selim Han sur les Circassiens indignes
du nom d’homme. Puisse la cessation des époques demeurer pour l’éternité entre les mains de la famille de
‘Osman, amen ! par égard pour le prince des Envoyés.
23. Ensuite, Selim Han fit procéder au recensement. Il fit du Caire la capitale d’un bey de sandjak à deux
tug. Il accorda ce sandjak à Hussam Pasa, l’un des kapudan de la mer. Sur mer, il l’affecta, avec quatre
kadirga, à la défense des routes de Malte et à celle des ports des forteresses situées sur la côte de la
province d’Egypte. Il fut ordonné que, dans celle-ci, tous les villages fussent recensés à titre d’affermages et
que, s’il n’y avait pas de villages, une bourse égyptienne fût prélevée mensuellement sur le trésor de
l’Egypte de la part de l’Empereur et sur les biens impériaux. À présent, conformément à l’antique règlement
de Selim Han, douze bourses sont prélevées annuellement. Le kapudan pasa fait campagne chaque année
avec deux kadirga, jette l’ancre chaque année dans le port d’Alexandrie et exerce l’autorité. Un droit de port
d’une pièce d’or est prélevé sur chaque navire qui jette l’ancre dans les ports d’Alexandrie, de Rosette et de
la Vieille-Alexandrie. Les taxes de marché, les inspecteurs des marchés, le personnel de l’Arsenal, les nids,
les esclaves fugitifs, les madragues, la direction des eaux de la ville, toutes les pendaisons et exécutions,
flagellations, pendaisons, décapitations et arrestations sont placés sous son autorité. Son lieutenant exerce
en permanence l’autorité avec deux cents levend. Avec l’impôt foncier, les amendes sur les délits et les
crimes, il perçoit également dix bourses égyptiennes chaque année. Au total, c’est un sandjak qui rapporte
vingt-deux, vingt-cinq et, en comblant les déficits, trente bourses.
24. Dans les villages qui sont placés sous son autorité, il n’y a ni timar ni ze’amet. Il n’y a qu’impurs
affermages. Il n’y a pas non plus de postes d’alay begi ni de çeri basi ni de kethüda, mais un commandant
des serviteurs de la Porte (venus) du Seuil, ainsi qu’un commandant des janissaires d’Egypte. Il y a un
glorieux agha dépendant du vizir de l’Egypte qui est un gouverneur autonome auquel est confiée la douane
à l’échelle. Mais il ne se mêle pas des pendaisons et exécutions, exerce son autorité uniquement sur les
choses qui dépendent de lui et perçoit sur les navires qui vont et viennent la taxe de douane canonique du
‘ösür. Il donne chaque année à son pacha une comptabilité de cent cinquante bourses. Il remet également
deux bourses pour le salaire du personnel religieux, imams et prédicateurs, qui sont imputées sur la
comptabilité de son fermage. Mais certains vizirs ne remettent pas ces droits de douane avec les fermages
et les laissent en dépôt auprès de l’un de leurs hommes de confiance. Grâce aux décrets secrets de Dieu,
les (revenus) des douanes augmentent (cependant) et un salaire quotidien de dix piastres est accordé à
l’agha pour son service. Quatre-vingts bourses sont prélevées par le fisc sur (les comptes du) pacha au titre
de ces droits de douane et il les donne comme salaires au personnel de service. Pertes ou profits, tout est à
la charge du pacha. Les magasins de l’hôtel de l’agha sont des fondations pieuses de Sinan Pasa. Deux
piastres par jour pour la location sont dues au pacha.
25. Lorsque l’humble auteur se trouvait en Egypte, nos maîtres envoyèrent ce moindre des serviteurs
(examiner) la comptabilité des aghas. Lorsque nous reçûmes une bourse pour chaque (cas) à titre
« d’indemnité du pas », il fut inscrit que nous avions agi en tant que « testateur des secrets ».
26. L’effectif du personnel de service de la douane, juifs, roméïques et musulmans, est de soixante-dix
personnes. Leurs salaires sont également prélevés sur (les revenus de) la douane.
27. Mais c’est un lieu où l’on trouve des hommes qui doivent être d’une grande droiture afin de se rendre
utiles pour leur vizir, car ils pourraient user de beaucoup de stratagèmes. Pour leurs aghas, un autre revenu
est de vendre des terrains vacants dans le faubourg qui est à l’extérieur de la forteresse, cela avec des titres
de propriété (émanant) de l’agha du pacha. Il n’en résulte pour le pacha ni profit ni utilité.
28. Cette douane (assure également le versement des soldes) des garnisons des cinq forts d’Alexandrie et
de celui d’Aboukir, mille serviteurs au total. Ils reçoivent chaque année une solde de quarante bourses
d’Egypte, le reste étant donné par le pacha. A certaines saisons, les navires francs viennent en grand
nombre, sur lesquels sont perçues deux cents bourses égyptiennes. C’est aussi une circonscription judiciaire
dont le juge du tribunal canonique (reçoit) trois cents aspres. Parmi les ulémas, il y a, au premier rang, la
charge de tahta basi. Au titre de la justice qu’il dispense, il perçoit annuellement vingt-cinq bourses.
29. Mais, au bord de la mer, il y a une nahiye de la forteresse appelée Aboukir, qui n’est liée à aucun autre
lieu, village ou bourgade. C’est comme si on avait, de la part de l’Empereur, annexé une circonscription
judiciaire supplémentaire.
30. Ce revenu est celui de la grande ville du port d’Alexandrie. Chaque année, trois ou quatre cents navires
francs et autres déploient leurs voiles, volent à la semblance d’oiseaux marins, jettent l’ancre dans le port
d’Alexandrie et y font escale. Il ne manque pas d’y avoir constamment plaintes et querelles. (Les taxes
afférentes) sont perçues par le cadi. Il y a les bailes de sept rois (mécréants). Ils résident dans la grande
forteresse, dans les caravansérails de Sinan Pasa.
LXVII. DESCRIPTION DE L’ASPECT DU CORPS DE LA FORTERESSE D’ALEXANDRE LE GRAND
1. Le nom en langue copte de cette forteresse monastique d’Alexandrie était Secencel. Par la suite, comme
Alexandre le Grand et Alexandre le Grec y résidèrent et en firent leur capitale, on l’appela Alexandrie. Mais
les Grecs roméïques l’appellent Makdonya Iskender et, dans la langue des Francs, on dit Golonya.
2. Elle est située sur la côte de la Méditerranée, au nord de l’île d’Égypte, sur un cap semblable à une île,
dont chacun des côtés peut accueillir mille barça et galyon. Au milieu des grands ports, à l’extrémité d’un
côté, il y a un fort qui est le sceau de la comparaison en ce qui concerne l’élévation : un fort solide et qui est
un grand bâtiment de forme décagonale –c’est-à-dire, à dix côtés-, digne de Seddad, muraille puissante
comme celle d’Alexandre.
3. Du côté du nord et de la tramontane comme de ceux de l’ouest et du sud, il n’y a que la Méditerranée.
Quant aux côtés de l’est et du sud, et de celui du vent étésien d’ouest, il n’y a que la terre ferme.
4. Les rives du canal Nasiriyye ne sont que roseraies et palmeraies, vergers, jardins et plaines fertiles
semblables à celles du Paradis.
LXVIII. DANS LEQUEL EST EXPOSE SUR TOUT SON POURTOUR LE CORPS DE LA FORTERESSE D’ALEXANDRIE
1. Il y a d’abord la Porte de Rosette qui est située sur une courtine, du côté oriental de la forteresse. C’est
une haute porte double, en fer, dont on dirait qu’elle est haute comme de Demavend. Lorsqu’on entre de
deux pas par cette porte, cette date est inscrite du côté gauche de la haute forteresse, à la hauteur de deux
hommes, en grands caractères sur une (plaque) rectangulaire de marbre brut :
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! Que Dieu bénisse et accorde Son salut à notre prince
Muhammad et à sa famille ! (...) « Entrez là avec le salut, paisibles ! » (...) ‘amar yata ammalu hada l-‘atabau
l-mubaraka wada aha wa ta’allaka bab Rasid hifzan wa’imarata l-mahrusa dans les jours (du règne) de Notre
Seigneur le Sultan, le Roi des royaumes, « aT-Tahir ‘Abu Sa’id –que Dieu éternise son royaume wa ca’al
l-‘ardu ma saraha l-malikuhu dans les jours (du règne) de ‘al-Mu’izzu l-‘Asraf T-Taki fi ammi en six cent cinq
(1208-1209).
2. Si l’on n’entre pas par cette Porte de Rosette et qu’on aille, en suivant le bord du fossé, du côté de l’autan
jusqu’à la Tour Hexagonale, il y a cinq cents pas longs. C’est une grande tour, ornée et de belles
proportions, qui regarde vers l’est. Le Nil béni, qui arrive (d’une distance) de deux étapes par le canal
Nasiriyye pénètre à l’intérieur de la ville d’Alexandrie par la grille qui se trouve sous le fossé, au pied de cette
tour. À l’intérieur de la ville, il s’écoule sous terre sous les rues et arrose toute la ville.
3. Ensuite, lorsqu’on va, toujours en suivant le bord du fossé, de cette Tour Hexagonale en direction du vent
étésien d’ouest, il y a juste deux mille deux cents pas jusqu’à la tour de Gavri. C’est le côté saillant de la
forteresse, c’est-à-dire qu’elle a une forme qui lui permet de protéger les deux côtés en saillie.
4. De là, si l’on suit encore le bord du fossé en direction du vent étésien d’ouest, on parvient en juste six
cents pas à la Porte du Lotus. C’est une haute porte double, en fer, qui regarde vers le suroît. Du côté
intérieur de la porte de fer intérieure, au-dessus du sofa des portiers, sur plusieurs morceaux rectangulaires
de marbre blanc, il y a plusieurs coquettes inscriptions anciennes mêlées. Elles sont placées très haut et, vu
la difficulté qu’il y a à les lire, elles n’ont pas été notées (ici). Mais, sur (une plaque de) marbre rectangulaire
est écrite (une inscription qu’on peut lire) jusqu’à ce qu’on arrive à « Au nom de Dieu, le Clément, le
Miséricordieux ! (...) « L’Envoyé a cru à ce qu’on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur. (Lui) et
les Croyants. » Au-dessous de ce verset péremptoire, il est écrit : « Année cinq cent cinquante
(1155-1156). »
5. En suivant toujours le bord du fossé à l’extérieur de la Porte du Lotus et en contemplant la puissante
construction de la forteresse, si l’on va cinq cents pas en direction du vent étésien d’ouest, (on parvient à)
une muraille semblable à celle de Kakaha et à celle d’Alexandre, une tour sans égale qu’on appelle la
Grande Tour, qui est située dans un angle.
6. Lorsqu’on l’a passée, on suit le bord du fossé en direction de l’ouest jusqu’à ce qu’on parvienne, en sept
cents pas, au bord de la mer où est le cap du fort intérieur. C’est un angle du fort intérieur.
7. Cette grande tour, fort au bord de la mer, est l’âme de toute la forteresse d’Alexandrie. Il a été construit
(sur un plan) hexagonal. Le maître architecte y a apporté tout ce qu’il pouvait et y a mis en d’oeuvre tant de
connaissances que l’être humain serait à présent incapable de manier le ciseau (avec lequel se taille un seul
de ces blocs de) marbre. Tel un cap, il entre dans la mer sur une distance d’un mil, défend et protège les
quatre côtés (de la forteresse). Ses fondations sont entièrement dans la mer et il est bâti sur des colonnes
de porphyre rouge massif. Tous les kolomburuna, les sa’ika et les canons bal-yemez se trouvent dans ce fort
intérieur afin qu’il puisse protéger le Port-aux-Galères.
8. Au pied de cette tour, nous prîmes nos chevaux de réserve, les fîmes aller dans la mer, passâmes le long
de la forteresse, pénétrâmes dans le port intérieur et mîmes de nouveau pied-à-terre pour contempler la
forteresse. Nous allâmes en marchant sur le sable entre le bord de la mer et celui de la forteresse, qui est
dépourvu de fossé. À l’endroit où le canal Nasiriyye, qui vient du Nil, se jette dans la mer au pied de la
forteresse, il y a comme lieu de plaisance de grands bassins et des banquettes. Certains étrangers se lavent
dans les bassins et y font leur lessive. Certains amants et leurs amantes vont nager dans la mer, tels des
hérons. C’est un endroit paisible pour être poitrine contre poitrine sans que rien ne vienne s’interposer.
9. Nous dépassâmes ces bassins, toujours en suivant le bord de la mer. En passant par le Port-aux-Galères,
il y a juste cinq cents pas depuis le cap du fort intérieur jusqu’à ces bassins. Toujours par le bord de la mer,
nous fîmes cinq cents pas sur le sable en direction du noroît, le bord de mer finit et on parvint au cap de
Sa’d Vakkas. Celui-ci est aussi un angle de la forteresse, qu’on appelle la Tour Verte. Au-delà, en direction
du noroît, il n’y a plus de forteresse, il n’y a que le faubourg, le Port-aux-Galères et le Port-aux-Galions. Le
faubourg d’Alexandrie est situé entre ces deux ports. De jour en jour, il devient plus prospère et peuplé. Mais
l’intérieur de la forteresse ancienne est en ruine. Ses habitants sont en train de construire à l’extérieur, dans
le faubourg, de hauts palais et des marchés sultaniens.
10. Lorsque, depuis la tour appelée Tour Verte, qui se trouve à l’angle formé par la forteresse au
Port-aux-Galères, on va en direction de l’est en suivant le bord du faubourg il n’y a qu’une muraille de
forteresse nue et haute. Entre le faubourg et la muraille de la forteresse, il y a un fossé vaste et bas. Depuis
l’intérieur de ce fossé, un bras du canal Nasiriyye, qui vient du Nil, après avoir irrigué la ville, sort de la base
de muraille de la forteresse d’Alexandrie par des grilles de fer, s’écoule par un grand fossé et va se jeter
dans le Port-aux-Galères au pied de la Tour Verte. Toute la population du faubourg tire son eau de ce canal.
11. La ville d’Alexandrie a, au total, six conduites d’eau réparties à l’image d’un échiquier. En ville, dans les
temps anciens, il y avait sept mille puits au-dessus des conduites d’eau. À présent, on en voit trois mille.
Chaque année, le kasif de la Buhayre vient avec trois cents boeufs. Grâce à ceux-ci, il fait tourner des
saquiehs dans les puits susdits et fait communiquer cent cinquante citernes avec l’eau du Nil. Le kasif donne
leurs revenus au cadi, à l’agha du pacha, à l’intendant du bey, aux aghas des Sept Compagnies et aux
gouverneurs des six forts. Lorsqu’il retourne au divan du Caire, il fait inscrire dans la comptabilité quarante
bourses de biens pour avoir irrigué Alexandrie.
12. L’eau du Nil béni arrive à cette Alexandrie depuis Nasiriyye qui se trouve près du village de Rahmaniyye,
à une distance de deux étapes. Les navires circulent grâce au canal jusqu’à la ville d’Alexandrie.
13. Sur la rive du canal, il y a un pavillon où, chaque année, on mesure la hauteur du Nil. Toute la population
vient avec des tentes, dresse les tentes d’Alexandrie et s’y livre à des réjouissances. On fait écouler le Nil
par trois endroits en direction de la ville d’Alexandrie. C’est un grand spectacle. C’est aussi un grand acte de
bienfaisance dont aucun empereur ne serait aujourd’hui capable. Le salut !
14. Lorsqu’on fait juste cent pas depuis la Tour Verte susdite en direction de l’est, il y a une double porte de
fer au pied de la tour de Sa’d Vakkas tournée vers le nord de la Tour Verte et le faubourg. En face de la
porte extérieure, on passe un pont de pierre à une arche, car le Nil coule dans ce fossé et bat la muraille de
la forteresse.
15. Si, depuis cette Porte Verte, on avance juste de mille cinq pas, toujours en suivant le fossé en direction
de l’est, il y a la Porte de la Mer. C’est une haute porte double en fer qui regarde vers le Port-aux-Galions.
On ne trouve dans aucune autre forteresse des portes aussi larges et aussi hautes. Ce sont des portes
extrêmement effrayantes et larges. Le matin, dix hommes en ouvrent avec difficulté chacun des vantaux qui
sont hauts de vingt-cinq aunes. Au-dessus de l’arc de la porte extérieure, cette date est inscrite en belle
écriture proche du coufique, sur (une plaque) rectangulaire de marbre blanc :
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! (...) Que Dieu bénisse Notre Seigneur Muhammad et toute
sa famille (...) L’achèvement de cette grande forteresse fut ordonné dans le mois du premier rabî de l’année
cinq cent-vingt-trois (1128-1129). (...)
16. Si, de là, on va deux cents pas en direction de la tramontane en suivant la plage, il y a une grande tour
qui est du côté du Port-aux-Galions.
17. Si, de là, on marche juste mille quatre cents pas, toujours en direction de l’est, il y a dans un angle une
grande tour qui protège tous les galions, les saïques, les kara-mürsel et les burtun qui se trouvent dans le
Port-aux-Galions. C’est une grande tour.
18. De ce côté où le Port-aux-Galions est battu par la mer, toutes les pierres des fondations de la forteresse
sont des colonnes en quantité infinie qui ont été disposées côte à côte dans la mer. Là, nous nous
déchaussâmes et, passant par la mer, nous pénétrâmes dans la forteresse par un endroit écroulé sous les
chocs de la mer, passâmes sur les tours et les remparts de la forteresse et marchâmes juste cinq cents pas
vers l’est. À cet endroit, il y a un obélisque (à base) quadrangulaire, comme celui qui se trouve sur
l’Hippodrome à la pleine d’Islam. (...) Une grande partie s’est écroulée et il y a un grand nombre de colonnes
qui gisent en ruines sur le sol. C’est celui qu’on appelle Carud le Renversé qui, au siècle du Prophète
Salomon, fit faire ces signes sur les colonnes à titre de talismans. Ce sont des vestiges pleins d’exemples
admonitifs. Ce serait Ya’mer fils de Seddad qui aurait fait certains de ces signes.
19. A proximité de cet obélisque, il y a un puits d’eau de jouvence appelé Bi’rü-l-Mebsit. Au mois de juillet,
c’est comme si (l’eau en) était un morceau de glace. Elle revivifie les assoiffés qui en font leur nectar. Parmi
les habitants de la ville, les gens d’un bon naturel font, pour la plupart, leur nectar de cette (eau du)
Bi’rü-l-Mebsit. C’est une eau limpide (dont la qualité est) régulière.
20. En conclusion de ce qu’on souhaitait, on dépasse cet obélisque et on fait quatre cents pas en direction
de l’autan. Au-dessous de la muraille, il y a un minaret dont une partie est dans la mer et l’autre moitié à
terre.
21. Ensuite, nous revenons à la Porte de Rosette et nous avons fait à pied le tour complet de la forteresse
d’Alexandrie. D’après ce calcul, le périmètre de la forteresse d’Alexandrie est de onze mille sept cents pas ;
mais, à marche rapide, en (---) heures à pas allongés.
22. Le mur extérieur de la forteresse compte au total soixante-quinze tours grandes et petites. Chacune des
grandes tours est semblable à un fort. Dans les temps anciens, soixante-dix mille hommes auraient veillé en
haut de ces tours, les défendant en sonnant les cloches, en battant les timbales et les tambours royaux.
23. À présent, il y a de hauts palais et des pavillons d’assemblée sur soixante-dix tours. Outre ces soixantedix
puissantes tours, la forteresse a, à dix de ses angles, dix grandes tours qui sont semblables à la muraille
d’Alexandre et où habitent à présent des descendants d’Adam.
24. Outre ce côté extérieur mentionné de la forteresse, il y a aussi le côté intérieur qui compte au total cent
soixante-dix tours ornées, hexagonales ou à décor à stalactites, imbriquées les unes dans les autres, de
toutes sortes, rondes, de belles proportions et élevées, véritables exemples admonitifs impliquant pour
chaque tour le déploiement d’un savoir tel qu’aucun maître architecte n’en a (jamais) déployé (ailleurs) pour
aucune tour.
25. En conclusion, le côté terrestre de la forteresse d’Alexandrie comporte deux épaisseurs de muraille, le
côté de la mer une seule épaisseur, et, au total, trois cent soixante-six tours qui sont autant de hautes tours
à la face du jour, à ce point connues dans tous les horizons entre les voyageurs de la surface de la terre et
les chroniqueurs. En vérité, voilà ce que nous avons pu rassembler avec l’oeil de la connaissance certaine.
26. Entre chaque tour, il y a vingt-cinq courtines. D’après ce calcul, les courtines des deux épaisseurs de la
muraille d’Alexandrie sont, au total, au nombre de (---) courtines. Sur chacune d’elles, un veilleur monte la
garde chaque nuit.
27. Les portes des murailles de cette forteresse sont à ce point des perles aussi blanches que des oeufs
qu’on dirait une unique perle massive. Depuis la terre comme depuis la mer, elle jette son éclat d’une
distance de cent mil ou de deux étapes sous le soleil rayonnant de feu. À présent, la terre est venue d’un
côté sur la couleur de la surface du mur, mais il n’y a pas eu de brèche. Toutefois, il y a une brèche à la
base de la muraille au bord de la mer et celle-ci s’est écroulée sur une longueur de cinquante aunes
mecquoises.
28. Mais, depuis quatre-vingts ans, les familles qui vivent à l’intérieur de la forteresse sont (dans les
maisons) de plus en plus ruinées. Du côté nord de la forteresse, entre les deux ports, une nouvelle ville
ornée est en train (d’apparaître).
29. Le corps et l’aspect de cette forteresse, ainsi que ses fondations, s’étendent en longueur du nord et au
suroît. Par exemple, sa longueur depuis la Porte de Rosette jusqu’à la forteresse intérieure est sa position
fondamentale en longueur.
30. Mais, sous le califat de Monseigneur ‘Ömer, ‘Amr bnü-l-‘As la conquit. Sous les Abbassides, les
Ayyoubides et les Omeyyades, elle aurait été si florissante et peuplée qu’elle comptait deux mille six cents
mihrab et soixante-dix-sept mille maisons particulières.
31. Les bâtiments situés hors de la forteresse devaient dépasser toute explication et description car,
d’Alexandrie à Rosette, il y a douze heures d’une route au long de laquelle s’étageaient de hauts palais, des
jardins et des plaines fertiles. Au bord de la mer, il ne devait pas y avoir une aune de terre inoccupée. De
même, à l’ouest, jusqu’à ce qu’on parvienne à la Vieille-Alexandrie, à douze heures de là, les coqs sautaient
de terrasse en terrasse et de toit en toiture jusqu’à ce qu’ils tombent dans une trappe. Du côté du sud, il en
allait de même jusqu’à Demenhur, à douze heures de là, où, sur la rive du canal Nasiriyye, palais et jardins
paradisiaques devaient s’étager. Les vestiges des bâtiments se voient encore aujourd’hui.
32. À l’intérieur de la forteresse, (la ville) a du avoir vingt mille boutiques, deux mille citernes communiquant
avec l’eau du Nil et trois mille puits. Il y aurait eu cent soixante-dix hammams, deux cents couvents, cent
cinquante caravansérails, des marchés couverts en trois endroits, des places d’agrément en trois endroits,
des places de marché en sept endroits. C’est ainsi que lors de la conquête par ‘Amr ibnü-l-‘As, (la ville) fut
présentée à Monseigneur ‘Ömer. Sur les biens pris lors de la guerre sainte, la charge d’or pur de mille
chameaux blancs et d’autres étoffes de grand luxe lui furent envoyées en présent.
LXIX. DANS LEQUEL SONT EXPOSES LES BATIMENTS DONT LES VESTIGES SUBSISTENT JUSQU’A PRESENT A
L’INTERIEUR DE LA FORTERESSE
1. À l’intérieur de la Porte de Rosette, il y a huit cents maisons, trois cents à l’intérieur de la Porte du Lotus,
deux cents à l’intérieur de la forteresse, sept cents à l’intérieur de la Porte de la Mer, trois cent quatre-vingts
boutiques, sept caravansérails, un marché couvert. Il y a aussi trois cents maisons appartenant à des
familles chez lesquelles elles avaient été transmises de père en fils par voie d’héritage, dont aucun membre
ne survit dans les alentours mais qui n’ont pas (pour autant) renoncé à leur propriété.
LXX. DANS LEQUEL SONT EXPOSES LES BATIMENTS QUI DEMEURENT HABITES A L’INTERIEUR DE LA FORTERESSE
1. D’abord, à l’intérieur de la Porte de Rosette, il y a la mosquée de Seyyid Ibrahim-i Dessuki. Elle a un seul
niveau et est pourvue d’un minaret.
2. Au-delà, sur la grand-route, il y a la mosquée du Jour-Clair (Cami’u-ssafvan). On y accède par un escalier
de sept marches. C’est une charmante mosquée. Elle est construite sur vingt hautes colonnes. C’est une
mosquée à auvent. Des quatre côtés de son enclos, il y a treize colonnes, deux portes latérales et une autre
du côté de l’autan. Au-dessus de celle-ci, il y a une date, mais comme l’écriture en est confuse, on ne l’a pas
notée. Il y a deux mihrab. Quant à celui qui est contigu à la chaîne, c’est un mihrab porteur d’exemple
admonitif, fait d’un seul bloc de porphyre vert et dont l’équivalent n’existe dans aucun pays. Dans l’enclos, il
y a un figuier et un palmier-dattier qui donne d’énormes dattes, signe du fait qu’il est extrêmement âgé.
3. (En allant) du côté de l’ouest à partir de cette mosquée en suivant la même route, il y a la mosquée des
Parfumeurs (‘Attarin). Bien que le constructeur de cette mosquée fût le vizir de l’Abbasside el-Mustansir
bi-Llah, l’émir des armées nommé Ebunnecm Bedrü-l-Cemal, un autre vizir d’el-Mustansir, le vizir nommé
Evhadü-ddin fils de Hamdan, fît mettre à mort injustement Bedrü-l-Cemal. Evhadü-ddin apprit que
Bedrü-l-Cemali avait subi le martyre de manière unique et, grâce à tous ses biens, fit construire cette
mosquée par un certain Hace ‘Attar, c’est pourquoi on l’appelle mosquée de ‘Attar. Quant au vizir et chef des
armées Evhaü-ddin, ses oeuvres de bienfaisance sont (non seulement) la mosquée de ‘Attâr, mais le
Hammam d’Or et mille boutiques et caravansérails. Tout cela est dû au vizir Evhadü-ddin.
4. Elle comporte un seul niveau et un minaret. C’est une ancienne et belle mosquée, bâtiment artistement
exécuté et porteur d’exemple admonitif qu’il faut voir. A l’intérieur de la mosquée, au-dessus des pures
arches que supportent au total trente-deux colonnes de marbre, il y a un plafond doré et peint, peinture
évoquant (le monde changeant comme) le caméléon et porteur d’exemple admonitif. À l’intérieur, la
mosquée, est longue et large de cent vingt pas. Des quatre côtés, il y a soixante-quatre vitres faites toutes
de verre taillé, de cristal de roche et de müran, mais il n’y a pas de fenêtres sur les côtés. Du côté du mur du
mihrab, à la hauteur de trois hommes et d’un bout à l’autre, à mi-hauteur, le mur est recouvert, à la manière
de Sainte-Sophie à la pleine d’Islam, de marbres blancs polis avec des ondulations de toutes les couleurs,
véritables effets de l’art de Dieu, et de porphyres rouge, vert ou jaune de guêpe qui reflètent, à la manière
d’un miroir, outre les stations debout ou assise de l’assemblée qui s’incline et se prosterne, les couleurs des
visages de celle-ci. C’est ainsi une mosquée brillamment construite avec des pierres polies et fourbies.
5. L’art qui a été déployé pour la marqueterie de nacre du mihrab n’a d’égal dans aucun autre pays. Il laisse
interdit l’oeil de l’exemple admonitif de celui qui le contemple et amène l’homme à mettre son doigt sur sa
bouche (en signe de stupéfaction). La chaire est faite de panneaux de yeuse, d’acacia, de noyer et de
cyprès. La voûte palatale de l’être humain en est purifiée. C’est là tout le zèle que le maître peintre a déployé
pour réaliser cette chaire. À l’intérieur de toutes sortes d’inscriptions et de motifs de petits nuages ont été
creusés de coquets entrelacs de motifs rumi, islimi, de roses aux cent-feuilles et de branches ornées de
fleurs multicolores d’arbres fruitiers. L’habileté déployée est telle que tous les peintres et hommes de l’art
demeurent frappés de stupeur en la contemplant. C’est une chaire d’un haut degré de perfection (dont la
vue) laisse paralysé comme par magie.
6. Au-dessus de la porte de cette chaire est écrit en caractères coufiques paradisiaques le verset : « Dieu et
Ses Anges... »
7. Juste au milieu du grand enclos de cette mosquée, il y a un jardin surélevé, semblable à celui d’Irem, où
se trouvent des arbres aux fleurs de toutes les couleurs. Ceux qui y accomplissent les pratiques rituelles ont
le palais embaumé par leurs senteurs, car c’est la mosquée du Parfumeur.
8. Du côté droit de ce jardin et également au milieu de l’enclos se trouve, sous une haute coupole, un bassin
à ablutions hanéfite fait d’un seul bloc de porphyre noir poli. Des quatre côtés de ce bassin, un maître tailleur
de marbre a déployé une habileté dans laquelle apparaît la magie de Sem. Il y a représenté, entremêlés,
oiseaux, hommes et génies de toute sorte, sortis de la cour de Monseigneur Salomon, cela de telle manière
qu’en les voyant, les maîtres de cet art comme Evreng, Beh-zad, Mani, Sah Kuli, Aga Riza et Veli-Can
resteraient frappés de stupeur et sans vie. À ce point doté d’un effet magique peut être un bassin hanéfite
représentant le conseil de Monseigneur Salomon. Ce sont des images représentant toutes les créatures du
Seigneur l’Eternel sur la terre comme au ciel, tous les chérubins, ceux qui supportent le neuvième ciel, celui
du Trône, ceux qui supportent la terre et le ciel, le boeuf et le poisson, et même un moucheron boiteux au
Conseil de Salomon, figures telles que
Celui qui les voit en perd la raison.
Autre est ce spectacle-ci.
Conformément au contenu de ce distique, c’est une grande oeuvre porteuse d’exemple admonitif que la
langue serait impuissante à dépeindre et à décrire, car je n’en ai pas vu la pareille dans les pays où j’ai
voyagé pendant quarante et une années.
9. Cette mosquée du Parfumeur a sept portes car, dans les temps anciens, elle devait posséder une
nombreuse communauté de fidèles. Le mur du côté du mihrab est entièrement recouvert (d’inscriptions en)
caractères coufiques. En bref, c’est une mosquée ancienne, mine de gens vertueux et qu’il faut avoir vue.
10. Mais l’humble auteur a regardé les actes de constitution du bien de mainmorte. Il y est dit que le
constructeur en est Monseigneur Seyh Cusi, qui est enterré au Caire, sur le mont Cusi. Cela est écrit dans
les actes de constitution du bien de mainmorte et dans les registres, ainsi que ses origines qu’on a notées
plus haut. Le salut !
11. De là, en allant en direction de l’ouest, toujours par la grand-route, à proximité de la forteresse de Rükin,
LXXI. DESCRIPTION DE LA MOSQUEE DE L’OUEST
1. C’est une grande mosquée qui fait trois cents pas en longueur et trois cent quatre-vingts pas en largeur.
C’est une mosquée établissant la différence entre le bien et le mal, puissante comme une forteresse et
possédant un enclos aussi vaste qu’une plaine. C’est une mosquée fameuse dans tous les horizons sous le
nom de « Mille et une colonnes » pour celles qui se trouvent entre l’enclos et l’intérieur de la mosquée. Mais,
autour de l’enclos et à l’intérieur de la mosquée, il y a, au total, six cent quarante colonnes de marbre,
chacune d’elle reposant sur une base de marbre rectangulaire. Ce sont des colonnes blanches. Au-dessus
des arches, il y a au total sept cents coupoles maçonnées et pareilles à des bols ronds qu’on aurait
renversés. Il n’y a pas de plafond et le toit plat n’est pas recouvert de plomb. Il y a partout un enduit de
chaux blanche. Du côté gauche de la mosquée, il y a un minaret assez bas.
2. Le milieu du vaste enclos est tout entier un jardin pareil à celui d’Irem, jardin et verger fait de roseraies, de
parterres de jacinthes et de palmeraies. Il y a toute sorte de palmiers-dattiers dont chacun attire le regard
des saints de Dieu de vénérable grandeur.
3. Les décrets secrets de Dieu ont fait que l’un des palmiers-dattiers s’est pétrifié. Il se trouve dans l’enclos,
du côté gauche de la direction de la Mecque. Au sujet de ce palmier-dattier pétrifié, les gens du pays
tiennent pour cette vaine opinion que, lorsque Monseigneur ‘Ali vint à Alexandrie, il attacha sa Düldül à ce
palmier-dattier et lui dit : « Reste tranquille comme une pierre ! » Ce palmier-dattier se serait alors pétrifié.
4. À présent, les voyageurs viennent à ce palmier de pierre. En disant « Si les jours sont (fastes) et si nous
(devons) retourner sains et saufs dans le (pays de) Roum ou dans notre patrie, j’irai tout droit vers cet
arbre », ils font dix pas depuis l’arbre en direction de la Mecque, ferment les yeux (en pendant à leur)
intention et se dirigent vers le palmier-dattier. Certains y vont tout droit, d’autres perdent leur chemin. Par les
décrets secrets de Dieu, celui dont l’intention est sincère y parvient et retourne dans sa patrie d’origine en
des jours favorables. L’intention de certains autres n’est pas sincère et ils demeurent à Alexandrie quelques
jours supplémentaires. C’est un palmier-dattier pétrifié dont les effets ont été observés par l’expérience. On
l’appelle « la Pierre des Intentions ». Il est comme un palmier-dattier haut d’une fais et demi la taille d’un
homme et de couleur fauve. C’est une pierre en forme d’arbre (aux bords) dentelés. On récite une fois avec
une intention sincère (la sourate) Ihlas, d’une distance de dix pas on s’avance vers l’arbre et celui qui le
frappe de sa main voit son désir exaucé. Celui qui, les yeux fermés, ne va pas droit, son désir n’est pas
exaucé et il lui faut retarder (son départ). Cela a été expérimenté plusieurs milliers de fois et est bien connu.
5. À proximité de ce palmier-dattier pétrifié, il y a une auge de pierre bleue où Monseigneur ‘Ali avait attaché
sa Düldül et lui avait donné sa pitance. C’est une pierre qui ne ressemble à rien de ce que l’on trouve dans
aucune mine. Elle est marquée d’une infinité de points noirs et blancs et, bien qu’elle soit telle, il s’y trouve
une ébréchure causée par les dents de Düldül. À présent, il y a à l’intérieur de petites pierres de la
dimension d’un grain d’orge. Depuis des temps anciens, les passants y prennent ces grains d’orge de pierre
et, (cependant,) ceux-ci ne manquent pas (de rester en quantité égale).
LXXII. AUTRE CHOSE EXTRAORDINAIRE
1. Si l’on avance de cinquante pas à l’intérieur en passant par la porte du milieu, qui se trouve à l’est de
cette mosquée, il y a une colonne de marbre. Vers elle également, certains hommes pieux marchent tout
droit en fermant les yeux et en se disant que, (s’ils y parviennent), il leur sera accordé dans l’année d’aller à
la Caaba de vénérable noblesse. Certains vont (ainsi) atteindre la Caaba, d’autres font fausse route et n’y
vont pas. L’expérience en a été faite. Comme cette mosquée est ancienne, les choses porteuses
d’exemples admonitifs y sont extrêmement nombreuses.
2. Du côté droit du mihrab de cette mosquée, à hauteur d’homme, est écrit en grands caractères, sur (une
plaque de) marbre brut, le verset : (...) « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! (...) L’Envoyé a cru
ce qu’on a fait descendre vers lui », puis la date :
Ansaa hada l-bina’a wa l-cadida l-sacinata l-kibla yas’una le vizir Sinan Pasa –que Dieu lui rende accessible ce
qu’il veut !- ma yuridu fi zamani hafr halici Iskandariyya hadihi sababu l-bunyan bi-Cami’i l-Garbi l-mubarak
Mustafa ‘ibnu ‘Abdi LLah Aga sakinu kal’ati r-rukn naziru l-cami’i s-sarif wa l-mutakallimu bihi que Dieu lui
pardonne ainsi qu’à tous les musulmans et les musulmanes. Que Dieu bénisse Notre Seigneur Muhammad,
sa famille et tous ses compagnons wa banaa fi firagi sept cent deux (1302-1303). (...)
3. Dans l’angle du côté droit de l’enclos de cette mosquée, à l’endroit appelé Kirklar Makami, la date est
écrite en grands caractères sur (une plaque) de marbre blanc : « Année deux cent cinquante-cinq après
l’Hégire prophétique (868-869) ».
4. Le mihrab et la chaire de cette mosquée sont de pierre maçonnée et de construction ancienne. Cette
mosquée a, au total, douze portes ouvertes : quatre exposées à gauche, quatre à droite et quatre du côté de
la Mecque. Mais, au-dessus de la grande porte du Sud, cette date est écrite en grands caractères sur (une
plaque de) marbre blanc le verset : (...) « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! (...) Seuls serviront
les mosquées de Dieu ceux qui croient en Dieu et au Dernier Jour. » Puis :
‘Abu N-Nasr Baksin fils de Sayyidu l-‘acalli l-‘afdal ‘Abu Husayn Sami –que Dieu éternise son royaume- wa
ca’ala ‘aktara mulkihi a ordonné la rénovation de cette mosquée en l’année cinq cent quatre-vingt
(1184-1185).
5. Mais comme tous les documents concernant le statut de bien de mainmorte de cette mosquée se
trouvaient dans la forteresse et ont été détruits, elle est demeurée sans communauté de fidèles et tombe en
ruine. Que Dieu le Très-Haut la restaure, amen !
6. A cent pas de distance du côté gauche de cette mosquée, le couvent de Seyh Musa est un grand Seuil
dont le périmètre est de quatre cents pas. Tous ses pauvres derviches et cheiks sont (des disciples de)
Seyyid Ahmedü-l-Bedevi. C’est un couvent Ahmedi prospère. Les bénédictions (de celui-ci) sont prodiguées
aux passants.
7. Devant l’ancienne salle du Conseil, au-delà de la route, se trouve la mosquée de Monseigneur ‘Ömer.
Comme elle a été construite au moment de la conquête, il n’y a pas (dans la ville) de mosquée plus
ancienne. C’est une petite mosquée à un étage, pourvue d’un utile minaret de modestes dimensions. À
gauche du mihrab, il y a aussi un petit mihrab fait d’un seul bloc de porphyre vert. Mais cette mosquée n’a
aucun enclos. C’est une petite mosquée.
8. Au nord de celle-ci et au-delà de la route, il y a la petite mosquée de Sinan Pasa, bien décorée et au
plafond peint, dotée d’un minaret, mais qui n’a pas d’étage ni d’enclos.
9. La mosquée qui se trouve à l’intérieur de la Porte du Lotus est également une petite mosquée sans
enclos, mais pourvue d’une école, d’une saquieh et d’une communauté de fidèles.
10. Il y a aussi la mosquée de Göm-dikke, celle de Burhaniyye, celle de Mustafà Efendi qui se trouve
dans le marché du faubourg extérieur et possède une nombreuse communauté de fidèles, celle de
‘Abdü-LLatif Efendi, celle de Seyh Hamza Efendi, celle d’Ernassi, celle de Temraz Beg, celle de Seydi
‘Abdu-LLahü-l-Megaveri, celle de Sultan Kaytbay, dans la tour du port, et une dans chacun des trois forts.
11. D’après ce compte, il reste à Alexandrie vingt-sept mosquées où le prône est prononcé. On arrive à
soixante-quinze avec les petites mosquées. Mais certaines mosquées ouvrent le vendredi et l’on y accomplit
les pratiques religieuses, puis elles demeurent fermées le reste du temps car, au milieu des ruines, elles
restent sans communauté de fidèles. Comme les documents relatifs au statut de biens de mainmorte de ces
mosquées ont été détruits, les salaires déterminés du personnel de service sont entièrement donnés comme
aumônes par la douane et imputés sur les revenus du pacha.
12. Outre ces mosquées, il y a au total cent soixante mihrab de mosquées. Dans cette forteresse, il y a au
total six hammams, il n’y a pas de hammam dans le faubourg extérieur. Il y a d’abord le hammam du Nebi,
le Hammam d’Or, celui du Bey et le Vieux-Hammam, mais celui de Sinan Pasa est un grand bâtiment
éclatant de blancheur qui est, entre tous, le plus réjouissant et dont l’eau et l’air sont les plus agréables.
13. À l’intérieur de cette forteresse, il y a au total cent trente citernes d’eau. Chaque année, le kasif de la
Buhayre vient avec trois cents boeufs et en un mois entier remplit toutes les citernes à ras bord avec l’eau du
canal Nasiriyye. Trente bourses égyptiennes sont ainsi dépensées sur les biens impériaux et imputées sur
leur comptabilité. Après que ces citernes ont été remplies, la ville d’Alexandrie reprend vie, car elle n’a pas
d’autre source d’eau courante. Mais, à l’intérieur de la forteresse, il y a, à proximité de la Pierre Dressée, un
petit puits d’eau de jouvence dont l’eau est extrêmement délicieuse.
14. Mais cela ne suffit pas pour une populeuse et grande ville portuaire. Après avoir approvisionné
Alexandrie en eau, le kasif de la Buhayre donne aux douze aghas en fonction dans l’administration
d’Alexandrie deux bourses (prélevées sur les) haliyye et ceux-ci, pour leur part, représentent au pacha, avec
des remerciements, que le kasif aga a approvisionné Alexandrie en eau. Si le kasif ne donne rien sur les
haliyye, aussitôt, tous les notables du pays font au vizir du Caire un rapport défavorable sur le kasif. À
présent, alors que tous les notables du pays vendent quotidiennement plusieurs milliers de chamelées
d’eau, c’est une injustice extrême à l’égard du Kasif.
15. À l’intérieur de la forteresse, le marché Sinaniyye, sur la grand-rue, compte cinquante boutiques. Il y a
aussi le marché des Maghrébins qui compte trois cents boutiques et a un marché fermé.
16. Les bayles de Venise, de France, d’Angleterre et de Gênes résident dans les caravansérails de Sinan
Pasa et de ‘Ali Pasa. Dans le caravansérail Davudiyye résident les marchands de drap de laine maghrébins.
À l’intérieur de la Porte de Rosette, il y a cent boutiques, cinquante à la Porte du Lotus et, en outre,
beaucoup d’autres dans le faubourg peuplé et prospère.
17. On dit qu’il y a quatre-vingts ans qu’on a commencé à construire une ville nouvelle, peuplée et prospère,
sur le cap qui est situé au milieu des deux ports. De hauts palais, des caravansérails et des mosquées sont
encore en train d’être construits. Il y a, au total, trois cent vingt-cinq maisons, grandes et petites, mais la
plupart d’entre elles sont sans étage.
18. Le côté de ce faubourg qui donne sur le Port-aux-Galères mesure mille sept cents pas. Du pied de
l’Arsenal jusqu’à ce qu’on parvienne devant le Port-aux-Galions, le faubourg fait deux mille pas. D’après ce
calcul, ce faubourg (a un périmètre de) trois mille sept cents pas.
19. Dans ce faubourg, au bord de la mer, il y a la douane et les magasins, les caravansérails de Mendil-zade
Mustafà Aga, de Sinan Pasa, de Mustafà Pasa, de Hüseyn Pasa, de (E)nis et de Hace Mehemmed. Ce sont
des caravansérails prospères et solides.
20. Il y a sept couvents. Parmi eux, celui de Kara Kasim Pasa, maître de Kara Kadirga, est un grand Seuil
de Monseigneur ‘Abdü-l-Kadiri-l-Cilani. Il a soixante-dix pauvres derviches, des cellules, une sema-hane et
une cuisine digne de celle de Keykavus. Ses bienfaits sont prodigués à tous les passants, car l’acte de
fondation est solide.
21. Il y a aussi un seuil de félicité qui se trouve sur le rivage du Port-aux-Galions, qui est celui de
Monseigneur Seyh Ibrahim Gülseni, mine des compagnons de la connaissance. C’est là une demeure où
résident des voyageurs de l’Inde et du Yémen, des Arabes et des Persans, car ils y sont accueillis
gratuitement. Il y a là beaucoup de derviches aux mille arts et dévoués de tout leur coeur. Comme ce
couvent se trouve à proximité du tribunal, on l’appelle aussi « Couvent Véridique », c’est-à-dire « Couvent
des Hace ». En langue arabe, on l’appelle la « Voie véridique ». C’est un haut observatoire.
22. D’autres couvents se trouvent à l’intérieur de la forteresse, mais ceux qui ont été mentionnés sont dans
le faubourg. On note aussi quelques autres couvents à l’endroit de lieux de pèlerinage.
23. Dans ce faubourg, il y a, au total, sept cents boutiques et trois cents magasins. Car, comme c’est une
échelle commerciale, lorsque des navires de tous les pays y arrivent, les marchands entreposent leurs
marchandises dans les magasins. De ce fait, ces derniers sont extrêmement nombreux.
24. Il y a douze cafés bien décorés, dont chacun peut accueillir cinq cents hommes. Chanteurs, joueurs de
saz et musiciens y jouent nuit et jours des compositions de Hüseyn Baykara.
25. Pour la plus grande partie, le marché sultanien est entièrement recouvert d’un revêtement de pierre. Les
autres grands-rues étant en terre sableuse chargée de sel, elles n’ont pas de revêtement. À présent, c’est
un faubourg qui est en train de gagner en prospérité. Mais il n’a ni vergers ni jardins ni eau ni hammams. Il
faut faire venir à dos de chameau ou de mulet l’eau des citernes qui se trouvent dans la forteresse.
26. Comme ce faubourg est un lieu bas situé entre la mer des deux ports, la terre en est chargée de sel et
aucun arbre n’y pousse. Parfois, du fait de la pluie ou du bouillonnement de la mer, celle-ci pénètre dans le
faubourg qui devient (alors) un vaste marécage. Mais comme le sol est chargé de sel, il sèche partiellement
grâce à l’effet de l’air.
27. Quant au côté occidental de ce faubourg, il s’y trouve, au bord de la mer, l’endroit appelé cap du
Port-aux-Figuiers. C’est un endroit très élevé où la terre est jaune. De ce côté-là, il y a partout des figueries
qui donnent des figues extrêmement agréables et impeccables.
28. Il n’y a de mur de fortification sur aucun des quatre côtés de ce faubourg. Chacun y dit donc : « La terre
de Dieu est vaste » et construit sa maison. Mais cela est extrêmement défavorable : que les mécréants
lancent à l’improviste une attaque de nuit avec leurs navires et il réduira toute la population en captivité.
Mais il n’en va pas ainsi. Le Seigneur l’Eternel a accordé à cette ville un bienfait : sur chacun de ses rivages
se trouvent de petits blocs de pierre semblables à des récifs. Il n’est en aucune manière possible pour
l’ennemi de débarquer ni de s’approcher pour triompher de cette ville.
LXXIII. DESCRIPTION DU PORT-AUX-GALIONS
1. Dans ce faubourg, si tu te diriges vers la tramontane, le port qui se trouve du côté droit s’appelle le
Port-aux-Galions. C’est là que jettent l’ancre toutes les saïques, les kara-mürsel, les galions, les pink, les
sitiye, les potac, les burtun et les djermes.
2. L’entrée de ce port ouvre à la tramontane-nordet et, des deux côtés, est pourvue de forts de grandes
dimensions. De l’un à l’autre, ce port fait juste dix mille pas.
3. Ce port peut accueillir un millier de navires. C’est un grand port. Comme son entrée ouvre au nordet, il est
extrêmement tempétueux.
4. Tous les navires y mouillent par quatre ou par cinq, à la force de l’ancre. Quant aux saïques, elles
mouillent à l’abri du grand fort et la tempête n’a aucun effet sur elles. Dans les autres endroits, on mouille
l’ancre maîtresse. C’est un mouillage au fond pierreux. Il n’y a pas de sable (au fond).
5. En entrant dans ce port et en en sortant, il y a, du côté gauche du port, au pied du grand fort, un rocher
bas à fleur d’eau qu’on appelle le rocher de Meymuncuk. C’est le rocher sur lequel se trouvait, lorsque
l’ambassadeur d’Espagne vint auprès des Omeyyades sous prétexte d’embrasser l’Islam, le phare de vigie
d’Alexandre, qui était le miroir talismanique de celui-ci et qui, depuis ce temps-là, est en ruines. (De ce fait,)
plusieurs milliers de navires ont heurté ce rocher et ont péri. À présent, ils pénètrent dans le
Port-aux-Galions de cette Alexandrie qui est la belle de la mer, et en sortent au large du fort afin de se
préserver des brèches que peut faire le rocher de Meymuncuk. Il n’y a pas d’autre remède.
LXXIV. DESCRIPTION DU FORT DE L’OUEST
1. Au temps des mécréants, les forts qui se trouvent à l’entrée de ce port devaient être des tours utiles et de
dimensions réduites car, en ce siècle-là, le Miroir d’Alexandre faisait périr par le feu les navires ennemis qui
venaient contre la forteresse. De ce fait, il ne devait pas y avoir besoin d’un puissant fort.
2. Ensuite, à la date de l’année 877 (1472-1473), Sultan Kaytbay le reconstruisit. La tour du fort intérieur est
également une construction qu’il fit.
3. Chacun de ces forts a une mosquée, des citernes, quarante à cinquante logements pour la garnison, une
maison richement ornée et parfaitement achevée, ainsi que quarante à cinquante canons balyemez.
4. Au point le plus haut du fort intérieur de cette forteresse, il y a un haut pavillon de Sultan Kaytbay qu’on
croirait être celui de Havernak. C’est un pavillon qu’il faut voir. Sur l’un des côtés, il y a un fanal semblable à
une petite tour, avec des vitres aux quatre côtés. Chaque nuit, des veilleurs s’assoient à l’intérieur de ce
fanal et y font brûler à flamme continue de l’huile de poisson afin que les navires qui sont en mer pendant la
nuit voient ce fanal et se dirigent vers Alexandrie. De nuit, il est visible d’une distance de cent mil.
5. Par la suite, Sultan Selim conquit Alexandrie et construisit à l’extérieur de ce fort une nouvelle épaisseur
de fort, puissante muraille pourvue de tours et de courtines qui se dresse face à la mer en opposant à
celle-ci sa poitrine. Tous les canons les plus achevés sont dans ce fort. En vérité, c’est la Muraille de Selim
Han.
6. Le périmètre du corps de ce fort est de huit cent cinquante pas. Il s’y trouve cent canons, grands et petits.
Lorsque chacun d’eux lance son projectile, ils rugissent comme le dragon aux sept têtes et protègent les
quatre côtés du port. Mais il y a dix canons dont les pareils ne se trouvent peut-être que dans la forteresse
de Kanije, à Egre, à Budin et dans la forteresse de Rhodes. Chacun d’eux tire des boulets de fer de
quarante vakiyye. Il y a dix canons sa’ika dans chacun desquels un homme peut s’asseoir et qui tirent des
boulets de pierre. Un seul de ceux-ci suffit s’il atteint une fois un navire ennemi. Dans la crainte de ces
canons, les galions mécréants qui entrent dans le port se montrent dociles et acquittent des droits de
douane. N’étaient ces canons, les mécréants pénétreraient dans le port dont l’entrée est si ouverte et en
sortiraient sans acquitter de droits de douane. Que Dieu t’en préserve ! Ce sont de puissants forts. Les dates
de certains des canons portent (le nom de) Süleyman Han.
7. Ce fort a une triple épaisseur de murailles et une triple rangée de portes solides. La porte extérieure
regarde vers le suroît.
8. Ce fort est situé sur un cap. Il est bordé de deux côtés par la mer dans laquelle il s’avance comme une
langue de terre. C’est une route qui fait juste cinq cents pas. Sur deux des côtés, il y a la muraille du fort,
c’est le corps de la courtine. En certains endroits, il y a des meurtrières. Il y a douze tours sur chacune
desquelles, chaque nuit, un bölük-basi monte la garde à tour de rôle avec ses hommes. Au total, la garnison
de ce fort se compose de (---) serviteurs. Le gouverneur du fort est l’un des müteferrika d’Egypte, Ibrahim
Aga, homme courageux et capable qui appartient à une vieille famille.
9. Les deux côtés du mur qui mènent au fort au long de la langue de terre ont d’autres doubles portes et
d’autres veilleurs. Il n’est pas possible d’y introduire d’autres hôtes que la garnison du fort. Le salut !
10. En allant par le bord de la mer de ce fort vers le faubourg, il y a, à cinq cents pas, une grande tour
appelée Tour de la Vierge. Elle est entièrement dans la mer. Elle a un autre gouverneur et une autre
garnison. Elle a été construite pour protéger le Port-aux-Galions. C’est là qu’on cache toute la poudre noire
qui vient du Caire et qui est destinée au Seuil (Impérial). Elle a ses propres défenseurs. Elle a une porte de
fer qui regarde vers le suroît. À l’intérieur, il n’y a ni logements pour la garnison, ni aucun autre bâtiment. Le
périmètre de son corps est de trois cents pas. D’après la date qui est au-dessus de la porte, c’est une
construction de Sultan Cakmak.
LXXV. DESCRIPTION DU FORT DE L’EST
1. La tour orientale du Port-aux-Galions est aussi due à Sultan Kaytbay. Elle a un gouverneur, une garnison,
un arsenal et de bons canons bal-yemez distincts. C’est un fort situé également sur un cap, à l’entrée du
port, dont le corps mesure deux cents pas et qui a une double épaisseur. À l’intérieur, il y a une petite
mosquée et sept maisons.
2. Ce fort est, lui aussi, entouré par la mer des quatre côtés et situé sur un cap rocheux escarpé s’avançant
dans la mer comme une langue de terre longue de quatre cents pas et dont les deux côtés sont un mur de
forteresse avec des tours de vigie. C’est un petit fort avec une porte de fer ouvrant au sud.
3. En bref, du côté de ces pays arabes et jusqu’au détroit de Sebte, il n’y a pas de port aussi grand, si ce
n’est celui de la forteresse d’Acre. Le salut !
LXXVI. DESCRIPTION DU PORT-AUX-GALERES
1. Outre ce port, il y a, du côté gauche du faubourg, le grand Port-aux-Galères. Depuis la tour de ‘Ali Pasa
qui se trouve à l’entrée du port jusqu’à l’angle du fort intérieur, ce port fait quatorze mille pas en suivant le
bord de la mer. C’est un grand et vaste port, à l’abri des huit vents violents, mais avec des endroits à l’abri
des aires de vent qui se trouvent hors de l’entrée de ce port. C’est un grand port qui fait vingt mille pas.
2. Son entrée regarde aisément vers le suroît. Tous les bâtiments, tels les galères, les firkata, les çekeleve,
les tartinar, les belkarmata et les kalyeta y mouillent sans peur ni crainte en jetant une ancre de réserve.
C’est un excellent mouillage. S’il faut entrer dans ce port par le côté de la Vieille-Alexandrie, l’amer est les
falaises de terre rouge qui se trouvent là, ainsi que les écueils situés à cinq mil au large. Il ne faut pas entrer
dans le port en suivant la côte, mais en prenant par le large à une distance d’un mil.
3. Avec les canons du fort intérieur qui se trouve à l’entrée du port, du côté du suroît, et qui a été décrit plus
haut, aucun oiseau ne pourrait s’envoler de ce port.
LXXVII. DESCRIPTION DU FORT DU PORT-AUX-GALERES
1. Toujours du côté droit de ce port, sur un haut rocher escarpé, il y a la tour de ‘Ali Pasa, bâtie de manière à
constituer la jetée d’un port particulier et qui est une muraille murante extrêmement puissante et forte. Son
périmètre est de deux cents pas. Il a été construit sur un cap rocheux. Bien qu’il semble être un petit fort, sa
puissance de feu en fait un oiseau-salamandre. A l’intérieur, il y a la mosquée de Sultan Murad III, dix
logements pour la garnison, un entrepôt pour le blé et une citerne d’eau. Il a un gouverneur et une garnison
distincts. Il y a une seule puissante porte de fer qui regarde vers l’autan, devant laquelle se trouve un
pavillon qu’habite la beauté et qui est une lieu de promenade où confluent les connaissances et d’où se peut
contempler le monde.
2. Au-dessus de la porte du fort, la date [est donnée par] ces distiques :
Dans la fortune de Monseigneur l’Empereur de l’Islam * fut construite cette tour.
Pour la base des tours et des murs, * le constructeur fut la main de ‘Ali Pasa.
De leur achèvement, les soins de Haydar Beg furent * le deyya
Il fit pour les Croyants le puissant fort * contre la Demeure de la Guerre, ce sûr refuge.
En cadeau ( ?) pour cette tour, le chronogramme : *« Bravo, marbre du beau fort ! »
année 667 [1268-1269].
3. En vérité, c’est un bâtiment puissamment construit où il y a des canons de royale splendeur et d’un art
accompli. Devant le fort, à l’extérieur, il y a des moulins à vent qui tournent jour et nuit.
4. Comme un côté de ce port est une plage de sable et que les [autres] rives sont rocheuses, il y a quarante
ou cinquante espèces de poissons qui font partie des choses merveilleuses. Il y a des rougets couleur de
rubis qui pèsent deux à trois vakiyye, des bars et des lufer de vingt vakiyye chacun et des merlans d’une
vakiyye qui ne sont pas particuliers à ce port.
5. Il y a des tortues grandes comme des plateaux, que chassent et mangent les Maghrébins.
6. Entre ce Port-aux-Galères et ce Port-aux-Galions, il y a un cap en forme de fourche qui s’avance dans la
mer en direction de la tramontane. On l’appelle le Port-aux-Figuiers. Il peut accueillir un millier de navires,
mais [le fond en] est pierreux. En cas de nécessité, les petits navires y mouillent. Ce n’est pas un mouillage
très agréable.
7. Dans ce port, il y a un petit îlot dont le pied est un excellent mouillage, car il n’est pas pierreux.
8. La terre ferme de ce Port-aux-Figuiers n’est que figueries et, la campagne avoisinante un limpide
cimetière.
9. Au bord du Port-aux-Galères, il y a les arsenaux. C’est dans ce quartier que se trouvent les logements
des ‘azeb et qu’habitent les aghas, les çorbaci et les oda-basi de la garnison. Il y a, au total, vingt bölük et
vingt logements.
10. Dans les magasins de l’Arsenal s’amoncellent tous les instruments et choses nécessaires aux navires.
11. Les douze galères qui viennent chaque année pour la poudre noire, les celliers impériaux et le trésor du
sucre jettent l’ancre et mouillent devant cet Arsenal.
12. Il y a un haut pavillon, lieu de repos pour le délassement des beys de la mer, qui se trouve sur le rivage
de la mer. Il y a aussi un pavillon du conseil de l’Arsenal. C’est une maison d’hôtes gratuite pour tous le
levend et les gurebä.
13. La plupart des gens de cette Alexandrie portent des vêtements maghrébins courts et serrés, car il y a
une Tradition de vénérable noblesse du Prophète à propos des vêtements serrés, qui fait l’objet d’éloges et
daigne dire : « Le meilleur de vêtements est court ». Ils ne portent pas de vêtements lâches comme les
Cairotes. Leurs usages sont semblables à ceux des Algérois, des Tunisois et des Tripolitains.
14. Le climat [de la ville], ainsi que les aimables jeunes gens et jeunes filles de celle-ci, sont plus estimés
que ceux du pays de Roum.
15. Parmi les plus estimés de ses produits manufacturés et de ses textiles d’origine végétale, il y a des toiles
de lin proprement faites pour y tailler des chemises, du kiz-demi fin fait de coton, du kuskus blanc, de belles
étoffes de laine pour faire des serviettes et du sahtiyan cramoisi tel qu’on n’en trouve dans aucun pays, si ce
n’est le cramoisi d’Edirne.
16. Il y a là un pain blanc particulier, des poissons de toute sorte et, sur l’île du Verger, des melons et toute
sorte de figues. Ses kebbar – c’est-à-dire ses câpres en conserve, – ses pyracanthes et, dans les plaines de
Cabir Ensari, les bonnes exhalaisons de plusieurs milliers de sortes de bonnes senteurs de fleurs d’arbres
de toutes les couleurs embaument la voûte palatale de l’homme.
17. Il y a du sel délicieux et blanc et, dans l’île des Vergers, du sable pour sablier de toutes les couleurs et
d’une telle finesse qu’on n’en trouve de semblable qu’à Azak. Dans la mer, il y a des (---) qui laissent la
raison frappée de stupeur.
18. L’agrément de son climat est célèbre dans tous les horizons. On y amène depuis le Caire des malades
qui jouissent de l’air et, par l’ordre de Dieu, retrouvent la santé en trois jours.
19. Bien que, dans les vergers et les jardins, on y récolte des dattes, des figues, des citrons, des oranges
amères, des grenades et d’autres fruits du littoral, il y fait très froid [pour eux].
20. Il y pleut beaucoup. Au siècle d’Ibrahim Pasa, alors que l’humble auteur s’y trouvait, la neige tomba,
mais disparut rapidement car [la ville] est la première du troisième climat. Le Caire est la dernière du
deuxième climat.
21. La latitude de cette Alexandrie est (---), et sa longitude (---). La population en est divisée en deux
catégories : les militaires d’une part et tous les commerçants de l’autre.
22. C’est la principale échelle de l’Égypte et le lieu de relâche de tous les navires des pays de la mécréance.
23. Comme cette ville est entourée des quatre côtés par la mer, on ne peut y récolter des grains. Toutes les
céréales et le blé viennent de la terre de la Buhayre. Quant aux vergers et jardins, les rives droite et gauche
du canal Nasiriyye ne sont que jardins plantés d’arbres fruitiers.
24. Cette ville est un passage extrêmement escarpé. La mer Méditerranée s’y trouve à l’est, au nord et à la
tramontane. Au suroît, au sud et à l’autan, il y a les lacs du pays de la Buhayre. Ce n’est qu’à l’est qu’il y a
une route sableuse allant vers les jardins de Rosette et de Remle. Jusqu’à ce qu’on parvienne en cinq
heures à la forteresse d’Aboukir, il y a les vergers de Remle. Tous les vergers productifs des Alexandrins se
trouvent là.
25. C’est ainsi que cet humble auteur décrit les formes de cette forteresse d’Alexandrie, avec son aspect
général, la situation de ses fondations, ses portes et ses murailles, ses tours et ses boulevards. Le salut !
LXXVIII. DANS LEQUEL SONT EXPOSEES LES TOMBES PLEINES DE LUMIERE DES PARFAITS SAINTS DE DIEU, DES
SULTANS PASSES ET DES AUTRES NOTABLES DE VENERABLE GRANDEUR PARMI LES JUSTES DE LA COMMUNAUTE, QUI
REPOSENT DANS L’ANTIQUE CITE D’ALEXANDRIE
1. Il y a d’abord, au bord de la mer, le grand lieu de pèlerinage de Monseigneur Seyyid Ebu-l-‘Abbas-l-Mursi,
le confident des secrets, le premier des justes, celui qui s’était reclus loin des gens.
2. Près de la tour de Mustafà Pasa, il y a celui de l’interprète des secrets divins, du combattant des lumières
infinies, du cheik Monseigneur Seyyid Yusuf el-‘Acemi –que sa secrète pensée soit sanctifiée !
3. Dans un haut Seuil à proximité de l’Arsenal est enterré le pôle du monde de la spiritualité, la mine de la
sagesse du Seigneur, le résident de la cellule du Loué, le cheik Monseigneur Yakut el-‘Arsi. Dans son
couvent, les pauvres derviches sont parvenus à la plus grande pauvreté. Il y a une mosquée et un personnel
de service. C’est un Seuil extrêmement prospère.
4. À l’intérieur de la Porte Verte de la grande forteresse d’Alexandrie, il y a le générateur de la mer (de la
connaissance) et le plongeur dans celle de la Religion, Monseigneur Sa’d ibn-i Ebi Vakkas. Au début,
lorsque la prophétie arriva à Monseigneur la Révélation, il fut de ceux qui, avec Monseigneur Abou Bakr
dont les actes répondent aux paroles, eurent l’honneur d’embrasser l’Islam : Sa’d ibn-i Vakkas, Zeyd
b. el-Haris, ‘Abdu LLah b. Mes’ud, ‘Osman, ‘Abdu-RRahman b. el-‘Avf, Zübeyr b. el-‘Avam, Bilal l’Abyssin,
Suheyb de Roum, tous ceux-là vinrent (alors) à la Foi. Mais le paradis fut annoncé à Sa’d ibn-i Ebi Vakkas et
il fut l’un des dix qui reçurent la bonne nouvelle. D’après les propos de certains chroniqueurs, lorsque ‘Amr
bnü-l-‘As conquit Alexandrie, Sa’d b. Ebi Vakkas était présent à ses côtés. On dit qu’(il mourut d’un) désordre
des entrailles et qu’il fut enterré sous la coupole qui se trouve à la Porte Verte de cette Alexandrie.
5. C’est un petit Seuil, mais il y a un gardien du tombeau. Mais, au-dessus de la tombe pleine de lumière
(Sa’d ibn-i Ebi Vakkas) et des quatre côtés, pendent sur la porte et les murs plusieurs milliers de zarb, de
pouciers, de flèches et d’arcs ornementés et de toutes sortes, laissés par des archers, et des zarb laissés
par chaque lutteur, qui plongent la raison (du visiteur) dans la confusion.
6. Mais, au sujet de ce Sa’d Vakkas, j’ai lu dans la chronique d’Edirneli Mehemmed Celebi qu’après le
martyre de Monseigneur ‘Osman, Monseigneur Sa’d abandonna le monde et, en l’année 55 (674-675),
mourut octogénaire à l’endroit appelé ‘Akik, à proximité de Médine. Son corps fut amené à Baki, à Médine la
Radieuse. C’est ce qui est écrit de manière détaillée. La vérité est que, outre le fait que l’humble auteur a fait
le pèlerinage (de sa tombe) auprès de celle de Monseigneur ‘Abbas à Baki’e, il a pieusement visité ceux qui
sont près du Pont-de-Jacob, près de Sa’sa’, à Hisn-i Keyfa dans le Kurdistan, et celle qui est au Seuil de ce
grand bâtiment à Alexandrie. Je ne sais pas de science certaine dans lequel il est enterré et où peut
s’exercer sa miraculeuse influence.
7. Le couvent de Monseigneur Yakut-i ‘Arsi est appelé « Couvent de Selam-Selam ». C’est là qu’est enterré
Monseigneur Selam-Selam Nasirü-ddin, pôle de la mer de la perle de la connaissance certaine. C’est un
grand prince qui, par ses perfections, a accompli de grandes actions –que Dieu sanctifie la secrète et grande
pensée de tous deux !
8. Monseigneur Seydi ‘Abdu-LLahi-l-Megaveri est enterré dans sa mosquée. C’est un lieu de pèlerinage de
l’élite et du commun.
9. À proximité du cap des Oliviers, le cheik Monseigneur Seyyid ‘Abdu-LLahi-l-Barki est enterré dans son
Seuil, derrière la tour de Mustafà Pasa, au cap de la Figuerie. Il a accompli plusieurs milliers d’actes
miraculeux. L’un entre tous aurait été lorsqu’un musulman que connaissait ce Abdu-LLah-i-Barki se trouva
captif. Aussitôt, avec l’oeil de la connaissance occulte, ce dernier vit que cet ami était réduit en captivité.
Aussitôt après, il exerça son influence miraculeuse et, à la vitesse de l’éclair tonnant, amena cette personne
à Alexandrie, les pieds encore entravés. C’est la raison pour laquelle tous les saints de l’Egypte l’appelèrent
‘Abdu-LLahi-l-Barki (l’Eclair). À présent, il y a dans son Seuil beaucoup de liens, d’entraves et de chaînes de
prisonniers. Jusqu’à présent, en quelques années, certaines gens ont été sauvées grâce à l’influence
spirituelle de ce prince et ceux qui étaient en captivité ont pendu leurs fers au Seuil de ce prince.
10. Près du bord de la mer est enterré Seyyid ‘Abdu-LLah el-Hicazi. À l’est de la mosquée du Parfumeur, le
cheik Seyyid ‘Abdu-RRazzak. Toujours à proximité de la mosquée du Parfumeur, Monseigneur Daniel – la
bénédiction de Dieu soit sur lui, et le salut ! – sous une haute coupole dans un Seuil très savamment fait.
Quant à son mihrab, il est dirigé vers Jérusalem, et il a un minaret bas.
11. Il y a un grand lieu de pèlerinage (au tombeau) du cheik Seydi Hakuk, près de celui de Seydi ‘Abdu-
RRazzak.
12. Il y a celui de Seyyidi Davudu-SSazeli. Sa tombe est située dans une dépression, au pied d’un amas de
décombres, derrière l’Arsenal et à proximité du pavillon de Kurafe.
13. Le lieu de pèlerinage de Seyyidi Ebu Bekr Tartusi se trouve à proximité des moulins à vent. Mais
lorsque, à date de (mil) quatre-vingt-deux (1671-1672), cet humble auteur alla auprès de Softa Mahmud
Pasa-zade (---) Pasa dans la forteresse de Tartus nous fîmes le pèlerinage de Monseigneur Daniel, qui est
enterré sous une haute coupole à l’intérieur d’un grand Seuil. C’est un grand pèlerinage, connu aux quatre
horizons. Ce doit être, assurément, à Alexandrie ou à Tartus que se trouve son lieu, car Nabuchodonosor
sortit du Kurdistan pour répandre le sang de Yahyà, détruisit Damas et Jérusalem et arriva dans la ville de
Safet. Il est clairement expliqué que Monseigneur Daniel se trouvait là et qu’il y fut fait prisonnier. Ensuite,
(Nabuchodonosor) le fit l’accompagner pendant plusieurs années, puis le libéra. (Daniel) doit se trouver dans
l’une de ces villes.
14. À l’endroit d’Alexandrie où l’on arrive à la Tour du Port, près du bord de la mer, (se trouve la tombe du)
cheik connu sous le nom de Cemalü-ddin Ebu ‘Ömer b. ‘Osman b. ‘Ömer b. Ebi Bekir b. Yunus ibn-i-Hacib. À
la date de l’année 646 (1248-1249), au temps de Yusuf Salahü-ddin Necmü-ddin Eyyüb, il devint, à
Alexandrie, l’objet de la miséricorde et on l’enterra là. Il avait vécu 72 années de sa sainte vie. Comme il était
le chambellan (hacib), c’est-à-dire le portier du père de celui-ci, Emir ‘Izzü-ddin Musek as-Salahu-l-Kürdi, on
l’appelait Ibn-i Hacib. Enfant du pays, le lieu de sa naissance, où il descendit de la matrice maternelle, est la
bourgade appelée Esna (Isne), qui se trouve en Egypte, dans le pays du Haut-Sa’id.
15. À présent, dans son Seuil, tous les titres des ouvrages et des épîtres qu’il a composés sont notés dans
l’ordre dans sa cellule. Nuit et jour, il composait au brouillon une cinquantaine de pages. C’est un grand
prince (de la pensée), l’un de ceux qui possédaient une connaissance vaste comme la mer des diverses
sciences. Parmi tous ses ouvrages figure la Kafiye, qui concerne la syntaxe et que ne parvient à lire aucun
de ceux qui ont toute la raison d’Aristote, tant (la lecture) en est un leblebi de fer.
16. À présent, c’est un lieu de pèlerinage des gens. Si une femme a lieu de se plaindre d’un homme, elle est
reçue comme hôte pendant quelques nuits dans une cellule, on trace avec le calame du plumier quelques
lignes de bénédiction, et si elle lit l’un de ces brouillons, elle acquiert la raison de Pythagore –la miséricorde
de Dieu soit sur lui ! En lisant la Kafiye (d’Ibn-i Hacib), cet humble auteur, Evliya Efendi, s’est attiré, quant à
lui, beaucoup de reproches de la part de son maître- que sa grande et secrète pensée soit sanctifiée !
17. Au-dessus de sa noble tombe, il n’y a ni coupole artistement faite, ni grand bâtiment. Il est enterré dans
une cellule enclose d’un mur rectangulaire. On y conserve ses feuillets et ainsi que les joyaux des calames
de son secrétariat. Le personnel de service est chaféite. (Le saint) était lui-même un uléma chaféite.
18. À proximité de la tombe de Monseigneur Ibn Hacib, Monseigneur le cheik ‘Amirü-l-Fevval repose sous
une haute coupole.
19. À l’intérieur de la Porte du Lotus, près de l’endroit appelé Gömü-DDikke, entre les deux murailles de la
forteresse et dans une palmeraie, Monseigneur Seyyid Mehemmed est un habitant de la muraille, dans un
Seuil aménagé dans une tour de la forteresse et pourvu d’un beau jardin pareil à celui d’Irem. C’est un grand
prince (de la connaissance) dont les effets du pouvoir charismatique se sont maintes fois manifestés.
20. Si l’on marche une demi-heure vers le sud à l’extérieur de la Porte du Lotus, il y a, à proximité du détroit
de la Buhayre et du canal de Nasirü-ddin, le Seuil, semblable à une forteresse quadrangulaire, de
Monseigneur le cheik Kasimü-l-Kebbari, soleil des secrets et lune de la vie. Il y a là une petite mosquée sans
coupole où ne se trouve aucune mouche, ni été ni hiver. Parmi les Arabes nomades du désert, la plupart des
Bihice et des Hinadi y font pèlerinage. C’est un grand prince. Il n’y a de bâtiments d’aucun des quatre côtés.
Il est enterré dans un coin du désert. Chaque mercredi, tous les gens pieux d’Alexandrie y viennent faire
pèlerinage.
21. À proximité de la Petite Tour, Monseigneur le cheik Satibi avait été enterré dans un petit couvent. À
présent, il repose dans un Seuil en ruine, sur une prairie en pente qui surplombe la mer, à proximité de la
Tour Militaire. Dans les temps anciens, le couvent, l’hospice, la mosquée et les citernes d’eau devaient être
en activité. À présent, seules subsistent les coupoles de la mosquée et, à l’exception d’un gardien du
mausolée, il n’y a plus de communauté de fidèles. À présent (le saint) repose entre quatre murs, derrière
une grille. Au-dessus de la stèle funéraire qui est à sa tête bienheureuse, il est écrit en écriture ornée sur
une pierre de marbre cylindrique : « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! (...) Toute chair est la
proie de la mort ! » Au-dessous :
Hada daru l-biladi Misr ’ahlu ddilwa s-sakina ’ilà dari l-’uhrà f’aw ‘anhu ma‘asu l-’ahakk wa tazawwadu fa-’inna
hayra z-zadi t-takwà (...) hada kabru l-fakir ’ilà LLahi r-raci ‘afwa LLahi s-sayhi –l-fakiri l-imamu l-‘alimu l-warau
r-rabikati hada s-suluku s-salihu s-sayhu t-tarikati wa ’imami l-hakikati ’Abi ‘Abdi LLah Muhammad ’aS-Sayh
’Abi R-Rabi Sulayman bnu S-Sayh ‘Abdi l-Maliki S-Satibi En l’an cent de la Tradition religieuse, au mois béni
de ramadan (mars-avril 719).
22. À côté sont enterrés les douze kapudan qui abattirent la coupole et en emportèrent les pierres au pays
des Francs. Ayant trouvé dans ce Seuil les colonnes de la coupole, ils revinrent l’année suivante mais,
lorsqu’ils virent toutes ces pierres agréées, ils vinrent à la Foi sur la tombe de Satibi. Chacun d’eux servit
jusqu’à l’heure fixée par le destin et, lorsqu’ils devinrent objets de miséricorde, ils furent enterrés auprès du
cheik avec plusieurs centaines d’autres personnes. La miséricorde de Dieu soit sur lui !
23. Il est l’auteur du Kitab-i-Satibi qui traite, en vers, de l’art de psalmodier le Coran. Lui-même devait être
aveugle de naissance. Il voyagea beaucoup dans le pays d’Andalousie et, en se conformant à Alexandrie à
l’ordre « Retourne auprès de ton Seigneur ! », il retourna dans sa patrie d’origine.
24. Au pied du Göm-i Nasur (est enterré) Monseigneur le cheik Seydi ‘Aruz, dont on dit qu’il est l’auteur d’un
traité de prosodie.
25. Au pied du Gömü-DDike, (il y a le tombeau du) cheik Seyyid Sihabü-ddin Remlevi et, près de là, celui de
Monseigneur le cheik Süca‘ü-ddin.
26. À proximité du Gömü-l-Es‘ad, il y a (le tombeau du) porte-étendard de l’Envoyé de Dieu, le cheik
Sadü-ddin, l’un des grands Compagnons.
27. Sur le Kümü-l-Es‘ad, il y a aussi le lieu de Monseigneur Hizir.
28. Dans les environs (du tombeau) de Monseigneur Satibi se trouve (celui du) cheik Mehemmed Deylemi,
auteur d’un commentaire du Coran.
29. Près de ce dernier se trouve (celui du) cheik ‘Ali Merankesi.
30. En allant à l’est d’Alexandrie, sur la route de Remle, à deux mille pas d’Alexandrie sur le côté gauche de
la grand-route, dans une palmeraie, (se trouve la tombe de) Monseigneur Cabirü-l-Ensari, dans un endroit
sableux du désert. Il est enterré sous une haute coupole, près de sa mosquée. Il est le plus grand des
Compagnons de généreuse illustration. Lorsque la population d’Alexandrie se transfère dans les vergers de
Remle, elle constitue une nombreuse communauté de fidèles pour cette mosquée de Cabirü-l-Ensari. C’est
un grand lieu de pèlerinage.
31. Dans les alentours de Monseigneur ‘Abbas-i Mürsi est enterré, dans un grand Seuil, l’un des califes
abbassides de Bagdad, Sultan Müsta ‘in bi-LLah.
32. À côté de lui est enterré un autre Abbasside, Sultan Ka’im bi-Amri-LLah Hamze ibnü-l-Mütevekkil
‘alà-LLah Mehemmed, dans un sarcophage de marbre dont les quatre côtés portent une date écrite en
caractères ornés. Il s’agit du frère cadet d’el-Müsta‘in bi-LLah Sultan.
33. Lorsque Sultan Müsta‘in bi-LLah devint objet de la miséricorde à Alexandrie, Sultan Inal nomma ce Ka’im
bi-Amri-LLah calife au Caire et lui donna l’investiture. Ce dernier, du fait qu’il était dans sa prime jeunesse,
commit toutes sortes d’actes inappropriés et commença à se mêler des ordres du gouvernement et de la
manière dont Sultan Inal exerçait l’autorité. Comme ce comportement déplut à Sultan Inal et qu’il en fut
ennuyé, il fit descendre, cinq années plus tard, ce Ka’im bi-Amri-LLah de la forteresse de Keps, au Caire, et
l’exila dans la forteresse d’Alexandrie où il habita dans le palais du roi Mukavkis. Il subit toute sorte de
désagréments du fait de Sultan Inal et se consacra à l’accomplissement des pratiques religieuses.
Finalement, il mourut à la date de l’année 863 (1458-1459) et fut enterré à Alexandrie, auprès de son frère
el-Müsta‘in bi-LLah. Mais ce n’est pas un lieu de pèlerinage.
34. Près de ce Seuil, sur la grand-route, il y a le pèlerinage de l’un des ulémas du Roum, el-Mevlà Haydar
Efendi qui, en disponibilité (de sa charge au) Caire, vint à Alexandrie et y devint l’objet de la miséricorde. Il
légua mille livres à (la bibliothèque de) la mosquée d’el-Azhar. À présent, on y lit ses livres estimés.
35. Près de là, à côté (du tombeau) du cheik Seydi ‘Aruz (se trouve celui de) l’un des juges (du pays) du
Roum, le vertueux et le parfait par le savoir et par les actes, le juge Muhtesem Ridvan Efendi qui devait être
l’un des ulémas de Sultan Murad III. Il est vrai que ce devait être un personnage plein de magnificence, car
la magnificence des bâtiments qui se trouvent sur son tombeau de vénérable noblesse en atteste. Son nom
de vénérable noblesse devait être Ridvan, et il est enterré dans un jardin digne de celui de Ridvan. Il était
originaire de la bourgade de Toyran, à proximité de Salonique. À Alexandrie, il se transféra dans l’autre
monde, jeûnant et zac muhtac dans un état de grande faiblesse. Il est l’un des personnages les plus
éloquents (du pays) de Roum et a aussi écrit de beaux poèmes.
36. Au temps bienheureux de Monseigneur le Refuge de la Révélation, le roi d’Egypte Mukavkis était le roi
des Coptes. Lorsque ‘Amr bnü-l-‘As présenta sa foi à Monseigneur et conquit l’Egypte depuis (le pays de)
Roum, ce roi Mukavkis se trouvait sous l’autorité (des gens du pays de) Roum, au rang d’un chef de tribu.
Au moment de la guerre sainte, il prêta çà et là assistance à Monseigneur ‘Amr. À Alexandrie, à l’extérieur
de la Porte du Lotus, il y a une colonne atteignant la perfection et qui dresse sa cime jusqu’au plus haut du
ciel. À proximité de celle-ci se trouve un monastère vétuste qu’on appelle Deyr-i Hanessed. C’est là qu’il est
enterré. Tous les chroniqueurs de l’Egypte sont d’avis que le roi Mukavkis est venu à la Foi. Ils écrivent que
les Coptes eux-mêmes aimaient beaucoup Muhammed –sur lui soit le salut ! et lui envoyaient en toute
occasion des cadeaux à Médine.
37. Dans cette ville d’Alexandrie sont enterrés plusieurs milliers de saints de Dieu de vénérable grandeur et
plusieurs centaines de Compagnons de généreuse illustration. Mais (les tombes) auxquelles l’humble auteur
s’est rendu en pèlerinage et sur chacune desquelles il a récité la y-s ou une fatiha sacrée sont celles des
princes dont nous avons eu connaissance et qui ont été décrites. Puisse leur influence charismatique être
toujours présente et vigilante ! La miséricorde de Dieu soit sur eux tous !
38. En ce lieu, à Alexandrie, nous fîmes halte un mois entier, y rencontrâmes tous nos amis et prîmes plaisir
et agrément dans chaque coin (de cette ville).
39. Ensuite, au moment des adieux, nous fîmes nos adieux à nos amis le gouverneur du Fort de l’Ouest,
Ibrahim Aga, à son fils, à Ahmed Corbaci, frère d’Ibrahim Aga, à Magribi ‘Ömer Aga, à Haci Cerbu‘, à
el-Hacc Seytanci et à beaucoup d’autres amis. Nous reçûmes une bourse de piastres de la part de l’agha du
pacha, dix arquebusiers d’escorte de la part du gouverneur de la forteresse et, avec nos chevaux, nous
partîmes d’Alexandrie par l’est, en suivant le bord de fla mer. Nous contemplâmes les vergers de Remle et,
cueillant de verger en verger des figues succulentes, et franchissant en cinq heures des étendues plates et
sableuses, »
- 514 - 534 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN DUMONT (du 8 janvier à février 1691)
Dumont, J., Voyages de M. Dumont en France, en Italie, en Allemagne, à Malthe et en Turquie. Où l’on voit
les brigues secretes de Mr. De Chateau-neuf, Ambassadeur de France à la cour ottomane, & plusieurs
histoires galantes, La Haye, 1694.
Jean Dumont (vers 1660-1726), publiciste français, suit d'abord la profession des armes, avant de voyager
dans presque toutes les contrées d’Europe et de se fixer en Autriche. Ses relations de voyages ont un grand
succès et lui valent l'estime de l'empereur d'Allemagne. Ce dernier le nomme historiographe et le gratifie du
titre de baron de Carlscroon.543
p. 236-247 :
« Nous partimes de Chipre le 28 au matin, & sommes arrivés ici à Alexandrie le huitième de ce mois vers le
midi.
Alexandrie autrefois si fameuse, si grande, & si belle, n’est plus aujourd’hui qu’un chétif amas de cahutes,
qui semblent n’être fabriquées que pour insulter aux déplorables ruines, sur lesquelles elles sont bâties.
Rien n’est si capable de faire sérieusement réfléchir sur la fragilité des choses humaines, que ces (p. 237)
riches morceaux de marbre, de porphire, & de granite qu’on trouve à chaque pas mélés confusement, avec
la terre, le bois & la pierre ; de tous côtés on ne voit que masures de palais renversés, dont les restes
admirables, font juger de ce qu’ils pouvoient être, mais comme cette vague description, où l’étonnement me
jette, ne vous satisferoit pas, il faut en venir à quelques particularités.
Les murailles d’Alexandrie, qui sont moins ruinées que le reste de la ville, font connoitre qu’elle avoit dix
mille de tours, & sont asseurement d’une beauté & d’une magnificence tout à fait admirable, elles sont
épaisses par tout de vingt pieds, & liées d'un certain ciment si dur que la pierre même ne saurait l'être
davantage, d'espace en espace, elles sont flanquées par de grosses tours quarées, si fortes & si massives
que chacune semble un château ; au-dedans de ces tours, il y a des citernes, des sales & des chambres
capables de loger cent hommes pour le moins, mais ce que j'ai trouvé de plus commode, & de plus utile,
sont les belles casemates qu'on avoit ménagées en terre, par dessous les murailles tout au tour de la ville, &
dans lesquelles y compris les tours, on pouvoit aisement loger cinquante mille hommes, qui par ce moyen
étoit toûjours en état de paroître en armes sur les murailles en cas de besoin, ou se rendre dans les places
de la ville, si on les y apelloit : ces murs étoient encore défendus par des bonnes fausses brayes qui
regnoient tout au tour, & qui sont encore dans leur entier, joignés à cela un bon fossé large & profond
(p. 238) & revêtu, & je pense que c’est tout ce qu’on pouvoit désirer en ce tems là pour la defence d’une
place.
Entre toutes les belles ruines qu’on trouve ici, celle du palais de César est une des plus remarquables, il étoit
d’une étenduë fort considérable, & si l’on en doit juger par la riche façade qui en reste encore presque toute
entière, c’étoit un édifice accompli, plusieurs colomnes de porphire, & de serpentin qu’on y voit les unes
encore debout, & les autres couchées, achevent d’en donner une magnifique idée ; tout proche de ces
mazures superbes, on en voit d’autres qui ne leur cedent en rien, & qui ne sont pas moins riches en Porphire
& en granite. On dit que ce sont les restes du palais des Ptolomées, il y en a encore tout plein d’autres,
aussi admirables que ceux là ; mais le moyen de pouvoir distinguer, ici fut un tel temple, & là fut un tel
palais, tout est trop pitoyablement boulversé, & depuis que cette ville fut demolie, il s’est passé un tems trop
considérable, les seules pieces qui restent bien entieres, sont la Colomne de Pompée & quatre obelisques le
tout de granite, cette colomne qu’on dit avoir été dressée par César, à la mémoire de Pompée est selon
quelques uns d’une espece de marbre, & au sentiment de quelques autres, de pierre fondue, & coulée dans
un moule, sur le lieu, ce qui est d’autant plus facile à croire, qu’on ne trouve de cette sorte de pierre dans
aucun endroit du monde, & qu’elle est d’une hauteur & grosseur si surprenante, qu’il seroit absolument
impossible d’élever une telle piece, (p. 239) cependant ceux qui tiennent que le colosse de Rhodes n’est pas
une fable, disent qu’en ce tems-là on avoit des machines bien autres que celles d’aujourd’hui, & avec
lesquelles on auroit pû le mettre sur pied ; mais je voudrois bien demander à ces Messieurs, pourquoy de
toutes ces sortes de monumens merveilleux qui nous restent de l’Antiquité Egyptienne, il ne s’en trouve pas
un de marbre ; mais seulement de granite, & d’où vient que cette derniere, qui en ce tems-là devoit être
commune, puisqu’on avoit la facilité d’en trouver des morceaux si enormes, est devenue si rare dans tout le
monde, qu’on en pouroit pas rencontrer presentement une piece, grosse comme le poing qui n’ait été
employée ; mais je veux que les carrieres dont elle a été tirée, ayent tellement fini qu’il n’en reste pas la
moindre trace, & que la nature soit devenue si foible & si impuissante, qu’elle n’ait plus la force ni la vertu
d’en produire de nouvelles, d’où vient que tout ce qu’on voit aujourd’hui, sont ou des obelisques, ou des
colomnes d’une grandeur prodigieuse, si c’étoit effectivement, une pierre ou un marbre, ne devrions nous
pas en avoir de petits morceaux, autant ou plus que de gros, aussi bien que de porphire, de serpentin & des
autres marbres precieux, ces raisons seules suffisent pour convaincre ceux qui revoquent en doute que ce
soit de la pierre coulée, d’ailleurs quand on l’examine de près, on remarque distinctement, que ce n’est
qu’un certain ciment, composé de sable & de pierre calcinée, comme pouroit être de la chaus, lequel s’est
endurci au point où nous le voyons, (p. 240) que si l’on me demande, comme ce mortier ou ce ciment auroit
peu se soutenir, à mesure qu’on l’auroit travaille, je reponds que je n’en sçai rien de positif ; mais
qu’apparemment on faisoit un moule de pierre ou de bois, enduit au dedans de quelque chose de gras, pour
l’empêcher de coller, & qu’après qu’on l’avoit rempli par le haut, & que la colomne, ou l’aiguille, étoit à peu
près seche, on rompoit le moule, & la piece qu’on avoit coulé demeuroit en son entier, quoy qu’il en soit la
colomne de Pompée est de cette pierre granite qui fait la question, sa hauteur est de quatre vingt pieds & sa
grosseur de vingt quatre en circonference, elle est posée sur un piedestal de marbre, quarré haut & large de
huit pieds, & terminée en haut par un chapiteau de même granite que la colomne, je vous laisse à juger
Monsieur, si jamais il y a eu machine au monde capable d’élever cela, quand il n’y auroit que le poids seul
sans l’embaras de la grandeur du vollume, cela seroit impossible, les quatre aiguilles dont je vous ay parlé
sont aussi de granite, & ornées de hieroglifes en relief comme celle de Rome, les unes sont debout & les
autres en terre.
C’est une merveille de ce qu’on s’est jamais avisé de bâtir une si superbe ville, dans un pays aussi
inhabitable que celui ci, les chaleurs y sont si insuportables en été, que tous les habitants en deviennent
noirs & basannés, autant que le peut être sans être absolument noirs, & pour comble d’incommodité, ils
n’ont point de fontaines pour se rafraichir, n’y ayant que deux sources dans toute l’Egypte, qui sont au Caire,
& dont (p. 241) je pourrai vous parler quand j’y aurai été, cette ingratitude de la nature a porté les Egyptiens
à fabriquer sous terre des bâtimens qui ne sont pas moins admirables que ceux de dessus, ce sont de
grandes & de vastes citernes, voûtées & soutenues, par de forts piliers de marbre, qui suportoient toute la
pesanteur des maisons & de la ville, car il n’y a point d’endroit qui ne soit ainsi creusé par dessous, & il y a
par tout des rues qui conduisent tout du long de ces citernes comme si c’étoient des maisons, de sorte qu’il
semble d’une ville souterraine, ce qui me fit souvenir des catacombes de Rome ; mais il y a bien de la
diference pour la beauté, celles de Rome sont étroites, basses & sans aucun ornement ; & celles-ci sont
spacieuses, & enrichies de marbre, & quelques unes même de porphire. Toutes ces citernes se
remplissoient au tems du debordement du Nil, par le moyen d’un grand canal qu’ils apelent le Khaalis, & qui
conduit encore aujourd’hui l’eau, depuis le Nil jusques ici, pour le service de peu de gens qu’il y a. Tout le
long de ce canal il y a des jardins qui ne sont pas beau, & dans lesquels pourtant il y a des orangers, des
citronniers, & des limoniers, fort gros & fort grande abondance.
Pour revenir aux catacombes de Rome, il y en a ici qui aparemment ont servi de modele aux Romains,
qu’on sçait bien avoir imité les Egyptiens autant qu’ils ont pû, celles-ci sont hors les murailles de la ville, en
tirant vers le palais, ce sont de grandes caves larges de quinze pieds en quarré, & hautes de dix ou onze,
dans la muraille desquelles il y a des tombeaux (p. 242) taillés dans le rocher vif, de la même maniere
qu’aux catacombes de Rome, mais avec plus d’ordre & plus d’art, il y a encore beaucoup des squelettes
tous entiers quoi qu’il y ait peut-être plus de deux mille ans qu’ils soient là, l’entrée de ces caves est fort
basse & étroite, ce n’est proprement qu’un trou par lequel il faut le fourer & couler plusieurs pas, avant que
d’y arriver.
Les habitants de ce pays sont fort mêlés, il y a des Turcs naturels, des Mores, des Arabes, des Grecs, & des
Juifs ; les Arabes sont les plus à craindre ils battent presque toujours la campagne, & devalisent ceux qu’ils
rencontrent sans misericorde, de maniere qu’il faut prendre garde à ne marcher que bien accompagné, il y
en a pourtant quelques uns qui demeurent dans les villes, & ceux là sont les plus honnêtes, mais si vous les
en voulés croire ils sont tous magiciens. C’est une manie de la Nation qui n’a gueres d’autre étude que
celle-là, ils ont plusieurs manieres de deviner, les uns le font par inspiration, d’autres par vision, & d’autres
par des febves qu’ils mettent au hasart dans un sac, & puis comptant combien il y en a, ils vous rendent
reponse sur ce que vous leur demandés. Ceux qui passent pour les plus habiles, sont ceux qui devinent par
vision, & sont aussi les plus rares, car quand aux autres les rues en sont pleines, je n’ay jamais ajouté fiy à
toutes les histoires qu’on m’en a faites, tant en chrétienté qu’en ce pays ici, parcequ’ordinairement on ne
conte que des ouï dire ; mais le capitaine de nôtre vaisseau, m’en a dit une qui veritablement me surprend
(p. 243), d’autant plus qu’il est homme d’honneur, & qu’une partie du fait est atestée de tout ce qu’il y a de
François dans Alexandrie, la voici telle que je l’ay aprise. Le capitaine Carbonneau, Maître du navire le
St. Augustin, faisant le voyage de cette ville, fut chargé à Marseille d’un group ou sac de deux cent piastres
Sevillannes, qu’il reçût sans compter & en donna police, étant arrivé il le rendit à celui à qui il étoit adressé,
lequel le comptant sur le champ y trouva cinquante piastres de manque, de sorte qu’il refusa de le reçevoir &
fit un procés au capitaine pour le surplus ; Carbonneau cependant fit de grandes perquisitions sur son
vaisseau, pour découvrir qui étoit celui qui avoit dérobé ces cinquante piastres, & soubçonnoit fort son
Ecrivain & son Chirurgien, comme les seuls qui avoient entrée dans la chambre ; & ne pouvant en apprendre
aucune nouvelle, il se resolut d’aller trouver un devin Arabe qui passoit pour fort habile, & le pria de lui faire
connoître les voleurs de son argent, cet Arabe qui devina par vision, ayant fait les évocations & les
cérémonies, lui dit qu’il voyoit un sac de coüetis rayé, dans lequel un homme fait d’une telle maniere, venoit
de compter cent cinquante piastres, & puis l’avoit fermé. Carbonneau reconnut à ces circonstances, & le sac
&, celui qui le lui avoit donné ; mais cela ne le satisfaisant pas entierement, il lui demanda positivement, si
on n’y avoit mis que cent cinquante piastres en tout, ou si des deux cent dont on l’avoit chargé, quelqu’un en
avoit ôté cinquante ; sur cela l’Arabe fit de nouvelles évocations &, dit (p. 244) qu’il venoit de le voir lui même
compter deux cent piastres dans le sac, & qu’elles n’avoient pas pû y contenir, vingt étant restées de surplus
hors du sac, ce qui me fait connoître ajouta il, qu’elles n’y ont jamais été, ni ne peuvent y demeurer, le sac
étant trop petit, ainsi va éprouve le, & tu verras que ce que je te dis est vrai. Carbonneau le fit, & trouva
qu’en efet les deux cent piastres ne pouvoient pas contenir dans le sac, ce que l’autre ayant reconnu de
bonne foi, le procés fut terminé. Cette affaire fut grand bruit parmi la Nation, & le capitaine fut surpris que
tous les autres, alla de rechef interoger le devin sur le succés de son voyage, quelques jours avant que de
partir, lequel lui repondit qu’il ne voyoit, ni combat ni naufrage, ni arrivée ; mais seulement quatre matelots
qu’il lui dépeignit, qui portoient du feu dans leurs mains, & qu’ainsi il se prit garde de ce côté-là.
Effectivement six jours après le capitaine ayant tiré son vaisseau au large pour faire voile le lendemain, les
quatre mêmes matelots, qu’il lui avoit représentés fumans entre les deux ponts, mirent le feu à des balles de
laine, dont il étoit en partie chargé, si bien que le vaisseau fut entierement consumé : voilà ce qu’un homme
digne de foi m’a dit lui être arrivé à lui même.
Les Arabes étoient autrefois fort sçavant, particulierement dans la medecine, & tous les chirurgiens francs
qui sont établis ici, ont tirés de très bons secrets de leur livres ; mais présentement ils ne s’apliquent plus
qu’à la devination, qu’ils regardent comme la seule science sublime, car quand à la religion ils en (p. 245)
sont ignorans autant qu’on le peut être, tout leur métier est de voler les passans, qu’ils ne tuent pas à moins
que ce ne soient des Turcs, & qu’ils ayent reçû quelque déplaisir du grand Seigneur. Ils sont divisés par
tributs, qui ont chacune leur Capitaine, & par dessus toutes il y a une espece de Duc ou Prince qu’ils
apellent Sheick el Kebir : Ils campent dans les déserts, où ils demeurent toute leur vie, & quant ils ont mangé
l’herbe dans un endroit, ils passent dans un autre, ce sont des gens tels que vous pouvés vous les figurer,
secs, noirs, & hideus, vétus la plus part de peaux de bêtes, & ne mangeant que du lait, du beure & du miel,
& de tems en tems quelque peu de chair de chameau, cuite au soleil ou dans la braise ; mais quant ils vont
en parti soit contre les caravanes ou les particuliers qui passent leur chemin, ils ne portent avec eux qu’un
peu de chair, qui se mortifie & se cuit sur leurs chevaux, & ils la mangent ainsi.
Leurs chevaux sont les meilleurs du monde, ils courent tout un jour avec une vitesse incroyable sans en être
pour cela plus fatigues ; c’est la coûtume chés les Arabes, de ne marcher qu’en courant, & de ne reposer
point pour diner, le soir ils metent leurs chevaux au piquet, & leur donnent à manger comme à eux du lait, de
la chair, & du froment, il est vrai qu’ils font plus d’état d’un bon cheval que de toutes choses au monde, &
pour n’y être pas trompés, ils en tiennent les généalogies par écrit ; avec plus de soin que la leur propre, &
lors qu’ils les vendent ou les (p. 246) troquent, ils la font voir, montrant comment ils sont descendus de male
en male d’un tel cheval, & par les femelles de tels & tels qui étoient renommés, & dont la memoire est illustre
chés eux.
Ce peuple errant et vagabond, s’est maintenu jusques ici par la foiblesse du grand Seigneur, & des Pacha
du Caire & d’Alep, qui non seulement les soufrent, mais qui pis est, payent au Skeick el Kébir une pension
qui resemble fort un tribut, car pour peu quelle tarde à venir, ils pillent, brûlent & font des ravages, que je ne
sçauroit mieux vous comparer qu’à ceux des François dans le Palatinat.
C’est assés parlé des Arabes, disons un mot des Turcs d’Egipte, avant que de finir cette lettre. Ils sont
superstitieux au dernier point, jusques là que si le matin s’étant levés, la premiere personne qu’ils
rencontrent est un chrétien, ils retournent sur leus pas, font leur ablution, & ne sortent plus de tout le jour,
persuadés qu’il leur arriveroit quelque grand malheur, cette aversion & ce mépris, qu’ils ont pour tous ceux
qui professent la foi de Jésus-Christ, se repant jusques sur les Francs, qui ne sont point exempts ici de mille
désagremens, que les Grecs même ne soufrent qu’avec peine, car sans parler de l’indignité avec laquelle on
nous renferme tous les soirs, il ne nous ai pas permis de passer à cheval dans la ville, il faut monter sur les
ânes, & si par malheur quelque Franc est surpris, en examinant quelque fortification avec un peu d’attention,
le meilleur marché (p. 247) qu’il en puisse avoir, est de payer une avance de cinq cens piastres, ce seroit
encore pis s’il avoit entré dans une mosquée ; de maniere que je ne vous manderai point si celles-ci sont
faites au dedans comme celles de Constantinople.
Quoi que les hommes soient ici fort noirs, on dit que les femmes un peu distinguées ne le sont point du tout,
par le grand soin quelles ont de se conserver, & de ne se point montrer au soleil. Ce qu’on me raconte
d’elles seroit fort plaisant s’il n’étoit point fabuleux, mais quoi qu’on me l’ait fort assuré je voudrois le voir
pour le bien croire.
On dit qu’il y a des Ecoles de filles pour apprendre à goûter le plaisir de l’amour, & à en beaucoup donner,
ce sont des femmes qui montrent ce joli métier, & qui faisant le personnage de l’homme, font faire à une
jeune fille, des postures les plus impudiques du monde, ces matrones vont aussi dans les maisons pour
aprendre aux filles de condition, celles là sont mariées bien plus avantageusement que les autres, au reste
je vous raporte ce que l’on m’a dit, & si vous me demandés positivement ce qui en est, je vous repondrai
que je n’en sçai rien.
Je croi que je partirai demain pour le Caire sur une Tartanne de Marseille, mais j’aprehende fort la bouche
de Damiete, car on dit quelle est fort dangeureuse, je suis &c. »
- 535 - 538 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIOVANNI FRANCESCO GEMELLI CARERI (1693)
Gemelli Careri, G. F., Voyage du tour du monde, Paris, 1727.
Giovanni Gemelli Careri (1651-1725) est juriste. Il fait ses études à Naples où il obtient un doctorat en droit.
Ce titre lui permet d’occuper un poste dans la magistrature dans cette même ville. Mais, contraint
d’abandonner son travail, il décide de voyager en Europe. Suite à ce périple, il écrit une relation intitulée :
Viaggio in Europa. Il entre de nouveau dans la magistrature, mais n’étant pas d’origine noble, il est
continuellement frustré. En 1693, il s’embarque pour un tour du monde qui prend fin en 1695.545
p. 46-54 (tome I) :
Après avoir fait mes provisions, je m’embarquai le Mardi 21 sur les dix heures avec un vent favorable, qui
continua jusqu’au jeudi qu’il diminua un peu ; mais comme le vendredi il redevint (p. 47) bon, nous nous
trouvâmes à la vue de la petite isle de Gozo, à l’occident de celle de Candie, que nous cotoyâmes le Samedi
& le dimanche. Le lundi 15 nous voguâmes aussi heureusement, mais le mardi il survint un calme ennuyeux.
Comme le patron étoit jeune et peu expérimenté, il voulu tirer à la mer pour éviter les basses d’Egypte ; mais
à la pointe du jour, il se trouva à 50 milles au dessus d’Alexandrie, près de Rosette. De sorte qu’ayant été
obligés de retourner sur un vent contraire, nous n’arrivâmes qu’à force de rames à Bichier, petit château à
18 milles encore plus haut qu’Alexandrie, muni de quelques pièces d’artillerie, avec une garnison de deux
cens Turcs ; il y a quelques cabanes d’Arabes autour de ce château, leurs moeurs et leurs noms font
également barbares, ils font peur à voir ; & quoiqu’extrémement pauvres, ils sont plongés dans une si
grande fainéantise, que rien ne les peut engager à travailler. On trouve ici assez de poisson & sur tout des
mulets, on en donne une tranche considérable pour deux liards, & quantité d’oeufs séchés pour un quart de
ducat. Les gens du pays ne vivent que de ce poisson-là & de fruits, car pour de viande on n’y en vend point
du tout.
(p. 48) Le patron de la Tartanne mit pied à terre le mercredi même ; quoiqu’il fut fort tard, il voulut aller
absolument à Alexandrie délivrer ses paquets au Consul. Allant donc à terre avec lui & l’Ecrivain, nous
fûmes au château de l’Aga, qui lui donna un Janissaire pour le conduire & le ramener, moyennant trois écus
& demi ; conduisant pour le service de tous les deux un cheval & un âne, qui dans ces endroits-là vont
merveilleusement bien. Il revint le jeudi de bonne heure, mais il eut dispute avec le Janissaire, celui-ci
demandant autant d’argent encore pour l’avoir ramené ; desorte qu’on fut obligé de retourner devant l’Aga
avec le Juif de la douanne, qui jugea en faveur du Janissaire. Ce sont de ces avanies que ces Barbares font
à tous moments aux Chrétiens. Comme la Tartanne s’en alloit à Chypre, & que je sçavois les rapines qui
s’exerçoient à la douanne, je formai la résolution de changer les hardes sur un autre bâtiment, sans les faire
porter à terre, afin de me rendre tout de suite à Alexandrie, comptant sur le crédit des Chrétiens, en cas que
les Arabes me fissent quelques tromperies ; mais le mauvais tems rompit mes mesures. Il me fallut tout
débarquer le vendredi, & me mettre entre les mains (p. 49) d’un Juif commis de la douanne, de deux maux
choisissant le moindre. Je logeai chez lui, & la femme m’apretoit à manger pour la moitié d’une pièce de huit
par jour.
Le samedi premier Aoust, le juif enregistra mes hardes. Je parti le grand matin pour Alexandrie : je me mis
dans une Germe ou Barque, & j’y arrivai sur les trois heures. Le Directeur de la douanne qui est aussi un juif,
se fit ouvrir mes valises pour exiger les droits ; car celui de Bichier comme son commis, les avoit seulement
enregistrées. Cependant je trouvai le moyen dans ces deux visites de cacher quelques bagatelles qui ne
laissoient pas d’être précieuses. Je me logeai dans l’Hospice de Sainte Catherine des PP. Religieux
Observantins de la Terre Sainte : aussi-tôt que j’y fus, j’allai dans l’église remercier Dieu d’être arrivé
heureusement après une navigation de 1200 milles depuis Malte. Alexandrie ou Scanderie fut bâtie par
Alexandre le Grand, suivant le plan de Dinocrate, 322 ans avant la naissance de Notre Seigneur, au
31 d. II min. de latitude. Elle est située sur le bord de la Mer Méditerranée, dans un terroir sablonneux : la
figure est plus longue que large. La vieille ville est entièrement inhabitée, (p. 50) & son ancien terrain ne sert
qu’à conserver l’eau de pluye pour les habitans. La nouvelle est assez mal peuplée sa longueur est
d’environ deux milles le long du rivage, mais sa largeur n’est pas de plus d’un demi mille ; elle seroit réduite
dans un état encore plus mauvais, & peut-être entièrement abandonnée à cause de son mauvais air, si la
commodité de son port, & la liberté du commerce, qui la rend une des principales Foires du Levant, n’y
attiroient les négocians de toute la méditerranée & de l’Océan, à cause du transport facile des marchandises
des Indes par la Mer Rouge, & de celle même de l’Egypte.
Elle a eu autrefois quinze milles de tour. Le déplorable état où elle est maintenant réduite, vient du malheur
qu’elle a eu de passer dans les mains de tant de Maîtres, de quantité de sièges qu’elle a soûtenue, & sur
tout des horribles carnages qu’y firent Antonin, Caracalla, & Maximilien Hercule.
Il y a eu quantité d’habiles gens dans Alexandrie, formés par l’Université qui y étoit établie, où plusieurs
SS. PP. Grecs ont enseigné la Philosophie d’Aristote et celle de Platon ; elle est célèbre aussi par le grand
nombre de Martyrs qui y ont confessé notre sainte Foi. On y voit sa grandeur (p. 51) ancienne dans
plusieurs Obélisques, Colomnes, & Edifices publics, dont les restes sont demeurés jusqu’aujourd’hui.
Je fus voir le jour même que j’arrivai les Maisons nouvelles que l’on y a bâties, où je n’ai rien trouvé de
grand, ni même aucune chose remarquable dans ses places ; n’y ayant dans son bazar, ou grand marché
que deux rues étroites, mal couvertes, avec de misérables boutiques de chaque côté. On y compte pas plus
de quinze mille habitans. Le port est presque rond, la nouvelle ville au Midi en occupe environ la huitième
partie. Du côté du Septentrion l’entrée en est défendue par une méchante Tour au Levant , & un moyen
château au Ponant dont les fortifications sont très-foibles, avec une espèce de Donjon pour la retraite, près
duquel est la Mosquée, mais dont l’entrée n’est permise à personne, car voulant m’approcher pour tâcher
d’en voir quelque chose, je courus un grand danger ; les enfans des Mores m’en chassèrent à coups de
pierres, quelques uns d’eux vinrent fondre sur moi le couteau à la main en me demandant de l’argent, que le
leur donnai au plus vîte pour me sauver la vie ; je ne laissai de fuir de toute ma force, voyant que le nombre
augmentoit, & j’y perdis (p. 52) ma perruque. Il est arrivé souvent la même chose, & quelquefois pis à
beaucoup de François, qui ont appris à leurs dépens combien il est dangeureux d’être curieux parmi cette
maudite Nation. En effet le Consul François m’avoit averti de ne me pas éloigner de son quartier ; mais
comme la curiosité m’est naturelle, ne faisant point d’attention au bon conseil qu’il m’avoit donné, je
m’exposai à un si grand péril. En m’en retournant, je remarquai qu’au septentrion il y avoit encore un bon
Port formé par une langue de terre qui est entre la ville et la mer.
Le lundi 3 je fus accompagné d’un Janissaire que m’avoit donné le Consul pour voir la Colomne de
Pompée546, qui est hors de la ville. Elle est sur une hauteur, que la mer laisse entre le Septentrion & le Midi ;
elle est d’un seul morceau de marbre rouge, excepté le chapiteau, le piédestal & la base, sur lesquels il y a
quelques Hiéroglyphes Egyptiens gravés. Sa hauteur est de 100 pieds ; sa circonférence de 25 celle de la
base de 85. Il y en a qui veulent que cette colomne soit quatre fois aussi grosse que celle de la rotonde à
Rome ; le Consul qui est un homme de beaucoup d’esprit, m’a dit qu’un ingénieur François s’étoit offert au
Roi de la (p. 53) faire transporter en France sans la gâter ; mais que le Grand Seigneur n’y vouloit pas
donner son consentement.
Le mardi 4 je voulus voir les Colomnes de Cleopatre. Elles sont auprès du Port : il y en a une couchée, &
l’autre debout ; le marbre en est mélangé, & on y a gravé des hiéroglyphes de tous les côtés. Je n’en pris
point les mesures ; mais autant que j’en puis juger, elles ont environ quarante palmes de tour & soixante-dix
de hauteur. Il y a quantité d’anciens Monuments dans la vieille ville & aux environs que l’on va voir.
Marc-Antoine Tambourin547, Consul de France, originaire de Marseille, ne voulant pas que je demeurasse
davantage dans le monastère des Peres, m’offrit un logement chez lui, qu’il m’obligea d’accepter le mécredi.
Il m’y régala très-bien avec quelques marchands de sa Nation. On y servit le soir jusqu’à cent oiseaux de
Chypre (comme les appellent les Vénitiens) & que je nommerois plûtôt Becfigues d’Alexandrie, tant ils sont
délicats ; car excepté les plumes, tout se mange. Je trouvai encore dans cette maison neuf autres François
qui y avoient pour moi les mêmes égards, & tous cherchoient à me faire plaisir, disant que puisque j’étois
(p. 54) un Etranger qui depensoit mon bien pour contenter ma curiosité, & faire part ensuite au public de ce
que j’aurois remarqué, ils avoient intérêt de me faciliter en tout ce qui dépendoit d’eux les moyens de faire
des observations. Ainsi comme les Etrangers paient vingt pour cent de douanne, & les François seulement
trois, par une Capitulation avec la Porte, en considération du commerce de Marseille, ils me firent jouir de ce
privilège, de même que si j’avois été de la Nation ; à quoi contribua beaucoup Henri Grimau, Marchand de
cette ville, chez qui je laissai mes hardes en partant pour Jérusalem. Précaution qui n’est pas inutile dans ce
pays-là, où la douanne est affermée jusqu’à deux cens cinquante mille écus, y compris le Caire, Rosette, &
Damiette. »
Il part pour le Caire en empruntant une germe en direction d’Aboukir (Bichier).
545 Amat di San Filippo, P., « Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia delle loro opere », dans
P. Amat di San Filippo et G. Uzielli (éd.), Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia I,
Rome, 1882-1884, p. 467-470.
546 Dessin de la colonne.
547 Voir au sujet de ce consul : Teissier, O., Inventaire des archives historiques de la Chambre de Commerce
de Marseille, Marseille, 1878, p. 168. Les archives de la Chambre de Commerce de Marseille conserve
50 lettres du vice-consul Marc-Antoine Tambouriny datée entre 1692-1695 (série AA).
À Alexandrie, réside un vice-consul depuis que le siège du consulat d’Égypte est passé au Caire, de 1611 à
1777.
- 539 - 541 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AUBRY DE LA MOTTRAYE (du 6 au 12 avril 1697)
La Mottraye, A. de, Voyages du sieur A. de La Motraye, en Europe, Asie et afrique, La Haye, 1727.
Aubry de La Mottraye (1674?-1743) parcourt, de 1696 à 1729, la plus grande partie de l’Europe et de
quelques contrées d’Afrique et d’Asie.548
p. 98-105 (tome I) :
« Nous fîmes voile ce jour-là, & fûmes si favorisez de cet Elément, qu’il nous rendit sans tempête le 6 dans
le port d’Alexandrie. La figure de ce port est exactement représentée sur ma carte B. Tome I de la
Méditerranée, & n’a pas besoin de description. J’ajouteray seulement, que l’entrée qui peut avoir un Mille de
largeur en est defendue au Nord-Est par une vieille tour, & au Sud-Ouest, par un château peu fort, appelé
Pharissar, ou Château du Phare, nom qu’il pris de l’ancienne Isle de Pharos, sur laquelle il est situé, ou du
fameux Phare ou Fanal. Cette Isle est devenue Prequ’Isle, par des débris d’un Pont ruiné, qui la joignit,
dit-on, autre fois au Continent, & par les sables que les ondes de la mer y ont apportez, & amassez. Si nous
en croyons la tradition du pays, le Phare qui y étoit autrefois, fut bâti sur le modèle de celui d’Ostie. Ce qui
frappa plus ma curiosité en mettant pied à terre, fut un admirable obélisque de granite encore debout,
auquel on donne plus de cent pieds de hauteur, plus gros de la moitié qu’aucun de tous ceux que j’ay vûs à
Rome, & tout couvert de hyerogliphes, & un autre tout semblable, mais rompu. On ajoûte qu’ils étoient tous
deux devant la façade du Palais de Cleopatre, dont on voit encore quelques ruines assez riches pour leurs
matériaux. Les Turcs qui ne savent pas même le nom de Cleopatre appelle ces ruines en leur langue Vieux
Palais, mais les Francs veulent que ç’ait été le Palais, les uns de cette Reine, les autres de Cesar, les Grecs
celuy d’Alexandre, &c. Je ne décideray pas lesquels ont raison, ils peuvent se tromper tous. Ces obélisques,
avec les anciens murs doubles flanquez de Tours à d’égales distances, comme ceux de Rome,
commençerent à tracer dans mon imagination une haute idée de l’ancienne magnificence d’Alexandrie, mais
cette idée fut bien augmentée par une grande diversité de colomnes debout, ou abatues, ou rompues,
d’architraves, de chapiteaux, de piedestaux de differens marbres, & principalement par la vue de la fameuse
colomne de Pompée. Cette colomne paroît haute de plus de cent empans, & a jusques à seize pieds de
circonférence : elle est d’une seule piece de granite, comme les Obelisques. Je fus charmé des admirables
citernes, qu’on comptoit encore alors dans cette ville au nombre de plus de quatre cents, passablement bien
conservées, de quelques milles qu’on y a comptées, dit-on, autrefois. Ces citernes sont incrustées d’un
ciment semblable à celui de la Piscine admirable de Puzzolo ; les voûtes en sont pour la plupart soutenues
de colomnes semblables à celles du reservoir de Constantinople, représentées par l’Estampe n° XIX.
Quantité d’appartemens ou logemens souterrains aussi de marbre, ou de briques, & soutenus, paroissent
avoir formé (p. 99) & fourni autrefois de rafraichissantes retraites contre les chaleurs de l’été, en faisant
comme une ville souterraine, ou inférieure, qu’on pouvoit appeler ville d’été, comme la superieure qui étoit
bâtie dessus, ville d’hiver. Mais si ces magnifiques restes donnent une si haute idée de l’état d’Alexandrie, ils
inspirent en même tems une juste horreur des sueurs de la guerre, qui renverse, ou détruit souvent en peu
d’heures, ou peu de jours, ce qui a couté des siècles entiers, avec des sommes immenses, à élever ou à
bâtir.
L’ancienne ville peut avoir eu dix à douze milles de circuit, selon qu’on en peut juger par les restes, la
nouvelle n’en a pas deux en longueur, ni plus d’un demi en largeur. Ses maisons sont generalement basses,
les Mosquées sont simples & mal bâties. La colomne de Pompée est environ à un demi quart de Mille de la
ville, sur un éminence vers le Midi. On peut découvrir de là les palmiers qui sont autour du Lac Bouchir,
autrefois Mareotis. La campagne qui regne autour de la ville est fort basse, marécageuse en quelques
endroits, sablonneuse, & peu fertile : au moins ce que j’en ai vû m’a paru tel, si on en excepte quelques
jardins assez agréables. Les Dattiers, les citronniers, les orangers, & figuiers, sont les principaux arbres dont
elle est agréablement diversifiée, sur tout sur les bords d’un profond & large canal, creusé, dit-on, par l’art,
pour conduire l’eau du Nil dans les citernes dont je viens de parler. Les eaux de ce fleuve se débordant tous
les etez, comme on sçait assez, & lavant les marécages ou les purgeant de leurs vieilles eaux qu’elles
remplacent ou renouvellent, empêche, disent les gens du Païs, qu’ils ne soient mal sains, comme ils
paroissent devoir naturellement être. L’histoire & le nom de cette ville disent, qu’Alexandre la bâtit pour être
un monument de ses conquêtes, en la cent douzieme Olimpiade, c’est à dire, cent vingt-neuf ans avant l’ere
chrétienne. Quelques-uns veulent qu’il n’ait fait que la réparer, & qu’elle s’appellât avant cela Nô. Quoi qu’il
en soit, elle devint non seulement la Capitale d’Afrique après la destruction de Carthage, mais la première
du monde, après Rome, & les Ptolomées la choisirent pour leur résidence. Elle a subi divers sièges, & sacs,
qui l’ont réduite en l’état où elle est. Le plus furieux fut quand les Sarazins la prirent sur les Grecs. Comme
c’étoit alors l’unique Place forte qui leur restât, ils la deffendirent en desesperez, mais les vainqueurs,
ennemis jurez des figures, aussi bien que des Grecs, briserent selon leur coutume statues, bas-reliefs, &c.
Quoi que je ne fusse pas encore tout à fait quite de ma fievre, les accés étoient moins violens, & quelque
foible que je fusse, ma curiosité sembloit me donner des forces pour faire certains jours jusqu’à trois ou
quatre milles de chemin, tant dans la ville, qu’au dehors. Le Grec, dont j’ai parlé m’accompagnoit presque
toûjours, n’ayant rien à faire que d’attendre quelque bâtiment pour son voyage. Le Capitaine du Vaisseau,
avec quelques Peres de la Merci, qu’on appelle Mathurins ou Trinitaires en France, qui cherchoient à
racheter des Esclaves, me menerent un jour voir ce qu’ils appelloient la Chaire de St. Marc. Elle est dans
une petite Eglise Grecque, assez mal bâtie, à laquelle ils donnoient le même nom, & où ils me disoient que
cet Evangile fut décapité par ordre d’Herode. Cette chaire est de pierre dure, avec quelques pieces de
marbre, & n’a (p. 100) rien de fort commun. Ils ajoûtoient, que son corps avoit été tiré de cet endroit, & porté
à Venise. Sur quoi je leur dis, que je m’étonnois que la République n’eût pas cette Eglise en sa possession,
puis qu’ayant tant fait que de quitter la protection de St. Theodore, pour se mettre sous celle de St. Marc,
elle auroit dû avoir cet égard pour celui-ci, d’acheter la Place des Turcs ou des Grecs : ce qui auroit été
d’autant plus facile & convenable, qu’Alexandrie étoit un port libre, où le commerce pouvoit entretenir
toûjours quelques Religieux & équipages des Vaisseaux qui y viendroient. Ils me répondirent qu’ils s’en
étonnoient encore plus que moi, & que cela avoit été proposé au senat, mais que la guerre, qui étoit
survenue en ce tems-là, l’avoit pû empécher d’y donner l’attention qu’on eût pû souhaiter. Les Peres ayant
racheté divers Esclaves de leur religion en cette ville, avoient dessein de continuer leur voyage jusqu’à
Tripoli, puis à Tunis, & par la côte de Barbarie, pour le même oeuvre pieux & charitable. En quoi ces
Esclaves Catholiques-Romains ont un grand avantage sur ceux d’une autre religion ; car ils sont bien plûtôt
délivrez ; & à meilleur marché, y ayant presque toûjours des Missionnaires sur les lieux, avec un crédit, ou
de bonnes sommes d’argent comptant, outre les Peres de la Trinité, qui y vont la bourse bien garnie des
charitez publiques pour ce sujet ; de sorte que ces Esclaves sont souvent de retour chez eux, avant que les
autres, tels que sont les Hollandois & autres Protestans, puissent donner avis de leur captivité ; ou ils sont
réduits à traiter de leur rançon à des conditions exorbitantes, par le moyen des Juifs, qui y gagnent
considérablement. Il me souvient souvent d’un Hambourgeois, qui desesperant de la liberté par cette voye
longue & onereuse, le fit catholique, & fut délivré alors par ces Peres. Les Catholiques ne sont pas privez du
libre exercice de leur Religion pendant leur captivité, comme les Protestans de la leur, les Missionnaires
ayant des Chapelles jusques dans les prisons où on les renferme, y disant la messe, & leur administrant la
Communion.
Le Grec continuant sa complaisance envers moi, me mena un jour à une église grecque, consacrée à la
panagia, qui étoit la plus belle que ceux de la religion eussent alors à Alexandrie. J’y ouis celebrer la liturgie
en Arabe, la langue la plus naturelle & la plus commune aux Prêtres, & à leurs Auditeurs de ce Païs, qui
n’entendent pas & ne sçavent pas même lire le Grec. Tous leurs Livres, & ceux de leur Auditoire sont écrits
à la main en langue Arabe.
Le Prêtre étoit habillé comme la Figure c de la planche XXIV d’un Evêque qui va celebrer la liturgie, avec (a)
l’Hippogonate pendu au côté droit, le Polo (b) sur le dos ; les vêtemens, comme sont generalement ceux des
Grecs & des Armeniens, de brocard d’or & d’argent, mais fort sales par la malpropreté si ordinaire à ces
deux Nations, que les Turcs les appellent Murdarler, impurs. Quand nous entrâmes dans l’Eglise, il étoit déja
retiré pour la préparation du pain & du vin dans le Thyrasterion ou Sanctuaire, marqué a sur la
planche XXIII (lieu où aucun laïque n’est admis, & qu’on appelle pour (p. 101) cela le lieu des Sacrez
misteres. Il y a deux tables dans ce sanctuaire, non pas autels, comme il plaît à quelques uns de les
appeller, toutes les Eglises orientales n’ayant qu’un seul autel ; la premiere à droite, appellée en Grec
Trapesa, sur laquelle on prépare le pain & le vin, avant que de le porter sur l’autel pour le consacrer ; la
seconde à gauche, nommée Skenophilakion, pour les Livres & les vases, & autres ustenciles sacrez. La
préparation se fait en cette maniere. Le Prêtre prend du pain levé, appelé Prosphera en Grec, & Mahoui ou
Zrem en Arabe, avec une impression semblable à O ou P, aussi de la planche XXIII. Il le coupe, & leve avec
un couteau, nommé en grec Agialogky, & Herby en arabe, de la figure q, ou du fer d’une lance, la croûte sur
laquelle est l’impression, qu’il met ensuite sur une espece d’assiette ou patene d’argent, appellée Agios
Discos en grec, & skence en arabe : ensuite il met du vin dans le calice qu’il couvre avec l’asterisk. Cela
étant fait, il coupe la croûte en diverses parcelles ou petites pieces qu’il offre l’une après l’autre, au nom de
la vierge, & des douze Apôtres, ou d’autres Saints, sur la pointe du couteau, & les remet ensemble sur la
patene, en les rejoignant comme si elles n’avoient pas été séparées ou coupées. Ensuite il met par dessus
l’Asterisk, & couvre tout cela, avec le calice qu’il auprès de la patene. Remarquez qu’un Diacre, Diaco en
grec, Tchemmes en arabe, habillé comme la figure e de l’estampe XXIV, tenant un encensoir, Baccour en
arabe, d’une main, & le Ripidion, espece d’écran, Meharhola en arabe, de l’autre, de la forme de r sur
l’estampe XXIII, encense continuellement, & évente, comme pour empêcher la poussière, ou les mouches de
tomber dans le calice, Keffz en arabe. Ce Ripidion répond au Flabellum Latin, quoi que l’usage en soit autre
dans les Eglises grecques que dans les latines, comme on le peut voir par ce que j’ai dit de celui du Pape. Il
est ordinairement fait d’une plaque d’argent ou de cuivre, ou de fer blanc, orné de cherubins, avec un
manche de même, ou de bois. Le Prêtre ayant préparé le pain & le vin, sortir du sanctuaire, & fit trois signes
de croix, avec trois doigts joints ensemble, en l’honneur de la Trinité, les portant premierement au front, puis
à l’épaule, & enfin à la gauche, en disant Dieu Saint, Dieu Puissant, Dieu Immortel, aye pitié, & s’inclinant
profondément à chaque fois, comme fit en même tems tout le Peuple assistant, qui avoit deja fait la même
chose selon la coutume en entrant à l’Eglise, avec la posture de f, g, de la planche XXIV chacun saluant ainsi
les images de Jesus-Christ, de la Vierge, & des autres saints, & le Prêtre même comme on voit à b qui
représente un Evêque avec sa mitre ordinaire, ou espece de capuchon, tel que le portent les Caloïeros ou
Moines Grecs, qui ressemble assez bien à celui des Dominicains. Après quoi le celebrant commença la
liturgie en la langue susdite, entonnant quelques Cantiques qui furent répondus par le choeur, ce qui ayant
duré près d’une demi heure, il alla prendre le pain & le vin, préparez dans le Sanctuaire, & puis restant
quelques minutes à la (p. 102) porte, & les présentant au peuple, la patene dans la main droite, & le calice
dans la gauche, il les eleva aussi haut que son front, en les lui montrant face à face, & non à reculons
comme les Latins, après la consécration & faisant ensuite un mouvement de tout son corps à droite & à
gauche, ce qui formoit une espece de croix imaginaire, comme fait le Diacre qui administre la communion au
Pape. Cependant le peuple faisoit des signes de croix, & chantoit alleluia, seul mot que j’entendis de
commun avec les Latins, & les grecs ; après quoi il les porta à l’autel, sur lequel il les plaça fort
respectueusement, le choeur & le peuple continuant de chanter, & un Sous-Diacre ne cessant d’encenser.
Les ayant placez sur l’autel, il prit l’encensoir des mains du Diacre, les encensa, puis rendit l’encensoir au
Sous-Diacre. Peu après il découvrit le calice, y versa encore un peu de vin & d’eau, puis découvrant le pain
il consacra ou acheva de consacrer, étant continuellement encensé par le Sous-Diacre ; & rompant le plus
gros morceau de la croûte en quatre, il le détrempa dans le calice, le mangea, puis bût à trois diverses
reprises, & donna trois des autres parcelles aussi détrempées dans le calice au Diacre, puis mit tout le reste
dans le calice, en purifiant, ou faisant tomber de ses doigts, par le moyen d’une éponge, les particules qui
s’y étoient attachées, qui formerent une espece de soupe froide au vin, que j’appelle ainsi, puis qu’il y avoit à
boire & à manger tout ensemble, le pain étant délayé dans le vin. Il n’y eut point d’autres communians qu’un
Laïque avec un petit enfant qu’il tenoit entre ses bras, & qui étoit son fils, âgé de trois ou quatre mois, & qui
paraissoit malade. Le Prêtre prenant une cuillérée de ce qui étoit resté dans le Calice la donna au pere, qui
demeura toûjours debout, en disant Créature de Dieu, reçois la communion, au nom du Pere, du fils, & du
St. Esprit, au moins selon qu’on me l’interpêta après. Puis prenant entre ses deux doigts quelques miettes
du pain détrempé, il le mit en prononçant les mêmes paroles dans la bouche de l’enfant, que le Pere lui
tenoit ouverte, & après trois signes de croix, & autant de reverences à ce Prêtre, qui lui donna sa main à
baiser, j’entends son pere, il se retira. Le Prêtre avala enfin tout ce qui restoit dans le calice, qu’il frotta avec
trois doigts, & les lecha : enfin il donna sa main à baiser à quiconque s’approcha, & distribua ce qui étoit
resté du pain de préparation.
Quelques Grecs d’Egypte & d’Abissinie sont accusez non seulement les premiers de Nestorianisme, & les
seconds d’Eutichianique, mais de retenir encore quelques ceremonies Judaïques, du nombre desquelles on
met la circoncision. Tout ce que j’ai pû entendre touchant ce dernier article, est qu’il y en a si peu
aujourd’hui, qu’on peut à peine en convaincre cinquante familles Armeniennes, dans toute l’Asie & l’Afrique.
Les Religieux Missionnaires de Rome s’en attribuoient la gloire, quelques-uns de ceux qui étoient sur notre
bâtiment m’assurant, que s’ils n’avoient pas converti autant de cette Nation à la foi Catholique, qu’ils
auroient souhaité, ils y avoient au moins réformé beaucoup d’abus, sur tout entre les Armeniens, qu’ils
disoient être plus sinceres & plus zelez pour la vérité que les Grecs, d’entre la plûpart desquels ils ne
pouvoient, disoient-ils, déraciner le nestorianisme, (p. 103) ni la procession du St. Esprit seulement du Pere.
Ils se vantoient, entr’autres choses, d’avoir aboli la coutume de circoncire jusqu’aux Filles des Coptes, qui se
pratiquoit, disoient-ils, encore en Abissinie, il n’y avoit pas trente ans.
La principale difference des ceremonies que j’ai remarquées ensuite en Turquie entre les Armeniens & les
Grecs, à l’égard de la Messe ou liturgie, est que les premiers se servent de pain sans levain un peu moins
épais que le leur, & ne mettent point d’eau avec le vin de la Communion, disant que Jesus-Christ n’en mit
point dans son dernier souper, dont elle soit être une imitation exacte, quoi que plusieurs disen que c’est la
représentation d’une seule nature en Jesus-Christ qu’ils évoquent, pour ainsi dire, ou semble évoquer le
corps de jesus-Christ du Ciel en Terre, en chantant à haute voix Corps de Jesus-Christ soit present devant
nous, pendant que les Diacres frappent assez harmonieusement des plaques rondes de cuivre l’une contre
l’autre ; que le Prêtre porte ensuite le pain & le vin en procession autour du Sanctuaire, étant accompagné
d’Acolites ou Sous-Diacres avec des cierges allumez, puis ayant posé l’un & l’autre sur l’autel, prononce
dessus les paroles d la consecration d’un ton un peu élevé, pendant lesquelles un Diacre l’évente d’un
Flabellum de cuivre ou d’argent, comme celui des Grecs, ou plûtôt qui n’en differe que par de petits grelots
attachez autour, selon que les représente sur la planche XXIII ; il prend de nouveau ce pain & ce vin entre les
mains & les montre au peuple, en se tournant à droite & à gauche, faisant la croix comme les Grecs, &
disant, voici le Corps de Jesus-Christ avec son sang livrez pour vous.
Il faut remarquer que les Grecs montrent ainsi le pain & le vin avant la consecration, & que tant eux que les
Armeniens ne témoignent pas plus de respect pour l’un & l’autre après qu’avant cette consecration, & quand
on leur demande s’ils croyent l’anéantissement du pain & du vin, ils répondent aussi bien que les Grecs,
sans se donner la peine d’expliquer leur croyance, « Nous croyons qu’en vertu des paroles consecratoires,
le Corps de Jesus-Christ est où il n’y avoit que du pain. Nous ne le comprenons non plus que l’union de la
Nature Divine à la Nature Humaine, & nous le mangeons en communiant ; nous ne sçavons pas si
St. Pierre, ou les autres Apôtres en croyoient plus que nous, & s’ils en pourroient donner d’autres raisons. »
tout ce que j’ai pû recueillir ou conclure de leurs réponses, est qu’ils admettent la Consubstantiation ou
l’Impanation des Lutheriens, sans en sçavoir les termes. Au reste, ceux qui disent qu’il n’y a plus de pain
après la consécration, mais un total changement d’une substance en l’autre, ou Transubstantation, sont
accusez non seulement par les Protestans, mais par leurs propres compatriotes attachez à leurs anciennes
opinions, d’avoir apris ce langage des Latins, qui embrouillent, ajoûtent-ils, les paroles de Jesus-Christ, sous
prétexte de les expliquer. Pour dire ce qui en est, ils sont les uns & les autres, j’entends les Armeniens & les
Grecs, dans un tel chaos, tant à cet égard qu’à celui de l’unité de nature en Jesus-Christ, & de divers autres,
aussi bien que les Nestoriens, touchant les deux personnes, qu’il faudroit être quelque chose au dessus de
l’homme pour en tirer quelque lumiere. Ils se contredisent non seulement eux-mêmes dans leurs réponses
aux (p. 104) questions qui leur sont faites, mais encore n’ont, comme les Grecs en general, presque
conservé de leur ancienne religion que l’extérieur, les ceremonies avec certaines formules de pierres, de
chants, & y ont ajoûté quantité de jeûnes. Et quoi qu’ils prient tous en une langue connue, ils le font avec
incomparablement moins de dévotion ou de zele que les Catholiques-Romains, ou avec très peu d’attention
& de révérence, même les Prêtres & les Diacres, dont les regards qui errent ça & là pendant l’Office Divin,
témoignent qu’ils sont occupez de toutes autres pensées que de celles qu’il exige.
Les Armeniens different encore des Grecs à l’égard de la forme des habits sacerdotaux, portant leurs Etoles
plus étroites, & leurs chappes presque à la Latine, comme (x) de la planche (I). Au reste, ils sont divisez en
diverses branches, qui s’appellent les uns les autres Héretiques, à sçavoir, Eutichiens, Jacobites, &c.
comme les Grecs en Coptes, Nestoriens, &c., & chaque parti prétend être le seul Orthodoxe. Ils s’accordent
generalement à l’égard des images peintes & non taillés, & des abstinences fréquentes de viandes, beurre,
lait, poisson, &c. Ces branches ou ces Sectes ont leurs Patriarches distincts, qui prennent les mêmes titres
que ceux des corps dont elles se sont séparées, quoi qu’ils ne résident pas aux mêmes endroits.
Le Pape donne aussi de semblables titres à ceux qui reconnoissent son autorité, quoi qu’ils soient déja
créez, ou qu’ils les ait créez lui-même. Ceux-ci résident ordinairement à Rome, & sont appellez
géneralement Patriarches ou Evêques in partibus infidelium, car il fait autant des uns & des autres, qu’il y a
de Patriarcats & d’Evêchez en Asie ou Afrique, & dans l’Europe Turque, & ceci tant pour les Armeniens que
pour les Grecs. Plusieurs même résident sur les lieux, sur tout où il y a des Francs établis, comme l’Evêque
de Constantinople qui réside à Pera.
Les Prêtres Armeniens administrent le baptême par immersion, non seulement en plongeant dans la cuve,
comme j’ai déja dit, l’enfant trois fois, mais encore & assez fréquemment dans des rivieres. Les personnes
riches sont fort magnifiques dans la ceremonie de ce Sacrement. Ils la font faire par le Patriarche, ou
quelque Vertabiet, ou Docteur de considération, accompagné du Clergé en habits Sacerdotaux, & l’on
choisit, dis-je, au lieu de la cuve, une riviere, ou quelque fontaine assez profonde. Si c’est une riviere, on s’y
rend sur des bateaux ornez de branches d’arbres, avec des fleurs, & le Patriarche avec son manteau
pontifical, comme sur la planche (I) plonge trois fois l’enfant dans la riviere ; après quoi il l’oint avec le Myron
ou l’huile benite. La ceremonie finie, tant ceux qui l’on faite que les assistans, se rendent au logis du Pere, &
passent le jour à bien manger & boire.
Pour la communion ils la donnent non seulement jusqu’aux plus jeunes enfans, comme les Grecs, mais
même quelques-uns d’eux la mettent dans la bouche des personnes nouvellement mortes, ce qu’ils
appellent, comme les Catholiques font que la derniere communion qu’ils donnent aux malades avant de
mourir, Saint Viatique, le considerant comme une espece de passeport pour le ciel. Cette superstition des
Armeniens paroît tirer son origine aussi-bien que son nom de l’obole, ou piece de monoye, que les Payens
mettoient dans la bouche de (p. 105) leurs morts pour payer à Caron leur passage dans les Champs Elisées.
Un autre usage superstitieux & plus commun entre les Armeniens est d’oindre les corps morts de leurs
Ecclesiastiques de Myron ; ce qui répond assez à l’extrême-onction qu’administrent les Catholiques aux
Agonisans. Un de nos religieux entendant qu’on oignoit ainsi un prêtre de cette nation mort à Alexandrie,
lorsque nous y étions, en prit occasion de déclamer contre cet usage, qu’il appelloit sacrilege, & qu’il mettoit
au nombre des abus que les Missionnaires n’avoient pû encore deraciner.
J’avois entendu dire, & lû, que les Coptes se vantoient d’avoir quelques parties du nouveau Testament
inconnues aux autres Chretiens, qu’ils nommoient les Secrets de St. Pierre : j’ay demandé à plusieurs ce
que c’étoit, & de plus extraordinaire que les autres. Je n’en ay pas trouvé deux en cent qui eût entendu
parler de l’existence de ces Secrets. Ceux qui prétendoient en sçavoir quelque chose, ayant apparemment
honte d’apprendre des Etrangers, ou d’ignorer qu’il y eût dans leur Eglise un tel tresor, m’ont dit positivement
que l’original étoit en Abissinie, & que leur Patriarche d’Alexandrie, qui reside au Caire, en avoit une copie, &
c’etoit tout. Mais je crois que leur vanité leur fournissoit cette réponse, & qu’ils ne sçavoient pas plus que
moy là-dessus.
Remarquez que les Armeniens qui sont en ces lieux, y sont generalement étrangers, comme à
Constantinople, mais en un incomparablement plus petit nombre. Ils y apportent par terre diverses
marchandises des Indes, comme de la rubarbe, des bijoux, du caffé, &c. Et c’est ce caffé qu’on appelle
ordinairement caffé de Turquie, que les Arabes prononcent Cahoua, & les Turcs Cahvé, quoy qu’il n’en
croisse point dans les Etats du grand seigneur. S’il est estimé meilleur que tout autre, c’est à cause qu’il
vient par terre jusques dans l’Europe Chretienne, & qu’ayant été moins long-tems sur la mer, il perd moins
de sa vertu que celui qui vient directement des Indes par mer : ainsi ces deux sortes de caffé du même
pays, mais ils prennent différentes routes.
Alexandrie a perdu les avantages qu’elle tiroit de son commerce des Indes, qu’elle faisoit autrefois par mer
rouge, depuis que les Portugais en ont decouvert le chemin par le cap de Bonne-Esperance. Après un
séjour de six jours à Alexandrie, nous partîmes pour Tripoli, où nous arrivâmes en neuf autres, sans toucher
à aucun port, & sans autres accidents, que celui qui arriva à un religieux qui fut attaquer par une fievre
tierce, semblable à celle dont je n’étois pas encore tout à fait gueri. »
- 542 - 546 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTHOINE MORISON (du 17 au 29 septembre 1697)
Morison, A., Voyage en Égypte d’Anthoine Morison, 1697, par G. Goyon, Ifao, Le Caire, 1976.
Anthoine Morison, né en 1665 à Bar-le-Duc, est chanoine de l'église Saint-Pierre de Bar-le-Duc. Sa famille
fait partie de la bourgeoisie de cette ville. En 1696, il part en pèlerinage pour les Lieux saints. Sa marraine,
Jeanne d’Anglure, est une parente lointaine du Seigneur d’Anglure qui visita Alexandrie en 1395.549
p. [3]-[21] :
« Le quinzième, faisant canal, c’est à dire, vogant en pleine mer & au large, nous nous vîmes encore
pourchassez par un vaisseau, qui nous contraignit de nous raprocher des côtes de Barbarie, & le
dix-septième jour du même mois de septembre, qui étoit le vingt-deuxième de nôtre navigation, après avoir
salué en passant la tour des Arabes (c’est un gros bâtiment fort élevé, qui sert de retraite à cette canaille, qui
ne manque jamais, quand elle peut, d’insulter & de piller les petits bâtimens qui passent) nous arrivâmes
enfin avant la nuit dans la rade d’Alexandrie d’Egipte, où nous moüllâmes près des superbes ruïnes de cette
ville également ancienne & superbe. Nous n’eûmes pas plutôt jetté l’ancre, que nous vîmes nôtre vaisseau
environné de quantité de bateaux chargez de Turcs, qui venoient les uns pour lever certains droits qui sont
dûs à l’Aga de la Doüane par tous les habitants étrangers, les autres pour transporter les balots ou autres
bagages à terre, les autres enfin y venoient pour voir pour voler ou pour y boire du vin, qu’ils demandent, &
qu’on ne leur refuse guere en cette ocasion, quoi qu’on sache comme eux que leur loi le défend, mais ils
n’en sont pas trop religieux observateur sur cet article. Un certain entr’autres, étant entré dans la chambre
de pouppe où j’étois, se saisit d’un gros flacon plein de vin, qu’il vuida presque sans prendre haleine, tant
cette liqueur lui parut agréable. Le même soir un jeune Marseillois avec qui j’avois fait le trajet, aïant pris
terre, donna avis de mon arivée à Monsieur de Rouhre, vice-consul d’Alexandrie, qui le lendemain matin
m’envoïa son premier Drogman, ou truchement, & m’engagea d’une manière très-obligeante à descendre
chez lui, ce que je fis.
De la ville d’Alexandrie d’Egipte
Quoi que les magnifiques ruïnes de la ville d’Alexandrie d’Egipte, surnommée LA GRANDE, porte encore
aujourd’hui un caractère assez vif de son ancienne splendeur, je suis persuadé que mon lecteur jugera
beaucoup mieux du déplorable état auquel elle est réduite, lors que je lui aurait dit quelque chose de l’état
florissant où elle étoit avant sa destruction.
Cette ville fameuse, qui par la ruïne de Carthage devint la principale de toute l’Afrique, & la premiere ville du
monde après Rome, pour me servir des termes d’un historien célebre, eut pour fondateur Alexandre le
Grand, qui en fit jeter les fondemens environ trois cens ans avant la naissance de Jesus-Christ. Ce
conquerant voulant laisser à la postérité un riche monument de ses conquêtes, lui imposa son nom, après
avoir épuisé ses trésors pour lui donner cet air de grandeur & de magnificence, qui seul pouvoit satisfaire un
coeur ambitieux & vain comme le sien ; & les Turcs, qui sont bien aises de lui conserver encore aujourd’hui
son ancien nom, lui donnent celui de Scanderie, qui veut dire Alexandrie, ou ville d’Alexandre.
Elle étoit située sur le bord de la mer, & comme elle avoit bien trois lieuës de longueur, le nombre de ses
habitants étoit environ de trois millions. Elle étoit ceinte d’une muraille double, & flanquée de distance en
distance de tours élevées, grosses & quarrées. Rien n’étoit plus magnifique que ses portes, & on en juge
ainsi par cet air de grandeur que l’on admire encore dans celles qui subsistent. Il y avoit un grand nombre de
palais & d’édifices superbes, presque tous ornez de portiques, soûtenus par des colonnes de marbre
granite, comme il est aisé d’en juger par cette prodigieuse quantité que l’on voit, & dont les unes sont encore
sur pied, & les autres couchées par terre. Les chaleurs excessives de l’Egipte avoient contraint ses habitans
de chercher de la fraîcheur dans les bâtimens soûterrains où ils étoient à l’abri du soleil, & il n’y avoit nulle
maison qui n’eût ces sortes d’aziles contre les ardeurs brûlantes de ce climat. Quoi que le Nil fût éloigné
d’Alexandrie, il s’y rendoit néanmoins par des canaux pratiquez sous terre, pour y remplir toutes les cîternes
de ses eaux, qui sont plus fraîches & plus salutaires que les eaux qui y tombent abondanment du ciel au
mois de Novembre, ce qui n’arrive pas dans tout le reste de l’Egipte où il ne pleut presque jamais. Son port,
qui avoit naturellement la forme d’un croissant, étoit défendu par deux chasteaux très-forts, ausquels ont
succedé deux autres peu considérables. A quelque distance de ce port étoit bâti ce phare, qui n’est plus,
mais qui fût digne d’être mis au rang des merveilles du monde, dans une petite île que Cleopatre fit joindre à
la terre (à ce qu’on dit) en sept jours, par une digue qu’elle fit faire. Après qu’Alexandrie fût devenuë
chrétienne, on y bâtit des églises dont on voit encore quelques restes, & qui font juger de leur ancienne
magnificence.
Les Ptolémées, qui établirent leur siège dans Alexandrie comme dans la capitale du roïaume d’Egipte,
s’apliquerent à l’embellir, à y faire fleurir les sciences & les arts ; & ce fût là que Ptolémée, surnommé
Philadelphe, dressa cette célebre bibliothèque composée de cinq cens mille volumes. Ce fût sous ce même
Prince, grand amateur de belles lettres, que les septante-deux interprètes, que le grand sacrificateur Eleazar
lui envoïa de Jerusalem, traduisirent la sainte bible d’hebreu en grec ; traduction qui est encore aujourd’hui
d’un grand poid dans l’Eglise, & qu’on apelle commnunément la version des septante.
Les Romains, après la mort de Cleopatre & la défaite de Marc-Antoine, aïant mis fin à la domination des
Ptolémées, & fait commencer la leur, s’atacherent à conserver, & même à augmenter la splendeur
d’Alexandrie ; & la qualité de citoïen de cette grande ville étoit presque autant estimée sous eux que celle de
citoïen Romain. Les empereurs Adrien & Antonin en releverent la beauté par plusieurs bâtiments superbes
qu’ils y firent, mais Caracalla piqué au vif par quelques railleries asses sanglantes que les Alexandrins
avoient faites de sa personne, leur fit éprouver la cruauté de son ressentiment par un horrible massacre, &
par la destruction des plus beaux édifices de cette ville, qui aprit par là à la postérité à ne perdre jamais le
respect dû aux souverains, quels qui soient, legitimes ou tirans. Omar, troisième calife des Sarazins,
assiégea ensuite Alexandrie, & l’aïant prise, la fit passer avec le reste de l’Egipte aux sultans ses
successeurs, sous la domination desquels cette ville resta jusqu’à ce que Selim premier empereur des Turcs
ayant défait Campson l’an de grace 1517 anéantit l’empire des Mammelucs, & s’empara de toutes les villes
de l’Egipte, & en particulier d’Alexandrie, qui peu à peu perdit son ancienne splendeur, & tomba ensuite
dans le pitoïable état où elle est à present réduite.
Quelque florissante que fût Alexandrie sous la profane domination des princes infidèles, sa gloire n’aprocha
jamais de cette grandeur divine qui lui fût communiquée, lors qu’elle se fût soûmise à l’empire de Jesus-
Christ, par la publication de l’evangile qu’elle reçut de saint Marc, disciple de l’apôtre saint Pierre, qui fonda
cette église ; car outre que les patriarches d’Alexandrie l’emportoient sur ceux d’Antioche même, pour le
rang d’honneur, ils étoient honorez du tître de vicaires nez du saint siège pour les affaires d’orient, & ne
cédoient qu’au seul pontif Romain.
Les sciences divines et humaines ont rendu Alexandrie illustre ; Appian & Herodien, célebres historiens, en
étoient natifs ; Origene, Clement d’Alexandrie, Didine l’aveugle, & plusieurs autres savants hommes des
premiers siècles de l’Egipte ont puisé leurs lumieres dans le trésor des sciences dont cette ville étoit
dépositaire : & saint Athanase, saint Cirille, & grand nombre d’autres saints & doctes prélats, ont remplis
avec honneur ce premier siège patriarchal ; mais les erreurs de l’impie Arius déshonorent en quelque sorte,
dit un autheur, cette illustre église qui l’avoit élevé au sacerdoce, duquel alors il ne lui parut pas indigne.
A present, cette ville si digne de la réputation qu’elle s’étoit aquise, n’est plus, & la négligence ou la fausse
politique des Turcs, qui laissent tout détruire sans jamais rien réparer, l’a réduite en un état de désolation
capable d’amolir le coeur des plus insensibles, & plus ses débris m’ont paru superbes, plus sa destruction
m’a semblé déplorable & digne de larmes. Il est vrai qu’Alexandrie étant un port de mer d’un grand
commerce, les Turcs qui ont leur intérêt en recommandation plus qu’aucune nation du monde, pour ne point
rendre inutil ce port, qui pouvoit leur être d’une grande utilité si grande, ont bâti proche des ruïnes de
l’ancienne ville des maisons qui composent la nouvelle Alexandrie ; mais quoi qu’elle soit médiocrement
grosse & assez peuplé, ses bâtimens sont trop peu de chose pour mériter une description. Ce qu’elle a de
particulier & de recommandable, est un port apelé le Port vieux, qui après celui de Constantinople, passe
pour le plus beau & le plus commode de tous les ports de la méditerranée, étant d’une étenduë prodigieuse,
& environné de montagnes qui metent les vaisseaux en sureté, mais ce port est uniquement destiné aux
bâtimens Turcs, & on ne soufre pas que nul autre vaisseau y moüille.
Il n’y a de personnes un peu considérables dans Alexandrie que les gouverneurs de la ville & des deux
petits châteaux : le Cadis, qui est l’unique juge du lieu, & l’Aga de la doüane, tous officiers dépendans du
Bacha du Caire, qui les y envoïe & les rapele quand bon lui semble.
La nation françoise est composée d’un assez bon nombre de marchands Provenceaux, qui sont
subordonnez à ceux du Caire, de même que leur vice-consul l’est au consul d’Egipte, qui fait sa résidence
dans cette grande ville capitale du roïaume, comme je le dirai en son lieu ; mais allons voir ce qui est resté
jusqu’à nous de plus digne de la curiosité d’un voïageur dans les ruïnes de la ville ancienne.
Le 22 septembre à la pointe du jour, pour prévenir la chaleur excessive qui se faisoit alors sentir, étant
acompagné d’un religieux conventuel du petit monastere que les peres de la terre sainte ont en Alexandrie,
de six ou sept marchands, & du premier truchement de monsieur le vice-consul, tous montez, selon la
coûtume d’Egipte, sur des ânes, armez de fusils & d’épées (bonne & necessaire précaution contre l’insulte
des Arabes qu’on y trouve souvent) j’allai parcourir les tristes ruïnes d’Alexandrie. La curiosité me posta à
aller voir d’abord la fameuse colonne de Pompée. Comme elle est hors des murs, & qu’il étoit fort matin, la
porte étoit encore fermée, & tandis que j’atendois l’arivée du portier qu’on alla chercher, messieurs les
marchands chassoient aux perdrix rouges, qui sont assez communes dans ces mazures, & se percherent
même sur les palmiers qui y sont en grand nombre. Enfin le portier étant arivé, armé d’une clef de bois de la
longueur & de la grosseur de mon bras, armée sur un bout de sept ou huit grosses pointes de fer qui
remuoient les ressorts de la serrure de bois, la porte nous fut ouverte pour le prix de sept ou huit maidins,
qui font neuf ou dix sols, car les Turcs ne font rien pour rien.
A un petit demi quart de lieuë de cette porte, est une colonne vulgairement apelée la colonne de Pompée,
qui sans doute est la plus belle qui soit au monde, comme elle en est la plus fameuse. Cette colonne est
d’un marbre apelé granite ou pierre de Thebes : elle est marquée de diferentes couleurs, entre lesquelles le
noir me sembla dominer. Elle a quatre-vingts-quatre pieds de hauteur entre la baze & le chapiteau, & elle est
d’une grosseur si prodigieuse que quatre personnes l’embrasseroient à peine. Sa baze posée sur plusieurs
autres masses d’un marbre de même espèce, est aussi extraoridinaire pour sa grosseur que la colonne
même, & l’on ne conçoit pas aisément avec quelles machines on a pû transporter ces deux pièces sur le lieu
où elles sont. Les Arabes qui croïent toûjours trouver des trésors enfermez sous ces magnifiques ouvrages
des anciens, ont tiré & éloigné avec de grands éforts, de grosses pierres sur lesquelles tout l’ouvrage est
posé, & ont manqué par là de ruïner ce monument qui mérite de subsister aussi long-tems que les siècles.
Le peuple tient que cette colonne a été dressée où elle est pour marquer la durée du monde, qui doit (dit-il)
périr avec elle ; mais voici quelle en est l’origine. Pompée aïant été vaincu par Caesar, dans la fameuse
bataille de Pharsalle, voulut se retirer chez Ptolémée roi d’Egipte, & frere de Cleopatre ; mais ce lâche prince
croïant rendre un service important à Caesar, fit trouver à Pompée la mort en un lieu où il se promettoit un
azile : car il lui fit couper la tête par un esclave, si-tôt qu’il fût entré dans un petit bâtiment magnifiquement
orné, qu’il lui avoit envoïe avec des témoignages trompeurs d’une amitié feinte : de quoi Caesar aïant eu
avis, pour marque à ce perfide que son grand coeur étoit incapable d’aprouve une action si noire & si
honteuse, il le priva du roïaume en faveur de Cleopatre sa soeur, à qui il l’avoit enlevé ; & pour rendre à son
rival une vie morale pour la naturelle que Ptolémée lui avoit ravie, il fit dresser cette colonne, sur laquelle il fit
mettre la tête de Pompée, enfermée dans une urne précieuse qui s’y est conservée long-tems.
Assez près de cette colonne, & hors les murs de l'ancienne ville, est une espèce de grote, dans laquelle
Saint Athanase, en but à la persécution des Ariens, fût contraint de se retirer pour éviter leur fureur. On tient
que c'est là où ce saint composa son simbole dont il est autheur, & que l'Eglise chante tous les dimanches à
l'heure de prime, Quicunq ; vult salvus esse, etc
Etans rentrez par la même porte dans cette ville ruïnée, nous allâmes voir la colonne sur laquelle on tient
que sainte Catherine vierge & martire eût la tête tranchée, par l’ordre du tiran Maximin. Cette colonne, qui
est de couleur blanchâtre, de figure quarrée, & d’environ quatre pieds de hauteur, est dans une chapelle de
l’église bâtie dans l’enceinte d’un petit monastère de Caloïers, ou moines Grecs : près de là se voïent
quelques débris de maison, qu’on dit être celle du pere de cette sainte.
À deux portées de mousquet de là est l’église de saint Athanase, qui est de grandeur médiocre, assez bien
bâtie & assez jolie au déhors : On dit qu’elle est toute revétuë de marbre au dedans, mais comme les Turcs
en ont fait une mosquée, les Chrétiens n’ont pas la liberté d’y entrer.
Continuant nôtre route, nous trouvâmes une partie de l’église de saint Marc, desservie par des moines
Coptes, logez dans de petits bâtimens qui sont autour, & qui ressemblent plutôt à des tanières de renards
qu'à des cellules de religieux. Dans cette église, qui est fort peu de chose, & qui ne faisoit apparemment que
partie de la nefs de l'ancienne, est un reste de la chaire dans laquelle on dit que saint Marc anonçoit
l'évangile à son peuple. Cette chaire étoit faite de pieces de marbre blanc de diverses couleurs.
Presque sur le bord de la mer sont des restes considérables d’un palais, que les uns disent avoir été celui
de Cleopatre, les autres d’Alexandre le Grand, & d’autres d’Alexandre & de Cleopatre successivement ; ce
qui n’est pas incompatible, & même qui me paroît probable, Alexandre aïant eu le goût assez bon pour
donner à son palais cette agréable situation ; & Cleopatre aïant été trop vaine & trop voluptueuse pour
n’avoir pas voulu loger dans le palais de ce prince, fondateur d’une ville qui étoit capitale du roïaume qu’elle
gouvernoit. J’entrai dans les bâtimens & apartemens soûterrains, dont les voutes, qui subsistent encore en
partie, étoient d’un très beau travail, & soütenuës par des colonnes de pierre de Thebes. Dans une place, à
laquelle ce palais aparenment faisoit face d’un côté, étoient deux aiguilles, dont l’une étoit sur pied & l’autre
renversée. Ces deux aiguilles, communément apelées aiguilles de Cleopatre, sont de marbre granite, &
d’environ soixante & dix pieds de hauteur : elles ont quatre faces, & se terminent insensiblement en pointe :
elles sont couvertes de caractères hieroglifiques, qui aparenment renfermoient d’une maniere mistérieuse
les victoires d’Alexandre, ou les amours de cette princesse, qui par sa superbe & sa lubricité à causé de
grands troubles tant en orient qu’en occident, & qui (comme chacun sait) après la défaite de Marc-Antoine
par Auguste, craignant de servir à relever le triomphe de cet empereur Romain, termina une vie honteuse
par une mort infame, se la procurant à elle même par la piqure d’un aspice.
Quoi que toutes les maisons de cet admirable & ancienne ville soient détruites, la double muraille dont elle
étoit environée subsiste encore, avec plus de soixante tours bâties de très-belles pierre de taille, le tout aisé
à rétablir entierement, n’étant pas beaucoup endomagées. On y voit encore quatre portes très-belles &
très-fortes qui conservant leur ancien nom, car l'une s'apele encore porte du Caire, l'autre porte des Deserts,
la troisième porte de Midi, & la quatrième porte Marine.
On trouve dans ces ruïnes des medailles anciennes & des pierres gravées : il est vrai qu’elles ne sont pas
toutes également belles & curieuses ; mais il arive souvent que les païsans, apellez Fellas, en aportent à
monsieur le vice-consul, & aux marchands, de très-rares, qu’ils leur vendent à très-bon prix, n’en
connoissant pas la valeur.
A une petite demi lieuë d’Alexandrie est un lac apelé Bouchiara, ou Palus mareotis, qui est une grande
étenduë & rempli d’une prodigieuse quantité de poissons de toutes espèces, & d’un très-bon goût, aussi
dit-on qu’il est d’un revenu très-considérable.
L’air d’Alexandrie n’est pas sain, & il engendre des fièvres malignes, qui emportent en peu de jours les
étrangers, qu’on avertit ordinairement de bien couvrir leur estomach ; précaution qu’on dit être nécessaire si
l’on veut éviter ces maladies, qui corrompent en peu de jours toute la masse du sang.
Le nouvel Aga de la doüane d’Alexandrie étant arrivé depuis peu, monsieur le vice-consul trouva à propos
d’aller à la tête de la nation rendre visite à cet oficier, envoïé par le Bacha du Caire, pour lui recommander
les interêts du commerce, & comme j’étois bien aise de voir cette cérémonie, je voulus être de la partie.
L’Aga étant averti que le vice-consul des François venoit le voir en ceremonie, c’est à dire, précedé de ses
deux Janissaires & de ses truchemens, & suivi de toute la nation, il alla aussitôt dans la salle d’audiance
s’asseoir à la turque sur son sopha, c’est à dire, s’y placer de la maniere que les tailleurs le sont en France
lors qu’ils travaillent, avec cette diference neanmoins, que les Turcs sont (par l’habitude qu’ils en ont) si
absolument maîtres de leurs jambes, qu’en les croisant ils les replient & les cachent si bien sous la veste,
qu’ils semblent des demi-corps. Mais parce que le sopha des Turcs n’étant pas assez connu des François il
pouroit causer quelque confusion dans l’esprit s’il n’étoit dépeint, je dirai que le sopha n’est autre chose
qu’une estrade ou une élévation d’un pied de hauteur ou environ, faite de planches, qui ocupe ordinairement
un quart et quelquefois un tiers de la chambre vers le fond, qui donne s’il se peut sur la mer, sur le jardin, sur
la cour, ou sur quelque autre lieu qui divertisse la vûë, car les fenêtres sont percées assez bas pour cela. Ce
sopha est couvert d’un beau tapis chez les riches, mais les pauvres se contentent d’y étendre une nate faite
de branches de palmier. Tout au tour regne un matelas de trois pieds de largeur ou environ, & sur ce
matelas sont placez contre la muraille de gros coussins bien remplis de laine, de cotton & de crin de cheval
mélangez, sur lesquels on est assis & apuïé fort mollement. Nôtre Aga étoit donc ainsi assi dans le fond de
son sopha, lorsque nous arivâmes dans la chambre.
Monsieur le vice-consul, aussi-bien que ses marchands, habillé à la turque selon la coûtume, aïant laissé
ses papouches au pied du sopha, s’aprocha de l’Aga portant la main droite sur son coeur, & lui disant,
Salamaleikum, c’est à dire, en langue Arabe, la benediction de Dieu soit sur toi, à quoi l’Aga lui rendant le
salut, lui répondit par un renversement de la même phrase, Aleikum salamé, après quoi chacun aïant salué
l’Aga à son tour, se plaça sur le sopha avec ordre. A l’instant les esclaves aportèrent des pipes avec des
tuïaux de quatre ou cinq pieds de longueur, fuma qui voulut, car personne n’est contraint de s’acommoder
en cela à la maniere du païs. Cependant le truchement étant debout entre le Consul et l’Aga, portoit les
complimens reciproques qui se font en pareilles rencontres. Toute la conversation roula sur des offres de
service qui se firent de part & d’autre, d’une maniere aussi peu animée que peu sincère ; car cet Aga, qui
étoit un Armenien rénegat, fit bien voir dans la suite par ses vexations, que toutes se honnêtetez aparentes
n’étoient que ruse & dissimulation.
Je dirai en passant, & par forme de digression, que quand nos Consuls vont voir les Pachas, les Beys, ou
les autres personnes de distinction, & qui ont quelque sentiment de generosité, ou quelque penchant, soit
feint ou veritable, pour la nation françoise, ils ne manquent pas, après les premieres civilitez faites &
renduës, de s’informer de la santé de l’empereur de France (car c’est ainsi qu’ils traitent le roi) de l’état des
afaires de l’empire, soit qu’il soit en guerre, soit qu’il joüisse de la paix ; & ordinairement ils sont assez justes,
ou du moins assez politiques, pour donner à sa majesté une partie des éloges qui lui sont dûs, mais rien de
tout cela ne se passa chez nôtre Aga, qui n’avoit que sa doüanne, son commerce & son intérêt en tête.
Pendant ce tems-là les esclaves distribuoient dans des pourcelaines de la Chine, le café tout pur & sans
sucre, après quoi vinrent les parfums qu’on presente dans des espèces de petits encensoirs sans chaînes,
& qu’on enferme pendant quelque tems sous la veste afin d’être tout embaumé. Ensuite les mêmes esclaves
aportent les eaux de senteur, enfermées dans des petits flacons à long cols, au bout desquels sont quelques
trous par lesquels sort cette eau que les esclaves jettent au visage. Pour moi qui n’étoit pas acoûtumé à
sentir cette sorte de rosée, je parois de la main & faisois signe à l’esclave de passer à mon voisin, tandis que
l’Aga, les autres Turcs, & une partie de nos gens, la recevoient avec avidité, en lavoient leur visage, & en
savonnoient leur longue barbe, avec un sérieux que j’avois bien du mal à garder. Enfin on fit mourir la
conversation, qui languissoit il y avoit long-tems, en aportant le sorbec dans des tasses. J’en goûtai par
céremonie comme les autres, mais je trouvai cette boisson si fade, qu’il m’en fallut peu pour en être à jamais
dégouté. Le sorbec aïant été pris par toute la compagnie, chacun se leva, se tourna sans dire mot du côté
de l’Aga, mettant la main sur le coeur, & le quita ainsi, le laissant sur son sopha. Voilà, mon cher lecteur, la
juste idée des visites qu’on rend aux personnes d’importance en Turquie où l’on n’en fait jamais de seiche, &
quelque homme du commun que soit celui qu’on va voir, il ait du moins presenter le café, qu’il seroit incivil
de refuser.
Départ d’Alexandrie pour le Caire
Après avoir passé douze jours dans Alexandrie, je pris congé de monsieur de Rouhre marseillois,
vice-consul, homme d’esprit, de mérite, & très-capable d’un emploi beaucoup plus considerable ; & je partis
pour le Caire dans un gros bateau apelé Germe, qui profita d’un petit vent nordoüest qui favorisoit son
passage. J’avois pour compagnon un jeune marchand de Marseille qui alloit s’établir au Caire, & nous
avions pour escorte deux espèces de Janissaires que monsieur de Rouhre nous avoit donner pour nous
parer d’insulte. Le chemin par terre d’Alexandrie au Caire est plus court de trente lieuës que la voie de la
mer & du Nil, mais la rencontre des Arabes y est si inévitable & si dangereuse, que je ne balançai pas un
moment sur le choix, quoi qu’on pût me dire des périls du Boghaze550, c’est à dire, de cet endroit voisin de
Rosset où le Nil venant à se jeter avec impétuosité dans la mer, cause de frequens naufrages, sur tout lors
que le vent étant trop fort, amasse dans cette embouchure du sable en forme en forme de petites
montagnes, dans lesquels les batimens venant à donner ils échoüent nécessairement, batus qu’ils sont par
les flots, ausquels ils ne peuvent résister longtems. »
- 547 - 551 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ANTOINE MARIE NACCHI (1697-1699)
Nacchi, A. M., Notitia rerum aegyptiarum, Rome, Archives de la Compagnie de Jésus, (non vidi).551
Antoine Marie Nacchi, né à Chypre en 1666, entre au noviciat de Rome en 1687. Il enseigne la grammaire et
occupe le poste de sous-ministre au Collège germanique. Il est le premier supérieur jésuite de la résidence
du Caire fondée en 1697. Lors de son arrivée en Syrie, où il est supérieur général des missions, il écrit cette
relation datée du 31 août 1699. Il revient en Égypte en 1726, après la mort du père Sicard, pour mettre en
ordre les papiers de ce dernier en vue de les publier. Il meurt en 1746.552
Non paginé :
« Alexandrie, antique résidence royale, assise en partie sur le rivage de la mer, possède un double port, l’un
ancien et l’autre nouveau. Le premier est beau, sûr et vaste. L’entrée en est interdite aux navires chrétiens,
grâce à la sotte persuasion où vivent les musulmans que le jour où les chrétiens y pénétreraient, le pays
tomberait sous leur pouvoir. Mais autant est sûr l’ancien port, autant le nouveau est dangereux, à cause des
rochers et des débris de colonnes qui l’encombrent. La ville actuelle n’est certes pas l’ancienne Alexandrie,
mais bien une ville moderne bâtie peut-être avec les ruines de l’ancienne par un Émir arabe du nom de
Maus. Une grande partie du sol est occupée par des citernes nombreuses qui se remplissent d’eau à
l’époque de l’inondation du Nil, et qui en contiennent assez pour les besoins de l’année. La population se
compose de Turcs, de Juifs et de Cophtes et ne dépasse pas le chiffre de 15 000, tandis qu’elle avait atteint,
aux jours de sa prospérité, celui de 4 millions.
Il n’y a de remarquable, en fait d’Antiquité, que deux obélisques, l’un renversé et l’autre encore debout. Ils
sont chargés l’un et l’autre de hiéroglyphes. On voit aussi la célèbre colonne dite de Pompée. C’est un beau
reste de la magnificence égyptienne. Elle est d’un seul bloc de granit et mesure 126 palmes de hauteur avec
un piédestal proportionné également en granit.
De l’ancien phare, il ne reste pas de trace. On croit qu’il s’élevait sur une langue de terre qui s’avance dans
la mer et que les Turcs ont muni d’une forteresse. En fait d’Antiquités chrétiennes, il ne reste plus que
l’église de Saint-Athanase, convertie hélas ! en mosquée, et une autre église de petite dimension, où l’on
croit que saint Marc fut enseveli et où, d’après la tradition des Cophtes qui la desservent encore, cet
Évangéliste aurait eu la coutume d’annoncer la parole de Dieu. En un monastère des Grecs, on montre un
bloc de marbre blanc, orné au milieu d’une croix, sur lequel on prétend que sainte Catherine fut décapitée, et
l’on ajoute que le monastère a été bâti sur l’emplacement de la propre maison de la glorieuse martyre.
Chose digne de remarque, la ville actuelle d’Alexandrie tend à se transporter du côté de l’orient, où il y a
plus de commodités pour les douanes. Et voilà pourquoi les quartiers opposés commencent à être délaissés
et presque déserts. En sortant d’Alexandrie du côté du couchant, on s’engage dans les solitudes profondes
du désert de Nitrie (autrement dit de Scété) qui s’étend à plusieurs journées de marche. Là est encore
debout le monastère de Saint-Macaire qu’habitent des moines grecs. On rencontre sur une colline voisine
les pierres d’aigle (aétites) qu’on dit utiles aux femmes en couche et dont les paysans se servent pour faire
porter à leurs arbres une plus grande quantité de fruits. Avant d’atteindre le monastère de Saint-Macaire et
non loin d’Alexandrie, on voit un lac d’une grande circonférence que sur les données des auteurs anciens, je
crois être le lac Maréotis. Son eau est saumâtre parce qu’il communique d’un côté avec la mer
Méditerranée. Les Arabes lui donnent le nom de Maadié, qui veut dire passage. Quand on dépasse le lac
susdit, on aperçoit une série de petites collines qui se suivent à une distance d’un mille environ et qui aident
le voyageur à s’orienter dans ce désert sablonneux. »
551 À la première page de cette relation conservée à la bibliothèque du Collège de la Sainte Famille au Caire,
on lit dans l’en-tête : « Le texte original, italien, de la Notitia est conservé aux archives de la Compagnie à
Rome. Dans les papiers Abougit (Archives sj de Beyrouth), il est recopié t. 1 p. 50-68. La traduction
française, ici reproduite, se trouve dans les papiers Rabbath, t. IV, p. 4351-4382. Il semble qu’elle ait été
faite pour les Études vers 1880, mais elle n’a pas été publiée. »
552 Les renseignements biographiques de ce voyageur se trouvent dans C. Sommergovel S. J., (Bibilothèque
de la Compagnie de Jésus, t. V, Bruxelles, 1894, p. 1517) ainsi que dans l’en-tête du récit conservé à la
bibliothèque du Collège de la Sainte Famille au Caire.
- 552 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PAUL LUCAS (du 24 au 25 août 1699)
Lucas, P., Voyage du sieur Paul Lucas au Levant, Paris, 1704.553
Paul Lucas, fils d’un orfèvre de Rouen, est antiquaire. En 1696, il rapporte du Levant des médailles qui sont
acquises par le Cabinet du Roi. En 1699, il fait un nouveau voyage dans le Levant et en publie une relation
en 1704. Par la suite, il obtient une mission officielle du roi de France en Orient. Nommé antiquaire de
Louis XIV, le ministre Pontchartrain le charge « d’y faire recherche des plantes qu’on a point en France, de
médailles et d’autres curiositez ». Paul Lucas, au moment de rédiger ses récits de voyage, fait appel à
Charles César Baudelot de Dairval, Étienne Fourmont et à l’abbé Banier pour la publication de ces ouvrages
dans lesquels « nous trouvons des observations qui sont à la fois le résultat d’une interprétation très
fantaisiste et d’une compilation d’ouvrages contemporains ou antérieurs ».554
En plus de ce voyage accompli en 1699, Paul Lucas séjourne plusieurs fois à Alexandrie : du 21 au
27 octobre 1707 ; du 2 au 7 septembre 1716 ; puis au mois d'août 1717. La seconde relation de voyage de
Paul Lucas présentée dans ce corpus est datée de 1716.
p. 36-44 (vol. I) :
Route d’Alexandrie. Singularitez de cette ville.
« A la pointe du jour nous nous trouvâmes devant le château du Beckhier qui est au Turc, & nous
commençâmes à découvrir ceux d’Alexandrie, & cette fameuse colomne de Pompée qu’on apperçoit avant
que de voir la terre. Dans le temps que nous approchions du port, le pilote & les gens de la Doüanne vinrent
à l’ordinaire, l’un pour faire entrer le bâtiment dans le port, & luy faire éviter plusieurs rochers qui sont sous
l’eau, & les autres pour empêcher que l’on ne fasse quelque contrebande.
(p. 37) Nous moüillâmes l’ancre le 24 d’Aoust à 8 heures du matin, & nous allâmes à terre avec des
bateaux. Les gens de ce Païs ont encore à present une grande mémoire ; en effet, je ne fus pas plûtôt
arrivé, que plusieurs Turcs, dans les complimens qu’ils me firent, me nommerent même par mon nom.
J’allay saluer de là Monsieur le Consul, & lui rendis des lettres que j’avois pour luy. Mes voyages frequens à
Alexandrie, & le séjour de sept mois que j’y ay fait m’ont donné occasion d’y remarquer bien des choses
qu’on ne trouvera peut-être pas desagreables avant que je poursuive les reste de mon journal.
La maison consulaire est tout proche de la marine. On trouve au dessus de cette maison des asnes qui
marchent fort vîte, pour aller où l’on veut. (p. 38) Comme c’est l’usage en ce pays de s’en servir nous en
prîmes, & nous traversâmes avec cette voiture un coin de la ville pour aller voir la colonne de Pompée qui
est sur son pied-d’estail. Elle est d’une pierre granite grise, haute d’environ 120 pieds sans le chapiteau.
J’apprehende qu’on ne la voye quelque jour tombée, & peut-être cassée ; car son pied-d’estail se ruine
beaucoup. Si cette colomne étoit en France, elle seroit regardée comme une merveille. De-là nous fûmes
voir des lieux soûterrains qui apparemment ont servi de cimetiere aux anciens. Ce sont de longues allées si
basses, qu’il faut se coucher sur le ventre, & cet endroit conduit à une espece de labyrinthe : ce qui fait
qu’on n’ose pas trop se hazarder à aller bien avant dans ces lieux. Vis à vis nous descendîmes (p. 39) dans
de longues allées fort sous terre, & toutes bordées de niches & de trous faits comme des fours d’une grande
profondeur. Il y en a deux rangs les uns sur les autres, comme qui diroit à deux étages. A quelque distance
de là nous fûmes à une grande ouverture où personne, disoit-on, n’osoit entrer. On en contoit plusieurs
fables qui ne me rebuterent pas d’y aller. Je fis allumer trois bougies ; & quand j’eux marché environ 40 pas,
je trouvais des puits dans le chemin. Il n’y avoit que des petits sentiers pour passer, ce qui étoit tres
dangereux, cela fit que je n’allay pas plus loin. J’entendis dans le puits quelque bruit que je crois de chauve
souris.
Au sortir de ce lieu, nous rentrâmes dans l’ancienne ville d’Alexandrie toute ruinée, excepté (p. 40) quelques
maisons ou demeures de pauvres gens. En effet, ce sont plûtôt des étables à cochons que la demeure des
hommes, tant elles sont malpropres & mal-bâties. En continuant notre chemin nous avançâmes à l’Eglise de
sainte Catherine, ancienne Eglise chrétienne, qu’on dit avoir été la demeure de cette sainte. Il faut
descendre quelques marches pour y entrer ; & l’on voit dans une niche à l’entrée la colomne sur laquelle la
prétendue sainte Catherine s’appuya ; dit-on, quand on luy coupa la tête. La colomne est de marbre blanc,
et de certaines marques rougeâtres qu’on y voit, disent-ils sont encore du propre sang de la sainte. On y
montre encore le lieu où cette vierge fut mise en prison, & où elle fut décapitée, la chaire dont saint Marc
(p. 41) se servoit quand il prêchoit, & une image de saint Michel faite par la main de saint Luc ; c’est aussi le
lieu où demeure ordinairement le Patriarche d’Alexandrie.
Delà en côtoyant les anciennes murailles contre lesquelles la mer bat, nous arrivâmes aux deux éguilles de
Cleopatre, qui sont constament deux obelisques des anciens Egyptiens. L’un est debout, & l’autre à bas un
peu en terre par sa pointe. Ils sont tous deux chargez d’hieroglyfiques depuis le haut jusqu’au bas, &
peuvent avoir environ 80 à 90 pieds de hauteur, d’un marbre granite rougeâtre.
Nous allâmes après dans une grande place entourée d’amphiteatres que l’on voit encore entiers, ce qui fait
assez connoître que c’étoit (p. 42) la place où se donnoient les jeux publics. Nous trouvâmes une grosse
tour ronde où nous entrâmes, & où nous vîmes plusieurs appartemens ornez en plusieurs endroits de
marbre & de porphyre ; c’étoit, dit-on, le Palais de Cleopatre. Il y a aussi plusieurs colomnes de marbre, &
quantité de niches de hauteur d’homme qui regnent tout au tour d’une salle toute de marbre. Nous
traversâmes ensuite par des galleries qui regardent la mer, & nous passâmes à une autre tour où il y a aussi
quantité de beaux appartemens tous de marbre. On monte en haut sur cette tour où l’on découvre de loin.
Nous fûmes voir de suite le vieux port que nous admirâmes comme un des plus beaux que la nature ait fait.
Les bâtimens y sont en sûreté en toute sorte de (p. 43) temps, & il n’y a que ceux des Turcs qui y puissent
moüiller. Pour aller à ce port on traverse presque toute la nouvelle ville qui est assez mal bâtie. Les rües en
sont petites ou fort étroites. Excepté quelques mosquées qui sont tres-belles, le reste ne paroît que des nids
à rats. Il peut y avoir environ 800 à 1000 maisons. Une grande place où il y a beaucoup de palmiers separe
la ville nouvelle de la vieille. Plusieurs bedoüins campent en differens temps de l’année sous les palmiers de
cette place. Les portes de l’ancienne Alexandrie sont encore en pied ; & ce qui est de particulier, c’est que
l’on voit le fer dont ces portes étoient revêtuës, presque tout mangé par le temps, & que le bois n’est ni
endommagé, ni pourri : aussi, dit-on, qu’elles (p. 44) sont faites de bois de Gemesse. Toute l’eau qui s’y boit
dans Alexandrie vient du Nil par des canaux que l’on nomme Kalis, qui la conduisent dans des citernes sous
les ruines de l’ancienne ville où l’on remarque encore de la beauté & de la magnificence.
Quand il a plu, les Bedoüins qui sont les paysans d’autour d’Alexandrie, vont chercher dans ces ruines aux
endroits où la pluie a le plus lavé : il s’y trouve des pierres gravées & des médailles qu’ils viennent vendre
aux marchands François ; j’y en achetay beaucoup d’assez rares, tant pierres que médailles. Voilà à peu
près ce que j’ay crû pouvoir âjouter aux relations plus étendües qu’on en a fait attention sur bien des choses
dont je parle. »
553 Une édition plus récente a été publiée : Lucas, P., Voyage du sieur Paul Lucas dans le Levant, juin
1699-juillet 1703, par H. Duranton, Paris, 1998.
554 Carré, J.-M., Voyageurs et écrivains français en Égypte, t. I, Ifao, Le Caire, 1956, p. 44-45.
Omont, H., Missions archéologiques françaises en Orient, aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1902, p. 317-382.
- 553 - 554 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
|
18e siècle |
FRANÇAIS ANONYME (1701)
Français anonyme, Nouveau voyage de l’Egypte, de la Terre Sainte, du Mont Liban, de Constantinople et
des Echelles du Levant, Lisbonne, 1702.
En 1701, Alexandrie reçoit la visite d'un voyageur qui préfère garder l'anonymat en ne signant son ouvrage
que par la phrase « un voyageur né sur les bords de la Garonne ».
p. 6-17 :
« Cette ville est située sur le bord de la mer. On y voit la vieille & la nouvelle : celle-ci n'a point de murailles,
& toutes les deux ensemble de peu d’étendue, d’où je conçois qu’Alexandrie si fameuse & si magnifique,
s’étendoit davantage du côté du Lac Mareotis, ce qui se justifie à l’inspection du terrein & de beaucoup de
mazures, sans compter qu’il n’est pas naturel de croire qu’une ville qui n’a cedé en beauté qu’à Rome & à
Carthage, ait été resserrée dans les bornes que nous voyons maintenant.
Les murailles sont de belles pierres de taille, flanquées de grandes tours où l’on voit plusieurs chambres
établies sur des voutes d’une simetrie admirable ; l’enceinte est double, un chemin entre-deux ; & ce qui
prouve que ce ne sont pas les anciennes murailles d’Alexandrie, c’est qu’on remarque un grand nombre de
colonnes de marbre & de porphire qui se laisse voir dans leur capacité, & qui sans doute sont tout-à-fait hors
d’oeuvre & de leur rudesse des Barbares qui devenant restaurateurs des villes dont ils avoient été les
destructeurs quelques momens auparavant, se servoient des matereaux preparez par leur propre fureur, &
confondoient brutalement les morceaux les plus précieux avec ce qu’il y avoit de plus commun.
Il y a deux ports, le vieux & le nouveau ; celui-ci est destiné à tout les bâtimens étrangers ; il a plus
d’étendue que de sureté, non-seulement parce qu’il est très-découvert, mais par la difficulté de son entrée
qui montre dans le milieu un rocher appellé le Diamant d’Alexandre, & à cause de plusieurs ruines cachées
sous les ondes, dont à peine les vieux Pilotes du païs peuvent se garantir ; & parce que les Turcs sont dans
l’habitude d’abandonner les choses au cours de la nature, sans se mettre en peine de les maintenir par des
reparations de quelque depense : les connoisseurs m’ont assuré qu’en moins de vingt ans leur negligence à
le nettoyer de beaucoup de sables & vases, les rendra tout-à-fait inaccessible : L’autre est l’un des plus
beaux & des plus assurez qu’on voye sur la Mediterranée ; mais la supertition de ces peuples, prévenus que
les François doivent s’en saisir un jour de vendredy, & ensuite de la ville, en defendra pour toûjours l’entrée
aux Chrétiens. Ensuite deux ports est l’Isle si renommée de Pharos ; ce n’est plus qu’un même continent
avec la nouvelle ville, & son Pharillon une tour très-commune, élevée sur le bord de la mer dans un château
de peu de consequence par lui-même, par l’artillerie & la garnison qu’on y entretient.
Je ne puis sortir de cette Isle, Monseigneur, sans me recrier sur l’extréme défence que nous devons aux
Oracles de l’Antiquité qui nous la dépeint l’une des merveilles de l’univers ; moi qui cherchant avec avidité
de mes yeux ne rencontrois chose au monde digne de la moindre attention ; & je ne sçai s’il ne seroit pas
permis de dire sans temerité que ce qu’on considere aujourd’hui dans cet endroit est une aussi grande
merveille de la vicissitude des choses humaines que le miracle lui-même l’a été autrefois.
On dit que c’est dans ce jour alors délicieux que Ptholomée-Philadelphe établit des cellules pour loger des
septante Vieillards, que le Grand Prêtre Eleazar lui envoya suivant son desir, afin de traduire en Grec les
Livres Sacrez, pour que chacun pût les lire, ce qui réussit avec tant de succés, qu’indépendament d’aucune
communication le travail de ces Hommes extraordinaires se trouva conforme dans le sens & dans les
paroles : Peut-être qu’on a pris occasion d’un évenement si prodigieux de publier de cette Isle ce que j’en ai
déjà remarqué. Il n'y a pas de consul dans Alexandrie que celui de France ; il réside dans la nouvelle ville
avec son chancelier et avec toute la nation, composée de dix ou douze marchands ; et tous les gens de
quelque considération en font de même, la vieille presque toute ruinée étant le partage des malheureux que
la nécessité de se procurer la subsistance attire tous les jours à la Marine : On voit parmi les ruines deux
aiguilles de Cleopâtre, l’une est abbatue & la moitié sous le sable, l’autre est dans son état naturel, toutes
les deux de pierre de granite, embellies de lettres hieroglifiques dont on a perdu la connoissance, ne cedent
qu’à celle qui est dans la Place de saint Pierre de Rome, & à une autre dont je parlerai dans la suite.
A quelques pas de là est une Eglise dediée à sainte Catherine, où une petite & très-pauvre communauté de
Grecs qui la desservent, font voir la pierre sur laquelle on a tranché la tête de cette Heroïne ; & c’est
uniquement par rapport à cet évenement tragique que ce lieu est de quelque consideration. D’un autre côté
est celle de saint Marc qui n’est pas plus recommandable, si ce n’est qu’on y voit la chaire dans laquelle a
prêché cet Evangeliste.
Il n’est plus possible de sçavoir l’endroit où étoit le serapium, ce lieu si venerable qui renfermoit cette
bibliotheque, que les soins de plusieurs Rois avoient augmentée jusqu’à cinq cens mille volumes, & qu’un
feu sacrilege consuma en peu de jours : Quelle affliction, Monseigneur, pour la posterité, & pour l’incendiaire
lui-même Jules-Cesar, trop favori des Lettres & des Sciences pour n’être pas sensible à une perte aussi
irreparable ; Mais si dans les maximes de la politique, à la verité criminelle, tout est permis pour regner
jamais mortel ne fut plus excusable que ce conquerant & fondateur de l’Empire du monde.
Il est tems de sortir de cette ville depourvue de toute science puisque ce tas inestimable d’érudition devint un
peu de cendre dont les vents se jouerent. Il faut donc chercher quelque consolation auprès de la colonne,
qu’on appelle la colonne de Pompée, sans sçavoir pourquoi ; & chemin faisant jetter les yeux sur ses fossez
assez larges, & quasi tous comblez d’ordures & de ruines ; on la voit placée à une portée de mousquet des
murailles, sans doute autrefois au milieu d’une belle place sur une petite élevation du côté du Lac, où ne
paroissent plus les vignes dont le vin trop fameux inspira à une reine voluptueuse de demander l’Empire de
Rome pour le prix de ses débauches.
Elle est de pierre de granite de cent vingt-cinq pieds de hauteur, d’une seule pierre ; son chapiteau de
marbre blanc qui lui est proportionné étoit surmonté d’une figure apparamment gigantesque qu’on ne voit
plus. Au reste il ne faut pas penser, selon le sentiment de plusieurs, que ce beau morceau soit fait de pierre
fondue, comme on le dit de beaucoup de piramides & colonnes élevées en tant de lieux differens, sur tout
dans l’Eglise des Chartreux de Rome aux Thermes de Diocletien ; je me suis desabusé moi-même sur le
témoignage de personnes d’esprit & de consideration, qui ont vû dans la haute Egipte des montagnes de
cette pierre, & admiré de parfaitement belles colonnes taillées dans le rocher, & abandonnées par le
malheur des tems, ce qui ne doit laisser aucun doute là-dessus. Les Turcs qui s’imaginent de trouver des
trésors par-tout où leur avidité leur inspire d’en chercher, ont creuse d’un côté sous la baze de cet excellent
ouvrage, & ont fait un trou qui découvre des hierogliphes & qui menace d’une chûte également prochaine &
funeste, ce monument l’un des plus magnifiques de la grandeur de l’Antiquité. A quelque distance de cet
endroit du côté du nord paroissent des Cathecombes, ce sont des niches ou tombeaux d’environ quatre
pieds de diametre en quarré, d’une profondeur proportionnée au cercueil, bâtis par étage d’assez belle
pierre ; avec beaucoup d’art, & qui sont encore assez entiers pour qu’on puisse juger de l’extréme
veneration que ces peuples avoient pour les morts. Le faubourg de Nécropolis, qui commençoit à la sortie
de la Porte de Canope, aujourd’hui de Rosette, est entierement effacé, & on s’en souvient que comme de la
piqure de ce serpent, qui termina dans ce lieu le destin malheureux de l’infortuné Cleopatre, trop tendre
dans la prosperité pour la gloire d’Antoine, mais aussi trop illustre dans la disgrace pour le triomphe
d’Auguste.
Les marchands ne font point d'emplette à Alexandrie, mais reçoivent les marchandises qu'on leur envoie du
grand Caire et de Rosset ; autrefois il y avoit un canal sur lequel on les voituroit de cette dernière ville
jusqu'au lac Mareotis, & du lac un autre qui communiquoit au vieux port, ou Cebotus ; ni l'un ni l'autre ne
sont plus pratiquables aux bâtimens, & ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que les Barbares ont laissé
combler celui qui part de Rosset, revêtu de murailles, & pavé de briques comme du temps des Romains, par
l’espace de quarante mille, de maniere qu'il ne devint de quelque usage qu'à la hauteur du Nil : alors les
officiers d'Alexandrie vont à cinq ou six milles vers le canal, et après avoir fait un grand régale & plusieurs
ceremonies donnent cours à l'eau de ce canal qui, remplissant toutes les cîternes, fournit de quoi boire aux
Alexandrins, dont la ville n’a ni puits ni fontaines ; Tout cet espace que j’ai dit, d’environ six milles, n’est
quasi qu’une voute par le nombre infini de cîternes, qui ne semblent resister à la rigueur du tems depuis
deux mille années, & devoir assister aux funerailles du monde, qu’afin d’aller du pair avec toute la gloire
d’Alexandre leur Fondateur ; ce qui me fait dire, non pas que les choses vont en diminuant, mais que s’il
n’est pas impossible d’imiter la magnificence des Anciens, comme nous le voyons en ce qui est achevé de
l’Eglise de Saint Pierre de Rome, au moins il sera très-difficile de les surpasser.
L’impatience de me rendre au Caire, comme au centre des beautez de l’Egypte, me détermina de partir
après avoir fait un séjour considérable à Alexandrie ; Je pris la route de terre escorté d’un truchement,
unique moyen de voyager en surêté, & me rendis le jour même à Rosset, après avoir fait quarante mille, &
pour conséquent un peu plus de treize lieues. »
- 555 - 556 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
SIEUR DE LA CROIX (1703)
Delacroix, L’Égipte Ancienne et Moderne, seconde partie de l’Égypte Moderne, Paris, Bnf, Ms. fr. 6093.
Le Sieur de La Croix (1630/1640-1704) a parfois été confondu avec François Pétis de La Croix
(1653-1713) ; deux orientalistes chargés, à la même période, par le ministre Colbert d’acquérir des
manuscrits et des antiques.555
p. 32-52 :
Description de la ville d’Alexandrie
« Cette ville celebre appelée par les Turcs Skenderié ville d’Alexandre, qui en fut le fondateur, est scituée
entre la mer d’Egipte et le Lac Maréotis, a l’extremité d’une plaine sablonneuse d’environ 800 pas qui la
separe de la mer.
Sa coste est agreablement diversifiée de palmiers, sicomores, orangers, citroniers, figuiers, grenadiers,
cassiers, caroubiers, et autres arbres, qui font un tres bel aspect, mais elle est dangereuse a cause de
quantité d’écueils cachés sous l’eau, et fort avancés dans la mer.
L’entrée de son grand port, qui est fait en croissant, est aussi assés dificile a ceux qui n’ont point la
connoissance des deux écueils de son embouchure, l’un apelé le Diamant par ce qu’il s’eleve en pointe hors
de l’eau, et l’autre le girofle a cause d’un vaisseau chargé d’epicerie dont le naufrage fit la malheureuse
decouverte de cet ecueil caché sous l’eau au milieu du passage.
Mais l’orsque l’on a evité ces deux rochers, ce port est scur partout, spacieux, et defendu par deux
forteresses, l’une forte, grande et munie de quantité de canons et d’hommes, laquelle est batie sur les ruines
de ce superbe phare, une des sept merveilles du monde, et l’autre plus petite et moins fortifiée placée sur la
pointe oposée.
Ce grand port en renferme deux autres, l’un destiné pour les vaisseaux, saïques et galeres Turques, et
l’autre pour les batimens etrangers, dont il y a tous les ans un fort grand concours, acause du comerce de
cette echele, qui est la plus considerable de l’Empire Otoman.
L’air d’Alexandrie est toujours malsain acause de la chaleur excessive de son climat et il seroit impossible
d’y vivre l’été si elle n’étoit pas modéré par les vents du Nort, qui commence à soufler des le mois de mai
depuis le matin jusqu’au soir et rafraichissent l’air.
L’enfoncement de sa situation et le voisinage de plusieurs canaux perdus, de lacs et de flaques d’eau du Nil,
produisent en se dessechant des vapeurs si puantes qu’elles causent la peste, les fiebvres malignes et
autres maladies mortelles qui cessent neanmoins a l’entrée du soleil dans le signe du Lion, de sorte que la
malignité de l’air n’est pas toujours égale.
Le sejour d’Alexandrie malgré tous ces accidents ne seroient pas si desagreable sans les avanies et le
risque que l’on court parmi les Mores qui sont enemis mortels des Cretiens, lesquels ne marchent qu’en
crainte dans cette ville ou la vie seroit fort douce par l’abondance et le bon marché des vivres.
Le quarteron d’oeufs ni vaut que deux sols, une poule quatre, un mouton trente et le beuf 18 deniers.
L’ocque qui est un poids de deux livres et demie ; le poisson de mer et d’eau douce y sont a tres bon
marché, aussi bien que le fruit et toutes les autres denrés, a la reserve du vin, lequel est assés cher parce
qu’il vient de Sirie ou des Isles de Chipre, Candie, et autres de l’Archipel, de Zante, de Cephalonie, et
quelque fois de Provence.
Ceux qui disent qu’il ne pleut jamais a Alexandrie, ni même dans toute l’Egipte, sont dementis par
l’experience annuelle d’une pluïe continuelle durant tout le mois de novembre melée de tonerre et de
tempestes furieuses, apres lesquelles le ciel reprend sa serenité et sa beauté ordinaire.
Cette Ville se divise en deux, l’Ancienne et la Moderne qui est batie sur le bord de la Mer pour la comodité
du comerce, et a cause que l’ancienne est détruite et inhabitable on l’apele Ville Neuve et elle n’est pas
close.
Elle conciste en un grand quay ou est batie la maison de la Doanne ou l’on decharge les marchandises
etrangeres avec plusieurs Bazars, hales couvertes pour le debit de celles du païs, et quantité de maisons
malbaties, mal arangées et sans ordre, qui forment cette ville moderne, laquelle s’agrandit tous les jours.
Comme elle depend du gouvernement du Kaire le Pacha y envoie un de ses Agas comander a sa place, un
Cadi pour la justice, et deux soubachis ou Prevosts pour la Police des deux villes avec une compagnie de
Janissaires pour contenir les Mores lesquels n’etant point admis dans aucune charge, s’occupent au
comerce.
Les François y ont un Vice Consul dependant du Consul du Kaire, lequel habite dans un fondique ou
Kervanséray a la Vieille Ville avec tous les marchands de la nation que l’on ferme tous les soirs de bonne
heure de crainte de bruit et d’avanie. Il n’y a qu’une porte a ce batiment gardée jour et nuit par quatre
Janissaires acause des Mores et dont les Turcs gardent les clefs de sorte qu’ils la viennent ouvrir de grand
matin, a la reserve du Vendredi qu’ils ne l’ouvrent qu’apres la priere de neuf heures, de crainte disent-ils que
les Cretiens ne reprennent la ville.
Lorsque ces marchands ont quelque avis de consequence a faire passer au Kaire en diligence, ils expedient
leurs couriers ailés, qui font cette course en une demie journée qu’un cavalier bien monté ne peut faire qu’en
trois jours et trois nuits.
Ce sont des pigeons masles acoutumés a ces sortes de courses que l’on aporte du Kaire lorsqu’ils ont des
petits et que l’on tient enfermés pour ces sortes d’occasions ausquels on atache sous l’aisle un petit billet
envelopé de cire et apres les avoir bien remplis de grains de crainte que la faim ne les arete ou les porte sur
la terasse et on leur donne l’escort. Ils voltigent quelque tems pour reprendre l’air de leur colombier sans se
tromper que l’on visite plusieurs fois le jour, lorsque l’on atend quelque avis.
Les Turcs se servent aussi de ces sortes de couriers plus scurs et plus vigilans que les autres. Le Pacha en
a un colombier rempli dont il envoie les masles de tems en tems dans les confins de son gouvernement pour
avoir des avis prompts de tout ce qui s’y passe, principalement durant les revoltes des Arabes de La
Mecque, les quelles sont assés frequentes.
Des Antiquités curieuses d’Alexandrie
Alexandrie apres avoir eté longtems la capitale de l’Egipte, le sejour de plusieurs Rois et Empereurs et
l’objet de l’admiration de tous les hommes acause de ses edifices, de ses palais superbes et de tous les
monumens rares et celebres n’est plus qu’un amas confus de ruines parmi lesquelles on ne decouvre a
present rien de plus entier et de mieux conservé que les murailles acause de leur solidité.
Elles ont plus de deux lieuës de circuit et elles sont baties de pierre dure et defendues de grosses tours
quarrées eloignées de deux cent pas les unes des autres et divisées en apartemens capables chacun de
loger deux cents hommes avec plusrs portes gardées par des commis de la Doanne pour empecher les
contrebandes des marchandises qui viennent du Caire, de Rosette et d’autres lieux.
On ne voit partout dans Alexandrie que marbres brisés, colones renversées et rompuës, et des vestiges de
ses anciens Rois, principalement de celui de la Reine Cleopatre.
Ses cisternes sont des ouvrages dignes d’admiration, lesquelles ont fait dire dans le monde qu’Alexandrie
étoit composée de deux villes l’une sur l’autre ; Elle estoit efectivement toute en l’air, batie et soutenuë sur
une infinité de colones separées en compartimens de murailles pour former des cisternes particulieres,
enfermées toutes dans une generale aussi etenduë que cette ville ou chaque année on introduit l’eau
nouvelle du Nil par deux aqueducs souterrains tirés du canal qui sort au dessus de Foä petite ville sur le
chemin de Rosette au Caire, lesquels passent sous les maisons, tombent dans des puits d’ou on les retire a
force d’hommes et on remplit les cisternes ou elles se conservent pour la boisson des hommes et des
animaux.
Les terres que l’on a tiré de ces cisternes ont formé deux grosses montaignes dans l’enceinte de cette ville
dont les pots cassés que l’on transportoit en ont composé deux autres, sur l’une desquelles oposée au
château du Phare, il y a une tour delaquelle ont fait la decouverte des batimens qui paroissent a la mer, dont
la sentinelle marque la quantité et la qualité par un pareil nombre de banieres taillées en voile latines ou
quarrées.
On voit auprès du fondique des françois deux Obelisques de marbre granite tres belles et chargées
d’hieroglifiques, l’une droite de 50 pieds de hauteur, et l’autre renversée, et demi enterrée sous les ruines
des edifices, laquelle paroit plus grosse que l’autre et faire partie des tristes debris du palais de Cleopatre,
desquels on peut conjecturer qu’il surpassoit autant en magnificence tous les autres que cette reine
l’emportoit en vanité sur les predecesseurs.
Ceux de la maison du Pere de sainte Caterine ne sont pas loin de la aussi bien que l’eglise dediée a cette
sainte, qui est desservie par les Grecs, ou il y a une petite colone de marbre blanc sur laquelle on lui trancha
la teste et deux chapeles entretenuës par les françois et les venitiens, lesquels y font celebrer la Messe a
toutes les festes solemnes.
Celle de saint Marc Premier Patriarche d’Alexandrie qui estoit anciennement l’eglise patriarcalle apartient
presentement aux Cophtes lesquels y ont conservé le corps de ce saint jusqu’a son enlevement par les
venitiens.
La colone de marbre granite, ditte vulgairement de Pompée, est le plus beau morceau de toutes les
Antiquités ; Elle a 60 pieds de hauteur et sept de diametre sans la base quarrée de douze pieds cubes aussi
bien que son chapiteau lesquels sont du même marbre, de sorte que plusieurs ont cru que cen’etoit qu’une
seule pierre.
Elle est exposée a cinq cent pas de la ville sur une petite eminence, que l’on decouvre du Port, du Lac
Mareotis, des deserts de Barca, et de saint Macaire, et de toute la ville, et qui est un des plus endroits (sic)
de son voisinage.
Quelques uns ont cru que cette colone, et toutes les autres ne sont pas des pieces entieres de marbre, mais
une composition d’un mastic pulverisé, dont le travail infini auroit epuisé les forces et les ages de plusieurs
hommes, lesquels n’auroient pas pu en fabriquer une si grande quantité que celle qui a eté enlevée et qu’il
en reste sous les ruines de cette ville, mais il est constant qu’il y a dans le sahyd ou la Thebaïde des
Montagnes de ces marbres ou l’on voit encore les lits dou il ont eté tirés.
Un Derwich ou Religieux Turc eut un jour la malice d’inspirer a un Vice Roi avare de la faire abatre pour tirer
un pretendu tresor qu’il disoit etre caché dans la base de cette colone du pied de laquelle il fit efectivement
tirer quelques pierres et il l’auroit fait mettre bas. Il n’en eut pas eté detourné par la remontrance de ses amis
qui lui firent conoitre que ce Derwich etoit un fourbe, lequel vouloit l’engager malicieusement dans cette
entreprise dans la vuë d’un interest imaginaire dont il ne lui resteroit qu’un honteux repentir de voir son
avarice trompée et renduë publique par la destruction d’un monument si rare.
On trouve parmi toutes ces ruines des Pierres fines, grenats, agates et cornioles gravées de testes et
d’autres figures lesquelles servoient de cachets et de charmes aux enchantemens aux anciens Egiptiens, si
bien travaillées qu’il s’en est trouvé de tres precieuses et inestimables, elles se decouvrent par les ravines et
font un des principaux guains des Beduins aussi bien que les médailles de toutes sortes de metaux parmi
lesquelles il y en a quelquefois de fort rares. »
555 P. Sebag, « Sur deux orientalistes français du XVIIe siècle : F. Pétis de la Croix et le sieur de la Croix »,
dans Revue de L’occident musulman et de la Méditerranée 25, 1978, p. 89-117.
- 557 - 559 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GIUSEPPE SORIO (du ? au 25 octobre 1706)
Sorio, G., Descrizione della citttà d’Alessandria d’Egitto, lettera inedita di Giuseppe Sorio Vicentino al Conte
Gaetano Chiercati, Vicence, 1864.
Giuseppe Sorio (1663-1742), gentilhomme de Vicence, voyage en Asie et en Afrique. Il rédige une relation
composée de douze lettres suite à la demande de G. Chiericato. Parmi ces lettres conservées à la
Bibliothèque communale Bertoliana, cinq sont inédites. Alexandrie est décrite dans la huitième lettre.556
p. 9-23 :
« Eccell.o Sig.r Col.o
Roma 6 Giugno 1707
Per liberarmi presto dalla relazione d’Egitto bisognerà ch’Ella ssi contenti di gradire una relazione
superficiale delle cose ; come le ho vedute, senza que io voglia profondere nell’esame delle tanto differenti
opinioni degli autori cosi antichi come moderni : perchè, volendolo anche fare, non so poi quanto vi possa
riuscire. Tutti gli autori che ne parlano, o sono oscuri ed incerti per la loro antichità e per la quasi totale
mutazione delle cose, o sono poco veridici, se anco sono moderni, perchè in un paese straniero di costumi,
di lingua e di genio non ne hanno potuto avere buona traccia dai libri, ne dal commercio degli abitatori, coi
quali, credo, in ogni tempo abbiano avuto di mezzo (p. 10) reciprocamente l’odio e il disprezzo ; onde il
viaggiatori hanno spesso perduta la tramontana nell’immensità del paese e del tempo, e nella difficoltà che
produce la barberia de’popoli. Erodoto, Diodoro ed altri vecchi autori ci rappresentano l’Egitto come lo
ritrovarono a tempo loro, come appunto Pausania ci rappresenta la Greccia : sicchè dell’uno e dell’altro
paese i secoli hanno cancellato le memorie, e noi altri al presente non troviamo nemmeno la divisione delle
provincie. Io le diro dunque brevemente cio che ho veduto, sebbene non sarà possibile di restringere l’Egitto
in una sola lettera, come lo scrupolo d’esser lungo mi fece desiderare nell’ultima che le ho scritta.
Eravamo giunti in Alessandria, città encora nobile pel commercio di quasi tutte le mercanzie orientali che vi
vengono per via dell’Egitto. Cio che scende pel destro braccio del Nilo, esce per Damiata, ov’era l’antico
Pelusio, e cio che scende per sinistra, passa per Rosetto, ove anticamente era Canopo. L’uno e l’altro di
questi due rami formano il triangolo del basso Egitto, che dalla figura si chiama il Delta ; e tutto questo
grande spazio d’aria per opinione di antichi e moderni autori si tiene che sia una vasta bonificazione del Nilo
per l’annua deposizione che ne deriva della sua regolare escrescenza. Quindi è che Damiata e Rosetto,
ov’erano Pelusio e Canopo, non sono più, com’erano, vicini al mare, perchè la stessa escrescenza ha
portata due o tre miglia avanti la spiaggia ; il che produsse anco il pocco fondo del mare per alcune miglia
(p. 11) lontano da terra . Questi sono i due rami principale del Nilo, che vanno in mare, non essendo molto
considerabili gli altri che non sono navigabili, ed alcuni non sempre pieni, e potendosi mutare da un luogo
all’altro secondo l’empito irregolare dell’ escrescenze. Uno cavato ad arte, che porta l’acqua nelle cisterne
d’Alessandria per la foce Canopica, e poi per mare con piccole barche chiamate germe, non potendo il fiume
portar legni grossi. L’acqua che viene pel suddetto canale si conserva nelle cisterne pubbliche, le quali
abbraciano tutto il sotterraneo della città, per nostro modo d’intendere, come una cantina universale con volti
sostenuti da colonne distribuite in eguali distanze quadrate. Queste si considerano opera de Alessandro,
supponendo che la città non possa essere stata fabbricata senza questa necessaria provvisione, perchè nel
paese i pozzi non danno altro che acqua salmastra. L’essere sotterranee le cisterne le ha preservate
dall’ingiurie del tempo et della fortuna, mentre del rimanente niente di vecchio e pocchissimo di nuovo si
vede in piedi. Resta il recinto delle muraglie, che non si crede più antico di cinque secoli, fatto da’Sarraceni
con molte e frequenti torri, molte delle quali sono tante fortezze, essendo distribuite in molti appartamenti,
ognuno ripartito in diverse sale, mi pare in modo da potervi tenere provvisione e soldati, e da potersi
difendere da nemici, cosi dentro come di fuori della città. (p. 12) Il recinto di cui le parlo, che contiene la città
vecchia, aveva due o quatro miglia di circuito, non contenendo altro che alcune chiese convertite in
moschee, una chiesa de’Goti, una de’Greci e l’Ospizio de’Zoccolanti nel luogo, ov’ era l’abitazione del
console e de’mercanti francesi, i quali tutti, fuori che i frati, si sono ritirati ad abitare alla marina fuori della
città. Qui vicino al fondaco de’francesi abita ancora qualche famigliuola di povera gente, e dall’altra parte,
ov’ è la punta que va a Rosetto, avvi una piccola contrada di casuccie ignobili e parimenti abitata da gente
simile. La città è situata nella parte meridionale dell’Egitto sopra la penisola del faro, che era isola
anticamente ‘Tanto cambiar puo lunga età vetusta’.
Le due gole dell’istmo formano due porti, l’uno si chiama il vecchio, che riguarda verso ponente e
mezzogiorno ; l’altro si chiama il nuovo, che è malamente dominato da tramontana. Il primo serve solamente
per le navi del gran Signore, l’altro pei legni mercantili, e particolarmente pei franchi, che sono del tutto
esclusi da metterve l’ancora. Il porto nuovo è custodito da una rocca quasi rotonda, fabbricata sul molo dalla
parte d’occidente, ed ha nel mezzo una torre, che serve di lanterna per scopirlo la notte, e dalla parta
d’oriente v’ è come un altra specie di molo con fortezza ruinata, ove mi pare aver osservata di lontano una
moschea con qualche casuccia. La rocca occidentale, ov’ è la lanterna, é provveduta di qualche cannone ;
ma la maggior difesa di questo porto sono gli (p. 13) scogli davanti la bocca, uno de’ quali è coperto con due
altri coperti in linea retta per dentro il porto, sicchè non è sicuro l’entrarvi senza piloto. Questo porto, cattivo
pei nemici, non è men buono pegli amici, perchè spesso vi se vede perire qualche legno, come accade due
settimane avanti la mia partenza ad un vascello livornese di quaranta cannoni, la notte antecedente al giorno
che doveva partire. Il porto vecchio ha tutte le buone qualità ; egli è grande, quieto e sicuro almeno all’amico,
e, possiamo dire, anco pei nemici, che troverebbero poca difficoltà in occuparlo. Ha la figura semirotonda, e
la boca larga pel diametro del semicerchio ; non è difeso se non da due grandi torri della città che gli sono a
cavaliere, e dal lato opposto ha una fortezza quadra con vecchie muraglie senza terrapieno, che una flotta
nemica volterebbe facilmente in testa ai difensori colle cannonate : lo tengono a forza con gelosia
superstiziosa. Non solo non è lecito l’entrarvi ad un legno cristiano ; ma non è nemmeno sicuro l’andarvi a
passeggiare per divertimento. Siccome il contorno del porto nuovo è tutto abitato da franchi, cosi quello del
porto vecchio è tutto popolato da turchi. Io v’ andai con un giannizzero e con un dragomano, che mi diede il
vice-console col vantaggio d’esser vestito levantino, mentre l’esser vestito alla francese m’avrebbe potuto
tirar addoso qualche sassata per esservi in quel tempo alcune sultane del gran signore ; sicchè la spaggia
era occupata da soldati di marina detti levanti, che sono in ogni luogo libertini (p. 14) ed insolenti contro di
noi. Voleva salire ad una torre di guardia sopra un’acuta montagnuola dentro la città, divisa dal porto con la
muraglia ; ma il giannizzero non volle assicurarmi da alcuni levanti, che là su si vedevano, i quali, diceva,
che facilmente si sarebbero approfittati delle mie vesti, affettando pretesti ch’io fossi andato a scoprire il
porto e le navi con qualche ostile intenzione. I consigli avvalorati dalla paura si abbracciano facilmente, e
facilmente io moderai la mia curiosità, perchè aveva già veduta abbastanza la situazione della città. Non so
quanto possano esser savi gli abitatori d’una città, ch’è tutta fuor di sè stessa. Tutt’Alessandria è ridotta fuor
delle mure nelle curve spiagge della penisola, che risguardano i due porti, perchè del formale della città altro
non resta che il commercio, che vi tiene i mercanti per l’opportunità del negozio ; il che si dimanda la città
nuova, che difficilmente arriverà al numero di dodici mila anime, come vien detto. La città vecchia, oltre le
suddette chiese di christiani e turchi, ha poco altro dentro que diverse colline di rovinacci restate a caso
dall’escavazione de’materiali portati altrove. Una parte de’materiali ha servito per le case della città nuova,
l’altra mi vien fatto credere che abbia servito per fabbricar le muraglie, non sapendo vedere ove possano
esser andate le pietre di cosi bella città, mentre non restano se non le sogliono restar fra la terra, quando si
asportano le parti meno minute ed utili ad uso migliore. Non voglio (p. 15) assolutamente creder questo fatto
di disfar la città per far le muraglie, che sarebbe lo stesso che abbruciare la casa per vender la cenere ; ma
qualche volta il cuor lo comporta, e molti bei pezzi di marmi e colonne, che sono ne’fondamenti delle
muraglie verso il mare ne danno indizio. Per le memorie antiche, cominciando dalle sacre, nella chiesa
de’Goti mostrano un luogo, ove dicono essersi trovato il corpo di S. Marco ; e nella chiesa de’Greci mostrano
una pietra, ove fu decapitata S. Catterina. Una bella guglia di granito con geroglifici si conserva ancora in
piedi alta circa settanta piedi e larga sei nella base quadrata ; la chiamano di Cleopatra, volendo
scioccamente che una vicina delle sopraddette torri di molte sale fosse il palazzo di detta regina. Un’altra
guglia vicina caduta in terra d’egual grandezza si vede per la base, essendo il resto coperto da ruine ; si
dice rotta in tre pezzi. Fuori poco della città, sopra una spaziosa eminenza, ve’è la colonna detta di Pompeo
per non sapersi altro dire. Alcuni la contano per la piu bella colonna dell’universo, ed io non so d’averne
veduta un’eguale. L’altezza sarà cento buoni piedi per la misura che ho potuto prendere senza stromento.
Eravano due che, riguardando la colonna, facevamo colle nostre linee visuali un angolo retto nel centro della
colonna, considerando le nostre linee orizontali alle base. S’allontanavamo dalla colonna l’uno a cenno
dell’altro, si che pareva reciprocamente all’uno che l’altro fosse tanto lontano dal centro perpendicolare della
colonna, quanto il fondo della (p. 16) base era lontano dalla cima della colonna. Quando a noi parve
d’essere tanto lontani dal fondo della colonna, quanto il fondo era lontano dalla cima, ognuno di noi misuro la
sua distanza co’passi andanti, ed avemmo l’altezza della colonna. Misurammo reciprocamente l’uno la
distanza dell’altro per convenire nella differenza de’passi e del giudizio dell’occhio, e, se l’occhio non
c’inganno tutti due, l’altezza fu ragguagliata in passi cinquanta, che importano cento piedi a buona misura ; e
tanto deve essere la colonna compresa la base e il capitello. La base è alta dodici piedi, ed è di due pezzi ; il
fusto della colonna è d’un pezzo, e il capitello fa il quarto pezzo. Tutto è di granito ; la base è alquanto
rossiccia, la colonna piu bigia, ed il capitello, se non m’inganna la memoria, se non è di marmo bianco, è
almeno piu chiaro. Bensi non m’inganno nell’aver osservato che il capitello è corintio, e cio sia detto con
licenza del signor Gemelli, che nel suo disegno lo mette d’ordine dorico ; che se le mie misure sconvenissero
molto da quelle del cortigian viaggiatore, siccome n’ebbi piena informazione cosi in Alessandria come in
Napoli, so ch’egli bensi ha fatto i viaggi ; ma non è stato osservatore piu diligente di me. Nella misura di
questa colonna credo di aver fallato di poco. Se il sole in quell’ora avesse portata l’ombra in terreno
orizontale, mi sarai servito di quella per prendere un’altra misura. Se avessi avuto una pàssera al mio
comando l’avrei presa, come mi fu detto aver fatto un capitano di nave, il quale (p. 17) sono fatte con molta
regolarità, la qual consiste in molte strade larghe sino a ventiquattro piedi con incavature da una parte e
dall’altra di quattro piedi in quadro, che vanno dentro per lunghezza d’un corpo umano ; alcune di queste
strade ne hanno un ordine per parte, altre ne hanno due o tre, l’un sopra l’altro, sempre con qualche non
essenziale differenza nella distribuzione, essendovi alcuna di quelle strade, che terminano in grotte quadrata
con tutto attorno i sepolcri ; altre di quelle strade voltano quà e là, come una città sotterranea, il che non ebbi
curiosità di vedere fino al fine per la troppa fatica, e perchè non era sicuro il fermarvisi lungamente.
Vedemmo poco lontano il canale que porta l’acqua nelle cisterne, che già era senz’acqua per
l’abbassamento del Nilo. Camminando un altro giorno per lo spazio vuoto della città vecchia, osservai circa
una ventina di colonne di granito disposte in ordine de sostenere qualche portico per facciata di qualche
tempio o di palazzo reale, essendovi in debita distanza una grande massa di mattoni induriti sulla malta, alla
quale il tempo ha levata ogni figura ; il che si puo credere che sia un resto del tempio o del palazzo che
aveva relazione colle vicine colonne. Una vicina grande moschea si dice essere stata la scuola di San
Atanasio. Del luogo dei settenta interpreti, che viene nominate da qualche autore, io non ne ho trovata
alcuna traccia. Dicono essere, ov’è la moschea de’Magrebini, cioè della nazione occidentale, come sono i
maomettani della costa africana : questi ne hanno (p. 19) piu d’una ; ma dei settenta interpreti non ne ho
trovato alcun vestigio. Dopo averle scritte le cose vedute in questa città, la incomodero parimente colla
descrizione d’una, che mi sono immaginato di vedere, benchè non sia recordata, ch’io sappia, da alcun
viaggiatore. Questo è l’avventura di Giulio Cesare, che mal veduto dall’ospite Tolomeo, perchè non avea
gradita la morte di Pompeo, fu sorpreso, credo, alla mensa dalle milizie del re, e, per difendersi colle poche
guardie che aveva, fece dar fuoco ai vicini edifici e ad alcune navi del porto, onde potè col mezzo della
confusione ritirarsi per l’istmo nella penisola del faro, ove non potendosi tenere per la prepotenza degli
aggressori fu necessitato di guadagnare a nuoto le sue navi, ch’erano in mare. Felici i viaggiatori se, di tutti i
fatti che hanno illustrati i luoghi che vedono, potessero ritrovarne cosi chiari riscontri. Il palazzo reale, ove fu
sorpreso, che non è in nessun luogo, si puo facilmente immaginarlo vicino alle mura, che confinano col
porto, ove prese l’occasione d’incendiare le navi. Dell’uno e dell’altro porto, a cui poteva esser vicino,
supponiamo il vecchio, che’è sempre stato il migliore e il più praticato, e supponiamo le navi romane nella
spaggia occidentale fuori del porto vecchio, per essere più sicura della settentrionale fuori del porto nuovo.
Da queste congruenti congetture non è difficile a vedere Giulio Cesare che si difende da disperato ; eccolo a
ritirarsi per l’istmo fra le confuse grida di fuoco e di armi : ecco la poca mano de’suoi, che non lo puo (p. 20)
sostenere nella penisola del faro ; eccolo a nuoto colla spada e co’suoi scritti per salvarsi nelle navi ; ecco il
trafitto paludamento che delude il furore degli aggressori ; ed ecco l’impaziente cavaliere Don Chisciotte che
snuda il ferro contro i soperchianti masnadieri d’Egitto. La relazione di Lucio Floro conviene perfettamente
con questo sito ; e benchè non faccia menzione alcuna di Don Chisciotte, io non ne dubito niente, perchè
essendo a lui riservate queste avventure dai negromanti, l’ommissione d’uno storico non puo togliere i diritti
d’un cavalier paladino. Sarebbero troppo voluminosi gli itinerari, se volessero abbracciare tutti i fatti d’armi
seguiti ne’paesi che nostrammo ; ma questo non era da ommettersi, perchè delle battaglie di Luzara e di
Cassano seguite sugli occhi nostri non abbiamo riscontri piu certi. Un opportuna occasione m’obbligo di
partire, quando era poco in istato di faticare, avendo avuta la febbre la notte avanti della partenza, che
dovea farsi. La sera dei 25 Ottobre montammo a cavallo, e appena usciti dalla città cominciammo a
camminare per un deserto sabioso, che non era se non qualche bosco di palme. Di questi boschi alcuni
nascono a caso, ed alcuni sono coltivati. La coltura consiste nel trapiantare i rampolli, che nascono dalla
radice d’una pianta vecchia, e nel tenerli irrigati l’estate, perchè almeno per sei mesi dell’ anno non vedono
pioggia. L’irrigazione si fa per via d’una macchina, ch’esalta l’acqua d’un pozzo, cavato ovunque vogliono
servirsi d’acqua. Non so se sia (p. 21) Diodoro Siculo che attribuisca l’invenzione di questa macchina ad
Archimede : so che in Egitto queste macchine sono di piu sorta, e so che sono note anco nei nostri paesi,
senza pero voler dire che di queste e d’ogni altra invenzione della meccanica non si debbano riconoscere gli
alti principii da quel grande uomo. L’irrigazione delle palme, se non è necessaria, è almeno molto utile,
acciocchè i frutti siano piu abbondanti e migliori. In alcuni luoghi, ove non sono irrigate, le ho vedute senza
frutti, mentre le irrigate gli aveano ; ma forse poteva darsi che, per essere non custoditi, i frutti fossero stati
antecedentemente levati. È ben notabile nella coltura de datteri, che la femmina non puo maturare senza
l’aiuto del maschio. Nello stesso luogo, ove il maschio produce i rami fogliosi, che propriamente chiamansi
palme, produce anche un ramo o piu d’uno senza foglie lungo qualche braccio, con in cima un cartoccio di
figura, come d’un frutto d’ulivo, lungo piu d’un palme e grosso nel mezzo, come un uovo ; il di fuori è tutto
verde, ed il di dentro è ripieno di certa polvere, la quale chiamano seme di dattero. Questa raccolta, quando
è matura, la spargono sulla cima dell’arbore, suppongo, nel tempo di fiorire, e la spargono sopra un crivello,
accio i frutti non cadano e si maturino, il che, dicono, non seguirebbe se cosi non facessero. Credo di avere
scritto al signor co. Gaetano delle filze de’fichi selvatici, che attacate ai domestici, servono a far loro
maturare i frutti. L’una di queste serve d’agromento all’altra, e le ho intese tutte (p. 22) due replicatamente
da tutti quelli co’quali io sono venuto in questo discorso. Questo arbore cresce in molta altezza, sempre dritto
in un tronco solo. Cresce pel centro della cima, coma gli asparagi, ed i rami con foglie lunghe e strette si
spargono in fuori, dando spazio a quelli che nascono in mezzo. Quando i rami sono vecchi di qualche anno,
o si tagliano, o si seccano, restando i tumori de’rami tagliati gli uni sempre tra i due, come le squamme della
pigna, e con la corteccia cosi squammosa cresce l’arbore sempre dritto sino alla cima, ove sono legati i
freschi rami d’una corteccia sottile e rosiccia, che rassomigliano a mazzetti di fiori. Dallo stesso luogo, di
dove escono i rami, escono parimente certi ramicelli, come gambe di ceci, i quali, sporgendo in fuori,
pendono a basso per lo peso de’datteri, che vi sono attacati. I datteri sono della figura de’nostri verdacci, di
colore più o men rosso, essendovi più sorta di datteri, come sono più sorta d’uva e di ciriege appresso di noi.
I datteri sono buoni ed utili cosi freschi come secchi. Si conservano, cavati gli ossi e stivati come il caviale,
tagliandoli nello stesso modo quando li vendono. Si cava acquavite fortissima, e gli ossi, finchè sono freschi
si macinano per mescolarli macinati con altra farina da far pasta per cammelli. L’arbore è alto a moltissimi
usi, e serve quasi a tutto, perchè il solo di cui l’Egitto ha quantità. Egli è eterno par fabbriche, perchè non
sente l’umido : la membrana (dalla quale ho detto che sono legati i rami nel luogo, ove escono dalla cima del
(p. 23) tronco) pestata in una pila di legno per romperla, come noi facciamo il canape, serve a filarla in corde,
delle quali son forniti quasi tutti i navigli dell’Egitto. In fatti si calcola che il solo arbore della palma basti per
mettere una nave in mare. Il legno fa il corpo e gli arbori ; la foglia fa le vele ; la suddetta corteccia o
membrana fa le corde, e i datteri servono pel vitto de’marinai. I ramicelli che fanno i datteri servono a far le
scope, ed a moltissimi altri usi servono le altre parti. Ma io non la incommodero più a lungo. Il nostro
cammino, che doveva essere di trenta miglia sino a Rosetto, fu fatto la metà, quando fummo ad un ramo
ignobile del nilo, che gli Arabi chiamano Inadie, volendo in loro lingua significare il passo. »
556 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 492.
Capparozzo, A., Giuseppe Sorio : viaggiatore vincentino, Vicence, 1881.
- 560 - 563 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HANNA DIAB (juin 1707)
Hanna Diab, Voyage d’un maronite alépin en compagnie et au service de Paul Loucas, pèlerin français,
Bibliothèque du Vatican, manuscrits de Paul Sbath, t. 1, p. 122, n°254.557
Hanna Diab, chrétien maronite d’Alep, est au service de Paul Lucas en tant que drogman (interprète). En
1709, il communique à Antoine Galland (1646-1715), premier traducteur des Mille et une nuits, plusieurs
contes : La lampe merveilleuse, Le cheval enchanté, Ali Baba et les quarante voleurs, etc.558
« Nous atteignîmes Alexandrie en 24 heures. Nous voulions entrer au port mais une tempête venue de la
terre nous obligea à regagner la haute mer. On dut y tourner durant 12 jours, jusqu’à ce qu’un vent favorable
souffle et on aborda au port sains et sauf. À notre descente du bateau on se rendit à l’habitation du consul
qui fit un excellent accueil à mon maître. Le consul donna ses ordres aux serviteurs d’aller au bateau pour
prendre nos bagages. On nous offrit des chambres meublées et nous transportâmes tous nos bagages sans
qu’ils soient fouillés par les douaniers. Nous demeurâmes là très bien traités. Les notables français nous
invitèrent chez eux et remplirent leur devoir envers mon maître parfaitement.
Quelques jours après, ils conduisirent mon maître hors de la ville et lui montrèrent, près de la mer, une
colonne haute comme un minaret sur laquelle étaient gravées des formes d’oiseaux, de reptiles, de gazelles
et d’autres animaux semblables. D’après les savants, cette colonne est faite d’un alliage, il est impossible
qu’elle soit tirée par une voiture ou qu’elle soit dressée ou bougée par quelqu’un. Elle est enfouie dans le sol
d’autant qu’elle s’élève au dessus, ce qui prouve que c’est un alliage. Mon maître demeura près de la
colonne et en transcrivit toutes les gravures ; lorsqu’on lui demanda pourquoi il les relevait, il répondit que
ces dessins représentaient des lettres et des mots dans une langue secrète qu’employaient les philosophes
grecs à l’époque. Près de la colonne, il y avait une grotte appelée « grotte de l’esclave », elle est creusée
dans le rocher et la mer y pénètre ; il s’y fait un vacarme terrible à cause de la violence des vagues. Peu de
nageurs peuvent y entrer. Ceux qui sont entrés racontent que c’est une grotte immense, à cause du tumulte
des flots. Enfin nous allâmes à un endroit où l’on a creusé 40 puits pour les besoins des gens de la ville en
eau. D’après les astronomes de l’époque, ces sources étaient influencées par certains astres ; quiconque
buvait de ces sources à l’époque de ces astres devenait fou. C’est pourquoi ils ont creusé tous ces puits.
Quand ils guettaient l’approche de ces astres, ils dirigeaient l’eau de la source vers les puits qu’ils
remplissaient. En temps opportun, ils puisaient de ces puits jusqu’à ce que passe l’influence de ces astres.
C’est ce que nous avons entendu dire sur la construction de ces puits, Dieu sait la vérité.
Enfin, nous avons visité des sites et des constructions très anciennes. Alexandrie est une des grandes villes
de l’Antiquité, comme en témoigne l’histoire. Nous sommes revenus à notre habitation pour quelques temps,
entourés de beaucoup d’honneurs.
J’allais tous les jours au port regarder les poissons qui vivent dans les eaux mélangées du Nil et de la mer.
C’est un spectacle indescriptible, je n’ai jamais goûté de poissons aussi excellents dans tous les pays que
j’ai visités. On fait des barrières pour pêcher le poisson, on y met une nasse de façon que les poissons qui y
entrent ne puissent plus sortir. On les prend alors sans peine. Il y en a des amas sur le quai. On extrait les
ovaires, on sale le reste et on l’envoie aux villes. Les principales occupations des habitants sont la salaison
et le travail du lin.
Mon maître se prépara à visiter le Caire. On prit en location une barque du Nil. On quitta la maison du consul
tranquillement le matin, on monta à bord et partit en mer. On arriva au Bougaz du Nil. Là, en permanence,
des gens indiquent la bonne route aux embarcations à leur arrivée, car le sable s’entasse et forme
continuellement des bancs du côté du Bougaz, qui en barrent l’entrée. J’ai vu alors le Nil se verser dans la
mer. C’est un spectacle admirable. Le Nil pénètre dans la mer sans que les eaux se mélangent, il y a une
raie qui se forme entre leurs eaux. Le Nil enfonce la mer. J’ai vu au fond de la mer des lignes blanches, à la
jonction, et j’ai demandé ce que c’était. On m’a répondu : « Ce sont les eaux douces qui se jettent dans la
mer salée sans se confondre avec elle. »559
557 Un document polygraphié est conservé à la bibliothèque du Collège de la Sainte Famille au Caire.
Voir également : Martin, M., « Souvenir d’un compagnon de voyage de Paul Lucas en Égypte (1707) », dans
J. Vercoutter (éd.), Hommages à la mémoire de Serge Sauneron, Bibliothèque d’Étude 82, 1979,
p. 471-475.
558 Zotenberg, H., « Notice sur quelques manuscrits des Mille et une nuits et la traduction de Galland »,
Notices et extraits des manuscritsXXVIII, 1ère partie, Paris, 1887, p. 167-320, p. 199.
559 Traduction : M. Martin (Bibliothèque de la Sainte-Famille, Le Caire).
- 564 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BENOIT DE MAILLET (de 1692 à 1708)
Maillet, B. de, Description de l'Égypte contenant plusieurs remarques curieuses sur la géographie ancienne
et moderne de ce païs, sur les monuments anciens, sur leurs moeurs, les coutumes et la religion des
habitants, sur le gouvernement & le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur
les Mémoires de M. Maillet ancien consul de France au Caire, par M. l'abbé Le Mascrier, Paris, 1735.
Benoît de Maillet naît à Saint-Mihiel, dans la Meuse, en 1656 dans une famille noble. Il passe ses premières
années à la campagne dans une oisiveté complète. Il a trente-six ans lorsque le chancelier de Pontchartrain
le fait désigner consul général de France en Égypte. En 1702, le roi le nomme ambassadeur en Abyssinie
avec la commission spéciale de travailler à la conversion des peuples de cette contrée. Effrayé par une
tâche aussi difficile, il démissionne et devient consul à Livourne où il demeure six ans. Il est ensuite nommé
inspecteur des établissements dans le Levant et sur les côtes de Barbarie. Il s'acquitte de cet emploi d’une
manière si satisfaisante qu’à son retour, il obtient sa retraite avec une pension considérable. Il s’établit alors
à Marseille et s’occupe de mettre en ordre les écrits de ses voyages. Il envoie son manuscrit à l’abbé
Le Mascrier pour en retoucher le style et le publier. Il meurt à Marseille en 1738.560
p. 118-152 :
« De la Ville d’Alexandrie ancienne et moderne, des monumens qu’elle renferme, et en particulier de la
Colonne de Pompée.
Je m’acquitte de ma parole, Monsieur. Après vous avoir promis plus d’une fois de vous donner une idée de
la fameuse Alexandrie d’Egypte, j’entreprens enfin dans cette lettre de vous faire une description la plus
exacte qu’il me sera possible de cette célébre & florissante Ville. Peut-être vous plaindrez vous de ce que je
vous l’ai fait si long tems attendre. Mais je vous prie de vous souvenir, qu’un plaisir différé n’en est que plus
piquant & plus sensible. Que si après la lécture de ma lettre vous trouvez que la chose ne valoit pas la peine
de mettre, comme j’ai fait, votre curiosité à la torture, avant que de la contenter sur ce sujet, je m’en
consolerai par l’exemple de mille honnêtes gens, à qui le même malheur est arrivé, & qui après s’être fait
souhaiter long tems, n’ont pas toujours répondu à la haute opinion qu’on avoit conçue de leur mérite.
Vous vous êtes fait sans doute une idée d’Aléxandrie comme d’une des premiéres Villes du monde, célébre
par les grands hommes qu’elle a produits, riche par son commerce, superbe par la magnificence de ses
bâtimens, digne enfin de picquer votre curiosité par l’étendue du terrain qu’elle occupoit, par le peuple
nombreux dont elle étoit habitée ; & plus encore par ces monumens fameux qu’on mit autrefois au nombre
de ce peu de merveilles dont l’Univers étoit enrichi. Que penserez (p. 119) vous, Monsieur, lorsque vous
verrez cette montagne n’enfanter qu’une souris, & que cette figure gigantesque, que votre imagination
prevenue par la lecture des Anciens vous peignoit si belle & si digne de votre admiration, se trouvera réduite
sur ce papier à une petite representation de Pigmée, qui à peine méritera d’arrêter un moment vos regards ?
Car je suis bien aise de vous prévenir d’abord sur cet article. Non, l’Aléxandrie de nos jours n’est plus cette
belle, cette florissante Ville d’Aléxandrie fondée par un Conquérant fameux, & qui non seulement fut
regardée à juste titre comme la premiére Ville d’Afrique après la ruine de Carthage, mais qui, comme le dit
Hérodien, pouvoit même se vanter d’être la premiére Ville du monde après Rome. De toutes ses grandeurs
passées il ne lui reste plus que son ancien nom, qu’elle soutient encore à peine, semblable à un vieux
chêne, qui courbé sous le poids des illustres trophées, dont de fameux guerriers ont enrichi son tronc,
semble gémir d’un honneur, qui commence à lui être à charge, après avoir fait la gloire & l’ornement de sa
jeunesse. Un amas confus de ruines informes & sans nom, des colonnes sans nombre, les unes encore
debout & conservant quelques traces imperceptibles de leur ancienne destination, quelques autres réduites
à des usages bien différens de ceux auxquels leurs premiers maitres les avoient employées, la plûpart
éparses, & renversées, ensévelies dans le sable & dans l’oubli, enfin des restes de Palais foudroyés par le
tems, telle est, Monsieur, l’image la plus exacte que vous puissiez vous former de cette ancienne Ville, dont
vous demandez des nouvelles. Un portrait si affreux seroit capable sans doute de vous rebuter. Cependant
au milieu des ces tristes débris, & malgré l’état déplorable où se trouve aujourd’hui cette superbe Ville,
combien n’y ai-je pas encore démelé de restes surprenants de son ancienne magnificence ! C’est de ces
recherches que j’ai faites moi même au travers de ces ruines autrefois si vantées, que j’entreprens de vous
entretenir. J’ose vous asseurer d’avance que vous y trouverez peu de chose de commun avec ce qui en a
été dit jusqu’ici. Un plan, je l’avoue, seroit seul capable de vous donner une juste idée de la situation
présente de cette Ville. Vous n’en serez pas même absolument privé. Ce que je vous dirai de l’ancienne
Aléxandrie supplera (p. 120) à ce deffaut, & servira à vous donner une connoissance plus exacte de
l’Aléxandrie moderne. Ne fût ce qu’en faveur de ce seul avantage, vous devriez, Monsieur, me passer le
parallelle. Je me flatte même que vous me sçaurez gré de vous avoir rappellé le souvenir de ce que fut jadis
cette puissante Ville, & de vous avoir donné lieu par là d’admirer encore les vestiges de son ancienne
splendeur.
El campos ubi Troja fuit.
Origine de l’ancienne ville d’Aléxandrie.
Aléxandrie est sans contredit la plus ancienne Ville, qui subsiste aujourd’hui en Egypte. Personne n’ignore
qu’elle doit son origine à Aléxandre le Grand. Après ce passage du Granique si célébré par les anciens
Auteurs, & dont un passage encore plus fameux fera à jamais oublier la mémoire, après avoir déja foudroyé
une fois dans les campagnes de la Cilicie des Perses redoutés, qui depuis si long tems faisoient trembler la
Gréce, maître de Tyr & de Sidon, ce Conquérant célébre, qui venoit d’ajouter l’Egypte à ses victoires,
comptant peu sur les asseurances d’une divinité qu’il étoit allé chercher jusqu’au fond des deserts de la
Lybie, songea encore à prendre des mesures plus puissantes & plus certaines, pour ne pas laisser échaper
la possession d’un si florissant Royaume. Lorsque ce Prince fit la conquête de l’Egypte sur les Rois du pays,
qui l’avoient gouverné jusqu’alors, leur résidence & le siége de leur empire étoit à Memphis. Cette ville,
comme je le ferai voir dans la suite, étoit située sur la rive gauche du Nil à la distance de trente lieues de la
mer, & au dessus des Piramides, lieu de la sépulture des Rois & des Grands du Pays. Par cette position
cette Capitale partageoit en quelque sorte tout le terrain de l’Egypte. Elle dominoit également, tant sur la
partie supérieure, qui sur une largeur fort resserrée avoit une longueur très considérable, que sur la partie
inférieure, qui n’étoit que de trente lieues de longueur depuis Memphis jusqu’à la mer, où elle avoit une
largeur assez étendue.
Mon dessein n’est point de vous entretenir ici de cette ancienne Capitale de l’Egypte si célébre dans les
histoires des tems reculés. Un autre sujet me fournira naturellement l’occasion (p. 121) de vous en parler
plus en détail dans mes lettres suivantes. Je me contenterai d’observer, qu’après qu’Aléxandre eut soumis
ce puissant Royaume, dont les habitans, alors tous Egyptiens naturels, étoient innombrables, ce Prince ne
crut pouvoir en conserver la domination sous un gouverneur, qu’il avoit résolu d’y laisser avec une très petite
partie de son armée composée seulement de trente mille hommes, s’il n’établissoit la résidence de ce
gouverneur sur les bords de la mer même. En effet c’étoit l’unique moyen, au cas que l’Egypte vint à se
révolter, de mettre ses troupes en état de recevoir par mer de la Macédoine les secours, dont elles auroient
besoin pour résister aux rebelles, & maintenir l’empire des Grecs en Afrique. Ce fut dans ces vues politiques,
que ce grand Conquérant aussi prudent, qu’il étoit brave, choisit vers la marine un lieu convenable à l’abord
des vaisseaux étrangers, pour en faire le séjour des gouverneurs, ou même des Souverains, qui pourroient
lui succéder dans la suite au gouvernement de cette nouvelle conquête. Il n’en trouva point de plus propre à
favoriser son dessein, que cette partie du rivage de la Méditerranée située à trente, ou trente cinq milles de
l’embouchure Occidentale du Nil, qui est une des deux principales par où ce fleuve va se rendre à la mer.
Ce fut donc dans cet endroit que dans la 112 Olympiade, & environ 330 ans avant la naissance de
Jesus-Christ ce Prince fit bâtir la Ville, qui dès lors prit le nom de ce Conquérant, qu’elle a toujours conservé
depuis, puisque le terme de Scandaria ou Scandarani, qu’emploient les Arabes pour la désigner, & celui
d’Aléxandrie, dont nous nous servons, ont absolument la même signification. Il est vrai qu’en vain
chercheroit-on aujourd’hui le tombeau de son fondateur sous le nom que lui donnent les anciens Auteurs.
S’il est vrai que ce tombeau ait jamais existé dans ce pays ci, il n’est pas moins certain, que l’endroit où il
étoit situé, aussi bien que le tombeau même, restes également ensévelis sous les ruines inconnues de cette
florissante Ville. Le fameux Dinocrates en fut l’architécte, & l’acheva, dit-on, dans l’espace de soixante &
douze jours. Aléxandre la fit surtout fortifier du côté de la terre. Par cette précaution, & par la communication
qu’elle avoit toujours libre avec les Etats héréditaires de ce Prince, puisqu’elle ne pouvoit être interrompue
par les Egyptiens, qui (p. 122) n’avoient alors aucunes forces maritimes, il la mit en état de soutenir un siége
assez long, pour attendre les secours qui pourroient lui être nécessaires. Il lui ménagea même une
ressource toujours présente dans les équipages des vaisseaux Grecs & Macédoniens, que la facilité & les
avantages du commerce ne pouvoient manquer d’y attirer.
De sa situation et de son étendue.
Il faut avouer, que le Conquérant de l’Asie ne pouvoit guéres choisir de lieu plus convenable plus le projet
qu’il avoit formé. Aussi cette Ville devenue dans la suite la résidence des Rois successeurs de ce Prince, qui
de Memphis transférerent le siége de leur empire dans cette habitation nouvelle, se rendit si considérable en
peu de siécles qu’eu égard à la grandeur de son étendue, & au nombre de ses habitans, Aléxandrie pouvoit
le disputer à Rome même. Apeine quatre à cinq cens ans s’étoient écoulés depuis qu’Aléxandre en avoit
jetté les fondemens, lorsque les Romains enleverent aux Grecs cette Capitale de leur empire en Egypte.
Dès lors ses fauxbourgs, & les petites Villes aux quelles elle étoit unie, s’étendoient d’un côté vers la Libye
jusqu’à la Tour des Arabes, éloignée de son fanal de dix milles d’Italie, tandis que du côté opposé, & tirant
vers l’Orient, elle s’avançoit jusqu’aux Biquiers, qui, comme je l’ai dit, en font encore à une distance de plus
de quinze milles. Ainsi Aléxandrie avec ses fauxbourgs, les Amphithéâtres, les temples, & autres édifices
publics, où particuliers, dont la mer étoit entiérement bordée des Biquiers jusqu’à la Tour des Arabes, & dont
cette superbe Ville occupoit à peu près le milieu, devoit avoir alors sept à huit lieues au moins d’étendue.
Les Auteurs anciens nous apprennent que la Ville seule contenoit une lieue de longueur sur une largeur à
peu près égalle ; qu’elle avoit la forme d’une chemise de femme, dont les manches seroient fort longues &
fort larges ; que par le bas de la chemise elle aboutissoit à la mer le long des ports, que nous appellons
aujourd’hui le vieux port & le nouveau ; que de ce côté-là ce fameux fanal, dont il est tant parlé dans les
histoires, séparoit en quelque sorte la Ville en deux parties égales ; que c’étoit de ce fanal, & non pas des
extrémités de la Ville même, qu’on commençoit à compter les distances de tous les lieux, dont elle étoit
environnée ; qu’enfin le haut de la chemise, c’est-à-dire la partie la plus considérable de (p. 123) cette Ville
s’étendoit le long du lac Mareotis, à la distance d’une lieue des bords de la mer, à laquelle elle alloit se
terminer.
Du nombre de ses habitans.
A l’égard du nombre de ses habitans, Diodore nous assure que de son tems on comptoit dans la seule
enceinte de la Ville d’Aléxandrie jusqu’à tois cens mille personnes libres ; ce qui joint aux esclaves & aux
affranchis dépendans de chaque maison quelque peu considérable, supposoit plus d’un million d’ames.
Cependant la splendeur d’Aléxandrie étoit alos déja sur son déclin. Un autre historien nous apprend, que
dans un soulévement arrivé dans cette Ville à peu près vers la même tems au sujet des Juifs, qui y étoient
établis, il périt quarante mille personnes de cette nation. Si les Juifs y étoient alors si nombreux, que doit-on
penser des autres peuples de la terre par qui elle étoit habitée ! Enfin Senéque écrivant à son ami Lucilius
originaire de la Ville de Lyon déja très vaste & florissante, qui venoit d’être entiérement consumée par un
incendie, & cherchant à le consoler de la douleur que lui causoit la vue de ce grand nombre de ses
concitoyens, qui devoient se trouver sans habitation après la destruction de leur patrie, ces habitans, lui dit
ce Philosophe, sont ils en plus grand nombre que ceux d’Aléxandrie, ou de la Ville d’Ephése ? expression,
d’où l’on peut raisonnablement conclure, qu’au moins après Rome ces deux Villes étoient les plus peuplées
de l’Univers. Cependant il est à propos de remarquer, que les habitans d’Aléxandrie ne faisoient pas
naturellement plus du tiers de ce nombre prodigieux d’ames, dont toute la côte de la Méditerranée étoit
peuplée, depuis Canope situé vis-à-vis des Biquiers, jusqu’à la Tour des Arabes. En effet par les dimensions
que je viens de vous donner de cette Ville il est constant, qu’elle n’occupoit pas plus du tiers du terrains
renfermé autour d’elle à droite & à gauche dans toute cette étendue du pays, qui lui appartenoit, & lui étoit
propre.
De son climat.
C’est ce dont il sera encore plus aisé de convenir après la description que j’ai entrepris de donner de ces
différens endroits si fameux dans l’antiquité, dont Aléxandrie étoit environnée. Mais avant que d’entrer dans
ce détail, il me paroît nécessaire de tracer d’abord un plan de la disposition des canaux divers, par où la
subsistance étoit fournie à tous ces peuples, qui (p. 124) habitoient un si long terrain, le plus aride & le plus
stérile, que la nature eût formé, contigu d’ailleurs à d’autres provinces également incapables de subvenir à
ses besoins, & très éloigné de toutes celles que leur climat rendoit plus fertiles. Le Ciel, qui sembloit être de
bronze pour cette petite contrée, lui avoit refusé jusqu’à l’usage des eaux. Dans toute l’étendue de cette
longue côte on ne trouvoit, ni puits, ni fontaines capables de désaltérer la soif des hommes & des animaux,
qui l’habitoient. Cependant c’étoit dans ce terrain ingrat, que la nature avoit placé les plus beaux ports de
tout le pays, que la stérilité de leurs environs rendoit inutiles.
J’ai parlé ailleurs de ces ouvrages immenses, qu’avant la naissance d’Aléxandrie les anciens Rois de
l’Egypte avoient fait élever, pour rendre fertile le dedans de leurs Etats, & leur assurer une abondance
perpétuelle, soit en prévenant les ravages que pouvoient causer les trop grandes inondations du Nil, soit
pour répartir ses eaux à tous les terrains cultivés dans les années même où ses accroissemens étoient le
moins considérables. L’attention de ces premiers Monarques, dont la puissance égaloit la politique & la
sagesse, ne s’en tint pas uniquement à ces soins. Après s’être occuper pendant plusieurs siécles à fertiliser
l’intérieur de ce Royaume, ils crurent devoir s’appliquer aussi à procurer les commodités de la vie, tant aux
étrangers qui viendroient aborder dans ces ports, dont leurs Etats étoient bornés du côté du Nord, qu’à ceux
de leur sujets qui voudroient s’y établir pour les y recevoir, & échanger avec eux les productions superflues à
l’Egypte contre les marchandises que les autres contrées de la terre pouvoient fournir.
Du lac Mareotis.
Comme cet échange mutuel est le lien le plus capable d’unir d’amitié les nations les plus éloignées, en leur
procurant reciproquement les commodités, dont elles manquent dans leur propre pays, ces anciens
Monarques zélés pour le bonheur des peuples, qui leur étoient soumis, jugerent qu’ils ne pouvoient
employer plus utilement les richesses immenses, dont leurs trésors étoient remplis, qu’à quelques nouveaux
travaux propres à favoriser ce commerce. Dans cette vue ils se proposerent de former au dessus de cette
contrée maritime, & au milieu même de cette plaine aride de sables & de cailloux, dont elle (p. 125) étoit
environnée, un vaste étang qu’on pût remplir des eaux du Nil, & qui servît en quelque sorte de troisiéme port
à ceux qui viendroient s’établir sur ce rivage. On examina par leur ordre le terrain le plus favorable pour
creuser ce lac ; on nivela tous les environs, afin de choisir les endroits les plus propres pour y conduire
facilement de la haute & de la basse Egypte les eaux du Nil, & avec elles tout ce que produit ce pays
abondant & fertile, & on travailla ensuite en même tems, tant à l’approfondissement de ce vaste réservoir,
qu’à creuser deux canaux par où les eaux devoient y être amenées.
Rien n’étoit impossible à des Princes, dont les revenus étoient innombrables comme les sujets soumis à leur
obéissance. Aussi parvinrent-ils en peu d’années à perfectionner ce grand ouvrage. Le lieu choisi pour ce
grand réservoir à la distance d’une lieue des ports de la Méditerranée fut appellé du nom, qu’il porte encore
aujourd’hui, le lac Mareotis. On mit en même tems la derniére main à deux canaux, destinés à y conduire les
eaux du Nil ; l’un de la haute Egypte, & l’autre de la basse. Le premier avoit sa source dans le lac Meris,
situé au Midi de la Ville de Memphis, alors capitale de tout le Royaume. Ce lac lui même empruntoit ses
eaux du fleuve à trois ou quatre journées plus haut par un canal, qui y aboutissoit, & rendoit ce lac
intarissable, comme il l’est encore aujourd’hui à cause de l’élévation de sa source. A l’égard du canal, qui du
lac Meris, ou de la haute Egypte, conduisoit les eaux du Nil vers la mer, & au lac Mareotis, il s’avançoit
d’abord au Couchant dans la petite province du Fioum, autrement appellée la province Sébennytique, la plus
abondante & la plus fertile de tout ce charmant pays. De là se recourbant vers le Midi, il traversoit une plaine
inégale de sables & de rochers, que l’on avoit cependant égalée pour la perfection du canal, soit en creusant
dans les rochers lorsqu’on s’y trouvoit obligé, ou en élevant au milieu des sables lorsque le terrain le
demandoit, un lit profond de vingt pieds & de trente de largeur. A la faveur de ces travaux immenses dignes
de la puissance des Rois, qui les avoient entrepris, ce canal fut conduit jusqu’à la mer, à la quelle il alloit se
rendre entre le port nommé Cibotus le plus Occidental de l’Egypte, & celui d’Eunoste, qui en étoit fort peu
éloigné. Ce canal s’appelloit la bouche Tanitique (p. 126) du Nil d’un petit village, où l’on bâtit depuis à cette
embouchure cette ancienne Ville, dont il est parlé dans les Auteurs sous le nom de Tanis.
Cependant avant que d’arriver à la mer, ce canal distribuoit ses eaux à deux autres qu’on avoit tirés à sa
droite & à sa gauche. Celui qu’il avoit sur sa gauche, & dont je parlerai dans la suite, alloit porter la fertilité du
Nil jusques dans les deserts arides de la Libye. A l’égard de l’autre canal qu’on avoit creusé sur sa droite, il
servoit à voiturer avec ses eaux dans le lac Mareotis toutes les denrées & les marchandises que la haute
Egypte pouvoit fournir, & ce que la province du Fioum avoit de superflu, après que la Ville de Memphis, au
devant de laquelle toutes ces provisions passoient sur le lac Meris, s’étoit pourvue de ce qui lui étoit
nécessaire. Dans la suite ce canal devint inutile au lac Mareotis par le comblement de la bouche Tanitique ;
mais il fut remplacé par un autre qu’on tira en même tems de la basse Egypte, & d’une autre embouchure du
Nil à la mer, depuis la Ville de Foua jusqu’au même lac. Ce canal subsiste encore aujourd’hui, quoiqu’il ne
serve plus au même usage, auquel il étoit employé dans ces premiers tems. C’étoit par là qu’on transportoit
alors au lac Mareotis toutes les denrées & les marchandises, qui venoient de la basse Egypte, comme par le
moyen de celui, dont j’ai parlé, on y voituroit auparavant tout ce que produisoit la haute. Les eaux de ce
dernier canal n’eurent point d’abord d’autre destination ; dans la suite on les fit servir à un autre usage. En
effet ce fut de là que par des canaux visibles, ou soûterrains, on tira celles que l’on conduisit depuis à
Canope, & dans tous les autres endroits habités, qui se trouvoient en grand nombre depuis cette Ville
jusqu’à celle d’Aléxandrie. Les canaux visibles servoient à voiturer d’un lieu à un autre les voyageurs, les
marchandises, les comestibles, en un mot tout ce qui dans ces anciens tems entroit dans l’usage de la vie &
du commerce. Les souterrains au contraire étoient destinés à conduire les eaux dans les citernes
nombreuses, qu’on avoit bâties dans des lieux différens, & principalement celles d’Aléxandrie. De là se
remplissoient divers petits lacs creusés, ou dans ces lieux mêmes, ou aux environs. Au tour de ces
nombreux réservoirs on avoit formé du limon même du grand canal, ou de celui (p. 127) qui se tiroit tous les
ans de ces canaux inférieurs que l’on nettoyait, des jardins embellis d’arbres & de verdure, des champs
fertiles, qui portoient des grains & des fruits en abondance. C’est ainsi qu’à la faveur de ce limon on avoit
trouvé le secret de rendre fécond au bout de plusieurs siécles le terrain le plus stérile de l’Univers. Enfin du
lac Mareotis au port Eunoste on tira encore un nouveau canal, qu’on destina de même à deux usages. Le
premier but qu’on se proposa dans cette entreprise fut de s’assurer une voye toujours ouverte, pour
soulager ce lac de la trop grande abondance des eaux qui pourroient y être portées par les autres canaux.
En même tems on crut par là se procurer un moyen sur pour voiturer commodément à la mer les denrées,
qui venoient de la haute & de la basse Egypte, & pour en faire venir de même toutes les marchandises, qui
dans différentes saisons de l’année arrivoient dans les ports de toutes les parties de la Méditerranée.
Il n’est pas difficile de comprendre de quel avantage étoient ces différens canaux pour les habitans
d’Aléxandrie, & ceux des lieux circonvoisins. Rien en effet n’étoit plus utile pour eux, que d’approcher de
leurs habitations toutes fort éloignées les unes des autres, les choses, dont ils avoient journellement besoin,
sans être obligés d’aller au loin les chercher par terre avec des voitures toujours beaucoup plus couteuses.
N’est-ce pas la même raison, que dans un certain tems on a songé en France à faire passer la Marne, ou un
bras de la Seine, autour de la Ville de Paris vers le rempart, dont elle est environnée du côté des portes
Saint Martin & Saint Denis, quoi qu’elles ne soient éloignées que d’environ un quart de lieue du cours de la
riviére, qui traverse cette capitale ? A combien plus forte raison étoit il favorable pour les habitans
d’Aléxandrie & des environs de pouvoir se fournir par eau, & à leurs portes, de tout ce dont ils avoient
besoin, sans être obligés de le faire venir par terre par le moyen des voitures toujours lentes, & d’une
dépense considérable, ou de l’aller chercher à la mer, c’est-à-dire à une grande lieue de là pour ceux, qui
demeuroient aux extrémités de cette Ville, & beaucoup plus loin à proportion pour ceux, qui étoient établis
ans le voisinage ? C’est pour cette raison que le canal du lac Meris au lac Mareotis, & celui du lac Mareotis
au port Eunoste, avoient (p. 128) été creusés, afin de faciliter le transport des denrées & des marchandises
de la haute Egypte à ce lac, de ce lac aux différens ports, dont Aléxandrie étoit bordée, & réciproquement de
ces ports en ce lac situé au dessus de cette Ville.
Ce projet eut un si grand succès, qu’en peu de tems le commerce devint beaucoup plus considérable au
port du lac Mareotis, qu’à celui d’Aléxandrie même. C’étoit là que toute l’Egypte alloit se fournir de ce qui lui
étoit nécessaire. Cependant par la succession des tems le canal Tanitique s’abolit ; comme je l’ai dit plus
haut. Il n’en reste aujourd’hui aucunes traces ; & à peine pourrions nous nous assurer de sa situation, si
nous n’apprenions des Anciens, qu’il portoit ses eaux à la mer entre le port Cibotus & celui d’Eunoste, qui
sont contigus. L’autre canal subsiste encore de nos jours par la nécessité qui oblige de l’entretenir, si on ne
veut rendre inutiles les deux ports d’Aléxandrie, & certains terrains adjacens, qui payent tribut au Grand
Seigneur. Mais comme il reste presque toujours à sec à cause de la dépense considérable qu’il faudroit faire
pour le nétoyer à fond, à peine sert-il à conduire les eaux du Nil à Aléxandrie pendant deux ou trois mois de
l’année, c’est-à-dire pendant le tems de l’augmentation de ce fleuve. Le peu qu’il en voiture suffit du moins
pour remplir les citernes de cette Ville, & pour entretenir le lac Mareotis. Ce vaste réservoir s’est de même
assez conservé jusqu’à present ; mais outre qu’il commence à se remplir, au lieu de cette espéce de Ville,
de ces temples, & de ces Palais, dont il étoit autrefois environné, il n’a pas même aujourd’hui une seule
maison sur ses bords. Son commerce jadis si florissant est absolument détruit, & il ne sert plus qu’à
abbreuver les chameaux de quelques Arabes, qui campent dans les environs, ou à arroser quelques terres
voisines, du produit desquelles ils subsistent.
Après cette idée générale que je viens de donner de la situation de l’ancienne Ville d’Alexandrie, on attend
sans doute que j’entre dans un plus grand détail, & que parcourant successivement chacune des parties, qui
la composoient, j’y fasse remarquer en passant la position de ces monumens si vantés, qui la rendirent
autrefois si célébre. Je commence par la partie de cette Ville, qui s’offroit d’abord, lorsqu’on y arrivoit par
(p. 129) la Méditerranée. Voici ce que nous en apprenons des anciens Auteurs, qui en ont parlé.
Du port Cibotus.
Le premier port que l’on rencontroit, en abordant en Egypte du côté du Nord & du Ponant, se nommoit
Cibotus. Il étoit situé au Levant de la Tour des Arabes dont il n’étoit éloigné que de quatre ou cinq lieues, &
précédoit de deux à trois milles au plus le port Eunoste, que nous appellons aujourd’hui le vieux port. C’étoit
entre ces deux ports, ainsi que je l’ai déja observé, qu’étoit située la petite Ville de Tanis, qui donna son nom
à cette embouchure du Nil appellée la bouche Tanitique. Ce mot Cibotus dérive, à ce que je pense, du terme
Arabe Sabek, qui signifie précédent, parce que ce port précedoit efféctivement celui d’Eunoste, comme il
étoit aussi antérieur à un troisiéme que l’on forma depuis au Levant de celui-ci par un retranchement, dont je
parlerai dans la suite. Ce premier port, qui subsiste encore aujourd’hui, n’est nullement bon, parce qu’il est
exposé aux vents de Nord & de Nord-Ouest, qui sont les traversiers de la côte. Aussi n’y mouille t’on que
dans une très grande nécessité, & dans une impossibilité absolue de gagner le port Eunoste qui est à
couvert de ces vents par l’Isle Antirhodus.
De l’Isle Antirhodus.
Cette Isle, qui s’appelle encore aujourd’hui Rondettin, terme Arabe, qui signifie le jardin des figues, & qui sur
une lieue de largeur, ou environ, a une longueur un peu plus considérable, tiroit sans doute son ancien nom,
ou du mot grec Rhodos, qui veut dire une rose, ou de l’Arabe Roda, qui signifie jardin, l’un & l’autre
marquant également qu’elle fétoit comme l’avant jardin de l’Egypte, ou le premier jardin qu’on y rencontroit,
en abordant du côté de l’Europe. Aussi étoit ce alors un lieu des plus charmans. Les Aléxandrins y avoient
bâti un nombre infini de maisons de plaisance, dont les unes avoient leur principale façade tournée vers le
Nord, pour jouir en Eté de la fraicheur du vent, qui souffle de ce côté-là, les autres du côté du port vieux, &
vers le Midi, afin de pouvoir y respirer en Hiver un air moins piquant & plus doux. Les jardins, dont cette Isle
étoit ornée & embellie d’un bout à l’autre, étoient renouvellés chaque année par le limon que le Nil dans le
tems de son accroissement laissoit dans les canaux & les citernes de toute la côte, & portoient les meilleurs
fruits de l’Egypte. Les (p. 130) figues surtout y étoient admirables, & n’y sont pas encore aujourd’hui moins
délicieuses. C’est dans cette Isle plus avancée à la mer, que la terre ferme d’Egypte, qu’abordent tous les
ans les oiseaux, qui dans l’Automne viennent des pays froids se réfugier en celui-ci, pour y passer l’Hiver à
l’abri des glaces de l’Europe. Il s’y en prend une si grande quantité tous d’espéces différentes, qu’après que
ces petits oiseaux ont été dépouillés de leurs plumes, & ensévelis dans des sables brulans pendant environ
un demi quart d’heure, ils ne se vendent de deux sols la livre. On ne nourrit pas alors d’autre viande les
équipages des bâtimens, qui dans cette saison viennent mouiller à Alexandrie. C’est dans ce délicieux
séjour, que fuyant de la bataille d’Actium, vaincu par un rival, dont il redoutoit moins la valeur que la
clémence, à charge à soi même, l’infortuné Marc Antoine victime d’un amour malheureux avoit bâti ce
fameux Palais, qu’il nomma Timonium du nom de Timon le misantrope, parce qu’à l’imitation de ce
Philosophe il avoit résolu d’y passer le reste de ses jours avec la belle Cléopatre, séparé pour jamais d’un
monde ingrat, qui l’avoit abandonné. Auguste ne lui donna pas le loisir de jouir d’un projet flatteur que le
dépit & l’amour lui avoient fait imaginer. Il le poursuivit jusqu’en Egypte, & ce malheureux Triumvir vaincu
une seconde fois par son redoutable ennemi, toujours trahi & toujours trop sensible, fut obligé de chercher
dans son propre désespoir la fin de sa passion, de ses infortunes, & de sa vie.
Des autres ports d’Aléxandrie.
C’est entre la pointe Occidentale de cette Isle & la terre ferme, que se trouve l’entrée du port Eunoste,
appellé aujourd’hui le vieux port. Cette embouchure est assez difficile, comme elle l’étoit dès le tems des
Romains, parce qu’elle est étroite & embarassée de rochers ; mais dès qu’on l’a passée on rencontre un
beau & vaste mouillage de plus d’une lieue de longueur, capable de contenir mille vaisseaux. Ce port est
très sur, & si profond, que les plus gros vaisseaux peuvent y aborder la poupe à terre. Il ne faisoit autrefois
qu’un même port avec celui qu’on appelle aujoud’hui le port neuf, qui en étoit alors une suite ; mais il en fut
séparé du tems des Grecs par une digue qu’on éleva depuis la terre ferme jusqu’à la pointe orientale de
l’Isle Antirhodus, laissant cependant à cette digue une ouverture pour communiquer d’un port à l’autre.
(p. 131) Du Phare & du Pharillon.
Ce fut au bout de cette digue, qu’on avança dans la mer le plus qu’il fut possible, que fut élevé ce Phare si
fameux, dont il ne reste plus que quelques débris, qu’on apperçoit encore sous les eaux, lors que la mer est
parfaitement calme, mais dont la mémoire vivra à jamais dans les descriptions magnifiques que les
historiens nous en ont laissées. Ce superbe édifice que les Anciens comptoient entre les sept merveilles du
monde fut l’ouvrage de Sostrate Gnidien, & fut bâti sous le régne de Ptolomée Philadelphe, qui y employa,
dit-on, des sommes immenses. Le premier étage étoit un vaste corps de logis de marbre blanc
agréablement ouvert, & dont toutes les vues, soit du côté de la mer, soit du côté de la Ville, ou des deux
ports, faisoient un aspect également amusant & agréable. Au dessus de ce Palais s’élevoit une Tour
Quarrée toute bâtie du même marbre, & d’une hauteur extraordinaire. C’étoit un composé de plusieurs
galeries balustrées, élevées les unes au dessus des autres, & soutenues par de riches colomnes. C’étoit au
haut de ce superbe édifice, que tous les soirs on allumoit un fanal, pour guider dans les ténébres de la nuit
des vaisseaux, qui arrivoient dans le port. On prétend que dans les plus élevées de ces galleries on avoit
placé grand nombre de miroirs disposés avec tant d’art, qu’on y voyoit representés tous les bâtimens, qui
abordoient à cette rade. On ajoute que cette Tour magnifique étoit d’une hauteur si prodigieuse, que de son
sommet on découvroit les vaisseaux, qui entroient dans le port de Rhodes éloigné de là de près de deux
cens lieues. Cependant on n’avoit point encore alors l’usage des lunettes d’approche ; mais comme le Phare
étoit fort élevé, & au contraire la terre d’Aléxandrie très basse, comme elle l’est encore aujourd’hui, il arrivoit
que ceux qui faisoient le guet au haut de cette Tour découvrant sur la mer des bâtimens passant dans le
canal, & tirant vers l’Egypte, & annonçant leur arrivée beaucoup avant qu’on pût les distinguer du port, on
s’imaginoit que leur vue portoit beaucoup plus loin, qu’elle ne s’étendoit en effet. La digue, au bout de
laquelle le Phare avoit été élevé, y étoit jointe par quatre ou cinq arcades, qui faisoient la communication du
port neuf avec le port Eunoste. Aujourd’hui ce superbe ouvrage ne subsiste plus, comme je l’ai déja dit.
L’ancien Phare est enséveli sous les eaux. Le tems (p. 132) l’a tellement détruit qu’apeine en reste-t-il les
moindres traces. On voit seulement à l’entrée du port neuf une petite forteresse bâtie à la moderne, à
laquelle on communique encore par des arcades, & qui s’avance moins dans la mer. C’est sur cette espéce
de château, qu’on a élevé une Tour, d’où l’on fait encore fanal pendant la nuit. Cet ouvrage est
incontestablement du tems des Rois Mahométans, qui après la ruine de l’ancien Phare n’étant pas assez
puissans pour en rebâtir un pareil, firent élever à sa place cette nouvelle forteresse plus voisine de la terre
ferme. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le Pharillon.
A la pointe Orientale de l’Isle Antirhodus finissoit le port Eunoste, ou le vieux port, & commençoit, comme je
l’ai dit, celui que nous appellons le port neuf. Celui-ci avoit deux entrées. La premiére & la plus considérable
rangeoit le Phare, & se terminoit à des rochers, sur lesquels on avoit bâti une petite forteresse, & sur cette
forteresse une Tour, qui servoit de second fanal. La seconde entrée du port neuf commençoit à cette
forteresse même, & finissoit à une autre pointe de rochers nommés Lochias, sur lesquels on avoit élevé de
même un troisiéme fanal qui ne subsiste plus de nos jours. Les vaisseaux passoient entre ce second & ce
troisiéme fanal ; mais comme cette bouche étoit plus étroite, & qu’on y trouvoit moins de fonds que dans la
premiére, on ne se servoit de ce passage, comme on le fait encore aujourd’hui, que pour les galéres, & pour
d’autres bâtimens de moindre grandeur, ou dans les occasions où il n’étoit pas possible de se prévaloir de la
premiére entrée. Toutes deux avoient leur bouche tournée vers le Nord, que j’ai dit être le traversier de cette
côte ; ce qui rendoit ce port beaucoup moins sur que le vieux. Cependant comme en y entrant la mer alloit
se briser contre les rochers, qui formoient ces deux ouvertures, & qu’après avoir passé le Lochias, on
rencontroit une ance fort vaste, ce port ne laissoit pas d’être assez bon, surtout pour les vaissseaux qui
mouilloient dans l’enfoncement.
C’étoit à la pointe du Lochias qu’étoient bâtis les Palais de ces anciens Rois d’Egypte si fameux par leurs
richesses & par leur puissance. Au milieu de ces édifices superbes on distinguoit surtout le Palais de la
Reine Cléopatre, dont les historiens (p. 133) nous ont laissé des descriptions si exactes. Cette princesse
également galante & magnifique n’avoit rien oublié pour en faire le plus somptueux & le plus délicieux
séjour. De là jusqu’à cet endroit d’Aléxandrie, qui lui étoit opposé, on avoit pratiqué au travers du port un
pont, qui communiquoit à la Ville. Ce pont bati entiérement de pierres de taille étoit élevé sur deux rangs de
colomnes, qui lui servoient de pilotis, & qu’on avoit plantées dans le fond de la mer, qui dans ce port n’étoit
pas fort profonde. Elles étoient si élevées, qu’elles surpassoient de plusieurs coudées la superficice des
flots. Aussi les galéres pouvoient elles passer sous ces arcades & entre ces colomnes, lorsqu’elles étoient
démâtées ; les petits bâtimens franchissoient même ce passage à la voile. On apperçoit encore quelques
unes de ces colomnes renversées & couchées sous les eaux dans l’endroit même, où elles avoient été
placées ; ensorte qu’on peut encore aujourd’hui s’assurer de leur suite, & de la distance qu’il y avoit des
unes aux autres. On voit aussi proche de la grande entrée du port une colomne très grande renversée sur
un rocher, qui se trouve dans cet endroit. Par là il est aisé de reconnoître quelle étoit l’attention des Grecs &
des Romains pour la sureté des vaisseaux, qui entroient dans leurs ports, puisque cette colomne n’avoit été
sans doute élevée dans cet endroit, que pour avertir les pilotes du danger qu’ils devoient éviter. C’est dans
ce port, qui, comme je l’ai dit, est appellé le port neuf, & dont l’entrée n’est pas encore aujourd’hui moins
difficile, qu’elle le fut autrefois, que tous les vaisseaux Chrétiens sont obligés de mouiller. Les Turcs ne leur
permettent point l’accès du premier, que nous nommons le vieux port, & que les anciens appelloient
Eunoste, parceque que les appartemens de leurs femmes sont presque tous tournés de ce côté-là.
Cependant comme le port neuf est d’un fond très mauvais, & presque tout comblé par le limon que le Nil y
charie, & par les sables que les vents de Nord & de Nord-Ouest y poussent avec violence pendant l’Eté, il
est certain qu’avant peu d’années il sera absolument impraticable. Alors il faudra nécessairement que les
Turcs permettent à nos bâtimens d’aller mouiller dans le vieux port, ou qu’ils renoncent à notre commerce.
De la Ville même d’Aléxandrie.
Cette Ville, dont l’abord étoit si magnifique & si charmant, n’étoit pas moins célébre par les propres beautés
qu’elle contenoit, (p. 134) par celles de ses fauxbourgs & de plusieurs petites Villes, dont elle étoit
accompagnée. Aléxandre, disent les Auteurs anciens, avoit fait tirer au cordeau toutes les rues de sa
nouvelle Ville. Entr’autres on en remarquoit deux, qui se coupoient à Angles droits, & qui avoient chacune
cent vingt pieds de large. Elles aboutissoient aux quatre extrémités de la Ville, qui se trouvoit par là ouverte
à tous les vents, & jouissoit par conséquent d’un air fort pur. On y comptoit, ajoutent-ils, cent Palais divers,
outre ceux des Rois, & un grand nombre de temples consacrés à toutes les divinités du Paganisme. On y
rencontroit à chaque pas des monumens sans nombre également superbes. Tels étoient la colomne de
Pompée, les Aiguilles de Cléopatre, le Sérapium, & plusieurs autres, de quelques uns desquels il reste
encore aujourd’hui des vestiges.
C’est par là, & par la succession des tems que la fameuse Aléxandrie parvint à être regardée comme une
des premiéres & des plus célébres Villes de l’Univers. Il est vrai, que soit que l’on considére l’avantage de sa
situation & des ses ports, les richesses de son commerce, & la magnificence de ses bâtimens, soit qu’on ait
égard à l’état florissant où elle sçut porter les Sciences & les arts, il semble qu’elle l’emportoit sans contredit
sur toutes les autres Villes du monde. Elle fut le second siége de la véritable religion sur la terre, & les
anciens Péres l’appelloient le Paradis, parceque la Sainteté y étoit comme sur son trône. Du reste aucun
pays ne fut plus fécond en hommes de lettres. On sçait que parmi les Astronomes & les Médecins on ne
considéroit guéres que ceux qui étoient sortis de l’Ecole d’Aléxandrie. Pour l’histoire elle a produit un Appien
& un Hérodien ; elle a été la patrie d’Euclides & d’Origénes. C’est-là qu’environ trois cens ans avant la
naissance de Jesus-Christ les soixante & douze interprétes envoyés par le grand Prêtre Eleazar au Roi
Ptolomée Philadelphe fils de Lagus firent cette fameuse version Grecque de la Bible ; ce fut dans cette
même Ville, que les Clémens Aléxandrins, les Jéromes, les Basiles, les Grégoires, firent leurs études dans
les Saintes lettres. Enfin l’histoire fera vivre à jamais dans la mémoire des hommes le souvenir de cette
célébre Bibliotheque rassemblée à Aléxandrie sous le régne du même Ptolomée par les soins de Démétrius
de (p. 135) Phalére, & composée de près de cinq cens mille volumes. Les Romains après la conquête de
l’Egypte avoient conservé tant de vénération pour cette Ville, que les Empereurs accordoient la qualité de
citoyen d’Aléxandrie avec beaucoup plus de précaution & de réserve que celle de citoyen Romain.
Mais si cette Ville étoit illustre par elle même, si elle étoit la plus noble de toutes celles de l’Univers, comme
on le lit sur un cachet de bronze large de deux doigts, & long de quatre pouces, qui lui servit autrefois de
Sceau, & dont l’antiquité & la vérité ne peuvent être contestées ; les fauxbourgs divers & les petites Villes,
ainsi que les monumens superbes, dont elle étoit accompagnée à sa droite jusqu’à la Ville de Canope du
côté de l’Orient, & à sa gauche vers l’Occident jusqu’à la Tour des Arabes, n’étoient pas moins dignes
d’admiration.
Du Fauxbourg de Necropolis.
Le premier endroit digne de remarque qu’on rencontroit à la gauche d’Aléxandrie, étoit le fauxbourg de
Necropolis, c’est-à-dire la Ville, ou l’habitation des morts, qui s’étendoit par l’espace d’une grande lieue entre
la mer & le lac Mareotis, tirant vers la Tour des Arabes, sur une largeur à peu près égale. C’étoit en ce lieu
que par une louable coutume les Grecs & les Romains avoient soin d’enterrer leurs morts. Mais il ne faut pas
s’imaginer que cet endroit n’eût rien que de triste & de lugubre, comme nos cimetieres, dont le seul aspect
fait horreur. Mille superbes tombeaux y étoient élevés accompagnés de Chapelles magnifiques, où l’or & le
marbre brilloient de toutes parts. De ces Chapelles il n’y en avoit point de considérable, à la quelle on n’eût
attaché des revenus proportionnés pour l’entretien des Prêtres chargés d’y faire chaque jour certaines
priéres, & de tems en tems même des sacrifices & des aumônes pour l’expiation des fautes de ceux qui y
étoient inhumés. Ces Prêtres, qui par le moyen de ces fondations se trouvoient en état de vivre à leur aise,
avoient à côté de ces Chapelles des maisons accompagnées de jardins, qui répondoient à la magnificence
des tombeaux qu’ils desservoient. Enfin comme ce grand terrain aboutissoit d’un côté à la mer, & du côté
opposé au lac Mareotis, qui formoient l’une et l’autre des vues (p. 136) charmantes, comme pendant l’Eté on
y jouissoit du côté de la mer de la fraicheur des vents du Nord, & de l’autre de celle des eaux du lac, à
l’exemple de ces Prêtres, divers particuliers d’Alexandrie s’y étoient bâti des maisons de plaisance, qui
rendoient ce quartier très agréable d’affreux qu’il auroit été, s’il ne s’y fût trouvé que des sepultures
ordinaires.
Du fauxbourg de Nicopolis.
De l’extrémité de ce fauxbourg jusqu’à la Tour des Arabes on rencontroit presque sans interruption de gros
bourgs, tels que celui de Tanis à l’embouchure de la branche Tanitique du Nil, & divers autres, entre
lesquels presque sans aucun intervalle se trouvoient des maisons de plaisance, que la vue & l’air de la mer,
qu’on y respiroit, y avoit fait bâtir. Quoi que ces habitations fussent considérablement éloignées du Phare,
cependant on s’y rendoit de la Ville d’Aléxandrie en batteau, ou par les voitures de terre, en si peu de tems,
que cette distance étoit comptée presque pour rien. A l’extrémité du fauxbourg de Necropolis tirant vers
l’Orient étoit l’Hyppodrome si vanté dans l’histoire, situé derriere la Ville ; & immédiatement après ce superbe
monument, on trouvoit un autre fauxbourg, nommé Nicopolis, c’est-à-dire la Ville de la victoire, bâti par
Auguste après que dans cet endroit il eut défait les troupes de Marc Antoine. C’étoit principalement en ce
lieu que se voyoient les plus beaux Palais des Grands, & leurs maisons de plaisance, qui avec leurs jardins,
& autres dépendances, formoient une seconde Ville presque aussi vaste & beaucoup plus gaye, que celle
d’Aléxandrie.
Du quartier appellé Rhacotis.
Au bout de ce fauxbourg étoit un quartier, appellé Rhacotis, assez considérable par son étendue, & qui avoit
été assigné aux Grecs pour faire leur commerce. Ce lieu étoit fort marchand, & renfermoit plusieurs rues
couvertes & très longues, dans lesquelles on pouvoit se promener à l’abri des vents & du Soleil. Ces rues,
qui ne reçoivent la lumiére que par des fenêtres pratiquées dans la couverture, sont encore aujourd’hui fort
communes à Constantinople, & dans diverses autres grandes Villes de l’Orient. On pouvoit se rendre dans
ce quartier par un canal, qui partant d’Aléxandrie, traversoit le fauxbourg de Nicopolis, & venoit aboutir dans
ce lieu. C’étoit la promenade ordinaire des Dames de la Ville.
Du fauxbourg Bucolis, & du bourg d’Eleusine.
De là tirant toujours vers l’Orient, on entroit dans un autre (p. 137) fauxbourg, nommé Bucolis, qui s’étendoit
jusqu’à la mer. Ce quartier n’étoit guéres rempli que de maisons de plaisance & de cabarets, & comme on
pouvoit également s’y rendre, soit par mer, ou par le canal, dont je viens de parler, on y trouvoit en tout tems
un concours prodigieux de différentes personnes, qui d’Aléxandrie venoient se réjouir dans ce lieu charmant,
& jouir de la vue de la mer & des jardins sans nombre, dont toutes les maisons de ce fauxbourg étoient
accompagnées. Ce délicieux séjour étoit suivi d’un autre, qui ne l’étoit pas moins & qui par sa vaste étendue
ne ressembloit pas mal à une petite Ville. On l’appelloit Eleusine. Cette bourgade étoit aussi fort
marchande ; & il s’y tenoit pendant l’année plusieurs foires, qui y attiroient les habitans de tous les lieux
circonvoisins. Quelques nombreux qu’ils fussent, ils y trouvoient des logemens commodes, & tous les
agrémens de la vie.
Des Fauxbourgs nommés Schedis et Taposiris, & du temple de Venus Arsinoé.
Du bourg d’Eleusine on passoit dans un autre fauxbourg, nommé Schedis. C’étoit dans cet endroit que se
payoit la douanne des marchandises & des denrées, qui de toute l’Egypte étoient apportées à Aléxandrie.
De ce quartier on entroit dans un autre, appellé Taposiris, où se fabriquoient différentes sortes d’étoffes,
qu’on transportoit de là à Aléxandrie, ou ailleurs. On rencontroit ensuite le temple de Venus Arsinoé élevé
sur un Cap, dont la mer baignoit le pied en cet endroit. Ce temple étoit environné d’un bourg assez
considérable. On y trouvoit plusieurs boutiques, où se vendoient des representations de la Déesse, &
d’autres fugures lascives qu’on employoit dans les sacrifices, qui se faisoient en ce lieu. Les autres
habitations étoient destinées à loger les pelerins, que la dévotion y conduisoit. A une distance très peu
considérable on voyoit les ruines de la petite Ville de Thonis, bâtie anciennement sur le bord de la mer en un
lieu, où il y avoit un port pour les petits bâtimens, & où le ravisseur d’Heleine aborda, dit-on, avec sa
conquête. Cette Ville étoit déja détruite lorsque les Romains se rendirent maîtres de l’Egypte. Enfin après
tant de différens endroits contigus, qui formoient une suite d’habitations d’environ cinq lieues d’étendue, on
arrivoit à la Ville de Canope. Après cette description ne conviendra-t-on pas, que si sur le témoignage de
l’antiquité on accorde que tous les lieux, dont je viens de parler, formoient véritablement une (p. 138) même
Ville, je n’ai rien exagéré, en donnant une si longue étendue au terrain qu’occupoit l’ancienne Aléxandrie
dans les beaux jours de sa splendeur.
Origine de Aléxandrie moderne.
Telle fut pendant plusieurs siécles la fameuse & célébre Aléxandrie. Tant que les Grecs & les Romains
resterent les maîtres de l’Egypte, elle soutint toujours son ancienne splendeur ; & elle ne commença à
déchoir de son premier éclat, que lorsque les Arabes s’emparerent de ce beau Royaume. Comme ces
peuples accoutumés à vivre sous des tentes à la campagne n’avoient aucun goût pour les Villes, qu’ils
méprisoient & regardoient comme des prisons, pour les Palais, & les anciens monumens, dont toute l’Egypte
étoit remplie, non seulement ils négligerent de les entretenir ; ils les détruisirent même pour en employer les
matériaux à élever des Mosquées, & à bâtir de mauvaises maisons, ou plutôt de misérables cabanes qu’ils
préférerent à ces magnifiques Palais. Aléxandrie se trouva enveloppée dans le commun naufrage, que
causa dans ce célébre pays la barbarie de cette nation. Cette grande Ville se dépeupla insensiblement, & se
remplit de ruines. Cependant l’étendue de ses murs étoit si grande, qu’il eût fallu des armées entiéres pour
les garder. Le peuple qu’elle renfermoit s’étoit déja révolté plusieurs fois, & il s’en étoit fait des massacres
prodigieux. Les Princes Mahométans, qui régnoient en Egypte fatigués de ces révoltes réiterées, & des
soins que leur donnoit la garde de cette grande Ville remplie de cent ruines différentes, songerent à se
mettre à l’abri de ces craintes & de ces soulévemens. Dans cette vue ils résolurent de reduire son enceinte
au peuple, qui restoit, & qu’elle pouvoit contenir.
De ses murs & de ses Tours.
Ce fut vers l’an 600. de l’Hegire que ce dessein s’executa par un des Rois successeurs de Saladin, qui,
comme on le voit dans son histoire, venoit d’enlever l’Egypte aux Califes de la famille des Fatimiens. On se
servit pour bâtir cette enceinte, qui n’a pas de circuit plus de dix milles d’Italie, ou deux grandes lieues de
France, des débris de l’ancienne que l’on abandonnoit. Aussi les murailles de cette Aléxandrie nouvelle, &
les cent tours dont elles sont flanquées, sont elles baties d’une infinité de marbres & de colomnes brisées
entrelacées avec les pierres ; ce qui justifie parfaitement, que cette Ville (p. 139) a été bâtie des ruines de
l’ancienne, & que ses murs ne sont pas de haute antiquité. Cette nouvelle enceinte est double. Un mur
extérieur ferme d’abord les avenues, & à environ trente pas de distance de celui-ci un second fait face au
dedans de la Ville. C’est entre ces deux enceintes, que par des voutes, ou arcades, pratiquées au pied des
Tours, dont elles sont accompagnées, les troupes commises à la garde de cette Ville pouvoient en faire le
tour à couvert des insultes du dedans & du dehors, dont ce double mur les deffendoit. Ces Tours, dont la
moindre est une espéce de citadelle, débordent considérablement en dehors, & ne sortent pas moins en
dedans. Aussi contiendroient elles aisément quatre ou cinq cens hommes ; ensorte qu’on pourroit y loger
une armée de cinquante mille hommes, sans qu’elle fût à charge aux habitans. Tout y est vouté, & on
compte dans chacune plus de cent chambres. Au reste je suis assez du sentiment de ceux qui pensent que
ces Tours, dont la hauteur est prodigieuse, ont été bâties à deux fois. On distingue encore aujourd’hui
l’ouvrage du Prince, qui les a fait élever plus qu’elles ne l’étoient d’abord, par le soin qu’il a eu de le faire
crépir. On remarque aussi dans le premier fossé au flanc de chaque Tour des portes par où les troupes
pouvoient faire des sorties. On ne peut nier que cette Ville ne fût très forte en ce tems-là.
Il n’en faut pas, je crois, davantage pour réfuter ceux, qui ont prétendu que ces murs étoient la véritable
enceinte de l’ancienne & superbe Aléxandrie. Cette Ville auroit certes été bien petite, & n’auroit pas eu la
vingtiéme partie de l’étendue que nous sçavons qu’elle contenoit, si elle eût été resserrée dans un espace
aussi médiocre. Pour se convaincre du contraire, il suffit de considérer ces murs & ces tours, dont la plus
grande partie subsiste encore aujourd’hui en son entier. Le moindre connoisseur s’apperçoit du premier
coup d’oeil qu’elles ne sont dignes de la magnificence ni des Grecs, ni des Romains. Les portes même dont
le bois est encore entier, après que les lames de fer qui les couvroient ont été consumées par le tems,
prouvent seules la fausseté de cette opinion, & les inscriptions Arabes qu’on lit encore aujourd’hui sur ces
portes, achevent de lever tous les doutes sur l’époque de l’origine de cette Ville.
(p. 140) De ses antiquités.
Cependant toute moderne qu’elle est, elle ne laisse pas de renfermer encore des morceaux respéctables de
la plus belle antiquité. Telle est cette superbe colomnade, qu’on trouve vers le milieu de cette enceinte. Elle
consiste en un rang de colomnes encore de bout d’une grosseur & d’une hauteur extraordinaires, entre
lesquelles il s’en remarque une, qui conserve encore son chapiteau. Ces colomnes, qui sont élevées sur une
même ligne, s’étendent près de cinq cens pas, & ne sont plus aujourd’hui dans une distance égale les unes
des autres, parce que la plus grande partie en a été enlevée. Il s’en trouve même plusieurs de renversées
entre celles qui subsistent encore aujourd’hui et restent debout. De celles ci on en voit quelques unes, qui ne
sont éloignées des autres que de dix à douez pieds ; d’où je juge que sur ce seul rang il y avoit près de cent
cinquante colomnes. Pour les réduire même à ce nombre, il faut supposer que la premiére & la derniére des
colomnes, qui se trouvent sur cette ligne, en occupoient réellement autrefois, comme elles font aujourd’hui
les deux extrémités. Vis-à-vis de ce rang de colomnes on en voit d’autres semblables, qui leur sont
opposées. & quoi qu’il n’en reste aujourd’hui sur pied que trois ou quatre, il est visible cependant par la
disposition & par la conformité de l’ordre, de la grosseur, & de la hauteur des colomnes de ce second rang
avec celles, qui composent le premier, que ce lieu étoit autrefois une place, dont la figure formoit un quarré
long de deux cens pas de large sur une longueur de cinq cens ; ce qui devoit être sans contredit d’une
beauté & d’une magnificence achevée. Un édifice de briques, qu’on voit au milieu de cet espace, avec des
réservoirs au dessus & des bassins destinés à recevoir l’eau, fait connoître qu’il y avoit dans cet endroit une
fontaine assez superbe, pour répondre à la beauté du lieu qu’elle occupoit. Il est naturel de croire, que les
plus beaux Palais d’Aléxandrie faisoient face à cette place, puisqu’immédiatement derriére les colomnes,
surtout du premier côté, on voit quantité de murs de briques, les uns renversés, les autres entiers, qui font
encore juger de la grandeur & de la beauté des bâtimens élevés en cet endroit. Peut être même ces Palais
s’avançoient-ils jusqu’à ces colomnes, sur lesquelles les murs antérieurs reposoient, & qui formoient ainsi
des (p. 141) portiques sous lesquels on alloit se promener. Je ne doute point que ces édifices superbes ne
fussent l’ouvrage des Romains. Au milieu de ces ruines, qui sont sans contredit un des plus beaux restes de
l’ancienne Aléxandrie, on trouve des bains encore presque entiers. J’y en ai remarqué un surtout, dont les
murs n’étoient uniquement composés que de mortier, mais si ferme & si dur, qu’il auroit disputé cette qualité
à la pierre même. Les Mores vont chaque jour en détacher quelques morceaux, pour composer leurs
nouveaux bâtimens, mais comme ces ruines sont déja presque entiérement ensévelies sous le sable, ils ne
se donnent pas la peine de creuser jusqu’au dernier fondement. Il est certain, que si on risquoit la dépense
d’y faire fouiller, on y découvriroit mille belles antiquités. La plûpart des gens croyent ici, que le Palais du
Pere de Sainte Catherine étoit autrefois bâti dans l’endroit, où ces murs de briques paroissent le plus
élevés ; mais comme cette tradition n’a rien de certain, & qu’on n’est pas fort scrupuleux ici sur ces sortes de
matiéres, d’autres assurent que c’étoient des bains publics. Ceux-ci pourroient bien avoir raison ; car on y
voit encore clairement plusieurs appartemens voutés, qui semblent n’avoir été destinés qu’à cet usage.
Vers le milieu de cette grande colomnade, & du côté où les colomnes sont plus entiéres, subsiste encore
aujourd’hui une Mosquée, qui fut autrefois une Eglise consacrée à Saint Athanase. C’est sans contredit
l’Eglise la plus belle, comme la plus ancienne, qu’on voye aujourd’hui en Egypte. Au travers des fentes de
plusieurs portes, dont elle est percée, on apperçoit que le quarré long, qui la compose, est environné de
quatre rangs de colomnes de porphire parfaitement belles. Ces colomnes soutiennent des arcades, que je
crois modernes, & faites, ou du moins rebâties par les Turcs. Le milieu de ce vaste édifice n’est qu’une
grande cour pavée de marbre ; en sorte que si c’étoit là toute l’Eglise, car on pourroit croire avec fondement,
que ce n’en étoit seulement que l’entrée, ou le parvis, elle n’étoit composée que de collatéraux, à moins
qu’elle ne fût couverte d’un dôme, qui ne subsiste plus. Ce qui pourroit confirmer cette opinion, c’est que la
plûpart des anciennes Eglises, ainsi que toutes les Mosquées des Turcs, sont bâties sur ce modele. On peut
dire (p. 142) que cet usage est très salutaire pour ceux, qui vont y faire leurs priéres. L’air qu’on y respire y
est sans cesse renouvellé par le vent, au lieu que celui de nos Eglises couvertes de voutes & fermées par
des portes se charge d’une infinité d’exhalaisons mauvaises, surtout dans les plus fréquentées, & produit
souvent plus de maladies qu’on ne s’imagine. Il est vrai, que la nature de notre climat ne permettroit pas
souvent de prier à l’air, même dans les plus belle saisons de l’année. Quoiqu’il en soit, l’extérieur de ce
bâtiment n’a rien de beau, ni de prévenant. Ce ne sont que de simples murailles ; mais s’il étoit permis d’y
entrer, je ne doute point qu’on n’y remarquât de belles antiquités, & qu’on ne jugeât beaucoup mieux de ce
que ce lieu étoit autrefois. Je ne fis même, alors que je visitai cet endroit, le peu d’observations, que je viens
de communiquer, qu’avec beaucoup d’inquiétude, & après avoir disposé mes Janissaires & la Nation qui
m’accompagnoit, de maniére à ne pouvoir être surpris. Les Turcs plus superstitieux ici qu’ailleurs ne
pardonneroient point une pareille curiosité. On peut dire qu’ils sont aussi jaloux de leurs Mosquées que de
leurs femmes. Cette Eglise n’est pas la seule, qui se trouve dans cette enceinte. Quelques Religieux Coptes
y ont aussi une Chapelle, qu’ils prétendent bâtie sur le lieu, ou étoit élevé le Palais du Pere de Sainte
Catherine ; & les Religieux de Terre Sainte y en occupent une autre située auprès d’une maison où le
Consul Vénitien logeoit autrefois.
Aiguilles de Cléopatre.
Après ce fameux monument ce qu’il y a de plus ancien & de plus curieux dans l’Aléxandrie moderne, ce sont
ces deux Aiguilles, ou Obélisques, que l’on attribue à Cleopatre, sans qu’on sçache trop bien sur quel
fondement. L’une est aujourd’hui renversée, & presque ensévelie sous les sables ; l’autre reste encore
debout, & quoi qu’on ne voye point le piedestal sur lequel est est posée, à cause des sables, qui
l’environnent & le couvrent absolument, il est aisé de connoître en mesurant un des côtés de la base de
celle, qui est debout, n’est pas fort considérable. Les quatre côtés de ces Aiguilles sont couverts de figures
hiéroglyphiques, dont malheureusement nous avons perdu la connoissance, & qui sans doute renfermoient
des mystéres, qui resteront toujours ignorés. Du reste elles sont (p. 143) de marbre granite, comme la
plûpart de celles qu’on trouve à Aléxandrie, & dans le reste de l’Egypte.
Des citernes.
L’Aléxandrie souterraine n’est pas à beaucoup près si maltraitée, que celle que je viens de décrire. De ces
citernes, dont j’ai déja parlé, destinées à fournir pendant toute l’année de l’eau aux habitans de cette Ville, si
quelques unes ont été enfoncées, s’il s’en trouve de gâtées, de remplies, de bouchées, enfin si celles qui
restent ne sont point entretenues avec la même propreté qu’autrefois, il est certain du moins par ce qu’on en
voit encore aujourd’hui, & par le témoignage de ceux qui y descendent tous les jours, qu’il n’y a rien de plus
beau, ni de plus entier que leurs voutes, rien de mieux bâti que les ouvertures, par où elles communiquent
les unes avec les autres. La plûpart de ces voutes, toutes fort exhaussées, sont soutenues par des
colomnes ; ensorte qu’après que les eaux en ont été épuisées, on peut se promener spatieusement dans
ces citernes, comme au milieu de plusieurs superbes colomnades. Les eaux y sont introduites par ces
ouvertures, qui aboutissent aux canaux, dont cette enceinte est traversée en differentes façons. Plusieurs de
ces citernes sont revêtues de marbre ; & si elles le sont seulement de ciment, il est si entier, soit dans le
fond de la citerne, soit au mur dont elle est environnée, qu’on ne peut se lasser d’admirer sa composition, &
l’art avec lequel il a été employé. Ces citernes ont encore une étendue surprenante. Des gens, qui y sont
entrés par un bout de la Ville, en sont sortis par l’autre. Cependant cette étendue, quelque considérable
qu’elle soit, est encore bien différente de celle que ces vastes réservoirs ont effectivement, & de celle qu’ils
avoient autrefois. On trouve une continuation de ces citernes depuis Aléxandrie, en suivant le rivage de la
mer vers l’Orient jusqu’aux Biquiers, qui en sont éloignés de cinq grandes lieues ; de semblables s’étendent
jusqu’à deux lieues vers l’Occident. Parmi ces canaux souterrains, qui servent à porter l’eau dans les
citernes, & qui sont assez élevés pour qu’un homme puisse s’y promener debout, on en voit encore un
presque entier, qui régne jusqu’aux Biquiers. Il étoit destiné à fournir l’eau aux citernes, qui s’avançoient de
ce côté là, & il la recevoit comme tous les autres par ce grand canal, dont j’ai parlé plus haut, & qui, comme
je l’ai dit, (p. 144) subsiste encore aujourd’hui en partie. Il n’y a que vingt cinq ou trente ans, qu’il étoit encore
en assez bon état, & il se trouve d’anciens négocians François, qui par ce canal ont fait voiturer des
marchandises de leurs maisons jusqu’au Caire. On m’a assuré que ce canal qui a aumoins quinze lieues de
longueur, est entiérement pavé, & que ses côtés sont revêtus & soutenus par des murs de briques aussi
entiers qu’ils l’étoient du tems des Romains.
Colomne de Pompée.
Il ne me reste plus qu’à parler d’un des plus beaux morceaux d’antiquité, qui nous ayent été conservés en
Egypte, je veux dire de la colomne de Pompée. De toutes les anciennes magnificences d’Aléxandrie & de
ses environs, dont la grandeur a été ensévelie dans l’enceinte des murailles de l’Aléxandrie moderne, il ne
nous reste guéres de débris aussi entiers, que cette colomne. Je ne prétens point décider si c’est avec
fondement, ou non, qu’on lui a donné le nom de Pompée. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’au bas de son fût
du côté de l’Ouest on trouve une inscription Grecque, dont je ne crois pas qu’on ait encore tiré de copie.
Aussi est il impossible de la lire à cause de la couleur variée du marbre, qui compose cette piéce. Le seul
moyen de l’avoir, seroit, à mon avis, d’en prendre l’empreinte sur de la cire molle. Quoi qu’il en soit, cette
colomne, qui autrefois étoit incontestablement dans l’enceinte d’Aléxandrie, se trouve aujourd’hui à un grand
quart de lieue des murs de la nouvelle Ville tirant vers le lac Mareotis, élevée sur un tertre naturel de pierre
solide escarpé de toutes parts, & de la hauteur de vingt cinq à trente coudées. Il est vrai, que si ce
monument subsiste encore de nos jours, nous en sommes redevables à l’énormité de son poids, qui n’a pas
permis aux Arabes d’arracher les pierres, sur lesquelles sa base est posée. Cependant à force d’attaquer
ses fondemens, dans l’espérance sans doute d’y trouver quelque trésor, ils sont parvenus à tirer une pierre
d’un coin. Par là ils nous ont donné lieu d’appercevoir sur celle, qui la suit immédiatement, des lettres
hiéroglyphiques parfaitement entiéres, & de voir que précisement au milieu des grosses pierres, sur
lesquelles s’appuie la base de cette colomne énorme, il y a aussi une espéce de colomne, sur laquelle
repose toute la pesanteur de l’ouvrage. On découvre de même sur cette (p. 145) derniére, qui sert en
quelque sorte de pont d’appui, plusieurs caractéres hieroglyphiques, qui vraisemblablement doivent regner à
l’entour.
Il seroit difficile de dire de quel ordre est cette colomne. Pour en parler avec assurance, il faudroit au moins
en avoir mesuré le fût par le bas. Or on doit s’imaginer que ce n’est pas une entreprise aussi facile qu’on
pourroit le croire que de porter une Echelle jusques là, & de faire cette opération. Ce que je puis assurer,
c’est que cette colomne n’est point Gothique ; qu’elle a de très belles proportions ; qu’on y observe une
diminution par les deux bouts, & un renflement dans le milieu ; qu’enfin l’oeil le plus difficile n’y peut rien
trouver à redire. La colomne est de trois morceaux. Le Chapiteau en fait un ; Le fût & trois pieds de la base,
qui y sont joints, sans doute pour appuyer d’autant mieux la position de cet ouvrage prodigieux sur son
piédestal, forme le second ; enfin la base même compose la troisiéme piéce. Chacune des faces de cette
base a quinze pieds au moins de largeur, & autant de hauteur, d’où l’on peut juger du poids énorme de ce
quartier de marbre. La colomne posée sur ce piédestal est sans contredit la plus grosse & la plus haute, qui
soit dans l’Univers. Suivant l’estime de plusieurs personnes, qui en ont pris les dimensions avec des
instrumens de Mathématique, elle a quatre vingt huit pieds entre la base & le chapiteau ; ensorte que sans
craindre de se tromper, on peut lui donner hardiment cent dix pieds d’élévation. Sa grosseur est
proportionnée à sa hauteur, & quatre homme pourroient à peine l’embrasser. En un mot il est impossible de
rien voir de plus parfait en ce genre. La base est aussi entiére que le premier jour. Le Chapiteau est, à la
vérité, un peu écaillé, ou plutôt dépoli ; mais outre qu’on trouveroit en Egypte deux cens morceaux pareils
propres à en faire un nouveau, ce léger défaut n’empêche point qu’on ne voye très distinctement les
feuillages, dont il est orné. Il est vrai aussi, que le cordon & le fût même se trouvent endommagés du côté
exposé au Midi, le vent humide, qui souffle de ce côté-là, ayant vraisemblablement produit cet effet ; mais ce
dommage est très léger, puisque ce qu’il y a de gâté ne s’étend pas à plus de vingt cinq pieds de longueur
sur un pied & demi de large, & ne pénétre pas plus de quatre doigts (p. 146) dans le vif de la colomne ;
défaut peu considérable, & qui doit être compté pour rien dans une piéce aussi prodigieuse & aussi antique.
D’ailleurs rien ne seroit plus facile que de reparer cette entamure, ou si l’on veut, cette excoriation, d’une
maniére même à n’en pas laisser le soupçon le plus léger, par le moyen d’un mastic composé du même
marbre. Tout le monde sçait que le marbre n’est qu’un assemblage de petits cailloux, que la nature réunit
par un ciment imperceptible, & qu’en maniant un peu fortement les écailles de cette pierre, que le tems a
detachées, elles se réduisent facilement en poussiére, qui découvre la composition. On trouveroit sans
peine de cette même espéce de marbre, c’est-à-dire de la même couleur, & de la même finesse. Elle n’est
pas absolument rare dans ce pays ci. On broyeroit ce marbre, dont on feroit une pâte ; & lorsqu’il s’agiroit de
rétablir la colomne, après avoir nétoyé d’abord jusqu’au vif l’endroit dégradé, on le rempliroit d’un bon mastic
mêlé de grains naturels, qu’on auroit séparés auparavant ; on appliqueroit ensuite la pâte composée de ce
même marbre broyé, & on en rempliroit tout l’espace gâté en plus grande quantité, que le vuide ne
l’exigeroit, afin qu’en polissant l’ouvrage, on pût rendre cette addition égale au reste du corps de la colomne.
Je suis persuadé que cette composition tiendroit autant que le marbre même, & qu’il ne seroit pas possible
de s’appercevoir de cette matiére artificielle entée de la sorte sur la nature. Peut être aussi seroit il plus à
propos de laisser au marbre cette difformité, qui ne serviroit qu’à mieux prouver l’antiquité de cette piéce. Ce
sont de ces deffauts légers, qui bien loin de défigurer, contribuent au contraire à relever le mérite d’un bel
ouvrage.
Le Chapiteau répond au reste de la piéce, & est creusé par dessus. Peut être soutenoit-il la representation,
ou de Pompée même, dont ce monument porte le nom, ou de quelqu’autre Empereur, ou Héros, dont on
avoit placé la statue au haut de cette masse prodigieuse. C’est ce dont on ne peut être éclairci que par
l’inscription, dont j’ai parlé, & qui se trouve au bas du fût. Si ce soupçon est fondé, il falloit que cette figure fût
d’une grandeur extraordinaire, pour répondre à la hauteur de la colomne, & pour être apperçue d’en bas
dans une proportion naturelle. Quelques uns sont d’un autre sentiment. (p. 147) Comme on apperçoit cette
colomne de la mer long tems avant que de découvrir la terre d’Aléxandrie, ils pensent que ce monument
peut avoir été destiné à servir de fanal aux vaisseaux, qui y abordoient. Mais comment auroit on porté du feu
au haut, puisque la colomne n’est point creuse, qu’elle a aumoins cent dix pieds d’élévation, & qu’on ne fait
point d’Echelle de cette hauteur. Il y a quelque tems qu’un danseur de corde, Arabe de nation, entreprit de
monter sur cette colomne, & en vint à bout. Il attacha une ficelle à une fléche qu’il eut l’adresse de faire
passer dans les jours de la corniche, dont le Chapiteau est accompagné. Ensuite par le moyen de la ficelle il
y éleva une corde, à la faveur de laquelle il monta réellement sur le haut de la colomne, portant un ânon sur
ses épaules. Cela se passa à la vue de tout le peuple d’Aléxandrie, qui étoit accouru pour jouir de cette
nouveauté. C’est de cet Arabe que l’on a sçu, que le Chapiteau étoit creusé considérablement.
Après l’idée que je viens de donner de ce monument, peut on s’empêcher d’avouer, que c’est le plus grand
dommage du monde, qu’il soit entre les mains de gens, qui en connoissent si peu le mérite ? Pour moi je ne
puis me détacher d’une idée, qui m’est venue naturellement en le considérant. Cette magnifique colomne
m’a paru digne de soutenir une statue du Roi. S’il est vrai qu’elle ait porté celle de Pompée, comme la
tradition le veut, à quel Héros pourroit-elle être mieux consacrée ? Par où pourroit on mieux conserver, &
même augmenter la gloire de sa premiére destination ?
Il ne seroit pas aussi difficile, qu’on le pense, d’obtenir cette colomne de la Porte. Je suis persuadé même
qu’on en viendroit aisément à bout, en s’y prenant avec adresse. La Cour pourroit d’abord la faire demander
au Grand Seigneur par l’Ambassadeur de France, à qui certainement on ne refuseroit pas cette grace. On
obtiendroit ensuite de S. H. qu’elle chargeât un Capigi Bachi d’un ordre adressé au Bacha & aux autres
Puissances de l’Egypte, par lequel elle déclareroit, qu’étant résolue de faire venir cette piéce à
Constantinople, & l’Ambassadeur de France ayant bien voulu se charger de la faire abattre, & de fournir des
vaisseaux pour la transporter, sa volonté seroit qu’à cette occasion il fût donné toute sorte de (p. 148)
secours & de protection au Consul de cette nation résident au Caire, sans pouvoir pour ce sujet rien exiger
de lui sous quelque prétexte que ce fût. Pour prévenir jusqu’au plus léger soupçon, il seroit encore à propos
qu’il fût ordonné au Bacha de faire délivrer au Consul les sommes, dont on auroit besoin pour satisfaire aux
dépenses absolument nécessaires. On auroit soin que ces sommes fussent ensuite remises secrétement au
trésor de S. H. par l’Ambassadeur. Comme il est très rare que les ordres du Grand Seigneur trouvent de la
résistance, comme d’ailleurs les Turcs & les Arabes sont trop grossiers, pour estimer de pareilles curiosités,
je ne doute point, si on s’y conduisoit de cette sourte, qu’ils ne s’empressassent à faciliter eux mêmes
l’exécution d’un dessein, auquel ils ne manqueroient pas de s’opposer de toutes leurs forces, s’ils sçavoient
qu’on destinât cette piéce à une Puissance étrangere. Je sçai qu’il seroit toujours nécessaire de faire ici
quelques libéralités ; mais je suis en même tems très convaincu, qu’elles n’égaleroient pas à beaucoup près
ce qu’il en couteroit, si l’on étoit obligé d’obtenir leur consentement au prix qu’y mettroit infailliblement leur
avarice insatiable. Toute la dépense consisteroit dans les frais du bâtiment destiné pour ce transport, & de
l’entretien des matelots, qui le monteroient. Du reste je mets en fait que l’exécution de ce projet ne couteroit
pas plus de vingt mille écus au Royaume. La France pourroit se vanter alors de posséder le plus rare
morceau d’antiquité de cette espéce, qui subsiste aujourd’hui dans le monde, & le concours d’étrangers, que
ce monument fameux y attireroit de toutes les parties de l’Europe, la dédommageroit avec usure de tout ce
qu’il en couteroit.
On prétend que cette colomne, comme toutes les autres qu’on voit dans la basse Egypte, ont été tirées des
carriéres de la haute, d’où on les amenoit par le Nil. Cette opinion a beaucoup de fondement, comme je le
ferai voir en parlant du marbre granite. Mais ce que quelques Auteurs Arabes ajoutent à ce sujet est de la
derniére extravagance. Ils disent que dans ces tems reculés, où l’Egypte se vit peuplée de ces monumens
célébres, ce pays étoit habité par des hommes d’une taille & d’une force si extraordinaires, qu’ils prenoient
une de ces colomnes sous leur bras, & faisoient gaillardement avec ce (p. 149) fardeau cent cinquante &
deux cens lieues, en passant seulement de tems en tems cette masse énorme d’un côté à l’autre, C’est
ainsi, continuent-ils, que toutes ces colomnes ont été transportées de si loin. Pour mieux établir le
merveilleux de ce récit ils ajoutent, que le Géant qui se chargea de la colomne de Pompée, la plus pesante
de toutes, se rompit une côte en chemin, peut être en voulant la passer de la droite à la gauche ; mais que
cet accident ne l’empâcha point de continuer sa route, & d’arriver à Aléxandrie son paquet sous le bras,
comme tous les autres. Quel dommage, qu’une race si vigoureuse soit manquée ! Que de travaux, que de
machines n’épargneroit on pas avec un tel secours. Il nous faudroit à nous autre foibles Pygmées des
années entiéres pour déplacer seulement cette colomne.
De l’état présent d’Aléxandrie.
Je finis par une observation, qui surprendra peut être, mais qui n’en est pas moins nécessaire ; C’est qu’on
ne doit pas croire que cette nouvelle enceinte, dont j’ai parlé, élevée il y a environ six cens ans sur les ruines
de l’ancienne Aléxandrie, & que j’ai appellée l’Aléxandrie moderne, soit véritablement la Ville d’Aléxandrie,
telle qu’elle subsiste aujourd’hui. Je ne crois pas qu’à bien compter tous les Chrétiens, les Turcs, & les
Arabes, qui habitent encore cette Aléxandrie prétendue, on trouvât une centaine d’hommes parmi les ruines
qu’elle renferme. Elle est devenue si déserte, qu’on n’y peut même aller vers le soir, ni de grand matin, sans
s’exposer à un danger manifeste d’être volé. Ce qui dans cette enceinte subsistoit de l’Aléxandrie ancienne,
étant encore trop étendu pour le peuple, qui l’habitoit, & les ruines des maisons inhabitées augmentant
encore tous les jours, quelques uns ennuié de demeurer parmi ces ruines songerent à se procurer un plus
agréable séjour. Les dehors de cette moderne Aléxandrie leur en offrirent un tel qu’ils pouvoient le souhaiter.
Au fond du port neuf, ou comme je l’ai déja dit, la terre se prolonge tous les jours dans la mer aux depens de
l’étendue qu’il devroit avoir, les sables que le tems y avoit rassemblés insensiblement avoient éloigné de
beaucoup la mer des anciens murs, & formé un terrain assez considérable. Ce fut là que quelques uns de
ceux qui avoient leurs maisons dans l’enceinte de l’Aléxandrie moderne transporterent leurs habitations.
Dans peu ils furent suivis par (p. 150) d’autres, & bientôt pour s’approcher de la marine, on abandonna
absolument la seconde Aléxandrie, où l’on n’a guéres conservé que quelques Mosquées, qu’on entretient
encore à cause de leur beauté, & des revenus qui y sont attachés.
Ce nouveau terrain, ou si l’on veut, cette troisiéme Aléxandrie, qu’on doit regarder comme l’Aléxandrie de
nos jours, s’est si fort accru, que la maison, où je débarquai en 1692. qui faisoit alors face à la mer, & n’en
étoit pas éloignée de trente pas, s’en trouvoit distante en 1718. de plus de soixante & dix ; ensorte que de là
au rivage on avoit bâti plusieurs habitations nouvelles. C’est un fait, dont j’ai été témoin ; & je ne doute pas
que depuis ce tems-là il ne soit arrivé encore quelque pareil changement. C’est ainsi que la Ville, qui porte
aujourd’hui le nom d’ancienne, a sans doute été construite des ruines de la premiére Aléxandrie, & que la
nouvelle s’est bâtie, & se bâtit encore tous les jours des débris de la seconde, autant & mille fois plus
inférieure à la véritable Aléxandrie, que celle qui subsiste aujourd’hui l’est elle même à celle là. Il viendra
peut être un tems, où les colomnes qui ont été transportés dans ce nouveau terrain, confondues avec la
poussiére des maisons, feront croire à ceux qui ne l’auront pas vû bâtir comme nous, que la Ville fondée par
Aléxandre étoit réellement située dans cet espace qu’il occupe, comme quelques uns osent encore soutenir
aujourd’hui, que les murs & les tours, dont j’ai parlé plus haut, l’enfermoient autrefois véritablement.
Tel est, Monsieur, l’état déplorable, où se trouve aujourd’hui cette grande cette fameuse Ville d’Aléxandrie,
autrefois si célébre par toute la terre, & dont l’histoire vous avoit donné sans doute l’idée la plus haute & la
plus magnifique. Au lieu de ce peuple immense qui l’habitoit, à peine y compte t’on de nos jours trois ou
quatre mille personnes réfugiées de différentes provinces de la Turquie. C’est à ces masures, dont elle est à
present composée, que se sont réduits ses grands fauxbourgs, ses Palais, ses Amphitéâtres. De tous ces
endroits autrefois si fameux, de tant de monumens si célébres, dont étoit enrichi ce long terrain depuis
Canope jusqu’à la Tour des Arabes, il ne reste plus que quelques monticules, qui par leur (p. 151) élévation,
& par les ruines dont ils sont couverts, marquent encore jusqu’où Aléxandrie portoit son étendue. Car il est
certain, qu’avec un peu d’attention rien n’est plus facile que de distinguer les endroits, qui ont été bâtis, de
ceux qui ne l’ont point été. A l’excéption de ces tristes débris, & à quelques monumens près que le tems a
respectés, & qui ont échappé à la fureur des Arabes, tout est cendre & poussiére aux environs de cette Ville.
On ne rencontre de tous côtés que des monceaux de pierres & de sables. On trouve dans l’enceinte des
murs, dont j’ai parlé, deux montagnes assez élevées, qui ne sont composées que de ces débris. C’est dans
ces ruines informes, surtout dans celles qui s’étendent à l’Orient & aux Couchant au dehors d’Aléxandrie,
qu’on trouve une infinité de médailles, & de ces pierres gravées, qui étoient si communes chez les Romains.
On sçait qu’ils les portoient au doigt en maniére de bagues ; peut être pour leur servir de cachet ; peut être
aussi comme des representations de leurs divinités, des personnes célébres par leur vertu, ou de celles
qu’ils estimoient. Les colomnes répandues, dans tout ce vaste terrain sont sans nombre. Il s’en rencontre
quantité dans l’ancienne Ville, les unes debout, d’autres renversées, la plûpart très grosses, & qui n’ont pû
être enlevées à cause de leur pesanteur. Car il est certain que les Turcs se sont emparés de toutes celles
qu’ils ont pû emporter, soit pour bâtir ici leurs maisons, ou leurs Mosquées, où il s’en trouve un nombre
prodigieux, soit pour enrichir la Ville de Rosette, où l’on en de même transporté beaucoup. On en voit aussi
plusieurs à l’entrée de ces arcades pratiquées, comme je l’ai dit, au pied des tours, qui sont entre les deux
murs de la Ville. Il y en a encore en grand nombre au pied de ces mêmes murs dans l’endroit, où ils sont
encore aujourd’hui battus des flots de la mer, sans parler de celles qu’on a entre-lacées dans l’épaisseur de
toutes les murailles, & qui y ont été mises, pour affermir & mieux lier tout l’ouvrage. Enfin de quelque côté
qu’on porte ses regards, on n’apperçoit que colomnes de toutes les grandeurs & de toute espéce de marbre.
Il seroit difficile d’imaginer le nombre de monumens illustres que l’avarice des Arabes a anéantis dans ces
environs. On les a vûs encore de nos jours abattre à la campagne des colomnes superbes, dans la seule
espérance de trouver sous la base (p. 152) quelques monnoyes d’or, ou d’argent, qu’ils croyoient y être
cachées. Il y a quelques années, que dans un tems de peste la supertition leur fit briser dans ces mêmes
campagnes une figure de Lion aussi belle qu’elle étoit ancienne. Combien d’autres ouvrages, qui méritoient
d’être respectés, ont péri de la même maniere !
Au reste quand je parle de montagnes de ruines, je ne prétens point entendre par là ces ruines récentes,
parmi lesquelles on rencontre encore de grosses pierres. Je parle de ces ruines de douze ou quinze cens
ans, où la poudre des briques & celle des pierres se distingue seulement par quelques petites parties, qui en
restent. Je suis persuadé, que si on se donnoit la peine d’approfondir le terrain, on trouveroit des murs, &
d’autres ouvrages entiers, qui ont été ensévelis sous cette poussiére, & sous le sable que le vent y a mêlé.
Je ne doute point encore, qu’en examinant les digues, & les divers autres endroits du port, où il paroît des
rochers, on ne découvrît beaucoup d’antiquités, qui y sont cachées. Le vieux port, par exemple, en est
certainement environné ; mais comme il n’est pas permis aux Chrétiens d’en approcher, il seroit impossible
d’en rien dire d’assuré. Quoiqu’il en soit, il est difficile de ne pas convenir, qu’il y a très peu de Villes dans
l’Univers, qui après tant de révolutions, puisse encore, comme celle-ci, au bout de dix sept siécles laisser
entrevoir autant de traces de sa magnificence. Que seroit Paris lui même, malgré sa grandeur presente, s’il
étoit seulement abandonné pendant une aussi longue suite d’années ? Quels ouvrages y connoissons nous
capables après un si long intervalle de conserver encore quelques traits de leur grandeur ? Avouons le,
Monsieur ; Nous ne faisons rien aujourd’hui en édifices publics ni en solidité de bâtimens, qui soit aussi
grand & aussi durable que l’étoient les ouvrages des Anciens.
Cependant à force d’admirer l’antiquité je m’apperçois que j’éloigne la fin de ma lette. Or comme le tems ne
me permet pas actuellement de la faire plus longue, peut être aussi n’auriez vous pas le loisir d’en lire
davantage. Je finis donc en vous assurant à mon ordinaire que je suis, &c.
Au Caire ce.... »
LETTRE.
- 565 - 579 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PÈLERIN ANONYME (XVIIe-XVIIIe siècle)
Pèlerin anonyme, Récits de voyages d’un arabe, par O. de Lébédew, Saint-Petersbourg, 1902.
Ce manuscrit aurait été écrit au XVIIe-XVIIIe siècle par un arabe orthodoxe d’après O. de Lébédew, éditrice de
ce texte. L’auteur anonyme décrit différents lieux comme la Terre sainte, le Sinaï, Rome, Alexandrie,
Antioche… Mais lors de la traduction du texte de l’historien syrien Ibn al-Wardī561 (1290-1349), nous nous
sommes rendus compte que le pèlerin anonyme avait reproduit la description d’Alexandrie de cet auteur. De
plus, d’après Clément Huart562, Ibn al-Wardī aurait copié Ǧami‘ al-funūn, encyclopédie composée par Naǧim
al-Dīn Aḥmad al-Ḥarranī, savant hambalite qui se trouvait en Égypte en 1332.
p. 66-69 :
« C’est la dernière ville de l’Occident. Elle est construite au bord de la Mer Syrienne.
Elle possède des Antiquités merveilleuses est des monuments qui, encore debout, témoignent de la
puissance et de la grandeur de son fondateur.
Elle est entourée de murs solides et se trouve dans un état prospère, possèdant beaucoup d’arbres et de
fruits, tels que grenades, raisins et autres. Malgré sa population nombreuse, la vie y est à bon marché. On y
fait d’admirables étoffes et d’autres objets d’une rare beauté. Il n’y a pas au monde une ville qui puisse être
comparée.
On exporte aujourd’hui, comme par le passé, de magnifiques étoffes, dans tous les pays.
Ses rues sont encombrées de monde et elle sert d’entrepôt pour les marchandises.
Le Nil occidental y coule sous les maisons, et ses eaux sont séparées en canaux fait avec tant d’art et
d’intelligence, qu’ils se réunissent l’un à l’autre d’une manière étonnante, ce qui fait que tous les édifices
sont construits comme sur un échiquier.
(p. 67) C’est une des merveilles du monde. C’est dans cette ville que se trouve un phare qui n’a pas son
égal dans le monde entier, et que rien ne peut surpasser en solidité.
Il est construit en pierres ponces cimentées dans du plomb, de sorte qu’elles ne peuvent jamais se détacher
l’une de l’autre. La mer bat ses flancs du côté Nord.
Il y a un mille de distance par mer du phare jusqu’à la ville, et trois milles par terre. La hauteur du phare est
de trois cents aunes. Cette aune est de trois empans. En un mot, sa hauteur égale la taille de cent hommes,
dont quatre-vingt-seize n’atteindraient que la coupole, et sa coupole est de quatre tailles d’homme. Et depuis
la base jusqu’à l’étage du milieu, il y aurait soixante-dix tailles d’homme, et de l’étage du milieu jusqu’à la
coupole, vingt-six. On y monte par un escalier en pente douce comme cela fait d’ordinaire dans les clochers.
Le premier escalier arrive jusqu’à la moitié de l’édifice, et puis il commence à se rétrécir.
Dans l’intérieur du phare et sous l’escalier, se trouvent des chambres habitées. Depuis l’étage central
jusqu’en haut, le phare se rétrécit au point qu’un homme y passe librement ; les marches aussi deviennent
beaucoup plus étroites que celle de la partie inférieure de l’escalier.
De chaque côté du phare, il y a des ouvertures pour laisser pénétrer la lumière, afin que l’on puisse voir où
l’on met les pieds.
Ce phare constitue une merveille du monde, par sa hauteur et sa solidité. On y allume du feu jour et nuit,
pour qu’il soit vu des vaisseaux et qu’il leur (p. 68) serve de guide. De nuit le feu brille comme une étoile et
de jour il en sort de la fumée, puisque Alexandrie se trouve au bout de la baie sur un terrain plat et n’a ni
montagne ni autre signe par lequel on puisse deviner qu’il s’y trouve une ville.
On dit que le fondateur de ce phare est le même qui a construit les pyramides auprès de la ville de Fostat,
du côté occidental du Nil. D’autres disent qu’il a été construit par Alexandre le Grand lors de la fondation
d’Alexandrie. On dit qu’il y avait au sommet du phare un miroir qui reflétait les vaisseaux à un mois de
marche. Ce miroir avait la priorité de brûler les vaisseaux à distance, grâce à certaines manipulations,
lorsqu’il s’y trouvait des ennemis, il les anéantissait par la force de ses rayons. On dit qu’un jour l’Empereur
de Byzance, en lui faisant dire que : « Alexandre avait caché dans la coupole de ce phare un grand trésor de
pierres précieuses de peur qu’on les lui volât. Si tu me crois, hâte-toi de les en retirer ; mais si tu en doutes,
je t’envoie un vaisseau chargé d’or, d’argent et d’étoffes précieuses, à condition que tu me permettes de
chercher le trésor, je t’en donnerai ensuite tout ce qui te plaira ».
Le roi d’Égypte s’y laissa prendre et détruisit la coupole, mais il n’y trouva rien et détériora le miroir
merveilleux, qui cessa d’agir. Après cela l’Empereur de Byzance l’attaqua et s’empara d’Alexandrie au
moyen d’une ruse adroite.
(p. 69) Il existe à Alexandrie deux obélisques : ce sont deux pierres entières carrées dont le sommet est plus
étroit que la base ; leur hauteur est de cinq tailles d’homme et la largeur de chaque côté est de dix empans,
de la sorte que la circonférence des quatre côtés est de quarante empans. Ils sont couverts d’écriture
syriaque.
L’auteur du « Livre des merveilles » dit que ces deux obélisques sont pris du mont Tarime qui se trouve à
l’occident de l’Égypte. L’un de ces obélisques est au centre de la ville et l’autre est à son extrémité.
On dit que le Palais du Conseil au sud d’Alexandrie est attribué à Salomon, le fils de David. Ses colonnes et
ses fondations existent encore aujourd’hui. Ce palais se présente sous la forme d’un carré long, dans
chaque coin duquel se trouvent seize colonnes ; au bout des deux côtés, dans le sens de la longueur, il y a
soixante-sept mâts.
Du côté gauche s’élève une grande colonne sur une base de marbre et couronnée d’un chapiteau en
marbre. Sa circonférence est de quatre-vingts empans et sa hauteur, depuis sa base jusqu’à sa cime, est de
neuf tailles d’homme ; son chapiteau est ciselé avec beaucoup d’art et son égal n’existe pas. Personne dans
tout Alexandrie ne sait dans quel but cette colonne a été érigée en ce lieu et laissée isolée. En ce moment
elle est très inclinée ; malgré cela elle ne risque point de tomber. Alexandrie est une des capitales de la
province d’Égypte. »
561 Fraehn, C. M., Aegyptus auctore Ibn al-Vardi, Halae, 1804.
562 Huart, C., Littérature arabe, Paris, 1902, p. 338.
- 580 - 581 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FULGENCE (début XVIIIe siècle)
Fulgence, Relation du Royaume d’Egipte, Munich, Bibliothèque Royale, Cod. Gall./a.m./756.
Moine français.
p. 56-75 :
« De la celebre Alexandrie
Alexandrie fut fondée par Alexandre le Grand, et batie par ce fameux architecte, Dinocrate, qui ayant envie
d’etre produit devant Alexandre, et ceux qui l’avait prie de le faire, le remettant de jour a autre, quitta ses
habillements ordianires, et se produisit luy meme devant ce prince vetu en Hercule, c’est a dire, couvert
d’une peau de lion et tenant en sa main une massue affin que par la singularité de son habillement il prit
l’obliger a luy parler ; Alexandre qui etoit alors sur son throne luy demanda qui il etoit ? Je suis, luy reponditil,
l’Architecte Dinocrates qui vient offrir a votre majesté d’entreprendre un ouvrage digne d’elle, je pretens,
ajoutat-il, tailler le mont athos en homme qui de sa main gauche tiendra une grande ville, et de la droite une
coupe ou se rendront toutes les eaux des fleuves qui s’écoulent de cette montagne ; Alexandre n’approuva
point son dessein, mais le retint pourtant auprès de luy et luy commanda quelque tems apres de batir cette
superbe ville, a qui il voulut donner son nom. Il la batit en soixante et douze jours : elle est située sur le bord
de la mer a trente ou trente cinq milles de la principale embouchure du Nil du coté de l’ouest ; l’enceinte des
murailles que l’on voit encore environner ce qu’on appelle ancienne ville, n’est pas visiblement un ouvrage
aussi ancien que la fondation de la ville ou que le regne de Cleopatre, la commune opinion est que ces
murs, qui n’enferment qu’une bien petite partie de l’ancienne Alexandrie ont été faits il y a cinq ou six cens
ans par un Roy du païs, et que les tours et les murs meme en plusieurs endroits furent elevez a une plus
grande hauteur par un roy, nommé, iassouf, qui regnoit il y a deux ou trois cens ans immediatement avant
que mamclus conquit cet Empire ; cette verité est aizée a persuader si l’on considere la structure de ces
tours, dont la plus grande partie subsistent encor dans leur entier et qui ne sont point dignes de passer pour
avoir été elevées par des romains ; les inscriptions arabesques qu’on voit encore sur les portes meme dont
le bois est encore tout entier, apres que les lames de fer dont elles étoient couvertes ont été consumées par
le tems ; la quantité prodigieuse de colomnes qui sont entrelassées dans les tours, et les autres endroits des
murailles, tout cela justifie assez que cette ville a été batie des ruines de l’ancienne, et qu’il n’y a pas fort
longtems que ces murs ont eté elevez, ils ne laissent pourtant pas d’etre considerables par leur force, et par
leur bonté ; il y a cinquante grosses tours sans les moindres dont la plus petite est comme une citadelle,
dans laquelle on pourroit librement loger cinq cens hommes, tout y est vouté et il y auroit plus de cent
chambres a chacune ces tours sont jointes l’une a l’autre par une double muraille dont la ville est
environnée, quoique d’une muraille a l’autre il y aye plus de trente pieds ces tours debordent encor
considerablement au dehors de la ville, et rentrent aussi en dedans, ce qui peut faire juger de leur
epaisseur ; il y a dans ces tours une arcade de la meme distance, en sorte que l’on passoit sous ces voutes,
et que l’on faisoit le tour de la ville sans que les tours en empeschassent. Dans le premier fossé on voit au
flanc des tours des portes par ou l’on pouvoit faire des sorties. Sur les assiegeans, il n’y a point de doute
qu’en ce tems-la la ville ne fut tres forte ; ses murs peuvent avoir environ six mille d’italie de circuit, ou deux
lieues de france ; les antiquitez que l’on voit audedans sont, les deux aiguilles ou obelisques de la reine
Cleopatre dont l’une est renversée et ensevelie sous le sable, et l’autre est encor debout, et quoyque l’on ne
voye point le pied-d’estal sur lequel elle est posée a cause du sable dont ilest couvert il est aizé de juger en
mesurant un des cotez d’en bas de celle qui est renversée que ce qui est caché de celle qui est debout n’est
pas bien considerable. Les quatre cotez de ces obelisques ou aiguilles sont pleins de figures hieroglifiques
dont nous avons perdu la connoissance ; la pierre dont elle est composée est la meme dont sont faites la
plu-part des colomnes que l’on voit encore a Alexandrie et qu’on a pretendu avoir eté fondue, qu’on appelle
marbre granite, qui s’etiroit de la haute Egipte, comme nous le ferons voir dans la suite ; on voit vers le
milieu de la ville un rang de colomnes de ce meme marbre encore debout d’une grosseur et d’une hauteur
extraordinaire dont une conserve encore son chapiteau. Ces colomnes qui sont sur une meme ligne
s’etendent pres de cinq cens pas et ne sont pas aujourd’hui a une egale distance l’une de l’autre parce que
la plus grande partie en a eté enlevée ou abatue, et on en voit encor plusieurs de renversée entre celles qui
subsistent ; vis a vis ces colomnes a deux cens pas on en voit d’autres semblables qui leur sont opposées,
et quoyqu’il n’en reste aujourd’hui que trois ou quatre, il est visible par la disposition des lieux, par le meme
ordre, grosseur et hauteur observez dans ce rang de colomnes, il paroit, dis-je, par deux autres colomnes
qui subsitent a une egale distance de ces deux rangs de colomnes a une des extremitez, au milieu
desquelles deux colomnes il doit y avoir eu une superbe fontaine par l’edifice de brique dont les lieux ou
l’eau tomboit se voyent manifestement, il est evident par la disposition de toutes ces colomnes que ce lieu
etoit autrefois une place superbe dont la figure composoit un quarré long, la largeur etoit de deux cens pas,
et la longueur de cinq cens ; il faut croire que les plus considerables palais de la ville faisoient face a cette
place puis qu’immediatement derriere les colomnes autour du coté ou il en reste le plus on voit quantité de
murs de briques les uns renversez sur les autres encor entiers qui laissent juger de la grandeur et de la
beauté des batiments qui étoient en cet endroit ; il est apparent que ces batiments sont du tems des romains
et ces ruines sont aujourd’hui une des plus belles antiquitez de cette ville ; on distingue parmi ces ruines des
bains presque entiers ; on tient icy par tradition que l’endroit ou ces murs paroissent le plus elevez etoit
autrefois le palais du pere de saincte catherine, d’autres assurent que c’etoient des bains publics ; on y voit
encor distinctement quantité de lieux voutez qui peuvent avoir servi a cet usage, dont la place environnée de
colomnes comme nous venons de dire ; subsiste encore aujourd’huy, non pas directement au milieu mais du
coté ou le rang des colomnes est plus entier et une mosquée qui etoit une eglise dediée a sainct anastase
qui est sans doute la plus belle, comme peut etre la plus ancienne eglise qui reste en afrique ; on voit a
travers de plusieurs portes que le quarre long dont elle est composée est environné de quatre rang de
colomnes de porphire admirable ; sur ces colomnes il y a des arcades modernes qui ont été faites ou
rebaties suivant les apparences par les turcs au milieu de cette eglise il n’y a rien du tout qu’une grande tour
pavée de marbre en sorte que si c’etoit là toute l’eglise (car il se pouvoit faire que ce ne fut que la nef) cette
eglise n’etoit composée que de collateraux, a moins qu’il n’y aye eu un dôme qui ne subsiste plus ; il n’y a
rein de beau a l’exterieur, mais s’il nous etoit permis d’entrer je ne doute pas qu’on n’y remarquat mille belles
antiquitez et qu’on y jugeat mieux de ce que ce lieu etoit autrefois on ne voit dans l’ancienne ville que debris
qu’une infinité de colomnes renversées et deux montagnes qui ont eté formées des debris des maisons, il
n’y a pas apparence que ces montagnes ayent eté formées de la terre qui se tiroit des citernes qui regnent
universelement sous la ville et qui sont une des plus belles antiquité du monde.
Alexandrie souterraine n’est pas maltraitée au point que l’est celle dont nous venons de parler, si quelques
citernes ont eté enfoncées ou qui ne soient point entretenues avec la meme propreté qu’elles l’etoient
autrefois, il est certein par ce que l’on voit aujourd’huy et par le temoignage de ce qui y descendent tous les
jours, que non seulement il n’y a rien de plus beau, ni de plus entier que les routes, rien de mieux construit
que leur ouvertures, rien de plus superbe que les pieces de marbre dont elles sont environnées, mais encor
que ces citernes se communiquent de l’une a l’autre par des canaux que l’on pouvoit fermer quand ces
citernes etoient remplies, et que ces citernes ont une étendue infinie, en sorte qu’il se trouve de gens qui
entrent par un bout de la ville sousterre et qui sortent par l’autre, mais cette etendue quelque considerable
qu’elle soit est bien differente de celle qu’elles ont effectivement et de celles qu’elles avoient autrefois car on
trouve une continuation de ces citernes depuis Alexandrie en suivant le rivage de la mer vers l’orient jusques
au beguier qui en est eloigné de cinq lieues et on le trouve de meme deux lieues vers l’occident ; l’on voit
tout un canal souterrain qui regne jusqu’aujourd’huy presqu’entier ; il etoit destiné a fournir l’eau dans les
citernes de la ville qui s’etendoient de ce coté-là et il la recevoit par une branche du Nil qui venoit se perdre
dans la mer a travers Alexandrie. Cette branche du Nil a laquelle on avoit creusé un lit avec une despense
incroyable a travers les vastes deserts de sable qui sont entre le Nil et la ville, cette branche dis-je par
laquelle on voituroit toutes les marchandises d’Alexandrie au Caire, et par laquelle on apportoit l’abondance
et la commodité de la vie qui ne se trouve que difficilement parmi les sables dont elle est environnée ; ce
canal etoit encore en etat il y a trente ou trente deux ans mais aujourd’huy par la negligence des turcs il n’y a
plus d’eau que lorsque le Nil est en sa hauteur ; et si la nessecité que les turcs ont d’entretenir ce canal
d’une maniere qui puisse au moins fournir de l’eau dans cette saison aux citernes d’Alexandrie ne les
obligeoit d’en avoir quelque soin il seroit tout a fait plein en moins de quatre années et alors il faudroit
abandonner la ville qui n’a point d’autre eau que celle-la.
Au-dessus des citernes qui s’etendent si loin a l’orient et au couchant d’Alexandrie qui ont depuis une
demi-lieue jusqu'à trois quarts de largeur, l’on voit partout des montagnes en ruines, on y trouve partout
comme dans la ville et meme en plus grande quantité de médailles et de ces pierres gravées qui etoient
autres fois si communes parmi les romains et qu’ils portoient au doigt en maniere de bagues, ces ruines si
vastes et si etendues font foy de ce qu’etoit l’ancienne Alexandrie et pour moi je suis persuadé que non
seulement la colomne de Pompée et la montagne sur laquelle elle est, qui est a la portée du mousquet de la
ville etoit autres fois dans son enceinte et meme bien au delà ; il est tres facile de distinguer a l’oeil les
endroits qui ont eté batis et ceux qui ne l’ont pas eté, j’estime que soit la ville soit fauxbourg, soit maison de
plaisance contigues il y avoit autrefois sept ou huict lieues en longueur et trois quarts de lieues en largeur
qu’ils etoient batis et habitez, que des ruines d’une ville tant de fois conquise et desolée depuis les romains
par de conquerants barbares, il s’en est construit il y a quatre a cinq cens ans les murs dont nous avons
parlé dans lesquels on enferma ce qu’on put y apporter de plus precieux, qu’il resta cependant dans
l’espace d’une si grande etendue qui fut abandonné quantité d’illustres monuments que la longueur du tems,
l’avarice et la superstition des arabes ont depuis aneantis ; on les voit encore tous les jours abattre des
colomnes a la campagne dans l’esperance de trouver sur la base quelques monoyes qu’ils se persuadent y
etre cachées ; on les a vus dans un tems de peste par superstition briser dans ces memes campagnes une
figure d’un lion aussi belle qu’elle etoit ancienne. Ainsi sont peris insensiblement tant de beaux ouvrages
dignes de l’immortalité et si la colomne de Pompée dont nous allons bientost parler est encore entierement
debout c’est que son poids qui est enorme a eté d’un grand et insurmontable obstacle aux efforts des arabes
pour arracher les fortes pierres sur lesquelles sa prodigieuse base est posée.
De la colomne de Pompée
Ils sont pourtant parvenus a tirer une pierre de celles qui sont a un coin par ou ils nous ont decouvert dans
celle qui suit immediatement des lettres hieroglyphiques qui sont parfaitement entieres par cette ouverture ;
aussi il est aisé de voir qu’au milieu des pierres sur lesquelles la base de cette colomne est posée il y a une
maniere de colomne sur laquelle principalement repose toute la pesanteur de la pierre, l’on y decouvre
meme quelques lettres hieroglyphiques qui doivent regner a l’entour ; une des faces de la base qui est
quarrée, et de marbre granite comme la colomne a quinze pieds de longueur et autant de hauteur d’ou l’on
peut juger du prodigieux poids de cette pierre ; la colomne tient meme naturellement une partie de cette
base par ou elle est plus fortement posée est sans contredit la plus haute et la plus grosse colomne qui soit
dans l’univers et le plus beau morceau qui nous reste de l’antiquité ; il est composé de trois pieces, le
chapiteau en compose une, la seconde fait toute la colomne et meme une partie de la base, et la troisieme
c’est le piedestal, le tout est d’un tres beau marbre granite ou de jaspe d’Egipte, le chapiteau est
proportionné a tout l’ouvrage et est creux au dessus ; j’estime qu’il y avoit une representation et peut etre la
figure de Pompée dont cette colomne porte le nom, il falloit que cette figure fut d’une grandeur extraordinaire
pour etre proportionnée a son elevation : il y a quelques tems qu’un arabe danseur de cordes de profession
trouva moyen par une flesche a laquelle etoit attachée une ficelle de faire passer ensuite par les corniches
du chapiteau une corde a la faveur de laquelle il monta en haut tenant un anon sur les epaules a la vue de
tout le peuple d’Alexandrie, c’est de luy que l’on a appris que le chapiteau etoit considerablement creusé ;
toute la colomne, la base et le chapiteau a cent vingt huict pieds de hauteur au raport de diverses personnes
qui l’ont mesurée ; un françois fort exact m’assure qu’elle a quatre vingt dix pieds entre le chapiteau et la
base, quatre hommes pourroient l’embrasser avec peine ; cette piece est aussi saine et entiere que si elle
avoit eté exposée de notre tems, et peut etre y est-elle depuis deux mille ans, on l’aperçoit de la mer
longtems auparavant de decouvrir la ville d’Alexandrie.
Voici les observations qu’on avoit faites pour abattre et embarquer cette colomne dans les vues que l’on
avoit de la transporter en France.
On suppose que Mr l’Ambassadeur obtiendroit cette colomne du grand seigneur et que sa hautesse voudroit
bien en ce qu’on luy proposeroit de la part du roy ; je suis assuré qu’un capigi bachi ayant un catecherif
soutenu a la marine d’un ou deux vaisseaux du roy et aidé de quelques liberalitez ne trouveroit icy aucune
opposition ni dans le grand divan ni dans le peuple d’Alexandrie ; il est hors d’exemple que les catecherifs
du grand seigneur trouvent de resistance quand de veritables motifs du bien public ne peuvent leur etre
opposez, mais pour aller au devant de toutes les difficultez et prendre dans cette entreprise une indubitable
voye pour le succez, on propose que Mr l’Ambassadeur ayant obtenu la colomne demande un catecherif
adressé au Pascha et aux puissances d’Egipte par lequel le grand seigneur declare qu’ayant envie de faire
venir cette piece a Constantinople et Monsieur l’Ambassadeur ayant bien voulu prometre de le faire abattre,
embarquer et transporter, il donne ordre qu’il soit accordé toute sorte de secours et de protection a cette
occasion sans exiger la moindre chose ou pour rendre cette declaration plus reelle, charger le pascha de
faire compter les sommes qu’on luy demandera, lesquelles M. l’Ambassadeur s’obligera en son particulier de
payer au tresor du grand seigneur ; le capigi baschi devra avoir ordre de ne communiquer le secret a
personne pas meme au pacha que la colomne ne soit hors du port et alors il pourra montrer un second
catecherif pour la faire conduire en France et affin d’engager d’autant plus le capigi a la diligence et au
secret ne luy promettre le surplus de la recompense dont on conviendra avec luy que lorsque la colomne
sera embarquée ; il est sans doute que si ces ordres sont donnez de cette maniere et qu’un capigi de
confiance en soit chargé bien loin de trouver icy la moindre opposition il n’y a sorte de secours qu’on ne
donnat puisqu’on croiroit rendre service au grand seigneur, cela epargneroit aussi considerablement au roy
pour les ouvriers qu’il faudroit employer et les recompense dont il faudroit toujours bien gratifier les officiers
de la ville d’Alexandrie et meme quelques uns du Caire puisqu’on seroit obligé de les traiter tout autrement
s’ils etoient persuadez que leur travail et leur soins regardassent la satisfaction du roy et non celle du grand
seigneur ; il seroit a propos pour la meme raison que les ingenieurs et la plu-part des officiers qui seroient
chargez de venir a Alexandrie pour cette entreprise soit aussi persuadez que cette colomne est destinée
pour la porte, et que ce secret fut en moins de mains qu’il seroit possible voicy ce que le capitaine Esprit
Reynaud de Marseille fort ingenieux pour les grandes entreprises m’envoya il y a quelques années
d’Alexandrie sur les moyens d’embarquer cette colomne.
« Il faut quinze perches de deux pieds de large et de la hauteur de la colomne pour l’entourer affin qu’elle ne
puisse se casser ; quatre mats de la grosseur ordinaire pour des echafauds pour trinquer les dites perches
qui seront mises autour de la piece non seulement avec des cordes mais avec de cercles de fer ; un cable
de la grosseur de cinq ou six pouces de la longueur de cent cinquante a deux cens brasses ; il faudra faire
un pont de pierre depuis le ferme de la terre jusqu’au pied d’estal pour pouvoir en dedans la creuser tout
autour ; il faudra faire un pont de pierre comme je l’ay dit et une montagne de terre du coté qu’on jugera a
propos de la faire tomber meme après qu’on la pourra faire insensiblement coucher sur ladite hauteur ;
quand la piece sera couchée sur cette terre mouvante il faudra faire en façon de la remettre sur la ferme ; il
faudra trois grosses pieces de bois pour servir d’anguiles comme quand on veut mettre un vaisseau en mer
pour pouvoir faire courir ladite piece avec quatre capestans jusqu’au port vieil parcequ’on ne peut approcher
la mer que de ce coté là, il faut faire un chemin depuis ladite piece jusqu’au dit port qui soit tiré en droite
ligne ; il faut faire un mole et l’avancer dans la mer tout autant qu’il sera necessaire pour que le vaisseau
puisse aborder pour l’embarquer ; il faut un vaisseau du roy des plus gros qui soit armé de quatre a cinq
cens hommes, tout matelots choisis et gens de travail, il faut pour soutenir les travailleurs un nombre
suffisant de milices du pays quand a la depense je ne puis pas vous en parler au juste parce qu’elle me
paroit considerable. »
Voilà ce que le capitaine Reynaud m’ecrivit et comme c’etoit un homme qui, ainsi que je l’ai deja dit avoit un
genie particulier pour les grandes entreprises, il ne faut pas douter que les moyens qu’il prescrivit pour
embarquer cette colomne n’eussent un heureux succez dans l’execution d’un pareil dessein. »
- 582 - 585 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN AEGIDIUS VAN EGMONT (1720-1723) ET JOHANN HEYMAN (1700-1709)
Aegidius van Egmont, J. et Heyman, J., Travels through part of Europe, Asia Minor, the Islands of the
Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai, Londres, 1759.
Aegidius van Egmont (1697-1747) est envoyé par « the United Province » à la cour de Naples. Entre 1720 et
1723, il visite le Levant. Quant à John Heyman (1667-1737), professeur des Langues Orientales à
l’Université de Leyde, il voyage dans le Levant entre 1700 et 1709. Dans le texte publié, il est impossible de
discerner la part de chacun d’entre eux car les deux récits ont été combinés ensemble par l’éditeur, neveu
de John Heyman. De plus, ce dernier aurait inséré des passages empruntés à d’autres voyageurs sans citer
ses sources. À noter qu’au cours de leur périple, les deux voyageurs relèvent de nombreuses inscriptions
grecques.567
p. 118-142 (tome II) :
« We left Rosetta at break of day, and after passing trough a wood of palm trees, we came to a fandy plain,
not having a single tree in it ; and where the traveller would often lose his way, by the perpetual shifting of
the sand, were it not for several round towers, about twelve feet high and three in diameter, built within fight
of one another, by which the traveller is directed to the sea-side. But after travelling about one hour on this
plain, we met with a refreshment which merits the thanks of all who travel over this desert. It consists of three
large jars full of excellent water. They stand under a cupola of stone supported by four (p. 119) brick pillars.
This water is brought fresh every day from Rosetta on mules.
After our arrival on the sea-shore, we travelled along it till we were about midway, where there is a large but
very different caravansera, called meidia, situated on an arm of the sea, which you here ferry over. In this
building the ferryman and his servants live, in order to attend travellers. And this is the only place on the
whole roadwhere you can pass the night ; though it is none of the safest, on account of the frequent
robberies commited in this country by the Arabians and Bedouins. Every stranger for himself and mule pays
nine paras, about sixteen pence sterling, for passing over. The water of this arm of the sea is salt, except at
the time of the inundation of the Nile, when it’s perfectly fresh.
After passing this creek, we continued our journey for some time along the coast, and then turned up the
country, leaving on the right, Bequier, a village and castle, before which, during the summer, is good
anchoring for ships, and is thence considered as the road of Rosetta. In the mean time, that we might omit
viewing no object that deserved attention, we approached the castle, in order to survey it and the road more
attentively.
It lies about twenty-one miles N. E. of Alexandria, and is sheltered from the sea by small uninhabited island,
having on it neither water nor tree. The castle, which commands this road, is built on the point of a rock
projecting into the sea, and about three miles from the island. It is an irregular and ill fortified quadrangle. In
the center of it is a large round tower pretty lofty, the top of which serves for a light-house.
This castle has a battery of eight brafs cannon, from four to six pounders ; but the works in no better
condition than those at Rosetta. The embrasures are about half the height of the wall, and under them a
(p. 120) masked battery level with the water’s edge. The wall is about eighteen feet high, and eight or nine in
thicknefs ; but in several places wants repairing. The entrance of the castle is on the west side, over a
draw-bridge ; for the whole fortification is surrounded by a moat near thirty feet wide and twelve deep. The
garrison conflits of about twenty-five Arabians, to whom the Governor allows free quarters, on condition, that
on the firth signal made by the castle, they immediately repair to their duty. The inhabitants of the village also
do the same.
These parts are entirely destitute of wood, so that the inhabitants of the village are obliged to purchase it of
ships coming from Constantinople and Natolia. But this is generally done by way of barter, giving in
exchange horned cattle, game, &c. which they have in plenty ; but vegetables of all kind are very scare.
The next morning early we arrived at Alexandria, having left on our right hand the ruins of an ancient
structure, which we were assured was once the palace of Catharina’s father. We entered Alexandria
thro’ one of the gate of the old city, called Rosetta gate, where three medins were demanded of each. After
passing through the old city, we came to another gate leading to the new city, built between the old and the
new harbour.
Here we took up our lodgings with Mr. Thomas Hume, secretary and vice-consul to the English nation. He
resided in a kane, where several French merchants also had their quaters. There is likewise another building
of the same kind for the French vice-consul, where several other merchants of the same nation reside, and
have in these kanes very convenient apartments.
Alexandria, formerly the strongest and most considerable city of all Egypt, and still by the Jews called
No-Ammon, has now, like many other in the east, totally lost its ancient splendor, and would probably have
been long since lost and buried in oblivion, had not the conveniency of its harbour for trade and navigation
supported its tottering condition, and left it considerable remains. The old city however is little the better for it,
the whole terminating in the new, which has been built on the sea-shore, without the wall of the former. It lies
in a level sandy country : On the north is a very beautiful port, defended by two forts built on each side of this
entrance ; and on the south side is a lake Mareotis, about five hundred toises from the city. The old port,
which lies on the west of the city, is one of the best in all the Mediterranean : The two ports are separated
only by a peninsula, is a sort called the great pharillon, of which I shall speak further in the sequel.
This peninsula appears to be the ancient island of Pharos, which lay before the port, and was, by Cleopatra,
joined to the continent ; and on it, in the time of Ptolemy Philadelphus, was the celebrated Pharos, a tower of
white stone, built by Sostratus Gnidius, to serve as a light-house, for the safety of mariners ; and from
whence the light-houses, among the Greeks and Latins, were called Phari ; and probably the modern
Turkish and Greek words Fanar and (en grec), are derived from the same source, as they signify a beacon,
or lantern.
This city, whole circuit is not small, for it took us up an hour and a quarter to ride round it, was inclosed by a
double wall, faced with free-stone. These walls consisted of curtains and large towers, with smaller between
them, to the number of sixty or seventy, and mostly square, though some were round, and others oval. They
had also in general three stories, and each several apartments, which in my opinion, would hold some
hundreds of soldiers for the (p. 122) defence of each. They had also loop-holes all round, according to the
manner of the ancients.
These walls were very firmly built, and six or seven feet thick, and in some places surrounded with a moat
about seven toises in breadth, but at present quit filled up. There were, however, no outwoks of any kind to
hinder the approach of an enemy. On the south side of the city great part of the inward wall is still remaining ;
it is five or six feet higher than the outward, and the space between them twelve feet. The inner wall has also
small round and square towers, like the outward. But the far greater part of both these walls is now entirely in
ruins, not being kept in the least repair.
Possibily it may be thought, that these walls were built by Alexander the Great, who changed the name of
this city into Alexandria, is original appellation being Leontopolis, from the figure of a lion on the signet with
which, according to Philip’s dream, the womb of Olympias was sealed. But these walls do not appear to me
to be so ancient ; for first, the very architecture of them seems more modern : secondly, we read of an
earthquake, by which this city was entirely ruined ; and thirdly, the circuit of these walls is not of an extent
answerable to the descriptions left us, by the ancients, of this celebrated city ; as after the destruction of
Carthage it was, next to Rome, the largest city in the known world. These reasons induce me to differ from
some respectable antiquaries ; and to consider these walls as a work of the Saracens or Mammelukes.
In the mean time, the whole space within the walls and towers is now almost entirely forsaken, most of the
inhabitants having retired into the new city, which is erected on the spot where the ancient suburbs stood ;
namely, on the peninsula which separates the two ports. This city confines (p. 123) on the south side on the
walls of the old, but towards the sea it has no other defence than the two castles at the entrance of the port ;
and these are badly provided for making any long defence, as will appear in the sequel. The houses are in
general better built than in most other Turkish towns ; but in very thing else it nearly resembles them. Most of
the Franks live in kanes, here called okel, and which are all stately edifices. However, one great
inconveniency in this new city, is the want of water, which the inhabitants are obliged to setch daily from the
old town, in luders, i. e. ox or buffalo skins, on camels or asses. And this, I think is a sufficient proof, that in
ancient times this part was not inhabited ; as otherwise it is natural to think, reservoirs would have been
made here as in old Alexandria.
Three of the gates of the old city are still remaining in tolerable condition ; and these are every night locked
in presence of the commander of the fort, called the Great Pharillon ; but no guard is placed for their security.
Near the Rosetta gate is a long street, inhabited by three hundred and fifty families of tradesmen ; and on the
south side of the city, near the pepper gate, is a small street, still called Bazar, inhabited by about forty or fifty
families. There is also a third gate on the north side of the city, at the end of a little street, called also Bazar,
where, not long since, about twenty families resided. The Venetian consul, at that time, had also his house
there ; but at the present it is altered into a handsome convent belonging to the fathers of the Holy Land ;
and near it are also some remains of shops.
At present, the inhabitants of the city of Alexandria, who are native of the country, do not exceed six
thousand ; besides which there are about sixty Christian families, sixteen of whom are Roman Catholics. And
among these inhabitants, two thousand (p. 124) and five hundred are able to carry arms ; tho’ seven
hundred only receive pay from the Grand Signior, as doing duty in the city and castle, exclusive of a hundred
janizaries under a soubasci, who also receive pay ; but are ill disciplined and badly armed, most of them
having only a sabre and lance ; but no fire-arms, not even pistols.
The magistrates of Alexandria are foreign Turks, nominated by the Pascha of Cairo for governing this city ;
but are generally an abandoned set of men, given up to sloth and licenciousness, and whose chief study is
to squeeze the people committed to their care.
The air of Alexandria is so salubrious, that Celsus mentions it as a common rule among the physicians, to
send their wealthy patients, labouring under a consumption, to Alexandria ; and Curtius says, Nullo fere die
Alexandriæ solem serenum non videri propter aërem perpetuo ibi tranquillum, i. e. There is not a day in
which it is not fair weather at Alexandria, the air being there constantly calm and serene.
The seasons of the year are but little different from those of Italy and Provence ; but the cold is less, and the
heat considerably greater. The rains generally begin in the month of November, and last till February ; but
instead of being violent, they are very gentle and pleasant. As to the winds, which here, as in most countries,
prevail principally in the winter, are the north, north-west, and south-west. At the beginning of the year, and
in autumn, these winds are also common, but blow with less force, and towards evening very little is to be
felt. Sometimes the north-east wind greatly moderates the excessive heats ; but the most convenient season
for visiting Alexandria is in spring, or, at farthest, in the month of May ; for by that means, both the rains and
extreme heats will be avoided.
I have already observed, that this city has two ports, the new, on the north side, and the old on the west. The
latter is thought to have been formerly larger than at present, the sea being retired, as appears from several
broken pillars in it ; and some will have it, that the spot, on which the new city stands, was formerly covered
with the sea, which almost touched the walls of the ancient city. But this port is still spacious, and defended
by two castles, called the great and little pharillion. The former is situated on a neck of land, on the west side
of the entrance of the port ; but is both irregular and badly fortified. In the middle of this fortification is a large
square, having at each angle a small round tower, and raised about six feet above the outward ramparts. In
the center is a very high minaret, or tower, serving as a light-house, for directing ships into the port in the
night.
The outward walls seem to be in very bad repair ; they are about eighteen feet in height, and ten in
thickness. Near the foot are about forty port-holes, for shouting parallel with the surface of the water, but
were close shut, so that no gun appeared ; tho’ I was assured the fort was well provided with ordonance.
Through ports about the middle of the wall I saw twelve-pounders ; and the parapets, both of the outward
rampart and the square within, are covered with tenter-hooks, and full of loop-holes.
The castle called the little Pharillon is erected on a small island at the entrance of the port, facing the great
Pharillon. It is only a mosque defended with a few iron guns, badly mounted, and round the mosque are a
few mean houses.
It is possible to tell the precise number of canon in these two castles, no person, except the Turks of the
garrison, being allowed to stay long enough in them to take a particular view. And these, it is natural (p. 126)
to suppose, are commanded to observe a strict silence, with regard to thier state of defence ; which,
however, is suppose to be none of the best, either with regard to stores, or the discipline of the garrison.
Provisions and ammunition also are not very plenty in these fortifications ; though these could, on occasion,
be readily procured, the city being at no great distance, and the powder magazine close to the walls.
The mouth of the old port has no fortification to defend it ; for the two ruinous forts at his entrance do not
deserve that name. They are, indeed, garrisoned by four or five men ; and a few small brass pieces are
pointed through apertures in the wall of the old city, but are not in condition to fire a shot. Nor is a mosque,
which has been turned into a battery, from its convenient situation near the old port, of much more
consequence.
At the mouth of this port are several rocks, which break both the force of the current and the waves. But
when the wind blows from the shore, ships must be very careful. The bay itself, however, is very convenient,
and not inferior to the best harbour in the whole Mediterranean ; and for this reason the Grand Signior’s
ships lie here, seven of which were in this port, when we were at Alexandria. They ride in eight fathom water,
about a pistol-shot from the land. The bottom also is very good ; so that they are safe both from winds and
sea.
Christian ships are not allowed to ride here, not even to enter the port, unless driven thither by stress of
weather ; and then, as soon the storm is over, they must immediately put to sea. This is entirely owing to
certain prophecies, that the Christians will, at some particular time, (enter the old port, and make themselves
masters of the city. And hence (p. 127) it is, that we have no complete draught of this port, and the depths of
water in it.
The French nation, however, are said to have obtained lately from the Porte, liberty for their ships to come
into this harbour, and ride there as long as they pleased, under pretence, that they could ont lie in the other
harbour, without great danger ; but their real intention was, to ship more easily clandestine goods, as corn,
rice, and other provisions, of which they were, at that time, in the greatest want. The people of the city,
however, openly opposed their lying in this port, notwithstanding the emperial licence ; for it must be
remembered, that the Egyptians pay no farther regard to the Grand Signior’s orders, that suits with their
humour.
As this harbour is in no state of defence, it would be very easy to make a descent close to the suburbs, there
being a sufficient space for landing the troops. Nor would the city be capable of defending itself any time ; for
the Arabians, who are miserable soldiers, would, on a few bombs being thrown into the place, betake
themselves to flight, and leave the army at full liberty to execute their designs.
With regard to the entrance of the new port, it is on the north side something dangerous, on account of the
shallows at the mouth of it. On coming in, at about a cable’s length from the great Pharillon, and close by a
rock called the Diamond, you have twelve fathom water, and from thence you must stand directly for the city
gate, till at a proper distance from the shore, where you will find good anchoring-ground. About two cables
length E. N. E. of the Diamond, is a very dangerous shoal, having only six feet water on it. The
merchant-ships generally come to an anchor near the great Pharillon, in four or five fathom water, being
there secured from the north and north-east winds, which are here the most dangerous ; not only blowing
with great violence, (p. 128) but at the same time causing such a hollow sea, that it is hardly possible to go
on shore in a boat ; and the cables are in great danger of being cut by the sharpness of the stones at the
bottom.
There is no wood here, except a few palm-trees ; so that they are obliged to fetch it from the coast of Natolia
and the Black-Sea, which renders it extremely dear. Fodder for beasts is likewise so very scarce, that it
would be impossible to subsist a small body of horse here a fortnight.
The Arabians of Barbary, called Magrebins, are continually at war with those of Egypt. They always appear
extremely well mounted, and armed with swords and long spears ; but seldom with fire-arms. They are
likewise very vigorous and hardy, but ill disciplined ; though better than those of Egypt. These two Arabian
tribes, however, if at peace between themselves, would be able to bring an army of ten thousand men into
the field, and, consequently, to defend the coast of Egypt.
From what have been said, the reader will naturally conclude, that few refreshments are to be expected at
Alexandria, except such as are brought from Rosetta, and the adjacent villages. The trade, however, is pretty
considerable. The principal exports are sugar, rice, lintfeed, all kinds of grain, linen, salt, cassia, the hides of
buffaloes, oxen and camels, safflower, frankincense, gum-arabic, elemi, myrrh, salammoniac, and other
drugs, dimittes, cotton, and coffee ; but the latter is prohibited to the Franks ; so that they must give large
bribes, if they intend to procure a large quantity of it.
Here are also palm-trees ; but the exportation of them is also prohibited, as well the parts of them are applied
to some use : The leaves are used in making cordage and baskets, the small branches for lattice-work
before the windows ; the wood for building of (p. 129) houses ; the ship for fuel ; and the fruit, which is very
palatable, for food. But to procure fruit, it is necessary to plant the male trees near the female, that the
blossoms of the latter may be impregnated with the farina of the former. In the forests of the palm-trees,
which often extend several days journey, you will generally fee but one male to numbers of female trees ; but
the wind dispersing the farina, or maledust, fructifies them all.
Before I proceed to describe the antiquities in Alexandria, I shall mention an experiment that had been often
told us, namely, that by mixing flour with water, and placing it in the evening before a window, wether open
or shut, the flour, during the night, would serment as if mixed with yeast. This phænomenon is supposed to
be owing to the dew, that, in these parts, begins to fall about the sixteen of June, when the plague, which is
very common here, generally ceases. And it was on that day we made the first trial, and continued it for
several days, the effect being contantly the same, as we had been told.
I shall now proceed to the antiquities, among which, in the old city, is an assemblage of ruins, called
Cleopatra’s palace, consisting of large arches, prodigious fondations, and scattered fragments of pillars. But
all these ruins, which are considered as so many superb remains of antiquity, do not answer the idea which
we conceive from reading the accounts of historians relating to that magnificent princess ; so that I much
question, whether her palace did not stand in some other part of the city.
Here are also two beautiful obelisks of granite, one being still standing on its pedestal ; but the other thrown
down and partly buried under the earth. In the first it is observable, that the sides facing the north-west and
south-west are best preserved, and still present the spectator with a distinct view of the (p. 130) ancient
hieroglyphics : while, on the contrary, notwithstanding the hardness of the stone, the north-east and
south-east sides are extremely damaged, large scales falling from the stone ; si that there is no
distinguishing the characters.
The obelisk still remaining on its pedestal, is fifty-four feet above the surface of the ground, and about twelve
beneath it. The pedestal is a flat square plynthe, eight feet on each side, and six in depth, formed out of a
single block of greyifh marble, or granite, and projects fourteen inches on every side beyond the base of the
obelisk. This obelisk is greatly injured by time, espacially near the base. Some are of opinion, that it is only
fifty-seven feet high ; and that no more than three are buried under ground : And all agree, that it was
brought thither from other place.
Near this supposed palace of Cleopatra is a tower of a stupendous magnitude, and remarkably bold
architecture. You first enter into a large hall, the ceiling of which is supported by two large pillars, and on the
capitals of them several Greek inscriptions ; but the injuries they have received from time, and the great
height of the ceiling, render it impossible to transcribe them. In this hall was also a reservoir, but at present
full of rubbish.
From this hall we ascended, by a flight of free-stone steps, into another room, the roof of which was nearly
flat, but without any thing to support it, except the side walls. Another flight of steps led us to a terrace, from
whence we had a beautiful prospect of the city, and the sea.
This structure, which was of the tower erected on the walls of the ancient city, is built of very white and
smooth circular stones, and the interstices filled up with small round pebbles, about the size of a farthing.
The intermixture of small stones, which are a kind of marble, and supply the place of cement (p. 131) or
mortal, renders it probable, that they are of that kind which the ancients made by fusion ; for it plainly
appears, they are of a singular composition. Between the large blocks of free-stone in this building is
surrounded with a high wall, without any aperture except the door, in order to secture it from the
depredations of the Arabians. In this convent are the church and the cells of the religious, of which there are
about ten, with nearly the same number of Christians under them, exclusive of foreigners, who come hither in
ships. Thus has the Almighty manifested his judgments against No (c) ; for the particular church of
Alexandria lies even in the dust.
This convent is the residence of the Patriarch of Alexandria, whiles he continues here ; but for some years
past Alexandria had not been suffered to enjoy this satisfaction, the prelate being obliged to reside at
constantinople. The epitropus, or vicar, received us with great courtesy, and accompagnied us in person to
the church dedicated to St. Catharine. This structure is much more spacious than the generality of Greek
churches in this country, which are indeed, for the most part, little more than caves, and subterraneous
recesses. The religious shewed us here in a chest, a block of white marble, in the form of a pedestal, having
on the top of it a cross in basso-relievo ; and pretended, that St. Catharine was beheaded on this stone ; and
in confirmation of this legend, shew some black specks, which they will (p. 132) have to be marks of her
blood ; and also, a cut in the stone, done by the axe. But notwithstanding these pretentions of the monks, it
is evident, that this stone is a counterfeit ; for the cross is square, after the manner of the Greeks ; and on
each side of it, two small pillars. Yet hither the poor Greeks come to kiss it, and to lay pieces of linen on it,
which are considered as very efficacious against all kinds of diseases.
Soon after, being in conversation with the vicar and the other religious, I told them, I had long desired to see
the patriarchal church of Alexandria ; but they answered, that its splendor was extremely obscured. On which
I took the liberty to say, that the introduction of superstition and idolatry into the churches of these countries,
and their obstinate perseverance in such practices, contrary to the divine admonitions, had induced
providence to remove the candle-stick of the gospel from hence into Europe. As they did not seem angry at
what I said, I ventured to touch on the worship of saints, and the paintings and imagery in their churches,
shewing the impropriety of them from the sacred writings. But all the answer I received was, that they only
followed the exemple of their predecessors.
Near this church is another, dedicated to St. George, and on the left a chapel, where the fathers of the Holy
Land are allowed to celebrate mass. Not far from hence we saw a ruined building of the ancient Franks, or
Italians ; and hard by the convent and church of the Succolanti, which have hitherto continued in the
possession of a few fathers, who perform divine service after the manner of the Roman church ; but at the
same time may be said to be in a prison ; for the buildings are inclosed with a very high wall, and they are
obliged to keep a constant watch at the door, to secure themselves from the Arabians.
(p. 133) We also walked to the old city, to visit the church and convent of St. Mark, now in the land of some
Coptis, or Coftis, i. e. Egyptian Christians. This church, like the former, is surrounded with a wall without any
aperture except the door. The church itself is only a small dark grotto, tho’they take great pride in shewing
several pictures of the blessed virgin, which they pretend were pained by St. Luke, and particulary a portrait
of the evangelist St. Mark. The religious belonging to this church, though not more than four, were equally
remarkable for their poverty and ignorance. They earnesty begged alms of us, and in return shewed us, on a
small altar, the head of St. Mark, or rather the casket in which it is said to be preserved. In this church we
were also desired to observe a large pulpit inlaid with pieces of fine earthen-ware, and which they affirmed to
have been the same in which St. Mark often preached. They likewise shewed us an arm of St. George, and
a whole length picture of St. Michael, pretended to have been done by St. Luke.
We also went into one of the towers on the city wall, where we found several chambers still entire, and
probably served as barracks for the soldiers. Here is also a large structure, said to have still witin it stately
piazzas of corinthian pillars ; but Turks only are permitted to enter it. Nor is it safe for a Christian even to
come near the walls ; so that nothing can be said of it with a multitude of cupulos supported by pillars. It is
added, that in it is a chest which no man can approach, at least not open, there being several instances of
persons, who, on attempting it, have dropt down dead ; and hence it is, that the Turks keep a guard on the
out-side of this building, and allow none to enter it, on any account ; for we (p. 134) made a very handsome
offer to be admitted, but were refused.
The Jews, from whom we had the above account, will have this to be an old temple built by Nicanor for the
Jews, who fled in multitudes to Egypt, from the cruelties of Nebuchadnezzar ; and this they pretend to prove
from a certain passage in their Talmud. But with regard to the dangerous chest, they acknowledge
themselves entirely ignorant. Others are equally positive, that it was a church to St. Athanasius.
Not far from this structure are two large pillars of granite still standing, and others lying on the ground, and
half buried under the ruins ; but none have any capitals, though it is easily seen, that all their parts are in true
proportion. Some suppose there was a street here, adorned on each side with piazzas, while others think
them to be the remains of Cleopatra’s palace. Near these are also some ruins of structures built with bricks ;
the space between them lies in a direct line, and is of a considerable lengh and breadth.
We next visited some of the reservoirs, or cisterns, which are extended under the greatest part of the ancient
city. You enter them through apertures made in the walls. They are all covered with arches supported by
pillars. The form and architecture of them are very curious, and deserve the attention of a traveller ; but they
are not all of the same dimensions. One of them was remarkably capacious, and its arched ceiling supported
by fourteen pillars. Others we saw which consisted of three ranges of arches on each other, after the manner
of the ancient aqueducts. But the greatest part of these cisterns rested on pillars ; so that old Alexandria
might have been said to have been built on pillars. These cisterns had formerly pipes, or conduits, by which
they communicated, and through which the water flowed (p. 135) from one to another : But at present, the
greatest part of these conduits are stopped up, and many of the cisterns themselves ruined by the falling in
of the arches over them. Other cisterns are also frequently found here by digging ; and the discoverer is
intitled to a reward, as the water of the Nile will keep a great while in these subterraneous reservoirs.
With regard to the manner of conducting the water into them, it is as follows : When the Nile has reached its
proper height, they cut the banks, in order to lay the lands of Egypt under water, when a current of it is
conveyed from Cairo to Alexandria by a canal, formerly one of the mouths of the river, and called Ostium
Canopium ; but by the negligence of the Turks, the river has lost that channel ; a circumstance not to be
wondered at, as the Nile has no strong current in these parts, the whole country being nearly level. And
hence it is, that the Nile hereabouts has no falls like the rivers of Europe.
The water of that branch, or canal, running from Cairo to Alexandria, is conveyed into the large cisterns by
subterraneous passages, and from them, by wheels, thrown into the smaller, which were, in all appearance,
originally constructed for the use of private houses ; and in these the water is kept during the whole year.
In the old city is an eminence called Belvedere, which very well deserves that name for its beautiful prospets,
extending over the whole harbour, and on the west side over a cape, noted for the burial-place of a Turkish
santon, and near which the ships generally sail when they enter the harbour, in order to avoid the many
sunken roks lying at a greater distance from the shore. Hence we have also a view both of the new city and
its harbour, and also a part of the old, some of it being concealed by St. Catarine’s hill. But amidst all these
delighful prospects the ruins and confusions of this city, anciently so (p. 136) famous for its splendor, fill the
mind with melancholy reflections : The new city, which has been built out of the ruins of the old, not being
comparable to it. The most beautiful particular in the latter is, a large aera of mosque, in which, among other
remarkable objects, is a colonade of exquisite pillars of the Corinthian order, running round the mosque.
In our return we saw, near the wall of the old city, a large bason, into which the water runs from the city
canal, and from whence it is setched in goarskin bags, on camals, for the use of private houses. We also
entered a tower on the city wall, which had a grand aspect, and found in it room sufficient for five hundred
men, and on the top of it a temple decorated with a great number of elegant pillars.
We next visited Pompey’s pillar, the khali or water canal, the lake formerly called Palus Mareotis, and the
catacombs. With regard to the column commonly called Pompey’s pillar, it stands on a sandy hill, not far
from the pepper-gate, and is seen at the distance of three leagues at sea. This piece is an astonishing work,
and is, indeed, the largest in the whole word, standing still entire on its pedestal ; and the capital and base
included is ninety-one, or, according to others, ninety-four royal568 feet high. The pedestal is eighteen feet
high, and its solid content eighteen hundred and twenty-eight cubic feet. The shaft itself is sixty-nine feet
high, and its solid content three thousand three hundred and forty-seven cubic feet. So that the solid content
of the whole pillar, pedestal, and capital, is five thousand six hundred and sixty-three cubic feet. And the
weight of it two hundred and fifty-nine tons, eighteen hundred, three quarters, and seven pounds, English.
The whole is (p. 137) placed on a foundation five feet square, and every side of it decorated with
hieroglyphics ; but it must be observed, that these figures are inverted, which sufficiently demonstrates the
falsity of the opinion of those who will have these column to be a work of the ancient Egyptians ; and, on the
other hand, renders it very probable, that the stones were taken from old Egyptian ruins, and coverted to this
use by the Romans.
This pillar is of the Corinthian order, and is the largest I ever saw standing, though its basis has suffered
considerably from the rude hands of some begoted Arabians, who supposed there were treasures concealed
under it. It is surprizing how a stone of this enormous bulk (for the whole shaft is formed out of one single
piece of granite) could be brought hither. Some will have it, that it was hewn on that very spot : Others are of
the opinion, that this, as well as the rest of the memorable columns formerly erected in this country, were
taken from the quarries in Upper Egypt, and brought down the Nile ; but how prodigiously large must that
vessel or float be, that was capable of bringing down such an enormous weight. And hence some have been
led to imagine, that the ancients, and particularly the Egyptians, were possessed of the secret of making
stones by fusion, equal, if not superior, to the most beautiful marble. But this is strongly opposed by others.
On the east side of the pedestral are some Greek letters, the remains of an inscription, but so greatly
obliterated as to be absolutly illegible. Father Sicard, however, from the remaining letters, thinks the purport
of it is, that Pompey was murdered there in the reign of Ptolemy and Cleopatra.
Near this pillar are the fondation and stately ruins of an ancient structure, which some affirm, but for what
reason I know not, to have been Cæsar’s palace.
(p. 138) We next proceeded to the khali, or canal Canopus, about two miles south of the city, where it
communicates with the Nile, at the time of its inundation. Thro’this canal the water is conveyed into the
cisterns of old Alexandria above described, and also into the vast bason at the foot of the wall.
This canal was anciently kept in better repair than at present, the inhabitants being then sensible of the great
advantages they reaped from it. And it appears, from some remains, that the sides of it were cased with
stone ; but it was now almost dry and vast numbers of cucumbers were growing in it, some of which we eat,
and found them very palatable. Along the sides of this canal are several cultivated spots, covered with
verdure during the whole winter. This country is very beautiful, and tolerably cultivated by the inhabitants of
Alexandria ; and would they take the pains to keep the canals and fosses which convey the water of the Nile
from the khali to different parts, in good repair, they might have a sufficient quantity of land, which would
amply reward them for whatever pains were taken in its cultivation.
Over this khali is a bridge of one arch, which we passed, and after walking some time on the opposite bank,
turned off to the left, in order to take a view of the lake anciently called Palus Mareotis, which we were told
was not less than twenty Italian miles in lenght ; but all we saw in it was a small quantity of stagnant water in
a marshy soil, which often renders the air of Alexandria unhealthy. Nor do I see how it can, with any
propriety, be called a lake, unless at the time of the overflowing of the Nile.
The banks of it were formerly celebrated for vineyards, which produced that noble wine mentioned by
Horace ; but at present, no trace or vestige of (p. 139) them is remaining. Possibly the soil, during such a
long succession of ages, may have greatly changed its nature and properties.
After crossing over the canal, which in this part was quite dry, we arrived at the catacombs. These are
subterraneous apartments hewn in the rock, and were used by the ancients for burial-places, having three
ranges of niches on each side over one another, and each large enough to hold a coffin. These are
separated from one another by small chambers, communicated with each other, and extending to a very
great distance under ground. The rock in which these subterraneous grottoes are hewn, being soft, many of
the chambres are full of ruins. At the entrance are still some remains of steps hewn in the rock ; and
doubtless these places were formerly very magnificent. On the north side of the city, near the sea, are also
several catacombs, but not to be compared with those above-mentioned ; and near them are several
remains of palaces, statues, sphinxes of black marble, and the like ; but all at present thrown down,
mutilated, and forming one confused heap of ruins.
After wandering for some time along these catacombs, each having a light in his hand, and proposing to go
to the extremity of them, we were called by our peasants, who formed a guard without, some Arabs armed
wit muskets and lances being at a distance, and preparing to attack them. At this we immediately left these
subterraneous grottoes, ranged ourselves behind a piece of a wall, which served as a parapet, and sent two
of our peasants to know there intentions. They told them, that they only intended to beg some powder of us ;
but instead of furnishing our enemies with arms against ourselves, we retreated towards the city, and they
followed us at a distance ; but we retired in such (p. 140) good order, taking care to keep beyond the reach
of their lances, that they did not offer to attack us.
This instance may serve to shew what safety is to be expected in Egypt, or even in the very neighbourhood
of Alexandria. You cannot indeed reckon yourself safe even in the city itself ; the extreme poverty, the
vicious dispositions of the people, and the bad governement, inducing most of the lower class of inhabitants
to turn robbers, on any favourable opportunity. Most of the present inhabitants of Alexandria are a mean,
depraved set of mortals. And a midina, which does not greatly exceed our penny in value, will induce them to
undertake very slavish employments ; but when they come to receive their wages, they express their
discontent in so an outrageous a manner, that a foreigner, to free himself from such disagreable company,
and the apprehension of their malice, commonly makes an addition, which is the very thing they want ; and
this is their general practice in every part in Egypt.
The commonality in general here make a very wretched appearance. Their bodies, which are so prodigiously
tanned, that the negroes and Moors look much better, are covered only with a blue linen shirt, reaching to
their ancles, and teh sleeves very wide. The women, if possible, make a worse appearance than the men :
Their whole dress consists of a pair of drawers, and a sort of long mantle which they throw over their whole
body. Their face is covered with a kind of veil fastened to their cap, or rather linen rag tied about their head.
Without the walls of Alexandria is still remaining a jewish synagogue, called Eliace, and which, they say, was
built in the time of the prophet Elijah. But this is far from being probable ; for tho’that prophet went to mount
Horeb, and possibly might return to Palestine by the way of Egypt, yet (p. 141) this does not prove, that any
Jews then resided there, unless we suppose they had removed thither for want of water, during the long
drought. But however this be, it seems more natural to think, that this synagogue was built long since the
time of Elijah, by some devout person of that name, and from thence received the appellation it now bears.
There is also without the city of Alexandria, in a very lonely situation, the house of a Turkish santon or rather
idiot, at least one who feigns himself to be such, the Mahometans being very fond of idiots ; being firmly
persuaded, that their souls go immediately to paradise when they quit their body. Nor are the Roman
Catholics more extravagant in their accounts of the miracles of their saints, than the Mahometans are in their
relations of this class of mortals ; and I was assured, that it is not uncommon for a lamp to be found burning
continually in their oratories, without any supply of oil.
Having gratified our curiosity as far as possible at Alexandria, we determined to return to Rosetta ; but we
found great difficulty in procuring asses for the journey, the Pasha being encamped on the road, in his march
to that city. But by the assistance of Mr. Hume and some other English gentlemen, we surmounted this
difficulty, and proceeded on our journey to Rosetta ; and the road saw an instance of the sudden turn of
fortune not uncommon in these parts. We met, riding in great pomp, the Bey of the country, who, not long
since, had been a slave to Circas Bey, but now raised to this pitch of power. His business was to secure the
roads from the depredations of the Arabian robbers. Here we also saw several salt-works, and a dyke thrown
up before them, as a security against the waves. At night we took up our quaters in a kane called Meidia, of
which we may well say with the Italians, E casa nuova, quando s’y porta qual che, s’y lo trova ; it is a new
house, bring (p. 142) something with you, and you find something in it. »
- 599 - 606 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇOIS PAUMIER (1710-1712)
Paumier, F., « Relation du Royaume d’Egypte », Revue d’Égypte, nov.-déc. 1896, p. 289-300, p. 343-374 ;
janvier-avril 1897, p. 96-104.
Religieux du tiers ordre de saint François de la province de Normandie, François Paumier séjourne en
Égypte de 1710 à 1712 avant de se rendre à Jérusalem.
p. 368-374 :
De la célèbre Alexandrie.
« Alexandrie, qui fut fondée par Alexandre le Grand, dont elle porte le nom, et bâtie par ce fameux architecte
d’Inocrate, dans l’espace de soixante et douze jours, est située sur le bord de la mer à 30 ou 35 m. de la
principale embouchure du Nil du côté de l’Ouest. L’enceinte de murailles que l’on voit encore environner ce
qu’on appelle l’ancienne ville n’est pas visiblement un ouvrage aussi ancien que la fondation de la ville ou
que le règne de dispute563 ; la commune opinion est que ces murs qui n’enferment qu’une bien petite partie
de l’ancienne Alexandrie, ont été faits il y a six et cent ans par un Roy du pays, et que les tours et même les
murs en plusieurs endroits furent élevés à une plus grande hauteur par un Roy nommé Jasouf, qui régna il y
a trois cent ans, immédiatement avant que Mamches conquit cet empire.
Cette vérité est aysée à se persuader si l’on considère la structure de ces tours dont la plus grande partie
subsiste encore aujourd’hui dans leur entier et qui ne sont point dignes de la main des Romains ; les
inscriptions arabes que l’on voit encore sur les portes mêmes dont le bois est encore entier après que les
lames de fer dont elles étoient couvertes ont été consommées par le temps, la quantité prodigieuse de
colonnes qui sont entrelacées dans les tours et les autres endroits des murailles, tout cela justifie assez que
cette ville a été bâtie des ruines de l’ancienne et qu’il n’y a pas fort long-temps que ces murs ont été faits ; ils
ne laissent pas pourtant d’être considérables pour leur force et par leur bonté ; on y compte 50 grosses tours
sans les moindres, dont la plus petite est une manière de citadelle dans laquelle on pouvoit librement loger
500 personnes ; tout y est voûté, et il y avoit plus de 100 chambres dans chacune ; ces tours qui sont jointes
l’une à l’autre par une double muraille dont la ville étoit environnée, et quoy que d’une muraille à l’autre il y
ait plus de trente pieds, ces tours débordent encore considérablement dehors de la ville, et ne sortent pas
moins en dedans, ce qui peut faire juger de leur épaisseur. Il y a dans les tours une arcade de même
distance des murailles, en sorte que l’on passoit sous ces voûtes et que l’on pouvoit faire le tour de la ville
sans que les tours en empêchassent ; dans le premier fossé, on voit au flanc des tours des portes par où
l’on pouvoit faire des sorties sur les assiégeants. Il n’y a point de doute qu’en ce temps-là la ville ne fût très
forte ; les murs peuvent avoir environ six milles d’Italie de circuit ou deux lieüs de France ; les antiquités que
l’on voit en dedans sont les deux aiguilles ou obélisques de Cléopâtre, dont l’une est aujourd’hui renversée
et ensevelie sous le sable, l’autre est encore debout, et l’on n’en voit point le piédestail sur lequel elle est
posée à cause des ruines dont il est couvert ; il est aysé de juger en mesurant un des côtés d’en bas de
celle qui est renversée que ce qui est caché de celle qui est sur pied n’est pas bien considérable ; les quatre
côtés de ces obélisques ou aiguilles sont pleins de figures hiéroglyphiques dont nous avons perdu la
connoissance. La pierre dont elle est composée est la même dont sont faites la plupart des colonnes que
l’on voit encore à Alexandrie, et qu’on a prétendu avoir été fonduë, et qu’on appelle marbre granite qui se
tiroit de la haute Egypte ; on voit vers le milieu de la ville un rang de colonnes de ce même marbre encore
debout d’une grosseur et d’une hauteur extraordinaire, dont une conserve encore son chapiteau ; ces
colonnes qui sont sur une même ligne s’étendent près de 500 pas et ne sont pas aujourd’hui dans une égale
distance l’une de l’autre parce que la plus grande partie en a été levée ou abattuë ; et on en voit encore
plusieurs de renversées entre celles qui subsistent ; vis-à-vis ces colonnes à deux cent pas, on en voit
d’autres semblables qui leur sont opposées et quoy qu’il n’en reste aujourd’huy que 3 ou 4, il est visible par
le même ordre, grosseur et hauteur observés dans ces rangs de colonnes qui subsistent qu’à une égale
distance de ces deux rangs de colonnes, à une des extrémités, au milieu desquelles deux colonnes il doit y
avoir eu une superbe fontaine par l’édifice de brique dont les lieux ou l’eau tomboit se voient manifestement ;
il est évident, par la disposition de toutes ces colonnes, que ce lieu étoit autrefois une place superbe dont la
figure composait un quarré long, la largeur duquel étoit de deux cent pas et la longueur de 500. Il faut croire
que les plus considérables palais de la ville faisoient face à cette place, puisque immédiatement derrière les
colonnes, surtout du côté où il en reste davantage, on voit quantité de murs de brique les uns sur les autres,
encore entiers, qui laissent à juger de la grandeur et de la beauté des bâtiments qui étoient en cet endroit ; il
est apparent que ces bâtiments sont du temps des Romains, et ces ruines sont aujourd’huy une des plus
belles antiquités d’Alexandrie. On distingue parmi ces ruines des Bains presque entiers ; on soutient par
tradition que l'endroit où ces murs de brique paroissent les plus élevés estoit autrefois le palais du père de
sainte Catherine, d'autres assurent que c'étoient des bains publics ; on y voit encore distinctement quantité
de lieux voûtés qui peuvent avoir servi à cet usage. Dans la place environnée de colonnes dont nous venons
de parler, subsiste encore aujourd’huy, non pas directement au milieu mais du côté où le rang des colonnes
est plus entier, une mosquée qui étoit dédiée à Dieu, sous l’invocation de Saint-Athanase, laquelle est sans
doute la plus belle comme peut-être la plus ancienne église qui reste dans l’Afrique. On voit à travers de
plusieurs portes que le quarré long dont elle est composée est environné de quatre rangs de colonnes de
porphyre admirablement belles ; sur ces colonnes il y a des arcades modernes qui ont été refaites ou
rebâties, suivant l’apparence, par les Turcs. Au milieu de cette église il n’y a rien du tout qu’une grande cour
pavée de marbre, en sorte que si c’étoit là toute l’église, car il se pourroit faire que ce ne fut là seulement
que la nef, cette église n’étoit composée que de collatéraux, à moins qu’il n’y eu un dôme qui ne subsiste
plus ; il n’y a rien de beau à l’extérieur, mais s’il nous étoit permis d’entrer dedans je ne doute point qu’on n’y
remarquât mille belles antiquités et qu’on ne jugeat beaucoup mieux de ce que ce lieu étoit autrefois. Pour
moy, j’ay cru que ces collatéraux étoient des ailes de cloître. On ne voit dans l’ancienne ville que débris,
qu’une infinité de colonnes renversées et deux montagnes qui ont été formées des débris de maisons. Il n’y
a pas d’apparence que ces montagnes ayent été formées de la terre qui se tiroit des citernes, qui règnent
universellement sous la ville et qui sont encore aujourd’huy une des plus belles antiquités du monde.
Alexandrie souterraine n’est point maltraitée au point que l’est celle dont nous venons de parler ; si quelques
citernes ont été enfoncées ou qui ne soient point entretenuës avec la même propreté qu’elles l’étoient
autrefois, il est certain par ce que l’on en voit encore aujourd’huy et par le témoignage de ceux qui y
descendent tous les jours, que non seulement il n'y a rien de plus beau ny de plus entier que les voûtes, rien
de mieux construit que leurs ouvertures, rien de plus superbe que les pièces de marbre dont elles sont
environnées, mais encore que ces citernes se joignent de l’une à l’autre par des canaux que l’on pouvoit
fermer quand ces citernes étoient rempliës, et que ces citernes ont une étendue presque infinië, en sorte
qu’il se trouve des gens qui entrent sous terre par un bout de la ville et qui sortent par l’autre. Mais cette
étenduë, quelque considérable qu’elle soit, est bien différente de celle qu’elles ont effectivement et de celle
qu’elles avoient autrefois, car on trouve une continuation de ces citernes depuis Alexandrie en suivant le
rivage de la mer vers l’orient jusqu’au Bequier qui en est éloigné de 5 lieuës et on le trouve de même deux
lieuës vers l’occident ; l’on voit tout un canal souterrain qui règne jusqu’au Bequier, lequel est encore
aujourd’huy presque entier ; il étoit destiné à fournir l’eau dans les citernes de la ville qui s’étendoit de ce
côté, il la recevroit par une branche du Nil qui venoit se perdre à la mer à Alexandrie : cette branche du Nil à
laquelle on avoit creusé un lit avec une dépense incroiable, à travers les vastes déserts de sable qui sont
entre le Nil et la ville, cette branche, dis-je, par laquelle on voituroit toutes les marchandises d’Alexandrie au
Caire, et par laquelle on apportoient l’abondance et la commodité de la vie qui ne se trouve que difficilement
parmi les sables dont elle est environnée. Ce canal étoit encore en état il y a 30 à 32 ans, mais aujourd’huy,
par la négligence des Turcs, il n’y a plus d’eau que lorsque le Nil est dans sa hauteur, et si la nécessité que
les Turcs ont, d’entretenir ce canal de manière qui puisse au moins fournir de l’eau dans cette saison aux
citernes d’Alexandrie, ne les obligeoit à en avoir quelque soin, il seroit tout à fait rempli en moins de
4 années ; il faudroit alors absolument abandonner la ville, qui n’a point d’autre eau que celle-là.
Au-dessus des citernes, qui s’étendent si loin à l’orient et au couchant d’Alexandrie, et qui ont depuis une
demie jusqu’à 3 quards de largeur, l’on voit partout des montagnes de ruines ; on y trouve partout comme
dans la ville et même en plus grande quantité, des médailles et de ces pierres gravées qui étoient autrefois
si communes parmi les Romains et qu’ils portoient au doigt en manière de bague. Ces ruines si vastes et si
étenduës font foy de ce que c’étoit que l’ancienne Alexandrie, et pour moy je suis persuadé que non
seulement la colonne de Pompée et la montagne sur laquelle elle est assise qui est à la porte du mousquet
de la ville, étoit autrefois dans son enceinte même encore bien au delà, il est très facile de distinguer à l’oeil
les endroits qui ont été bâtis et ceux qui ne l’ont point été ; j’estime que soit la ville, soit faux-bourgs, soit
maison de plaisance contiguë, il y avoit autrefois 7 à 8 lieües en longueur et trois quards de lieuës en largeur
qui étoit bâti et habité, que des ruines d’une si grande ville tant de fois conquise et désolée depuis les
Romains par des conquérants barbares, il s’en est construit enfin il y a 4 à 5 ou 6 cents ans les murs dont
nous avons parlé, dans lesquels on enferma ce que l’on peut y apporter de plus précieux, qu’il resta
cependant dans l’espace d’une si grande étenduë qui fut abandonnée quantité d’illustres monuments que la
longueur du temps et la superstition des Arabes ont depuis anéantis ; on les voit encore tous les jours
abattre des colonnes dans les campagnes dans l’espérance de trouver sous la base quelques monnoyes
qu'ils se persuadent y être cachées ; on les a vus, dans un temps de peste, par superstition, briser dans ces
mêmes campagnes une figure de lyon, aussi belle qu'elle étoit ancienne. Ainsy sont péris insensiblement
tant d'ouvrages qui auroient dû être immortels ; et si la colonne de Pompée, dont nous allons parler, est
encore debout aujourd’huy, c’est que son poids énorme n’a pas permis aux Arabes d’arracher les pierres sur
lesquelles sa base est posée. »
p. 96-98 :
De la colonne de Pompée.
« Ils sont pourtant parvenus à tirer une de ces pierres d’un coin, par où ils nous ont découvert, dans celle qui
suit immédiatement, des lettres hiéroglyphiques qui sont parfaitement entières. Par cette ouverture aussy, il
est aysé de voir qu’au milieu des pierres prodigieuses sur lesquelles la base de cette colonne est posée, il y
a une manière de colonne, au milieu immédiatement, sur laquelle principalement repose toute la pesanteur
de la pierre ; l’on y découvre même quelques lettres hiéroglyphiques qui doivent régner à l’entour ; une des
faces de la base qui est quarrée et de marbre granite comme la colonne, a quinze pieds de largeur et autant
de hauteur, d’où l’on peut juger du prodigieux poids de cette pierre ; la colonne à laquelle tient même
naturellement une partie de cette base où elle est plus fortement posée, est sans contredit la plus haute et la
plus grosse qui soit dans l’univers et le plus beau morceau qui nous reste de l’antiquité ; il est composé de
3 pierres ; le chapiteau en compose une, la deuxième fait toute la colonne et même une partie de la base et
la troisième le piédestal ; le tout est d’un très beau marbre granite ou de jaspe d’Egypte ; le chapiteau est
proportionné à tout l’ouvrage et est creux au dessus ; j’estime qu’il y avoit peut-être une représentation et
paut-être la figure de Pompée dont la colonne porte le nom. Il falloit que cette figure fût d’une grandeur
extraordinaire pour être proportionnée à son élévation. Il y a quelque temps qu’un arabe, danseur de corde
de profession, trouva moyen, par une flèche à laquelle étoit attachée une ficelle, de faire passer ensuitte les
corniches du chapiteau une corde, à la faveur de laquelle il y monta tenant un ânon sur les épaules, à la vue
de tout le peuple d’Alexandrie. C’est par luy qu’on a appris que le chapiteau étoit considérablement creusé.
Toute la colonne avec la base et le chapiteau a cent 28 pans de hauteur, au rapport de plusieurs personnes
de Provence qui l’ont mesurée ; un françois fort exact m’a assuré qu’elle a quatre-vingt-dix entre le
chapiteau et la base ; quatre hommes pouvoient l’embrasser avec peine. Cette pièce est si saine et entière
que si elle n’étoit posée que de notre temps, et peut-être y est-elle depuis deux-mille ans ; on l’aperçoit de la
mer longtemps auparavant de découvrir Alexandrie.
Voicy des observations qu’on avoit fait pour abattre et embarquer cette colonnne, dans les vuës qu’on avoit
de la transporter en France. On supposa que M. l’Amb. Obtiendrait cette colonne du grand Seigneur, et que
Sa Hautesse voudrait bien entrer dans ce qu’on luy proposoit de la part du Roy.
Je suis asseuré qu’un Catecherif, accompagné d’un Capigi Bachi, soutenu à la marine d’un ou deux
hommes du Roy et aydé de quelques libéralités, ne trouveroit ici aucune opposition, ny dans le grand divan,
ny dans le peuple d’Alexandrie ; il est fort douteux que les Catecherifs du Seigneur trouvent de la résistance
quand des véritables du bien public ne peuvent leur être opposés ; mais pour aller au devant de toute
difficultés et perdre dans cette entreprise une voye indubitable pour le succès, il faudroit qu’on fit croire qu’on
veut la mener à Constantinople, et que M. l’Ambassadeur a bien voulu ayder le grand Seigneur dans cette
entreprise, et qu’il n’y eut que le seul Capigi Bachi qui fut prévenu du secret, etc.
Du phare d’Alexandrie.
A l’égard du phare d’Alexandrie, qui étoit autrefois une des sept merveilles du monde, il ne s’en voit plus
aujourd’huy que la place, encore est-elle incertaine ; le plus connu est qu’il étoit bâti où est aujourd’huy le
pharillon qui est une forteresse moderne, à l’entré du port ordinaire d’Alexandrie. Il y en a qui soutiennent
que l’ancien phare étoit plus avancé dans la mer et prétendent qu’on en voit les débris dans les eaux quand
la mer est parfaitement calme ; il s’est insensiblement amassé des sables lesquels enfin ont éloigné la mer
des murs de la ville qui étoient de ce côté-là et découvert un terrain sur lequel, depuis 20 à 30 ans, les Turcs
ont transporté leurs maisons pour être plus près de la marine ; c’est ainsy que la ville qui porte aujourd’huy le
nom d’Ancienne a sans doute été renouvellée des ruines de la première Alexandrie, et que cette dernière
s’est bâtie et se bâtit tous les jours des ruines de la deuxième autant et mille fois inférieure à celle-cy, qu’elle
l’étoit elle-même à la véritable Alexandrie. »
563 Il faut peut-être lire despote ? Note de l’éditeur.
- 586 - 588 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
DOMINIQUE JAUNA (début XVIIIe siècle)
Jauna, D., Histoire générale des roïaumes de Chypre, de Jérusalem, d'Arménie et d'Égypte, comprenant les
croisades… et les faits les plus mémorables de l'empire ottoman,… jusqu'à la bataille de Lépante…
l'anéantissement de l'empire des Grecs. On y a ajouté : I. L'état présent de l'Égypte ; II. Dissertation sur les
caractères hiéroglifiques des anciens Égyptiens ; III. Réflexions sur les moïens de conquérir l'Égypte et la
Chypre, Leyde, 1785.
Dominique Jauna, voyageur autrichien (vers 1668-après 1747), est chevalier. Les informations que nous
avons de lui sont très fugaces. Toutefois, nous savons qu’il est conseiller royal et impérial, et, intendant
général du commerce. Après avoir reçu une bonne éducation, il séjourne plusieurs années dans le Levant
où il fait l’apprentissage des langues orientales, de l’histoire et des modes de vie. À la fin du XVIIe siècle, il
est envoyé par le gouvernement autrichien à Chypre, en Palestine et en Égypte pour étudier l’industrie de la
soie. Il y passe une longue période au cours de laquelle il étudie les monuments et les manuscrits. Il publie
le résultat de ses études à son retour en Autriche dans l’ouvrage cité ci-dessus.564
p. 1223 (tome II) :
« Les figues d'Alexandrie sont admirables, mais petites. »
p. 1231-1232 (tome II) :
« L'ichneumon ou rat de Pharaon : on peut apprivoiser cet animal vers (sic) Alexandrie en lui donnant à
manger des serpents, des rats, des limaçons et autres insectes. »
p. 1233 (tome II) :
« On voit des gazelles en assez grand nombre près d'Alexandrie. C'est une sorte de chevreuil, dont l’oeil vif
et perçant a passé en proverbe. Pour louer en ce pays-là les yeux d'une dame, on dit qu'elle a des yeux de
gazelle. »
p. 1229-1243 (tome II) :
« Description de la ville d’Alexandrie, telle qu’elle subsiste présentement
La ville d’Alexandrie, qui fut fondée par Alexandre le Grand, dont elle porte le nom, & bâtie par le fameux
architecte Dinocrate, selon quelques auteurs, en 12 jours, ce qui paroit pourtant impossible, est située sur le
bord de la mer, à environ 35 miles à l’Occident de l’embouchure du Nil, qui se décharge à l’Ouëst. L’enceinte
des murailles, dont elle est encore environnée, n’est pas visiblement un ouvrage aussi (p. 1230) ancien que
la fondation de la ville, ou que le règne de Cléopatre. L’opinion commune est que ces murs, qui n’enferme
qu’une bien petite partie de l’ancienne Alexandrie, ont été fait il y a 6 à 700 ans par un roi du pays, & que les
tours, & même les murs, en plusieurs endroits, furent depuis élevés à une plus grande hauteur, par un roi
nommé Yasouf, qui régnoit, il y a plus de 330 ans, immédiatement après que les Mammelucs, conquirent cet
Empire.
Cette vérité est aisée à croire, si l’on considère la structure de ces Tours, dont la plus grande partie subsiste
encore aujourd’hui dans leur entier, & qui ne sont point dignes de la main des Romains, encore moins des
anciens Egyptiens. Les Inscriptions Arabes, que l’on voit encore sur les Portes ; les Portes mêmes, dont le
bois est encore entier, depuis que les lames de fer, dont elles étoient couvertes, ont été consummées par le
tems ; la quantité prodigieuse des colonnes, qui sont entre-lassées dans les Tours, & les autres endroits des
murailles : tout cela justifie assez, que cette ville a été bâtie de ruines de l’ancienne ; & qu’il n’y a pas fort
long tems, que ces murs ont été élevés. Ils ne laissent pas pourtant d’être considérables, par leur force, &
par leur bonté.
On y compte cinquante grosses Tours, sans les moindres, dont la plus petite est une Citadelle, dans laquelle
on pourroit aisément loger 500 Hommes. Tout y est voûté ; & il y avoit plus de cent chambres dans
chacune ; celui qui les a fait élever plus qu’elles n’étoient d’abord, a eu soin de faire crépir son ouvrage ; &
on le distingue fort bien encore aujourd’hui de l’ancien.
Ces Tours qui sont d’une hauteur prodigieuse, sont jointes l’une à l’autre par une double muraille, dont la
ville étoit environnée ; & quoique d’une muraille à l’autre il y ait plus de 30 piés, ces Tours débordent encore
considérablement en dehors (p. 1231) de la ville, & ne sortent pas moins en dedans, ce qui peut faire juger
de leur épaisseur.
Il y a dans les Tours une arcade de même distance des murailles ; en sorte que l’on pouvoit faire le tour de
la ville, sans que les Tours en empêchassent. Dans le premier fossé, on voit au flanc des Tours, des portes,
par où l’on pouvoit sortir sur les Assiégeans. Il n’y a point de doute, qu’en ce tems-là, la ville ne fût
très-forte ; ces murs peuvent avoir de circuit environ 6 miles d’Italie, ou deux lieues de France.
Les Antiquités que l’on voit en dedans, consistent dans les deux aiguilles, ou Obélisques de Cléopatre, dont
l’une est aujourd’hui renversée, & presque ensevelie sous le sable. On en découvre pourtant la plus grande
partie : L’autre est encore debout ; &, quoiqu’on ne voie point le pié-d’estal, sur lequel elle est posée, à
cause du sable, dont il est couvert, il est aisé de juger, en mesurant un des côtés d’en-bas de celle qui est
renversée, que la partie cachée de celle qui est en pié n’est pas fort considérable. Les quatre faces de ces
obélisques sont remplies de caractères hiérogliphiques, dont nous avons perdu la connoissance. La pierre
dont ils sont composés, est la même, dont sont faites la plupart des colonnes, qu’on voit encore aujourd’hui
à Alexandrie, & qu’on a prétendu mal-à-propos avoir été fondues. On l’appelle marbre granite. Les carrières
s’en trouvent dans la Haute-Egypte, comme nous le ferons voir dans la suite.
On voit un Obélisque, qui a plus de 55 piés de hauteur, sans compter le pié-d’estal ; & son épaisseur
d’en-bas est de 7 à 8 piés de chaque côté, & va toujours en diminuant. Vers le milieu de la ville, on voit un
rang de colonnes, du même marbre, qui sont encore debout, d’une grosseur, & d’une hauteur extraordinaire.
Ces colonnes, qui sont sur une même ligne, s’étendent près de 500 pas, & ne sont pas dans une égale
distance l’une de l’autre, parce que la plus grande partie en a (p. 1232) été enlevée, ou abatue ; & l’on en
voit beaucoup de renversées ; il y en a qui ne sont éloignées que de 10 à 12 piés, d’où l’on peut juger qu’il y
avoit, sur ce seul rang, près de 150 colonnes ; encore faut-il supposer, que la première, & la dernière des
colonnes, qui se trouvent sur cette ligne, étoient effectivement la première, & la dernière, ce qui n’est pas
vraisemblable.
A environ deux cens pas, & vis-à-vis des colonnes, on en voit d’autres semblables, qui leur sont opposées ;
& quoiqu’il n’en reste plus que trois, ou quatre, il est visible, par la disposition des lieux, par le même ordre,
la même grosseur, & hauteur, & par deux autre colonnes, qui subsistent à une égale distance de ces deux
rangs, qu’il doit y avoir eu un très-superbe Palais, une fort grande Place, & une magnifique Fontaine ; ce
qu’on peut conjecturer, par le débris des briques, dont les conduits étoient fabriqués, & les lieux où l’eau
tomboit, qui se voient encore aujourd’hui manifestement.
Il est évident, dis-je, par la disposition de toutes ces colonnes, que ce lieu étoit une place superbe, dont la
figure composoit un quarré de 200 pas de largeur, & de 500 de longueur : Et vraisemblablement les plus
considérables Palais de la ville faisoient face à cette Place, puisqu’immédiatement derrière les colonnes, sur
tout du côté où il en reste davantage, on voit quantité de murs de briques, les uns renversés, les autres
encore entiers, qui laissent à juger de la grandeur, & de la beauté des Bâtimens, qui étoient en cet endroit. Il
y a apparence, que les Bâtimens sont du tems des Romains.
Ces ruines sont aujourd’hui une des plus belles Antiquités d’Alexandrie. On y voit un Palais de César, où l’on
distingue, parmi les ruines, des Bains presque entiers. Il y en a un, dont les murs n’étoient uniquement
composés que de mortier, mais si dur, & si ferme, qu’il auroit disputé avec la pierre. Les Maures vont tous
les jours en détacher quelque morceau, pour composer (p. 1233) leurs nouveaux Bâtimens ; & il est sûr que
qui voudroit faire la dépense de faire aprofondir ces endroits découvriroit encore plusieurs belles Antiquités.
On tient ici par tradition, que l’endroit, où ces murs de briques paroissent les plus élevés, étoit autre-fois le
Palais du Père de Ste. Catherine. D’autres assurent, que c’étoient des bains publics. On y voit encore
distinctement quantité de lieux voûtés, qui peuvent avoir servir à cet usage.
Dans la place environnée des colonnes, dont nous venons de parler, subsiste encore aujourd’hui, non pas
directement au milieu, mais du côté où le rang des colonnes est plus entier, une mosquée, qui étoit une
église destinée à St. Anasthase, laquelle est, sans doute, la plus belle, & peut-être la plus ancienne Eglise,
qui reste dans l’Afrique. On voit au travers des fentes de plusieurs portes, qui y sont, que le quarré long,
dont elle est composée, est environnée de quatre rangs de colonnes de porphire admirablement belles. Il y a
sur ces colonnes des arcades modernes, en apparence, qui ont été faites, ou rebâties par les Turcs ; & au
milieu de cet édifice, on ne voit, qu’une grande cour pavée de marbre ; en sorte, que, si c’étoit-là toute
l’église, car il se pourroit faire que ce ne fût seulement que la nef, cette église n’étoit composée que de ces
côtés collatéraux, à moins qu’il n’y ait eu un dôme, qui ne subsiste plus.
Il n’y a rien de beau à l’extérieur. Ce sont de simples murailles ; mais, s’il étoit permis d’entrer dedans, je ne
doute pas, qu’on y remarquât mille belles Antiquités, & qu’on ne jugeât beaucoup mieux de ce que ce lieu
étoit autre-fois. Je ne regardai à travers la fente des portes, qu’avec inquiétude ; car les Turcs sont
superstitieux, jusqu’au point de ne pas permettre ces sortes de curiosités.
En divers endroits de l’ancienne ville, il se trouve des colonnes debout, & d’autres renversées, la plupart
très-grosses, & qui n’ont pu être enlevées à cause de leur pesanteur, les Turcs (p. 1234) aïant pris toutes
celles qu’ils ont pu emporter, soit pour bâtir leurs mosquées, ou leurs maisons, dans lesquelles on en voit
une quantité prodigieuse ; soit pour embellir celles de Rosette, où l’on en a également transporté beaucoup.
L’on voit à l’entrée des arcades, des voûtes des Tours, qui sont entre les deux murailles de la ville, dont
nous avons parlé, aussi bien qu’au pié des murs de la ville, dans les endroits, qui sont encore aujourd’hui
battus de la mer, sans parler du grand nombre qu’on en a entrelassé dans l’épaisseur de toutes les
murailles, pour en mieux maintenir l’ouvrage. En fin ce ne sont par tout que colonnes de marbre de
différentes espèces, & de différente grandeur ; & il ne faut pas douter, qu’il n’y en ait encore davantage
d’ensevelies dans les sables, & sous les ruïnes ; car l’ancienne ville n’est plus habitée, que par quelques
particuliers, qui n’ont point eu encore la commodité de se tirer des débris des maisons, qui y étoient
autre-fois. Ce ne sont de tous côtés que monceaux de pierres, & de sable, qui se sont formes de la
démolition de cette superbe ville.
Il y a surtout deux montagnes assez élevées, qui ne sont composées que de ces décombres ; mais il y a
apparence, qu’il y a déjà long-tems qu’elles ont été formées, par la tolérance, qu’on avoit de soufrir, que les
Particuliers déchargeassent en ces endroits les ruïnes d’une partie de leurs maisons, au lieu de les faire
transporter à la mer ; car il n’est pas vraisemblable, que ces montagnes aient été formées, comme on le dit,
de la terre, qu’on tiroit des citernes, qui règnent universellement sous la ville, & qui sont encore aujourd’hui
les plus belles Antiquités du monde.
(p. 1235) Alexandrie souterraine n’est point maltraitée, au point que l’est celle, dont on vient de parler. Si
quelques citernes ont été enfoncées, s’il y en a de bouchées, si celles qui restent ne sont point entretenues
avec la même propreté qu’elles l’étoient autrefois, il est certain que ce que l’on en voit encore aujourd’hui
est, selon le témoignage de ceux qui y descendent tous les jours, ce qu’il y a de plus beau. Rien n’est plus
entier, que leurs voûtes, rien de mieux construit que leurs ouvertures, rien de plus superbe, que les pièces
de marbre, dont elles sont environnées. Ces citernes se communiquent de l’une à l’autre par des canaux,
qu’on pouvoit fermer, lorsqu’elles sont remplies : & elles ont une étendue presque infinie ; en sorte qu’il se
trouve des gens, qui entrent sous terre par un bout de la ville, & en sortent par l’autre.
Mais, quelque considérable que soit cette étendue, elle est bien différente de celle qu’elles ont
effectivement, & de celle qu’elles avoient autre-fois ; car on trouve une continuation de ces citernes, depuis
Alexandrie, en suivant le rivage de la mer vers l’Orient, jusqu’aux Béquiers, qui en sont éloignés de cinq
lieues ; & on les trouve de même jusqu’aux deux lieues vers l’Occident.
On voit surtout un canal souterrain, qui règne jusqu’aux Béquiers, lequel est encore aujourd’hui presque tout
entier. Il étoit destiné à fournir l’eau dans les citernes de la ville, qui s’étendoient de ce côté-là ; & il la
recevoit, comme tous les autres, d’une branche du Nil, qui venoit se perdre dans la mer à travers Alexandrie.
Cette branche du Nil, à laquelle on avoit creusé un lit, avec une peine, & une dépense incroïable, à travers
(p. 1236) les vastes déserts de sable, qui sont entre le Nil, & cette ville, cette branche, dis-je, servoit à
voiturer toute sorte de marchandises de l’Egypte à Alexandrie, & y apportoit l’abondance, & les commodités
de la vie, qui ne peuvent se trouver que difficilement parmi les sables dont elle est environnée.
Il n’y a pas plus de 50 à 60 ans que ce canal étoit en état ; & il se trouve encore des marchands, qui ont fait
voiturer des marchandises jusqu’au Caire ; mais aujourd’hui par la négligence des Turcs, il n’y a plus d’eau,
que lorsque le Nil est dans sa plus grande hauteur ; & si la nécessité, que les Turcs ont d’entretenir ce canal,
d’une manière qui puisse au moins fournir dans cette saison, de l’eau aux citernes d’Alexandrie, ne les
obligeoit à en avoir quelque soin, il seroit tout-à-fait rempli en moins de quatre années. Il faudra alors
absolument abandonner la ville, qui n’a point d’autre eau que celle-là.
Au-dessus des citernes, qui s’étendent si loin à l’Orient, & au couchant d’Alexandrie, & qui ont depuis une
demie-lieue, jusqu’à trois quarts de lieues de largeur, se voient par tout des montagnes, des ruines,
composées de même matière que les autres ; & l’on y trouve, comme dans la ville, & même en plus grande
quantité, des médailles, & de ces pierres gravées, qui étoient autre-fois si communes chez les Romains, &
qu’ils portoient au doigt en manière de bague, & pour se servir de cachet, ou enfin comme des
représentations des personnes qu’ils estimoient. Ces pierres se trouvent l’hiver, lorsque les pluies les
découvrent. Les Arabes les vont chercher, & les aportent à Alexandrie. Le terrain où elles se découvrent,
étoit autrefois la ville même. Il faut qu’elle ait été brûlée ; car il n’y a point d’apparence, que, si elle eût été
seulement détruite peu à peu, on eût laissé, dans les maisons, des choses se quelque prix. On trouve, enfin,
dans la seule ville d’Alexandrie plus de restes des Antiquités Romaines, qu’on en trouve dans tout le reste
de l’Univers.
(p. 1237) Ces ruines si vastes, & si étendues, font foi de ce qu’étoit l’ancienne Alexandrie. Je suis persuadé,
que non seulement la colonne de Pompée, & la hauteur, sur laquelle elle se trouve, qui est à une portée de
mousquet de la ville, du côté de la terre, étoit autre-fois dans son enceinte ; mais encore les petites buttes,
qui sont au-delà, & qui ne sont pas moins couvertes de ruines. Il est très-aisé de distinguer, à l’oeil, les
endroits, qui ont été bâtis autre-fois, de ce qui ne l’ont point été. J’estime, que, soit ville, soit fauxbourgs, soit
maisons de plaisance contigues, il y avoit autrefois 6 à 8 lieues en longueur, & trois quarts de lieues en
largeur, qui étoit bâti, & habité ; que, des ruines d’une si grande ville, tant de fois conquise, & désolée depuis
les Romains, par les Barbares, il s’en construisît enfin, il y a 5 à 600 ans, les murs dont nous avons parlé,
dans lesquels on renferma ce qu’on put y apporter de plus précieux ; qu’il reste cependant dans un espace
si étendu, qui fut abandonné, quantité d’illustres monumens, que la longueur du tems, l’avarice, & la
superstition des Arabes ont depuis anéantis. On les voit encore tous les jours abattre des colonnes à la
campagne, dans l’espérance de trouver sous la base quelque monnoie d’or, ou d’argent.
On les a vus dans un tems de peste, par superstition, briser, dans ces mêmes campagnes, une figure d’un
lion, aussi belle, qu’elle étoit ancienne. Ainsi ont péri insensiblement tant d’ouvrages, qui auroient dû être
immortels ; &, si la colonne de Pompée est encore debout aujourd’hui, c’est que son poids énorme n’a pas
permis aux Arabes d’arracher les pierres, sur lesquelles la base est posée. Ils sont pourtant parvenus à en
tirer une d’un coin, par où ils nous ont découvert dans celle, qui suit immédiatement, des figures
hiérogliphiques, qui sont parfaitement entières.
Par cette même ouverture, il est aussi aisé de voir, qu’au milieu des pierres prodigieuses, sur lesquelles la
base de cette colonne (p. 1238) est posée, il y a une manière de colonne immédiatement au milieu, sur
laquelle principalement repose toute la pesanteur de la pièce. L’on y découvre même quelques figures
hierogliphiques, qui doivent régner à l’entour.
Je ne m’arrêterai pas à faire une scrupuleuse description de cet illustre monument de l’Antiquité. Je me
contenterai de dire, qu’une des faces de la base, qui est de même marbre, que la colonne, a quinze piés, au
moins, de largeur, & autant de hauteur, d’où l’on peut juger du prodigieux poids de cette pierre. La colonne,
à laquelle tient même naturellement une partie de cette base, par où elle est fortement posée, est, sans
contredit, la plus haute, & la plus grosse colonne, qui soit dans l’Univers. Le chapiteau est proportionné à
son ouvrage, & est creux au-dessus. J’estime qu’il y avoit une représentation, & peut-être la figure de
Pompée, dont la colonne porte le nom. Il faloit que cette figure fût d’une grandeur extraordinaire, pour être
proportionnée à son élévation.
Il y a quelque tems qu’un Arabe, danseur de corde de profession, trouva moïen par une flèche, à laquelle
étoit attachée une ficelle, de faire passer entre les corniches du chapiteau, une corde, à la faveur de laquelle
il y monta, tenant un anon sur ses épaules, à la vue de tout le peuple d’Alexandrie. C’est par lui qu’on a su,
que le chapiteau étoit considérablement creusé. La sculpture du chapiteau est seulement un peu usée ; &, à
l’égard de la colonne, le cordon, qui termine en bas la rondeur, & qui touche à la partie quarrée, qui
compose ce dernier étage de la base du pié d’estal, & qui n’est qu’une même pierre avec la colonne, est un
peu entamé, du côté de l’Est, aussi bien qu’un peu de la colonne au-dessus ; mais il seroit bien facile de
rétablir ce dommage du tems, par un mastic de la même pierre ; & l’ouvrage seroit aussi parfait qu’il étoit, il y
a 16 à 17 siècles, lorsqu’il fut posé en cette place. Enfin, la hauteur, le pié d’estal (p. 1239) compris, a
quelque chose au-dessus de cent piés ; & sa grosseur est bien proportionnée.
A l’égard du Phare d’Alexandrie qui étoit autre-fois une des sept Merveilles du Monde, on n’en voit plus
aujourd’hui que la place, encore est-elle incertaine. La plus commune opinion est, qu’il étoit bâti où est
aujourd’hui le Farillon, qui est une petite forteresse moderne à l’entrée du port ordinaire, sur laquelle est
élevé un second Château, & sur ce Château une Tour, d’où l’on fait encore fanal pendant la nuit. Il y en a qui
soutiennent que l’ancien Phare étoit plus avancé dans la mer : Ils prétendent, qu’on en voit des débris sous
les eaux, lorsque la mer est parfaitement calme. C’est une question que l’éloignement des choses a rendue
très-difficile : il paroit seulement, en général, qu’il y a eu autre-fois deux ports à Alexandrie, qui subsistent
encore aujourd’hui. Le vieux port est destiné pour les grands vaisseaux, & les galères ; il est très-beau, fort
sûr, & si profond partout, que les plus gros navires abordent la poupe à terre. On ne permet point aux
Bâtimens Chrétiens d’entrer en aucune manière dans ce port. L’autre qui a moins de profondeur, & au milieu
duquel il se trouve quelques écueils, étoit seulement destiné pour les galères, ou les moindres Bâtimens, qui
venoient à Alexandrie.
L’entrée de ce port est aujourd’hui très-difficile ; elle est la plupart comblée, par le lestage des Bâtimens, qui
y abordent ; de sorte que les navires Chrétiens sont obligés de mouiller dans un très-mauvais fond. Le port,
qui est du côté de l’Orient, étoit environné, depuis la ville, d’un môle, en manière de demi-cercle, qui
aboutissoit à des écueils, & qui le couvroit de ce côté-là. Il subsiste encore une partie, & il y a une manière
de petite Forteresse sur le bout, d’où l’on pouvoit encore faire fanal aux vaisseaux du côté du couchant.
Il y avoit un second môle, depuis les murs de la ville jusqu’au Farillon, ou grand Phare, qui étoit situé sur
l’extrémité de l’île (p. 1240) qui forme le port ancien, & qui répond au premier môle ; en sorte que le port aux
galères n’étoit séparé du vieux port, que par le second môle, qui subsiste encore à demi-ruïné comme le
premier, à l’endroit où cette seconde digue touche à la ville du côté du petit port. Il s’est amassé des sables,
qui ont enfin éloigné la mer des murs de la ville, qui étoit de ce côté-là, & découvert un terrain, sur lequel,
depuis 40 à 50 ans, les Turcs ont transporté leurs maisons, pour être plus près de la marine. C’est ainsi que
la ville, qui porte aujourd’hui le nom d’ancienne, a, sans doute, été renouvellée des ruines, de la première
Alexandrie, & que cette dernière s’est bâtie, & s’augmente tous les jours des ruines de la seconde, autant, &
mille fois inférieure à celle-ci, que celle-ci l’étoit à la véritable Alexandrie.
Il viendra peut-être un tems, où les colonnes, qui ont été transportées, étant confondues avec la poussière
des maisons, feront croire à ceux qui ne l’ont pas vu bâtir, comme nous, que la véritable Alexandrie étoit
bâtie en cet endroit, comme on soutient que les murs, & les Tours, dont nous avons parlé, l’enfermoit
autre-fois véritablement.
Au reste, lorsque je parle de montagnes, & de ruines, je n’entens pas de ces ruines récentes, parmi
lesquelles on voit encore de grosses pierres, mais de ces ruines de dix ou douze siècles, où à peine on
distingue la poudre des pierres, & celle des briques, par les petits morceaux, qui en restent, d’autant plus
que, si on se donnoit la peine d’aprofondir, je ne doute point, qu’on ne trouvât encore des murs tout entiers &
bien des particularités dignes d’admiration. On pourroit aussi, en examinant les digues, & les endroits du
port, où il paroit des roches, découvrir, avec quelque dépense, beaucoup de belles Antiquités, qui y sont
ensevelies : par exemple, on a reconnu, depuis peu, dans le port ordinaire, une colonne couchée, laquelle
doit y avoir autrefois été dressée, pour servir d’avertissement.
(p. 1241) Le vieux port est aussi indubitablement environné d’Antiquités ; mais, comme on ne permet même
pas aux Chrétiens d’en approcher, il est impossible d’en rendre témoignage. S’il est permis ; après ceci, de
faire quelque réflexion ; Quelle est la ville de l’Univers, qui, après tant de révolutions, & de ruïnes si souvent
réïtérées, pourroit, après 2000 ans, laisser entre-voir sa magnificence, comme le fait encore Alexandrie ?
Que seroit Paris lui même en moins de deux siècles, s’il étoit abandonné ? Quels ouvrages croïons-nous qui
puissent, après ce tems, témoigner leur grandeur passée. Il faut convenir, qu’il n’y a rien aujourd’hui en
édifices publics ; & en solidité de Bâtimens, qui soit aussi grand, & aussi durable, que l’étoient les ouvrages
des Anciens, & qu’il sera difficile de les imiter de côté-là.
Les ports d’Alexandrie sont , l’un à l’Est, & l’autre à l’Oüest d’une langue de terrain, qui s’avance vers la mer,
en forme de presqu’il, sur laquelle est située la ville, qui à proprement parler, n’est qu’un fauxbourg de
l’ancienne, où les ruines de ses remparts paroissent encore. Celui de l’Est s’appelle Port-neuf ; & celui de
l’Oüest, vieux-Port.
La reconnaissance de ces ports, en venant du large, sont les deux montagnes de terre mouvante située
dans l'enceinte des vieux murs, sur l'une desquelles il y a une vieille tour carrée d'où l'on fait découverte et
reconnaissance de la côte ; lorsqu'on atterre du côté de l'Oüest, est la Tour des Arabes, qui fait comme de
petites montagnes de terres semblables à celles d'Alexandrie ; mais sur ces deux il y a, une tour carrée sur
l'une, et une tour ronde sur l'autre, qui paraissent de 4 lieues de la mer.
Lorsqu'on atterre du côté de l'est, la reconnaissance sont les dattiers en quantité, qui paraissent sur un
terrain inégal, mêlés de vieilles masures ; ce qui ne se trouve point (p. 1242) à l'ouest d'Alexandrie, où le
terrain est uni sans dattiers, hormis quelques uns écartés les uns des autres.
Pour entrer dans le port neuf, il faut tirer droit au grand Farillon, & laisser un petit écueil, qu’on nomme le
Diamant, à la droite, éloigné de 15 à 20 toises ; on laisse à gauche deux seiches, qui ont deux brasses d’eau
au-dessus ; &, après les avoir doublées, on peut mouiller en 5 &6 brasses d’eau, fond de sable net, c’est le
mouillage ordinaire, pour les vaisseaux de 8 à 9000 quinteaux.
Il y a dans ce port plusieurs écueils qu'on appelle des seiches, marquées sur le plan par des croix et des
points. Le plus considérable s'appelle Gérofle, qui est un banc de roches de la longueur de 60 toises ; une
partie paraît à fleur d'eau. À l'ouest de cette roche, il y a un bas-fond uni, marqué par des points. En
quelques endroits de ces bancs, il y a passages pour de petites germes et pour des chaloupes.
Il y a une autre roche sous l'eau, à la distance de 130 toises du Gérofle, où il y a deux pieds d'eau dessus ; il
s'appelle le Poivre, il y a passage libre au milieu.
Les vaisseaux du port d'environ 4 à 6.000 quintaux mouillent au sud-est du Gérofle où il y a 3 à 4 brasses
d'eau ; et les barques mouillent plus en dedans, à couvert du Poivre à deux brasses et demie ; ce mouillage
se nomme la tonde (sic) ; le fond est de sable.
L'on se ramège en mettant un cable nord-est, et l'autre sud-ouest : ce qu'on appelle afourché, par la raison
que les vents régnant presque toujours au N.N.O et au N.N, les deux ancres font également force. On met
aussi une ancre à poupe du côté du S.E : c'est ce qu'on appelle la rajaire, par la raison que les vents à la
terre assez frais, cette ancre fait force et soulage les deux autres.
Lorsque le vent N.N.O se met avec force, on met une autre (p. 1243) ancre de ce côté, afin qu'elle soulage
les deux premières, qui font force toutes trois ensemble ; cette dernière se nomme le gardien ou l'espérance.
On a la précaution de mettre à tous ces cables des soutiens de distance à l'autre, qui empêchent que les
cables ne touchent au fond, et ne se coupent aux pierres qui y sont en quantité. Les traversiers, c'est-à-dire
les vents les plus à craindre, sont les vents de N.N.O. qui amènent une si grosse mer que les équipages ne
peuvent plus descendre à terre. Les embats, c'est-à-dire les vents les plus en règne, sont ceux de N.O.N. et
de N.N.O.
L'entrée de ce port est un peu plus difficile que l'autre ; mais en récompense, lorsqu'on est dedans, on est à
couvert de tout temps. On n'y peut entrer sans pilote, à cause que le passage est entre deux seiches ; et il
faut qu'un bateau se mette sur un, et l'autre bateau sur l'autre, et le vaisseau passe au milieu ; il y a 4 à
5 brasses d'eau au passage, fonds de roche. Lorsqu'on est entré, on tire droit à la vieille douane, pour éviter
le banc, qui reste à la pointe, où il y a peu de fonds ; on tourne ensuite vers le milieu du port, où l'on trouve
6 brasses d'eau, fonds de sable. Les plus grands vaisseaux du Grand Seigneur y mouillent toujours et
jamais dans le port neuf, à cause du peu de fonds et des vaisseaux marchands dont il est presque toujours
rempli.
On s'y ramège E. et O. afourché, avec une rajaire de poupe. On n'y sent jamais aucune houle de mer, les
bas-fonds qui sont à l'entrée l'arrêtant tout à fait. L'aigade se fait par le moyen des chameaux, qui vont
prendre l'eau dans une branche du Nil qu'on appelle le Halis, ou dans les citernes : c'est la meilleure eau du
monde. »
- 589 - 594 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PAUL LUCAS (1716)
Lucas, P., Voyage fait en 1714 jusqu’en 1717 par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie,
Palestine, Haute et Basse Egypte, &c., Rouen, 1724.565
Se référer à sa notice biographique présentée précédemment.
p. 22-44 (tome II) :
« Un de mes premiers soins fut d’aller examiner la colonne de Pompée, qui est près d’Alexandrie du côté du
couchant, & je crois qu’il serait difficile de rien ajouter à l’exactitude avec laquelle je l’ai mesurée. La curiosité
du public sera sans doute satisfaite (p. 23) du dessein que je lui en donne & de toutes ses dimensions. Cette
Colomne a précisément 94 pieds de hauteur, y compris son pied d’Estal & son chapiteau. Le pied d’Estal en
a 14 & 1828 pieds cubes. Le chapiteau en a 9 de haut & 485 pieds cubes. La Colomne 69 & 3347 pieds
cubes. Le tout ensemble fait 5663 pieds cubes, mesure de Paris ; tout ce grand poids est planté & supporté
par un pivot de cinq pieds en carré comme l’on voit dans la figure : ce pivot est environné de pierres qu’on
pourroit aisément ôter sans que la Colomne courut aucun danger de tomber. Il est impossible de trouver un
monument d’une pareille antiquité mieux conservé que celui-là, je dis d’une pareille antiquité, car on ignore
s’il n’est pas même plus ancien que Pompée, (p. 24) dont elle porte le nom parce qu’il avoit peut-être fait
mettre la figure dessus : on n’y remarque rien présentement mais un charlatan y étant monté il y a quelques
années avec une facilité qui surprit tout le monde assura que le faîte étoit creux ; & on l’avoit sans doute
taillé de la sorte pour pouvoir y placer quelque figure. Les Turcs ont enlevé quelques pierres du pied destal,
croyant qu’il y avoit dedans quelques trésors renfermez.
J’examinai avec le même soin l’Aiguille de Cléopâtre : elle a 54 pieds hors de terre & environ 12 pieds qui y
sont ensevelis, & on n’en sçauroit voir le pied destal pour la même raison : cette Aiguille est chargée de
hiéroglyphes, en quoi elle diffère de la Colomne de Pompée, comme on peut le voir dans la Figure que j’en
donne.
(p. 25) On en voit à 12 pas delà une autre de la même grandeur qui est à present renversée : ces
Obélisques sont d’un beau marbre granite.
La nouvelle ville d'Alexandrie s'agrandit tous les jours, & je trouvai que depuis mon dernier voiage on y avait
bâti plus de vingt Oquelles, ce sont des Auberges pour loger les voyageurs ; & un grand nombre de
maisons, sans parler de quelques Bazars qu'on a rétablis ou faits à neuf. La nouvelle Alexandrie est le long
de la mer, et n'est pas environnée de murailles comme l'ancienne, qui n'est presque plus habitée
présentement. On voit arriver tous les jours à Alexandrie un grand nombre de Maures & autres Affricains, à
qui on donne le nom de Maugarbins, gens sans aveu & (p. 26) vagabonds, qui causent de grands ravages
dans cette ville. Leur haine pour les Chrétiens, et en particulier pour les Francs, éclate dans toutes les
occasions ; et ils ne manquent pas de leur faire tous les jours quelque nouvelle avanie ; je fus témoin de
celle qu'ils firent à un Capitaine François, qui arriva au port d'Alexandrie. Un de ces maîtres fripons l’aidant
reconnu pour l’avoir vû sur un de ces Vaisseaux Maltois, qui vont en course sur les côtes de Barbarie, se
jetta sur lui, le maltraita & l’auroit tué si un Janissaire ne l’eut arraché de ses mains pour le conduire chez le
Cady. Il s’assembla dans le moment une troupe de ces Maugarbins, qui assiégèrent à coups de pierres la
maison du Consul, en cassèrent toutes les vitres, & y auroient mis le feu, si (p. 27) leur fureur n’avoit été
arrêtée par les Magistrats qui y accoururent pour réprimer cette sedition. La chose alla même si loin, qu’on
fut obligé d’écrire au Caire à Ibrahim Bey, qui faisoit pour lors la charge de Caimacan pendant l’absence du
Pacha, pour savoir de quelle manière on devoit se comporter à l’égard de ces nouveaux habitants. Ibrahim
envoia sur le champ ordre à Caffen Bey de purger la ville de cette canaille, & l’on travaille actuellement à
l’execution de ce projet.
L'ancienne Alexandrie n'a à présent que trois portes ouvertes ; celle de Rosette, celle qui conduit à la
Colomne de Pompée, et la porte verte. Toutes ces portes sont belles et bien bâties, et on y voit encore des
colomnes de granite et de porphire de (p. 28) la dernière beauté. Je fis le tour des murailles de la Ville, qui
sont en fort bon état ; mais il est aisé de juger que ce ne sont pas les mêmes qu’Alexandre y avoit fait
élever, comme Pietro della Vallé, qui ne les avoit pas apparemment bien examinées, l’a publié dans ses
Voiages : car quoi qu’on se soit servi pour les rétablir des mêmes mâtereaux, on voit bien qu’on en a
employé d’autres qui ne sont pas de la même antiquité ; on y en remarque qui ont servi à d’autres usages,
parmi lesquels il y a plusieurs morceaux de marbre, avec des Inscriptions Arabes qui n’ont aucun raport à la
construction de ces murailles. Ce que je trouvai de plus beau ce fut des Tours, qui sont pour la plûpart
ornées de Colomne de marbre granite : il y a quelques-unes de ces Tours (p. 29) qui sont si grandes qu’on
pouvoit y pratiquer de beaux apartemens pour loger les principaux Officiers : celle qu’on nomme le Palais de
Cléopâtre est de la derniere beauté ; les voûtes en sont soutenuës par quatre rangs de belles Colomnes de
granite : on y remarque encore plusieurs belles Salles, qui conduisoient dans des appartements trèscommodes
& bien entendus ; ainsi je croirois volontiers que quoique les murailles aient été rebâties, les
Tours sont les mêmes que celles qu’Alexandre y avoit fait construite.
Je découvris au pied des murailles, sur le bord de la Mer, plusieurs blocs de Porphire qu'il seroit fort facile
d'enlever pour en faire d'excellents ouvrages. Il y en a qui pèsent assurément deux ou trois milliers : j'en
enlevai (p. 30) un de cent cinquante livres que j'ai envoié en France, & on peut juger, par cet échantillon, de
la beauté du Porphire et de l'usage qu'on en pourrait faire. Toutes ces richesses sont fort inutiles aux Turcs
qui ne savent pas les mettre en oeuvre, & par conséquent n’en font pas beaucoup de cas.
J’allai visiter les Catacombes de cette fameuse Ville ; mais comme je n’y fit aucune nouvelle remarque, je
n’ajoûterai rien ici à ce que j’en dis dans mes autres Voiages. Ce qui me parut de plus beau & de plus
commode à Alexandrie ce furent les Citernes, qui y sont en si grand nombre, & si près les unes des autres,
qu’elles règnent presque par toute la Ville, qui est comme soûtenuë en l’air par une infinité de Colomnes &
de Voûtes. (p. 31) Comme il n’y a point dans tout ce canton de sources d’eau vive, il a été nécessaire de
construire ces édifices soûterrains ; ce que l’on a fait avec tant d’art & d’industrie, qu’elles se remplissent
aisément lorsque le Nil est dans une élévation ordinaire. Les Turcs, malgré leur négligence ordinaire,
entretiennent encore quelques-unes de ces citernes, sans quoi ils manqueraient absolument d’eau.
Je vis aussi en passant dans le milieu de la Ville, un rang de Colomnes de marbre granite, d’une hauteur &
d’une grosseur extraordinaire, dont il y en a encore une qui conserve son chapiteau ; ces Colomnes, qui
sont sur une même ligne, s’étendent près de 500 pas, & ne sont pas aujourd’hui dans une égale distance
l’une de l’autre, parce que (p. 32) la plus grande partie en a été enlevée ou abatuë, & l’on en voit encore
beaucoup de renversées. Entre celles qui subsistent, il y en a qui ne sont éloignées que de dix ou douze
pieds, ce qui fait juger qu’il y avoit sur chaque rang plus de 150. Encore faut-il supposer que la premiere & le
derniere qui se trouve sur cette ligne étoit effectivement aux deux extrémitez de ce rang ; ce qui n’est pas
vrai-semblable, puisque vis-à-vis de ces Colomnes on en voit à deux cents pas de là d’autres semblables
qui leur sont oposées ; & quoiqu’il n’en reste aujourd’hui que trois ou quatre, il est visisble, par la disposition
des lieux, par le même ordre, la même grosseur, qu’elles ne faisoient qu’un même tout avec celles dont je
viens de parler. Il paroit aussi (p. 33) par d’autres Colomnes, qui sont à une égale distance de ces deux
rangs, qu’il y avoit autrefois en cet endroit une superbe Fontaine ; l’édifice de brique, & les bassins où l’eau
tombait se voient aujourd’hui manifestement. Ainsi on peut conclure qu’il y avoit là une place superbe, dont
la figure composait un quarré long, large de 200 pas, & long de 500. Les principaux Palais de la Ville
faisoient sans doute les quatre faces de cette belle place, puisque derrière ces Colomnes, du côté où il en
reste un plus grand nombre, on voit quantité de Murs de brique, les uns renversez, les autres encore entiers,
qui laissent juger de la grandeur & de la beauté des édifices qui étoient en cet endroit. On distingue même,
parmi les Masures, des bains presque (p. 34) entiers, et j’en ai vû un, dont les murs étoient faits d’un ciment
si dur qu’il ressemblait à du marbre. Les Turcs en détachent tous les jours quelques morceaux pour faire
servir à leurs bâtimens. Mais comme ces ruïnes sont presque entièrement couvertes de sable, ils n’enlèvent
que ce qui paraît en dehors ; & s’ils voulaient se donner la peine de creuser jusques aux fondemens, ils
découvriraient bien des choses curieuses.
On voit de tous côtez dans cette Ville les tristes débris de Palais & des Temples, & on trouve à chaque pas
des Colomnes de Marbre & de Porphire sans parler de celles qui sont ensevelies sous terre, & qui sont sans
doute en bien plus grand nombre. On voit dans la Mosquée, qui est dans la belle Place dont (p. 35) j’ai parlé,
un rang de Colomnes de marbre qui sont de la derniere beauté, autant qu’on en peut juger en les regardant
par les fentes des portes ; car il n’est pas permis aux Chrétiens d’y entrer : cette Mosquée étoit autrefois une
église dédiée à S. Anastase.
Quand on est hors de la Ville, on ne trouve que de petites Montagnes qui se sont formées des débris des
maisons & des Palais, & on ne sçauroit y fouiller la terre sans y rencontrer des Médailles & de ces pierres
gravées, qui étoient autrefois si communes chez les Romains, & qu’ils portoient au doigt en maniere de
bague pour leur servir de cachet. Ces ruïnes sont si vastes, qu’elles renferment près de trois lieuës en
longueur & trois quarts de lieuë en largeur ; ensorte que la Ville & les Fauxbourgs, qui étoient (p. 36)
eux-mêmes aussi beaux que la Ville avoient sans doute toute cette étenduë ; ainsi Alexandrie, je parle
même de l’ancienne ; c’est-à-dire, de celle qui est environnée de murailles, n’est pas le quart aussi grande
aujourd’hui qu’elle étoit autrefois. Il y resterait cependant encore des Monuments d’une grande beauté, si
l’avarice et la superstition des Arabes ne les détruisoient tous les jours. On les voit encore détruire de belles
Colomnes, soit pour en bâtir leurs maisons dans la nouvelle Ville, soit dans l’espérance de trouver sous les
ruïnes quelques pièces d’or & quelques Médailles. On les a vûs, dans un tems de peste, briser, par
superstition, la figure d’un lion, qui étoit aussi belle qu’elle étoit ancienne ; ainsi ont péri tant de beaux
ouvrages, à qui la beauté (p. 37) & la solidité devoient assurer une plus longue durée. Et si la Colomne de
Pompée est encore sur pied, c’est que son poids énorme n’a pas permis aux Turcs d’arracher les pierres de
la baze qui la soutient. Ils sont pourtant parvenus à en tirer une d’un des coins, par où ils nous ont donné
occasion de voir dans celle qui suit des caractères hiéroglyphiques qui sont de la derniere beauté. Ce qui
prouve que cette Colomne, qui a été élevée en cet endroit par les Grecs ou par les Romains du tems de
Pompée, avoit été apportée de plus loin, peut-être de la haute Egypte ; car je ne doute pas qu’elle ne soit de
la premiere antiquité.
Pour ce qui est du Phare d’Alexandrie, qui étoit autrefois une des sept Merveilles du Monde ; il ne s’en voit
plus aujourd’hui que (p. 38) la Place ; encore cette place est-elle fort incertaine. La plus commune opinion
est qu’il étoit bâti dans le lieu où est aujourd’hui le Pharillon, qui est une petite Forteresse d’une architecture
moderne à l’entrée du Port, sur laquelle est élevé un second Château, sur lequel il y a une Tour où l’on fait
encore Fanal pendant la nuit ; il y a des voyageurs qui soutiennent que l’ancien Phare étoit plus avancé
dans la mer, & qui prétendent en même-tems qu’on en voit les débris sous les eaux quand la Mer est calme.
Quoiqu’il en soit, la question n’est pas aisée à décider ; ce qui est incontestable, c’est qu’il paroit qu’il y a eu
autrefois deux Ports à Alexandrie, qui subsistent encore aujourd’hui, l’un sous le nom de vieux Port, qui est
(p. 39) destiné pour les Vaisseaux & pour les Galeres ; il est si sûr & si profond, que les plus gros Bâtimens y
viennent aborder la Poupe à terre ; mais on ne permet pas aux Chrétiens Francs d’y entrer. L’autre qui a
moins de profondeur, & où il se trouve même quelques écüeils, étoit destiné pour les Galeres & les autres
moindres Bâtimens qui venaient à Alexandrie ; & c’est dans ce Port, dont l’entrée est si difficile & si
dangereuse, que les Francs sont obligez de mouiller. Ce Port étoit environné, du côté du Levant, d’un Mole
en maniere de demi cercle, qui aboutissait au lieu où sont les écüeils dont j’ai parlé, & le couvroit de ce
côté-là ; il subsiste encore en partie, ainsi qu’une petite forteresse qui est au bout, d’où on pourroit faire
Fanal. Du côté du (p. 40) Couchant il y a un second Mole, depuis les Murs de la Ville jusqu’au Pharillon, qui
est placé sur l’extrêmité de l’Isle, qui forme le vieux Port & qui répond au premier Mole ; ensorte que le Port
des Galeres n’étoit séparé de l’autre que par le second Mole qui subsiste encore à présent, quoiqu’à demi
ruïné, comme le premier. A l’endroit où cette seconde Digue touche à la Ville, du côté du petit Port, il s’est
insensiblement formé un terrain entre les deux Ports, où les Turcs ont bâti depuis vingt-cinq ou trente ans
leurs maisons pour être plus près de la Mer, & ont ainsi abandonné l’ancienne Ville qui est aujourd’hui
presque entièrement deserte. On montre encore à Alexandrie le lieu où l’on enseignoit autrefois les
Sciences, qui (p. 41) rendirent cette Ville si florissante, parmi lesquelles la Philosophie & l’astrologie, ou
plutôt les Matématiques, tenoient le premier rang. On les enseignoit d’abord sous des hiéroglyphes, dont les
anciens Egyptiens étoient les inventeurs ; car ils ne vouloient pas que ces Sciences fussent communes à
tout le monde ; ces docteurs étoient à peu près en Egypte, ce que les Mages étoient entre les Perses ; les
Chaldéens chez les Assiriens ; les Bracmines dans les Indes, & les Druides parmi les Gaules ; c’est-là
qu’avoit étudié Homere, Orphée, Pithagore, Platon & ces autres grands hommes, qui portèrent ensuite dans
la Grece ces belles connoissances qu’ils avoient puisées en Egypte.
On voit encore dans cette Ville l’Eglise de S. Marc qui est (p. 42) possedée par les Chrétiens Coptes : c’étoit
autrefois un fort bel édifice, mais il est à présent fort dégradé ; on y montre quelques degrez & une partie de
la Chaîre, où l’on prétend que S. Marc prêchait autrefois l’Evangile à ce peuple infidelle. Elle est encore
presque dans toute sa rondeur & elle est revétuë par dehors de pierres de diverses couleurs. On voit aussi
dans cette Eglise un morceau d’un Tableau qu’on prétend avoir été peint par S. Luc. Il représente l’archange
S. Michel : ce n’est qu’une figure à demi corps, avec une épée à la main fort grossièrement peinte ; outre ce
Tableau dont on ne ferait pas grand cas sans l’honneur qu’on lui a fait, de dire qu’il a été peint par le saint
Evangeliste ; on montre un morceau sur un Autel qui est assurément de meilleur (p. 43) goût, aussi y a-t-il
été aporté de l’Europe par un consul François ; il représente la Vierge Marie avec nôtre Seigneur. Le corps
de S. Marc, qui souffrit le martyre à Alexandrie l’an 46 de Jésus-Christ, a été conservé dans cette Eglise,
jusqu’à ce que quelques Marchands Venitiens, qui revenoient de la Terre Sainte, le transportèrent à Venise.
On montre aussi dans l’Eglise de Ste Catherine la Colomne où elle eut la tête coupée, & on y voit aussi
plusieurs peintures d’un assez bon goût.
Je partis d’Alexandrie le 15 pour retourner à Rosette par le même chemin où j’étois venu, & j’y arrivai le soir
du même jour : comme on avoit eu soin de mettre un Bâteau à l’endroit où la Digue étoit rompuë pour
passer les Voiageurs, je ne courus (p. 44) aucun danger cette fois-là. Cependant l’eau entroit toujours avec
beaucoup de violence dans les terres, & si on n’y mettoit ordre, tout le païs, dont la terre est plus basse que
la Mer, pourroit bien-tôt être inondé, & ce que l’on a appréhendé tant de fois ariveroit infailliblement, sur-tout
s’il survenait une tempête aussi terrible que la derniere qui rompit la Digue ; si même l’eau de la mer entroit
une fois dans les Canaux du Nil, on serait obligé d’abandonner Alexandrie, parce qu’il n’y a point dans cette
Ville d’eau bonne à boire, Dii tales avertite casus. »
- 595 - 597 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHARLES DE SAINT-MAURE (février 1721)
Saint-Maure, Ch. de, Nouveau voyage de Grèce, d’Égypte, de Palestine, d’Italie, de Suisse, d’Alsace, et des
Pais-Bas, fait en 1721, 1722, & 1723, La Haye, 1724.
p. 67-73 :
IX LETTRE
« Nous avons toûjours eu le vent en poupe depuis Rhodes jusques en Alexandrie, où nous sommes passez
dans trois jours. Cette ville doit son premier lustre au Grand Alexandre qui la fit rebâtir, & l’honora de son
nom. Les Rois qui l’embellirent successivement, en firent leur Capitale : la Reine Cléopatre acheva de la
rendre après Rome la plus considérable de l’Univers : elle est située entre la mer & un bras du Nil : elle ne
montre aujourd’hui que des tristes restes de la magnificence de ses Princes & de la libéralité des Empereurs
Romains, qui la distinguèrent infiniment. Ses habitans fourbes, railleurs, & voluptueux, furent vaincus par
César qui les attaquant dans leur port fit brûler leurs vaisseaux ; le feu se communiqua à leur fameuse
Bibliothèque, consuma les meilleurs originaux, les plus beaux manuscrits & les premiers livres qu’on eût
encore écrits : c’est ainsi que périt le grand trèsor qui enrichit tant de savans. La Tour du Phare qui passoit
pour une des merveilles du monde, & qui subsiste encore, n’est gueres en meilleur état que deux petits
châteaux que l’on trouve à l’entrée du port. Les murailles de la ville fort basses, & parfaitement négligées ne
se sont mieux conservées que les cent-vingt Tours qui les défendent. J’ai vû une belle colonne d’un granite
gris haute de six vingts pieds sans le chapiteau, posée sur un pied d’estal fort bien travaillé, mais qui se
mine insensiblement : elle porte le nom de Pompée sans qu’on en sache positivement la raison : tout ce que
j’en puis apprendre de plus clair, c’est qu’elle ne fut élevée qu’après la bataille de Pharsale : quoi qu’il en soit
c’est un des plus beaux monumens que nous tenions de l’Antiquité. Des Religieux Grecs occupent le
couvent de Sainte Catherine, où ils montrent le lieu de sa demeure, & celui de son martyre. Il m’on fait voir
en même tems une colomne de marbre blanc qui a des veines rougeâtres qu’ils ont voulu que je prisse pour
du sang de cette vierge : je n’ai pas eu la complaisance d’en convenir avec eux ; ni de trouver leur Eglise
belle, quoiqu’ornée d’une Chaire où St. Marc selon leur tradition doit avoir monté souvent pour annoncer aux
Alexandrins les véritez de l’Evangile. C’est dans cette abbaye que demeure le Patriarche qui n’est pas en
meilleur odeur que les autres. Nous avons passé du couvent de Sainte Catherine aux deux Aiguilles de
Cléopatre qui sont incontestablement deux obélisques des anciens Egytiens : l’une est debout, l’autre à
demi enterrée par sa pointe : elles sont d’un marbre granite rougeâtre, chargé d’hyérogliffes dont personne
n’a la clef : elles peuvent bien avoir quatre vingts pieds de hauteur. C’est entre ces deux Aiguilles que
quelques Antiquaires placent le tombeau d’Alexandre, dont on ne voit aucune preuve. On trouve assez près
de là une place entourée d’amphithéâtres que le tems n’a pas plus épargnez que le reste : c’est sans doute
la place où se donnoient les Jeux Publics. Ce que nous voyons encore du tems de Cléopatre, ne nous
persuade point que cette reine fut aussi superbement logée qu’on veut nous le faire croire : je suis entré
dans une Tour ronde qui en faisoit partie, où j’ai vû des chambres assez entières pour le faire juger que si ce
bâtiment passoit alors pour magnifique, il faloit que la pierre qui n’y est pas épargnée fût bien chère, ou bien
rare dans ces tems-là. Il y a aussi quelques colomnes qui ne sont assurément ni de marbre, ni de granite,
quoi qu’en disent des auteurs modernes qui nous donnent des relations des voyages qu’ils n’ont peut-être
faits que dans leurs cabinets ; ou qui parlent plus en poètes des lieux qu’ils ont effectivement parcourus
qu’en ecrivains fidèles. Après avoir visité les débris du palais de Cléopatre ; nous avons été sur le vieux Port
qui est sans contredit un des meilleurs & des plus beaux que la nature ait faits. Mais les Chrétiens n’en
peuvent profiter ; les Turcs ne permettent point qu’aucun de nos vaisseaux y mouille. Nous avons traversé
pour nous rendre à ce port, toute la nouvelle ville qui n’est ni belle, ni bien bâtie ; à l’exception d’une
mosquée, & de l’Oquelle où loge le consul de France. Ces Oquelles qu’habitent nos négocians, sont comme
des grands corps de cazernes d’officiers, séparez ou détachez des maisons que les Turcs occupent. Une
grande & vaste place aussi peu pavée que le sont les rues des villes de Turquie, sépare la nouvelle ville
d’avec la vieille qui est misérable. Un corps de cavalerie de trois mille Arabes, campoit il y a deux jours sur
cette place que l’on nomme le Plan : je me suis mêlé avec eux comme si j’eusse été parmi nos troupes :
celles-ci ne m’ont paru ni belles ni bien exercées. Je remarque dans les portes de l’ancienne Alexandrie
quelque chose d’assez particulier ; c’est que le fer de ces portes étoient revêtues est presque tout mangé, &
que le bois que l’on dit être de gemesse est très bien conservé. Toute l’eau que l’on boit ici vient du Nil par
des canaux nommez Kalis, qui la conduisent dans des citernes sous les ruines de l’ancienne ville : quoique
cette eau ne paroisse pas fort claire, l’on n’en boit pas de plus saine. »566
566 Cette lettre date du 6 février 1721 d’après la version anglaise.
- 598 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHANN AEGIDIUS VAN EGMONT (1720-1723) ET JOHANN HEYMAN (1700-1709)
Aegidius van Egmont, J. et Heyman, J., Travels through part of Europe, Asia Minor, the Islands of the
Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai, Londres, 1759.
Aegidius van Egmont (1697-1747) est envoyé par « the United Province » à la cour de Naples. Entre 1720 et
1723, il visite le Levant. Quant à John Heyman (1667-1737), professeur des Langues Orientales à
l’Université de Leyde, il voyage dans le Levant entre 1700 et 1709. Dans le texte publié, il est impossible de
discerner la part de chacun d’entre eux car les deux récits ont été combinés ensemble par l’éditeur, neveu
de John Heyman. De plus, ce dernier aurait inséré des passages empruntés à d’autres voyageurs sans citer
ses sources. À noter qu’au cours de leur périple, les deux voyageurs relèvent de nombreuses inscriptions
grecques.567
p. 118-142 (tome II) :
« We left Rosetta at break of day, and after passing trough a wood of palm trees, we came to a fandy plain,
not having a single tree in it ; and where the traveller would often lose his way, by the perpetual shifting of
the sand, were it not for several round towers, about twelve feet high and three in diameter, built within fight
of one another, by which the traveller is directed to the sea-side. But after travelling about one hour on this
plain, we met with a refreshment which merits the thanks of all who travel over this desert. It consists of three
large jars full of excellent water. They stand under a cupola of stone supported by four (p. 119) brick pillars.
This water is brought fresh every day from Rosetta on mules.
After our arrival on the sea-shore, we travelled along it till we were about midway, where there is a large but
very different caravansera, called meidia, situated on an arm of the sea, which you here ferry over. In this
building the ferryman and his servants live, in order to attend travellers. And this is the only place on the
whole roadwhere you can pass the night ; though it is none of the safest, on account of the frequent
robberies commited in this country by the Arabians and Bedouins. Every stranger for himself and mule pays
nine paras, about sixteen pence sterling, for passing over. The water of this arm of the sea is salt, except at
the time of the inundation of the Nile, when it’s perfectly fresh.
After passing this creek, we continued our journey for some time along the coast, and then turned up the
country, leaving on the right, Bequier, a village and castle, before which, during the summer, is good
anchoring for ships, and is thence considered as the road of Rosetta. In the mean time, that we might omit
viewing no object that deserved attention, we approached the castle, in order to survey it and the road more
attentively.
It lies about twenty-one miles N. E. of Alexandria, and is sheltered from the sea by small uninhabited island,
having on it neither water nor tree. The castle, which commands this road, is built on the point of a rock
projecting into the sea, and about three miles from the island. It is an irregular and ill fortified quadrangle. In
the center of it is a large round tower pretty lofty, the top of which serves for a light-house.
This castle has a battery of eight brafs cannon, from four to six pounders ; but the works in no better
condition than those at Rosetta. The embrasures are about half the height of the wall, and under them a
(p. 120) masked battery level with the water’s edge. The wall is about eighteen feet high, and eight or nine in
thicknefs ; but in several places wants repairing. The entrance of the castle is on the west side, over a
draw-bridge ; for the whole fortification is surrounded by a moat near thirty feet wide and twelve deep. The
garrison conflits of about twenty-five Arabians, to whom the Governor allows free quarters, on condition, that
on the firth signal made by the castle, they immediately repair to their duty. The inhabitants of the village also
do the same.
These parts are entirely destitute of wood, so that the inhabitants of the village are obliged to purchase it of
ships coming from Constantinople and Natolia. But this is generally done by way of barter, giving in
exchange horned cattle, game, &c. which they have in plenty ; but vegetables of all kind are very scare.
The next morning early we arrived at Alexandria, having left on our right hand the ruins of an ancient
structure, which we were assured was once the palace of Catharina’s father. We entered Alexandria
thro’ one of the gate of the old city, called Rosetta gate, where three medins were demanded of each. After
passing through the old city, we came to another gate leading to the new city, built between the old and the
new harbour.
Here we took up our lodgings with Mr. Thomas Hume, secretary and vice-consul to the English nation. He
resided in a kane, where several French merchants also had their quaters. There is likewise another building
of the same kind for the French vice-consul, where several other merchants of the same nation reside, and
have in these kanes very convenient apartments.
Alexandria, formerly the strongest and most considerable city of all Egypt, and still by the Jews called
No-Ammon, has now, like many other in the east, totally lost its ancient splendor, and would probably have
been long since lost and buried in oblivion, had not the conveniency of its harbour for trade and navigation
supported its tottering condition, and left it considerable remains. The old city however is little the better for it,
the whole terminating in the new, which has been built on the sea-shore, without the wall of the former. It lies
in a level sandy country : On the north is a very beautiful port, defended by two forts built on each side of this
entrance ; and on the south side is a lake Mareotis, about five hundred toises from the city. The old port,
which lies on the west of the city, is one of the best in all the Mediterranean : The two ports are separated
only by a peninsula, is a sort called the great pharillon, of which I shall speak further in the sequel.
This peninsula appears to be the ancient island of Pharos, which lay before the port, and was, by Cleopatra,
joined to the continent ; and on it, in the time of Ptolemy Philadelphus, was the celebrated Pharos, a tower of
white stone, built by Sostratus Gnidius, to serve as a light-house, for the safety of mariners ; and from
whence the light-houses, among the Greeks and Latins, were called Phari ; and probably the modern
Turkish and Greek words Fanar and (en grec), are derived from the same source, as they signify a beacon,
or lantern.
This city, whole circuit is not small, for it took us up an hour and a quarter to ride round it, was inclosed by a
double wall, faced with free-stone. These walls consisted of curtains and large towers, with smaller between
them, to the number of sixty or seventy, and mostly square, though some were round, and others oval. They
had also in general three stories, and each several apartments, which in my opinion, would hold some
hundreds of soldiers for the (p. 122) defence of each. They had also loop-holes all round, according to the
manner of the ancients.
These walls were very firmly built, and six or seven feet thick, and in some places surrounded with a moat
about seven toises in breadth, but at present quit filled up. There were, however, no outwoks of any kind to
hinder the approach of an enemy. On the south side of the city great part of the inward wall is still remaining ;
it is five or six feet higher than the outward, and the space between them twelve feet. The inner wall has also
small round and square towers, like the outward. But the far greater part of both these walls is now entirely in
ruins, not being kept in the least repair.
Possibily it may be thought, that these walls were built by Alexander the Great, who changed the name of
this city into Alexandria, is original appellation being Leontopolis, from the figure of a lion on the signet with
which, according to Philip’s dream, the womb of Olympias was sealed. But these walls do not appear to me
to be so ancient ; for first, the very architecture of them seems more modern : secondly, we read of an
earthquake, by which this city was entirely ruined ; and thirdly, the circuit of these walls is not of an extent
answerable to the descriptions left us, by the ancients, of this celebrated city ; as after the destruction of
Carthage it was, next to Rome, the largest city in the known world. These reasons induce me to differ from
some respectable antiquaries ; and to consider these walls as a work of the Saracens or Mammelukes.
In the mean time, the whole space within the walls and towers is now almost entirely forsaken, most of the
inhabitants having retired into the new city, which is erected on the spot where the ancient suburbs stood ;
namely, on the peninsula which separates the two ports. This city confines (p. 123) on the south side on the
walls of the old, but towards the sea it has no other defence than the two castles at the entrance of the port ;
and these are badly provided for making any long defence, as will appear in the sequel. The houses are in
general better built than in most other Turkish towns ; but in very thing else it nearly resembles them. Most of
the Franks live in kanes, here called okel, and which are all stately edifices. However, one great
inconveniency in this new city, is the want of water, which the inhabitants are obliged to setch daily from the
old town, in luders, i. e. ox or buffalo skins, on camels or asses. And this, I think is a sufficient proof, that in
ancient times this part was not inhabited ; as otherwise it is natural to think, reservoirs would have been
made here as in old Alexandria.
Three of the gates of the old city are still remaining in tolerable condition ; and these are every night locked
in presence of the commander of the fort, called the Great Pharillon ; but no guard is placed for their security.
Near the Rosetta gate is a long street, inhabited by three hundred and fifty families of tradesmen ; and on the
south side of the city, near the pepper gate, is a small street, still called Bazar, inhabited by about forty or fifty
families. There is also a third gate on the north side of the city, at the end of a little street, called also Bazar,
where, not long since, about twenty families resided. The Venetian consul, at that time, had also his house
there ; but at the present it is altered into a handsome convent belonging to the fathers of the Holy Land ;
and near it are also some remains of shops.
At present, the inhabitants of the city of Alexandria, who are native of the country, do not exceed six
thousand ; besides which there are about sixty Christian families, sixteen of whom are Roman Catholics. And
among these inhabitants, two thousand (p. 124) and five hundred are able to carry arms ; tho’ seven
hundred only receive pay from the Grand Signior, as doing duty in the city and castle, exclusive of a hundred
janizaries under a soubasci, who also receive pay ; but are ill disciplined and badly armed, most of them
having only a sabre and lance ; but no fire-arms, not even pistols.
The magistrates of Alexandria are foreign Turks, nominated by the Pascha of Cairo for governing this city ;
but are generally an abandoned set of men, given up to sloth and licenciousness, and whose chief study is
to squeeze the people committed to their care.
The air of Alexandria is so salubrious, that Celsus mentions it as a common rule among the physicians, to
send their wealthy patients, labouring under a consumption, to Alexandria ; and Curtius says, Nullo fere die
Alexandriæ solem serenum non videri propter aërem perpetuo ibi tranquillum, i. e. There is not a day in
which it is not fair weather at Alexandria, the air being there constantly calm and serene.
The seasons of the year are but little different from those of Italy and Provence ; but the cold is less, and the
heat considerably greater. The rains generally begin in the month of November, and last till February ; but
instead of being violent, they are very gentle and pleasant. As to the winds, which here, as in most countries,
prevail principally in the winter, are the north, north-west, and south-west. At the beginning of the year, and
in autumn, these winds are also common, but blow with less force, and towards evening very little is to be
felt. Sometimes the north-east wind greatly moderates the excessive heats ; but the most convenient season
for visiting Alexandria is in spring, or, at farthest, in the month of May ; for by that means, both the rains and
extreme heats will be avoided.
I have already observed, that this city has two ports, the new, on the north side, and the old on the west. The
latter is thought to have been formerly larger than at present, the sea being retired, as appears from several
broken pillars in it ; and some will have it, that the spot, on which the new city stands, was formerly covered
with the sea, which almost touched the walls of the ancient city. But this port is still spacious, and defended
by two castles, called the great and little pharillion. The former is situated on a neck of land, on the west side
of the entrance of the port ; but is both irregular and badly fortified. In the middle of this fortification is a large
square, having at each angle a small round tower, and raised about six feet above the outward ramparts. In
the center is a very high minaret, or tower, serving as a light-house, for directing ships into the port in the
night.
The outward walls seem to be in very bad repair ; they are about eighteen feet in height, and ten in
thickness. Near the foot are about forty port-holes, for shouting parallel with the surface of the water, but
were close shut, so that no gun appeared ; tho’ I was assured the fort was well provided with ordonance.
Through ports about the middle of the wall I saw twelve-pounders ; and the parapets, both of the outward
rampart and the square within, are covered with tenter-hooks, and full of loop-holes.
The castle called the little Pharillon is erected on a small island at the entrance of the port, facing the great
Pharillon. It is only a mosque defended with a few iron guns, badly mounted, and round the mosque are a
few mean houses.
It is possible to tell the precise number of canon in these two castles, no person, except the Turks of the
garrison, being allowed to stay long enough in them to take a particular view. And these, it is natural (p. 126)
to suppose, are commanded to observe a strict silence, with regard to thier state of defence ; which,
however, is suppose to be none of the best, either with regard to stores, or the discipline of the garrison.
Provisions and ammunition also are not very plenty in these fortifications ; though these could, on occasion,
be readily procured, the city being at no great distance, and the powder magazine close to the walls.
The mouth of the old port has no fortification to defend it ; for the two ruinous forts at his entrance do not
deserve that name. They are, indeed, garrisoned by four or five men ; and a few small brass pieces are
pointed through apertures in the wall of the old city, but are not in condition to fire a shot. Nor is a mosque,
which has been turned into a battery, from its convenient situation near the old port, of much more
consequence.
At the mouth of this port are several rocks, which break both the force of the current and the waves. But
when the wind blows from the shore, ships must be very careful. The bay itself, however, is very convenient,
and not inferior to the best harbour in the whole Mediterranean ; and for this reason the Grand Signior’s
ships lie here, seven of which were in this port, when we were at Alexandria. They ride in eight fathom water,
about a pistol-shot from the land. The bottom also is very good ; so that they are safe both from winds and
sea.
Christian ships are not allowed to ride here, not even to enter the port, unless driven thither by stress of
weather ; and then, as soon the storm is over, they must immediately put to sea. This is entirely owing to
certain prophecies, that the Christians will, at some particular time, (enter the old port, and make themselves
masters of the city. And hence (p. 127) it is, that we have no complete draught of this port, and the depths of
water in it.
The French nation, however, are said to have obtained lately from the Porte, liberty for their ships to come
into this harbour, and ride there as long as they pleased, under pretence, that they could ont lie in the other
harbour, without great danger ; but their real intention was, to ship more easily clandestine goods, as corn,
rice, and other provisions, of which they were, at that time, in the greatest want. The people of the city,
however, openly opposed their lying in this port, notwithstanding the emperial licence ; for it must be
remembered, that the Egyptians pay no farther regard to the Grand Signior’s orders, that suits with their
humour.
As this harbour is in no state of defence, it would be very easy to make a descent close to the suburbs, there
being a sufficient space for landing the troops. Nor would the city be capable of defending itself any time ; for
the Arabians, who are miserable soldiers, would, on a few bombs being thrown into the place, betake
themselves to flight, and leave the army at full liberty to execute their designs.
With regard to the entrance of the new port, it is on the north side something dangerous, on account of the
shallows at the mouth of it. On coming in, at about a cable’s length from the great Pharillon, and close by a
rock called the Diamond, you have twelve fathom water, and from thence you must stand directly for the city
gate, till at a proper distance from the shore, where you will find good anchoring-ground. About two cables
length E. N. E. of the Diamond, is a very dangerous shoal, having only six feet water on it. The
merchant-ships generally come to an anchor near the great Pharillon, in four or five fathom water, being
there secured from the north and north-east winds, which are here the most dangerous ; not only blowing
with great violence, (p. 128) but at the same time causing such a hollow sea, that it is hardly possible to go
on shore in a boat ; and the cables are in great danger of being cut by the sharpness of the stones at the
bottom.
There is no wood here, except a few palm-trees ; so that they are obliged to fetch it from the coast of Natolia
and the Black-Sea, which renders it extremely dear. Fodder for beasts is likewise so very scarce, that it
would be impossible to subsist a small body of horse here a fortnight.
The Arabians of Barbary, called Magrebins, are continually at war with those of Egypt. They always appear
extremely well mounted, and armed with swords and long spears ; but seldom with fire-arms. They are
likewise very vigorous and hardy, but ill disciplined ; though better than those of Egypt. These two Arabian
tribes, however, if at peace between themselves, would be able to bring an army of ten thousand men into
the field, and, consequently, to defend the coast of Egypt.
From what have been said, the reader will naturally conclude, that few refreshments are to be expected at
Alexandria, except such as are brought from Rosetta, and the adjacent villages. The trade, however, is pretty
considerable. The principal exports are sugar, rice, lintfeed, all kinds of grain, linen, salt, cassia, the hides of
buffaloes, oxen and camels, safflower, frankincense, gum-arabic, elemi, myrrh, salammoniac, and other
drugs, dimittes, cotton, and coffee ; but the latter is prohibited to the Franks ; so that they must give large
bribes, if they intend to procure a large quantity of it.
Here are also palm-trees ; but the exportation of them is also prohibited, as well the parts of them are applied
to some use : The leaves are used in making cordage and baskets, the small branches for lattice-work
before the windows ; the wood for building of (p. 129) houses ; the ship for fuel ; and the fruit, which is very
palatable, for food. But to procure fruit, it is necessary to plant the male trees near the female, that the
blossoms of the latter may be impregnated with the farina of the former. In the forests of the palm-trees,
which often extend several days journey, you will generally fee but one male to numbers of female trees ; but
the wind dispersing the farina, or maledust, fructifies them all.
Before I proceed to describe the antiquities in Alexandria, I shall mention an experiment that had been often
told us, namely, that by mixing flour with water, and placing it in the evening before a window, wether open
or shut, the flour, during the night, would serment as if mixed with yeast. This phænomenon is supposed to
be owing to the dew, that, in these parts, begins to fall about the sixteen of June, when the plague, which is
very common here, generally ceases. And it was on that day we made the first trial, and continued it for
several days, the effect being contantly the same, as we had been told.
I shall now proceed to the antiquities, among which, in the old city, is an assemblage of ruins, called
Cleopatra’s palace, consisting of large arches, prodigious fondations, and scattered fragments of pillars. But
all these ruins, which are considered as so many superb remains of antiquity, do not answer the idea which
we conceive from reading the accounts of historians relating to that magnificent princess ; so that I much
question, whether her palace did not stand in some other part of the city.
Here are also two beautiful obelisks of granite, one being still standing on its pedestal ; but the other thrown
down and partly buried under the earth. In the first it is observable, that the sides facing the north-west and
south-west are best preserved, and still present the spectator with a distinct view of the (p. 130) ancient
hieroglyphics : while, on the contrary, notwithstanding the hardness of the stone, the north-east and
south-east sides are extremely damaged, large scales falling from the stone ; si that there is no
distinguishing the characters.
The obelisk still remaining on its pedestal, is fifty-four feet above the surface of the ground, and about twelve
beneath it. The pedestal is a flat square plynthe, eight feet on each side, and six in depth, formed out of a
single block of greyifh marble, or granite, and projects fourteen inches on every side beyond the base of the
obelisk. This obelisk is greatly injured by time, espacially near the base. Some are of opinion, that it is only
fifty-seven feet high ; and that no more than three are buried under ground : And all agree, that it was
brought thither from other place.
Near this supposed palace of Cleopatra is a tower of a stupendous magnitude, and remarkably bold
architecture. You first enter into a large hall, the ceiling of which is supported by two large pillars, and on the
capitals of them several Greek inscriptions ; but the injuries they have received from time, and the great
height of the ceiling, render it impossible to transcribe them. In this hall was also a reservoir, but at present
full of rubbish.
From this hall we ascended, by a flight of free-stone steps, into another room, the roof of which was nearly
flat, but without any thing to support it, except the side walls. Another flight of steps led us to a terrace, from
whence we had a beautiful prospect of the city, and the sea.
This structure, which was of the tower erected on the walls of the ancient city, is built of very white and
smooth circular stones, and the interstices filled up with small round pebbles, about the size of a farthing.
The intermixture of small stones, which are a kind of marble, and supply the place of cement (p. 131) or
mortal, renders it probable, that they are of that kind which the ancients made by fusion ; for it plainly
appears, they are of a singular composition. Between the large blocks of free-stone in this building is
surrounded with a high wall, without any aperture except the door, in order to secture it from the
depredations of the Arabians. In this convent are the church and the cells of the religious, of which there are
about ten, with nearly the same number of Christians under them, exclusive of foreigners, who come hither in
ships. Thus has the Almighty manifested his judgments against No (c) ; for the particular church of
Alexandria lies even in the dust.
This convent is the residence of the Patriarch of Alexandria, whiles he continues here ; but for some years
past Alexandria had not been suffered to enjoy this satisfaction, the prelate being obliged to reside at
constantinople. The epitropus, or vicar, received us with great courtesy, and accompagnied us in person to
the church dedicated to St. Catharine. This structure is much more spacious than the generality of Greek
churches in this country, which are indeed, for the most part, little more than caves, and subterraneous
recesses. The religious shewed us here in a chest, a block of white marble, in the form of a pedestal, having
on the top of it a cross in basso-relievo ; and pretended, that St. Catharine was beheaded on this stone ; and
in confirmation of this legend, shew some black specks, which they will (p. 132) have to be marks of her
blood ; and also, a cut in the stone, done by the axe. But notwithstanding these pretentions of the monks, it
is evident, that this stone is a counterfeit ; for the cross is square, after the manner of the Greeks ; and on
each side of it, two small pillars. Yet hither the poor Greeks come to kiss it, and to lay pieces of linen on it,
which are considered as very efficacious against all kinds of diseases.
Soon after, being in conversation with the vicar and the other religious, I told them, I had long desired to see
the patriarchal church of Alexandria ; but they answered, that its splendor was extremely obscured. On which
I took the liberty to say, that the introduction of superstition and idolatry into the churches of these countries,
and their obstinate perseverance in such practices, contrary to the divine admonitions, had induced
providence to remove the candle-stick of the gospel from hence into Europe. As they did not seem angry at
what I said, I ventured to touch on the worship of saints, and the paintings and imagery in their churches,
shewing the impropriety of them from the sacred writings. But all the answer I received was, that they only
followed the exemple of their predecessors.
Near this church is another, dedicated to St. George, and on the left a chapel, where the fathers of the Holy
Land are allowed to celebrate mass. Not far from hence we saw a ruined building of the ancient Franks, or
Italians ; and hard by the convent and church of the Succolanti, which have hitherto continued in the
possession of a few fathers, who perform divine service after the manner of the Roman church ; but at the
same time may be said to be in a prison ; for the buildings are inclosed with a very high wall, and they are
obliged to keep a constant watch at the door, to secure themselves from the Arabians.
(p. 133) We also walked to the old city, to visit the church and convent of St. Mark, now in the land of some
Coptis, or Coftis, i. e. Egyptian Christians. This church, like the former, is surrounded with a wall without any
aperture except the door. The church itself is only a small dark grotto, tho’they take great pride in shewing
several pictures of the blessed virgin, which they pretend were pained by St. Luke, and particulary a portrait
of the evangelist St. Mark. The religious belonging to this church, though not more than four, were equally
remarkable for their poverty and ignorance. They earnesty begged alms of us, and in return shewed us, on a
small altar, the head of St. Mark, or rather the casket in which it is said to be preserved. In this church we
were also desired to observe a large pulpit inlaid with pieces of fine earthen-ware, and which they affirmed to
have been the same in which St. Mark often preached. They likewise shewed us an arm of St. George, and
a whole length picture of St. Michael, pretended to have been done by St. Luke.
We also went into one of the towers on the city wall, where we found several chambers still entire, and
probably served as barracks for the soldiers. Here is also a large structure, said to have still witin it stately
piazzas of corinthian pillars ; but Turks only are permitted to enter it. Nor is it safe for a Christian even to
come near the walls ; so that nothing can be said of it with a multitude of cupulos supported by pillars. It is
added, that in it is a chest which no man can approach, at least not open, there being several instances of
persons, who, on attempting it, have dropt down dead ; and hence it is, that the Turks keep a guard on the
out-side of this building, and allow none to enter it, on any account ; for we (p. 134) made a very handsome
offer to be admitted, but were refused.
The Jews, from whom we had the above account, will have this to be an old temple built by Nicanor for the
Jews, who fled in multitudes to Egypt, from the cruelties of Nebuchadnezzar ; and this they pretend to prove
from a certain passage in their Talmud. But with regard to the dangerous chest, they acknowledge
themselves entirely ignorant. Others are equally positive, that it was a church to St. Athanasius.
Not far from this structure are two large pillars of granite still standing, and others lying on the ground, and
half buried under the ruins ; but none have any capitals, though it is easily seen, that all their parts are in true
proportion. Some suppose there was a street here, adorned on each side with piazzas, while others think
them to be the remains of Cleopatra’s palace. Near these are also some ruins of structures built with bricks ;
the space between them lies in a direct line, and is of a considerable lengh and breadth.
We next visited some of the reservoirs, or cisterns, which are extended under the greatest part of the ancient
city. You enter them through apertures made in the walls. They are all covered with arches supported by
pillars. The form and architecture of them are very curious, and deserve the attention of a traveller ; but they
are not all of the same dimensions. One of them was remarkably capacious, and its arched ceiling supported
by fourteen pillars. Others we saw which consisted of three ranges of arches on each other, after the manner
of the ancient aqueducts. But the greatest part of these cisterns rested on pillars ; so that old Alexandria
might have been said to have been built on pillars. These cisterns had formerly pipes, or conduits, by which
they communicated, and through which the water flowed (p. 135) from one to another : But at present, the
greatest part of these conduits are stopped up, and many of the cisterns themselves ruined by the falling in
of the arches over them. Other cisterns are also frequently found here by digging ; and the discoverer is
intitled to a reward, as the water of the Nile will keep a great while in these subterraneous reservoirs.
With regard to the manner of conducting the water into them, it is as follows : When the Nile has reached its
proper height, they cut the banks, in order to lay the lands of Egypt under water, when a current of it is
conveyed from Cairo to Alexandria by a canal, formerly one of the mouths of the river, and called Ostium
Canopium ; but by the negligence of the Turks, the river has lost that channel ; a circumstance not to be
wondered at, as the Nile has no strong current in these parts, the whole country being nearly level. And
hence it is, that the Nile hereabouts has no falls like the rivers of Europe.
The water of that branch, or canal, running from Cairo to Alexandria, is conveyed into the large cisterns by
subterraneous passages, and from them, by wheels, thrown into the smaller, which were, in all appearance,
originally constructed for the use of private houses ; and in these the water is kept during the whole year.
In the old city is an eminence called Belvedere, which very well deserves that name for its beautiful prospets,
extending over the whole harbour, and on the west side over a cape, noted for the burial-place of a Turkish
santon, and near which the ships generally sail when they enter the harbour, in order to avoid the many
sunken roks lying at a greater distance from the shore. Hence we have also a view both of the new city and
its harbour, and also a part of the old, some of it being concealed by St. Catarine’s hill. But amidst all these
delighful prospects the ruins and confusions of this city, anciently so (p. 136) famous for its splendor, fill the
mind with melancholy reflections : The new city, which has been built out of the ruins of the old, not being
comparable to it. The most beautiful particular in the latter is, a large aera of mosque, in which, among other
remarkable objects, is a colonade of exquisite pillars of the Corinthian order, running round the mosque.
In our return we saw, near the wall of the old city, a large bason, into which the water runs from the city
canal, and from whence it is setched in goarskin bags, on camals, for the use of private houses. We also
entered a tower on the city wall, which had a grand aspect, and found in it room sufficient for five hundred
men, and on the top of it a temple decorated with a great number of elegant pillars.
We next visited Pompey’s pillar, the khali or water canal, the lake formerly called Palus Mareotis, and the
catacombs. With regard to the column commonly called Pompey’s pillar, it stands on a sandy hill, not far
from the pepper-gate, and is seen at the distance of three leagues at sea. This piece is an astonishing work,
and is, indeed, the largest in the whole word, standing still entire on its pedestal ; and the capital and base
included is ninety-one, or, according to others, ninety-four royal568 feet high. The pedestal is eighteen feet
high, and its solid content eighteen hundred and twenty-eight cubic feet. The shaft itself is sixty-nine feet
high, and its solid content three thousand three hundred and forty-seven cubic feet. So that the solid content
of the whole pillar, pedestal, and capital, is five thousand six hundred and sixty-three cubic feet. And the
weight of it two hundred and fifty-nine tons, eighteen hundred, three quarters, and seven pounds, English.
The whole is (p. 137) placed on a foundation five feet square, and every side of it decorated with
hieroglyphics ; but it must be observed, that these figures are inverted, which sufficiently demonstrates the
falsity of the opinion of those who will have these column to be a work of the ancient Egyptians ; and, on the
other hand, renders it very probable, that the stones were taken from old Egyptian ruins, and coverted to this
use by the Romans.
This pillar is of the Corinthian order, and is the largest I ever saw standing, though its basis has suffered
considerably from the rude hands of some begoted Arabians, who supposed there were treasures concealed
under it. It is surprizing how a stone of this enormous bulk (for the whole shaft is formed out of one single
piece of granite) could be brought hither. Some will have it, that it was hewn on that very spot : Others are of
the opinion, that this, as well as the rest of the memorable columns formerly erected in this country, were
taken from the quarries in Upper Egypt, and brought down the Nile ; but how prodigiously large must that
vessel or float be, that was capable of bringing down such an enormous weight. And hence some have been
led to imagine, that the ancients, and particularly the Egyptians, were possessed of the secret of making
stones by fusion, equal, if not superior, to the most beautiful marble. But this is strongly opposed by others.
On the east side of the pedestral are some Greek letters, the remains of an inscription, but so greatly
obliterated as to be absolutly illegible. Father Sicard, however, from the remaining letters, thinks the purport
of it is, that Pompey was murdered there in the reign of Ptolemy and Cleopatra.
Near this pillar are the fondation and stately ruins of an ancient structure, which some affirm, but for what
reason I know not, to have been Cæsar’s palace.
(p. 138) We next proceeded to the khali, or canal Canopus, about two miles south of the city, where it
communicates with the Nile, at the time of its inundation. Thro’this canal the water is conveyed into the
cisterns of old Alexandria above described, and also into the vast bason at the foot of the wall.
This canal was anciently kept in better repair than at present, the inhabitants being then sensible of the great
advantages they reaped from it. And it appears, from some remains, that the sides of it were cased with
stone ; but it was now almost dry and vast numbers of cucumbers were growing in it, some of which we eat,
and found them very palatable. Along the sides of this canal are several cultivated spots, covered with
verdure during the whole winter. This country is very beautiful, and tolerably cultivated by the inhabitants of
Alexandria ; and would they take the pains to keep the canals and fosses which convey the water of the Nile
from the khali to different parts, in good repair, they might have a sufficient quantity of land, which would
amply reward them for whatever pains were taken in its cultivation.
Over this khali is a bridge of one arch, which we passed, and after walking some time on the opposite bank,
turned off to the left, in order to take a view of the lake anciently called Palus Mareotis, which we were told
was not less than twenty Italian miles in lenght ; but all we saw in it was a small quantity of stagnant water in
a marshy soil, which often renders the air of Alexandria unhealthy. Nor do I see how it can, with any
propriety, be called a lake, unless at the time of the overflowing of the Nile.
The banks of it were formerly celebrated for vineyards, which produced that noble wine mentioned by
Horace ; but at present, no trace or vestige of (p. 139) them is remaining. Possibly the soil, during such a
long succession of ages, may have greatly changed its nature and properties.
After crossing over the canal, which in this part was quite dry, we arrived at the catacombs. These are
subterraneous apartments hewn in the rock, and were used by the ancients for burial-places, having three
ranges of niches on each side over one another, and each large enough to hold a coffin. These are
separated from one another by small chambers, communicated with each other, and extending to a very
great distance under ground. The rock in which these subterraneous grottoes are hewn, being soft, many of
the chambres are full of ruins. At the entrance are still some remains of steps hewn in the rock ; and
doubtless these places were formerly very magnificent. On the north side of the city, near the sea, are also
several catacombs, but not to be compared with those above-mentioned ; and near them are several
remains of palaces, statues, sphinxes of black marble, and the like ; but all at present thrown down,
mutilated, and forming one confused heap of ruins.
After wandering for some time along these catacombs, each having a light in his hand, and proposing to go
to the extremity of them, we were called by our peasants, who formed a guard without, some Arabs armed
wit muskets and lances being at a distance, and preparing to attack them. At this we immediately left these
subterraneous grottoes, ranged ourselves behind a piece of a wall, which served as a parapet, and sent two
of our peasants to know there intentions. They told them, that they only intended to beg some powder of us ;
but instead of furnishing our enemies with arms against ourselves, we retreated towards the city, and they
followed us at a distance ; but we retired in such (p. 140) good order, taking care to keep beyond the reach
of their lances, that they did not offer to attack us.
This instance may serve to shew what safety is to be expected in Egypt, or even in the very neighbourhood
of Alexandria. You cannot indeed reckon yourself safe even in the city itself ; the extreme poverty, the
vicious dispositions of the people, and the bad governement, inducing most of the lower class of inhabitants
to turn robbers, on any favourable opportunity. Most of the present inhabitants of Alexandria are a mean,
depraved set of mortals. And a midina, which does not greatly exceed our penny in value, will induce them to
undertake very slavish employments ; but when they come to receive their wages, they express their
discontent in so an outrageous a manner, that a foreigner, to free himself from such disagreable company,
and the apprehension of their malice, commonly makes an addition, which is the very thing they want ; and
this is their general practice in every part in Egypt.
The commonality in general here make a very wretched appearance. Their bodies, which are so prodigiously
tanned, that the negroes and Moors look much better, are covered only with a blue linen shirt, reaching to
their ancles, and teh sleeves very wide. The women, if possible, make a worse appearance than the men :
Their whole dress consists of a pair of drawers, and a sort of long mantle which they throw over their whole
body. Their face is covered with a kind of veil fastened to their cap, or rather linen rag tied about their head.
Without the walls of Alexandria is still remaining a jewish synagogue, called Eliace, and which, they say, was
built in the time of the prophet Elijah. But this is far from being probable ; for tho’that prophet went to mount
Horeb, and possibly might return to Palestine by the way of Egypt, yet (p. 141) this does not prove, that any
Jews then resided there, unless we suppose they had removed thither for want of water, during the long
drought. But however this be, it seems more natural to think, that this synagogue was built long since the
time of Elijah, by some devout person of that name, and from thence received the appellation it now bears.
There is also without the city of Alexandria, in a very lonely situation, the house of a Turkish santon or rather
idiot, at least one who feigns himself to be such, the Mahometans being very fond of idiots ; being firmly
persuaded, that their souls go immediately to paradise when they quit their body. Nor are the Roman
Catholics more extravagant in their accounts of the miracles of their saints, than the Mahometans are in their
relations of this class of mortals ; and I was assured, that it is not uncommon for a lamp to be found burning
continually in their oratories, without any supply of oil.
Having gratified our curiosity as far as possible at Alexandria, we determined to return to Rosetta ; but we
found great difficulty in procuring asses for the journey, the Pasha being encamped on the road, in his march
to that city. But by the assistance of Mr. Hume and some other English gentlemen, we surmounted this
difficulty, and proceeded on our journey to Rosetta ; and the road saw an instance of the sudden turn of
fortune not uncommon in these parts. We met, riding in great pomp, the Bey of the country, who, not long
since, had been a slave to Circas Bey, but now raised to this pitch of power. His business was to secure the
roads from the depredations of the Arabian robbers. Here we also saw several salt-works, and a dyke thrown
up before them, as a security against the waves. At night we took up our quaters in a kane called Meidia, of
which we may well say with the Italians, E casa nuova, quando s’y porta qual che, s’y lo trova ; it is a new
house, bring (p. 142) something with you, and you find something in it. »
- 599 - 606 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CLAUDE SICARD (1712-1726)
Sicard, C., « OEuvres II. Relations et mémoires imprimés », BiEtud 84, Ifao, Le Caire, 1982.
Né en 1677 à Aubagne près de Marseille, Claude Sicard entre dans la Compagnie de Jésus en 1692. Après
avoir enseigné les Humanités pendant cinq ans au collège de Lyon, il est envoyé, en 1706, au Levant,
d’abord à Tripoli où il se met à l’étude de l’arabe. En 1712, il est envoyé au Caire. À la demande du Régent
Philippe d’Orléans, le père Sicard s’intéresse aux monuments anciens d’Égypte. De plus, sa vaste culture et
ses connaissances des langues anciennes lui permettent de lire les auteurs grecs et latins. En 1726, il meurt
de la peste en Égypte.569
p. 254-260 :
« Alexandrie, l’ouvrage du Grand Alexandre. Cette Ville si fameuse, la demeure des Ptolomées, la capitale
de l’Égypte, la rivale d’Athènes & de Rome, en fait des sciences & des beaux arts, peuplée à l’infini,
opulente, superbe dans ses bâtimens, où l’on ne voyait que temples, que palais, qu’édifices publics, que
places environnées de colonnes de marbre. Cette Ville, qui dans les premiers siècles du Christianisme
rendoit encore son nom plus illustre, qu’il n’avoit été du tems du Paganisme, par la multitude & la
magnificence de ses Eglises, par la sainteté de ses Evêques, & leur zele à défendre la foi, par le courage
héroïque d’un million de Martyrs, par la profonde érudition, le génie sublime, les écrits de ces grands
hommes, qui ont été, & qui sont du nombre des lumières de notre Religion. Cette Ville est depuis long-tems,
ensevelie sous ses ruines, & n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. A peine mérite-t-elle d'être mise au
rang des Villes du second ordre, soit pour son enceinte, soit pour le nombre de ses habitants. Elle doit au
commerce tout ce qu'elle est. Comme elle a deux ports excellens, les vaisseaux y abordent volontiers. Le
vieux port est destiné pour les bâtimens des sujets du Grand Seigneur ; & le port nouveau est ouvert aux
Européans.
Mais malgré ce changement total, un voyageur a bien de quoi contenter sa curiosité. Il retrouve l’ancienne
Alexandrie au milieu même de ses ruines. Il n’a qu’à suivre pas à pas la description que Strabon en a fait ;
par tout il en découvrira assez de vestiges, pour juger de l’étenduë de cette Ville, & pour reconnoître les
lieux, où étoient placées les choses, dont il parle.
Les deux ports, qu’il appelle (en grec) sont le port vieux, & le port nouveau d’à présent. (En grec), est la
partie de la Ville, qui borde le port vieux, & qui s’étend jusqu’au port nouveau. Le Septem Stadium étoit la
presque Isle, qui est entre les deux ports. Du côté du port neuf est l’Isle du Phare, où étoit bâtie la tour du
Fanal. Il y avoit communication de l’une à l’autre Isle par un pont, sur lequel passoit un canal d’eau douce. Il
suffit de jetter les yeux sur les deux ports, tels qu’ils sont aujourd’hui, pour y apercevoir, du moins en
général, tout ce que les anciens en ont dit. Dans les restes, il faut examiner jusqu’au moindre débris des
anciens monumens, qui sont de tout côté aux environs de la nouvelle Alexandrie.
En effet en les examinant avec attention, l’on voit que c’est dans la plaine, qui aboutit à la porte de Rosette,
qu’étoient les Palais des Ptolomées, leur ancienne biblioteque, les sépulcres d’Alexandre, & des Ptolomées.
Car proche leur Palais, ils avoient au Sud du Lochias un petit port, qui ne servoit qu’à eux. L’entrée en étoit
fermée par des jettées de pierres, qui paroissent encore dans la Mer. Ce port s’étendoit jusqu’à l’Isle
Antirhodus, qu’on nomme le Pharillon, dans laquelle il y avoit un palais, & un theâtre.
Au Sud-Est de ce port, à peu près, où l’Eglise de S. George, étoit l’Emporium, dont parle Strabon. Un peu
plus loin, ce petit Cap, que le même auteur appelle Posidium, à cause d’un temple dedié à Neptune.
Marc-Antoine allongea ce cap par un mole, dont la tête subsiste. Il y fit bâtir un Palais, nommé Timonium.
Quand la Mer est calme, tout enseveli qu’il est sous l’eau, on en distingue une si grande multitude de débris,
que l’on voit bien qu’il étoit d’une grande étenduë, & d’une grande magnificence.
Strabon fait le detail des choses remarquables, qui étoient depuis là à l’honneur de Jules Cesar. C’est en
vain qu’on chercherait à déterrer du moins la place, où chaque chose étoit. Il ne reste pas même de quoi
fonder sur cela la plus legere conjecture. Cependant les fondations du Cesarium devoient être immenses,
solides, & profondes, puisqu’il y avoit deux obélisques dans l’enceinte de ce superbe temple. « Obelisci sunt
Alexandriæ ad portum, dit Pline, in Cæsaris templo. »
Comme la colonne, connuë sous le nom de colonne de Pompée, subsiste encore, elle sert, pour ainsi dire
de guide, & fait connoître le (grec), cet endroit de l’ancienne Alexandrie, où elle étoit.
Outre les grotes sépulcrales, ce quartier contenait le temple de Serapis tant vanté par les anciens, dans
lequel on voyoit une statuë du Soleil, toute de fer, qui étoit agitée & attirée, dit Ruffin, par une pierre d’Aiman
posée dans la voute. Il étoit si magnifique, qu’il n’y avoit, au rapport d’Ammien, que celui du Capitole, qu’on
pût lui préférer. « Post Capitolium quo se ventriculaires Roma in æternum attolit, nihil orbis terrarum
ambitieuses cernit Serapæo templo ».
L’Amphitheatre, le Stadium, le lieu destiné aux jeux, & aux combats, qu’on representoit tous les cinq ans, le
Panium, qui est la bute de Nadour, d’où l’on a veuë charmante & fort étenduë, le College avec ses longs
portiques, le Tribunal de la Justice, & les Bois sacrés, & enfin une grande place, qui aboutissait à la porte de
Canopus.
Au sortir de cette porte commençait l’Hippodrome pour la course des chevaux. Il étoit de la longueur de
30 stades, & alloit jusques à (grec), nommé aujourd’hui Quasser Quiassera. Ce fauxbourg alloit jusques à la
mer. Auguste attaqua & prit par-là Alexandrie. Nicopolis devoit être quelque chose de considerable, car l’on
y voit encore les restes d’un Château quarré, long, flanqué de 20 tours, délabré à la vérité, mais
reconnaissable. Le port pouvoit contribuer à la grandeur de ce fauxbourg. Il étoit si commode, & si sûr, que
Vespasien s’y embarqua, dit Joseph, lorsqu’il entreprit la conquête de Jerusalem.
C’est-là proprement qu’Alexandrie, y compris son fauxbourg, finissait. Par conséquent, selon la supputation
de Diodore, cette Ville avoit dans une de ses longueurs soixante et dix stades, qui font plus de deux lieües &
demi, puisqu’il assure qu’il y avoit une ruë ornée de palais, & de temples, qui avoit 100 pieds de large, &
40 stades de la Porte, apparemment de la porte du vieux port, jusques à la porte de Canopus ; car c’est
dans cette distance d’un bout à l’autre, que l’on trouve encore aujourd’hui presque à chaque pas des
morceaux de colonnes brisées.
Mais si ces ruines, ces débris, ces masures plaisent, & instruisent ceux qui ont du goût pour l’antiquité,
quelle doit être leur admiration à la vûe des monumens, que le tems a épargné, & qui sont dans leur entier,
ou, il s’en faut peu, savoir, la colonne de Pompée, les deux obélisques de Cleopatre, quelques citernes, &
quelques tours de l’enceinte de la Ville.
La colonne de Pompée est de granite, & d’ordre Corinthien, haute de 94 pieds, compris son piédestal & sa
corniche. Le piédestal a 14 pieds de hauteur, & 1828 pieds cubes. Le chapiteau a onze pieds de haut, &
488 pieds cubes. Le fust 69 pied de haut, & 3347 pieds cubes. Ainsi le tout fait 5663 pieds cubes. Le pied
cube de granit pese 252 livres, par consequent le poids de la colonne entiere de 14270 quintaux, &
76 livres ; cependant ce poids énorme est élevé, & supporté sur plusieurs pierres cramponnées entre elles
avec du fer. Deux de ces pierres sont couvertes de Jeroglyphes renversés. Les quatre faces du piédestal
sont tellement placées, qu’elles ne répondent pas directement aux quatre parties du ciel ; sur la face, qui est
du côté de l’Oüest déclinant un peu an Nord, il y a dans la plinte une inscription Grecque en cinq lignes ;
mais à huit ou dix lettres près, séparées, & nullement de suite, le reste est presque effacé.
Il est étonnant que tout ce qu’il y a eû d’anciens auteurs n’aïent pas donné la moindre connoissance du
tems, auquel cette colonne a été placée, du nom de l’ouvrier, de l’usage qu’on en vouloit faire : étant la plus
haute, & la plus singuliere, qui ait été vûe dans le monde, à ce que l’on sache, il étoit du devoir des
historiens de marquer en détail ces circonstances. Quelques modernes l’ont appellée la colonne de
Pompée, & ce nom lui est demeuré ; mais assurément ils l’ont fait sans aucun fondement, s’ils parlent de sa
premiere construction. Il y a de fortes conjectures qu’elle est faite du tems de Ptolemée Evergetés le
premier, & non pas sous les Dynasties des Egyptiens, sous les Perses, lorsqu’ils étoient maîtres de l’Egypte,
ou sous Alexandre, encore moins sous les Romains.
Les deux obélisques, dits les obélisques de Cleopatre, qui, selon Pline, furent faits par ordre du Roy
Mesphée, « quos excidit Mesphees rex quadragenum binum cubitorum », & qui furent mis dans le temple de
Cesar, sont de granit, égaux, chargés de Jeroglyphes, & près l’un de l’autre ; mais l’un est debout, & l’autre
est par terre. L’obelisque qui est debout, a 54 pieds de Roy hors de terre, & un peu plus de trois pieds dans
la terre. Sa largeur d’en bas a six pieds huit pouces. Il pose sur une base de granit de six pieds de hauteur,
& de huit en quarré, ce qui fait les 63 pieds, ou les quarante-deux coudées marquées par le même auteur. Si
l’on a pu vérifier toutes ces dimensions, on en a l’obligation à M. Claude le Maire, Consul de la nation
Françoise au Caire. Au mois d’Octobre 1718 il employa son crédit pour obtenir la permission de faire
déchausser l’obelisque, découvrir la base, & le reste qui étoit enterré.
Mais il est de ces obélisques, comme la colonne de Pompée. On ignore en quel tems, & par les ordres de
qui, ils ont été apportés à Alexandrie. Il est vraisemblable que celui, qui fit bâtir le temple de Jules Cesar, les
trouva à Alexandrie même, & qu’il voulut, que ce qui avoit servi à l’embellissement des palais des
Monarques Grecs, servît à orner son nouveau temple.
En effet, le Roy Mitrées, qui regnoit à Heliopolis, fut le premier qui fit faire des obélisques du granit, que l’on
tira de la carriere de Syene. Plusieurs Monarques Egyptiens en firent faire dans la suite à son exemple, la
plûpart dédiés au Soleil, & couverts de Jeroglyphes. Ils crurent par là augmenter la magnificence de leurs
palais, & des villes où ils se plaisoient, ou qu’ils vouloient rendre considérables. Il est donc à présumer que
les Monarques Grecs se conformerent à cette coutume, n’aïant rien tant à coeur que de rendre Alexandrie
une ville fameuse par tous les endroits imaginables. Il leur étoit même aisé d’avoir de ces sortes d’ouvrages.
Il y en avoit déjà plusieurs en Egypte. Outre cela le granit ne leur manquoit pas, la carriere de Syene étoit
d’une vaste étendüe, & ils n’ignoroient pas, que les Isles, qui sont près de la derniere Cataracte, entre-autres
l’Elephantine, la Phile, & la Tacompsus, sont pleines de carrières de cette espece de marbre.
Toutes les citernes, qui étoient dans Alexandrie, ne subsistent pas. Il y en avoit une si grande quantité,
qu’elles faisoient une seconde ville souterraine ; mais il en reste plusieurs : on ne peut rien voir de plus
achevé en ce genre-là ; belles pierres, belles voutes, & si bien cimentées, que rien ne s’est encore démenti.
Il y avoit une communication du Nil à ces citernes : & toute la Ville n’avoit point d’autre eau à boire, que celle
qu’on en puisoit. Et c’est ce qui fit que les soldats de Jules Cesar, lorsque ce Prince assiegeoit Alexandrie,
aïent trouvé le moyen de faire entrer l’eau de la mer dans les citernes, la Ville faute d’eau douce fut obligée
de capituler, & de se rendre.
Pour ce qui est du peu de murailles, & de tours, qui sont restées de l’enceinte de la Ville, leur architecture
est la seule chose, qui mérite quelque attention. Elle n’est point Romaine, elle ne peut être que grecque, ou
Sarrazine. Les tours étoient fort vastes, elles sont à present dégradées en quelques endroits.
Qui ne croirait pas trouver aussi quelque monument considérable du Christianisme, qui a été si florissant à
Alexandrie pendant plusieurs siècles ? Il n’y en a néanmoins aucun. Les Eglises de saint Marc, desservies
par les Coptes, & celle de sainte Catherine desservie par les Grecs, n’ont absolument rien, qui frappe, & qui
soit remarquable.
Deux choses hors d’Alexandrie attirent les Etrangers, l’Isle du Phare, & le Lac Mareote ; quoique l’idée seule
du tems passé y puisse faire plaisir. Le Phare, parceque l’on dit que c’est dans une maison, qui étoit au Nord
sur le rivage de la mer, que les Septante firent en soixante & douze jours leur version de la Bible. En
mémoire de cette Version, les Juifs, & les gens de toute nation s’assembloient autrefois un jour de l’année
dans cette Isle, & y célébroient une grande fête.
Le lac Mareote, ou le Lac Charei, parceque son port, dit Strabon, étoit plus fréquenté, & qu’il produisoit
beaucoup plus que le port Cibotus, le port vieux ; dans lequel le fleuve Calits après avoir traversé ce Lac,
alloit se jetter.
L’embarras d’un voyageur, qui n’a que ses livres à consulter, augmente à chaque pas ; car tous ces lieux-là
ont changé de nom, les grecs les appellent d’une maniere, & les Latins d’une autre : par exemple, dans
Cesar, le vieux port est le port d’Afrique ; dans Strabon, c’est le port Tegammus ; le port nouveau, dans
Cesar, est le port d’Asie ; dans Strabon, c’est Taurus, ainsi des autres. Ce sont aujourd’hui de nouveaux
termes. Pour être parfaitement au fait, il faut sçavoir s’orienter, entendre la langue du pays, & examiner les
choses à loisir, & avec exactitude. »
Sicard, C., « OEuvres III. Parallèle géographique de l’ancienne Égypte et de l’Égypte moderne », BiEtud 85,
Ifao, Le Caire, 1982.
p. 42-54 :
« Aléxandrie, en copte (en copte), bâtie par Aléxandre le grand dans un lieu nommé Racotis, Corn. Tacit.
hist. L. 4, Strab. L. 17, Pausanias in Eliaus, Clem. D’Aléx. In protreptric. Elle a été quelque fois appellée
Leontopolis, Sebaste, Julia Claudia, Domitiane, Steph. (en grec)
Aléxandrie moderne en parallèle de l’ancienne, sur le texte de Strabon L. 17.
Port vieux à l’ouest, Cibotus, Tegamus, portus Africæ. Port entre Rassetin et le phare, Eunostis,
Possidonius, port mitoyen. Portus magnus, Taurus, portus Asiæ, port neuf à l’Est. La partie de la ville qui
borde le port vieux et s’étend jusqu’au nouveau, Racotis. Le nom de Racotis et Rassétin se ressemblent. La
presqu’isle entre ces deux ports, Septem stadium. Le cap occidental du port neuf, ou plus tost de l’isle du
phare, Acrolochias. Le Pharillon, autrefois isle où étoit bâtie la tour du fanal, qui fut ensuite jointe au Septem
Stadium par un pont sur lequel passoit un canal d’eau douce, Pharus. Le cap oriental du port neuf vers le
petit Pharillon, Lochias. La plaine au Sud et à l’Est du Lochias tirant vers la porte de Rossette contenoit les
palais des Ptolémées, dans l’enceinte desquelles étoit le Musæum. Dans l’enceinte du palais des
Ptolémées, le Musæum ou Académie des beaux esprits occupoit d’agréables jardins et un vaste Hôtel. Cette
Académie avoit un prestre pour directeur et des revenus fixes. Elle avoit été établie par les Ptolémées, et
César Auguste continuoit de la protéger, Str. L. 17.
Dans un coin de ces mêmes palais, en un quartier nommé (en grec), s’élevoient les sépulchres d’Aléxandre
et des Ptolémées. Au sud du Lochias un port particulier (p. 43) et destiné pour les Roys s’étendoit depuis
environ St George jusqu’au petit Pharillon. On remarque à l’occident du dit Pharillon des jettées de pierre
dans la mer, pour mieux fermer ce port. Le petit Pharillon, isle Anti Rhodus. Il y avoit là un théatre, un palais
et un petit port au Nord est et en dehors, dont on reconnoist les vestiges.
Au Sud est du port des Roys, on rencontroit une place nommée (en grec), le marché, à peu près au Sud du
cimetière de St George. De là s’avançoit un petit cap ou coude nommé Posidium (en grec), à cause d’un
temple consacré à Neptune. Marc Antoine allongea ce cap par un beau mole dont on voit la tête, au bout du
quel il bâtit son palais Timonium. Cet ouvrage du Triumvir enseveli sous les eaux montre encore de
magnifiques débris. Ensuite vient le Césarium ou temple de César dans le contour du quel étoient
enfermées les deux obélisques. Le témoignage de Pline est formel là dessus, Alii duo obelisci sunt
Alexandriæ ad portum in Cæsaris templo, Plin. L. 36 c. 9. Tout de suite un autre Emporium, après cela le
Secessus ou petit Golphe qui couvroit la plaine derrière les oukèles, ou habitations des Marchands, et
abboutissoit à la porte de la marine. Enfin le Navalia, tout le reste du port jusqu’au Phare.
Le géographe persien dit avec la plus part des Autheurs Musulmans qu’Aléxandre le grand fit dresser le
phare d’Aléxandrie, qu’il y fit placer au haut un miroir talismanique, de la conservation duquel dépendoit celle
de la ville. Pure réverie. Ammien Marcellin rapporte que la tour du phare qui éclairoit la nuit fut dressée par
Cléopatre. C’est par Ptolémée Philadelphe, Ammian. L. 22 c. 16. [La tour du phare fut achevée sur la fin du
règne de Ptolémée Lagide et au commencement de celui de Philadelphe. Elle couta 800 talents, Euzeb.
Pline L. 36 c. 12]. Colonia Cæsaris Dictatoris Pharus juncta Alexandriæ, Plin. L. 5 c. 31. On a des médailles
d’Auguste avec un revers de cette colonie.
Nécropolis, (en grec) quartier des morts, vers la colonne de Pompée et les grottes Sépulchrales, renfermoit
le Sérapium ou temple de Sérapis entre le calits et le port Cibotus. La place de la colonne de Pompée a
succédé au Sérapium. Là étoient aussi l’Amphitéatre, le Stadium, les quinquennalia certamina, le Panium
(p. 44) hauteur à découvrir de loin (c’est la butte de Nadour) le gymnasium ou lieu des éxercices avec ses
longues galeries, son tribunal de justice et ses bois sacrés. Le Nécropolis se terminoit par une grande place,
qui aboutissoit à la porte de Canope ou Rossette, en s’étendant le long du Gymnasium.
L’hyppodrome ou course des chevaux duroit 30 stades, depuis la porte de Canope jusqu’au calits d’une part
(de là vient qu’on ne voit là aucunes mazures) et le faux bourg de Nicopolis de l’autre ; lequel faux bourg
aboutissoit à la mer à l’Est du Lochias et des palais royaux. C’est par là qu’Auguste attaqua et prit
Aléxandrie. C’est en ce port que Vespasien s’embarqua pour aller détruire Jerusalem, au rapport de Joseph
L. 4 bell. jud. c. 42.
Le port vieux est uniquement destiné pour les bâtiments des sujets du Grand Seigneur. Le port nouveau est
ouvert aux Européens.
Selon Etienne de Bysance plusieurs gens du vaisseau de Ménélaüs ont donné leurs noms à divers lieux
près d’Alexandrie. Homère odiss. L. 4 dit que l’isle du phare étoit autrefois séparée de l’Egypte d’une
journée. Il entend par l’Egypte la rivière du Nil, qu’il nomme toujours Egypte.
Erathosthène, Pline, Aristide et autres s’imaginans que le mot Egypte signifioit la terre ferme ont repris là
dessus Homère mal à propos Plin. L. 13 c. 11.
Plutarque est dans la même erreur qu’Erathosthène et croit que la mer entre la terre ferme et le phare s’étoit
desséchée, Plut. L. de isid.
Nicopolis, nommé à présent château des Césars, ou Casser Quiassera, et Quessour Fares, montre les
restes d’un château quarré barlong, fort délabré, flanqué de 20 tours, à 3 ou 4 milles Est d’Aléxandrie. On
appelle aussi Nicopolis château du Persan ou du Cavalier. Strabon conte 30 stades d’Aléxandrie à
Nicopolis, Joseph n’en met que 20.
Jules César dans son livre des guerres civiles ne fait mention que du fort neuf. Il est vray que dans son
volume de la guerre d’Aléxandrie il décrit le combat naval donné entre les 2 ports, dont il nomme l’un port
d’Asie (c’est le nouveau) et l’autre d’Afrique, c’est le port vieux.
(p. 45) Du temps de Pline et de Solinus les ports avoient changé les noms qu’on lit dans César et dans
Strabon. Le vieux s’appelloit Tegamus, le nouveau Taurus et le mitoyen, vers le cap Rassétin, Possidonius,
Plin. L. c. 31, Solin c. 35.
A l’Est du petit Pharillon ou Anti Rhodus, j’ai vû des canaux taillés dans le roc sur la mer, des conduits, des
mazures restes des palais des Ptolémées.
Les 72 interprêtres de la bible travaillèrent à leur ouvrage qu’ils achevèrent en 72 jours dans une maison de
l’isle de Pharus assise au Nord sur le rivage de la mer, Josep. Antiq. Judaïc. L. 12 c. 2. En mémoire de cette
version, il y avoit tous les ans une feste dans l’isle du Phare où s’assembloient les juifs et toutes sortes
d’autres nations. Dans le calendrier juif au 8e du mois de Tebeth jejunium, Scripta est lex græce diebus
Ptolemæi regis : tenébræ triduoque per totum orbem. On voit à Aléxandrie une très ancienne synagogue des
juifs. Eutychius patriarche grec d’Aléxandrie, nommé en arabe Saïd ebn batriq, rapporte sérieusement qu’un
des 72 interprètres étoit Siméon qui vécut 350 ans et reçut J.X. au temple. Il ajoute à cette fable que cette
interprétation se fit non sous Philadelphe, ce qui est de certain, mais sous Ptolémée surnommé Aléxandre,
père de Lagide et ayeul de Philadelphe.
Philadelphe après avoir dressé sa nombreuse bibliothèque institua des jours pour la dispute de la poèsie. Un
certain Aristophane nommé juge avec six doctes personnages décerna le prix contre l’avis de ses confrères
à un des concurrents dont la versification le cédoit à celle des autres écrivains à qui tout le monde avoit
applaudi, disant que celui là seul étoit poëte et autheur de sa pièce, les autres ayant dérobé les vers qui
avoient attiré les acclamations. Il prouva le fait par les Manuscrits, qu’on apporta sur le champ de la
bibliothèque qu’il avoit fort bien parcourüe, et dont le Roy le déclara intendant, Vitruv. præf. L. 7.
Amrou ou Omar Ebn as ayant pris Aléxandrie ruina toutes les bibliothèques et fit distribuer les livres dans les
bains ; on les chauffa pendant 6 mois, quoiqu’il y eût 4000 bains, Abulf.
(p. 46) Comme Philadelphe avoit dressé une bibliothèque à l’envy d’Attalus Roy de Pergame, il défendit
qu’on ne laissast point sortir de papier d’Egypte. Attalus fit alors façonner des peaux pour écrire dessus, d’où
est venu le vélin ou parchemin qui a retenu le nom de la ville de Pergame, Voss. De Gramm. L. I c. 38.
Attalus Roy de Pergame avoit commencé sa bibbliothèque environ 22 ans avant celle d’Aléxandrie.
Dans le temple de Sérapis un simulachre du soleil de fer étoit agité et attiré par une pierre d’aimant de la
voute, Ruffin L. 2 hist. Eccl. Ce simulachre étoit peut être sur la colonne de Pompée. Post capitolium quo se
venerabilis Roma in æternum attollit, nihil in orbis terarum ambitiosius cernit Serapæo templo, Amm. L 22
c. 16.
Le temple de Saturne dressé par Cléopatre fut converti par le patriarche Théophile en l’Eglise de St Michel
nommée la Quaisserie, brulée par les Magrebins du temps ou sous le regne de Giauher, Saïd Ebn Batriq. Le
patriarche ordonna que le 12e jour de chaque mois fut consacré à la mémoire du St Archange ; ce que les
coptes ont toujours observé.
Sur le port nommé Navalia Ptolémée Philadelphe fit dresser un obélisque sans hiéroglyphes de 80 coudées
de haut, près du temple d’Arsinoé sa soeur et sa femme. Le Roy Nectabis l’avoit fait autrefois tailler. Dans la
suite du temps, comme il embarassoit le port, on le transporta dans le marché, Plin. L. 36 c. 9.
Dans le temple d’Arsinöé il y avoit une statüe de fer de cette Reine. L’architecte Chinocrate avoit commencé
de dresser un dome d’aimant pour que la dite statüe en étant attirée demeurast suspendüe en l’air. La mort
de l’architecte et de Philadelphe, mari et frère d’Arsinöé, intérompit l’ouvrage. Ce temple étoit sur le port,
Pline L. 34.14. V. d’Herbelot Bibli. orient. Il se trompe. Dans le temple d’or on dressa à Arsinoé femme de
Philadelphe une statüe de topaze de 4 coudées, Plin. L. 37 c. 8.
(p. 47) [Maréote] Un très riche port sur le lac Maréote est nommé Charei, (en grec) par Etienne de Bysance
et par Procope. Strabon dit que le port de la Maréote rendoit plus que celui de la mer, Strab. L. 17.
[Aléxandrie] Aléxandrie avoit une rüe de 100 piés de large et 40 stades de long d’une porte à l’autre, ornée
de palais et de magnifiques temples, Diod. L. 17 n. 52. C’est apparemment celle qui alloit du port vieux à la
porte de Rossette, où il paroist encore tant de colonnes.
Inscription en grec
Explication. Terentius Potamius fils de l’illustre Commode officier de l’Empereur dans la 1er cohorte. Cette
inscription est gravée sur le dé d’un pié d’estal de marbre blanc, tiré des ruines d’Aléxandrie, que j’ay vû au
mois de may 1720. Il y a un reste d’écriture effacée au dessus de la corniche rompüe du pié d’estal.
CAPPELLA HEC VIRGINI …
INTEMERATE MARI ……
DICATA D IOANNE CAMILLA
GENUENSI PATRICIO VIRO INSIGNI
CONSULE 9STRUTA EXORNATAQ FUIT
ANNO DOMINI M D XVII
Cette inscription est gravée sur un marbre blanc tiré des ruines d’une Eglise des Francs à Aléxandrie. On me
la fit voir en may 1720. Les points … sont en la place des caractères effacés.
[Version des 70] En mémoire de la version des Septantes, il y avoit tous les ans une feste du Phare, où
s’assembloient les juifs et toutes sortes de Nations, Philon de vita. L. 3.
(p. 48) Dans le calendrier juif, au 8e du mois Tebeth, jejunium … scripta est lex græce diebus Ptolemæi
Regis ; tenebræ triduo per totum orbem.
[Aléxandrie] On voit à Aléxandrie une tres ancienne synagogue des juifs. Bruchion, quartier d’Aléxandrie où
logeoient les sçavants, Ammian. L. 22 c. 16.
Pierre de Lusignan Roy de Chypre prit et pilla Aléxandrie un vendredi 3 octobre 1365 sous le sultan Shaban
Mammelus fils de Hossain. Les chrétiens après 4 jours quittèrent la ville et se retirèrent.
Les anciennes Eglises de Sainct Marc et de Ste Catherine, desservies celle cy par les Grecs celle là par les
coptes, sont réduites à présent à fort peu de chose.
Le corps de St Marc fut transporté d’Aléxandrie à Venise environ l’an 821. A Venise on ne sçait point le lieu
où repose cette relique, Eginh. Ann.
D’admirables citernes bien voutées, bien cimentées et qui durent formoient une ville soûterraine.
[Colonne de Pompée] Cette colonne d’ordre corinthien, de Marbre granit, a 94 piés de hauteur, compris son
pié d’estal et son chapiteau. Le diamètre à proportion. Le pié d’estal, 14 piés de haut, y joint la base avec
son plinthe, et 1828 piés cubes. Le chapiteau, 11 piés de haut et 488 piés cubes. Le fust, 69 piés de haut et
3347 piés cubes, le tout 5663 piés cubes, et comme un pié cube de marbre est de 252 livres, le poids de
toute la colonne sera de 14270 quintaux et de 76 livres.
Tout ce grand poids est planté et supporté sur plusieurs pierres cramponnées entre elles avec du fer, dont
deux sont couvertes de jéroglyfes renversés. La colonne est en quatre pièces : le pié d’estal, la base, le fust
et le chapiteau. Les Arabes nomment ce monument Amoud el savari, colonnes des colonnes.
Cette colonne étant la plus haute que nous connoissions dans l’univers, il est étrange qu’on ait ignoré
jusqu’à présent son autheur et sa destination. Toute l’Antiquité garde là dessus un profond silence. Les
Modernes lui donnent vulgairement le nom de Pompée. Hasarderai je icy mes conjectures ?
(p. 49) Ce monument ne doit sa construction ny aux dynasties des Egyptiens ny aux Perses ny aux
Romains, mais uniquement aux Grecs successeurs d’Aléxandre. 1° les deux pierres du pivot posées sans
dessus dessous, nonobstant leurs jéroglyfes, dénotent un temps où ces traits mystérieux étoient inconnus
ou négligés, c’est à dire postérieur au règne des Egyptiens Naturels. 2° étant d’ordre corinthien, il est
postérieur, non seulement aux Egyptiens, mais encore aux Perses. 3° avant Aléxandre le grand, qu’étoit ce
qu’Aléxandrie ? un bourg nommé Racotis, où quelques Marchands de l’Archipel négocioient avec bien des
ménagements, le commerce libre avec les peuples de la Grèce étant réservé à la seule ville de Naucratis
comme l’assure Herodote. Qui auroit donc pu planter sur une éminence déserte le monument en question ?
Psammetichus fut le premier qui permit aux Grecs et autres Nations de voyager dans son Royaume et d’y
trafiquer. Auparavant, on punissoit par la mort ou par la servitude tout étranger qui osoit aborder en Egypte,
de là la fable du Tyran Busiris, Diodor. L. I n. 67, Herodote L. 2. Le Roy Amasis accorda aux Négociants
Grecs un établissement dans sa ville de Naucrate, seule pourtant où ils pouvoient trafiquer. La politique
inspira sans doute à ce monarque de défendre aux étrangers l’entrée du port de Racotis, de peur qu’ils ne
s’y établissent malgré lui. 4° après la mort du grand Pompée, quel ami lui resta t’il en Egypte pour lui ériger
un mauzolée de cette conséquence, de cette dépense, de ce travail ? Le Roy Denys qui l’avoit fait
assassiner ? Jules César son rival ? Il est vray que celui cy eut horreur de l’homicide et en fit de sanglants
reproches au Roy Denys. Il n’est pourtant écrit nulle part qu’il ait obligé le Monarque Egyptien à dresser
quelque Monument en l’honneur du mort. 5° les Romains devenus Maîtres d’Aléxandrie n’ont songé qu’à la
ruiner, qu’à s’enrichir de ses dépouilles, bien loin de l’embellir d’ouvrages nouveaux et avec des frais
immenses. 6° si les Romains avoient été les Autheurs de la colonne, quelque histoirien contemporain en eût
parlé, sur tout Plutarque dans la vie de Pompée. On doit donc ranger l’époque de cette colonne sous la
domination des Ptolémées. Mais duquel des Ptolémées ? Je soupçonne que c’est du Philadelphe. Mais
pourquoi les Autheurs anciens n’ont ils rien dit de cet ouvrage ? C’est qu’il étoit confondu avec le temple de
Sérapis.
(p. 50) On voit les restes d’un mur autour de la colonne … Il y a sur le plinthe de la base au dessus du pié
d’estal une inscription grecque de 3 lignes fort effacées :
(en grec)
Le 22 janvier 1724, Mr de Marigny fit porter une echelle à la colonne de Pompée. Nous découvrîmes quatre
lignes et demye à l’inscription
(en grec)
On remarque les vestiges, bien que fort effacés, d’une pareille inscription dans la face orientale du même
plinthe de la base.
[Vansleb dit grossièrement dans sa relation avoir remarqué que la colonne de Pompée panchoit d’un côté,
huit ans après qu’il l’avoit vüe fort droite.
Le chapiteau de la colonne est à feuilles galbées, c’est à dire sans être refendües comme les chapiteaux
corinthiens et composites du Colisée.]
Les angles du plinthe de la base ne correspondent pas juste à ceux du pié d’estal. Ny les uns ny les autres
aux angles du chapiteau, et galbé de même que les chapiteaux corynthiens du Colisée.
Nous avons mesuré avec une ficelle le contour du fust … 25 piés ½
hauteur du plinthe de la base …………………………………2 … ½
hauteur du pié d’estal …………………………………………10
largeur du dé ……………………………………………………11 … 2/3
(p. 51) On voit dans le livre Elucidatio terræ sancta du père Quarêmius l’inscription suivante qu’il a tiré d’un
livre composé par deux Allemans. Ceux cy écrivent donc ainsi in Alexandrià Ægypti in columnâ mira
magnitudinis
(inscription en grec)
Si ces Allemans entendoient parler de la colonne de Pompée, ils rêvoient.
A travers ce qui reste des charactères du pié d’estal à demy rongés, on entrevoit évidemment le nom du Roy
Denys Ptolomée dans la 3e ligne, et probablement de Pompée à l’entrée de la 4e, de la manière que je l’ai
expliqué cy dessus. Mais qui a posé là, dira t’on, le nom du Général Romain mis à mort et celui du Prince
Egyptien son ennemi ? Je répond que quelque officier Romain ami de Pompée et zélé pour sa gloire aura
voulu graver dans un lieu aussi noble que le temple de Sérapis, et aussi exposé que ce pié d’estal,
l’épitaphe de l’illustre défunct, peut être du tems, peut être même par ordre de Jules César. De là vient que
par tradition on donne à cette colonne le nom de Pompée, parce qu’on aura lu son nom sur le pié d’estal.
Il est bon pourtant de remarquer que les lettres de cet épitaphe sont si superficiellement imprimées sur le
marbre qu’il paroist bien que jamais la colonne n’a été érigée à l’honneur du Triumvir malheureux, ni que son
simulachre n’a été posé au dessus. Autrement, après travaux et frais immenses d’un monument si superbe,
auroit on épargné la dépense nécessaire à sculpter profondément quelques mots, ainsi qu’on le fait dans
pareilles occasions ? Auroit on manqué de graver l’inscription au milieu du dé du pié d’estal selon la
coutume ?
[J’ai remarqué en septembre 1722 que les 4 faces du pié d’estal ne correspondent pas droit aux quatre
parties du ciel, la face de l’inscription décline un peu au Nord.
(p. 52) Peut être cette colonne a t’elle servi dans le temple de Sérapis pour porter l’image du soleil, ainsi elle
auroit été élevée par Philadelphe.]
[Grottes sépulchrales]. A l’ouest à 5 ou 600 pas de la colonne de Pompée, au delà du calits, on trouve des
grottes sépulchrales ; c’est une allée entre deux rochers dans laquelle on descend par une dizaine de
degrés. Elle est large de 10 piés et longue d’une cinquantaine de pas. A droit et à gauche sont des rangs de
cavernes, 8 de chaque côté. Les cavernes sont plus ou moins profondes et coupées de niveau. Une de
celles là sur la droite a 9 toises et demye de longueur, y compris la salle du fond de 2 toises de long, une
toise et demie de largeur et de 2 de hauteur, avec 96 niches en trois rangs l’un sur l’autre de chaque côté :
chaque niche a 3 piés de haut, 2 de large et 6 de profondeur.
Dans une autre caverne nous contâmes 37 niches en double rang l’un sur l’autre de chaque côté.
Dans la dernière des cavernes à gauche, on entre dans les allées dont on ne sçauroit trouver le bout.
La plus part de ces cavernes sont bouchées à l’entrée, et les autres fort dégradées. Les Arabes les
nomment El Souq, le marché.
A l’ouest de ces cavernes mortuaires et vers le bord de la mer, on en rencontre plusieurs autres toute
creusées à la pointe du ciseau comme celles cy.
[Obélisque du Roy Mesphée dit de Cléopatre]. Il est de granit comme tous les autres obélisques, sa
longueur est de 54 piés de roy hors terre, et 3 piés et demy dans la terre. Sa largeur d’en bas six piés huit
pouces, celle d’en haut vers la cime 5 piés. Au dessus de cette cime l’obélisque rentre et se rétrecit pour finir
en pointe. Il y a des jéroglifes peu profonds vers cette pointe.
Non loin à l’Est de l’obélisque est une tour remarquable par une voute à champignon soutenüe de quatre
colonnes de granit.
On voit un autre obélisque abbatu à 12 pas oüest de celui là, de la même forme et grandeur.
Pline dit en parlant de ces 2 monuments, Alli duo obelisci sunt Alexandriæ ad portum in Cæsaris templo,
quos excidit Mesphées Rex quadragenum binum cubitorum, L. 36 c. 9.
Ces deux obélisques posés dans une avant cour du temple de César présentoient (p. 53) au loin dans la
mer une noble perspective. S’ils doivent leur fabrication au Roy Mesphée, ils ne sçauroient avoir été
transportés du Saïd à Aléxandrie qu’aux tems des Ptolomées, ou si vous voulez d’Auguste, par la raison
qu’avant Aléxandre cette ville n’étoit rien ou se réduisoit au chétif village de Racotis. Il est plus vray
semblable qu’Auguste (ou quiconque a fait bâtir le temple de César) a trouvé ces obélisques portés sur les
lieux, ayant déjà servi d’embellissement à des palais des Monarques grecs, et qu’il n’a eu la peine que de
les clorre dans le parvis du temple de son grand oncle.
Mr Claude le Maire étant consul du Caire fit creuser au mois d’octobre 1718 au pié de l’obélisque qui est
debout, voici ce qu’il trouva.
L’obélisque n’avance en terre que de 3 piés ½. Il pose sur une base de marbre granit de 6 piés de hauteur.
Cette base déborde du côté du Sud de 3 pouces, et du Nord de 9. Quant à l’Est et à l’oüest, elle déborde
également de 6 pouces de chaque côté. Le bas de l’obélisque est mutilé pour le moins d’environ 14 pouces
à chaque face. Il n’appuye sur la base que d’environ 5 piés ½. Pour remplir la mutilation et mieux soutenir le
pié du monument, on lui a fait tout autour une batisse de pierre et de chaux. Vers le Nord il y a un chapiteau
de marbre qui sort de dessous l’échancrure ou mutilation d’environ un pié. La base est toute unie sans
aucun ornement d’Architecture. Sous la base est un socle de marbre rougeâtre et grisâtre (tel que le socle
sous la base de la chapelle de Pan, dont je parlerai dans l’article Themuis) qui déborde de chaque côté de
14 pouces. On n’a pas pu sonder sa profondeur. Les jéroglyfes du fust qui sont ensevelis sont mutilés vers
le bas.
Les 42 coudées de la longueur des deux obélisques déterminées par Pline se trouvent dans les 63 piés de
Roy compris au fust et à la la base, le fust 57 et la base 6.
Ces 2 obélisques ont ressenti les effets d’un climat pluvieux et des brumes salines de la mer, qui ont altéré
plusieurs caractères aux faces de l’Est et du Sud. Les aiguilles de l’ancienne Thèbes dans le Saïd sont
encore aujourd’hui d’une conservation et d’une gravure si entière qu’elle surprend.
[Nicopolis] Nicopolis, faux bourg et port de mer véritablement séparé d’Aléxandrie, éloigné seulement de
20 stades (Strabon en conte 30) vers le levant. Vespasien s’y étant embarqué continua sa route vers
Jerusalem par les villes (p. 54) de Mendérine, Thamaïs, Tanis etc. situées le long du rivage, Josep. bell. jud.
L. 4 c. 42.
[Aléxandrie]. Les murailles et les grosses tours dont elle est bordée paroissent l’ouvrage des Mahométans,
non des chrétiens encore moins des Romains. Il y a force inscriptions Arabes sur les portes.
La latitude d’Aléxandrie est de 31 d. 10’.
Du tems de St Cyrille, les juifs furent chassés d’Aléxandrie, où ils avoient habité depuis le tems d’Aléxandre
le grand. Socr. L. 7.
Le 73e patriarche d’Aléxandrie fut Marc Aboulfarage fils de Zaraa lequel, contre la coutume de ses
prédécesseurs, faisoit servir de la viande sur sa table.
De son temp et vers l’an 1166, 1168 de l’Hegire, l’Eglise de St Mercure et plusieurs autres du vieux Caire
furent brulées par un incendie général dont le vizir Chauvar fut l’autheur. Dans le même tems les coptes se
confessoient sur un encensoir et observoient la circoncision. Le prêtre Marc fils d’el Combar, déclamant
contre ces vices et ramenant plusieurs coptes à la religion catholique, fut excommunié par son patriarche
Marc d’Aléxandrie, aussi bien que par Michel patriarche jacobite d’Antioche, dans un concile de 60 Evêques.
Marc tint le siège près de 23 ans et mourut le 1er de janvier 1189, Vita Salad. Manuscripta, apud Renaudot et
Fleury Hist. Eccl. »
- 607 - 614 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
BASILE GRIGOROVITCH-BARSKY-PLAKA-ALBA (1730)
Volkoff, O. V., Voyageurs russes en Égypte, RAPH XXXII, Ifao, Le Caire, 1972.
Basile Grigorovitch naît en 1701 dans une famille noble de Kiev. Son père, qui pense que les vices tels que
la vanité et l’orgueil proviennent des sciences, ne veut pas qu’il devienne un savant. Ainsi, il éduque son fils
à la maison. Ce dernier entre tout de même au séminaire de Kiev, mais une plaie à la jambe le force à
interrompre ses études. Le jeune homme quitte la maison familiale et entre, sous un faux nom, à l'Académie
des Jésuites à Lvov. Mais après avoir été démasqué, il décide de visiter les pays étrangers et se met en
route à pied. Il voyage ainsi pendant 24 ans. En 1723, il entre en religion et devient moine sans renoncer à
sa vie errante. Au cours de ses pérégrinations, il visite, de 1726 à 1730, Rome, Naples, Florence, Venise,
Constantinople, les Lieux Saints, l’Égypte, etc. Pendant ces voyages, il tient un journal de route très détaillé
et illustré de plus de 150 croquis. Il meurt en 1747, un mois après son retour en Russie.570
Remarque : texte partiellement traduit par O. V. Volkoff.
p. 95-100 :
« C'était jadis une grande ville ; maintenant elle est si déserte et ruinée que l'on voit à peine qu'il y a eu ici
jadis une ville. Elle ressemble à un grand village. Les murs sont effondrés et en ruines ; sur les pans de mur
encore debout s'ouvrent, en beaucoup d'endroits, des embrasures. [Il y a] deux portes, fermées pendant la
nuit, celle du midi et celle de l'est. La porte du côté de la terre est debout, tandis que celle du côté de la mer
est tombée (sic). À l'intérieur de la ville il y a peu de bâtiments, mais à l'extérieur, au bord de la mer,
s'élèvent beaucoup de cours, de palais et de maisons, bâtis en pierre blanche et d'une belle allure ; il y a là
aussi un grand marché avec beaucoup de granges et de magasins. C'est là qu'habitent les gens distingués.
À l'intérieur de la ville vivent çà et là les chrétiens, les juifs, les coptes, les Turcs, et tous ont des monastères
(sic) ; de même les Italiens ont un monastère nouvellement fondé, dédié à la grande martyre Ste Catherine ;
[il y a] également le monastère orthodoxe de St Saba. Là, à l'intérieur de la vieille ville, non loin du
monastère, au sud, existent des palais en ruines faits en brique, au sujet desquels les chrétiens racontent
que là habita la grande martyre Ste Catherine quand elle était encore en vie ; là, devant ce palais, à gauche
et à droite, à une jetée de pierre, il y a des piliers monolithes grands et gros, et leur pierre semble être
formée de divers marbres concassés ; certains disent qu'ils étaient originellement multicolores, rouges et
blancs, et ils sont (me semble-t-il) comme ceux que l'on voit parfois dans les palais des rois ; mais
maintenant ils sont à côté des chemins [et] sont recouverts des débris de la ville, car personne n'ose les
déplacer et les utiliser, pour les employer, à cause de [leur] grand poids ; car les hommes faibles de ce
siècle ne sont pas comme les premiers géants [de jadis]. Pareillement on trouve à l'ouest une grande
mosquée turque, complète, en longueur et en largeur, comme une (p. 96) forteresse ou un château, avec
beaucoup de fenêtres et une seule coupole de pierre, dont les habitants locaux disent qu'elle était jadis
l'église de St Athanase, évêque d'Alexandrie, et là était la demeure des anciens patriarches ; à côté du
monastère St Saba, il y a une colline artificielle, composée de nombreux débris anciens de la ville ; là les
Arabes creusent et fouillent tous les jours, et trouvent parfois de l'or, parfois de l'argent ou des perles et des
pierres précieuses avec des sceaux anciens gravés ou d'autres choses.
Il y a aussi une autre colline de débris située loin du monastère, à l'ouest des murailles de la vieille ville,
mais là on ne trouve rien.
On sait qu'Alexandrie n'a pas été fondée sur la terre ferme, mais [repose] sur des piliers et des supports, car
on rapporte comme une chose certaine, qu'une deuxième ville se trouve au-dessous, avec de nombreux
puits, semblables à des sanctuaires, avec des piliers et des tournants à l'intérieur ; si bien que chaque été ils
se remplissent [d'eau] du fleuve Nil pour la boisson du peuple et l'arrosage des jardins, et pour toutes les
nécessités humaines ; une partie du Nil se sépare en amont de Rakhit près du village appelé Thèbes, et
coule plus loin (p. 97) dans les champs, et passe près d’Alexandrie du côté sud et tombe dans la mer. Mais il
ne coule pas naturellement ; le peuple dit que le roi Alexandre de Macédoine creusa le lit et y posa des
pierres, et y conduisit l’eau, car en cet endroit il n’y a pas d’autre eau, sinon salée. Et il y a beaucoup de
piliers monolithes debout tombés, çà et là dans la ville. Au dehors de la ville, il y a un pilier très grand, en
hauteur et en longueur, remarquable par son travail et son art ; il est admiré par beaucoup de voyageurs. Il
est appelé « colonne de Pompée ». Sur lui se trouvait jadis une idole, adorée par les idolâtres. Elle était la
première de la ville (dit-on), car jadis la ville ancienne était très grande ; mais elle a été complètement
détruite ; on ne peut même en distinguer les traces. On en voit les restes parmi les murailles de la ville, qui
furent bâties plus tard ; cette colonne a été mesurée par des mesureurs intelligents et compétents qui
viennent des pays de l’ouest [et] examinent chaque chose soigneusement. Par eux on sait, et on le dit, que
la hauteur de la colonne est de 122 [pieds] et son épaisseur intérieure (sic) est de 12 pieds ; et quant à la
largeur, juges-en toi-même combien cela peut faire. Elle est composée de quatre parties : la première est la
pointe, la seconde est le tronc lui-même, et deux parties forment le socle. Et on dit que tout le pilier est d’une
pierre, et qu’il a cent pieds, et le socle 22 [pieds] ; il semble qu’il est à l’intérieur ; mais de cela personne
(p. 98) n’est certain, car il est impossible à un homme d’y entrer. À l’intérieur de la ville, du côté nord, près du
monastère de Saint-Saba, à côté de la mer, il y a encore deux autres grandes colonnes monolithes qu’on
appelle « [aiguilles] de Cléopâtre ». L’une d’elle est tombée, à cause de son grand âge, la seconde par
contre, reste inébranlable. Les uns pensent qu’elles se trouvaient jadis devant des palais royaux. Elles ont
onze empans d’épaisseur, que j’ai mesurés moi-même : quant à leur hauteur, je n’ai pu la connaître, mais je
pense qu’elle doit être de dix sajènes. La pierre est une et entière, simple, pas arrondie comme le sont en
général les colonnes, mais elle est carrée, et en haut elle est pointue, et de tous les côtés elle a la même
largeur, et certains sceaux ou signes y sont gravés profondément [à une profondeur] de deux phalanges de
doigts (…).
Et puisque j'ai parlé de tant de choses, il convient de dire aussi un mot du couvent mentionné plus haut,
St Saba ; là habitent très peu de chrétiens, il y a seulement les marins571 qui viennent là et [en] partent. C'est
pourquoi il n'y a [là] qu'une église paroissiale ; à part le monastère de St Saba, qui est à l'intérieur de la ville,
mais tout seul en un endroit spécial et isolé, il y a un monastère ancien, fondé par les anciens chrétiens,
mais je ne sais pas le nom de celui qui l'a fondé ; le bâtiment [du monastère St Saba] est petit, a quatre
murs, [il est] haut, caché du dehors et sans aucune beauté. À l'intérieur, il est par contre d'une belle
disposition, il y a des cellules, une cuisine et un réfectoire, et il a une porte bardée de fer. Du côté du mur de
l'est, il y a une église avec un toit plat, sans coupoles ; [elle est] belle, dallée de pierre et de marbre, assez
longue, large et haute, soutenue par douze hautes colonnes monolithes ; cinq sont placées à droite et cinq à
gauche, et deux derrière l'iconostase celles-ci sont sculptées ; à part celles-ci, il y a d'autres piliers, petits, en
marbre ; l'église est à trois autels, dont le premier est de St Saba, le deuxième du martyr St Georges, et le
troisième est inoccupé. L'autel principal (p. 99) est grand et beau, et il a un toit en bois avec une coupole sur
quatre colonnes, également en bois, et construites avec art ; le siège de l'archevêque est pareil, et est dallé
de marbre ; il y a une iconostase avec de belles icônes ; [l'iconostase] a trois portes, [celle] du Tzar572, la
Méridionale et la Septentrionale, et il y a encore sur le côté une petite entrée dans le sanctuaire ; il y a
encore le trône du saint patriarche, fait avec beauté et art ; de même l'ambon où l'on lit l'Évangile. À droite,
sur un petit autel, les Romains célèbrent parfois la messe et les funérailles, les jours de St Samuel, le
patriarche d'Alexandrie ; avant ils n'avaient même pas de monastère. Il y a là les tombes de beaucoup de
célébrités et au-dessus des tombes, sur des plaques de marbre, il y a des mots gravés dans le dialecte latin.
Il y a là encore, dans l'église, derrière l'estrade de gauche pour le choeur, une colonne de marbre blanc,
carrée, plantée en terre ; elle est large de deux empans. Les moines et les novices disent que sur cette
colonne fut tranchée la tête de Ste Catherine, et qu'elle fut arrosée de son saint sang. C'est pourquoi, les
chrétiens qui viennent s'y incliner, la baisent avec vénération. L'église est très belle, seulement sombre à
cause du petit nombre de fenêtres ; elle est à l'étroit entre les cellules, et elle en longueur 77 pieds, en
largeur 66, et moins en hauteur ; elle a une seule petite porte du côté du mur méridional, et il y a encore
deux jardins, l'un devant, l'autre derrière le monastère. Ils contiennent des oliviers et des dattiers, et des
légumes ; dans le grand jardin il y a un hôpital ; il y a là beaucoup de malades, soit du monastère, soit,
parfois, des étrangers, [et ils] y restent jusqu'à complète guérison. Et la vieille ville d’Alexandrie n’a aucun
beau bâtiment ou palais, à part ceux qui ont été décrits. Elle a encore un autre [palais], à l’est, placé à
l’intérieur de la ville, et à part ça il n’y a rien ; et si elle (p. 100) ne possédait ces lourdes et belles anciennes
colonnes grecques, cette ville n’aurait rien qu’on puisse louer, à part les maisons nouvellement bâties au
bord de la mer ; Alexandrie est digne de louanges, en ce qu’elle accueille de nombreux et divers navires ;
elle a deux grands ports, l’un plus petit à l’est, et celui-ci est pour les Français, les Anglais, les Hollandais et
les Vénitiens ; le deuxième, plus grand, est à l’ouest, où sont les navires turcs et grecs, et celui-ci est
silencieux et muet. Entre les deux, sur une mince corne (sic) qui s’allonge dans la mer, il y a une forteresse
avec des bâtiments forts et solides en pierre, et elle est armée de canons à cause de brigands et de toute
sorte d’ennemis qui peuvent [y] arriver ; elle a encore sur une autre colonne, une grande lanterne que l’on
allume chaque nuit et dont la lumière sert de signal aux navires qui abordent la nuit, ou qui se sont égarés,
pour qu’ils trouvent le chemin du port d’Alexandrie.
Étant resté à Alexandrie une semaine, et ayant trouvé un petit navire turc et donné de l’argent, je partis pour
Damiette pour deux jours non plus par le Nil, le doux fleuve, mais par l’illustre mer salée. »
570 Volkoff, O. V., Voyageurs russes en Égypte, Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire XXXII,
Ifao, Le Caire, 1972, p. 75-76.
571 Th. D. Mosconas écrit : « Les marins, dont beaucoup avaient un pied-à-terre à Alexandrie, Damiette ou
Rosette, avaient des attaches dans le pays, car beaucoup contractaient mariage avec des orthodoxes
résidentes. » (« L’église Saint-Saba à travers les siècles », RCFO 11e année, n° 8, 1947, p. 457.)
572 On appelle ainsi la porte centrale de l’iconostase, que seul le prêtre peut franchir.
- 615 - 617 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN-BAPTISTE TOLLOT (du 30 juillet au 9 août 1731)
Tollot, J.-B., Nouveau voyage fait au Levant, ès années 1731 et 1732, contenant les descriptions d'Alger,
Tunis, Tripoly de Barbarie, Alexandrie en Égypte, Terre sainte, Constantinople, Paris, 1742.
Jean-Baptiste Tollot (1698-1773) est botaniste.
p. 108-119 :
« Mouillage des Bequiers devant Alexandrie :
Le 30 le consul vint à bord avec le Drogmant & plusieurs Marchands François établis à Alexandrie pour
traiter des affaires de la Nation ; ils dînèrent à bord de M. de Camilly ; l’après midi nous partimes avec eux
pour aller à terre, sur un bâtiment du pays que l’on nomme Germes. Ces sortes de bâtimens sont bons
voiliers ; nous arrivâmes en deux heures du mouillage à Alexandrie, distance de sept lieues des Bequiers.
En entrant dans le port tous les bâtimens saluerent, ainsi que le château ; nous logeames chez M. le Consul,
où nous fumes très-bien reçus.
Le lendemain M. de Camilly vint à terre avec beaucoup d’Officiers dont la plupart logerent chés des
Marchands, n’y ayant point assés de place chés le Consul. A l’arrivée de ces Messieurs, les vaisseaux du
port saluerent, & le château salua à boulets. Il y eut pendant trois jours chés le consul trois tables très-bien
servies, & l’on peut dire qu’il fit faire bonne chere & traita bien ses nouveaux hôtes. Ce consul se nomme
M. d’Hesse, homme d’environ 60 ans, qui a épousé depuis peu une des filles du Consul de Chio, agée de 18
ans. C’est une dame fort aimable dont il est, à ce que l’on dit, un peu jaloux ; il n’en donna cependant nulles
marques pendant tout notre séjour dans cette ville, peut-être pour s’accommoder au gout François.
Ce même jour, après dîner, nous fûmes visiter les ruines de l'ancienne Alexandrie. Pour cet effet nous
montâmes sur des asnes moyennant quatre parats chacun. Nous étions vingt-cinq ou trente hommes à
courir dans ces ruines sur ces sortes de montures, sans brides ni étriers, de sorte qu'il falloit se tenir dans
l'équilibre ; et souvent en cherchant à s'y mettre, l’on tomboit.
Nous fûmes d’abord voir cette belle colonne, dite de Pompée, dont on parle tant. M. de la Condamine la
mesura très exactement, & trouva qu’elle avoit quatre vingt-quatorze pieds de haut, y compris de pied d’estal
& le chapiteau ; le fut, qui est tout d’un seul bloc, est haut de 70 pieds, & huit pieds de diametre dans la
moyenne epaisseur. La base & la colonne sont posées sur une pierre isolée de douze pieds en quarré. Le
pied d’estal est dégradé tout à l’entour. Cette colonne est de ce beau granite tiré des carrières de la haute
Egypte.
Elle est dans les champs, éloignée de l’ancienne ville d’environ six cens pas. Nous revinmes ensuite dans
l’Eglise de Ste. Catherine qui appartient aux Grecs Schismatiques, où l’on nous fit voir la pierre sur laquelle
on prétend que la Ste. eut la tête tranchée.
Paul Lucas dit avoir vu du sang sur ladite pierre. Nous l'avons examiné dans tous sens, même avec un
flambeau, parce que le lieu est un peu obscur. Comme c'est un bout de colonne de marbre blanc, nous n'y
aperçûmes que quelques petites veines rouges qui sont fort communes à ces sortes de marbre ; ce sont
peut-être ces veines rougeâtres que Paul Lucas et d'autres ont pris pour être le sang de Sainte Catherine,
ce qui doit suffire pour désabuser un Lecteur trop crédule ; ce bout de colonne a environ deux pieds & demi
de haut.
Sortant de ce lieu, nous fûmes voir l’Aiguille dite de Cléopâtre, qui a soixante pieds de haut, & d’un seul bloc,
du même granite que la colonne de Pompée. Il y a sur cet obélisque plusieurs caractères arabes, des
figures d’oiseaux, & d’autres animaux. Il y en avoit autrefois quatre comme celle qui existe actuellement,
entre lesquels Cleopâtre se promenoit dans son char. Celles qui manquent ont été enlevées par les Turcs &
employées à construire des Mosquées.
L’on ne voit parmi toutes ces ruines, que Colonnes, Cyternes, Pilastres & autres monumens qui font voir
aujourd’hui qu’elle étoit autrefois la grandeur de cette grande ville, qui après Rome étoit la Capitale du
monde.
Cette ville est bâtie dans une plaine sur le bord de la mer, 332 ans avant Jesus-Christ, proche un des sept
bras du Nil, que nous nommions l’embouchure de Canope.
L’Eglise d’Alexandrie fut fondée par St. Marc vers l’an 50 de J. C. La 7e année de Neron & elle a eu le titre
de Patriarchat qu’elle conserve encore.
Nous vîmes dans une Eglise qui appartient aux Arméniens, une membrure de fauteuil de bois posée sur une
pierre de quatre pieds de haut, que l’on dit être la chaire dans laquelle St. Marc prêchoit. Les Grecs et les
Arméniens le croyant fermement, je le veux bien croire aussi ; mais en tout cas, saint Marc n'étoit pas trop à
son aise, si sa chaire n'étoit pas dans ce tems-là en meilleur état qu'elle est actuellement.
La ville étoit autrefois très-bien fortifiée, ses murailles étoient hautes, flanquées de Tours distantes l’une de
l’autre de trois cens pas, dans chacune desquelles est une salle ronde dont la voûte est soutenue de
colonnes où l’on pouvoit mettre environ cent hommes ; au dessus desdites Tours étoit une platte-forme où
l’on auroit pû placer encore autant de combattans. Il y a aussi des embrazures & des Meurtrières ;
quelques-unes de ces tours subsistent encore.
Le deux nous fûmes voir les Catacombes, où sont les sépultures des anciens Egyptiens. Ce lieu est éloigné
de l’ancienne ville d’environ une lieue. Pour y aller nous nous servîmes encore de nos mêmes montures, &
nous étions environ le même nombre de cavaliers. Il y avoit avec nous les deux aumôniers de nos
vaisseaux, & deux capuçins d’Alexandrie qui marchoient à la tête de notre escadron.
On descend dans ces souterrains par une espece d’escalier ou du moins on juge par la situation de l’entrée
qu’il y en eût autrefois un. Après avoir descendu environ vingt pas, on trouve au fond, des tombeaux taillés
dans le roc de trois pieds de large, sur six de profondeur ; à main gauche en entrant on voit des souterrains
que les eaux ont comblés, dans lesquels on ne peut entrer ; au milieu à main droite nous entrâmes par un
trou fort étroit, où l’on ne peut passer qu’en se traînant sur le ventre. Nous descendîmes donc par ce trou,
dans une grande salle d’environ quarante pieds de long sur douze de large. Des deux côtés et au fond de
ladite salle sont des sépulchres tous taillés dans le roc de même que ceux dont je viens de parler. Il y en a
quelques uns faits différemment. On entre par un de ces sépulchres ordinaires, au fond duquel est une
petite chambre ronde d’environ trente pieds de circuit, tout au tour de laquelle chambre, & dans le roc sont
des sépulchres de même que ceux de la grande salle. On prétend que ces lieux, ainsi distribués, étoient
destinés pour des familles entières. Il y a dans tous ces sépulchres beaucoup de sable que l’on employa à
conserver les corps. Ces souterrains ne reçoivent le jour d’aucun endroit, on est obligé d’y porter des
bougies, & on assure qu’ils s’étendoient autrefois très-loin, & que ce que nous avons vu n’en étoit que la
plus petite partie, parce que les eaux ayant miné dans plusieurs endroits en ont fermé l’entrée.
Après avoir vu ces lieux nous remontâmes sur nos asnes, et à peine avions nous fait cent pas, qu'un de nos
Capucins fit la culbute avec sa monture. Je ne puis dire au juste lequel portait l'autre dans ce moment ;
c'était au commandant de notre escadron que ce contre-tems arriva, qui en fut quitte pour la peur. Il ne fut
pas le seul, beaucoup d'autres eurent le même sort.
Le lendemain M. de Camilly retourna à son bord, ainsi que Messieurs les officiers. Nous restâmes à terre
jusqu’au neuf ; jour de notre départ.
L’on me fit voir les fours à poulets, dans lesquels on met un millier d’oeufs & plus pour les faire éclore de
même que s’ils avoient été couvés par des poules. On y maintient le même degré de chaleur que celle qui
vient de la poule, & au bout du terme ordinaire les oeufs éclorent. L’on fait sur le champ avertir tous les
habitants de la ville & ceux qui veulent des poulets viennent en acheter & n’ont pas si bon goût qui ceux qui
ont été couvés par des poules.
Nous nous embarquâmes le neuf pour nous rendre à bord, M. Pignon consul du Caire y arriva le même jour,
& reçut de M. de Camilly les ordres de la cour ; le lendemain il s’en retourna avec le vice-consul & plusieurs
marchands de cette ville. »
- 618 - 619 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CLAUDE GRANGER (1731)
Granger, C., Relation du voyage fait en Egypte par le sieur Granger en 1730, Paris, 1745.
Médecin de Dijon, appelé en réalité Tourtechot, Claude Granger après avoir étudié la chirurgie se fait
remarquer à Marseille et à Toulon au moment de l’épidémie de peste. En 1730, Jean Frédéric Phélypeaux,
comte de Maurepas et secrétaire d’État à la marine, le charge de rechercher en Égypte les plantes, les
animaux et autres choses pour servir à l’histoire naturelle. Il meurt près de Bassorah en 1737 ou 1738.573
p. 215-222 :
« Description d’Alexandrie. Lac Mareote. Tour des Arabes.
Alexandrie Capitale de L’Egypte sous les Ptolomées & les Romains, superbe par ses Temples & ses Palais,
est depuis longtems accablée sous les ruines. Il lui reste quelques murailles & de grandes tours fort
dégradées dont l’Architecture n’est ni Grecque ni Romaine, ce qui fait conjecturer qu’elles ont été bâties par
les Sarasins. Son double port y fait pourtant fleurir le commerce, le vieux est destiné pour les vaisseaux des
sujets du Grand-Seigneur, le nouveau est ouvert aux Européens ; la colonne vulgairement appelée de
Pompée, un obélisque sur pied & un autre renversé sont les seules choses qu’on voit à Alexandrie dignes
de l’attention des curieux. La partie de la ville qui borde le port vieux & s’étend jusqu’au nouveau, est bâtie
dans l’endroit où étoit autrefois Racotis. On voit au Sud du port neuf un Cap que les Anciens appelloient
Possidium à cause d’un Temple consacré à Neptune ; Marc Antoine allongea ce Cap par un beau Mole, au
bout duquel il bâtit son Timonium dont on voit encore de magnifiques débris en tems calme, cet édifice ainsi
que la plus grande partie du Mole étant enseveli sous les eaux. De tous les anciens édifices d’Alexandrie,
les mieux conservés sont les citernes qui s’emplissent tous les ans de l’eau du Nil, qu’un canal qu’on nomme
de Cléopatre, & qui commence à deux lieuës de Rosette, y conduit ; c’est la seule eau qu’on ait à
Alexandrie ; quand le Nil manque, on est obligé d’aller s’en pourvoir à Rosette.
Les habitants d'Alexandrie sont au nombre de quatorze à quinze mille, tous gens ramassés, séditieux, &
voleurs à l'excès. Outre les François et les Anglois qui y font un assez grand commerce, on y voit plusieurs
marchands Grecs et Juifs. Il y aborde tous les ans quelques vaisseaux marchands Vénitiens qui prennent la
protection de la France.
Les anciennes Eglises de saint Marc & de sainte Catherine desservies, celle-ci par les Grecs & l’autre par
les Coptes, sont réduites à fort peu de chose.
Les Cordeliers de la Terre-Sainte y ont un hospice et desservent, comme dans les autres endroits de
l'Egypte, la Chapelle et la Cure de France.
Les terres d’Alexandrie sont extrêmement basses, la seule reconnoissance qu’en ont les navigans, après la
tour des Arabes qui n’est qu’à douze lieuës du côté de l’Ouest, est la colonne de Pompée, ce qui oblige
souvent les bâtimens d’aller à Chypres & quelquesfois en Syrie quand les terres sont embrumées. Il n’y a
aux environs d’Alexandrie ni bien loin de là ni bois ni paturages, ce sont des terres couvertes de sable qui
peuvent à peine produire quelques dattiers. On a lieu de s’étonner qu’Alexandre eût choisi un endroit dont
l’accès est si difficile aux naviguans, & dépourvû d’eau, de bois & généralement de toutes choses
nécessaires à la vie, pour y bâtir une si grande Ville ; mais on a lieu d’admirer la magnificence des
Ptolomées qui la rendirent la plus peuplée & en même temps la plus abondante du monde connu.
Au sud d’Alexandrie il y a le lac Mareote qui a dix lieuës en longueur de l’Est à l’Ouest & quatre de largeur, il
s’emplit des eaux du Nil dans le tems de l’inondation & reste à sec pendant quatre à cinq mois de l’année.
À l'extrémité Occidentale de ce lac on voit la tour des Arabes que les gens du pays nomment Château
d'Abouzir574, c'est effectivement un Château quarré de quatre-vingts pieds de haut dont les faces en ont
chacune deux cent cinquante de large ; bâti de très-belles pierres de taille, les murs ont quatorze pieds
d'épaisseur. À un quart de lieuë de ce Château il y a une tour quarrée par le bas & ronde par le haut, & à six
lieuës de-là, toûjours du côté de l'Ouest, il y en a une autre sur les murs de laquelle on voit les restes d'une
inscription arabe : tous ces édifices tombent en ruines. »
573 Riottot, A., Voyage dans l’Empire ottoman de Claude Granger, naturaliste (1733-1737). Correspondance
au comte de Maurepas, document polygraphié conservé à la bibliothèque du Collège de la Sainte Famille au
Caire, 2004, non paginé.
Clément, R., Les Français d’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, Ifao, Le Caire, 1960, p. 185-188.
Carré, J. M., Voyageurs et écrivains français en Égypte, t. I, Ifao, Le Caire, 1956, p. 53.
574 C’est l’ancienne Taposiris Magna, à environ cinquante kilomètres à l’Est d’Alexandrie. Il en subsiste les
ruines d’un temple dédié à Osiris. Note de O. V. Volkoff.
- 620 - 621 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
THOMAS SHAW (entre 1720 et 1732)
Shaw, T., Voyages de Monsr Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant de 1720 à 1732,
Paris, 1743.
Thomas Shaw (vers 1692-1751) est chapelain au comptoir anglais d’Alger de 1720 à 1732. Il revient en
Angleterre en 1734 et publie son récit de voyage en 1738.575
p. 20-23 (tome II) :
« Alexandrie qu’on nomme aujourd’hui Scandarea, a deux ports ; le Port neuf, où entrent tous les vaisseaux
qui viennent d’Europe, & le vieux Port, où ne sont admis que les vaisseaux qui viennent de Turquie. Le
premier est celui que Strabon appelle le Grand Port, étant à l’Est du Phare : le dernier doit être celui qu’il
appelle Eunostus ; c’est-là qu’étoit le Cibotus, qu’on dit avoir eu communication avec le lac Mareotis, lequel
est derriere au Sud. L’Alexandrie moderne est située entre ces deux ports, vraisemblablement sur le terrain
que Strabon nomme Heptastadion : l’ancienne ville étoit plus avant au Nord & au Nord-Est.
La plus grande partie des murs de l’ancienne Alexandrie avec leurs tourettes subsistent encore ; ce qui est
surprenant, vû les grands ravages que les Sarazins ont fait dans d’autres endroits. Les anciennes cîternes
de la ville se sont aussi fort bien conservées : elles se remplissent d’eau dans le tems de l’inondation du Nil,
& sont très-profondent, leurs murailles étant soutenues par plusieurs rangs d’arches, sur lesquelles la ville
est bâtie. On peut aussi juger de la grandeur & de la magnificence de l’ancienne Alexandrie par deux rangs
de colomnes de Granite, dont plusieurs subsistent encore, lesquelles, à ce qu’on suppose, formoient la ruë
dont parle Strabon, qui alloit du quartier Necropolitain jusqu’à la porte de Canopus. On trouve de même à
Latikea & à Hydra, dont nous avons déja parlé, des rangs de colomnes semblables.
La Colomne de Pompée se voit à une petite distance au Sud des murs d’Alexandrie : elle est de l‘ordre
Corinthien, mais le feuillage du Chapiteau est mal exécuté. On a enlevé plusieurs grands morceaux de
pierre & de marbre du fondement de cette colomne, dans l’espérance de trouver un trésor au-dessous, de
sorte que toute la fabrique ne semble présentement tenir que sur un bloc de marbre blanc, qui est à peine
de deux verges en quarré, & qui sonne comme une cloche lorsqu’on le touche avec une clef. Quelques-uns
des morceaux de marbre qu’on a arrachés du fondement de cette Colomne sont chargés d’hiéroglyphes : ce
qui me fait soupçonner que ce monument n’est ni l’ouvrage des Egyptiens, ni celui des Grecs, ni des
Romains, mais qui n’a été fait qu’après Strabon, & que cet Auteur n’auroit probablement pas oublié d’en
parler, s’il avoit subsisté de son tems.
On comptoit que le Delta commençoit à la branche Canopique du Nil, qu’on supposoit entrer dans celle de
Me-dea. D’ici jusqu’à Rosette les Caravanes sont guidées, l’espace de quatre lieuës, par un rang de poteaux
semblables à celui du Shibkah el Low-deah, ou Lac des Marques. Le canal qui fournissoit Alexandrie d’eau
est sur la droite, & comme on n’en fait plus le même usage, il se décharge dans le canal de Me-dea. On ne
voit que peu ou point de traces de l’inondation du Nil depuis Alexandrie jusqu’à Rosette, tout ce district
paroissant plutôt avoir été originairement une continuation de la côte sablonneuse de Libye, ou bien une
Isle : aussi lorsqu’on fait voile du côté de l’Est, on trouve plusieurs monticules de terre sablonneuse ; un
entr’autres à l’Orient de l’Embouchure de la branche Bolbutique du Nil, un autre au Cap Brullos, & un
troisiême au Ouest de Dami-ata. On peut supposer que ces monticules étoient originairement des Isles, qui
par leur situation arrêtoient les eaux du Nil, & retenoient le limon, qui aura enfin formé le Delta. Il est
probable qu’auparavant cette partie de la Basse-Egypte n’étoit qu’un grand golfe de la Mer, de sorte qu’alors
l’Isle de Pharos étoit, suivant l’observation d’Homere, à un grand jour de navigation du continent de
l’Egypte. »
575 Cassou, J., Itinéraires de France en Tunisie du XVIe au XIXe siècle, Catalogue d’exposition, du 6 mai au
27 juillet 1995, Bibliothèque Municipale de Marseille, Marseille, 1995, p. 172.
Bruwier, M.-C., Présence de l’Égypte, Namur, 1994, p. 127.
- 622 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHARLES THOMPSON (février 1735)
Thompson, C., Travels through Turkey in Asia, the Holy Land, Arabia, Egypt, and Other Parts of the World,
giving an account of Manners, Religion, Polity, Antiquities and Natural History, Londres, 1767.
p. 254-256 (tome II) :
« In a few hours we arrived at Alexandria, or Scanderea, as it is now called, a once famous and flourishing
city, built by Alexander the Great when we went to consult the oracle of Jupiter Ammon. The old city is
entirely ruined, but the Ancient walls, which are beautiful built of hewn stone, are most of them standing, with
Turrets at convenient distances. The new city is built on the strand to the north, without the walls ; and
through upon the whole it makes but a mean appearance, we (p. 255) find in it a great variety of pillars,
mostly granite and many fragments of columns of beautiful marble, all tokens of the grandeur and
magnificence of the ancient city, from the ruins wherof they were taken. The cisterns, which were built under
the houses of Alexandria to receive the waters of the Nile brought by a canal from the canoptic branch, are
many of them entire, and still serve for the same purpose. The pillar, commonly called Pompey’s pillar, is a
fine piece of Antiquity, which is still standing on a little eminence, about a quater of a mile to the south of the
old walls ; but upon what occasion it was erected is uncertain. It is of red granite, about a hundred and
fourteen feet high, with a corinthian capital, the leaves whereof are not at all indented. The shaft, which is
nine feet in diameter, and almost ninety in height, is of one entire stone, and the base and pedesal of
another. It stands on a foundation consisting of several pieces of stone and marble, some of which have
been dug away, which makes it surprizing how such a vast weight is supported.
The island of Pharos, on which flood the famous Watch-Town or Light-house of the same name, which was
reckoned one of the wonders of the world, is now joined to the continent ; and probably the Light-house was
situated where the castle is at present, at the entrance of the new port, some pillars being discernible thereabouts
at the bottom of the water, which perhaps are the remains of that superb structure. The present city of
Alexandria has two ports, being situated exactly between them ; one of which is called the new port and is
appropriated to the ships of Christendom ; the other the old port, into which Turkish vessels only are
admitted. The former is what Strabo calls the Great Port, and the latter the Port of Eunostus.
Amongst the curious remains of Antiquity to be seen at Alexandria may be reckoned the catacombs, and
also two obelisks, one of which is broken, part of it lying upon the ground. The Patriarchal Chair in the church
of the Coptic convent is another thing usually shewn to strangers, and the Greeks boast of their being
possessed (p. 256) of the stone on which St. Catharine suffered martyrdom, with other curiosities of the
same nature. But we had not half time enough to take a view of every thing in this city, and its
neighbourhood, that is worth a traveller’s observation, the ship which was to carry us to Europe setting sail a
week sooner than we expected. With some reluctance therefore we embarked the 4th of February on board
a ship bound for Marseilles, where we landed the 27th of the same month, and waited a week for a passage
to England. »
- 623 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRÉDÉRIC-LOUIS NORDEN (juin 1737)
Norden, F.-L., Voyage d’Egypte et de Nubie, Paris, 1795.
Frédéric-Louis Norden (1708-1742), Danois destiné à la marine, est reçu à l’école des cadets à Copenhague
où il devient très habile dans le dessin. En Hollande, il passe deux ans à étudier tout ce qui a trait à la
marine et apprend également à graver à l’eau forte. Après avoir passé trois années en Italie, il reçoit de son
roi l’ordre d’aller en Égypte pour décrire et dessiner les monuments antiques de ce pays. Il débarque à
Alexandrie au mois de juin 1737, poursuit sa route jusqu’au Caire et remonte le Nil jusqu’à Deïr, en Nubie. À
son retour à Copenhague, en 1738, le roi du Danemark lui témoigne sa satisfaction et l’élève au grade de
capitaine de la marine royale. Il est également nommé membre de la commission établie pour la construction
des vaisseaux. La guerre s’étant allumée en 1740 entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, il sert comme
volontaire dans la marine britannique où on l’accueille comme un voyageur distingué. Après son voyage en
Amérique, il revient à Londres en 1741 et devient membre de la société royale anglaise. De santé fragile, il
meurt à Paris en 1742.576
p. 1-67 (tome I) :
« Ancienne Alexandrie
L’ancienne Alexandrie a été sujette à tant de révolutions et si souvent ruinée, qu’on auroit aujourd’hui de la
peine à la retrouver, si la situation de ses ports et quelques monuments antiques ne nous en indiquoient pas
la véritable place.
Ces guides infaillibles me serviront à décrire avec une espece d’ordre ce que j’ai pu observer. Je ne
prétends pas néanmoins donner une description complete, ni écrire l’histoire entiere de l’accroissement et de
la décadence de cette grande ville ; mon unique but est de communiquer fidèlement ce que j’ai vu et ce que
j’ai pu remarquer touchant l’état présent (p. 2) de l’ancienne et de la nouvelle ville. L’ordre que je tiendrai
sera celui que ma mémoire me fournira ; et si par hasard je ne m’explique pas quelquefois assez clairement,
les dessins que j’ai levés sur les lieux acheveront de perfectionner l’idée que le lecteur aura conçue par la
relation que je vais donner.
Le vieux et le nouveau port sont présentement à Alexandrie ce qu’on appeloit autrefois les ports d’Afrique et
d’Asie. Le premier est réservé pour les Turcs ; le second est abandonné aux Européens. Ils différent l’un de
l’autre en ce que le vieux est bien plus net et bien plus profond que le nouveau, où on est obligé de mettre
de distance en distance des tonneaux, vuides sur les cables, afin qu'ils ne soient pas rongés par le fond qui
est pierreux. Mais si cette précaution garantit les cables, les vaisseaux ne laissent pas d'être toujours
exposés aux risques de se perdre. L'ancre ne tenant pas si bien de cette façon, un gros vent détache
aisément le vaisseau, qui, se trouvant une fois à la dérive, périt dans le port même, parce qu'il n'a ni assez
d'espace ni assez de profondeur pour faire tenir de nouveau ses ancres. Un vaisseau français se perdit de
cette manière l'année qui précéda mon arrivée à Alexandrie.
L’entrée du nouveau port est défendue par deux châteaux d’une mauvaise construction turque, et qui n’ont
rien de remarquable que leur situation, puisqu’ils ont succédé à des édifices très renommés dans l’histoire.
(p. 3) Celui qu'on appelle le grand Pharillon a au milieu une petite tour dont le sommet se termine par une
lanterne, qu'on allume toutes les nuits, mais qui n'éclaire pas beaucoup, parce que les lampes sont mal
entretenues. Ce château a été bâti sur l’isle de Phare, qu’il occupe tellement, que s’il y a encore quelques
restes de cette merveille du monde que Ptolomée y avoit fait élever, ils demeurent entièrement cachés pour
les curieux. Il en est de même de l’autre château, connu sous le nom de petit Pharillon. Il ne présente aucun
vestige de la célebre bibliotheque qui, dans les temps des Ptolomées, étoit regardée comme la plus belle
qu’on eût jamais vue.
Chacune de ces deux isles est attachée à la terre ferme par un môle. Celui de l’isle de Phare est
extrêmement long ; il m’a paru avoir trois mille pieds d’étendue, et fait partie de briques, parties de pierres de
taille. Il est voûté dans toute sa longueur ; ses cintres sont à la gothique, et l’eau peut passer dessous : il
ressemble en cela au reste du môle de Pouzzol, qu’on donne communément pour le pont de Caligula. Il
n’est pas croyable que les Sarrasins ni les Turcs en aient été les inventeurs ; s’ils y ont trouvé les ruines d’un
ancien môle, ils les ont tellement défigurées en les réparant, qu’on y remarque pas le moindre trait qui
ressemble à la belle antiquité.
Le môle qui donne le passage au petit Pharillon n’a rien de particulier que deux zigzags qui, en cas de
besoin, peuvent servire à sa défense.
(p. 4) Les Pharillons et leurs môles, l’un à la droite, l’autre à la gauche du port, conduisent insensiblement à
terre ; mais il est bon d’avertir que, précisément à l’entrée du port, on a à passer des rochers dont les uns
sont au-dessous et les autres au-dessus de l’eau. Il faut les éviter soigneusement : pour cet effet on prend
des pilotes turcs, préposés pour cela, et qui viennent à la rencontre des vaisseaux hors du port : on est
assuré alors d’arriver dans le port, et d’y mouiller avec les autres vaisseaux qui sont affourchés tout le long
du grand môle comme dans l’endroit le plus profond.
Rien n’est plus beau que de voir de là ce mêlange de monuments antiques et modernes qui, de quelque
côté qu’on se tourne, s’offrent à la vue. Quand on a passé le petit Pharillon, on découvre une file de grandes
tours, jointes l’une à l’autre par les ruines d’une épaisse muraille. Un seul obélisque debout a assez de
hauteur pour se faire remarquer dans un endroit où la muraille est abattue. Si l’on se tourne un peu plus, on
s’aperçoit que les tours recommencent ; mais elles ne se présentent que dans une espece d’éloignement.
La nouvelle Alexandrie figure ensuite avec ses minarets ; et au-dessous de cette ville, mais dans le lointain,
s’éleve la colonne de Pompée, monument des plus majestueux. On découvre aussi des collines, qui
semblent être de cendre, et quelques autres tours. Enfin la vue se termine à un grand bâtiment quarré, qui
sert de magasin à poudre, et qui joint le grand môle.
(p. 5) Après avoir mis pied à terre, nous traversâmes la ville neuve, et nous prîmes la route de l’obélisque,
où nous n’arrivâmes qu’après avoir grimpé sur des murailles ruinées, qui offrent au travers d’une tour de
maçonnerie, un passage libre jusqu’au pied de cet antique monument ; et à peine s’en est-on approché
qu’on en voit à côté un autre qui a déjà depuis longtemps été obligé de plier, et qui se trouve presque tout
enterré.
L’obélisque qui est debout, et qu’on appelle encore aujourd’hui l’obélisque de Cléopatre, indique que c’est
l’endroit où a été le palais de cette reine, auquel on donne aussi le nom de palais de César. Il ne reste
d’ailleurs aucun vestige de ce superbe bâtiment, ce qui fait que je ne m’arrêterai qu’à l’obélisque.
Cet obélisque de Cléopatre est situé presque au milieu, entre la nouvelle ville et le petit Pharillon : sa base,
dont une partie est enterrée, se trouve élevée de 20 pieds au dessus du niveau de la mer. Entre ce
monument et le port regne une épaisse muraille, flanquée à chaque côté de l’obélisque d’une grande tour ;
mais cette muraille a été largement ruinée, que son haut est presque égal à la base de l’obélisque. La partie
intérieure de la muraille n’est qu’à 10 pieds de ce monument, et la partie extérieure n’est qu’à quatre à cinq
pas de la mer. Tout le devant de cette muraille jusques bien avant dans le port est rempli d’une infinité de
débris de colonnes, de frises, ou d’autres pieces d’architecture qui ont appartenu à un édifice superbe : ils
sont de diverse sortes de marbres ; j’y ai apperçu du granit et du verd antique. Du côté de la terre l’obélisque
a derriere lui une assez grande plaine, qu’on a si souvent fouillée que tout le terrain semble avoir été passé
au crible : il n’y vient par-ci par-là que peu d’herbe, encore est-elle de si mauvaise substance qu’elle se
seche d’abord.
Quant à l’obélisque en lui-même, il est d’une seule piece de marbre granit. Les planches VII, VIII et
IX representent les dessins de ces quatres faces avec leurs dimensions.
Il suffit seulement de dire qu’il n’y a que deux de ces faces qui soient bien conservées ; les deux autres sont
frustres, et on y voit à peine les hiéroglyphes dont elles ont été couvertes anciennement.
L’obélisque renversé paroît avoir été cassé ; mais ce qu’on déchiffre de ses hiéroglyphes fait juger qu’il
contenoit les mêmes figures et dans le même ordre que celles de l’obélisque qui est debout.
On s’étonnera sans doute de ce que les empereurs romains ne firent pas transporter à Rome cet obélisque
plutôt que les autres qu’il falloit aller chercher bien loin : mais si on considere les deux faces qui ont été
gâtées par l’injure des temps, on trouvera que c’étoit là une raison suffisante pour ne le point emporter ; et
cette raison dispense de recourir à d’autres.
Quelques auteurs anciens ont écrit que ces deux obélisques se trouvoient de leur temps dans le palais
(p. 7) de Cléopatre, mais il ne nous disent point qui les y avoit fait mettre. Il est à croire que ces monuments
sont bien plus anciens que la ville d’Alexandrie, et qu’on les fit apporter de quelque endroit de l’Egypte pour
l’ornement de ce palais. Cette conjecture a d’autant plus de fondement, qu’on ne sait que, du temps de la
fondation d’Alexandrie, on ne faisoit plus de ces monuments couverts d’hiéroglyphes, dont on avoit déja
perdu long-temps auparavant et l’intelligence et l’usage.
Les deux côtés d’une pierre si dure, gâtés et effacés, nous font connoître la grande différence qu’il y a entre
le climat d’Alexandrie et celui de tout le reste de l’Egypte : car ce n’est ni le feu ni une main brutale qui ont
endommagé ces pierres ; on voit clairement qu’il n’y a que l’injure du temps qui a rongé quelques unes des
figures, et qui en a effacé d’autres, quoiqu’elles fussent gravées assez profondément.
Comme les dessins donnent au juste les contours des figures qui couvrent les faces de cet obélisque, je me
dispense d’entrer dans un plus long détail : ainsi, après avoir donné tout ce que je sais par rapport à ce
monument, je le quitte pour examiner ce qui se trouve au pied des murailles et le long de la mer depuis
l’obélisque jusques vers le petit Pharillon.
J’ai déja dit qu’au devant de l’obélisque on trouve une grande quantité de divers marbres qui paroissent
avoir été employés à quelque édifice superbe. On juge facilement que ce sont les débris du palais qui étoit
(p. 8) situé dans l’endroit où est l’obélisque : ce n’est que parceque’ils sont dans la mer qu’ils restent là ;
l’accès en est trop difficile pour les retirer et pour les emporter. Il n’en a pas été de même de ceux qui, en
tombant, demeurerent sur la terre ; on en a enlevé une partie pour les transporter ailleurs, et le reste a été
employé dans la nouvelle Alexandrie. Il n’y a donc point lieu d’être surpris si, dans l’espace que nous allons
parcourir, on ne trouve plus de ruines d’une matiere si rare. On n’y apperçoit effectivement que des
ouvrages de brique cuite au feu et très durs : ils méritent pourtant notre attention, puisqu’ils se présentent
avec un air d’antiquité. Quelques canaux voûtés, ouverts et en partie comblés ; des appartements à demi
détruits ; des murailles entieres renversées, sans que les briques se soient détachées : tout cela prouve que
ce ne sont pas des ouvrages d’une construction moderne. Par ailleurs ces ruines forment un chaos si
confus, qu’on ne sauroit se faire une juste idée des édifices qui étoient dans ce quartier. Tout ce qu’on peut
s’imaginer c’est que ces bâtiments appartenoient au palais, et qu’ils étoient employés à différents usages,
comme pour servir d’égouts de maisons particulières, de corps-de-garde, et autres choses semblables.
La curiosité ne va pas plus loin de ce côté-là. Il y auroit encore à examiner le petit Pharillon ; mais la
garnison n’en permet point l’entrée : il faut donc prendre le parti d’aller considérer ce que c’est que ces
(p. 9) grandes tours jointes par des murailles si épaisses. On n’a nulle peine à concevoir que c’est l’enceinte
de l’ancienne Alexandrie. Mais de quel temps est cette enceinte ? c’est sur quoi on pourra hasarder un
sentiment, après avoir examiné l’objet de près, et après l’avoir bien considéré.
Ses tours, qui forment comme des boulevards, ne sont pas toutes d’une égale hauteur, ni d’une même
figure, ni d’une même construction ; il y en a de rondes, d’autres sont quarrées, d’autres ont la figure d’une
ellipse ; et celles-ci se trouvent quelquefois coupées par une ligne droite dans un de leurs côtés.
Elles différent de même dans leur intérieur. Il y en a qui ont une double muraille, et à l’entrée un escalier en
colimaçon qui conduit jusqu’au haut de la tour. Quelques unes n’offrent pour tout passage qu’un trou dans la
voûte, et par lequel il falloit passer à l’aide d’une échelle. Généralement parlant les entrées de ces tours sont
fort petites et fort étroites, et donnent sur l’intérieur de la courtine ou muraille de jonction. Leurs différents
étages sont formés par des voûtes, supportées quelquefois par une colonne, quelquefois par plusieurs ; il y
en a même qui sont soutenues par un large pilier. Les embrasures qui regnent tout à l’entour de ces
boulevards sont étroites et s’élargissent en dedans ; elles ressemblent à celles qu’on voit à plusieurs
anciens châteaux en Angleterre. On ne remarque aucuns puits dans ces tours, et je ne doute point
cependant qu’elles n’en aient eu ; il (p. 10) y a apparence qu’ils auront été abandonnés, et qu’ils se seront
comblés avec le temps. Toutes les tours sont bâties de pierres de taille et d’une architecture très massive.
Dans la partie la plus basse on remarque tout à l’entour et de distance en distance des fûts de colonnes de
différentes sortes de marbres ; et on les y a placés de façon que, quand on les voit de loin, on les prend pour
des canons qui sortent de leur embrasure. On apperçoit encore, par-ci par-là, quelques carreaux de marbre
mis en oeuvre ; mais tout le corps du bâtiment, comme je l’ai déjà dit, est formé de pierres de taille ; et elles
sont d’une espece sablonneuse, comme celles de Portland ou de Bentheim.
Les murailles qui font la jonction des tours, et qui avec elles ont composé l’enceinte de la ville, ne sont pas
non plus par-tout d’une même largeur, ni d’une même hauteur, ni d’une même construction ; quelques unes
peuvent avoir 20 pieds d’épaisseur, tandis que d’autres en ont plus ou moins ; leur hauteur va à 30 et à
40 pieds. On ne peut pourtant pas assurer à la seule vue de ces ruines que toute l’enceinte de la ville ait été
bâtie de la maniere que je l’ai remarqué en parlant de la muraille voisine de l’obélisque ; mais elle avoit, du
côté intérieur, une allée presque dans le même goût que celle qu’on voit dans l’enceinte du palais d’Aurélien
à Rome.
Il ne me reste plus qu’à dire, à l’égard de cette enceinte, que les tours comme les murailles, au moins
(p. 11) celles qu’on peut voir, sont toutes fort endommagées, et dans plusieurs endroits ruinées entièrement.
Après cela il n’est plus question que de savoir si, avec ce qui vient d’être observé et avec ce que nous
apprend l’histoire, on peut décider si cette enceinte est du temps de la premiere fondation d’Alexandrie, ou
en quel temps elle peut avoir été construite.
Si nous devons croire l’histoire et ce qu’elle nous dit de la grandeur de l’ancienne Alexandrie, il nous seroit
bien difficile de la renfermer dans une enceinte de si peu d’étendue. Cependant, sans nous engager dans ce
qu’on veut qu’elle ait été, nous pouvons nous en tenir à considérer ce qui reste de cette célebre ville.
On apperçoit d’abord une architecture très massive et telle qu’il convenoit qu’elle fût pour soutenir le choc
des béliers : mais cela peut être de tout temps. Attachons-nous donc à des particularités qui soient capables
de faire sentir la différence d’un temps à l’autre ; et dans ce cas on ne sauroit guere se prévaloir que des
colonnes qui soutiennent les voûtes en dedans, et des fûts des colonnes qui se montrent en dehors. Les
colonnes ont des chapiteaux qui absolument ne paroissent point être du siecle d’Alexandre ; le goût en est
trop sarrasin pour remonter leur origne si haut. Mais, dira-t-on, une voûte tombée, et réparée par les
Sarrasins, auroit pu faire le même effet : il ne reste donc que les fûts de colonnes de différents marbres, qui
témoignent que l’ouvrage n’est (p. 12) ni de la premiere fondation de la ville, ni du temps des Ptolomées, ni
de celui des Romains : il n’y a que des barbares qui puissent avoir fait un usage si bizarre des pieces d’une
matiere aussi précieuse en Egypte que l’est le marbre étranger. Ces colonnes ont été sans doute tirées des
ruines d’Alexandrie, et peut-être même du palais de Cléopatre : car si elles avoient été apportées de
Memphis telles qu’elles sont, on y verroit des hiéroglyphes ; mais on n’en apperçoit ni sur ces colonnes ni
sur les carreaux de marbre employés çà et là. Concluons donc que cette enceinte n’a été faite que quand
les Sarrasins, après avoir ruiné Alexandrie, se trouverent dans l’obligation de s’y fortifier pour profiter de
l’avantage des ports, et que, de tout le terrain de l’ancienne ville, ils n’en refermerent qu’autant qu’il leur en
falloit alors pour leur défense et pour la sureté de leur commerce.
Après avoir fait le tour de l’ancienne ville il convient de voir ce qui est renfermé dans son enceinte, où l’on ne
trouve guere aujourd’hui que des ruines et des décombres, si on en excepte un très petit nombre de
mosquées, d’églises, de jardins, et quelques cîternes, qu’on peut regarder comme entieres, puisqu’elles sont
encore assez bien entretenues pour fournir de l’eau à la nouvelle ville.
Nous connoissons si bien présentement l’obelisque de Cléopatre et sa situation, qu’il est à propos de partir
de ce point pour aller reconnoître les églises de S. Marc et de Ste Catherine, qui en sont les plus près. (p. 13)
Ces deux églises appartiennent aux chrétiens, et sont maintenant desservies par des prêtres grecs et par
des prêtres coptes ; d’ailleurs elles se ressemblent si fort l’une l’autre qu’une seule description suffira pour
toutes les deux. Elles n’ont rien de respectable que le nom d’églises qu’elles portent ; et elles sont si
obscures, si sales et si remplies de lampes, qu’on les prendroit plutôt pour des pagodes que pour des
temples où le vrai Dieu est adoré.
Celle de S. Marc n’a rien de particulier qu’une vieille chaire de bois, qu’on fait passer, si je m’en ressouviens
bien, pour celle de l’évangéliste dont l’église porte le nom : je n’assure pourtant pas le fait, parceque je ne
me le suis pas assez mis dans l’idée pour me le rappeler au juste. Ce que je puis garantir, c’est que le saint
évangéliste est infiniment mieux logé dans son église à Venise que dans celle d’Alexandrie.
Dans l’église de Ste Catherine on montre avec grande vénération un morceau de colonne sur laquelle on
prétend que cette sainte eut la tête coupée ; et quelques taches rouges qu’on y fait remarquer sont, dit-on,
des gouttes de son sang.
Au voisinage de cette église on rencontre la butte de Ste Catherine, qui est une colline formée des ruines de
la ville ; il y en a encore une autre de même espece et de même grandeur : toutes deux ont été fouillées et
refouillées si souvent, que ce ne sont proprement que des tas de poussieres. On n’y trouve rien que quand il
a plu : l’écoulement des eaux laisse alors à (p. 14) découvert quelques pierres gravées, ou quatre petites
choses qui ont échappé à la vue de ceux qui ont fouillé les premiers, ou qu’ils ont rejétées comme peu
dignes de leur attention. Les Sarrasins en ont usé ici de la même maniere que les Goth et les Vandales à
Rome : ils ont fait sauter la pierre de la bague avec un fer pointu ; ils ont pris l’or, et ont jeté la pierre, qu’on
trouve ordinairement endommagée par cette violence. Il est rare maintenant qu’on y découvre maintenant
quelque chose de bon. J’ai vu une infinité de ces pierres ; j’en ai même acheté quelques unes, sans pouvoir
dire que j’en aie acquis une seule qui soit de bonne main.
Avant que de sortir de la ville je jetai les yeux sur quelques fûts de colonnes de marbre granit, qui sont
encore debout, par-ci par-là, sur le chemin qui conduit à la porte de Rosette. Il peut y en avoir une demidouzaine
; mais elles ne nous apprennent rien, sinon que cette longue rue doit avoir eu de chaque côté des
portiques, pour se promener près des maisons et à l’abri : ce qui en reste fait juger qu’elles étoient toutes de
même grandeur, mais il n’est pas aussi facile de décider si elles étoient de quelque ordre d’architecture, ou
faites dans le goût égyptien : elles sont enfoncées d’un tiers dans la terre et toutes ont perdu leur chapiteau ;
elles ont la surface unie et la circonférence plus grande vers le bas que vers le haut. Voilà ce que j’y ai
remarqué ; mais ce n’en est pas assez pour fonder quelques conjectures raisonnables : du reste il n’y avoit
pas moyen de me dispenser d’en parler, (p. 15) parcequ’elles ont certainement droit de tenir une place parmi
les antiquités qui subsistent à Alexandrie.
Après avoir suivi le chemin qui conduit à la porte de Rosette, je passai cette porte pour me rendre à la belle
colonne appelée communément la colonne de Pompée. Elle est placée sur une hauteur d’où l’on a deux
belles vues ; l’une qui donne sur Alexandrie, l’autre sur le terrain bas qui s’étend le long du Nil, et qui
environne le calisch ou canal creusé au-dessus de Rosette pour porter l’eau du Nil à Alexandrie. Mais je
parlerai plus bas de ce canal : tenons-nous présentement à la colonne de Pompée.
Cette colonne ne doit pas être proprement un monument égyptien, quoique la matiere dont elle est faite ait
été tirée des carrieres du pays : c’est apparemment la plus grande et la plus magnifique colonne qu’ait
produit l’ordre corinthien.
Si on veut bien jeter les yeux sur le dessin que j’en donne, il me restera fort peu de choses à dire touchant
ce superbe monument : un chacun est en état d’en juger par lui-même, sur-tout quand j’avertirai le fût est
d’une seule piece de marbre granit, que le chapiteau est d’une autre piece de marbre, et le piedestal d’une
pierre grise approchant du caillou pour la dureté et pour le grain : à l’égard des dimensions on les trouve
marquées sur la planche qui donne le dessin de cette colonne.
Pour ce qui est du fondement sur lequel posent le piédestal et la colonne, on le trouve ouvert d’un
(p. 16) côté. Un Arabe, dit-on, ayant creusé sous ce fondement, y mit une boîte de poudre, afin de faire
sauter la colonne en l’air et de se rendre maître des trésors qu’il s’imaginoit être enterrés dessous :
malheureusement pour lui il n’étoit pas bon mineur ; son entreprise échoua ; la mine s’éventa, et ne
dérangea que quatre pierres qui faisoient partie du fondement, dont les trois autres côtés resterent entiers :
l’unique bien qui en résulta fut que les curieux étoient désormais en état de voir quelles pierres en avoient
employées à ce fondement. J’y ai remarqué une piece de marbre blanc oriental tout rempli d’hiéroglyphes si
bien conservés qu’il m’a été aisé de les dessiner exactement. Une autre grande piece, qui n’est pas partie
de sa place et qui demeure cependant à découvert, est d’un marbre de Sicile jaunâtre et tacheté de rouge : il
a également ses hiéropglyphes, mais tellement endommagés que je n’en ai rien pu tirer. Un morceau d’une
petite colonne avoit encore servi à ce fondement, ainsi que quelques autres morceaux de marbre qui n’ont
rien de remarquable.
J’ai déja dit que dommage n’a été fait que d’un côté : ce qui a été enlevé du fondement laisse tout au plus un
vuide de trois pieds au-dessous du piédestal, et le milieu ainsi que les trois autres côtés restent dans leur
premiere solidité. Cependant Paul Lucas, qui ne s’est pas contenté de nous donner un dessin peu exact de
cette colonne, nous la représente encore comme ne posant plus effectivement que sur (p. 17) la seule pierre
du milieu. Dans le fond on pourroit lui passer cette faute, comme tant d’autres : mais qu’un consul général
qui a demeuré seize ans au Caire, qui prétend avoir mieux vu qu’aucun autre voyageur, et qui a demeuré
assez long-temps à Alexandrie pour pouvoir examiner cette colonne, se soit contenté de copier le dessin
qu’il a trouvé dans Paul Lucas, c’est ce qui n’est pas concevable. Peut-être avoit-il des raisons de politique
pour en user de la sorte. Il fermoit le projet de transporter cette colonne en France ; et, ne la représentant
assise que sur une seule pierre, elle en paroissoit d’autant plus aisée à descendre et à embarquer.
J’avouerai cependant que ce qu’ils en disent l’un et l’autre est plus exact que le dessin qu’ils donnent.
Après avoir considéré la colonne de Pompée et les autres objets dont j’ai fait mention, il ne s’offre plus
d’ailleurs à la vue qu’une campagne rase. On me dit néanmoins qu'il y a dans le voisinage des catacombes,
et qu'un quart de lieu de chemin y conduit : c'est assez pour m'engager faire cette traite. Nous arrivons
bientôt au lieu indiqué ; nous y entrons, et nous trouvons une longue allée souterraine qui n'a rien de
particulier. Elle ressemble pour la largeur aux catacombes de Naples. Cela ne valoit pas la peine de nous y
arrêter davantage : nous prîmes donc la route du Calisch, ou canal de Cléopatre, qui fournit de l’eau douce à
Alexandrie pour tout le cours de l’année.
(p. 18) En descendant la colline nous entrâmes dans une plaine toute couverte de broussailles qui ne
portent que des câpres ; et en avançant davantage, nous nous engageâmes dans un bois ou dans une forêt
de dattiers. Leur fertilité fait voir qu’ils se ressentent du voisinage du Calisch, dont les eaux leur sont portées
par quelques canaux d’arrosement pratiqués entre les arbres. Nous traversâmes ce bois, et nous
rencontrâmes enfin le Calisch.
Les bords de ce canal sont couverts de différentes sortes d’arbres, et peuplés de divers camps volants de
Bédouins ou d’Arabes errants. Ils sont là pour faire paître leurs troupeaux, dont ils se nourrissent, vivant
d’ailleurs dans une grande pauvreté. Ils voudroient bien être à leur aise ; et je n’ai pas oublié qu’un jour que
je sortois de bon matin par la porte de Rosette, une vingtaine d’entre eux avoit grande envie de me
dépouiller ; et ils auroient mis leur dessein à exécution si un janissaire que j’avois avec moi ne les en avoit
empêchés. Ces Arabes ressemblent aux hirondelles : tant qu’ils jouissent dans un lieu du beau temps et de
l’abondance, ils y demeurent ; mais dès que la disette vient, ils délogent et vont chercher des endroits plus
fertiles. C’est à ces changements de demeures aussi bien qu’à leur pauvreté qu’ils doivent la liberté dont ils
jouissent. Il leur seroit fort difficile de la garder s’ils avoient plus de bien qu’ils n’en n’ont.
Le Calisch, à ce que l’histoire nous apprend, fut pratiquer pour faciliter le commerce et pour porter (p. 19) les
marchandises du Caire à Alexandrie sans les exposer à passer les Bogas, ou l’embouchure du Nil,
parcequ’elles auroient couru le risque de s’y perdre. On y trouvoit encore une autre utilité, en ce que la ville
d’Alexandrie, dépourvue d’eau douce, en pouvoit être pourvue abondamment par le moyen de ce canal.
Aujourd’hui il est hors d’état de répondre à tous ces desseins. Creusé simplement dans la terre, sans être
soutenu d'aucun revêtement de maçonnerie, il s'est peu-à-peu comblé. La décadence du commerce et la
ruine du pays ne permettent plus aux habitants de fournir à la dépense qu’il faudroit faire tous les ans pour
tenir ce canal dans le niveau requis. Il ressemble aujourd'hui à un fossé mal entretenu, et à peine y coule-t-il
assez d'eau pour remplir les réservoirs nécessaires à la consommation de la nouvelle Alexandrie. Je le
passai à pied sec dans le mois de juin. On y remarque néanmoins un endroit revêtu de murailles : c'est où
commence l'aqueduc qu'on peut suivre tout le long de la plaine, et même jusqu'à Alexandrie ; car, quoiqu'il
soit sous la terre, les soupiraux qu'il a de distance en distance font assez connaître la route qu'il prend pour
se rendre aux réservoirs ou citernes, qui ne se trouvant que dans ce que nous avons vu être l'ancienne ville.
Du temps qu’il subsistoit, tout le terrain qu’elle occupoit étoit creusé pour des réservoirs, dont la plus grande
partie est maintenant comblée. Il n’en reste qu’une demi-douzaine, encore ne sont-ils pas trop bien
entretenus.
(p. 20) Il seroit superflu d’entreprendre de faire ici la description d’un de ses réservoirs ; un coup d’oeil jeté
sur le dessin que j’en donne en apprendra plus que tout ce que je pourrois dire : j’avertirai seulement d’une
chose que le dessin ne sauroit exprimer ; c’est que toutes les voûtes paroissent être faites de briques et
couvertes d’une matiere impénétrable à l’eau. Cette matiere est précisément la même que celle dont sont
couvertes les murailles et les piscinari ou qu’on voit à Baïes et à Rome dans les thermes des divers
empereurs.
La plus grande partie des colonnes qui supportent les voûtes de ces réservoirs sont de différentes sortes, et
la plupart dans le goût gothique, ou plutôt sarrasin. Il n’est pas concevable qu’elles aient été placées de la
sorte dès le commencement ; une entiere destruction a fait sans doute que les unes ont pris la place des
autres. On aura réparé les réservoirs qui étoient le moins ruinés, et on se sera servi pour cela de ce qui
coûtoit le moins à mettre en oeuvre. Jugeons de là de quelle maniere le reste doit avoir été traité.
De tous les réservoirs dont on se sert aujourd’hui celui qui est voisin de la porte de Rosette conserve le plus
long-temps son eau, apparemment parcequ’il est plus bas que les autres. Quand il y en a quelqu’un de
vuide, on a soin de le nettoyer vers le temps de l’accroissement du Nil ; car il faut savoir que ces réservoirs
ne peuvent pas se vuider d’eux-mêmes. Ils sont faits pour recevoir l’eau et pour la conserver, et non pour la
laisser (p. 21) échapper. On les vuide par le moyen de pompes à chaînes ou à chapelets ; et, lorsqu’on veut
transporter l’eau à la nouvelle ville, on en remplit des outres que l’on charge sur le dos des chameaux ou
des ânes. L’obligation où l’on est de vuider à la main ces réservoirs nous fait connoître la raison pourquoi on
en a comblé un si grand nombre. La consommation n’étant plus si grande dans la nouvelle ville qu’elle l’étoit
dans l’ancienne, l’eau se seroit corrompue et auroit infailliblement causé des maladies par sa mauvaise
odeur ; d’ailleurs il n’y avoit pas moyen de subvenir à la dépense qu’il auroit fallu faire pour les nettoyer tous
les ans. Si l’on avoit bouché les canaux de l’aqueduc qui conduisent l’eau, on auroit été en danger de faire
un cloaque général. Enfin on remédioit à un autre inconvénient : la plupart des réservoirs étant à moitié
ruinés, il valoit mieux les combler que s’exposer aux accidents que leur conservation auroit fait naître d’un
jour à l’autre. Voilà tout ce que je puis dire touchant les réservoirs d’Alexandrie. Les dessins et les mesures
dont ils sont accompagnés acheveront d’en donner une idée complete.
Il ne nous reste plus dans l’enceinte de l’ancienne Alexandrie qu’à voir ce qu’est la porte de Rosette, et une
autre porte par où on sort de la ville neuve pour entrer dans la vieille après qu’on a traversé la grande place
de cette derniere. Ces deux portes sont bâties dans le même goût que le reste de l'enceinte ; celle de
Rosette a quelques petites tours à chaque angle ; l'autre, qui (p. 22) est proche d'un boulevard, n'a qu'une
simple ouverture dans la muraille. Les battants de la porte sont en bois et couverts de plaques de fer
extrêmement rouillées.
Comme il vaut mieux achever de dire tout ce qui concerne l’antique avant de passer au moderne, il convient
de faire un tour vers le vieux port, au bord duquel nous rencontrerons des restes d’antiquités appartenants à
l’ancienne Alexandrie.
Le vieux port, autrement le port d’Afrique, a d’un côté le grand Pharillon qui le défend, comme il fait la
défense du nouveau port. A l’opposite du grand Pharillon et sur la langue de terre qui forme le vieux port, il y
a un autre petit château pour la sûreté du même port de ce côté-là ; et en front, une partie de la nouvelle ville
se joint à la vieille. C’est de ce point que nous partons pour aller examiner des restes d’antiquités, qui
consistent en grottes sépulcrales, en temples souterrains, en petits ports ou bains, etc.
Les grottes sépulcrales commencent dès l’endroit où les ruines de la vieille ville finissent, et elles suivent à
une grande distance le long du bord de la mer. Elles sont toutes creusées dans le roc ; quelquefois les unes
sur les autres, quelquefois l’une à côté de l’autre, selon que la situation du terrain l’a permis. L’avarice ou
l’espérance d’y trouver quelque chose les a fait toutes ouvrir : je n’en ai pas vu une seule fermée ; et je n’ai
absolument rien rencontré en dedans. On juge (p. 23) aisément, par leur forme et par leur grand nombre, de
l’usage auquel on les avoit destinées. On peut dire qu’en général elles n’ont que la largeur qu’il faut pour
contenir deux corps morts l’un à côté de l’autre : leur longueur va tant soit peu au-delà de celle d’un homme,
et elles ont plus ou moins de hauteur selon la disposition de la roche. La plus grande partie a été ouverte
avec violence ; et ce qui en reste d’entier n’est orné ni de sculpture ni de peinture. C’est là un champ trop
stérile pour s’y arrêter davantage : il vaut mieux jeter les yeux sur ces petits enfoncements du rivage dont on
se servit pour y pratiquer des retraites agréables, où l’on se divertissoit en prenant le frais, et d’où, sans être
vu que quand on le vouloit bien, on voyoit tout ce qui se passoit dans le port. Quelques rochers qui s’y
avancent fournissoient une charmante situation, et des grottes naturelles qu’ils formoient donnoient lieu d’y
pratiquer, à l’aide du ciseau, de véritables endroits de plaisance. On y trouve en effet des appartements
entiers faits de cette façon ; et des bancs ménagés dans le roc offrent des places où l’on est à sec, et où l’on
peut se baigner dans l’eau de la mer qui occupe tout le fond de la grotte. En dehors on avoit de petits ports,
par lesquels on abordoit avec des bateaux qui y étoient à l’abri de toutes sortes de vents. Si l’on vouloit jouir
de la vue du port, on trouvoit facilement sur le roc, au dehors de la grotte, une place à couvert des rayons du
soleil. Toutes ces agréables retraites, qui sont en grand nombre, n’ont (p. 24) d’ailleurs aucun ornement. Les
endroits où le ciseau a passé sont unis, et le reste a la figure naturelle du roc.
A trente ou quarante pas du bord de la mer et à l'opposite de la pointe de la presqu'île qui ferme le port, on
trouve un monument souterrain auquel on donne communément le nom de Temple. On n'y entre que par
une petite ouverture sur la pente de la terre élevée qui borde la porte de ce côté-là. Nous y entrâmes munis
de flambeaux, et nous fûmes obligés de marcher courbés dans une allée fort basse qui, au bout d'une
vingtaine de pas, nous introduisit dans une salle assez large et quarrée. Le haut est un plafond uni comme
les quatre côtés et le bas est rempli de sable, ainsi que des ordures des chauve-souris et des autres
animaux qui y ont leur retraite.
Ce n'est pas là ce qu'on nomme proprement le Temple. On n'a qu'à passer une autre allée, et on rencontre
quelque chose de plus beau. On trouve un souterrain de figure ronde dont le haut est taillé en forme de
voûte ; il a quatre portes, l'une à l'opposite de l'autre. Chacune d'elles est ornée d'une architrave, d'une
corniche, et d'un fronton surmonté d'un croissant. Une de ces portes sert d'entrée ; les autres forment
chacune une espece de niche bien plus basse que le sous-terrain, et qui ne contient qu'une caisse épargnée
sur la rue en creusant, et suffisamment grande pour renfermer un corps mort.
Cette description ainsi que le plan et la coupe du (p. 25) souterrain, mettent le lecteur en état de juger que
ce qu’on en donne dans le pays pour un temple doit avoir été le tombeau de quelque grand seigneur, ou
peut-être même d’un roi. Du reste comme il n’y a ni inscription ni sculpture qui fasse connoître à quoi cet
édifice a servi, je laisse à un chacun à décider sur l’usage auquel il étoit destiné. J’avertirai seulement que la
galerie qui continue au-delà de ce prétendu temple semble annoncer qu’il y a plus loin d’autres édifices de
cette nature. L’opinion commune veut aussi qu’il y ait dans le voisinage d’autres semblables souterrains,
mais il ne sont point connus ; apparemment parceque l’entrée en est si bien fermée qu’elle demeure
interdite, ou parcequ’après les avoir ouverts on les a tellement négligés, que le trou s’est bouché par le
sable ; et il en arrivera, selon les apparences, autant à celui dont je viens de parler, puisque l’entrée devient
de jour en jour plus petite, et l’allée plus basse. Je me félicite cependant d’en avoir vu assez pour en donner
une juste idée et pour en conserver la mémoire.
En montant au-dessus du même rocher, on rencontre de grands fossés, dont on ne sait ni la destination, ni
le temps où ils ont été creusés. Ils sont taillés perpendiculairement de la surface en bas, et peuvent avoir
quarante pieds de profondeur sur cinquante de longueur et sur vingt de largeur. Leurs côtés sont fort unis ;
mais le fond est si rempli de sable qu'à peine peut-on en découvrir le haut d'un canal qui, (p. 26) dans
quelques-uns de ces fossés, semble devoir mener à quelque souterrain. On sait bien, sans que je le dise,
qu’il est hors de la portée d’un voyageur de faire nettoyer de pareils endroits pour satisfaire sa curiosité.
Quiconque connoît le pays ne sauroit exiger une démarche si périlleuse ; et ceux qui, sans avoir rien vu,
prétendent qu’on fasse tout ce qui leur semble praticable, n’ont qu’à voyager en Egypte pour y apprendre
qu’il est plus aisé de juger que de faire par soi-même.
Il s’agiroit maintenant de passer à la description de la nouvelle Alexandrie ; mais avant que de quitter
l’ancienne j’ai encore bien des choses à dire et des réflexions à faire à son sujet. Il ne suffit pas d’avoir fait le
tour de cette ancienne ville, d’être allé hors de son enceinte voir la colonne de Pompée, d’être entré dans les
catacombes qui sont au voisinage, d’avoir vu le canal de Cléopatre, d’avoir parcouru les bords du vieux
port, et le terrain voisin qui avoit paru mériter nos recherches ; on omet toujours quelque chose dans de
pareilles occasions, et quelquefois on laisse trop entendre. Il sembleroit, par exemple, en lisant la description
que j’ai donné de l’enceinte de la vieille ville, qu’on la peut suivre tout à l’entour sans qu’elle soit interrompue
nulle part : il est pourtant certain qu’il se trouve des espaces où il ne reste ni boulevards ni murailles ; et si on
veut connoître ces espaces, on n’a qu’à examiner le plan, on les y verra d’un coup d’oeil. De plus, pour avoir
une idée (p. 27) juste de l’état du terrain qui étoit occupé par l’ancienne ville, il y a à connoître autre chose
que les antiquités qui subsistent. Les édifices modernes même, la butte de Sainte-Catherine, et la plaine
voisine de l’obélisque, ne font pas, avec les antiquités, tout l’espace entier. Il convient encore d’ajouter que
le reste ne differ guere du terrain qui est près de l’obélisque ; que tout a été remué et fouillé ; que le meilleur
a été emporté ; et que, s’il y a encore quelque chose qui en vaille la peine, il faudroit le chercher bien avant
dans la terre, ou dans les réservoirs qu’on a comblés.
D’autre part il se présente naturellement quelques questions qui méritent qu’on y réponde. D’où avoit-on tiré,
dira-t-on, cette énorme quantité de marbre et de granit qu’on employa à la construction de la premiere
Alexandrie ? et qu’est-ce que tout cela est devenu depuis la destruction de cette grande ville ? Si je
n’apprends pas de répondre positivement à ces demandes, je hasarderai du moins des conjectures qui
soient tant soit peu raisonnables.
Un chacun, je pense, conviendra avec moi qu’il n’auroit pas été sensé d’aller chercher bien loin ce qu’on
avoit en quelque maniere sous la main, et que, si on l’eût entrepris, on n’auroit jamais pu porter cette ville au
degré de magnificence où on la vit dès sa premiere fondation, ou peu de temps après sous les Ptolomées. Il
est donc naturel de supposer que la premiere Alexandrie tiroit son plus grand lustre de la destruction de
Memphis ; et cette raison est d’autant (p. 28) plus probable, qu’il faut absolument un endroit pour placer les
ruines de cette grande ville, dont il est resté à peine quelques foibles vestiges capables d’indiquer la place
où elle étoit. Il ne s’agit, après cela, que de lever quelques objections qui se présentent d’elles-mêmes.
On dira d’abord qu’il n’est pas concevable qu’Alexandre, guerrier si généreux, ait pu se porter à détruire une
ville aussi superbe que Memphis pour en construire une en son nom. Ce n’est pas non plus ce que je
prétends. Je ne veux pas charger davantage la mémoire d’Alexandre que celles des papes, qui n’ont point
fait difficulté de permettre de détruire une partie des antiquités de Rome afin d’en construire des palais
superbes pour leurs familles.
Memphis, ajoutera-t-on sans doute, subsistoit encore du temps d’Alexandre et sous les Ptolomées. J’en
tombe d’accord. Mais de quelle façon subsistoit-elle ? A peu-près comme l’ancienne Alexandrie subsiste de
nos jours, ou tout au plus comme elle subsistoit du temps des Sarrasins. Est-il à croire effectivement que les
Perses ait fait plus de grace à Memphis qu’aux autres villes d’Egypte ? ceux qui exterminoient les dieux
auroient-ils épargné les temples ? Lorsqu’Alexandre entra dans l’Egypte, l’éclat de la religion n’étoit-il pas
éclipsé dans Memphis ? les principaux prêtres s’étoient retirés dans les déserts, et Cambyse avoit emporté
les idoles. Jugeons par-là de l’état où se trouvoit des temples, qu’on ne fréquentoit (p. 29) plus, qui étoient
en horreur aux Perses, et qu’ils employoient aux plus vils usages. Dans ce cas, Alexandre et ses
successeurs ont bien pu y toucher sans devenir sacrileges et sans s’attirer la haine des peuples, qui
devoient même voir avec plaisir que les matériaux de leurs temples ruinés fussent employés à des édifices
où devoient se rétablir le culte de leurs anciens dieux.
Cette grande objection ainsi levée, il ne s’agit plus que d’examiner comment on a pu transporter cette
quantité immense de matériaux. Mais le Nil et le canal de Cléopatre n’offroient-ils pas des passages bien
faciles ? Le canal, dira-t-on, y étoit-il déja ? Il n’y a point de doute à cela. On ne pouvoit pas faire le projet de
bâtir une ville dans un tel quartier sans penser d’abord au canal. L’endroit était dépourvu d’eau douce, et il
n’y avoit pas de moyen de lui en procurer qu’en la tirant du Nil au-dessus de Rosette, où le canal
commence ; car l’eau de ce fleuve, mêlée à son embouchure avec l’eau de la mer, n’est pas potable, et,
pour aller chercher par mer il auroit fallu au moins deux journées, l’une pour l’aller, l’autre pour le retour.
D’ailleurs il n’y avoit pas moyen de se servir de grands bâtiments plats, capables de contenir beaucoup
d’eau, parcequ’ils n’auroient pas été propres à passer la mer ; et, d’un autre côté, de moindres bâtiments qui
auroient tiré plus d’eau n’auroient pas trouvé assez de fond à l’embouchure du Nil. Il y avoit donc une
nécessité absolue de commencer par le canal ; et ce canal devoit être navigable : car si on avoit eu
simplement en vue de fournir la ville d’eau, on se seroit contenté de faire un aqueduc de maçonnerie ; mais
on creusa un canal, et à ce canal commença l’aqueduc qui portoit l’eau à la ville, tandis que le canal
lui-même prenoit sa route vers la mer, où il se jetoit au voisinage d’Alexandrie. Le nom de Cléopatre, qu’il
conserve encore aujourd’hui, n’est pas une raison pour nous fixer par rapport au temps où il a été
premierement creusé. Une réparation faite par une reine aussi célebre, quelques divertissements qu’elle y
aura pris, ou une fête qu’elle y aura donnée, peuvent aisément avoir occasioné ce nom. Du reste la
nécessité d’un canal était constante, c’est pour moi un guide assuré ; et je m’y tiens, sans m’embarrasser de
chercher d’autres raisons que celles qui viennent d’être alléguées.
Quelque certaine pourtant que paroisse cette preuve, il ne laisse pas de se présenter encore une difficulté
capable de déranger tout notre systême, si on ne trouvoit pas moyen de la lever. Pourquoi, dira-t-on, si les
ruines de Memphis ont servi à la construction de la premiere Alexandrie, ne trouve-t-on sur l’obélisque et sur
les pierres qui forment le fondement de la colonne de Pompée, aucune des figures dont chaque colonne et
chaque carreau de marbre apporté de Memphis doivent avoir été couverts ou ornés ? On voit bien que je
veux parler des hiéroglyphes ; car il est certain qu’à l’exception de ceux de (p. 31) l’obélisque et du
fondement de la colonne de Pompée, on n’en apperçoit point à Alexandrie. Quelques morceaux de granit
cassés et tirés des fondements de quelque édifice ancien ne font rien à l’affaire : il est sûr que les débris qui
se trouvent dans la mer devant l’obélisque, et que j’ai jugés avoir appartenu au palais de Cléopatre, n’ont
aucun hiéroglyphe : les fûts et les carreaux de marbre employés dans les boulevards n’en ont pas non plus.
Il convient donc de chercher le moyen d’accorder cette contradiction, et d’en donner une bonne raison, afin
de rendre notre preuve acceptable ; c’est ce que je vais tâcher d’exécuter.
Dans le temps d’Alexandre et sous ses successeurs, le goût de l’architecture égyptienne n’étoit plus en
regne. La Grece, quoiqu’elle eût tiré de l’Egypte les premiers principes de cet art, y avoit substitué une
architecture bien plus légere, et ornée d’une tout autre façon. Les Grecs, n’ayant pas les immenses
richesses des Egyptiens, ni comme eux l’abondance des matériaux, ni la multitude des ouvriers, renoncerent
à cette architecture solide. Ils l’envisagerent même dans la suite comme defectueuse et ne produisant que
des masses lourdes et sans goût. Ils fixerent des regles pour les differents ordres d’architecture, et ils les
porterent si loin, qu’ils allerent jusqu’à se croire les premiers inventeurs de cet art.
Alexandre, imbu dans sa jeunesse des principes dans sa patrie, n’avoit garde d’adopter ceux d’un royaume
qu’il avoit subjugué ; et d’ailleurs il lui eût été peu honorable d’y élever des bâtiments qui se seroient trouvés
inférieurs aux moindres de ceux qui s’étoient conservés dans le pays. On conviendra donc aisément que
tous les temples et tous les palais que ce prince ou ses successeurs éleverent furent construits dans le goût
et suivant les regles de la Grece. Les matériaux qu’il tira des ruines de Memphis n’y pouvoient pas être
employés, à moins qu’on ne les façonnât de nouveau selon l’ordre de cette architecture. Cet ordre étoit
extrêmement léger en comparaison de l’autre ; ainsi il y avoit beaucoup à ôter. On ne respecta point les
hiéroglyphes dont on n’avoit plus l’intelligence. Les Grecs les regardoient même avec envie, parcequ’ils
contenoient les mysteres de la religion et des arts, dont ils prétendoient être seuls les inventeurs. Ne soyons
donc point surpris si on ne trouve point d’hiéroglyphes sur les marbres qu’on tire des ruines d’Alexandrie ; il
ne doit pas y en avoir. Si les regles de la nouvelle architecture ne les avoient pas fait ôter, on les auroit
effacés pour qu’ils ne parussent pas dans des édifices, avec lesquels ils n’avoient aucune connexion. Quelle
indécence, par exemple, n’y auroit-il pas eu à employer une colonne couverte d’hiéroglyphes avec une
colonne d’ordre corinthien !
Nous ne devons proprement regarder les ruines de Memphis que comme une carrière brute d’où on tiroit les
pierres pour les tailler d’une maniere convenable. Il eût même été impossible de rassembler toutes les
pieces de façon qu’elle pussent servir à des édifices (p. 33) pareils à ceux où elles avoient été employées.
Dès qu’on suppose que ces édifices étoient en ruines, on y doit rien chercher d’entier ; et il y auroit eu la
même impossibilité à rétablir ce qui y manquoit. Des raisons d’ambition et de jalousie, comme nous l’avons
vu, s’y opposoient ; et on ne sauroit ignorer l’empêchement qu’une cause naturelle y apportoit, puisque du
temps d’Alexandrie, on étoit déja aussi ignorant dans l’intelligence des hiéroglyphes que nous le sommes
présentement.
Je pourrois m’étendre davantage sur cette matiere ; mais je me persuade que les raisons que je viens de
donner sont convaincantes. Je me contente donc simplement de remarquer que les morceaux de marbres
couverts d’hiéroglyphes qui se trouvent au fondement de la colonne de Pompée prouvent qu’on en a
effectivement apporté, et qu’on a pas voulu s’en servir sans les changer, si ce n’est quand on les mettoit
dans des endroits où on les croyoit pour toujours cachés aux yeux des hommes.
Il ne reste plus qu’un point à examiner. Qu’est devenu, dira-t-on, cette grande quantité de ruines que doit
avoir causées la destruction générale d’une aussi grande ville qu’Alexandrie ? Je réponds que je leur ai,
autant qu’il m’a été possible, assigné des places convenables dans Alexandrie même, où elles doivent être
profondément ensevelies sous la terre. Qu’on se représente combien l’ancien pavé de Rome a été haussé à
l’occasion du saccagement et de la ruine de (p. 34) cette ancienne capitale du monde, et on se persuadera
aisément qu’il en est arrivé de même à Alexandrie. De plus, n’est-il pas constant que de tout temps on a
transporté en Europe beaucoup de ces débris ? On en use de même tous les jours ; et, dans le temps que
j’y étois, j’ai vu charger dans des bateaux françois de grosses pieces de colonnes et d’autres restes
d’antiquités. A la vérité on m’enleve de cette maniere que peu de chose à la fois ; mais à succession de
temps cela forme une somme. Si Alexandrie se trouvoit sous un gouvernement moins défiant et moins
difficultueux, on pourroit examiner les choses de plus près, et donner des raisons peut-être plus évidentes :
faute de cela le lecteur doit se contenter du peu d’observations qu’il est possible de faire dans un tel pays.
Je me rappelle ici d’une chose que je ne dois point passer sous silence, quand ce ne seroit que pour faire
connoître que j’y ait fait attention. Cette grande et superbe colonne que l’on voit hors de la porte de Rosette
est nommée la colonne de Pompée ; mais personne, je crois, ne nous saurois dire d’où dérive cette
dénomination. On n’ignore point que César pleura la mort de ce grand capitaine ; mais qui nous dira qu’il lui
ait érigé ce magnifique monument ? Le silence des anciens auteurs sur ce point est étonnant. Je ne
m’engage pas non plus à en donner l’histoire, il faudroit être devin : je remarquerai seulement que comme
cette colonne est de l’ordre corinthien, cela semble fixer son érection au temps des Ptolomées. (p. 35) Je dis
son érection et non sa fabrication, car je la crois égyptienne d’origine, et changée ensuite dans la forme
qu’on lui voit aujourd’hui. Une inscription qu’on découvre avec peine sur un des côtés du piédestal pourroit
sans doute donner quelques lumieres là-dessus ; mais le temps l’a si peu ménagée qu’elle n’est guere
déchiffrable. Un voyageur qui l’a observée une vingtaine d’année avant moi prétend avoir pu distinguer
qu’elle étoit écrite en caracteres grecs. Je m’en rapporte. Je sais seulement que les traditions que les
Arabes nous en ont transmises sont si fabuleuses, qu’il vaut mieux les mettre avec les contes de Roland et
de son cheval que de les rapporter parmi des observations et des remarques sérieuses.
Ce que j’avois à dire sur l’ancienne Alexandrie finiroit ici : mais je prévois que quelqu’un me demandera des
nouvelles du tombeau d’Alexandre, du Serapeum, du Museum, etc., et que d’autres iront peut-être jusqu’à
vouloir que je donne un plan des quartiers de cette ancienne ville.
Pour répondre aux premiers, je dirai que je me suis informé avec soin de ces anciens édifices, et que j’ai fait
bien des recherches afin de tâcher au moins de connoître les places où ils ont été élevés. Tous mes soins
ont été inutiles : de sorte que si j’ai placé, au commencement de cet ouvrage, le Museum dans l’endroit où
est aujourd’hui le petit Pharillon, j’y ai été déterminé par ce qu’on dit les soixante-dix interpretes. Si
cependant on jugeoit plus convenable de (p. 36) l’approcher du palais et de le mettre entre cet édifice et le
petit Pharillon, rien n’en empêche. Je conseillerois pourtant de se sentir au bord de la mer, c’est à-dire près
du port, sans y entrer, et sans faire tant que d’y placer des quartiers entiers, comme s’est avisé de le faire
l’auteur des Remarques sur les Commentaires de César, imprimées en Angleterre. Il a suivi les dessins de
Palladio, qui avoit usé de la liberté des peintres ; liberté peu excusable en lui, mais qui devient un crime
dans un auteur sérieux qui fait commentaire sur commentaire pour nourrir de fausses idées l’esprit de ses
lecteurs. Quiconque a été sur les lieux et en a vu la situation ne peut s’empêcher de remarquer la fausseté
d’un tel plan, fait dans le dessein d’éclaircir ce qu’a dit César, et qui n’est propre au contraire qu’à jeter dans
l’erreur ceux qui le prendront pour guide. Ceci soit dit néanmoins sans prétendre toucher au reste de
l’ouvrage, qui peut avoir son mérite. Je n’ai absolument prétendu parler que du plan d’Alexandrie.
Le tombeau d’Alexandre, qui, au rapport d’un auteur du quinzieme siecle, subsistoit encore alors, et étoit
respecté des Sarrasins, ne se voit plus ; la tradition même du peuple en est entièrement perdue. J’ai
cherché sans succès ce tombeau ; je m’en suis informé inutilement. Une pareille découverte est peut-être
réservée à quelque autre voyageur.
Il en est de même du Serapeum : ses ruines peuvent reposer sous quelqu’une des buttes dont j’ai fait
(p. 37) mention ; mais je n’ai rien apperçu de ce qui a pu appartenir à ce temple superbe.
Pour ce qui concerne le plan des quartiers de l’ancienne ville, c’étoit une tâche qui passoit ma portée. Il n’y a
pas assez de ruines sur pied pour assigner à chaque quartier sa véritable place : j’ai été obligé de me borner
à marquer la situation des ports, et de laisser à un chacun la liberté de travailler au plan des quartiers
suivant les descriptions que les anciens nous en ont données. Si ma relation et mes dessins leur peuvent
être de quelques secours, j’en serai charmé ; sinon je me contente d’avoir satisfait aux devoirs d’un
voyageur qui voit et qui n’écrit que ce qu’il a vu. Si j’ai tant fait que d’avancer mon sentiment sur certaines
choses, je ne m’y suis pas pris d’une maniere si entiere que je n’aie laissé à un chacun la liberté de penser à
sa façon. Si j’ai omis quelques particularités qui ont échappé à mes recherches, tant mieux pour ceux qui
viendront après moi, ils en pourront enrichir leurs relations ; et, s’il m’est arrivé de redire ce qu’on savoit déja,
on ne doit pas me savoir mauvais gré d’avoir attesté des faits par un nouveau témoignage.
(p. 39) Nouvelle Alexandrie
On peut dire avec raison que dans la nouvelle ville d’Alexandrie on rencontre un pauvre orphelin à qui il n’est
échu pour tout héritage que le nom respectable de son père. La vaste étendue de l’ancienne ville est bornée
dans la nouvelle à une petite langue de terre entre les deux ports ; les plus superbes temples sont changés
en des mosquées assez simples ; les plus magnifiques palais en des maisons d’une mauvaise construction ;
le siege royal est devenu une prison d’esclaves ; un peuple opulent et nombreux a cedé la place à un petit
nombre d’étrangers intéressés, et à une troupe de misérables qui sont les valets de ceux dont ils
dépendent ; une place (p. 40) autrefois si célebre par l’étendu de son commerce n’est plus qu’un simple lieu
d’embarquement ; enfin ce n’est pas un phénix qui renaît de ses cendres, c’est tout au plus une vermine
sortie de la boue ou de la poussiere dont l’alcoran a infecté tout le pays.
Voilà en gros le portrait de l’Alexandrie de nos jours. Elle ne mérite guere qu’on en donne une description
dans les formes. Un voyageur ne sauroit pourtant se dispenser de cette tâche par rapport à lui-même. C’est
le premier endroit où il débarque. Il y doit commencer à se faire aux usages et aux coutumes du pays ; y
apprendre à supporter les mépris d’un peuple grossier et peu affable envers les étrangers ; s’y faire une idée
des incommodités et désagréments qu’il s’y peut promettre en allant plus loin, et en mot faire comme le
noviciat de son voyage en Egypte. Il convient donc qu’il soit instruit de ce que l’expérience a appris à ceux
qui l’ont précédé.
On connoît assez le port et la maniere dont on y entre : je l’ai dit au commencement de cette description. En
arrivant à la ville on aborde à la douane, où le voyageur paie quelque bagatelle pour ses hardes. On les
visitera peut-être ; mais il n’y a rien à appréhender. On ne connoît point à Alexandrie de contrebande pour
un voyageur : le marchand à qui il est adressé fait ordinairement son affaire de cela comme de lui fournir le
logement et la nourriture.
Toutes les marchandises qui entrent dans l’Egypte par ce port y paient un droit suivant la taxe que le
(p. 41) grand-seigneur a imposé à ses sujets, ou bien suivant les conventions qu’il a faites avec les
puissances de l’Europe dont les sujets trafiquent à Alexandrie, où, pour le bon ordre, elles entretiennent des
consuls. Les marchands dont les souverains ne sont point en alliance avec la Porte paient sur le même pied
que ses propres sujets. Le bacha du Caire met, de deux ans en deux ans, cette douane en ferme au profit
du grand-seigneur : il l’adjuge au plus offrant, pourvu qu’il donne bonne et suffisante caution. Elle échet
ordinairement aux Juifs, parcequ’ils savent prendre les devants chez le bacha soit par des présents soit par
des intrigues. Ils ne sont pas sujets à avoir beaucoup de compétiteurs. Le marchand turc n’y prétend pas,
pour ne point paroître trop riche, et pour ne pas courir les risques qui s’ensuivroient. Les chrétiens non plus
ne s’en veulent pas mêler, parcequ’ils savent d’avance que les avanies qu’on leur feroit absorberoient
bientôt tout le profit de la ferme. Ce ne sont donc que les Juifs qui y aspirent ; et ils en ont assez de jalousie
entre eux pour enrichir les uns sur les autres, et faire ainsi monter le prix de la ferme.
On s’imaginera sans doute que les Européens doivent faire de grands profits, puisque, selon leurs traités, ils
paient toujours tant pour cent moins que ceux qui sont assujettis à la taxe du grand-seigneur, parmi lesquels
sont compris les Juifs étrangers et ceux du pays, ainsi que les nations qui n’ont point de consul : mais on se
désabusera bientôt quand on saura (p. 42) qu’ils ne peuvent jamais vendre à si bon marché que les Turcs et
les Juifs établis à Alexandrie, et qui ont assez de force pour soutenir un grand commerce.
Voici de quelle maniere ces derniers s’y prennent : dès que la douane est affermée, ils conviennent avec le
douanier de lui payer tant pour cent des marchandises qu’ils feront venir durant tout le temps de sa ferme.
Par-là ils sont mis d’abord au niveau des Francs, et quelquefois ils donnent encore moins. En effet le
douanier sait d’avance que s’il n’en agit pas de la sorte avec eux ils ne feront venir que peu de chose
pendant les deux années de sa ferme. Si au contraire il leur fait une bonne composition, il auroit soin de
pourvoir leurs magasins non seulement pour le temps présent, mais encore pour l’avenir. On sent bien qu’un
chacun ne peut pas agir de la sorte, puisqu’il faut qu’un douanier entrevoie un grand commerce pour faire un
pareil accord, et qu’un homme qui n’est pas riche ne peut pas faire venir beaucoup de marchandises. Il est
par cette raison exclus de ce privilege ; et comme il ne veut pas vendre au prix courant et que personne ne
veut lui donner davantage, il demeure dans l’inaction, se ruine, et reste toujours pauvre. Le contraire arrive
aux autres ; ils deviennent riches de plus en plus, et parviennent à la fin à établir une espece de monopole.
Il peut y avoir à Alexandrie une douzaine de ces marchands juifs aisés. Les autres ne commercent que sous
eux, et vendent en détail ce que les riches font (p. 43) venir en gros. Ces derniers se rendent par ce moyen
puissants dans leur nation, et le gouvernent presque en souverains. Celui qui refuse de leur obéir n'a plus de
part dans le négoce, et par conséquent devient dans peu misérable. Son exemple oblige de se soumettre à
tout ce que les riches décident : leurs sentences sont comme celles du juge, à qui les Juifs n’ont guere
recours, puisque, dans tout leur besoin, ils sont dans une espece de nécessité de s’adresser aux richards de
leur nation, et de s’en tenir à ce qu’ils prononcent.
Insensiblement la douane nous a mis sur le chapitre des Juifs : ainsi je joindrai ici par occasion quelques
autres remarques qui les concernent. Les plus considérables d’entre eux sont presque tous des étrangers,
et originaires de Constantinople, de Portugal, ou de Livourne. Il ne faut pas s’imaginer pourtant que ceux
d’Alexandrie soient les chefs des familles : ils résident ordinairement à Livourne, et étendent de là leurs
branches à Alexandrie, au Caire, à Alep, à Constantinople, à Tunis, à Tripoli, et pour ainsi dire dans toutes
les villes commerçantes de la Méditerranée, sur-tout dans le Levant. Ils n’ont ni privilege particulier ni
protection déclarée ; mais ils savent s’en procurer par leurs intrigues. Ils s’attachent toujours au plus forts,
c’est à-dire aux chefs du gouvernement, qui demeurent au Caire. Il leur en coûte à la vérité quelque chose :
mais ils s’en dédommagent ailleurs : car ils mettent si bien cette protection à profit, (p. 44) qu’ils emportent
communément le prix dans les occasions où il y a quelque chose à gagner. Cela leur donne encore du relief
parmi les Turcs, et les garantit des avanies et des insultes à quoi d’autres nations plus privilégiées que la
leur sont souvent exposées. Deux faits que je vais rapporter pourroient faire croire qu’on n’a pas grand
égard pour les Juifs à Alexandrie. Un douanier y fut tué il y a peu de temps, et une maison fut brûlée par la
populace, qui y fit périr tous ceux qui étoient dedans : mais ces accidents peuvent arriver ici à tout le monde
en pareil cas. Le douanier fut tué par un janissaire à qui il refusoit de diminuer la taxe de la douane ; et la
maison fut brûlée dans une émeute populaire, parcequ’on ne vouloit pas rendre un homme qui s’y étoit retiré
après avoir blessé ou battu un Turc. Il n’y eut point de satisfaction ; ce n’est pas la mode ici. Le coupable
prend la fuite : ou se contente ordinairement de cela, parcequ’on a pour principe qu’une chose faite n’est
point à redresser. Cependant depuis le meurtre du douanier il y a toujours une garde à la douane.
Puisque j’ai tant fait de parler d’une nation, il est naturel de faire connoître les autres ; et, pour rentrer en
quelque maniere dans l’ordre, je donnerai le premier rang aux Turcs, comme à ceux qui ont en main les
rênes du gouvernement. Ils tiennent des garnisons dans les deux Pharillons, et ils en ont encor une dans la
ville même : elle consiste dans un petit nombre de janissaires et d’asappes. Le gouverneur (p. 45) qui les
commande est un aga, et fait sa résidence dans un des anciens boulevards. Il y a aussi un cadi qui juge
dans les causes civiles. Les autres Turcs qui habitent à Alexandrie sont pour la plupart des artisans ou des
gens qui tiennent boutique. Il n’y a parmi eux qu’un fort petit nombre de marchands. Ceux-ci sont
communément à leur aise, quoiqu’ils ne le fassent pas trop paroître, comme je l’ai déja remarqué plus haut.
Les chrétiens coptes, grecs et arméniens, qui sont du pays même, se trouve en assez grand nombre à
Alexandrie. Ils n’y font pas néanmoins grande figure : ils s’entretiennent à-peu-près sur le même pied que
les Turcs, avec cette différence qu’ils sont généralement méprisés. Cependant parmi les Grecs et les
Arméniens il se rencontre quelques marchands étrangers qui font assez bien leurs affaires. Le patriarche
copte occupe dans cette ville la chaire de S. Marc, quoiqu’il réside ordinairement au Caire. Il se dit
successeur de ce saint apôtre et évangéliste ; et dans cette qualité il prétend marcher de pair avec le pape.
S’il étoit en même temps souverain temporel comme celui-ci, il ne manqueroit pas sans doute de faire bien
valoir sa prétention ; mais, vivant dans l’esclavage comme le reste de sa nation, sa puissance est bornée à
gouverner la mauvaise conscience de son troupeau.
J’espere que MM. les Européens ne prendront pas en mauvaise part si je les nomme les derniers : mon
intention a été bonne ; je ne les ai pas voulu confondre avec les autres habitants d’Alexandrie. En tout cas,
comme (p. 46) ils y sont étrangers, il n’étoit pas naturel de leur assigner le premier rang. Il est bon d’avertir
que tout Européen passe ici sous le nom de Franc. Ceux qui y demeurent sont les François et les Anglois.
Les premiers se flattent de se faire mieux respecter ; mais les derniers font peut-être un meilleur commerce.
Les François tiennent ici un consul dépendant de celui du grand Caire. La cour de France donne
ordinairement son plein pouvoir à son ambassadeur à Constantinople, et c’est lui qui pourvoit aux charges
vacantes. Ce consul a pour assistant un chancelier et un drogman, chacun avec commission de la cour tout
comme lui. Il gouverne ordinairement sa maison. Le chancelier a soin de la correspondance et juge les
différends entre les marchands et les capitaines ou maîtres qui conduisent ici des vaisseaux de la nation ; et
le drogman se mêle des affaires qui concernent les intérêts des François avec les Turcs.
Suivant les traités convenus entre les deux cours, les privileges des François sont assez considérables ;
mais leur force est trop petite à Alexandrie pour y pouvoir soutenir ces avantages. Ils n’y ont qu’une
douzaine de marchands, dont un seul, Italien de nation, fait le commerce pour son propre compte ; les
autres sont seulement les facteurs de divers marchands du Caire, à qui ils ont soin d'envoyer les
marchandises qu'on débarque ici.
J’ai déja donné une idée de la maniere dont on s’y prend pour diminuer leurs privileges par rapport aux
(p. 47) droits de la douane : le fait que je vais rapporter fera connoître comment ils se soutiennent dans ces
mêmes privileges. J’ai été témoin de l’affaire dans le temps que j’étois à Alexandrie pour me rembarquer afin
de passer en Europe.
Depuis quelques années, certaines femmes grecques d’assez mauvaise vie avoient tenu une espece de
cabaret où les matelots françois alloient boire quand ils venoient à la ville. Les désordres qui s’y
commettoient avoient engagé le consul à faire son possible pour détruire ce cabaret : mais ces femmes
s’étoient si bien précautionnées que tous ces efforts avoient été inutiles. Elles avoient choisi pour protecteur
un janissaire, l’un de ces braves qui dans l’occasion ne manquent jamais d’amis parmi leurs camarades.
Dans le commencement ce drôle se contentoit de faire le maîtrre dans le cabaret, châtioit les matelots
françois quand ils faisoient du bruit : mais lorsque le consul de la nation fit défense qu’aucun François ne
hantât ce cabaret, ce janissaire se déclara l’ennemi de tous ceux de cette nation. Il ne s’en tint pas aux
paroles et aux menaces, il insultoit dans toutes les occasions tous ceux qu’il rencontroit. Le gouvernement
d’Alexandrie refusoit de châtier ce janissaire, soit parcequ’il le craignoit, soit parcequ’il ne vouloit pas donner
satisfaction aux François sans être bien payé. Cependant le janissaire devenoit de jour en jour si
insupportable qu’aucun François ne pouvoit sortir de sa maison sans s’exposer à une mauvaise rencontre
avec lui. Leur sureté y souffroit (p. 48) trop et leur ambition encore plus. Il fallut donc s’adresser au
gouvernement du Caire ; et on y obtint par la voie ordinaire qu’un chiaous ou une tête-noire de la porte des
janissaires seroit envoyé à Alexandrie avec plein pouvoir pour connoître de cette affaire et pour prendre les
mesures convenables à la sureté des François. Ceux-ci eurent soin de se rendre leur juge favorable, et
convinrent avec lui de la maniere dont on s’y prendroit pour se saisir du janissaire, qui, informé du péril qui le
menaçoit, se mit, le jour qui précéda l’arrivée du chiaous, sous la protection des asappes, espérant par-là
esquiver le coup.
Enfin le chiaous, étant arrivé à Alexandrie, se déclara suivant ses ordres, souverain juge pour le temps de sa
commission. Le jour qu’il voulut prendre connoissance de l’affaire tous les François furent avertis de se tenir
chez eux, et la porte de l’hôtel du consul fut gardée par les janissaires que la nation entretient. Il n’y eut que
le drogman qui parut.
Ce jour-là, de grand matin, le chiaous fit enlever d’autorité toutes les femmes grecques du cabaret, et on les
embarqua sur un vaisseau françois, qui aussitôt mit à la voile pour l’isle de Chypre, où il avoit ordre de les
mettre à terre. Le janissaire ne se montra point dans cette occasion ; mais il ne s’éloigna pas non plus,
parcequ’il croyoit que la protection qu’il avoit prise chez les asappes le mettroit suffisamment en sureté.
Dès que le chiaous eut reçu la nouvelle du départ des femmes grecques, il tint un grand divan, où (p. 49) il
manda le janissaire et ses complices. Ils s’y rendirent sans témoigner la moindre crainte, et suivis de toute la
populace, curieuse de voir l’issue de cette affaire. Le sious (tchaouch) les reçut fort civilement : il les fit
asseoir à ses côtés, et s’entretient d’abord avec eux de choses fort indifférentes. Le discours tomba enfin sur
la démarche qu’ils avoient faite de changer la porte, en laissant celle des janissaires pour entrer dans celle
des assafs (assappes) ; et ils ne furent pas plutôt convenus du fait que le sious (tchaouch) lui-même sa saisit
du janissaire coupable, tandis que ses gens en faisoient autant à l’égard des autres : en même temps on
leur ôta les armes qu’ils portoient cachées sous leurs habits, on les chargea de chaînes, et dans cet état on
les embarqua sur une vergue qui mit aussitôt à la voile.
Cette procédure violente fit soulever dans le moment la populace et tous ceux qui appartenoient à la porte
des assafs (assappes). Le sious (tchaouch), s’en étant apperçu, se rendit sur un balcon ; et, après avoir
ordonné de faire silence, il fit à haute voix la lecture de deux pleins pouvoirs dont il étoit muni. Comme l’un
de ses pleins pouvoirs avoit été expédié par la porte des assafs (assappes) et que personne n’y pouvoit
trouver à redire, un chacun se retira. Le sious (tchaouch), informé par les François que le janissaire alloit
entrer dans cette porte, avoit eu la précaution d’en prendre des ordres. Le janissaire, qui l’ignoroit, donna
ainsi tête baissée dans le filet ; car, s’il en eût eu le moindre vent, (p. 50) il n’auroit eu qu’à se mettre à l’écart
pour quelques temps ; il seroit retourné après le départ du sious (tchaouch), et le procès auroit été terminé.
Les François avoient eu soin de ne point paroître prendre part à cette affaire ; il n’étoit pas non plus fait
mention d’eux dans les pleins pouvoirs : malgré cela on les regardoit comme les agresseurs ; et les femmes
de ces misérables qu’on avoit embarqués, s’imaginant qu’on alloit les noyer hors du port, coururent par la
ville comme des forcenées, assemblerent leurs amis, et marcherent droit vers l’hôtel du consul, vomissant
des malédictions et des imprécations contre les François. En vain les janissaires qu’on avoit appelés
voulurent arrêter cette canaille en furie ; une grêle de pierres les obligea de se mettre à l’abri de la maison
du consul. Les mutins en devinrent plus insolents ; ils casserent des vitres, et se préparoient à abattre la
maison, lorsque les janissaires reçurent un renfort de quelques uns de leurs gens que leur envoya le consul
d’Angleterre, et d’un certain nombre d’autres janissaires que le sious (tchaouch) fit marcher à leur secours.
L’affaire changea alors de face : les janissaires jouerent si bien du bâton, que les pleureuses et les mutins
prirent la fuite. Ils coururent pourtant dans les rues jusqu’au soir, et firent tout ce qu’il purent pour animer la
populace et pour la porter à la vengeance. Mais ce tumulte s’appaisa tout d’un coup dès qu’on fut informé
que les prisonniers étoient envoyés au château de Beaukier, d’où ils partiroient pour aller en exil. On jugea
qu’ils méritoient ce châtiment, et on ne s’en inquiéta plus. (p. 51) Il n’y eut que la nation françoise qui parut
un peu intriguée de la douceur de cette punition. Elle s’étoit imaginé qu’ils seroient du moins étranglés, afin
qu’un exemple de sévérité servît à prévenir de pareilles insultes ; au lieu qu’un simple exil faisoit craindre
qu’il ne se trouvât toujours quelque insolent capable de faire du chagrin à une nation entiere. Ce qui faisoit
encore plus de peine, c’étoit l’incertitude de la durée de cet exil : on appréhendoit de voir revenir ces
séditieux au bout de quelque temps, et d’être exposé à de plus grandes insolences de leur part. Du reste,
cette affaire coûta beaucoup aux François. Nous verrons dans la suite d’où se tire une semblable dépense,
et quel préjudice de telles levées font à leur commerce. En attendant je vais dire encore quelque chose de
leur consul et de celui des Anglois.
J’ai trouvé que le consul françois s’attribuoit sur sa nation un pouvoir qui peut être toléré. Le chancelier et le
drogman qu’il avoit de mon temps entendoient leur métier, et cela faisoit que chacun étoit content. Il est
d’usage parmi les François d’Alexandrie de témoigner un respect extrême pour leur consul : afin même de le
faire d’autant plus valoir dans l’esprit des Turcs et des autres nations, ils s’attachent à donner une haute idée
de sa personne, et à illustrer tellement sa naissance, qu’il ne dépend pas d’eux qu’on ne le regarde comme
sorti du sang royal. S’il fait par hasard un tour à Rosette, il porte pavillon blanc au mât de sa vergue ; et
quand il sort du port de même que (p. 52) quand il rentre il est salué d’une décharge générale du canon des
vaisseaux françois.
Il demeure, avec la plus grande partie de sa nation, dans un vaste hôtel où il a une église et un chapelain.
Les autres François habitent dans des maisons séparées. Il ne fait point de négoce, du moins à ce qu’il
paroît ; et il ne sort que très rarement, pour ne pas exposer sa personne et son caractere. Les airs qu’il se
donne parmi les siens ne lui permetent pas de trop converser avec eux : ainsi il paie sa grandeur par une vie
assez ennuyante pour un homme qui aimeroit la société.
Je quitte pour un moment MM. les François, car je reviendrai à eux en parlant du commerce. Voyons, en
attendant, comment agissent les Anglois. Il s’en faut de beaucoup qu’il y ait autant de choses à dire d’eux
que des premiers. Ils n’ont à Alexandrie que deux marchands, dont l'un est le consul qui dépend de celui du
Caire. Ils se tiennent tranquilles et se conduisent sans faire beaucoup de bruit. S’il s’agit d’entreprendre
quelque affaire délicate, il se mettent à l’écart, et laissent aux François l’honneur d’applanir les difficultés.
Quand il en résulte du bénéfice, ils y ont leur part ; et, si les affaires tournent mal, ils se garantissent du
mieux qu’ils peuvent. Voilà tout ce qu’on peut dire des nations établies à Alexandrie. Il n’y en a pas d’autres
que celles que j’ai nommées. Les François protegent pourtant un Italien et quelques Grecs qui passent pour
être des leurs. Je vais finir (p. 53) présentement ce qui me reste à dire du commerce de cette nation.
Celui des François est assez considérable à Alexandrie. Ils reçoivent chaque année plusieurs vaisseaux, sur
lesquels ils chargent les marchandises qui leur viennent du Caire. Les vaisseaux dont ils se servent pour ce
commerce sont des polaques, des barques et des tartanes. Il y vient peu d’autres vaisseaux, parceque tout
bâtiment qui ne porte pas beaupré paie moins pour l’entretien des ports, etc. On les nomme des
caravaniers, par la raison que, comme les caravanes, ils vont d’endroit en endroit pour s’y charger le mieux
qu’ils peuvent. Ce seroit ici le lieu de parler des diverses sortes de marchandises que la nation françoise
porte à Alexandrie, et de celle qu’elle retire de l’Egypte ; mais, à dire vrai, je n’ai pas cette matiere assez
présente à l’esprit pour la détailler comme il faut, et il vaut mieux n’en rien dire que d’en parler
imparfaitement. J’aime donc mieux toucher la question que j’ai promis d’expliquer ; savoir, pourquoi les
François se trouvent obligés de hausser le prix de leurs marchandises.
Il n’en faut point chercher la cause ailleurs que dans les faux-frais auxquels la nation est exposée : car, outre
que tous les vaisseaux paient un assez grand droit de consulat, ils sont encore tenus de payer une certaine
taxe qu’on impose ou sur les bâtiments ou sur les marchandises. Cette taxe est destinée à subvenir aux
dépenses qu’exige la sureté (p. 54) commune, et à dédommager les divers particuliers qui ont souffert
quelques avanies de la part des Turcs. C’est le consul qui hausse ou baisse cette taxe suivant que les
circonstances le demandent. Je ne crois pas néanmoins qu’il soit absolument le maître d’en ordonner
comme il lui plaît. Tout cela dépend sans doute de l’ambassadeur de France à Constantinople, qui doit
approuver les représentations des consuls d’Alexandrie et du Caire avant qu’ils puissent passer outre.
Cependant quelle que soit l’autorité en vertu de laquelle on leve ces droits, on peut dire qu’ils sont fort à
charge à la nation, qui véritablement perd par-delà beaucoup plus qu’on ne sauroit se l’imaginer.
Les Anglois ne connoissent point de contributions semblables : ils ont le droit du consulat à payer, et voilà
tout. De plus, cette grande subordination que les François sont obligés d’avoir pour leur consul n’est point en
usage parmi les Anglois : ils agissent plus rondemment les uns avec les autres ; et il n’y a de respect
qu’autant que la bienséance ou quelque intérêt particulier le peut exiger. Il arrive tous les ans un bon nombre
de vaisseaux anglois à Alexandrie ; mais ils ne sont pas toujours chargés pour le compte de cette nation.
Les Juifs et même les Turcs en fretent souvent, et ils y font bien leurs affaires.
Les Vénitiens et les Hollandois ont eu autrefois des établissements et des consuls à Alexandrie ; mais de
grandes banqueroutes, faites par les consuls mêmes, ont ruiné entièrement ce commerce. Les Turcs, qui
(p. 55) n’entendent pas raillerie quand il s’agit de leurs intérêts, ne veulent plus admettre aucun consul de
ces deux nations avant qu’elles les aient dédommagés des torts qu’ils ont soufferts de la part des consuls
précedents. Comme les sommes dont il s’agit sont grandes, et que les uns ni les autres n’entrevoient point
l’espérance d’un profit considérable, ils n’ont point depuis travaillé sérieusement au rétablissement de cette
branche du commerce. Peut-être aussi ne veulent –ils pas l’entreprendre à cause des conséquences qui en
pourroient naître si toute une nation faisoit son affaire de la dette d’un particulier. Le peu de vaisseaux que
les Vénitiens ou les Hollandois envoient à Alexandrie sont, aussi que leur charge, à la merci du douanier, qui
est réputé leur consul. Ils font accord avec lui pour les droits de la douane, et il s’en tire quelquefois assez
bien. Cependant les Vénitiens paroissent ordinairement sous le pavillon françois, et jouissent de sa
protection autant qu’il la peut donner par rapport au commerce.
Les Suédois, quoiqu’en alliance avec la Porte, ne vont que très rarement à Alexandrie. Dans le temps que j’y
étois, il s’y trouvoit un vaisseau de cette nation : il s’attendoit d’y jouir au moins des privileges qu’on accorde
aux Vénitiens et aux Hollandois ; mais le douanier refusa de traiter avec lui sur ce pied-là : de sorte qu’il fut
contraint de payer les droits dans toutes leur étendue ; ce qui ne devoit pas l’encourager à retourner une
autre fois.
(p. 56) Il n’y a pas, ce me semble, d’autres nations européennes qui fassent commerce à Alexandrie. Les
bâtiments turcs qui fréquentent son port sont des sultanes qui y vont tous les ans prendre en marchandises
le carat (kharadje) du grand-seigneur. Le bacha du Caire est chargé de le rassembler et de le faire conduire
sous les yeux d’un baye du Caire, qui l’accompagne toujours jusqu’à Constantinople.
On vit encore à Alexandrie, du temps que j’y étois, une escadre turque qui s’y rendit pour transporter les trois
mille hommes que l’Egypte fournissoit pour son contingent durant la guerre entre la Porte et l’empereur
d’Allemagne. La moitié de ce contingent consistoit en janissaires ; l’autre moitié en assafs (assappes). Ces
deux coprs se comporterent si mal durant les deux mois qu’ils resterent à Alexandrie, que personne n’y
pouvoit venir du Caire en sureté : ils pilloient de tous côtés, et ils volerent entre autres trente mille sequins
qu’un marchand françois envoyoit afin qu’on les embarquât pour les faire passer en Europe. Il avoit cru que
son argent ne courroit aucun risque, parcequ’il avoit confié à quelques janissaires que la nation entretient ;
mais ceux-ci furent attaqués par un ennemi supérieur en nombre ; et l’un d’eux se trouvant blessé
dangereusement, ils lâcherent l’argent aux vainqueurs. Le consul employa le verd et le sec pour faire
restituer l’argent ; mais, malgré toutes les démarches qu’il fit, malgré tout ce qu’il put offrir aux chefs de ces
troupes, il n’obtint rien ; et à mon (p. 57) départ d’Alexandrie on regardoit ces milles sequins comme perdus
sans ressource.
Les désordres allerent depuis à de si grands excès dans la ville même d’Alexandrie que les janissaires et les
assafs (assappes) en vinrent aux mains. Les réservoirs ne se trouvant pas pourvus d’une assez grande
quantité d’eau pour fournir au besoin d’un si grand nombre de personnes surnuméraires, c’étoit à qui s’en
empareroit : avec cela la haine qui subsiste toujours entre ces deux portes les animoit tellement que leurs
chefs avoient beaucoup de peine à les empêcher de s’égorger : ils n’en seroient jamais venus à bout s’ils
n’avoient pris le parti de presser leur départ. Par ce seul moyen ils rétablirent la discipline parmi leurs
troupes, et ils délivrerent la ville d’Alexandrie d’un pesant fardeau qui lui laissoit à peine la liberté de vaquer
aux affaires les plus nécessaires. Je n’ai point été le témoin oculaire des faits que je viens de rapporter ;
mais comme j’arrivai à Alexandrie immédiatement après le départ de ces troupes, la mémoire des excès
qu’elles y avoient commis étoit encore si récente qu’il n’étoit pas possible de douter des récits ni des plaintes
qu’un chacun en faisoit.
Cette digression que j’ai crue nécessaire m’a empêché de parler des saïques et des vergues, sorte de
vaisseaux turcs qu’on voit tous les jours dans le port d’Alexandrie. Les premiers, comme les plus grands,
vont à Damiette et dans divers autres ports du Levant ; et les vergues sont ordinairement employées à aller
(p. 58) à Rosette. Ces vaisseaux apportent de Damiette et de Rosette les marchandises de l’Europe
déposées dans ces deux villes, et ils portent les marchandises du Caire qu’on a dessein de faire passer en
Europe.
Il ne me reste après cela qu’à dire que, durant le séjour de trois semaines que je fis à Alexandrie, j’allai par
maniere de promenade voir quelques endroits qui n’en sont éloignés que de quelques lieues.
(…)
(p. 59) Cependant, avant de quitter Alexandrie, je vais m’acquitter de la promesse que j’ai faite ci-dessus de
donner la maniere dont un voyageur doit se conduire en Egypte. J’avertirai néanmoins que ce que j’écris
n’est point pour ceux qui y vont dans le dessein d’y faire négoce ou d’y chercher fortune : ces personnes-là
seront placées auprès de quelque marchand qui aura soin de leur apprendre bientôt tout ce dont on a
besoin pour faire son chemin. Mon intention est uniquement d’instruire ceux qui, comme moi, vont en Egypte
pour satisfaire leur curiosité et pour y faire des recherches utiles à la république des lettres.
Je commence donc par dire que je me suis apperçu dans l’Egypte, encore plus qu’ailleurs, on a besoin d’un
bon banquier. Il suffit dans un autre pays qu’un banquier fournisse de l’argent ; mais, en Egypte, il faut outre
cela qu’il serve d’hôte et en quelque (p. 60) façon de protecteur. On s’imagine assez que dans un tel pays il
n’y a point d’auberges capables de recevoir ce qu’on appelle un honnête homme : il est donc nécessaire que
le banquier fournisse les besoins de la vie ou chez lui ou chez quelqu’un de ses amis. Si le banquier est
d’une nation qui ait un consul, ce ministre se charge ordinairement de la protection dont on a besoin ; et s’il
est Juif et raisonnable, il ne manquera pas de crédit pour garantir le voyageur de toute insulte.
Si après s’être pourvu d’un bon banquier, qui est à mon avis la chose la plus nécessaire, on veut avancer
dans le pays et satisfaire sa curiosité, je conseille fort de s’habiller à la turque ; car, quoiqu’on puisse paroître
à Alexandrie en habit à l’européenne, il vaut beaucoup mieux se mettre comme les Francs, à la vue
desquels on est déja fait. Par-là on passe pour savoir les coutumes et les usages du pays, et l’on est moins
sujet aux réflexions du passant. Une paire de moustaches et un air grave et imposant sont encore fort bien
placés ici ; on en a plus de conformité avec les naturels du pays.
Un voyageur prendra ensuite un janissaire à son service, et, s’il est possible, il en choisira un qui soit
accoutumé à servir les Francs. On a des janissaires pour peu de chose. Ils savent ordianirement ce qu’on
appelle lingua franca. Ils accompagnent un voyageur par-tout où il lui est permis d’aller : personne ne
l’insultera dans leur compagnie. S’ils (p. 61) rencontrent un homme de distinction, ils savent lui rendre
compte de celui qu’ils escortent ; et ils voient accourir le menu peuple, ils l’écartent par des menaces. Les
banquiers connoissent les janissaires serviables, et on peut s’en rapporter à leur recommandation.
Avant d’arriver à Alexandrie un voyageur aura lu les anciens auteurs, et se sera fait une idée des choses
qu’il veut ou examiner ou confronter. Mais comme le pays a si fort changé de face, ce voyageur a besoin
que quelqu’un le mette sur les voies. Il peut faire aisément connoissance avec les diverses nations
européennes établies dans le pays, et il en pourra tirer de grands secours. Qu’il prenne garde néanmoins de
ne pas s’y livrer trop facilement. Il regne ordinairement beaucoup de jalousie entre ces messieurs. On doit
tâcher de les connoître, et ne s’attacher qu’à ceux qui peuvent être les plus utiles. Le drogman de la nation
françoise, par exemple, est ordinairement un homme élevé dans les pays et qui en sait parfaitement la
langue et les coutumes. Avec cela, pour peu qu’il soit curieux, il est en état d’indiquer les endroits où il y a
quelque chose à voir. On ne doit pas négliger les instructions qu’il peut donner ; mais il ne faut absolument
se fier qu’à soi-même. Telle chose qu’une personne ne daignera pas regarder pourra mériter l’attention
d’une autre, et donner des lumieres qui auront échappé à des gens moins attentifs. Tous ceux avec qui un
voyageur fait connoissance lui offrent (p. 62) civilement d’aller avec lui visiter les antiquités du pays.
Leur bonne volonté n’est pas de refus : mais au premier essai, on éprouvera qu’ils se borneront aux choses
communes ; et si on veut aller plus avant, ils tâcheront d’en détourner, soit parcequ’ils commencent à
s’ennuyer, soit parcequ’ils craignent de s’exposer à quelques accidents. On n’a rien de tout cela à craindre
quand on a la compagnie d’un janissaire. Il est accoutumé à fumer sa pipe et à ne rien faire ; il trouve ces
deux sortes d’agréments avec le voyageur qui l’accompagne : ainsi il se soucie peu du temps qui se passe à
s’arrêter dans un endroit. Je dois pourtant avertir qu’il n’est pas expédient qu’un voyageur pousse sa
curiosité jusqu’à vouloir pénétrer dans les lieux dont les Turcs ne permettent pas l’entrée, comme sont les
forteresses et les mosquées. Peut-être pourroit-il persuader son janissaire de l’y mener : l’intérêt peut
beaucoup sur ces gens-là ; ils ne sont pas à l’épreuve des présents. Mais il y auroit toujours de l’imprudence
à s’exposer. Il arrivera une fois qu’on échappera du péril ; il y aura néanmoins toujours à parier cent contre
un qu’on sera la dupe de sa curiosité. Je conseille de ne point s’entêter à vouloir visiter des lieux interdits, à
moins qu’on ne se soit assuré d’avance d’une permission de nature à garantir des hasards, et à moins qu’on
ne soit convaincu que la chose vaut la peine qu’on se donne pour parvenir à la voir.
(p. 63) Les discours des personnes avec qui ont fait connoissance dans le pays donnent ordinairement dans
le merveilleux. Elles racontent mille accidents qu’elles prétendent être arrivés à des voyageurs ou à d’autres.
Si on s’en rapportoit à ces personnes-là, on n’iroit guere au-delà des murs de l’ancienne Alexandrie, et tout
au plus on avanceroit jusqu’au Caire ; mais dans le fond, j’aime mieux m’en tenir à ma propre expérience
que me fier aux rapports de gens peu instruits ou trop crédules. J’ose du moins assurer que si on
n’entreprend pas d’aller plus loin que le Caire, et qu’on prenne tant soit peu de précaution, la route ordinaire
y conduira en toute sureté.
On n’a point besoin de drogman ou d’interprete tant qu’on ne sort point d’Alexandrie. Si on a intention d’aller
plus loin, il convient de se pourvoir au moins d’un valet qui sache l’arabe. Une dispute qui s’éleveroit entre
les gens du bateau sur lequel on s’est mis, ou entre eux et les passagers naturels du pays, seroit capable
d’alarmer si on n’avoit pas quelqu’un qui pût dire de quoi il s’agit.
Au cas que l’on trouve à Alexandrie quelque occasion de voyager en compagnie, soit avec des
missionnaires, soit avec des marchands de quelque nation européenne, la partie ne doit pas être manquée :
outre qu’on y trouve ordinairement l’avantage de la langue, on peut toujours faire plus de fonds sur le rapport
de ces honnêtes gens que sur celui d’un coquin de valet, juif ou grec, qui souvent a (p. 64) l’effronterie de
supposer quelques dangers afin de se rendre plus nécessaire.
Avant que de laisser cette matiere j’ajouterai une regle que l’on doit déja suivre à Alexandrie, et qui doit être
exactement observée dans toute l’Egypte c’est de ne jamais creuser au pied de quelque antiquité, ni rompre
aucun morceau de pierre de quelque monument que ce soit. Il faut se contenter de voir ce qui est exposé à
la vue, et les endroits où l’on peut grimper ou auxquels on peut parvenir en rampant. Quelque plaisir qu’il pût
y avoir à considérer un monument antique dans son entier, il faut y renoncer ; les suites en seroient trop
dangereuses. Un consul de France essaya de faire creuser auprès de l’obélisque de Cléopatre à Alexandrie
afin d’en avoir les justes dimensions. Il avoit eu soin d’en demander la permission, qu’il n’avoit obtenue
qu’avec bien de la difficulté. Malgré cela il ne lui fut pas possible de venir à bout de son dessein ; à mesure
qu’il faisoit creusé le jour, on fermoit la nuit le trou qu’il avoit fait faire. Cette oposition opiniâtre vient de ce
que tout le peuple, tant grands que petits, est persuadé que tous les monuments antiques renferment
quelques trésors cachés. Ils ne sauroient s’imaginer qu’une pure curiosité engage les Européens à passer
en Egypte uniquement pour y creuser la terre : au contraire ils sont si persuadés de notre avarice qu’ils ne
nous permettent point de fouiller nulle part. Si on s’avise de le faire en cachette, et qu’ils viennent (p. 65) à
s’en appercevoir, ils nous regardent comme des voleurs ; ils soutiennent qu’on s’est emparé du trésor qu’ils
supposent être dans cet endroit ; et, afin d’avoir meilleur prise sur ceux qui ont fouillé la terre, ils font monter
ce prétendu trésor à un prix excessif.
Il semble que les grands du pays, infatués de cette opinion, ne devroient jamais cesser de fouiller dans la
terre et de détruire tous les restes d’antiquités. C’est en effet à quoi plusieurs d’entre eux se sont appliqués,
et divers précieux restes de monuments antiques sont péris par-là. Mais comme ils n’ont rien trouvé, ils se
sont à la fin lassés de la dépense. Ils ne se sont pas pour cela défaits de leur folle imagination ; au contraire
ils y ont joint une autre idée encore plus insensée, en supposant que tous ces trésors sont enchantés, qu’à
mesure qu’on en approche ils s’enfoncent de plus en plus dans la terre, et qu’il n’y a que les Francs qui
soient capables de lever ces charmes ; car ils passent généralement en Egypte pour être de grands
magiciens.
Une autre raison encore a détourné de ces sortes de recherches. Deux de ce qui s’étoient rendus fameux
par cette entreprise de creuser la terre pour y chercher des trésors tomberent entre les mains de leurs
supérieurs, qui ne les épargnerent pas, et ne voulurent jamais croire que ces hommes-là n’avoient rien
découvert. Ils les accuserent d’avoir trouvé des trésors, et de le nier pour ne pas les partager avec eux. On
leur faisoit tous les jours de nouvelles (p. 66) avanies sous des pretextes frivoles ; et enfin on leur fit payer
les profits d’une recherche dont ils n’avoient jamais tiré aucun avantage.
Ce qui se trouve d’antiquités à Alexandrie, tant en médailles qu’en pierres gravées et en autres choses
semblables, se découvre, comme je l’ai déja remarqué ci-dessus, sans creuser et seulement quand les
terres sont lavées par la pluie. Si dans quelques occasions on remue la terre, on le fait sous d’autres
prétextes, comme pour tirer des pierres quand on veut bâtir, etc. ; mais cela se fait sans toucher en aucune
façon à ces pieces antiques qui sont debout, et qui par cette heureuse jalousie se sont conservées au milieu
d’un temple barbare, qui d’ailleurs n’en fait pas grand cas.
Je ne dis rien du péril où un étranger s'expose s'il a la faiblesse de s'engager dans quelque intrigue
amoureuse. Je suppose qu’un homme qui va en Egypte pour s’instruire par la recherche de l’antiquité doit
être assez modéré et assez retenu pour n’avoir rien à craindre de ce côté-là. Si cependant il s’en trouvoit
quelqu’un qui eût besoin d’antidote contre une si folle passion, il suffit de le renvoyer au récit que tous ceux
qui ont fréquenté Alexandrie et le Caire lui pourront faire. Il apprendra que de jeunes marchands ont été
malheureusement assassinés dans ces deux villes ; que d'autres, après s’être ruinés à force de faire des
présents aux janissaires pour les engager à se taire, se trouverent à la fin trompés à tel point, qu’au lieu
(p. 67) d’avoir jouit de quelques femmes de distinction, ils s'étaient abandonnés aux plus viles prostituées,
qui, par-dessus le marché, les avaient régalés d'un mal qu'ils gardoient pour toute leur vie, et dont personne
n'étoit en état de les guérir.
Enfin dans l’Egypte on doit éviter encore plus qu’ailleurs les occasions d’être insulté par les gens du pays.
Mais si malheureusement le hasard vouloit qu’on fût exposé à leurs insultes, il est prudent et sage de faire
l’oreille sourde et de fermer les yeux. En tout cas, on en peut venir jusqu’aux menaces ; mais qu’on se garde
bien de frapper un musulman : si on étoit assez heureux que d’échapper la mort, il en coûteroit tout le bien
qu’on auroit ; et, ce qui seroit aussi chagrinant, les amis de celui qui auroit frappé seroient engagés dans
l’affaire et ne s’en tireroient qu’à force d’argent. Si absolument on veut avoir satisfaction, il faut la demander
aux juges : mais elle coûteroit si cher qu’on n’aura pas envie d’y retourner une autre fois. S’il y a quelque
autre chose que le voyageur doive savoir, il l’apprendra dès les premiers jours de son arrivée dans le pays. Il
convenoit de l’instruire des articles que je viens de toucher : peut être seroit-il trop tard d’en être informé sur
les lieux, outre que l’on est sujet à ne pas croire tout ce qu’on entend dire. Pour moi j’aurois été ravi d’en être
informé d’avance : c’est ce qui m’a engagé à les publier pour l’utilité de ceux qui pourroient être dans le cas
où je me suis trouvé. »
- 624 - 640 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
RICHARD POCOCKE (du 10 octobre au 3 novembre 1737)
Pococke, R., Voyages de Richard Pococke, éditions J.-P. Costard, Paris, 1772.
Richard Pococke naît en 1704 à Southampton. En 1756, il est nommé archiprêtre d’Ossory, en Irlande, puis
évêque à Elphin. Il est par la suite transféré au siège épiscopal de Meath. Il semblerait qu’il ait acquis une
réputation peu glorifiante. Dans sa biographie, on lit : « Les obscures et insignifiantes particularités de sa vie
ne valent guère la peine d’être rapportées. Ses voyages sont tout ce qu’il importe de savoir de lui. » 577
Contrairement à ce qu'on peut lire dans sa relation de voyage, Richard Pococke ne séjourne pas à
Alexandrie du 29 septembre au 24 octobre 1737, mais bien du 10 octobre au 3 novembre 1737.578
p. 3-27 (tome I) :
« Alexandre le Grand revenant de consulter l’Oracle de Jupiter Ammon, fut tellement charmé de la situation
de Rhacotis, qu’il ordonna d’y bâtir une (p. 4) ville, qu’on appella de son nom Alexandrie. C’étoit autrefois
Memphis, qui étoit la capitale du royaume ; mais cet honneur ayant été transféré à cette derniere ville, elle
ne fit point dans la suite partie d’aucune province, mais un gouvernement à part. Les historiens Arabes
rapportent que lorsque les Sarrasins prirent cette ville. Il y avoit 4000 palais, autant de bains, 400 places
publiques, & 40 000 Juifs qui payoient tribut.
Comme la mer a gagné d’un côté ce qu’elle a perdu de l’autre, il est très difficile de fixer la situation de
plusieurs lieux dont on trouve la description dans Strabon.
Comme la baie a environ trois lieues de large, l’Isle de Pharos, qui s’étend d’orient en occident, près du
Promontoire oriental Lochias forme les ports d’Alexandrie ; le port Eunostus est à l’occident, & ce qu’on
appelle le Grand-Port à l’orient : ce dernier est aujourd’hui appellé le Port-neuf, & l’autre le Port-vieux.
L’Isle étoit jointe vers l’occident (p. 5) au continent, par une chaussée & deux ponts de 900 pas de long, & il
y a toute apparence que cétoit dans l’endroit où est le Quai du vieux-port. La mer a gagné du côté occidental
de l’isle, & l’on voit encore sous l’eau les ruines de quelques cîternes qui étoient taillées dans le roc.
Le fameux Phare étoit bâti sur un rocher, à l’extrémité orientale de l’isle. Il étoit entouré d’eau de tous côtés,
& formoit par conséquent une petite isle séparée. C’est-là vraisemblablement qu’on a bâti le château qui est
à l’entrée du port-neuf ; & les piliers qu’on voit lorsque la mer est calme au-dedans de l’entrée, peuvent-être
les débris de ce superbe édifice. Je fus moi-même les voir en bateau ; on m’apperçut, & j’appris depuis que
plusieurs soldats qui étoient (p. 6) ce jour-là de garde au château, avoient été punis pour m’avoir permis de
reconnoître le port.
La mer a gagné de tous côtés sur l’isle de Pharos, excepté celui du midi ; la partie occidentale de l’ancienne
isle est aujourd’hui appellée le Cap des Figues, à cause quelle en produit d’excellentes.
La mer s’étant retirée au nord & à l’ouest du côté où étoit anciennement la chaussée, de-là vient que le port
oriental est plus petit qu’il n’étoit. Chacun de ces ports a deux entrées, une près de chaque cap du
continent ; celle du port oriental n’est que pour les petits bateaux, au lieu que celle de l’occidental est la plus
sûr pour les gros vaisseaux. L’entrée de l’autre port qui est du côté du château, est très étroite, & fort
dangereuse, à cause des écueils qui s’y trouvent, conformément à la description que les anciens en ont
donné.
On prétend qu’Alexandrie étoit baignée de deux côtés, au nord par la mer, & au midi par le lac Mareotis,
(p. 7) & que les deux autres côtés formoient chacun une espece d’isthme d’environ sept stades de long ; ce
qui fit donner à chacun de ces côtés, sur-tout à celui de l’ouest, où l’on dit que commençoit la chaussée qui
conduisoit à l’isle, le nom d’Heptastadium ; ce qui sert à confirmer ce que je suppose dans le plan
d’Alexandrie, que l’Heptastadium commençoit à l’angle qui est près de la porte d’occident, à la pointe du
vieux port qui est au sud-est.
La première chose que je fis à Alexandrie fut d’aller me promener autour de ses murailles, & d’en mesurer la
hauteur, mais avec tant de précaution, que je crus n’avoir été apperçu que par le Janissaire qui
m’accompagnoit ; mais le bruit se répandit aussi-tôt dans la ville, que je les avoit mesurées par palmes. Les
vieux murs de la ville paroissent avoir été bâtis sur la hauteur, qui s’étend depuis le cap Lochias vers l’orient,
car l’on voit encore dans cet endroit une porte qui conduit au chemin de Rosette, d’où les fondements
s’étendent jusqu’au canal. Les murailles extérieures de la vieille ville, sont bâties de pierres brutes, &
paroissent être fort (p. 8) anciennes ; toutes les arches sont en plein ceintre & fort bien bâties. Elles sont
défendues par des tours demi-circulaires, de vingt pieds de diamètre, & espacées d’environ 130 pieds ; elles
ont chacune un escalier pour monter aux crénaux, dont le parapet est soutenu par des arcades. Ces
murailles, telles qu’on les voit aujourd’hui, paroissent avoir enfermé toute la ville, à l’exception du palais des
Rois, qui est au nord-est ; & il y a toute apparence que l’enceinte du palais s’étendoit vers l’occident, depuis
l’angle du sud-est jusqu’à la porte de Rosette, ainsi qu’on le voit dans le plan, & que les murailles, dont les
fondemens s’étendent jusqu’au canal, en formoient les fauxbourgs. Les murailles intérieures de la vieille
ville, sont plus fortes & plus hautes que les autres, & défendues par de grosses tours extrêmement hautes.
Les deux plus grosses sont sur le rivage, en tirant au nord-ouest vers la ville neuve. Celle qui est au nord
servoit autrefois de Douane, & appartient aujourd’hui à l’Aga.
L’autre qui est abandonné, est à trois étages, & a des cîternes (p. 9) au-dessous. Le palais, avec les
fauxbourgs qui en dépendent, faisoit une quatrieme partie de la ville. C’étoit dans ce district que se
trouvoient le Museum, ou l’Académie & les tombeaux des Rois, dans lesquels on déposa le coprs
d’Alexandre dans un cercueil d’or. On l’en tira depuis, pour le mettre dans un verre, & ce fut dans cet état
qu’Auguste le vit, lorsqu’il répandit des fleurs dessus, & l’orna d’une couronne d’or, pour marquer le respect
qu’il avoit pour ce héros. Comme les Mahométans ont beaucoup de vénération pour la mémoire
d’Alexandre, quelques voyageurs ont prétendu qu’ils avoient son corps dans une mosquée, mais on n’en a
eu aucune nouvelle jusqu’ici.
Les rois ayant abandonné le séjour d’Alexandrie, il y a tout lieu de croire que leur palais tomba en ruine,
(p. 10) qu’on transporta les matériaux dans l’endroit de la ville qui étoit habité, & qu’on s’en servit pour bâtir
les murailles intérieures. On voit encore près de la mer quantité de débris, & sur le rivage où étoit l’ancien
palais, plusieurs morceaux de porphyre & d’autres marbres précieux. Mais à l’égard des édifices qui sont sur
les bords de la mer, près des obélisques, & de la Tour ronde à deux étages, qui est au nord-ouest, ils
paroissent avoir été bâtis en même-tems que les murailles intérieures, & être par conséquent moins anciens
que les Ptolomées ou Cléopatre. Il y a dans la Tour ronde un puits entierement ruiné ; & l’on dit qu’il y en a
aussi dans les autres Tours.
Au bas de ces palais étoit le port particulier des rois, vis-à-vis la Tour ronde qui est dans la mer, où les
vaisseaux mouillent quelquefois. C’étoit là que les Turcs les obligeoient de décharger leur cargaison il y a
cinquante ans, ne leur permettant point de mouiller sous le château, comme (p. 11) ils le font aujourd’hui.
C’étoit aussi dans ce port que se trouvoit l’isle Antirrhodes, où il y avoit un palais & une petite baie. Cette isle
paroît avoir été entierement détruite par la mer, & elle étoit vraisemblablement vis-à-vis des obélisques ; car
l’on voit encore quantité de ruines dans la mer, & l’on en tire souvent de très-belles colomnes. On parle d’un
théâtre qui étoit au-dessus, & de la partie de la ville qui portoit le nom de Neptune, & où on lui avoit bâti un
temple. Je crois que c’étoit vers l’angle que forme la baie. Ce fut dans ce district qu’Antoine bâtit son
Timonium, où il se retira après ses infortunes. On parle ensuite du (p. 12) Caesarium, où l’on croit qu’étoit le
temple de César, & où, suivant Pline, on avoit dressé quelques obélisques. Plus haut étoit l’Emporium, ou le
Marché ; venoient ensuite les bassins pour les vaisseaux, où étoit l’ancienne ville de Rhacotis, avec une
espece de fauxbourgs appellé Bucolis, parce qu’il étoit habité par des pastres.
Ces deux ports communiquoient ensemble par deux ponts attenans à la chaussée, qui commençoient à
l’angle nord-ouest de la ville ; à l’Heptastadium, au couchant, qui étoit un des isthmes, formés par la mer & le
lac. Il y a toute apparence que la mer a gagné vers l’orient du vieux port, ainsi que je l’ai marqué dans le
plan, où elle baigne les murailles depuis la grande tour qui est dans l’angle, où la muraille fait un coude vers
le nord-ouest ; car il est évident qu’elle a gagné sur le rivage, où l’on voit quantité de grottes, à moitié
détruites par la mer.
Dans ce port occidental, appelé anciennement Eunostus, & aujourd’hui le vieux port, se trouvoit le port
Cibotus, où commençoit un canal (p.13) navigable qui alloit se rendre dans le lac. Il y a aujourd’hui dans cet
endroit un canal ou fossé le long des murailles, qui aboutit du canal de Canopus jusqu’à la mer, par lequel
l’eau du grand canal s’écoule dans la mer, dans le tems des inondations du Nil. Lorsqu’un vaisseau étranger
est obligé de relâcher dans le vieux port, il faut qu’il passe dans l’autre, sitôt qu’il a occasion de le faire,
parce que c’est celui où mouillent les vaisseaux chrétiens.
On parle d’une montagne, appelée Panium, qui est dans la ville, & il paroît par la description qu’on en
donne, que c’est la même qui est dans l’enceinte des murailles, près de la porte occidentale & du port vieux.
La rue qui traversoit la ville dans toute sa longueur, depuis la porte de Necropolis, jusqu’à celle de Canope,
avoit, dit-on, cent pieds de large, & il devoit y avoir plusieurs bâtimens superbes, comme on en peut (p. 14)
juger par les colonnes de granite qu’on voit encore dans deux ou trois endroits. On compte parmi ces
édifices le Gymnase, ou les Ecoles publiques, dont les portiques avoient plus d’un demi-quart de mille de
longueur. Elles étoient vraisemblablement bâties dans l’endroit où l’on voit encore quantité de ruines, & de
grosses colomnes de granite rouge, je veux dire, à l’occident de la rue. Le Forum, ou Cour de Judicature,
étoit probablement un autre édifice de cette magnifique rue, & il pouvoit être placé près de la mer, où l’on
voit encore quelques colonnes. La porte de Necropolis est, je crois, la même que la porte méridionale qui
existe actuellement. On prétend que les deux principales rues d’Alexandrie se coupoient à angles droits ; de
sorte que si celle qui traversoit la ville dans sa longueur commençoit à la vieille porte, l’autre devoit être
vis-à-vis.
De tous les monuments qui restent à Alexandrie, les plus extraordinaires (p. 15) sont les cîternes qu’ils
bâtissoient sous leurs maisons, & qui étoient soutenues par deux ou trois étages d’arcades ou de colonnes,
pour recevoir l’eau du Nil qui s’y rendoit par le canal, ainsi qu’on le pratique encore aujourd’hui. Les maisons
de Jérusalem ont aussi des cîternes dans lesquelles on conserve l’eau de la pluie. Ce canal de Canope
vient aboutir aux murailles près de la colonne de Pompée, au couchant de laquelle il coule. Il passe sous les
murailles, & à commencer de cet endroit, on a creusé un fossé en dehors, le long des murailles, qui va
aboutir à la mer. Mais non-seulement on conduit l’eau de ce canal dans les cîternes, depuis l’endroit où il
entre dans la ville, mais encore de plusieurs autres endroits par des conduits souterreins, jusqu’aux endroits
les plus élevés. On a pratiqué dans ces passages des ouvertures pour pouvoir y descendre & les nettoyer.
On nettoye aussi les cîternes de tems à autre. On y descend par des puits, où l’on a pratiqué de chaque
(p. 16) côté des trous espacés de deux pieds. On tire l’eau par le moyen d’un vindas, et on la porte dans les
maisons à dos de chameau dans des outres. L’eau de la plupart n’est point bonne à boire, lorsqu’on n’a pas
soin de les nettoyer ; car il y en a quelques-unes, & entr’autres celle du couvent des Latins, où elle se
conserve dans toute sa bonté.
La vieille ville est entièrement ruinée, & l’on s’est servi des matériaux pour bâtir la nouvelle. A l’exception de
quelques maisons qui sont à Rosette, & des portes des bains, il n’y a que quelques mosquées & trois
couvents dans la vieille ville.
Une de ces mosquées est appellée la mosquée de mille & une colonnes. Elle est à l’occident, près de la
porte de Necropolis. J’y ai vu quatre rangs de colonnes du sud à l’ouest, & un rang des autres côtés. On
prétend qu’il y avoit là, une église dédiée à Saint-Marc, où le Patriarche faisoit sa résidence, & que
l’Evangéliste fut martyrisé près de sa porte. L’autre grande mosquée est celle de (p. 17) Saint-Athanase, où
il y avoit sans doute une église de ce nom.
On montre dans l’église de Cophtes la chaire patriarchale. Ils prétendent avoir la tête & même le corps de
Saint Marc. Les Grecs montrent certaines choses qu’ils disent avoir appartenu à Sainte Catherine, qui fut
pareillement martyrisée dans cette ville. Les Latins ont aussi leur couvent dans la vieille ville ; il dépend de
celui de Jérusalem. Il y a toujours quelques pauvres Arabes qui campent autour en dedans des murailles, de
maniere qu’il est dangeureux de sortir après le coucher du soleil, lorsque la compagnie commence à se
retirer.
Il y a au sud-ouest un gros château, où il y a toujours quelques soldats en garnison, qui ne laissent entrer
aucun Européen. On trouve en dedans des portes, sur-tout à celle de Rosette, quantité de beaux morceaux
de granite ; dans la ville, des fragmens de colonnes d’un très-beau marbre, qui montrent la grandeur & la
magnificence de l’ancienne ville.
La ville neuve est bâtie sur le rivage au nord, hors des murailles, sur le terrein que la mer paroît avoir
(p. 18) abandonné, & a très-peu d’apparence. Elle comprend l’espace marqué sur le plan hors des murailles,
à l’exception du rivage qui est vers l’orient, & une grande partie qui n’est point bâtie vers le vieux port, aussi
bien que l’endroit où étoit autrefois l’isle de Pharos. Plusieurs maisons ont des cours & des portiques
soutenus par des colonnes, la plupart de granite qui faisoient l’ornement de l’ancienne ville. Il y a tout lieu de
croire que cette derniere étoit florissante, dans le tems que les Vénitiens faisoient le commerce des Indes
Orientales par cette voie ; & l’on peut dater sa décadence de celui où l’on découvrit le cap de
Bonne-Espérance. Alexandrie a repris vigueur depuis 60 ans, au moyen du commerce du caffé.
De deux obélisques qui restent, l’un est cassé, & l’autre renversé. On a découvert en creusant que leur base
étoit circulaire, & faite en forme de plinthe, les Egyptiens ayant coutume de donner une pareille base à leurs
colonnes, comme on peut le voir dans les Observations sur l’Architecture. Ces obélisques étoient
vraisemblablement placés devant le temple de (p. 19) Neptune. Si je ne me suis point trompé en mesurant
celle qui est sur pied avec le quart de cercle, elle a 63 pieds de hauteur. Le morceau de celle qui est
rompue, a 18 pieds de long, & sept pieds quarrés à sa base.
Le théâtre, à ce qu’on prétend, étoit au haut de la ville, au-dessus & vis-à-vis de l’isle Antirrhodes, je veux
dire sur la montagne qui est près de la porte de Rosette, & qu’on appelle Coum-Dimas. J’en juge par sa
figure. On y creusoit lorsque j’arrivai à Alexandrie, pour en tirer les pierres.
La Colonne, qu’on appelle communément Colonne de Pompée, est située sur une petite éminence, à
environ un quart de mille au midi des murailles. Ce qui me fait croire qu’elle fut érigée après le tems de
Strabon, c’est qu’il ne fait aucune mention de ce monument extraordinaire. Peut-être fut elle érigée en
l’honneur de Titus, ou d’Adrien, pendant qu’ils étoient en Egypte. On trouve tout auprès quelques morceaux
de colonnes de granite de quatre pieds de diamètre, & il paroît par plusieurs vieux fondemens qu’il y avoit
dans (p. 20) cet endroit un palais superbe, dans la cour duquel on avoit placé cette colonne. Quelques
historiens Arabes l’appellent le palais de Jules César, mais j’ignore sur quel autorité ils se fondent. Cette
fameuse colonne est de granite rouge. Elle est composée de trois pierres, non compris le fondement. Son
chapiteau, qui peut avoir huit à neuf pieds de hauteur, est Corinthien ; ces feuilles sont unies & sans
dentelure, & ressemblent parfaitement à celles du laurier. Quelques matelots ayant monté jusqu’au sommet,
y ont trouvé un trou, ce qui donne lieu de croire qu’elle portoit une statue. Le fust de la colonne, y compris le
tore supérieur de la base, est d’une seule pierre ; le reste de la base & le piédestal d’une autre, & le tout
porte sur un fondement composé de plusieurs pierres, en forme de deux plinthes, qui forment deux assises,
dont l’inférieure déborde de quatre pouces celle de dessus, & celle-ci d’un pied la plinthe qui est au-dessus.
Ce fondement a quatre pieds neuf pouces de hauteur, & le piédestal, en y comprenant une partie de la base,
qui est d’une seule pierre, 10 pieds & 6 (p. 21) pouces. J’ai trouvé sa hauteur de 114 pieds, ce qui s’acorde
avec la description que d’autre voyageurs en ont donnée. De manière qu’en retranchant les mesures
susdites, & un demi-pied pour le tore supérieur, la hauteur de la tige est de 88 pieds 9 pouces, c’est-à-dire,
environ dix fois le diamètre de la colonne, qui est d’environ 9 pieds. Le dé du piédestal est de 10 pieds
2 pouces en quarré, & la plinthe de 14 pieds. J’ai remarqué un renflement dans la colonne, & qu’elle
penchoit un peu vers le sud-ouest. Elle est parfaitement bien conservée ; à l’exception qu’elle est un peu
éclatée du côté du midi, mais moins que de celui du nord est. On a arraché quelques pierres du côté du
fondement qui regarde l’ouest sud ouest, pour pouvoir découvrir la pierre du milieu, sur laquelle on prétend
que toute la colonne porte, ce qui est faux, car elle porte sur tout le massif. Il y a pourtant lieu de croire que
c’est elle qui soutient le plus grand poids de la colonne. Cette pierre a 4 pieds d’épaisseur, & elle m’a paru
être un mêlange d’albatre & de caillous de différentes couleurs, & on a gravé dessus (p. 22) quelques
hiéroglyphes. A mon retour à Alexandrie, on l’avoit réparée de maniere que la plinthe inférieure servoit de
banc. Il y a du côté du couchant une inscription Grecque, qu’on ne peut lire que lorsque le soleil donne
dessus. Elle est en quatre lignes.
On trouve à l’occident, au-dessus du canal de Canope, & près du tombeau d’un Sheik quelques
catacombes. Elles consistent en différents appartements taillés dans le roc, de chaque côté d’une galerie
ouverte. A chaque côté de ces appartements, il y a trois étages de trous assez grands pour contenir un
cadavre. C’est-là vraisemblablement où commençoit le fauxbourg. Il y avoit des jardins, des sépulchres, &
des lieux pour embaumer les corps. Le quartier appellé Necropolis ou la ville des morts, étoit à l’occident de
la ville. Les catacombes s’étendoient de plus d’un mille vers le couchant ; il y en a quantité le long de la mer,
dont la plupart sont détruites. J’entrai dans quelques grottes taillées dans le roc, en forme de longues
galeries paralleles les unes aux autres, qui sont (p. 23) coupées par d’autres à angles droits. Je crois que
c’étoit-là où l’on embaumoit les corps. Les plus belles catacombes sont à l’extrémité ; elles sont taillées dans
le roc, & plusieurs ont des niches ornées d’une espece de piliers d’ordre dorique.
On trouve environ un mille plus loin, un fossé de 30 à 40 pas de largeur, qui paroît avoir été creusé depuis le
lac Mareotis jusqu’à la mer. Comme on dit que la ville s’étendoit au-delà du canal, qui aboutissoit au port
Cibotus, ce ne peut être celui-là, vu que non-seulement il est hors de la ville, mais encore plus au couchant
que Necropolis. On crut que je me hasardois beaucoup d’aller jusqu’au fossé, sous l’escorte seule d’un
domestique & d’un Janissaire, & j’eus même besoin d’user d’artifice, pour engager ce dernier à
m’accompagner. Cette corvée commençoit à l’ennuyer, d’autant plus qu’il faisoit extrêmement chaud.
Comme j’ignorois leurs coutumes, je m’étois proposé de le gratifier à mon départ ; mais ne (p. 24) sachant
point mon intention, il auroit voulu que je lui eusse donné quelques pieces d’argent à chaque fois qu’il sortoit,
& de là vient qu’il avoit toujours quelque excuse à alléguer, lorsqu’il étoit question de m’accompagner. Mais
la principale raison étoit, je crois, qu’on lui avoit dit de la part du Gouverneur, que j’observois ce qui étoit
autour de la ville avec plus d’attention que personne n’avoit encore fait, & qu’on l’avoit détourné de me
suivre dorénavant ; car le Gouverneur exige une certaine somme des étrangers qui sortent avec les
Janissaires d’Alexandrie, que ceux-ci sont tenus de lui payer, au lieu qu’il n’en est pas de même de ceux du
Caire. Je pris donc un Janissaire de la ville, & moyennant le tribut que je lui payai, j’eu une entière liberté de
faire ce qui me plaisoit.
J’appris d’un gentilhomme, qui avoit été environ à trente milles à l’occident d’Alexandrie, & environ deux
heures au midi de la tour d’Arabie, dans une vallée qui est à l’occident du lac Mareotis, qu’il avoit vu sous
terre un édifice soutenu par trente-six colonnes de marbre : c’est vraisemblablement (p. 25) Taposiris, qu’on
dit être éloigné de la mer, & où se tenoit la grande assemblée ; & si cela est, il y a lieu de croire que la tour
d’Arabie est l’ancien Cynosema, & la vallée dont je viens de parler ce qu’on appelle Boher Bellomah, ou la
mer sans eau, dont je ferai mention ailleurs.
Le grand lac Mareotis, qui étoit autrefois navigable, est aujourd’hui à sec, excepté quelques tems après qu’il
a plu. Il y a lieu de croire que les canaux qui y conduisoient l’eau du Nil s’étant bouchés, il n’a formé qu’une
plaine, comme il l’est encore actuellement. Pomponius Mela, parlant du lac Mareotis, qui est
vraisemblablement le même que ce grand lac, dit que ce qui est aujourd’hui un lac, étoit autrefois un champ.
Le canal de Canope, qui conduit l’eau à Alexandrie, se seroit pareillement bouché, si l’on avoit eu soin de le
nettoyer de tems-en-tems, ainsi qu’on le fit pendant que j’y étois ; ce (p. 26) qui fut cause que l’eau y
séjourna deux mois de plus. On prétend que ce canal étoit revêtu de briques d’un bout à l’autre. Il y a des
endroits où il est revêtu de pierres, ce qui forme un quai fort commode pour décharger les vaisseaux. Ce
canal prend son cours environ à un demi-mille au midi des murailles de la vieille ville ; il se replie ensuite au
nord, près de la colonne de Pompée, & passe sous les murailles de la ville ; & environ à trois milles de la
ville, il se porte à l’ouest, en tirant vers le nord.
L’hippodrome, qu’on place hors de la porte de Canope, étoit, selon toutes les apparences, dans la plaine
vers le canal, au-delà de la hauteur, où je suppose qu’étoit la porte.
Je fis quelques courses vers l’orient, pour voir les antiquités qui s’y trouvent. Je rencontrai souvent quelques
Arabes à cheval, qui m’offrirent de m’escorter jusqu’à la porte de la ville, dans le dessein de recevoir quelque
gratification. M’étant apperçu de leur (p. 27) dessein, & sachant d’ailleurs que je n’avois aucun danger à
craindre, je les remerciai de leur politesse, & ils se retirerent tranquillement. Lorsque ces Arabes ont quelque
démêlé avec les habitans d’Alexandrie, ce qui arrive souvent, ils ne laissent sortir personne, & bloquent pour
ainsi dire la ville.
Les habitans d’Alexandrie, sur-tout les Janissaires, sont de très-mauvaises gens. Ils ne demandent en rien le
caractere que César donne de la soldatesque de son tems. Ils excitent des tumultes, pillent & assassinent
souvent, sans qu’on puisse en avoir raison. »
- 641 - 645 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JOHN MONTAGU (jusqu’au 16 septembre 1739)
Montagu, J., A voyage round the Mediterranean in the years 1738 and 1739, Londres, 1799.
Le Britannique John Montagu, quatrième comte de Sandwich (1718-1792), reçoit une éducation au collège
de la Trinité de Cambridge. À son retour de voyage en 1739, il prend sa place dans la Maison des Lords. En
1748, il devient amiral de la flotte du roi George III. L'explorateur James Cook a baptisé deux archipels du
nom de ce Premier Lord de l'Amirauté. C'est lui encore qui aurait donné son nom au plat, le sandwich.579
p. 425-434 :
« What contributed much to increase the happiness of Ægypt at that time, was the foundation of Alexandria ;
which, having a most advantageous situation for commerce, soon rendered the country as famous for its
riches and trade, as it had before been for its fertility. The vast wealth, which was continually flowing to
Alexandria from the eastern countries, with which it had a communication, by a canal cut out of the Red Sea
to the Nile, rendered it in a short time a place of such luxury and effeminacy, that the pleasures of Alexandria
became a synonimous expression for a life led in all sorts of debauchery :
« Ne Alexandrinis quidem permittenda deliciis580. » Quint. I. O. L. i.
This city was built in the hundred and twelfth Olympiad, three hundred and thirty years before Christ, by the
command of Alexander the Great, under the direction of Dinocrates, the most famous architect of his time. It
stretched itself along the shore of the Mediterranean to the north, having the large lake Mareotis lying behind
it to the southward, and was situated at the distance of thirty-five miles from the Canopic mouth of the Nile. It
would be a needless labour, after Strabo and Hirtius de Bello Alexandrino, to give a particular description of
the spacious suburbs, magnificent (p. 426) amphitheatres and portico’s, which Alexandria had in common
with other great cities ; I shall only mention one peculiar advantage which this city had above all others in
Ægypt. Dinocrates, considering the great scarcity of good water in this country, dug very spacious vaults ;
which, having communication with all parts of the city, furnished the inhabitants with one of the chief
necessaries of life. These vaults were divided into many capacious reservoirs, or cisterns, which were filled
at the time of the inundation of the Nile, by a canal cut out of the Canopic branch entirely for that purpose.
The water was in that manner preserved for the remainder of the year, and being refined by the long
settlement, was not only the clearest but the most wholesome of any in Ægypt. By means of these cisterns
Julius Cæsar, when besieged in Alexandria, by the ennuch Ganymede, was brought to very great
extremities, the enemy having made themselves masters of the ducts, which supplied the reservoirs, and by
means of a machine filled them with salt-water. This grand work is still remaining, whence the present city,
though built entirely out of the ruins of the ancient one, still enjoys part of the benefactions of Alexander the
Great. The ancient city, together with its suburbs, was above seven leagues in length ; and Diodorus Siculus
informs us, that the number of its inhabitants amounted to above three hundred thousand, counting only the
citizens and freemen, but that, reckoning the slaves and foreigners, they were allowed at a moderate
computation to be upwards of a million. These vast numbers of people were enticed to settle here by the
convenient situation of the place for commerce ; since, besides the advantages of a communication to the
eastern countries, by the canal cut out of the Nile into the Red Sea, it had two very spacious and commodius
ports, capable of containing the shipping (p. 427) of all the then trading nations in the world. The largest and
best of these ports lay to the westward of Alexandria, extending itself as far as the city of Plinthina, the
western boundary of Ægypt. It was called by the ancients Portus Cibotus, and known at present by the name
of the Old Port ; the form of it is near an oval, composed to the southward of the African shore, and to the
northward of an island anciently called Anti Rhodus. Here the ships, which belong to any subjects of the
Grand Signor, ride secure in all weathers, while those which come under European colours are obliged to
anchor to the New Port, anciently called the Portus Eunostus. This harbour lying more in the center of the
city was in greater use, when Alexandria was in its prosperity ; being rendered secure not only by nature, but
by the utmost efforts of art. The figure of this harbour was a circle, the entrance being very nearly closed up
by two artificial moles, which left a passage for two ships only to pass abreast. At the western extremity of
one of the moles was erected the celebrate tower of Pharos, a small island, which was in the time of Julius
Cæsar joined to the continent by a bridge, though Homer assures us, that in his days it was distant from the
main land as far as swift ship could sail with a fresh gale of wind in a day :
[en grec581]
(p. 428) Seneca speaks of this account of Homer in such a manner as shews, that he gave very little credit to
it :
« Tantum (si Homero sides est,) aberata continenti Pharos, quantum navis diurno cursu metiri plenis lata
velis potest582. » Sen. Quæst. Nat. L. vi. C. 26.
It is not indeed easy to conceive by what natural means such a prodigious change could have happened
between Homer’s time and that of Julius Cæsar, since in almost twice that number of years the alternation is
so inconsiderable, that whereas Pharos, in Cæsar’s time, was joined to the main land by a bridge, it is now
fastened to the continent by a small neck of land, and from an island is become a peninsula. Lucan,
therefore, where the mentions the ancient didtance of Pharos from the continent, seems to have paid a
compliment to the father of poetry, at he expence of that historical truth, which he so strictly observes
through the general course of his poem :
« Tunc claustrum pelagi cepit Pharon ; insula quodam in midio stetit illa mari, sub tempore vatis Proteos, at
nunc est Pellæis proxima muris583. » Luc. L. x. l. 509.
(p. 429) The Pharos together with the isthmus, which joins it to the main, forms the New Port, defending it
from the rage of the northwest winds ; which, notwithstanding, frequently make terrible havoc among the
shipping, driving the vessels from the anchors, and forcing them against the adjacent rocks. In this island
was erected the famous tower or light-house, built by Sostratus of Cnidos, at the command of Ptolomy
Philadelphus, in the place of which, in a calm day, one may easily distinguish large columns, and several
vast pieces of marble, which give sufficient proofs of the magnificence of the building, in which they were
anciently employed. On the mole, opposite to the Pharos, was another light-house called Lochias, to point
out more certainly the entrance into the harbour. Not far hence stood the palaces of the Ptolomies, and the
celebrated museum, in which many learned men were maintained at the public expense, who had the
opportunity of pursuing their studies in the famous library, which was thereto contiguous, collected under the
reign of Ptolomy Philadelphus, by the care of Demetrius Phalereus, and increased by the successors of that
prince, to the (p. 430) number of seven hundred thousand volumes. Whoever considers the magnificence of
the public edifices, the noble works for the common benefit of the inhabitants, and the many ohers
advantages enjoyed by the ancient Alexandria, must neccessarily lament its present condition, deprived of
all its ornaments, almost destitute of inhabitants, and shewing no other proofs of its former grandeur than a
few ruins, which have maintained themselves superior to the attack of time. The old city, part of which is at
present subsisting, was built entirely out of the remains of the original Alexandria, which was totally
destroyed by the Arabs, when they rendered themselves masters of Ægypt. This people, accustomed to live
in tents, and naturally averse to any kind of magnificence in their buildings, being displeased at the
sumptuous edifices, which presented themselves to their view, from allsides at their entrance into the city,
determined to level it with the ground. This resolution being immediately executed, they applied themselves
to build another city more suitable to their way of thinking, which was composed after the manner of all the
Arab towns of low huts, built out the materials of the original Alexandria. This new city acknowledged for its
founder one of the successors of Saladin, who possessed himself of Ægypt by driving out the caliphs of the
Fatumian family, in the six hundredth year of the Turkish Hegira. This prince, notwithstanding he despised all
useless magnificence as luxurious and effeminate, was resolved to perpetuate his memory by a grand work,
which was built not only through ostentation, but also to defend his people effectually from the assaults of
their enemies. He to his end surrounded the new-built city with a strong fortification, containing five miles in
circuit, which in those ages must have been almost impregnable. It is composed of a thick and lofty wall
(p. 431) with one hundred large towers placed at equal distances ; these towers were divided into a great
many different rooms, allotted for habitations to the garrison, which by that means was neither troublesome
nor expensive to the inhabitants. Within this was another wall not so high, but considerably stronger than the
former, being secured behind by a very large rempart of earth. These walls are to this day remaining almost
entire, and have been by several persons erroneously imagined to have belonged to the ancient and original
Alexandria ; which supposition might be very easily disproved, even though we were unacquainted with the
period, in which they were erected ; it being plain from the many broken pillars of porphyry, granite, and
such-like rich materials inserted in these coarse structures, that they were built out of the ruins of the first
city. This second Alexandria, after a few ages, being bereft of the greatest part of its inhabitants, who were
swept away by two or three successive plagues, the remainder of the people displeased at living in a town,
which was full of nothing but ruin and desolation, uniting together built themselves a third city, to the
westward of the ancient one, upon the neck of land which devides the Old and New Port. The inhabitants of
this last town, by application to commerce, enriched themselves to that degree, that they began to turn their
thoughts towards rendering their habitation a place of safety, having before nothing but their poverty to
defend them from the attacks of an enemy. To this end they build two castles, the same which at present
command the entrance into the harbour, which at the same time that they defend them from a foreign
enemy, keep the citizens themselves in awe. Such is the situation of the present Alexandria, bears no
resemblance to the ancient city except only in (p. 432) the name. Within the circumference of the second city
are remaining several pieces of Pagan, Christian, and Mahometan antiquity, in which are to be found some
traces of the original grandeur of Alexandria. In the center of the New Port are still to be seen two obelisks,
the one standing, the other fallen, and almost buried in rubbish, they are called by the common people
Cleopatra’s Needles, though improperly, since it is pretty certain that princess had no hand in erecting them.
I make no sort of doubt, that these are the very obelisks mentioned by Pline to have been erected by king
Mesphees ; the height agreeing almost exactly with those described by that author :
« Alii duo [obelisci] sunt Alexandriæ in portu, ad Cæsaris templum, quo excidit Mesphees rex quadragenum
binum cubitorum584. » Plin. L. xxxvi. C. 9.
The obelisk, which is now standing, is formed of one sole piece of granite, fifty-four feet high, and seven feet
four inches square at the base ; part of it is buried in the ground, which probably is that now wanted to the
exact dimensions of the Mesphean obelisks. It is inscribed on the four sides with hieroglyphics, which on
those parts exposed to the south and east winds, are very much effaced, though to the north and west they
are mightily well preserved. At a small distance from the obelisks is a long row of granite pillars about forty
feet high, bordering on a street above a mile in length ; which, being placed at exact distances from one
another, seem to be (p. 433) the remains of a magnificent portico which divided the city in the middle,
terminating at the eastern and western gates. These pillars, the greatest part of which are fallen, and half
buried in the ruins, are composed all of one single stone, placed upon pedestals, and appear to be of the
Corinthian order, though their capitals are wholly destroyed except one, which is so much worn by the
injuries of time, that it is not possible from it to distinguish the order, though the height and figure of it agree
entirely with the Corinthian. Near the middle of this street, behind the row of columns, are the ruins of a large
brick building, which by the structure, seems to be Roman, and approaches nearer to the figure of the
ancient baths, than of any other public edifice, there being still remaining several small rooms, which by their
form and situation favour this supposition. At a small distance hence is a church with the pulpit in which
St. Mark the evangelist is said to have preached, when he was sent into Ægypt by St. Peter, and
acknowledged for patriarch of Alexandria. This church is in the hands of the Coptes, a sect of Christians
peculiar to this country, differing only in a few articles from those of the Greek rite. Almost contiguous to this
is another church and convent, in which are maintained a pretty considerable number of Greek caloyers or
monks, who pretend to shew the stone on which St. Catharine was beheaded, which they assure us is still
marked with the blood of that virgin and martyr. Not far hence is also a convent of capuchins, and a
synagogue for the Jews, none but Mahometans being suffered to exercise their religion in public within the
precincts of the present Alexandria. About half a mile without the walls of the second city is standing, upon a
rising ground, a very fine column of granite, distinguished vulgarly by the name of Pompey’s Pillar. This
noble piece of antiquity is composed only of (p. 434) three pieces of marble, one of which forms the
pedestal, the second the plinth and shaft of the pillar, and the third the capital, its whole height, inclusive of
the three parts, is one hundred and two feet. It is of the Corinthian order, and though the capital, which is not
very well executed, gives one reason to imagine that it was erected at a time when architecture was not in its
highest parfection, yet the other parts are found to answer the rules of the strictest proportion. One thing
also, which would give one reason to conclude that it is of greater antiquity than is commonly imagined, is
that the lower part of the pedestal is inscribed with hieroglyphics, which seems to intimate that it owed its
foundation to the ancient Ægyptians. The common notion, from which it has taken its name, is, that it was
erected by Julius Cæsar upon his arrival in Ægypt, as a monument of his victory over Pompey ; but, as there
is no mention of this in any ancient author, we must content ourselves with admiring the magnificence of the
column, without inquiring after its founder.
The sixteenth of September, N. S. one thousand seven hundred and thirty-nine, we set out from Alexandria
in a germe, or open boat, of which there are continually a great number in their passage between that city
and Rosetto. »
- 646 - 649 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHARLES PERRY (entre 1739 et 1742)
Perry, C., A view of the Levant : particulary of Constantinople, Syria, Egypt, and Greece, Londres, 1743.
L’Anglais Charles Perry (1698-1780) étudie la médecine à Leyde avant d’être diplômé à Utrecht en 1723. Il
voyage entre 1739 et 1742 en Europe et dans le Levant. Il dédicace sa relation de voyage à John Montagu,
voyageur de ce corpus, qu’il rencontre lors de son périple.585
p. 410-419 :
« Having finished our observations on Cairo, we embark’d at Boulac, on board a vessel, which we took to
ourselves in proprio, for Alexandria, the 17th day of July ; and the 21st at night we arrived at Rosetto, having
viewed several pleasant villages on our way. About ten o’clock at night, and about a league short of Rosetto,
we were met by a boat which was sent out in search of vessels for the new Bashaw, who then lay at Rosetto,
on his way to Cairo. This boat boarded us, and seize us for the Bashaw’s service ; and the next morning all
our baggage, etc. were tumbled out upon the quay to our great damage and mortification. But this is a
digression in the modern (french), for which we beg excuse.
Rosetto is a very considerable town, and by far the most beautiful in all Egypt, Cairo not excepted. We went
from hence to Alexandria, by land, which is 12 good leagues. The road is good, dut disagreeable, the whole
being one continued desart plain, which exhibits no sort of verdure, except here and there some palm-trees,
whose tops are ever-green.
We found a manifest difference in the air, as to temperature and coolness, betwixt Cairo and Alexandria ; but
though the latter is the coolest place, yet the air there is, generally speaking, very damp and clammy, which
makes it disagreeable.
The present Alexandria is much improv’d of late years, as to the extent and beauty of its buildings ; so that at
this day it makes a (p. 411) pretty considerable figure for an Egyptian City. But however, the modern
Alexandria occupies little or none of that space, where the ancient city stood ; nor is the present city shadow
of the ancient, either for extend, beauty, or importance.
Alexandria has two very good ports, one called the New, and the other the old, which is an advantage that
few other cities can boast of. The old port lies to the West of the town, and is appropriated to the Turkish
vessels only, as the new port is to the Frank ships, though the sultanas, as Turkish ships of war are called,
chuse the new port likewise.
The new port is a very beautiful mole, lying to the North of the town : it describes this figure, and its entrance
on each side is defended by a castle. The present town is situated and comprehended betwixt the
south-west of the mole and the curv’d line A, that’s drawn at a Distance without it : and the last old city,
whose walls are the major part of them yet standing, extended from the eastermost point b, all along to the
west-south-west, but without the comprehension of the new town, and terminated at the old port. The only
remaining obelisk, commonly called Cleopatra’s Needle, stands at a, at the east-end of the mole, just within
the limits of the wall. A few paces to the south of it lies the base of another, which was doubtless a fellow to
that now on foot ; for it is of the very same sort of granite, and of the same diameter on its north and east
sides ; but that on its south and west sides is preserved tolerably well yet. Of all the obelisks we have seen,
whether in Egypt, Italy, or elsewhere, this is the only one which has felt in injuries of time in a perceivable
degree : and, which is yet more extraordinary and remarkable, the sculpture on this obelisk is not only the
closest or thickest set, (if we may be allow’d that expression) but is the boldest and deepest of any other ;
whence (cæteris paribus) it should resist the longer time. But we ascribe this decay or effacement of the
sculpture to the nature and texture of the granite ‘tis made of ; for this is of a larger and coarser grain, and a
redder sort, than any other we have seen. And we find universally, that such granite as is inclining to a black,
or iron-grey, or cinericious colour, and is at the same time and weather. Their substances may be broken to
pieces, or otherwise mutilated, on purpose ; but their carving will always appear fresh and perfect, except
purposely destroy’d by friction, or broken (p. 412) to pieces with hammers, or other instruments. The height
of this obelisk is near 70 feet, and its width at he base seven feet four inches.
The noble and surprising column, commonly called Pompey’s pillar, is situate on an eminence to the south of
the old city, about 500 yards without the gate on that side. It did not appear, upon the best observations we
could make, to be quite 100 feet high, though others pretend to have found it to be 110 feet. But, be that as it
will, ’tis generally allow’d to be the lostiest pillar in the world, whose shank, like this, is compos’d of one
piece. Whether the chapiter be of a piece with the shaft, we cannot say ; but if so, then the whose,
comprehending the upper-part of the pedestal, is all one piece, and the diameter of the shank at the bottom
is 11 feet 4 inches.
Another very extraordinary and marvellous circumstance in this pillar is, that it rests upon a pivot of a small
diameter, compar’d with itself. The lower end of this pivot centres in a large stone, in a socket made so as to
receive and fit it exactly, whilst the other and upper end of it passes in like manner up the center of the
pedestal, and, so aught we know, may pass quite through the pedestal, and enter into the pillar itself.
About twenty-five years ago the Arabs (who fancied, and were assur’d beyond all doubt, that a great deal of
treasure lay conceal’d under this pillar) began to undermine it, with design to throw it down, and profit of such
booty as they should find under it ; and it was by this means that the pivot, upon which the pillar rests,
happen’d to be first discover’d : and though the Arabs were diverted or deterr’d from carrying on their
designs to the subversion of that noble pillar, yet the earth was so far dug and clear’d away as to get a good
and distinct sight of the pivot, which they found to be wrought all over with hieroglyphics. The pillar continu’d
in that manner, more or less undermin’d, ‘till the last year, when, by an order of government, it was fill’d up
again, and is flank’d all round with a stone bulwark, the better to secure it from falling.
’Tis the common opinion and tradition of people, that this pillar, and the obelisk call’d Cleopatra’s Needle,
were erected by, or at least to the memory of the persons whose names are now attach’d to them : but, in
reality, the world is intirely in the dark concerning their æras, as also by whom, or to whose memory, they
were erected.
’Tis pretty extraordinary, that there is no inscription upon the pedestal of this famous pillar, to give some light
concerning the time, intent, and use, when, by whom, and for what, it was erected. Some personns, indeed,
have fancy’d they saw the vestiges of an inscription on the north side of it ; but we concess, for our (p. 413)
parts, we could discover no such thing. Who knows, however, but the hieroglyphics on the pivot may be the
thing we are in quest of, though now bury’d, in the earth, the hieroglyphic figures offer nothing more at
present than the vain image of those things which were so well understood by the Ancients.
The present Alexandria is the second town that has been rais’d out of the ruins of the ancient city ; that is, of
the ancient city which was built by Alexander the Great, and call’d after his name. For the catacombs, which
are now in a very ruinous state, and evidently derive their existence, from a very remote period of Antiquity,
are a sufficient evidence (if history was perfectly tacit concerning it) that there was a city prior to the time of
Alexander. The city built by Alexander the Great out of the ruins of the preceding, though inferior to the
former, as well in Magnitude as magnificence, was nevertheless a very superb and splendid city, and was
more than ten large miles in circuit ; whereas the walls of the last city, which at the present subsist, though
pretty much shatter’d, are not of above half extend.
When the first Alexandria fell a victim to the Arabs, those savage people, who had been accustom’d to live in
huts and tents, had rather an abhorrence for fine towns and palaces, than any manner of taste for them.
They look’d upon the superb stately palaces rather as prisons than as pleasurable habitations ; and, in
consequence of their deprav’d notions and appetites, they destroy’d all those noble structures, and
prostituted their materials to the bulding of huts and cottages, preserving the fine pillars, and other choice
materials of Antiquity, for their Mosques. Thus the ancient Alexandria became almost choak’d with its own
ruins, and there was little else to be seen within the compass of the walls, except spoils and rubbish.
Succeeding Mahometan Princes, finding it near depopulated with time, reduc’d the compass of it to the
number of its people, and so abandon’d the rest. It was one of the successors of Saladine who began this
reform ; and we are inform’d by history, that the walls of this new Alexandria, and the hundred towers with
they were flank’d, were rais’d chiefly out of the ruins of the palaces, and other ancient fabrics.
Some ill-judging travellers have asserted, that the present walls and towers are the same that subsisted in
the times of the Greeks and Romans : But people must have little knowledge in history, and less judgment in
things, who pretend to support such a fact. For, first, the compass of ground contain’d within the present
walls is (as above observed) in no proportion so large as the ancient Alexandria was. And as to the present
walls, etc. If people were (p. 414) not blind, it would be easy to convice them, that these were not of the
Greeks or Romans : For in these we see many pieces of damag’d marble pillars, interlaid with common
stones ; so that the walls of the late city shew in part the ruins of the former.
Almost all the inhabitants are now settled in the new town which lies in the space above describ’d, betwixt
the south-west part of the mole and the old wall ; and the late city is so far depopulated and deserted, that
we question if there are 50 families left in it ; and, in the morning or the evening, a man runs great risque of
being robb’d, if business or curiosity lead him thither.
We have sometimes gone in a boat, when the weather has been calm, and the sea smooth and clear, so
that we could see to the bottom ; and thus coating along the east end of the mole, we discovered a great
number of broken pillars in the water ; and moreover, we saw the vestiges of ancient buldings almost as far
as to the new bridge, that leads to the eastermost castle ; which things are undeniable proofs, that the
ancient city extended much farther than the present walls do on that side.
The ancient city had for a subsrtatum, or basis, one continued range of cisterns, for preserving a due supply
of the Nile water, which was brought every year in time of the high Nile, by a chalitz cut for that purpose.
Almost all those witin the present walls subsist at this day, in good repair ; and their structure may serve to
evidence a fine invention, as well as great labour and industry, in the founders of them. We fathom’d several
of them, and found them to be about 20 foot deep.
In ranging all over the ruins of the old city, we found a surprising quantity of broken pillars, all of granite
marble, lying scattered up and down amongst the ruins. Indeed we find several noble pillars of the same sort
yet standing, and ranged on each side the capital street, which ran along, in a right line, from one end of the
city to the other.
There are yet to be seen, within the extend of the present walls some remains of the superb colonnade
which stood towards the middle of the area. This colonnade, as ’tis said, consisted of a range of pillars of
extraordinary bigness and beauty ; that it was of an oval figure, and that within it was described the noble
square of Alexandria. The immense ruins that appear near the place of this colonnade, shew that the finest
palaces of the ancient city fronted on each side of this stately piece of architecture. Probably the buildings
advanced as far as the columns, upon which the anterior walls might have rested, and so form porticoes
convenient for walking. We have rode round within the present walls several times, and, according to the
best estimate we can make, find them (p. 415) to be above five miles in circuit, and a figure inclining to a
long square.
The Pharos or Light-house of Alexandria (accounted one of the seven wonders of the world) is supposed to
have stood where the westermost castle now is. Ammianus Marcellinus says, it was situate at seven furlongs
distance from Alexandria ; which seems to agree pretty well with the distance of the present castle from the
walls of the old town.
A certain commentator on Lucian says, it was built like a tower of a square figure ; the circumference of its
base equal to that of the great pyramid ; its height 300 cubits, and that its light might be seen at sea to
100 miles distance.
Ptolemy Philadelphos is said to have built it, on his coming to the crown, in the 470th year of Rome.
Alexander essay’d to build a city in the same place, but, finding it too streight for that purpose, was obliged to
decline it, and so contented himself to build one opposite to it, upon the main land.
All that space which the new Alexandria occupies, as well as the large, beautiful plain that lies at the east
end of it, is said to be adventitious, or to be land made by the surges of the sea, which are continually
throwing up sand and earth : ’Tis said further, that heretofore the sea washed the foot of the old wall, to the
south and eastward, as it now does to the westward, beyond the old port.
About four miles to the west of the new town, and about 60 paces from the sea-side, we found a large
subterranean space, commonly called a Temple. We crawled into it upon our bellies, not without much
difficulty ; and, ranging a good while about it, we found it to consist of a great many different compartments,
which were not made without design : and amongst others, we found one which was more spacious and lofty
than the rest, which was roofed with a dome or a cupola.
About five miles to the east of the town, upon a cape or point of land, near the sea, is a very considerable
antient fabric now almost in ruin, which is said to have been an amphitheatre. We had formed a design of
going to see this ruin, in compagny with our consul and some others of our nation, but just as we were going
to set out, came a message from Sardar of the janisaries to the consul, advising him not to stir any-where
without the walls, for that the Arabs were encamped round the old town, in a hostile manner, so that we were
obliged to abandon our design for the present ; and as the said Arabs continued under Arms ’till the time of
our leaving Alexandria, we had no opportunity of going afterwards.
(p. 416) During the time we were at Alexandria, there was a great dearth of corn, and all other kinds of grain ;
upon which a troop of boys, amounting to about 50 in number, assembled together one morning early, and
ran all about the town, crying Sheer Allah ; that is, heaven do us justice. In this tumultuous manner they went
first to the house of the cadi, and afterwards to those of other chief men of this city ; and in such cases ’tis
feard’d that some one, or more, of the chief men will fall a sacrifice.
Before we finish our remarks on Alexandria, we can’t omit to observe, that this, of all other places whatoever,
is the principal theater, or chief mart, for antique medals, intaglios, stone statues, and what we call icunculæ,
or little grotesque images, in brass or earth ; and ’tis to this place we are indebted for a good part of what we
have collected. ’Tis the more to be wonder’d at, that Alexandria should yet continue to abound in such
things, as it has long been a place of great trade with foreign nations, and a great rendezvous to all Franks,
especially English, French, Dutch, and Italians, who have from time purchased and carried off great
quantities, but more especially the French. But in reality there seems to be an inexhaustible fund of them ;
and the people who at this day make it their employ to go amongst the ruins, and garble the earth, find their
account in it, by picking up daily, both of the one sort and the other. But besides what things are daily found
within the old ruins and immediately about the out-skirts, the peasants (called Bodoweens) frequently bring
such things in from the remote villages : and further, ’tis a very common practice for the Franks, who dwell in
Alexandria, to send out some of the native Arabs to all the villages, for a considerable distance about to
collect these sort of Antiquities for their account ; but these fellows take care to be paid in hand for their time
and trouble, ere they will go. Indeed the same thing is practiced, in some measure, in other parts of Egypt
likewise : for in various parts we have sent out the fillahs to beat about, not the bushes, but the villages, for
ten or fifteen days successively, who never fail to bring home either statues, idols, images, medals or
intaglios ; but in the Upper parts the racolta has usually been more scanty than here at Alexandria.
About two years ago, a couple of Arabs digging somewhat deep in the ruins, upon some occasion or other,
sound two urns, containing to the value of 30 000 sequins in golden medals, and antient gold coins. But the
fellows being so imprudent as to discover the secret, the commanding officers of the town eased them of the
major part of it.
This, one would think, should be esteemed a good earnest, and a great temptation to continue on in
ransacking and torturing the (p. 417) bowels of the earth throughout the old ruins and as deep as to the
vaulted roofs of the cisterns ; and in all likehood their pains and expence would be well recompensed by a
discovery of immense treasures. But in fact this enstance of good luck seems to have had little or no
influence upon them for they continue equally supine and indolent as before. But perhaps the tyranny and
usurpation exercised by the commanding officers of the town, towards the two fellows who sound the
treasure we have mentioned, may have discouraged them and others from searching any farther. Indeed, ’tis
not to be questioned but people might sind great treasures in the places where the ancient cities of Thebes,
Memphis and Heliopolis stood would they make a diligent and due and search after it. But whether it be that
the materials of those cities have been removed by succeeding ages, or that they have been dissolved by
the successive inundations of the Nile, or that they are overwhelm’d and buried by annual accretions of the
soil, as at present sind no traces or vestiges of them remaining except some of their temples, Obelisks, etc.
’Tis yet a thing in dispute, (and perhaps will always remain so) which were the more antient people, the
Egyptians or the Chaldeans. But it is past all doubt and dispute, that the Egyptians incomparably surpassed
the Chaldeans in the invention and culture of Arts and sciences, as well as in Power, Grandeur, Splendor
and Magnificence. For it some few of the antients travelled into Chaldea to get the tincture of astrology, (in
which science the Chaldeans were very early procisients and great adepts) we learn from history that almost
all the ancient sages of Greece, down to Socrates, travelled to Egypt, there to inform themselves of and
instruct themselves in the theology, philosophy, polity and history of those people ; and next to that to view
and consider their magnificent stupendous works. And though Socrates was an exception to a general
custom, that had long prevailed, yet many celebrated persons, both Greeks and Romans, continued to do it
after his Æra.
Alexander the Great, who (as Quintus Curtius relates of him) joined a strong passion for letters and Antiquity
to a boundless ambition of usurping the sole dominion of the universe, and conceived a strong desire to visit
the remotest consines of Egypt, and to penetrate even into the sultry regions of Ethiopia. And after his
example, Germanicus, a prince of great knowledge and sagacity, and of very shining accomplishments,
undertook a voyage to Egypt from a like motive.
Germanicus travelled as high up as Thebes, to view the glorious and illustrious remains of that so samed
city ; and as he was viewing and considering the obeliks, cover’d all over with hieroglyphics, (p. 418) he
ordered some of the oldest amongst the priests (whom he supposed to be the most knowing) to expound the
meaning of those antient characters to him. And this being accordingly done, he learnt by the explanation,
that at that time those monuments were erected, the city of Thebes contained 700 000 men fit to bear arms.
They likewise set sorth the conquests and atchievements of the ten reigning prince who conducted this
mighty army, the tributes which the vanquished nations paid him, the quantities of silver and gold, the
number of arms, horses, etc. And hence we may infer and conclude, that, the Egyptian obelisks were
designed and used, in part at least, as their archives, or as the records of the cities, respectively, where they
were erected. We must, however, except some particular obelisks from that intent and use ; as their
hieroglyphics can’t possibly be interpreted into any other signification, than those of theology and philosophy.
Nobody will deny, we fancy, or even dispute, that the antient sages of Greece were highly meritorious and
praiseworthy, in the pain they took of travelling into Egypt, there to instruct themselves in the polite Arts and
Sciences of that country, with which they enriched their own, at their return thither. But their merit, and their
claim to praise extented yet further ; for they, with great industry and pains, (assisted by very great and
happy talents) superadded to what they had observed and learn’d, by instituting certain opinions, systems,
and laws, which perhaps may not improperly be styled the fruits of those seeds which that had imbid’d in
Egypt, and were, by their additions and improvements, better calculated for, and adapted to, their own
people and clime. Thus, to mention one instance only. They borrowed, ’tis true, the notion and doctrine of
transmigration from the Egyptians. But then, after having transplanted it into Greece, (their own country) they
greatly improved and exaclted it, by adding a moral superstructure to a basis which was purely natural. For
so the antient Egyptian notion and doctrine of the metempsychosis is generally interpreted to emply no other,
nor more, than a natural gradation or peregrination of the soul through various beings or bodies of the
aereal, terrestrious and aquatic kinds, ’till, after a certain revolution (by them determined) of years, it should
reassume a human body. In like manner, though they retained no less than 12 of the primary Egyptian Gods,
yet they superadded many of their own inventing (though of subordinate rank and dignity) to the celestial
class.
As to architecture and statuary, though they could neither equal nor imitate the Egyptians in those
particulars, yet, having converted with those people, they so far enriched their own minds and ideas,
(p. 419) that they were the first people who instituted the rules and canons of architecture ; and have
excelled all other people (their masters excepted) in the excellency of performance.
It is recorded of Thales, the first Grecian philosopher of note, (who held and taught that water was the
universal principle of all things) that he had no other master or tutor than his travels into Egypt ; where he
imbided all his learning and knwoledge, by converting with the priests, who were the depositaries of it.
The antient Pelusians did (amongst other whimsical, chimerical objects of veneration and worship) venerate
a fart, which they worshipped under the symbol of a swelled paunch.
Having now brought our observations and remarks on the kingdom of Egypt, to a final period, we shall here
give the cuts of such images, urns, icunculæ, etc. as we have collected in that part of our travels. »
- 650 - 654 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
LEANDRO DI SANTA CECILIA COTTALOURDA (du 21 août au 1er septembre 1746)
Santa Cecilia Cottalourda, L. di, Mesopotamia, ovvero, Terzo viaggio di F. Leandro di Santa Cecilia,
Carmelitano scalzo, in Oriente. Scritto dal medesimo, e dedicato à sua Altezza Serenissima, il Principe
Pietro Leopoldo, Arciduca d’Austria, Rome, 1757.
Leandro, né en 1704 à Breglio, est carmélite déchaussé. Il entre à vingt ans au noviciat de Santa Maria della
Scala à Rome et reçoit le nom de Santa Cecilia. Il effectue plusieurs voyages dont un, de 1734 à 1746, qui
le conduit en Perse. En 1758, il est nommé prieur du couvent de Malte et y séjourne jusqu’en 1762. Il meurt
en 1784.586
p. 4-7 (tome III) :
« All’ottavo giorno di nostra navigazione scoprimmo gli alti Monti di Candia, ed ad decimo entrammo
felicemente nel Porto di Alessandria. Quivi prima di por piede a terra summo spettatori d’un assalto dato da
un Vascello Inglese ad una Nave Francese, la quale con destrezza mirabile voltando bordo, venne a
ricoverarse sotto il Cannone della Fortezza, (p. 5) nelle mura di cui giunsero le palle dell’Artigliera Inglese,
che poco danno recarono al Naviglio, il quale a tempo sostratto erasi da quel pericolo.
Non ha la nuova Città d’Alessandria cosa, che meriti particolare descrizione, essendo assai piccola, e mal
disposta. Il moderno castello non è molto forte benchè sotto di esso siavi uno scoglio, da cui se non sanno
ben riguardarsi i Nocchieri, nell’entrare nel Porto vengono sovente a ricevere gravissimi danni. Presso il
mentovato Castello vi sono alcune poche case, che si stendono verso Oriente, e fino alle rovine della Città
antica, in mezzo alle quali veggonsi le vestigia d’un diroccato Palaggio, che dicono fosse di Cleopatra per
una smisurata Piramide, che giace ad esso vicina. Le mura della Città conservano in alcuni luoghi l’antica
loro magnificenza, benchè continuamente battute dall’onde del mare : e conservansi ancora due chiese, in
una delle quali vedesi il sepolcro vuoto, in cui giacevano le ceneri di S. Marco Evangelista, trasportate dai
Veneziani nella loro Metropoli ; e nell’altra venerasi la Colonna, sopra cui dicesi esser stata decollata
S. Caterina Vergine, e Martire Alessandrina.
A questa gloriosa Eroina di Nostra Santa Fede rinovammo Noi l’offerta del nostro viaggio, e di cio, che
andavamo ad imprendere, poichè sotto il dilei valevole patrocinio l’avevamo già posto prima della nostra
partenza da Roma ; e la supplicammo impetrarci da Dio quello spirito, da cui Essa animata confuse, e vinse
non meno gli errori, che le forze dell’Idolatria. Fuori dei recinti dell’antiche mura stà ancora eretta sopra
ampia base un’alta Colonna, che chiamano Pompejana, perchè inalzatavi in memoria di Pompeo Magno, e
sparsamente altre inferiori se ne veggono, la maggior parte rotte, che è fama servito avessero per la
construzione dei Tempi di Serapide, e di Giove Ammone ne’ tempi de’ Gentili. Fra quelle rovine trovansi
molte rare antichità, e poco tempo prima, che noi vi giungessimo, un Arabo Beguino aveva ivi trovate alcune
staffe d’oro Massiccio, (p. 6) capaci da tenervi dentro tutto il piede a guisa di scarpa, aperta pero da capo, e
da fondo. In mano d’un Mercadante Francese viddi un bel medaglioncino d’oro coll’immagine di Pescennio
Negro, da lui destinato al Museo del Duca d’Orleans ; siccome in mano d’alcuni altri varie gemme di
considerabile valore, e bene intagliate. La gente, che abita el paese, è mista d’ogni Nazione, e per lo piu
sono forastieri, che vanno, e vengono per cagione di mercatura.
Da molti anni s’aggira in que’Contorni un Santone di statura assai molto ben complessionato ; aveva costui,
quando io colà passai, 45 anni di età, ed erasi acquistata tanta stima, e venerazione, che ogn’uno lo
rispettava, benchè incredibili fossero le dilui scelleratezze. Camminava di tutti i tempi affatto ignudo, e nella
state piu infuocata esponevasi in luoghi visibili a sedere sotto la sferza de raggi del Sole, e qual sozzo
animale ravvolgevasi fra le arene cocenti senza ritrarne alcun nocumento. Entrava Egli per tutte le case, che
a lui parevano atte a poterlo ben sattolare, ed in esse si faceva lecito di commettere ogni piu laida azione : e
quantunque alcuni anni prima fosse stato ferito con un colpo di cangiare da un Turco, che l’aveva trovato a
far oltraggio alla gente di sua famiglia, con tutto cio era allora assai rispettato ; posciachè, essendo stato per
le sue iniquità esiliato dalla Città per ordine del Mufti, convenne richiamarlo, mercecchè nel tempo del dilui
esiglio, non avendo mai el Nilo inondate quelle campagne, non avevano esse prodotto alcuna sorta di Biada,
o di frutta ; ed Egli su cosi superbo, che non volle tornarvi, finchè quella gente illusa da suoi prestigi, non
gl’usci incontro in processione, e non lo supplico a tornarvi, accompagnandolo con molte lodi della su
Santità, e con condizione di fabbricargli una sontuosa Moschea, in cui debbe esser sepolto dopo la sua
morte. Iddio in pena della sozza vita dei musulmani di Egitto, permesso aveva, che tornato appena questo
scelerato in Alessandria, fecondate fossero quelle Campagne, in maniera (p. 7) che compensarono con il
loro frutto alla sterilità, la quale avea continuato nei tre anni, che n’era Egli stato lontano : cosa che io non
avrei mai creduta, se da molti Cristiani, e da persone Religiose non mi fosse stata contestata. Quindi non
dee recar meraviglia, se tal forta d’Uomini viene in quelle parti da gente barrara venerata, giacchè con arte
Diabolica, (permetendolo Iddio,) resti illusa, e crede esser vero miracolo quello, che è operazione dello
Spirito Maligno, da cui sono tutti i Santoni da me veduti manifestamente assistiti, ed agitati ; alla maniera
stessa degl’Antichi Vati, e Sacerdoti Gentili, de quali fanno menzione ali Storici, ed i Poeti di que’ tempi.
Abbondano quelle Campagne di Volatili, e specialmente di Quaglie, e di Beccafichi, per parlare i quali usano
quelle genti alcuni Crivelli pieni d’arena, in cui immergendoli, tanto li squotono, che restano affato senza
piume, e bianchi, come se fossero d’Alabastro. Gl’Ebrei hanno gran dominio nella città, e nel Porto, ove
tengono l’affitto delle Dogane, che rendono loro gran scrutto per la quantità de Negozianti, che del continuo
vi approdano. Noi ci trattenemmo ivi quindici giorni, allogiati dai Padri Minori Ossevanti di Terra Santa, e
vedemmo giungervi uno dei quaranta quattro Bei, (che Signori Duchi sono nel Gran Cairo,) inseguito da
molti di partito contrario, i quali gl’avevano sempre tenuto dietro con armi da fuoco, e gl’avevano uccise non
so quante delle sue genti, che in quella sua suga l’accompagnavano, rifuggiandosi nel Castello di quella
Città. »
586 Toselli, J.-B., Biographie niçoise ancienne ou Dictionnaire historique, t. I, Marseille, 1973, p. 222-223.
Piastra, W., Dizionario biografico dei Liguri, vol. 4, Gênes, 1998, p. 892.
- 655 - 656 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CLAUDE-LOUIS FOURMONT (du 25 octobre au 15 novembre 1747)
Fourmont, C.-L., Journal de mon voyage d’Egypte, Paris, Bnf, Ms. fr. 25289.
On lit à l’entête du manuscrit : « Cette relation paroit être de Claude Louis Fourmont, sur lequel on peut
consulter la biographie universelle. (Reinaud) ».
Neveu de Michel Fourmont, orientaliste, arabisant et sinologue, Claude-Louis Fourmont, né à Cormeilles en
1713, s’applique également à l’étude des langues orientales. Au retour d’un voyage au Levant avec son
oncle, il est attaché comme interprète à la bibliothèque du Roi. Protégé par l’abbé Bignon, il s’embarque en
octobre 1746 à Marseille à destination du Caire en compagnie du consul de Liancourt. Se considérant
comme chargé d’une mission officielle, il se plaint de ne pas avoir été consulté pour l’envoi de l’abbé
d’Orvalle. Le consul de Liancourt prétendit au contraire que seul l’abbé d’Orvalle avait ordre de faire des
recherches en Égypte et décide Claude Louis Fourmont de remettre à l’abbé d’Orvalle le catalogue des
manuscrits arabes de la bibliothèque royale que lui avait confié l’abbé Bignon. Claude-Louis Fourmont
réside au Caire pendant trois ans et en profite pour étudier la langue arabe et acquérir quelques notions des
langues copte et persane. Il fait aussi le lever topographique de la région des pyramides et de la plaine
d’Héliopolis. Rappelé en France en 1750, il revient en rapportant une dizaine de manuscrits arabes. Il meurt
en 1780.587
p. 12-16 :
« La journée du 25 8bre 1747 nous vîmes la ville d’Alexandrie à 5 heures du matin. Nous nous en
approchâmes assés pour en distinguer les Châteaux qui sont à l’entrée du port, les mosquées et même les
maisons. Le vent du sud este qui nous poussoit violemment à la côte ne nous permettoit pas d’y arriver. Le
capitaine Suedois n’avait jamais fait le voyage. Il connossoit seulement la difficulté d’entrer dans ce port ce
qui luy fit prendre le parti de virer pour la seconde fois. Nous eûmes bientôt perdu la ville de vue, nous
continuâmes cette bordée depuis six heures du matin jusqu’après midy. Le vent etant venu meilleur, nous
mîmes le cap vers la ville que nous aperçumes deux heures après pour la seconde fois. Mr Tassin pour lors
vice consul à Alexandrie et toute la Nation françoise qui y etoit établie avoit apperçu dès le matin le pavillon
blanc que nôtre Capitaine a arboré au Mât de Misene. Il envoyerent donc sur le ? un canot avec des pilotes
côtiers pour nous conduire dans le port. Mois comme ces derniers nous vîrent virer de bord ils se retir,
cependant Mr Tassin ne cessa d’observer nôtre Course il nous vit enfin reparoître sur les trois heures du
soir. Il depêchent de nouveau les mêmes Pilotes qui nous joignirent vers les six heures et menerent
heureusement dans le port avec le pavillon blanc que le consul ou des vaisseaux de Roy qui ayant ce
privilege. Nous n’eûmes pas plus tot jetté l’ancre que Mr Tassin vint envoyer le capitaine Fournier pour
complimenter le consul de sa presence sur la bonne arrivée. Un moment après le Chancelier accompagné
de Mr Chassin premier Droquemont vinrent aussi de la part du consul qui nous envoya des
rafraichissements. Nous eumes beaucoup de plaisir de voir des dattes fraiches, et nous en eumes bien
davantage, des figues bananes, ces fruits sont ce qu’il y a au monde de plus delicieux, les dattes forment le
goût des confitures les plus parfait et la figues Banonneceluy du moins Beurre de journee sucrée. Les
compliments ordinaires finis, le consul demanda qu’il y avoit rien de nouveau. Nous apprîmes avec du ? que
le Caire etoit en combustion, que les puissances avoient de grands differents entre elle, que dans ce trouble
que plusieurs têtes avoient été coupées, mais ce qui nous rassura c’est qu’ils ajouterent que malgre ces
dissentions et les meurtres qui se commettent tous les jours dans cette ville les francs y jouissaient d’une
parfoite tranquilité, que ces querelles ne regardent uniquement que les puissances du Pais. Le lendemain
26 8bre 1747, les exacteurs de la Nation françoise accompagne le Chancelier et du premier Droqueman se
rendirent abord de notre vaisseau pour le complimenter et ensuite l’accompagner et toutes sa suite, comme
le consul avoit même sa femme et les demoiselles ses filles, il fut convenu quelles descenderoient et se
renderois dès le matin a terre incognito ce qui fut executé il y eu une dispute de politesse, le capitaine
Fournier qui étoit françois qui pretendoit quil etoit de son droit de mettre le consul a terre la chose fut decidée
que ce seroit le consul Suedois qui nous avoit amenés qui nous metteroit a terre le consul descendit dans le
canot Suedois et toute sa suite. Notre capitaine ordonna de tirer quatre coups de canon, le commandant du
chateau fit selon l’usage tirer trois coups de canons mais il les fit tirer a boulets ce qui fut une distinction, plus
de 20 batiments qui etoient pour lors dans le port tant François, Suedois, Hollandois, Malthois, Italiens,
Napolitains, Venisiens, firent leur décharge. Il n’y eut qu’un seul vaisseau anglois qui ne le fit pas parce que
pour lors nous etions en guerre. Le consul arrivé à terre, le vice consul de france accompagné de toute la
Nation françoise qui reside a Alexandrie et des Italiens qui sont sous la protection de France le reçurent et
l’accompagnerent a la douane lieu où toutes les puissances devoient etre rassemblees. Le commandant de
cette ville avoit envoyé des officiers de sa maison, des Fharaches ou valets de pied qui conduisoient cheval
très richement caparaçonné destiné pour le consul com? Il n’y avoit pas loin pour aller au divan, le consul ne
mon? point, etant arrivé au lieu où les grands de la ville l’attendoient, il fut introduit dans un grand salon dans
le fon duquel etoit un magnifique sopha. On avoit mis plusieurs coufins les uns sur les autres a la place
destinée audessus afin quil fut assis a la françoise. Tous ceux qui l’accompagnerent se mirent au dessous
de luy selon son rang et ses dignités. Toutes les puissances du pais se trouverent a cette ceremonie à la
reserve de Hussein et le Cady qui etoient ind? Mais ils envoyerent le lendemain des officiers de leur port
faire leurs compliments et leurs excuses au Consul. C’eux qui s’y trouvoient etoient Ismail Oda Bachi, Aga
de la douane du coprs des Janissaires, Hussan Tchiorbadgi, Serdar des Janissaires, Mehe? Tchiorbagy
Gariani, Serdar des Azaps et Kiaya du Bey d’Alexandrie ou lieutenant de police, Nakib Alla Havaf des
Scherifs, Houssein Bettache Kiaya de la Terfehané, lieutenant de l’Amirauté. Il fut reçu par les puissances
qui trouverent avec toutes les politesses et la décence possible.
Après les compliments ordinaires, plusieurs Chouadars vinrent apporter le café. D’abord ils le presenterent
au consul, et ensuite à toute la suite. Apres le café, le sorbet, les eaux de senteur et enfin les parfums, qui
est l’instant du congé.
Le consul le prit donc et fut conduit et mené à la maison consulaire, de la même façon avec le même
cortege qui l’avoit prit au bord de la mer. La nation françoise qui reside a Alexandrie et le consul entrerent
dans la chapelle ou le pere de Terre Sainte qui dessert la cure fit un discours adressé au consul, dans lequel
il luy representa la necessité de protéger la Religion et le Commerce et enfin tous les interets de la Nation
dans un pais d’infidels ; ensuite on chanta un Te Deum en action de grace. Tous les instruments de la ville
que le pacha avoit envoyé faisoient retentir de toutes part la joye que la Nation avoit de l’arrivée du consul.
Au sortir de l’Eglise, il fut mené dans un appartement qu’on luy avoit destiné. Ensuite il y eut un grand repas,
où tous les principaux de la Nation se trouverent. Après le diné on alla a la promenade, sur les debris de
l’ancienne Alexandrie. Le 27 du mois, le consul reçu la visite de tous les marchands qui sont sous la
protection de France, et celle de quelques marchands Turcs. Le consul de Venise qui étoit incommodé
envoya son chancelier accompagné de plusieurs personnes de la même Nation. L’après diné fut employée a
la visite des jardins d’Ismael Aga.
Le 28 il reçu aussi la visite de quelques juifs qui etoient autre[fois] sous la protection de France, qui font des
affaires de commerce avec nos marchands françois, et celle d’un vieux Turc ami des françois.
On alla a la promenade dans les jardins de Sanseddin ou le Vice Consul avoit eu soin de faire apporter des
rafraichissements. En y allant nous visitames de fort grands debris. Nous y vîmes encore cinq belles
colonnes de granit, et proche de ces colonnes, un fort ancien batiment qui paroit avoir été des bains. Dans
l’etendue d’une ville si fameuse il est surprenant qu’on ne trouve pas plus d’anciens vestiges.
Je l’ay parcouru ensuite dans la vuë dans lever un plan que j’inserrerai icy. Les musulmans et les Turcs qui y
restent ne sont point de l’ancienne. Mr Olivier, Marchand françois me montra un plan mais il n’avoit pas été
levé avec toute l’exactitude que celuy que j’ay levé il y avoit seulement l’ancien port et le moderne assés
bien detaillé.
Le jour suivant, nous allâmes entendre la messe a l’ospice des peres de Terre Ste qui est un quart de lieuës
de la ville, ce sont les capitaines qui habitent cet ospice qui etoient mouillé dans le port vinrent faire leur
compliment au consul.
Après diné, on alla a la promenade, du coté de l’eguille de Cleopatre. Le 30, le consul et le vice consul
allerent diné chés l’exacteur de la Nation. Le repas fut servi en gras et maigre ; on y servi de toutes espece
de poissons. Le dessert fut du plus magnifique ; rien ne fut epargné : les confitures de Gênes, les vins, les
plats rares furent a profution ; on porta les santees de tous les monarques, en particulier celle du Roy et de
toute la famille Royale, celle de Monsieur de Maurepas, après toutes ces santees, on porta celle du
Superieur général de la terre Sainte, et en dernier lieu, celle du Consul. Après le diné, quelques perres
jouerent des instruments et furent accompagne par la voix de Mlle de Lironcourt, qui chanta plusieurs airs
Italiens avec l’applaudissement de toute l’assemblée.
L’après midi on alla voir la Colonne dite de Pompée mais qui est d’Antoine par l’inscription qui s’y lit dont
parle Mr Maillet. Je l’ay copiee ; il est vrai quelle est fort haute, que le tems la rendu frustre, mais on y lit
parfaitement le mot d’Antoine. Nous fumes tous surpris de la beauté de cette colonne ; j’en donnerai icy la
representation de l’inscription. La hauteur du fut, celle du pied d’estal et de son chapiteau.
Après l’avoir visitée, nous allâmes au Kaliche qui n’est pas fort eloigné. Ce Kaliche, ou conduit, est un canal
foit par les princes Egyptiens. Les batiments qui etoient dans le port d’Alexandrie alloient anciennement
jusqu’au tems des Mamelouks. Pour le present, il est tellement negligé quil n’y a pas que de l’eau dans le
tems du debordement du Nil. Les Turcs laissent tout perire.
Le 2 du meme mois, nous allames chés le second exacteur, qui ne fit pas moins bien les choses que le
premier.
Le 3 jour du même mois, plusieurs marchands Italiens, Maronites, Grecs, vinrent rendre visite au Consul, luy
demandant sa protection pour le commerce ensuite nous allâmes sur une terrasse qui parrois avoir été des
decombres de l’ancienne ville, c’est a dire celle que les Sarasins avoient bâtie. De cet endroit on decouvre
très bien l’enceinte de l’ancienne et de la nouvelle ville.
Le 4 le consul alla rendre sa visite au consul de Venise, accompagnés des officiers de la Nation.
Le 5 il rendit sa visite au Consul d’Angleterre accompagné de toute la Nation du Chancelier et des deux
premiers Drogman. De la nous allames sur une autre colline qui est a lorient de la [ville], presque semblable
à la première.
Le 6 toute la suite du Consul accompagné de plusieurs marchands et le vice consul proche d’un [pont] qui
est sur le canal qui va se rendre dans le lac Mareotis qui [n’est] pas eloigné de là ; mais ce lac est rempli de
fange. Le vice consul y avoit fait porté des rafraichissements. La nature nous y presenta un agreable sopha
où nous restâmes jusqu’au soir a l’ombrage de tres beaux palmiers et sicomores, ce qui rendoit des plus
delicieux cette endroit.
Le 15 nous partimes d’Alexandrie pour nous rendre a Rosette accompagné de toute la nation françoise et de
quelques janissaires qui avec nous formoient une cavalcade de plus de 150 personnes. Nous partîmes de la
ville tous montés sur des ânes et des mulets. Le vice consul avoit fait partir la veille les equipages et les
vivres (?) pour la route ; il avoit eut l’attention de faire dresser deux [tentes] a moitié chemin de la Madiée qui
est celle du chemin de la ville de Rosete qui est batie proche de l’ancienne Canope. On nous y servis des
rafraichissements et des viandes de toutes especes.
Le Vice Consul et toute la Nation qui habitent à Alexandrie a l’exception du second Drogman, du Superieur
de terre Sainte et de quelques autres, prirent congé du Consul général ; tout le reste de la Nation
l’accompagnerent jusqu’à Rosete. »588
587 Clément, R., Les Français d’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, Ifao, Le Caire, 1960, p. 189-190.
588 Transcription : archives Sauneron, Ifao.
- 657 - 659 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRÉDÉRIC HASSELQUIST (du 15 au 30 mai 1750)
Hasselquist, F., Voyages dans le Levant dans les années 1749, 50, 51 et 52, Paris, 1769.
Frédéric Hasselquist (1722-1752), naturaliste suédois, est un disciple de Carl von Linné (1707-1778) à
l’Université d'Uppsala. Suite aux travaux de son maître, qui regrette que l’on sache peu de choses sur la
faune et la flore des pays du Levant, il décide de partir pour explorer la région. Une souscription lui permet
d’obtenir une bourse nécessaire au voyage. Au cours de ce périple, il meurt à Smyrne. Ses notes de voyage
sont publiées par Carl von Linné.589
p. 79-82 (tome I) :
« Etant arrivé à Alexandrie le 15 de Mai 1750, la première chose que je fis, fut d’aller voir les jardins de cette
fameuse ville. Je me servis pour cet effet d’une monture que je n’avois jamais connue, savoir, d’un âne dont
les harnois consistoient en une selle arabe & une assez belle bride. Je pris avec moi trois Arabes, dont deux
marchoient à mes côtés & le troisième derrière pour me faire aller plus vîte. Cet animal étoit un des plus
beaux & des plus vifs que j’aye jamais vu parmi ceux de son espèce. Je perdis ici l’avantage que j’avois eu
(p. 80) il y avoit quinze jours, de voyager à cheval. On voit dans l’Egypte mieux que partout ailleurs la bonne
opinion que les Turcs ont d’eux-mêmes & le mépris qu’ils ont pour les Chrétiens, les Juifs & les Maures. La
preuve en est qu’ils ne permettent à aucun de ceux-ci d’aller à cheval, cet animal étant, selon eux, trop noble
pour servir de monture à d’autres qu’aux Musulmans. Il n’y a qu’un petit nombre d’Arabes & de Maures, pour
lesquels ils ont quelque estime, auxquels ils permettent d’aller sur un mulet. C’est avec raison que les
Chrétiens se moquent d’une coutume aussi insensée & il faut convenir qu’elle marque une stupidité
profonde. Cependant, puisque la coutume veut qu’on se serve de ces animaux, loin de les mépriser, on doit
être ravi qu’elle en est introduit l’usage. Il n’y a point de ville au monde où l’on ait plus de commodités pour
aller d’un endroit à un autre, qu’Alexandrie & le Caire. Toutes les rues y sont remplies d’ânes, qui sont au
service de ceux qui ne veulent point aller à pied. Moyennant un, deux ou trois paras au plus, on vous conduit
d’un bout de la ville à l’autre. Ils appartiennent à des Maures, qui en font un (p. 81) très-grand cas ; & il y a
tel de ces animaux, qui leur coûte plus qu’un cheval. Le maître de celui que je montai, me dit qu’il l’avoit
payé 20 ducats & qu’il ne le donneroit pas pour 30, parce qu’il le faisoit vivre. Je m’étois promené à Smirne
dans des jardins remplis de citronniers, d’orangers, de figuiers & de mûriers. J’avois vu des champs entiers
couverts de vignes, traversés de forêts d’oliviers & de cyprès ; mais les choses changent de face en Egypte.
Je trouvai ici dans les jardins d’autres espèces de plantes qu’il a plus au Créateur de faire croître dans les
contrées méridionales, savoir, des palmiers dont l’ombrage me garantissoit de l’ardeur du soleil. Je
questionnai les habitans sur les propriétés d’un végétal que les Botanistes ne connoissent pas encore, dans
le dessein de perfectionner l’histoire qu’on en a donnée. Je les priai de m’apprendre la distinction qu’il y avoit
entre le mâle & la femelle, de même que les moyens dont il falloit se servir pour leur faire porter du fruit ;
mais malheureusement l’interprête françois que j’avois avec moi, m’interrompit & entama un autre discours.
Je m’embarquai le 30 à deux heures (p. 82) du matin sur un petit bateau & arrivai à midi dans un bras du Nil
qui conduit à Rosette, qui en est éloignée de la portée d’un coup de canon. »
589 Dubois, L., « Hasselquist, Frédéric », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie Universelle
ancienne et moderne 19, Paris, 1817, p. 482-484.
- 660 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ABŪ AL-QĀSIM AL-ZYĀNĪ (novembre-décembre 1757)
Pérès, H., L’Espagne vue par les voyageurs musulmans de 1610 à 1930, Paris, 1937.
Abū al-Qāsim al-Zyānī naît à Fès en 1734-1735. À la fin de ses études, il accomplit le pèlerinage à
La Mecque en compagnie de son père. Pour cela, ce dernier doit vendre deux maisons qu’il possède à Fès
et un grand nombre de livres. C’est parmi ces livres qu’Abū al-Qāsim al-Zyānī repère un carnet qui contient
la généalogie de sa famille. Cette découverte lui donne le goût des recherches historiques et généalogiques.
Par la suite, il entre dans la vie publique et devient secrétaire de gouvernement. Il est désigné comme
ambassadeur auprès du sultan ottoman à Constantinople. Abū al-Qāsim al-Zyānī jouit d’une grande
renommée littéraire au Maroc au XVIIIe siècle. Il est l’auteur d’une relation de voyage (Riḥlat al-Ḥarrāq
li-muṣāhadat al-buldān wa al-afāq) qui s’apparente plutôt à un traité de géographie. Le récit de son passage
à Alexandrie se trouve dans le manuscrit intitulé : Turgumāna al-Kubrā (Rabat, Bibliothèque du Protectorat,
D659).590
p. 18 :
« Alors que nous étions sur le point de partir du Caire, nous apprîmes la mort du sultan ‘Abd Allāh au mois
de rabi` I 1171 (nov.-déc. 1757) ; nous déscendîmes à Alexandrie ; mais les navires que nous y trouvâmes
étaient empêchés de partir à cause de la guerre qui mettait aux prises les Français et les Turcs d’une part et
les Anglais d’autre part ; aucun départ ne pouvait s’effectuer pour se rendre en pays arabe [de l’Afrique du
Nord] par crainte des pirates.
Nous nous dirigeâmes, sur un vaisseau français, vers Livourne où nous restâmes quatre mois… »
590 Salmon, G., « Un voyageur marocain à la fin du XVIIIe siècle. La rihla d'Az-Zyany », ArMar II/3, 1905,
p. 330-340.
- 661 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
VITALIANO DONATI (du 18 juillet au ? 1759)
Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 429-615.
Vitaliano Donati, né à Padoue en 1717, obtient un doctorat en médecine en 1739 à l’Université de cette ville.
Il passe sa jeunesse à voyager dans la péninsule italique et à l’étranger où il recherche et collecte des
spécimens naturels. Il acquiert ainsi une reconnaissance qui lui ouvre le poste de Professeur d’histoire
naturelle à l’Université de Turin en 1752. En tant que naturaliste s’intéressant aux antiquités, il est choisi par
Charles Emmanuel III, roi de Sardaigne et duc d’Aoste, pour diriger une expédition dans le Levant ainsi
qu’en Arabie et en Inde en 1759.591 Le récit de Vitaliano Donati n’a jamais été publié, son manuscrit est
conservé à Turin, Biblioteca Reale (Man. Varia 291-293 et 307) sous le titre de : Giornale di Viaggio fatto in
Levante nell’anno 1759.
Remarque : ci-dessous, le récit de Vitaliano Donati est présenté incomplètement. L’extrait publié en italien
par Giacomo Lumbroso a été partiellement traduit en français par Oleg Volkoff592.
p. 498-500 :
(p. 498) Tratando dunque di Alessandria, l’autore parla « del mare accresciuto di superficie e del terreno in
alcun luogo da lui trovato di 20 piedi in circa accresciuto dalle ruine. Non crede pero che Alessandria
anticamente si ritrovasse fabbricata sopra un terreno affatto piano, poichè vi sono anco delle colonne (la
grossezza ed il peso delle quali ci fa credere che sopra alta fabbrica non dovessero essere piantate), delle
quali tutto il piedestallo è scoperto. Al di là del Castel Vecchio verso Levante si trovano due pavimenti coperti
dalla terra, l’uno fatto tutto di plache di marmo, l’altro di rottami di marmo similissimo a’ nostri terrazzi, e tali
pavimenti sono al disopra del livello del mare da un uomo in circa. Al di sotto pero de’ medesimi pavimenti vi
sono ruinazzi in grandissima quantità, e non già terreno virgine. Sulla medesima costa osservo quattro piani,
o sterniti l’uno sopra l’altro, ed il più basso superiore si ritrova al comune del mare da due piedi in circa. Vi è
pure una fabbrica, che rappresenta una capella, il di cui pavimento non di raro ritrovasi coperto dal mare
(I p. 18 e segg.) ». A proposito della cosidetta colonna di Pompeo (p. 7) egli osserva che « il capitello non è
lavorato con molta esattezza, e pottrebe essere dei tempi di Pompeo, non lo (p. 499) nega, ma sembra di
lavoro assai più conveniente all’età più bassa, o del principio della declinazione delle arti… Gli Arabi tutti
sono persuasissimi che sotto quella colonna vi sonno delle ricchezze immense, e però fecero tal cava nel
piedestallo vicino a terra, che non so come non sia scrollata quella gran macchina. Una tale cavità poi fu
riempita per ordine d’un comandante Turco. In poca distenza della colonna di Pompeo verso Levante vedesi
(p. 59) la testa d’una colonna sepolta del diametro di quella di Pompeo ». –Più sotto (p. 49-58) l’a. descrive
le catacombe degli antichi vicine alla colonna di Pompeo scavate nella pietra arenaria, e questa minuta
descrizione è seguìta (p. 57) dalla « spiegazione de’disegni », i quali mancano. – « Li vestigi del Palazzo
detto da alcuni di Cleopatra, da altri di S.ta Caterina sono mura grossissime… Questi sono lontani dal mare
di mezz’ora di cammino andate, e si ritrovano in poca distanza del tempio di S. Atanasio ora ridotto in
Moschea. Per rovine di tale Palazzo prese Le Bruyn un pezzo di fabbrica de’tempi de’Saraceni, che sta alla
marina. In vicinanza alle rovine, che si dicono del Palazzo di Cleopatra, o di S.ta Caterina vi sono due
colonne piantate su i loro manca il rapporto, che avere dovevano anticamente, come si conosce dall’essere
il piedestallo molto più ristretto di quello sia la base posta sopra il medesimo piedestallo. La base è lavorata
d’ottimo gusto, ed è di marmo greco venato. Le colonne sono di dienite o granito rosso e portano capitelli di
pietra numismale priva di qualunque ornato grezzi affatto, e con alcuni fori all’intorno, quali essendo
somigliantissimi a quelli che si fanno per rapportarvi il capitello di bronzo, non dubita che antichamente non
sieno pure stati coperti da’ rapporti di bronzo. Oltre alle dette colonne altre quattro se ne ritrovano in piedi
poste alla stessa linea, ma in buona parte sepolte. … In un giardino vi sono due colonne della grandezza
delle mentovate, lunghe piedi 27.4, grosse p. 3 con basi di granito, sono gittate a terra… Altre si ritrovano
sparse qua e là nelle rovine… Poche sono le scavazioni che si vanno facendo nelle quali non si scopra
qualche colonna. Queste nel sommo numero sono di sienite, alcuna se ne ritrova di porfido, altre molte ne
sono di marmo greco venato, e ne vide ancora alcuna d’alabastro, e d’africano, ma queste sono rarissime.
La grande abbondanza di colonne di questa città viene pure provata da tronchi… che in gran numero sepolti
si trovano nelle mure della città in modo che solo per testa compariscono. Case inoltre de’Turchi vi sono non
poche, che hanno portici, o volte sostenute da colonne pure antiche. I Turchi miseramente rompono quelle
colonne più grosse che vanno scoprendo per farne delle macine (pp. 8, 13) ». –« La chiesa di S. Marco
(p. 9) ha qualche pezzo di pavimento di bei marmi, e lavorato sul gusto ottimo antico » ; « oltre del detto
pavimento vi è un’iscrizione greca » che il Donati dice qui d’aver copiata, ma non si trova nel presente
manuscritto. –« La chiesa di S. Anastasio ora ridotta in Moschea è la più bella fabbrica d’Alessandria.
Questa ha quattro porte… ed a ciascheduna porta vi sono due colonne di marmo greco venato con loro basi
e capitelli. Le basi sono ben lavorate ma ad un tale lavoro non corrispondendo i capitelli assai rozzi, e
lavoratori d’un gusto barbaro oppur saraceno, ciò fa conoscere che le basi furono prese da altre fabbriche, e
che non sono di lavoro contemporaneo. Tutta questa chiesa è incrostata di marmi greci venati bardigli
alabastri, quali incrostature in buona parte sussistono al fianco di mezzogiorno (p. 11 : pianta della
(p. 500) chiesa di S. Anastasio ora Moschea con quattro navate a mezzogiorno, e due che scorrono tutto
all’intorno). Dicono gli Ebrei che questo tempio anticamente sia stato da loro fabbricato (p. 9-12) ». –A
p. 15 e segg. E data la descrizione delle antiche cisterne fatte a più camere (con due figure). –In fine è
notevole questa osservazione : « Non vi è sicuramente paese veruno, in cui si faccia ricerca d’antichità con
maggiore diligenza di quella s’usa in Alessandria (p. 23), conciosiachè molti Arabi quivi sono, che scavano
sotterra buchi profondi a guisa appunto de’canapi nelle miniere, da quali estraggono la terra, e questa con
crivelli viene passata, nel qual lavoro sono sì diligenti che non perderebbero una pietra della grossezza d’un
grano di frumento. Tale è l’esattezza loro nella ricerca perchè sovventemente ritrovano qualche rubino,
smeralde, o perla, o altra gemma oltre delle pietre intagliate che non sono assai rare ; bene è vero però che
tra moltissime che io ne viddi, appena ne ritrovai alcuna di sufficiente bellezza. Vendono le antiche
particolarmente ai capitani di vascello, o altri forastieri da quali vengono loro pagate dieci volte più di quello
meritano. A quest’ora credo poco terreno vi sia in Alessandria qual non sia stato passato sotto il lavoro degli
Arabi, e però è sommamente difficile il ritrovare statue, o altre antichità di qualche merito. Gli escavatori
benchè miserabilissimi, perchè un giorno sull’ altro, lavorando continuamente, appena potranno guadagnarsi
tre medini, pure (come gli artefici ecc.) hanno il loro capo, dal quale dipendono, ed a cui consegnano tutto
ciò che ritrovano perchè egli ne faccia la vendita ».
Traduction partielle de O. V. Volkoff :
« Au-delà du château vieux, vers le Levant, se trouvent deux pavages recouverts de terre, l'un fait
entièrement de plaques de marbre, l'autre de fragments de marbre, semblables à nos terrasses. De pareils
pavages sont au-dessus du niveau, environ [à la hauteur] d'un homme. Toutefois, au-dessous de ce même
pavage, il y a des ruines en grande quantité, et non pas tout de suite de la terre vierge. Sur ce même côté, je
remarquai quatre étages (?) ou plates-formes, l'une au-dessus de l'autre ; l'inférieure se trouve à environ
deux pieds [au-dessus du niveau de la mer] (?). Il y a aussi un bâtiment qui représente une chapelle, et dont
le pavage est souvent recouvert par la mer. »
« Dans un jardin, il y a deux colonnes, de la grandeur de celles qui ont été mentionnées, longues de
27,4 pieds, et grosses de 3 pieds, avec des bases de granit. [Elles] gisent à terre (…). D'autres se retrouvent
éparpillées çà et là parmi les ruines (…). Peu d'excavations ont été faites sans que l'on découvre quelque
colonne. Celles du plus grand nombre sont en syénite, [mais] on en trouve en porphyre, beaucoup d'autres
sont en marbre grec veiné ; on en voit encore en albâtre, et en africain (?), mais celles-ci sont très rares. La
grande abondance des colonnes de cette cité est encore prouvée par les troncs [de colonnes] qui se
trouvent dissimulés en grand nombre dans les murs de la ville, de façon que seule la tête apparaît. En outre,
bien des maisons de Turcs ont des portiques ou des voûtes, soutenus par des colonnes antiques. Les Turcs
pauvres brisent les colonnes plus grosses qui sont découvertes, pour en faire de meules (…) »
Donati décrit l'église de St Marc, dont certaines parties du pavage sont en beau marbre. À part le pavage
mentionné, il y a une inscription en grec, mais celle-ci ne se trouve pas reproduite dans son ouvrage.
« L'église St Athanase, maintenant transformée en mosquée, est le plus beau bâtiment d'Alexandrie. Elle a
quatre portes (…) et à chacune des portes, il y a deux colonnes de marbre grec veiné, avec leurs bases et
leurs chapiteaux. Les bases sont assez bien travaillées, mais à ce travail ne correspondent pas les
chapiteaux [qui sont d’un travail] assez grossier, façonnés dans un style grec barbare ou même sarrasin ;
ceci montre que les bases furent prises d'un autre bâtiment, et ne sont pas d’un travail contemporain. Toute
cette église est incrustée de marbre grec blanc, veiné de bleu (…). Les juifs disent que ce temple fut jadis
bâti par eux. »
« Je crois que, actuellement, il y a peu de terrains à Alexandrie qui n'ont pas été passés au crible par les
Arabes, et c'est pourquoi il est extrêmement difficile de retrouver des statues ou d'autres antiquités de
quelque valeur. Les fouilleurs, bien que très pauvres, car travaillent un jour après l'autre, continuellement,
peuvent gagner à peine trois médins, ont pourtant un chef dont ils dépendent et auquel ils remettent tout ce
qu'ils trouvent, pour qu'il se charge de la vente. »
591 Almagià, R., L’opera degli Italiani per la conoscenza dell’Egitto e per il suo risorgimento civile ed
economico, t. I, Rome, 1926, p. 78.
A. Scattolin Morecroft, « The Vitaliano Donati Collection at the Turin Egyptian Museum », The Journal of
Egyptian Archaeology 92, 2006, p. 278-282.
592 Volkoff O. V., Alexandrie vue par les voyageurs du passé, Le Caire, 1981 (Tapuscrit conservé à l’Ifao et
au CEAlex).
- 662 - 664 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CARSTEN NIEBUHR (du 26 septembre au 31 octobre 1761)
Niebuhr, C., Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins, Amsterdam, 1776.
Carsten Niebuhr naît en 1733 dans le duché de Lauenbourg (Allemagne). Ses parents sont des paysans
aisés. En 1753, il part à Hambourg pour y étudier la langue latine et pour y suivre les cours du gymnase
pendant huit mois. Il y séjourne un an de plus pour recevoir des cours de mathématiques. En 1757, il entre
dans le corps des ingénieurs hanovriens. En 1758, le gouvernement danois lui propose de faire un voyage
en Arabie. L’expédition, en route le 7 janvier 1761, est composée de cinq personnes devant se rendre
d’abord à Alexandrie, puis au Caire, au Mont-Sinaï et de là, en Arabie Heureuse jusqu’en Perse. Tous les
compagnons de Carsten Niebuhr meurent au cours de ce voyage. Il retourne à Copenhague en 1767. Il
meurt en 1815.593
p. 34-43 (tome I) :
Observations faites à Alexandrie
« La ville d'Alexandrie, ou Scanderîe, comme disent les Arabes & les Turcs, est située sur une langue de
terre, entre une presqu'isle & les anciennes murailles de la ville, & entre les deux ports, à 31°, 12', de
latitude. Le terrain, sur lequel cette ville est bâtie, est si bas, que l'on diroit, que la plus grande partie en a été
anciennement submergée. Cependant les mosquées, les tours de ces temples, quelques grands édifices,
les restes des anciens murs, la colonne Pompée, l'obélisque de Cléopatre, et les palmiers, donnent de loin
une belle apparence de la ville, envisagée sous le point de vue, qu'elle offre, quand on y (p. 35) aborde en
venant du côté de l'Europe. J'ai déjà remarqué, que le port ancien est vaste, profond & sûr. Le nouveau au
contraire, où tous les vaisseaux venant de l'Europe sont obligés de mouiller, est déjà presque impraticable,
& le devient de jour en jour d'avantage. Le fond en est si plein de pierres. Quelques ruines d'un grand
édifice, qui semble avoir été bâti, pour ainsi dire, dans ce port, sont peut-être les débris du Timonium
d'Antoine. Il y a d'ailleurs encore dans les environs plusieurs ruines d'anciennes murailles, des colonnes
brisées & de grosses pierres. Mais ces endroits remarquables & plusieurs autres encore, dont les anciens
auteurs font mention, sont également changés, que je n'y ai pu reconnoître que très peu d'objets, d'après les
descriptions de ces auteurs. C'est ce qui m'oblige de renvoyer à d'autres écrivains, & particulièrement à
Pocock, qui a tout examiné avec beaucoup de soin & d'intelligence, ceux, qui s'attendent à trouver ici de plus
amples relations.
Devant la nouvelle Alexandrie & ses deux ports est une grande presqu'isle, dont la partie occidentale, qui est
devant le port ancien, s'appelle à présent Râs et tîn. Je n'y ai rien vu de remarquable, sinon un petit fort, qui
n'est qu'une masure, une saline & beaucoup de figuiers, dont cette partie de la presqu'isle emprunte sa
dénomination. A l'extrémité orientale de la presqu'isle & devant le nouveau port est un fort, où il y a une
garnison de 500 Janissaires ; ce fort est situé sur un petit rocher, & probablement il occupe la même place,
où étoit autrefois le fameux phare. Une digue maçonnée de la longueur de quelques centaines de pas
s'étend depuis ce fort jusqu'à la nouvelle ville d'Alexandrie. Comme la mer donne avec beaucoup de
violence contre cette muraille, lorsqu'il fait un vent de Nord ; on y a pratiqué des arches, afin que l'eau puisse
se décharger dans le port. Vis-à-vis de ce fort, à l'entrée du port, il y a un autre petit fort, situé de même sur
un rocher. De là on passe au continent par dessus une muraille de 15 à 16 cents pas en longueur ; on y a
pareillement pratiqué des arches, afin que l'eau puisse céder, & ne renverse pas la muraille.
On chercheroit envain les indices de l'étendue précise de la ville d'Alexandrie, telle qu'elle etoit lors de sa
fondation ; car les murailles actuelles de l'ancienne Alexandrie ont été bâties par les Sarracins ou les
Arabes, comme il paroît par plusieurs inscription arabes, dont elles sont chargées, par leur structure & par
celle de leurs tours, dans lesquelles on a maçonné horizontalement de belles colonnes de marbre.
L'enceinte des anciennes murailles dans leur état actuel est beaucoup plus petite que celle, que les
Historiens donnent à la grande Alexandrie. Il est vrai pourtant, que ces murailles, bâties par les Arabes, ne
laissoient pas d'être considérables, fort étendues & très hautes. Je les ai trouvées de la hauteur de 43 pieds,
& même de 50, y compris le parapet, (p. 36) c'est à dire près de la porte Raschîd, où l'on en voit encore
toute la hauteur. Mais dans la plupart des endroits elles sont ruinées, & ce n'est que dans quelques-unes de
ces tours que l'on fait encore la garde, ainsi que l'ont déjà remarqué Norden, Pocock & d'autres écrivains594.
Alexandrie n'a pas été abandonné tout-d'un-coup ; mais cette ville est déchue peu à peu, à mesure que ses
habitants ont diminué, ou se sont appauvris. On n'y a laissé des anciens & magnifiques palais que ce qui n'a
pu être transporté & employé à de nouveaux édifices. On a même déterré les pierres, qui servoient de
fondements aux murailles. Ce qui fait, que l'on voit par-tout des monceaux de ruines. Quelques réservoirs
d'eau d'une extême magnificence sont les monuments les plus précieux, qui soient restés de ces anciens
palais. La nouvelle Alexandrie n'ayant d'autre eau fraîche que celle, que lui fournit la pluie & le Nîl ; les
habitants sont obligés d'entretenir autant de ces réservoirs, qu'il en faut pour leur provision annuelle. Voilà
pourquoi aussi ils doivent empêcher, que les canaux, qui portent l'eau du Nîl dans ces réservoirs ne se
comblent entièrement. Quoique le canal, qui sort du Nîl & qui coule près des murailles de la ville, soit
innavigable depuis de longues années ; on ne laisse pas de le nettoyer tous les ans, & on le débouche,
après que le Nîl est monté à une certaine hauteur. De là l'eau est portée du côté de l'Est dans la ville & dans
les réservoirs par un petit canal sous terre ; & quand les réservoirs sont pleins, on dérive l'eau superflue à
travers les anciennes murailles de la ville dans l'ancien port par le moyen d'un petit canal.
Le meilleur morceau de l'Antiquité, qui soit dans l'enceinte des anciennes murailles de la ville, & que les
Mahométans n'ont pu transporter, c'est l'obélisque de Cléopatre. Il est d'un granit dur de couleur rouge, &
tout d'une piece, comme tous les autres obélisques, que l'on a trouvés auprès des palais & des temples des
anciens Egyptiens. Une partie est à présent enfoncée dans la terre : cependant il a encore 61 pieds,
11 pouces de haut, & 7 pieds, 3 pouces de large au rez de chaussée595. Quelques caractères de l'écriture de
Pharaon, dont il est chargé, ont encore un pouce de (p. 37) profondeur. Il paroît par là, que les Egyptiens ont
eu en vue d'immortaliser leurs inscriptions ; & ce n'est pas leur faute, que leurs descendants ne puissent
plus les lire. Norden a donné un bon dessein de cet obélisque596. Il y en a un autre tout près, dont chaque
côté a 6 pieds, 3 pouces de large ; il n'est plus debout, mais renversé & brisé, & en partie couvert de terre.
De tous les temples magnifiques de l'ancienne ville d'Alexandrie il ne reste plus rien, qui mérite d'être vu,
sinon l'église de St. Athanase. Elle est encore très-vaste. On prétend, qu'elle est ornée d'un grand nombre
de belles colonnes, & qu'elle renferme une riche collection de livres grecs. Mais depuis bien long-temps
cette belle église a été changée en mosquée, ce qui est cause, que l'entrée en est defendue aux Chrétiens.
Tout près de cette église il y a quelques colonnes de granit rouge, & tout joignant on voit les ruines d'un
vaste palais.
L'église de Ste. Catherine qui appartient aux Grecs, ne se distingue ni par sa grandeur ni par la
magnificence de l'architecture ; mais elle est remarquable par une pierre de marbre blanc, qui a des taches
rouges. Les moines grecs prétendent, que c'est sur cette pierre, que Ste. Catherine a été décapitée, & que
c'est ce qui en fait le mérite. A les en croire, les taches rouges en font preuve. L'église de l'Evangéliste
St. Marc, qui appartient aux Coptes, est à peu de distance de la premiere. On y montre encore le tombeau
de cet Evangéliste. Les Coptes n'ouvrent plus ce tombeau, parce qu'ils débitent, que la tête de l'Evangéliste
leur a été enlevée par les Vénitiens : tandis que les Catholiques-Romains soutiennent au contraire, qu'ils ont
eu l'adresse de délivrer tout le cadavre de la prison des hérétiques, & que les Coptes leur font tort, en disant,
que les ecclésiastiques romains n'ont pu enlever que la tête du saint. Ils se rappellent encore les prudentes
mesures, qu'on pris leurs frères, pour venir à bout de (p. 38) cette grande entreprise. On dit, qu'ils ont coupé
en pieces & bien empaqueté le cadavre, et qu'ils l'ont fait passer pour du porc, afin d'empêcher que ce grand
tréforme fût découvert à la douane par les Mahométans & les Juifs, & ne leur fût enlevé de nouveau. Il est
effectivement très-difficile d'envoyer des cadavres d'Alexandrie dans la Chrétienté. Les Turcs ont même
défendu l'exportation des Momies ; parce qu'ils estiment, que c'est une vaine curiosité, qui porte les
Européens à vouloir transporter ces anciens cadavres du lieu, où ils devroient reposer. Néanmoins comme
la douane d'Alexandrie est entre les mains des Juifs, il est plus aisé de transporter des cadavres hors
d'Egypte, que de les envoyer en Europe par des vaisseaux italiens. Plusieurs caisses, qui renfermoient des
momies, & que nous avions expédiées pour l'Europe, étoient déjà arrivées à bord en toute sûreté : mais les
matelots voulurent tous quitter le vaisseau, à moins que le patron ne renvoyât ces cadavres de Païens.
Aussi Monsieur Marion, qui s'étoit chargé de faire parvenir nos Momies en Europe, fut obligé de les
reprendre ; & un autre patron italien, qui les prit ensuite à bord, fut obligé de cacher soigneusement à ses
matelots ce que ces caisses renfermoient. La chose la plus remarquable, que l'on montre aujourd'hui aux
étrangers dans l'église de St. Marc, c'est une chaise, que l'on dit être faite précisément de la même façon
que celle, où étoit assis l'Evangéliste en prêchant. Il est encore à remarquer, que quelques Protestants sont
enterrés dans ce temple. Outre la grande mosquée, & les deux églises, dont je viens de parler, on voit dans
l'enceinte des murs d'Alexandrie, bâties par les Sarrasins, un couvent des Franciscains habité, & quelques
mauvaises maisons des Arabes. Tout le reste est désert.
Du temps des Grecs la colonne de Pompée étoit vraisemblablement dans la ville : mais présentement elle
est hors des murailles, & presque à la distance d'un quart d'heure de la ville d'Alexandrie, qu'on bâti les
Arabes. Norden a donné un bon dessein de cette colonne. Comme on ne paroît pas encore bien d'accord
sur la hauteur de ce monument ; j'entrepris de le mesurer à mon tour, & je trouvai, que la colonne entiere
(sans compter les fondements) n'étoit haute que de 88 pieds, 10 pouces597. Ainsi, (p. 39) selon moi, elle
n'est pas à beaucoup près aussi haute, que d'autres voyageurs le prétendent. Cela n'empêche pas, qu'elle
ne soit un admirable morceau de l'Antiquité ; car elle est toute entiere de granit rouge, & cette masse
prodigieuse n'est composée que de trois pieces, qui par cela même ne peuvent qu'être d'une grandeur
immense. Je n'ai pu distinguer clairement que quelques caractères de l'inscription, dont le côté du sud-ouest
de la colonne est chargé. Monsieur de Haven se donna bien de la peine, pour en découvrir d'avantage :
mais il ne put à beaucoup près en reconnoître autant, que d'autres prétendent en avoir reconnus avant nous.
Il paroît, que l'architecte grec n'ait pas voulu immortaliser son nom par cette inscription, ou qu'il n'est pas
connu la nature de la pierre aussi bien que les anciens Egyptiens. Car si les Grecs eussent taillé cette
inscription aussi profondément dans la colonne, que les Egyptiens ont taillé les hiéroglyphes dans les
obélisques ; elle ne seroit pas devenue méconnoissable. D'ailleurs les Anciens avoient coutume de charger
de caracteres les quatre côtés de leurs obélisques ; & l'inscription grecque de cette colonne est précisément
du côté, qui a le plus souffert des injures du temps. Du temps de Norden les fondements au dessous de la
colonne étoient fort endommagés. Dans la suite ils ont été réparés par un certain Mohammed
Tschurbatschi ; mais nous ne saurions en conclure, que la grande colonne repose sur une plus petite,
comme d'autres voyageurs l'ont assuré. Ceci est une preuve, que tous les Mahométans ne cherchent pas à
détruire les antiquités de leurs pays. La vérité est, que plusieurs d'entre eux y cherchent leur profit, & en cela
ils ne sont pas pis que les Européens. Supposé, qu'un homme pauvre trouvât dans son jardin la plus belle
colonne de l'Antiquité ; il en seroit indubitablement des meules, plutôt que de la laisse subsister, sans en
faire aucun usage. Les quatre coins de l'obélisque de Cléopatre répondent à peu près aux quatre coins du
monde. Mais les coins du piedestal de la colonne de Pompée semblent décliner environ de 12 degrés. Il est
donc probable, qu'en érigeant cette colonne, on ne s'est réglé que sur la situation des édifices d'alentour, &
non pas sur un méridien, comme on a fait, en érigeant les pyramides.
Durant notre séjour à Alexandrie, les Arabes rodoient continuellement autour de la ville & parmi les ruines ; &
je ne voulus pas m'exposer au risque d'être pillé, pour lever le plan d'Alexandrie, sur-tout puisque nous en
avons déjà un fort bon, dont nous sommes redevables à Norden. Mais comme de la hauteur, sur laquelle est
la colonne de Pompée, je pouvois voir une grande partie des anciennes murailles de la ville ; je mesurai de
là quelques angles, dans l'espérance d'en pouvoir mesurer d'avantage dans d'autres endroits. L'un des
Marchands turcs, qui étoient présents, & qui avoient remarqué, que j'avois dirigé l'astrolabe du côté de la
ville, eut la curiosité de regarder à travers la lunette ; mais il ne fut pas peu allarmé, en appercevant une tour
renversée. Cela fit courir le bruit, que j'étois venu à Alexandrie, pour boulverser toute (p. 40) la ville. On en
parla chez le Gouverneur. Mon Janissaire ne voulut plus m'accompagner, quand il étoit question de prendre
mon instrument avec moi ; & comme je m'imaginois alors encore, que dans les villes de l'Orient il n'étoit pas
permis à un Européen de paroître en rue sans être accompagné d'un Janissaire, je ne fis plus ici
d'opérations géométriques. Quelques temps après un Arabe, ayant apperçu à Raschid un vaisseau renversé
à travers ma lunette, peu s'en fallut, qu'il ne jettât l'instrument par terre. C'est ainsi que les soupçons des
Mahométans m'apprirent à faire mes observations avec prudence ; j'eus besoin sur-tout d'en agir de la sorte,
aussi long-temps que je ne pus converser avec eux, faute de savoir parler leur langue. Un paysan fort
honnête & discret, du village Daraue, fut présent à une observation astronomique, que je fis sur la pointe
australe du Delta. Pour lui faire voir quelque chose d'étrange, je tournai la lunette du cadran du côté du
village ; & il s'effraya beaucoup, en voyant toutes les maisons renversées. Il en demanda la raison à mon
domestique, qui répondit, que le gouvernement, très mécontent des habitants de ce village, m'avoit envoyé,
pour le détruire. Le pauvre homme s'affligea, & me pria d'attendre, jusqu'à ce qu'il eût mis en sûreté sa
femme, ses enfants & une vache. Mon domestique l'assura, qu'il avoit encore deux heures de temps. Là
dessus il fut en hâte chez lui, & je rapportai mon cadran à bord, dès que le soleil eut passé le méridien. Dans
le fond, il n'y a pas grand sujet de s'étonner de l'ombrage, que ces sortes d'observations donnent aux
Mahométans, quand on considere, qu'il n'y a pas long-temps, que bien des Européens prenoient pour
sortilège tout ce qu'ils ne pouvoient concevoir.
On enterroient autrefois les morts à l'Ouest d'Alexandrie, & on trouve encore dans cet endroit quantité de
tombeaux. Le sol est le même que celui de Malte : c'est une pierre à chaux fort molle, & couverte d'une
légere couche de terre & de sable ; aussi s'apperçoit-on, quand on va à cheval, que le sol est creux en
quelques endroits. A peu de distance de la colonne Pompée, & tout près d'une petite maison de priere, je fus
conduit dans une catacombe, semblable à celle, que Pocock dit être dans cet endroit, et dont il a donné la
description, à cela près, que celle, dont je parle, étoit plus petite. Il y avoit deux chambres l'une derriere
l'autre toutes taillées dans le roc. La premiere avoit de chaque côté 12 cavités, à deux rangs de hauteur.
Chaque cavité avoit 2 pieds & 3/4 de haut, 2 pieds de large, & autour de 6 pieds de profondeur. Toutes ces
cavités avoient indubitablement été destinées à être des cercueils ; & ainsi cette chambre avoit pu servir de
sépultures à 48 personnes. Dans la seconde il n'y avoit un petit enfoncement dans le mur, de 4 pieds de
haut, & de 2 pieds & 1/2 de large. Environ à une lieue d'Alexandrie, mais plus encore à l'ouest, on nous
conduit dans des catacombes beaucoup plus vastes & plus belles. L'entrée en est presque bouchée par des
(p. 41) décombres, & même dans l'intérieur on est quelquefois obligé de ramper, pour passer outre. Dans la
premiere allée on voit au haut quelques cavités dans le roc, qui peuvent avoir été des soupiraux, ou des
places, pour les lampes. De là on passe dans une antichambre carrée, qui a une porte à chaque côté &
quelques foibles ornements d'architecture. Celle, qui est à gauche, differe des autres en ce qu'il y a eu à
côte deux autres petites portes : mais comme les piliers, qui les séparoient de la grande, ont été détruits par
le temps, toutes trois ne forment plus qu'une seule entrée. De ce côté là la chambre est ronde, voûtée par le
haut, & a autour de 20 pieds de diametre. Trois autres petites chambres sont aux trois côtés de la grande ;
elles ressemblent aux anciens tombeaux de Syrie, & à quelques égards aux tombeaux des Rois près de
Jérusalem ; car il y a de-même des cavités aux côtés, où vraisemblablement on dépotoit les morts. J'en ai
tracé la figure, que l'on trouve sur la Ve. Planche, lettre B. De l'antichambre, dont je viens de parler, on
passe par une autre porte & par plusieurs allées, dont le passage est à présent difficile, dans une place fort
grande, mais devenue basse par la quantité de poussiere & de sable, dont elle est remplie, & qui peut-être y
a pénétré par des ouvertures inconnues. Il peut y avoir eu en cet endroit des magasins à bled. Comme cette
place est trop grande, pour avoir pu soutenir sans s'écrouler, on y a laissé des rangées de piliers de 3 pieds
en carré, faisant partie du rocher, & n'ayant aucun ornement. On trouve encore ici plusieurs allées &
chambres souterreines, toute taillées dans le roc : mais comme elles sont devenues des repaires de bêtes
sauvages, je ne jugeai pas à propos de m'y arrêter. Il faut prendre de la lumiere, quand on veut les visiter, &
en y entrant on tire d'ordinaire un coup de pistolet, pour en chasser les bêtes sauvages, qui pourroient s'y
trouver. A l'Ouest de ces catacombes il y a un petit port ou une baie au bord de la mer, & à l'un des côtés de
cette baie il paroît y avoir eu un palais ; car on y trouve encore quantité de petits morceaux de marbre, qui
peuvent avoir servi de pavé, ou à couvrir les parois. On voit ici d'ailleurs deux chambres taillées dans le roc,
qui semblent avoir été des réservoirs d'eau ; car on ne peut y descendre que perpendiculairement par une
petite ouverture sur des marches, qui descendent des deux côtés le long du rocher, dans lequel on a encore
taillé quelques endroits pour s'asseoir, où l'on est à l'abri de l'extrême ardeur du soleil, tandis que l'on jouit
du beau coup d’oeil, que présente la mer. On voit de plus quelques grands escaliers dans le rocher même.
Ce qu'il y a de remarquable, ce sont les bains de Pompée. Ils forment actuellement encore trois chambres,
l'une à côté de l'autre, & taillées dans le roc. Chaque chambre a une porte du côté du port, par laquelle l'eau
de la mer y peut entrer ; & la derniere de ces chambres a encore à l'opposite une petite ouverture à travers
le rocher, par où l'eau peut découler. On a laissé autour des parois un banc, qui fait partie du rocher. Je n'ai
pas bien pris garde à (p. 42) quel degré les eaux montoient ou baissaient dans ces endroits : mais je pense
que dans ces chambres elles atteignoient à peu près la hauteur des bancs. Cela feroit présumer que, l'eau
de la mer ne diminue pas beaucoup dans les environs d'Alexandrie.
Les étrangers ne font pas grand commerce avec les habitants d'Alexandrie. Mais c'est devant cette ville, que
mouillent tous les vaisseaux, qui transportent de l'Europe & de la Barbarie des marchandises en Egypte, ou
qui viennent en prendre en Egypte, pour les transporter en Barbarie et en Europe. C'est ce qui fait de la
douane une source de revenus très-considérables. Alexandrie est le séjour de plusieurs marchands
d'Europe, & la résidence d'un consul de France, de Venise, de Hollande & de Raguse. Le consul de
Hollande étoit en même-temps consul d'Angleterre, & Monsieur Marion étoit vice-consul de Danemarck, de
Suede, de Toscane, & de Naples. La langue, que l'on parle généralement à Alexandrie, ainsi que dans toute
l'Egypte, c'est la langue arabe ; & les Européens, qui n'entendent point cette langue, parlent la langue
italienne. J'ai même rencontré à Alexandrie, mais point ailleurs, des Mahométans de nation, qui parloient le
provençal, le Danois ou le Suédois, presque aussi bien, que s'ils fussent nés en France, en Danemarck ou
en Suede. Cela feroit penser, que les Alexandrins ont plus de disposition à apprendre des langues
étrangeres, que les autres Mahométans. Mais il y a en apparence, que ce qui les porte à s'y appliquer, c'est
uniquement l'esperance du gain, & un moindre degré d'attachement pour leur religion. Il n'est guere
possible, qu'un Mahométan pratique les cérémonies de sa religion parmi les matelots européens : malgré
cela il y a des Alexandrins, qui sont quelquefois plusieurs années au service d'un patron chrétien. Quand ils
ont appris la langue, ils servent d'interpretes & d'acheteurs aux patrons, qui viennent à Alexandrie ; & par ce
moyen ils gagnent d'ordinaire leur vie plus richement & plus commodément, qu'ils n'auroient pu faire sans
cela.
Le gouverneur d'Alexandrie dépend de la régence de Kahira, & par conséquent encore du sultan de
Constantinople. Des tribus nombreuses d'Arabes, qui rodent en Egypte, paient certaines sommes au
gouvernement turc ; ils se montrent quelquefois pacifiques, & se conduisent comme des vassaux ou des
alliés : mais quelquefois aussi ils deviennent si mutins, que le gouvernement est obligé d'envoyer contre eux
des centaines & même des milliers d'hommes, & de les faire chasser dans des contrées plus éloignées.
Durant notre séjour à Alexandrie ces vagabonds s'approchoient de plus en plus & ne malestoient pas peu
les paysans arabes des environs. Le 11e d'octobre quelques centaines s'étoient campés à une demie lieue
de la ville. Le matin deux patrons vénitiens, montés sur deux anes selon l'usage du pays, voulant aller voir la
colonne de Pompée, furent arrêtés par les vagabonds tout devant la ville, & on voulut les forcer à mettre bas
leurs habits & tout ce qu'ils portoient sur eux. Leur janissaire ayant représenté (p. 43) aux vagabonds, que
les Européens ne leur avoient jamais fait du mal, & que, s'ils avoient quelque chose à prétendre du
gouvernement, c'étoit une affaire à terminer entre le gouvernement & eux ; ils laisserent les patrons &
voulurent détrousser le janissairre, qui ne leur échappa qu'en habits déchirés. Lorsque ces Arabes ennemis
viennent dans la ville, pour faire des emplettes, ils vont toujours un à un, pour ne pas être remarqués par les
habitants. Précisément cet après-midi il en étoit entré dans Alexandrie un très grand nombre, qui nous
donnerent ensuite une scene, telle que je n'en ai vue dans tous mes voyages ; nous vîmes le tout de dessus
notre terrasse ou du toit de notre maison. Les-uns disoient, que la populace d'Alexandrie, qui est peut-être
aussi méchante qu'aucune autre dans tout l'empire ottoman, ayant remarqué les ennemis, avoit voulu
venger les désordres, qu'ils avoient commis hors de la ville. D'autres au contraire croyoient, que le fils d'un
Schech, ayant acheté dans une boutique de la poudre & du plomb, & voulant essayer son fusil dans la ville,
avoit tiré une bale dans la maison vis-à-vis de la boutique ; que là dessus le bourgeois ne lui ayant pas parlé
plus poliment qu'il n'auroit parlé à un Arabe du commun, & le jeune Schech ayant répondu comme s'il eût eu
à faire à un de ses inférieurs au désert : la querelle avoit commencé d'abord entre eux deux. D'autres
Arabes vinrent au secours du Schech, & d'autres bourgeois au secours de leur concitoyen. Tous se
rendirent dans une très grande place près de notre maison, & du côté, où il falloit, que les Arabes se
retirassent. Ceux d'entre eux, qui étoient à cheval, auroient facilement pu échapper, mais ils ne voulurent
pas abandonner leurs camarades, qui étoient à pied, & encore dans la ville, où on les arrêtoit, heurtoit, &
battoit par-tout. Les Arabes à cheval, la lance ou le pistolet à la main, couroient quelquefois à toute bride sur
une troupe ennemie, & de cette maniere un seul Arabe repoussoit une multitude d'Alexandrins. Mais dès
que celui-là se retiroit, ceux-ci le poursuivirent à coups de pierre, jusqu'à ce que d'autres accourussent avec
des armes à feu. Les Arabes, voyant, qu'ils avoient le dessous, se donnerent bien de garde de tuer
personne. Les Alexandrins n'userent pas de tant de précaution. Un arabe à cheval fut tué d'un coup de
pierre, & un autre d'un coup de feu. A la fin ils se sauverent, après avoir perdu 15 hommes & quelques
chevaux. Dans la premiere chaleur la plupart des prisonniers furent fort maltraités par la populace
d'Alexandrie ; & deux d'entre eux avoient tellement été battus, qu'ils en moururent bientôt. Sur cela les
Arabes assiégerent la ville, & emporterent aux habitants quantité de bestiaux, qu'on alloit mettre aux
champs, ou qui y étoient déjà. Mais deux jours après la paix fut faite, & le butin fut rendu de part & d'autre. »
- 665 - 669 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PEHR FORSSKAL (du 26 septembre au 31 octobre 1761)
Nigel Hepper, F. et Friis, I., The Plants of Pehr Forsskal’s Flora Aegyptiaco-Arabica collected on the Royal
Danish Expedition to Egypt and the Yemen 1761-63, Copenhague, 1994.
Pehr Forsskal (1732-1763), naturaliste suédois suivant les cours de Carl von Linné, fait partie de l’expédition
dans laquelle se trouve Carsten Niebuhr. Rappelons qu’il meurt au cours de ce voyage. Un manuscrit
contenant ses notes est publié à Uppsala en 1950 sous le titre : Resa til Lycklige Arabien. Petrus Forsskal’s
1761-1763.598
Remarque : texte incomplet.
p. 9 :
« At Alexandria, Forsskal found a botanical haven, his « so-called botanical island, or rather a peninsula,
which protects the old harbours, and is called Ras-Ettin. The town is built on the isthmus connecting this
peninsula with the mainland, and therefore no Arab [beduin] goes there. It is the only area near Alexandria
where one can safely botanize alone. The place is well worth a visit. The salinity of the soil attracts herbs
which love such ground. The beach, high and low parts of the land, fields, shady and open ground are here
found close together. »
598 Nigel Hepper, F. et Friis, I., The Plants of Pehr Forsskal’s Flora Aegyptiaco-Arabica collected on the
Royal Danish Expedition to Egypt and the Yemen 1761-63, Copenhague, 1994, p. 2.
- 670 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JAMES HAYNES (du 16 octobre au ? 1765)
Haynes, J., Travels in the several parts of Turkey, Egypt and the Holy Land, Londres, 1774.
En page de garde, on apprend que James Haynes est « Late Clerk » d’un grand marchand du Caire.
p. 36-44 :
Letter IV
Alexandria, Oct. 23, 1765.
Sir,
…
« We arrived safe at our desired port on the 16th, and we went to Mr. Stephen Roboly the French
druggerman, to whom we had been warmly recommanded by letters from Constantinople and Smyrna, and
were received by him in a friendly manner. The three next days after we landed here, we were invited
(p. 37) to dine with the French, Imperia, and Dutch consuls. The invitations were brought by their respective
druggermen. We returned for answer, that we would do ourselves the honour to wait on them. We did, and
were treated in a princely manner : indeed I was agreeably surprised to find such noble cheer in Egypt, and
could be happy enough was it not for the tormenting musquitos ; these little insects are continually biting and
sucking out our blood in the day time. We master them at night ; for the curtains are so well contrived and
closed about the bed, that it is impossible for them to get to us. The Turks call Alexandria, Scandria. This city
according to ancient history, was built by Alexander, son of Philip of Macedonia, and had its beginning in the
112 Olympiad. Here is a very high artificial mountain, much ressembling the Testaccio of Rome. Upon it is a
little tower, and a man continually in it, to observe what ship are passing, and of which he gives notice to the
custom house.
One time since the Turks have been masters of this city, a cunning Mahometan mufti, observing it very thinly
inhabited ; (p. 38) spread a report, that Mahomet in one of his writings, had left many blessings to the
inhabitants of this city, and to those who visit it, and this false report, it got full of inhabitants. Here is a very
good Bazar. We see here large remains of the ancient walls and towers. Near the French Han, is a large
open place, where the Franks recreate themselves ; on the East of which some Venetians merchants reside,
particulary, my friend, Mr. Peter Bernardi. On the North side of this place, is a stand of asses, ranged in
rows, and with each ass a driver. These are lett out to ride, and the driver runs behind his beast, and with a
short stick makes him go pretty fast. ‘Tis pleasant enough to observe the Christian sailors when they come
on shore ; the drivers in an instant bring their asses in a ring round the sailors, and importune them to ride ;
the sailors not understanding them, fall to cursing and swearing at being so hedged in. At length the drivers
put the door tars by force on their beasts, and drive them about half a mile and back again, and (p. 39) then
insist on their fare. About Alexandria, you see little else but sandy deserts, and what they call gardens are
more like wildernesses. There is an aqueduct from the Nile to the city, but it is now very much out of repair.
We see here a fine pillar of red granite, called Pompey’s pillar, about 70 feet high, and 25 in circumference at
the bottom ; but I am of opinion, that the dimensions from there to the top are not exactly the same.
Every traveller who views Pompey’s pillar, must wonder how it could be brought thither, and by what
machines it could be raised, considering its enormous size and weight. We see also here, an obelisk full of
Hieroglyphicks, called Cleopatra’s needle. We went to see St. Mark’s church, ‘tis a small building, but very
strong. In it they shew you the pulpit St. Mark preached in, and a picture of him, and another of St. Michael,
which by tradition were drawn by St. Luke. St. Mark was buried in this church, but some Venetian merchants
found means to steal his body and transport it to Venice. In order to deceive the Turks, and the masters of
the custom house who (p. 40) were Jews, they put it at the bottom of a case, and then filled it up with dryed
hams. When the Jew customers opened the case to examine it, and saw the swines flesh, they looked no
further but ordered it to be nailed up, and sent it on board immediately. The Copti priests say, that the
Venetians in their haste left St. Mark’s head behind them, and that they have it now in the same tomb where
his body lay. They shew you also here, the stone on which St. Catherine was beheaded ; ‘tis a piece of a
pillar two feet two inches high and slightly stained with blood ; but I will not say that ever had a drop of it in
her veins.
Mr. Roboly the French interpreter, is an admirer of antiquities, and when any of the Bedouins (the people
who spend their time in searching among the ruins) find any, they generally offer them first to him. This
gentleman told me that two winters ago, a Bedouin came and shewed him something, which on examination
proved to be a piece of ice, a thing not found in an age in this place. Mr. Roboly, pleased with the sight of
what he had not seen since he left France, (p. 41) offered the value of a shilling for it ; but the Bedouin
imagining it to be a precious stone, disdained hid offer, and wrapping it carefully in a rag, went away in quest
of a better bidder. He met an acquaintance, and opening the rag to shew him what he had found ; was
surprised to find, it and his imaginary jewel wet ; and in order to dry them, he laid them in the sun-shine on a
large stone. But how great was his surprise when he saw his jewel grow less ans less. He invoked Mahomet,
called every Turk that passed to look at this miraculous affair, which in a very short time deprived him of his
jewel, and left him nothing but the rag. Here they kill their oxen, sheep, &c. very early in the morning upon
the beach, close to the sea, and wash every part they cut them into with plenty of salt water, which I think is
more cleanly than the way used in England. As at Cairo, no Frank wears his own country dress, Mr. F-H-,
and myself have had our hair cut off, thrown aside our European garments, clothed ourselves like Turks, and
in order to be quite complet have been letting our whiskers grow ever since we left Smyrna. (p. 42) I find
these garments rather troublesome at present, particularly when I go up stairs with any thing in my hands, as
I then tread on the bottom of my Caftan. The next morning after my metamorphosing, I was obliged to get
one to assist in dressing me, but can now do it easily myself. I am now free from many articles I used before
this mutation ; as buckles, stockings, garters, sleeve buttons, ruffles, stocks, cravats, hats, great coats and
walking sticks. I was told the following by a French gentleman of good repute, and which has been confirmed
to me by other Franks of unblemished character, and which I fear we may take as a specimen of Turkish
justice.
A worthly French merchant who had long resided in this city, used every day during some years to take a
solitary walk. A poor Turk stood to ask alms in the way this gentleman passed, and received daily of him a
para, by way of charity. At lenght the merchant finding his business decrease, determined to quit Alexandria
and return to France, where he settled, and remained nine years. At the expiration of which, some genteel
(p. 43) offers were made the induce him to settle again in Alexandria. He accepted them and returned.
According to his former custom, he went to take his old walk, in which he saw the Turk medicant, he had so
often relieved, and offered him a para, which he refused, and said « Sir, you are some hundreds in my
debt. » The gentleman affronted at his insolence walked on, and determined never more to give him any
thing. The next day, the merchant was ordered to appear before the Cadi, when the beggar declared he
owed him as many paras, as there were days in nine years, (the time of the merchant’s absence.) The Cadi
desired the medicant to explain the nature of the debt, which he did as follows ; « during this gentleman’s
first residence in this city, I constantly received a para a day of him, and on this account, looked on myself as
his pensioner, and depended on my pension ; but he acted very unjustly by me in absenting himself nine
years, without first leaving a fund sufficient for the payment thereof ; but fate has savoured me in bringing
him here again, and I doubt not but I shall have justice done (p. 44) me. » The Cadi declared, that beggar
had a just right to the pension in question, and ordered the merchant to pay him up to that day, which he was
obliged to comply with.
I am in good health and spirits,
and remain, Sir, your’s, &c.
- 671 - 672 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
AL-ḤUSAYN B. MUḤAMMAD AL-WARṮILĀNĪ (1768)
Al-Ḥusayn b. Muḥammad al-Warṯīlānī, Nuzat al-Anẓār fī faḍl `Ilm al-Tārīḫ wa al-Aḫbār, Beyrouth, 1974.
L’auteur, Al-Ḥusayn b. Muḥammad al-Warṯīlānī, originaire de Tlemcen (Algérie), a véritablement effectué un
pèlerinage en passant par Alexandrie. Mais dans ce récit, il ne cite que ses prédécesseurs :
Al-Mas`ūdī (Xe siècle), Al-Suyūṭī (1445-1505) et Al-‘Ayyāšī (1628-1679). Les premier et troisième auteurs
sont des voyageurs faisant partie de ce corpus.
p. 561-572 :
« L’imam Al-Suyūṭī a dit dans son livre Ḥusn al-Muḥāḍara d’après `Uqba b. `Amir al-Ǧahnī – que Dieu soit
satisfait de lui ! que des Chrétiens sont venus vers le Messager de Dieu – que la bénédiction et le salut de
Dieu soient sur lui ! avec des livres. Le Messager de Dieu leur a dit – que la bénédiction et le salut de Dieu
soient sur lui ! : “Si vous voulez, je vous informerai sur ce que vous voudrez (p. 562) avant que vous parliez,
ou alors vous parlez et je vous informe ensuite.” Ils dirent : “Informe-nous avant que nous parlions.” Le
Messager de Dieu leur dit : “Vous êtes venus à propos de Ḏī al-Qarnayn, je vous informerai donc sur ce que
vous trouverez écrit chez vous. Au début de sa vie, Ḏū al-Qarnayn était un enfant romain, quand on lui
donna un royaume, il alla jusqu’à la côte égyptienne où il y construisit une ville qui s’appelle Alexandrie.
Quand il finit de la construire, un ange vint, le monta au ciel et lui dit : "Dis-moi ce qu’il y a en bas". (Ḏū
al-Qarnayn) dit : "Je vois ma ville et les villes autour d’elle". Ensuite (l’ange) le monta encore plus haut et lui
a demanda ce qu’il voyait. (Ḏū al-Qarnayn) lui répondit : "Ma ville est mêlée à d’autres et je ne la reconnais
pas". Voici toute la narration. Je l’ai lue dans le commentaire conservé dans la sourate de la cave. Ibn `Abd
al-Ḥakam a dit, d’après `Abd Allāh b. `Amr b. al-`Aṣ, qu’au début, un pharaon avait installé des fabriques et
des salles de conseil à Alexandrie et qu’il était le premier à y habiter. Il y construisit des fabriques qui
subsistèrent aussi longtemps que les rois égyptiens la gouvernèrent après lui. Dalūka, fille de Zabā,
construisit le phare d’Alexandrie et le phare de Būqīr après Pharaon. Quand apparut sur terre Sulaymān
b. Dāwūd – que la bénédiction et le salut soient sur eux ! – il y construisit une salle de conseil et une
mosquée. Ensuite Ḏū al-Qarnayn la gouverna et détruisit ce que les rois, les pharaons et autres avaient
construit, à l’exception des constructions de Sulaymān b. Dāwūd, qu’il ne changea pas et qu’il ne détruisit
pas. Il restaura ce qui fut détruit et laissa le phare dans son état. Ensuite, il construisit à nouveau Alexandrie,
les édifices se ressemblant. Ensuite les rois de Rūm et d’autres la gouvernèrent, chacun d’eux y apporta une
nouvelle construction portant leur nom, qui les rendit célèbres. Ibn `Abd al-Ḥakam rapporta que l’on dit
que le souverain qui construisit le phare d’Alexandrie est la reine Cléopâtre qui fit venir le canal jusqu’à le
faire entrer dans la ville car l’eau ne l’atteignait pas. Il ajouta que l’on dit que Šaddād b. `Ad construisit
Alexandrie.
On dit qu’il y avait cinq mosquées saintes : la mosquée de Moïse – que la bénédiction et le salut soient sur
lui ! – qui se trouve près du phare, la mosquée de Sulaymān – que la bénédiction et le salut soient sur lui ! –
la mosquée de Ḏū al-Qarnayn, la mosquée Al-Ḫiḍr ; l’une se trouve à Al-Qaysāriyya et l’autre à la porte de la
ville, et la mosquée `Amr b. al-`Aṣ le Grand – que Dieu soit satisfait de lui !
(p. 563) Alexandrie se composait de trois villes placées côte-à-côte, qui sont dans la localité où se trouve le
phare et ce qui l’entoure, Alexandrie, à l’endroit où se trouve la citadelle aujourd’hui, et Hebta599. Chacune
de ces trois villes avait un mur et toutes les trois étaient entourées par un autre mur. Ibn `Abd al-Ḥakam a dit
d’après `Abd Allāh b. Ṭurayf al-Hamadānī qu’il y avait à Alexandrie sept forteresses, sept fossés et que Ḏū
al-Qarnayn bâtit les murs et le pavement d’Alexandrie de marbre blanc. Les vêtements (de ses habitants)
étaient noirs et rouges. Bien avant cela, les moines étaient vêtus de noir à cause de la blancheur éclatante
du marbre. La nuit, il n’était nul besoin de lampe en raison de la blancheur du marbre. La nuit, le couturier
pouvait entrer un fil dans le chaton d’une aiguille grâce à la lumière de la lune. Alexandrie était blanche la
nuit et le jour. Après le coucher du soleil, personne ne sortait de sa maison ; celui qui sortait disparaissait.
On rapporte qu’un berger faisait paître ses brebis près du rivage de la mer, il s’aperçut qu’une ombre sortait
de la mer et lui ravissait un de ses moutons : le berger se mit en observation et vit une esclave sortir des
eaux, il s’accrocha à elle, la mena jusqu’à sa demeure et elle devint docile ; elle remarqua que les gens de la
maison ne sortaient pas après le coucher du soleil, et elle en demanda la cause ; il lui fut répondu que celui
qui sortait était enlevé, alors elle confectionna des talismans dont l’origine date de ce jour à Alexandrie
d’Égypte. `Aṭa’ al-Ḫurāsānī dit que le marbre tint [les habitants] de la ville en esclavage au point de les faire
rester à la maison du matin jusqu’à la mi-journée parce que celui-ci se transformait en pâte. Ensuite, en fin
d’après-midi, le marbre se durcissait à nouveau. Avant Alexandre, Alexandrie s’appelait Raqūda. Les Coptes
la connaissent dans leurs livres par ce nom. D’après Al-Layṯu b. Sa`ad, la Bouhaira d’Alexandrie était
remplie de vignes. La femme d’Al-Mūqawqis, propriétaire des vignes, imposait [aux habitants] de payer la
taxe en vin. C’était la loi. Mais le vin devint de plus en plus abondant. Elle [la femme d’Al-Mūqawqis] dit alors
qu’elle n’avait plus besoin de vin mais d’argent. Les habitants lui dirent qu’ils n’avaient pas d’argent. Alors
elle inonda d’eau les vignes qui s’abîmèrent. Ce lieu devint un lac où l’on pêcha des gros poissons jusqu’à
ce que les gens au temps de al-`Abbās mirent fin (à la pêche), fermèrent les aqueducs et cultivèrent
l’endroit.
Parmi les merveilles d’Alexandrie, il y a la colonne des colonnes. Elle n’a pas son pareil sur terre. Il a été
rapporté à l’auteur de l’ouvrage Le miroir, qui a vu la colonne des colonnes, (p. 564) qu’il y a la même à
Assouan. Ibn Faḍl Allāh dit qu’à l’extérieur d’Alexandrie se trouve la colonne des colonnes. C’est une
colonne dressée en l’air. En bas, se trouve une base et en haut aussi. On dit qu’il n’y a pas une colonne
semblable pour sa hauteur et sa circonférence.
Je vis cette colonne quand j’entrai à Alexandrie au cours de mon voyage. La circonférence de la base est de
88 empans. D’après les Alexandrins, celui qui s’approche de la colonne en fermant ses yeux et va vers sa
direction ne s’y cogne pas et s’en éloigne. Personne ne peut la toucher bien que beaucoup essayent.
J’essayai de nombreuses fois, mais je ne pus la toucher. Quelques hommes de qualité d’Alexandrie me
racontèrent qu’il y avait à Alexandrie quatre colonnes, semblables à la colonne des colonnes, qui avaient
une coupole. Dans ce lieu, Aristote, l’auteur de La chronique, prenait place. D’après Al-Tanūḫī, il y avait à
Alexandrie une statue de cuivre qu’on appelait Šarāḥīl. Elle se trouvait sur un rocher de mer et montrait
Constantinople du doigt. On ne sait pas si c’est Sulaymān qui la construisit ou si c’est Alexandre. Les
poissons se réunissaient autour de cette statue et tournaient autour ; là on les pêchait. Usāma écrivit à
Al-Walīd b. `Abd al-Malik pour l’informer à propos de cette statue ; il lui dit : “Nous avons peu d’argent. Si
l’émir des musulmans est d’accord, Usāma fera couper la statue pour en faire des pièces d’argent.” Al-Walīd
lui envoya des hommes de confiance qui descendirent la statue et trouvèrent que ses yeux étaient deux
rubis qui sont inestimables. Les poissons partirent et ne revinrent plus dans ce lieu.
Parmi les merveilles construites sur la terre de Miṣr, comme le dit l’auteur de Mabāhiǧ al-Fikr, il y a le phare
d’Alexandrie qui est fait de pierres bien taillées enduites de plomb (et qui est posé) sur des arcades de verre.
Les arcades portent sur leur dos des colonnes de cuivre. Dans le phare, il y a environ trois cents pièces les
unes au-dessus des autres. Une bête de somme monte chargée à l’intérieur de toutes les pièces. Les pièces
possèdent des fenêtres d’où l’on voit la mer.
Les historiens sont en désaccord à propos de celui qui construisit le phare. On dit que c’est Alexandre qui le
construisit ou la reine Dalūka de Miṣr. On dit que sa hauteur était de mille coudées. Au sommet, il y avait des
statues de cuivre dont une qui montrait, avec l’index de sa main droite, le soleil où qu’il fût ; l’index tournait
toujours avec le soleil. Parmi ces statues (p. 565), il y en avait une dont le visage était tourné vers la mer.
Quand l’ennemi était à une distance d’une nuit, on entendait un son fort [de cette statue] qui prévenait les
habitants de la venue de l’ennemi. Parmi ces statues, il y en avait une qui produisait un son mélodieux à
chaque heure passée de la nuit. Il y avait au sommet du phare un miroir d’où on voyait Constantinople et
l’étendue de la mer entre les deux villes. À chaque fois que l’armée des Rūm se préparait, on la voyait dans
le miroir.
Al-Mas`ūdī raconta que ce phare était au milieu d’Alexandrie. C’est une des merveilles du monde. Il fut
construit par un des rois grecs. On dit qu’il s’agit d’Alexandre quand il était roi. Quand les Grecs étaient en
guerre contre les Rūm, ils firent du phare un observatoire et y installèrent un miroir de pierres diaphanes où
l’on observait les bateaux qui venaient de Rome à une distance que l’oeil ne pouvait apercevoir. Ce miroir
resta ainsi jusqu’à ce que les Musulmans la gouvernassent. Un roi de Rūm fit une ruse, à l’époque où les
musulmans l’utilisaient, à Al-Walīd b. `Abd al-Malik. Il envoya un de ses hommes avec une troupe vers un
des postes frontières d’al-Šām sous prétexte de se convertir à l’islam. Cet homme arriva auprès d’Al-Walīd
et se montra musulman. Il sortit des trésors et des biens enfouis à al-Šām, ce qui poussa Al-Walīd à croire
que sous le phare se trouvait des richesses, des biens enfouis et des armes qu’Alexandre aurait enterrées.
Al-Walīd lui donna une troupe d’hommes de confiance pour aller à Alexandrie. Il détruisit un tiers du phare et
fit disparaître le miroir. Les gens s’aperçurent alors que c’était une ruse. Cet homme le pressentit et s’enfuit
sur un bateau qui était prêt pour lui. Ensuite, on reconstruisit ce qui avait été détruit avec du gypse et des
briques.
Al-Mas`ūdī dit que la hauteur de ce phare, en 333600, était de deux-cent trente coudées et que sa hauteur
ancienne était de quatre cents coudées. À l’époque d’Al-Mas`ūdī, sa construction avait trois formes. Le
premier tiers était un carré bâti avec des pierres. Ensuite sa construction consistait en un octogone construit
avec des briques et du gypse qui mesurait soixante coudées. Le sommet du phare avait une forme arrondie.
L’auteur du Mabāhiǧ al-Fikr dit qu’Aḥmad b. Tūlūn construisit au sommet du phare une coupole en bois que
le vent détruisit. On construisit à la place une mosquée à l’époque d’Al-Malik al-Kāmil, roi de Miṣr. Ensuite, le
côté du phare tourné vers la mer (p. 566) s’écroula ainsi que la jetée. Aussi à l’époque d’Al-Malik al-Ṭāhir
Ruqn al-Dīn Baybars, on recouvrit la jetée et on la remit en état. Ibn Faḍl Allāh rapporta dans son livre
Al-Masālik que ce phare s’effondra et demeura en ruines sans observatoire à l’époque de Qalāwūn ou de
son fils.
Ibn al-Mutawaǧ dit dans son livre Iqāẓ al-Mutaġafil que parmi les merveilles, il y a le phare d’Alexandrie
construit par Ḏū al-Qarnayn. Sa hauteur était de plus de trois cents coudées, sa construction était de pierre
taillée. Le premier niveau était de forme carrée. Au-dessus du phare de forme carrée, il y avait une forme
octogonale en brique. Au-dessus de la forme octogonale, il y avait une forme arrondie. La hauteur du phare
était construite de roche façonnée sur plus de deux cents coudées. Au-dessus, il y avait un miroir de fer
chinois dont la largeur était de sept coudées. On pouvait y voir tout ce qui sortait en mer venant de tout le
pays de Rūm. Si c’était des ennemis, on ne les laissait pas s’approcher d’Alexandrie. Au moment du coucher
de soleil, on tournait le miroir face au soleil, puis on dirigeait celui-ci vers les navires jusqu’à ce que les
rayons fassent tomber la lumière du soleil sur eux et les fassent tous brûler en mer pour faire périr tout ce
qui était à bord. Ceux de Rūm payaient une taxe pour garantir leurs navires contre l’incendie causé par ce
miroir. Quand Alexandrie fut conquise par `Amr b. al-`Aṣ, ceux de Rūm usèrent de ruse : ils envoyèrent une
troupe de prêtres arabisés qui se présentèrent comme étant musulmans ; ils sortirent un livre en prétendant
que les trésors de Ḏū al-Qarnayn se trouvaient à l’intérieur du phare. Les Arabes les crurent, car ils
connaissaient peu les ruses des Rūm et ne connaissaient pas l’utilité de ce miroir et du phare. Ils
s’imaginèrent que quand ils se seraient emparés des trésors et des richesses, ils rétabliraient le phare et le
miroir comme ils étaient auparavant. Ils démolirent à peu près les deux tiers du phare, sans rien y trouver.
Ces prêtres prirent la fuite et les Arabes surent alors que c’était une ruse. Ils reconstruisirent le phare en
briques et ne furent pas capables de remonter ces pierres à leur place. Quand ils eurent terminé de
reconstruire le phare, ils replacèrent le miroir à son sommet, tel qu’il était auparavant. Mais le miroir s’était
rouillé et l’on ne vit plus les choses comme on les voyait, et son pouvoir d’incendier les navires disparut.
Dans la moitié inférieure du phare qui était de la construction de Ḏū al-Qarnayn, les gens entraient par la
porte du phare, qui est élevée de vingt coudées au-dessus du sol. On y monte par les voûtes construites en
pierres taillées. Quand on entre par la porte du phare, on trouve, à sa droite, une porte par laquelle on entre
dans une grande salle haute de vingt coudées de forme carrée où pénètre la lumière des deux côtés du
phare. Ensuite on trouve une autre pièce identique, puis une salle, puis encore une autre salle. (p. 567) Les
Djinns avaient fait à Alexandrie pour Sulaymān b. Dāwūd – que la paix soit sur eux ! – une salle avec des
piliers de marbre coloré de toutes sortes, pur comme l’onyx yéménite et poli comme un miroir. Quand on
regardait dedans, on y voyait ceux qui marchaient derrière, tant le marbre était pur. Les piliers sont au
nombre de trois cents et chaque pilier mesure trois cents coudées. Au milieu de cette salle, se trouve un seul
pilier qui bouge d’est en ouest ; les gens en sont témoins, mais ne connaissent pas la cause de son
mouvement.
Parmi les merveilles d’Alexandrie, il y a la colonne et le théâtre où on se rassemblait un jour par an pour tirer
à la balle ; celle-ci ne tombait que dans le giron du roi de Miṣr. Tout le monde y assistait, il y avait plus de
mille milliers hommes. Chaque participant s’installait l’un face à l’autre. Ensuite, dans ce stade, on lisait un
livre que l’assemblée écoutait, ou bien on jouait au jeu de la couleur des couleurs que tout le monde avait
vue.
Mon maître `Amr b. al-`Aṣ – que Dieu soit satisfait de lui ! – était présent dans ce théâtre parmi eux avant le
temps de l’Islam. Il alla à Jérusalem avec quelques commerçants de Qurayš. Soudain, un des prêtres
alexandrins de Rūm, qui allait prier à Jérusalem, sortit se promener dans les montagnes. `Amr faisait paître
son chameau et ceux de ses amis car c’était son tour de garde. Ainsi, alors que `Amr faisait paître son
chameau et ceux de ses amis, un prêtre atteint d’une soif intense en ce jour très chaud vint vers lui. Le
prêtre se tint face à `Amr et lui demanda à boire. `Amr lui donna à boire de son outre et il but jusqu’à être
désaltéré. Le prêtre s’endormit dans ce lieu. Il y avait à côté du prêtre, là où il s’était endormi, un trou d’où
sortit un serpent énorme. `Amr le vit, jeta (le serpent énorme) avec une flèche et le tua. Quand le prêtre se
réveilla, il regarda l’énorme serpent auquel il avait échappé. Il dit alors à `Amr : “Quel est ce serpent ?” `Amr
l’informa qu’il l’avait tué avec sa flèche. Le prêtre s’approcha de `Amr, lui baisa la tête et lui dit : “Dieu m’a
laissé en vie grâce à toi deux fois, la première fois d’une soif intense et la seconde de ce serpent.” Le prêtre
lui demanda : “Pourquoi es-tu venu dans ce pays ?” `Amr dit : “Je suis venu avec des amis pour demander la
faveur de commercer.” Le prêtre lui dit : “Combien espères-tu gagner de ton commerce ?” `Amr dit : (p. 568)
“J’espère gagner de quoi acheter un chameau, car je n’en possède que deux. Je souhaiterais avoir un autre
chameau pour en avoir trois.” Le prêtre lui dit : “Connais-tu le prix du sang de l’un d’entre vous ?”, il dit :
“Cent chameaux.” Le prêtre lui dit : “Nous ne payons pas en chameaux mais en deniers.” Il lui dit que : “Ça
fera mille deniers.” Le prêtre lui dit : “Je suis un étranger dans ce pays, je suis venu ici pour prier à
Jérusalem, je visite ce pays pendant un mois pour exaucer un voeu. Ce voeu est accompli, je veux retourner
dans mon pays. Est-ce que tu peux me suivre jusque dans mon pays ? J’ai envers toi une dette, je dois te
donner deux prix de sang car deux fois Dieu m’a laissé en vie grâce à toi.” `Amr lui demanda : “Où est ton
pays ?” (le prêtre) lui dit : “À Miṣr, dans la ville qu’on appelle Alexandrie.” `Amr lui dit qu’il ne la connaissait
pas et qu’il n’y était jamais entré. Le prêtre lui dit : “Si tu y entres, tu sauras que tu n’es jamais entré dans
une ville pareille.” `Amr lui dit : “Est-ce que tu me donneras ce que tu m’as promis, c’est-à-dire ta dette ? Le
prêtre lui dit : “Oui, je te promets de te rendre à tes amis.” `Amr lui dit : “Combien de temps vais-je y
rester ?”, il lui dit : “Un mois. Tu pars avec moi pour dix jours, tu resteras chez moi dix jours et tu reviendras
au bout de dix jours. Je prendrai soin de toi à l’aller et je te donnerai quelqu’un qui prendra soin de toi au
retour.” `Amr lui dit : “Attends-moi jusqu’à ce que j’en parle à mes amis.” `Amr alla vers ses amis et les
informa de ce qu’il avait conclu avec le prêtre. Il leur dit de rester ici jusqu’à son retour : “Je vous donnerai la
moitié « de sa dette » si quelqu’un d’entre vous vient avec moi pour me tenir compagnie.” Ils lui dirent « oui »
et lui envoyèrent un homme parmi eux. `Amr et son ami partirent avec le prêtre à Miṣr jusqu’à ce qu’ils
parvinssent à Alexandrie. Quand `Amr observa ses édifices, ses belles constructions et sa population
nombreuse, son émerveillement s’agrandit. Quand il entra à Alexandrie, c’était un grand jour de fête où les
rois et les nobles se réunissaient. Ils avaient une balle d’or qu’ils se lançaient et qu’ils recevaient dans les
manches. Celui qui essaie de prendre cette balle est le plus rapide. Si la balle tombe dans sa manche et y
reste, il ne mourra sans les avoir auparavant gouvernés. Quand `Amr arriva à Alexandrie, le prêtre lui fit le
plus grand honneur et l’habilla de brocart. (p. 569) `Amr et le prêtre s’assirent avec les gens dans cette
assemblée, là où on lançait la balle pour la recevoir dans les manches. Un homme la lança et la fit tomber
dans la manche de `Amr. (Les gens) s’étonnèrent et dirent que cette balle ne leur avait jamais menti sauf
cette fois-ci : “Est-ce que tu crois que cet Arabe nous gouvernera ?” “Ce ne sera jamais le cas.”
(Le roi) gouvernait (le peuple) avec autorité et oppression depuis la conquête de Miṣr. Ce prêtre marcha
parmi les Alexandrins et leur apprit que `Amr lui sauva la vie deux fois et qu’il lui avait promis deux mille
dinars. Il leur demanda de lui réunir les deniers. (Les Alexandrins) le firent et payèrent cette somme à `Amr.
`Amr et son ami partirent, le prêtre leur envoya un guide messager qui leur donna des vivres et leur fit
honneur jusqu’à ce que son ami et lui revinrent vers leurs compagnons. C’est ainsi que `Amr connut l’entrée
et la sortie de Miṣr. Il sut de ce pays ce qu’il vit et il sut que c’était le plus merveilleux des pays, contenant les
plus grandes richesses. Quand `Amr revint vers ses amis, il les paya mille dinars et garda pour lui mille
dinars. C’était la première richesse que `Amr amassa.
Parmi ses merveilles, il y a deux obélisques qui sont dressés sur des crabes de cuivre à leurs bases, chaque
base est posée sur un crabe. Si quelqu’un veut faire pénétrer une chose par dessous pour la faire sortir de
l’autre côté, il le peut.
Parmi ses merveilles, il y a la colonne sans mesure qui est composée de deux colonnes qui se croisent.
Derrière chaque colonne, il y a une colline de cailloux qui ressemblent à des cailloux volcaniques. Quand
celui qui est fatigué arrive (là), il prend sept cailloux et s’appuie contre une colonne. Ensuite, il lance derrière
lui les sept cailloux. Puis il se lève sans se retourner et continue son chemin comme s’il n’avait souffert de
rien.
Parmi ses merveilles, il y a la coupole verte qui est une merveilleuse coupole habillée de cuivre comme si
c’était de l’or pur qui ne vieillit pas et que le temps ne change pas.
Parmi ses merveilles, il y a le quai et la citadelle de Fārus ainsi que l’église souterraine qui est une ville dans
une ville (p. 570) et qui n’a pas son pareille sur terre. On dit que c’est Iram Ḏāt al-`Imād, on l’appelle ainsi
parce que ses colonnes sont uniques pour leur hauteur et leur largeur. Le propos est fini. (Il faut être prudent
lorsqu’on transmet un savoir) des omissions, des changements et de ce qui s’est passé avant et après.
À propos de ce qu’on dit sur Alexandrie, sur ses étrangetés, ses constructions et ses merveilles, il ne reste
aujourd’hui que la colonne des colonnes. Tout le reste fut emporté par le temps qui le détruisit et l’enterra. Il
ne reste de ses monuments que ce que l’on raconte dans les nouvelles. Il ne reste que Dieu l’unique et le
très puissant.
Parmi ses monuments, sans compter ceux qui nous avons déjà cité, il y a le tombeau de Sīdī `Alī al-Badawī
– que Dieu soit satisfait de lui ! –, il y a aussi celui d’Al-Ḫazraǧī, célèbre en ce lieu pour sa nisba, mais je ne
sais pas s’il est l’auteur de la poèsie Al-`arūḍ ou si c’est un autre. À côté de lui il y a le tombeau de l’imam
Al-Fākahānī. Il y a aussi le tombeau de l’imam, le cheikh pieux Sīdī `Abd al-Razzāq, le plus grand des
étudiants d’Al-Ṣīḫ Sīdī Abī Madyan – que Dieu soit satisfait d’eux ! – et un de ceux qui ont répandu sa ṭarīqa
après lui et que les gens ont apprise ; sa renommée parmi les gens de la ṭarīqa est reconnue. Il y a aussi la
zāwiya d’Abī al-Ḥasan al-Šāḏilī, où il se rendait avec ses amis : c’est une grande citadelle dans les murs de
la ville à l’est. À l’intérieur, il y a de nombreuses pièces dont une renferme le tombeau de Sīdī Aḥmad
al-Manārī dont les miracles sont célèbres ; la raison de son nom vient du fait qu’il vint dans cette ville avec
son ânesse et demanda où il pouvait passer la nuit. En se moquant de lui, on lui montra le phare, il leur
répondit “au nom de Dieu !” et monta avec son ânesse. Les gens se réunirent et le regardèrent, étonnés.
C’est un acte facile pour les pieux de Dieu-le-Puissant, Dieu est capable de tout. Dieu seul sait la vérité.
Pause
On raconte que le sultan Selim l’Ottoman, quand il entra à Miṣr, est venu à Alexandrie ; il monta un jour sur
le Kūm qui donne sur la ville. Le peuple d’Alexandrie y vint et dit au sultan que la ville était dominée par les
ruines : “Sultan ! Notre ville est dominée par la destruction comme vous le voyez. Nous voulons une entière
générosité de ta part, que tu aies pitié de nous et que tu prennes en considération la restauration de cette
ville, car sa place parmi les villes du monde est connue, il se pourrait qu’elle retrouve un peu de son passé
grâce à tes soins.” Le sultan resta silencieux pendant une heure et réfléchit. Ensuite il releva la tête vers eux
et leur dit que : “Dieu décida que cette ville (p. 571) soit en ruines. Moi je ne peux pas la construire puisque
Dieu voulut qu’elle soit en ruines.” Puis les gens le quittèrent.
Abū Sālim dit que ce roi observa avec un regard de connaisseur et pensa profondément aux détails
minutieux de la sagesse de Dieu qui se trouve dans son royaume. Il semblerait que ce roi prit en compte
l’aménagement de cette ville, pour qu’elle réponde aux besoins nécessaires de la vie, étant entourée par
toutes les qualités urbaines grâce à sa place au centre des royaumes islamiques. Elle regroupe à la fois des
particularités terrestres et maritimes, ainsi que des populations bédouines et urbaines. À l’est, sa porte est
reliée à la campagne égyptienne qui est le champ du monde et qui n’a pas son pareil. Sa porte ouest est
reliée au désert de Barqa qui sépare les pays de l’est et de l’ouest. Il n’y a pas de désert dans le monde qui
s’en approche par la grandeur de son étendue, il n’y a pas d’aussi bon pâturage et il n’y a pas d’air aussi
sain. La porte de la Mer est en face du territoire de Rūm, source d’importation des marchandises précieuses.
Si Alexandrie réunissait tous ces avantages, en ayant de nombreuses raisons pour développer son
urbanisation, la destruction de la ville ne peut avoir comme raison que celles de la volonté de Dieu et de Son
observation, d’une rigueur divine, sur cette ville orgueilleuse et arrogante envers les autres pays. C’est par
Sa volonté qu’aucune chose ne s’élève que pour être anéantie par un seul mot : soit. L’Homme sera sans
doute incapable de l’urbaniser, car Dieu a permis qu’elle soit détruite. Sur ma vie, c’est une bonne vision et
une étrange pensée. Évidemment, ceci n’est pas étonnant puisque le sultan Selim – que Dieu l’accueille
dans sa miséricorde ! – était connu dans le royaume pour l'acuité de son analyse, la sagacité de sa pensée
et son bon discernement. L’empire ottoman est devenu grand sous Selim qui a conquis les royaumes
d’al-Šām, d’Égypte, du Ḥiǧāz et d’autres pays encore.
En conclusion, la ville d’Alexandrie est parmi les villes-mères citées dans le monde. C’est le royaume des
maisons égyptiennes où vécut Mūqawqis durant la période préislamique. De même, on ne peut omettre de
signaler la splendeur du règne de son fondateur Alexandre, sa célébrité et ses conquêtes sur les royaumes.
Les chroniqueurs relatent sa vie ainsi que les circonstances de l’édification et de la construction de cette
ville. En effet, il l’a transformée en deux villes : l’une est souterraine et la seconde, visible, est au-dessus
d’elle. Pendant les jours de la crue du Nil, la ville d’en bas se remplit pour que les habitants de la ville d’en
haut s’abreuvent. Ses vestiges demeurent encore aujourd’hui. »601
- 673 - 677 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JAMES BRUCE (juin 1769 et mars 1773)
Bruce, J., Voyage aux sources du Nil en Nubie et en Abyssinie, pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771
et 1772, Paris, 1790-1791.
James Bruce (1750-1794), marchand de Londres, décide de s’adonner aux études et aux voyages à la mort
de son épouse. À son retour en Angleterre, son goût pour la langue arabe s’intensifie et apprend également
l’éthiopien. En 1763, il est nommé consul à Alger. Quelques années plus tard, en 1768, Lord Halifax lui
propose d’aller à la recherche des sources du Nil. C’est au cours de ce voyage que James Bruce passe par
Alexandrie. Pendant son séjour de quatre ans en Abyssinie, il est commandant de cavalerie.602
p. 13-30 (tome I) :
« Le 20 juin, au lever du soleil, nous vîmes de loin la ville d’Alexandrie, qui sembloit s’élever du sein de la
mer. Si l’état où est maintenant cette ville n’étoit pas généralement connu, un Voyageur curieux des
monumens de l’architecture antique, s’imagineroit trouver dans Alexandrie un vaste champ pour ses
chercheurs.
En effet, Alexandrie promet de loin un spectacle digne d'attention. La vue des anciens monuments, parmi
lesquels on distingue la colonne de Pompée, avec les hautes (p. 14) tours & les clochers construits par les
Maures, font espérer un grand nombre de beaux édifices ou de ruines superbes.
Mais au moment où l'on entre dans le port, l'illusion s'évanouit, & on n'apperçoit plus qu'un très-petit nombre
de ces monuments d'une grandeur colossale & majestueuse, qui distingoient les anciens, & qui se trouvent
mêlés avec les édifices aussi mal imaginés que mal construits, qu'ont élevés les conquérants qui se sont
emparés d'Alexandrie dans les dernières siècles.
Alexandrie a deux ports, l’ancien & le nouveau. L’entrée de ce dernier est difficile & dangereuse, parce qu’il
est défendu par une barre. Il est, en outre, plus petit que l’ancien, quoique Strabon l’ait nommé le grand
port603 .
Ce n'est que dans ce nouveau port que les vaisseaux européens peuvent mouiller, (p. 15) encore n'y sont-ils
pas en sûreté, car il en périt sans cesse, même à l'ancre.
Lorsqu'au retour de mon voyage je passai à Alexandrie, dans le mois de mars 1773, il y eut plus de quarante
vaisseaux jetés à terre et mis en pièces. La plupart étoit de Raguse ou des ports de Provence : mais ceux
des Nations accoutumées à naviguer sur l'Océan n'éprouvèrent aucun mal.
Il étoit très-curieux d’observer, en ce moment terrible, la manière dont on agissoit à bord de ces différents
vaisseaux. Aussitôt que la tempête se fut annoncée avec violence, tous les Capitaines Ragusiens, & les
François des ports de la Méditerranée, après avoir mouillé tous leurs ancres, s’embarquèrent dans leurs
canots, pour gagner promptement le rivage, abandonnant le sort de leurs vaisseaux aux fureurs de la
tempête ; car ils savoient bien qu’ils avoient des agrêts trop foibles pour pouvoir y demeurer en sûreté.
La plupart de leurs câbles étant faits d'une espèce d'herbe appelée spartum, ne purent supporter ni le roulis
du vaisseau, ni l’agitation des vagues. Ils se furent bientôt cassés & les vaisseaux jetés à la côte.
(p. 16) Cependant les Anglois, les Danois, les Suédois, les Hollandais, tous les navigateurs de l’Océan enfin
ne pressentirent pas plutôt le mauvais tems, qu’ils quittèrent leurs magasins à terre, & se rendirent à leur
bord. Ils connoissoient la bonne construction de leurs vaisseaux, & contens de pouvoir, par eux-mêmes,
remédier aux accidents imprévus, ils osoient braver la tempête. Ils savoient que leur cables étoient faits de
bon chanvre, & que leurs ancres étoient assez forts. Quelques-uns présenterent au vent la pointe de leurs
vergues ; d’autres descendoient leurs vergues sur le pont. Ensuite on les voyoit se promener tranquillement
sur le tillac, & défier l’orage. Aucun homme de leurs équipages ne sortit de leurs vaisseaux jusqu’à ce que le
tems fût calme. Alors ils vinrent à (p. 17) l’aide des infortunés dont les navires avoient été brisés & dispersés
sur la plage.
L’autre port d’Alexandrie est l’Eunostus des Anciens, situé à l’Occident du Phare. Il étoit aussi appelé le port
d’Afrique. Beaucoup plus grand que le premier, il se trouve placé immédiatement au-dessous d’une partie de
la Ville. L’eau y est bien plus profonde quoique depuis plusieurs siècles beaucoup de vaisseaux y aient
versé une immense quantité de lest. Mais il n’y a point de doute que ce moyen ne finisse par combler le
port ; & la postérité pourra probablement, d’après le système d’Hérodote, (si ce système est encore adopté,)
nommer cette partie du continent, comme on a nommé le reste de l’Egypte le produit du Nil.
Les vaisseaux des Chrétiens n’ont pas la liberté d’entrer dans ce port ; & cela seulement parce qu’on veut
éviter que les (p. 18) femmes musulmanes ne soient vues, lorsqu’elles prennent l’air le soir à leurs fenêtres.
Cette considération a été jugée assez puissante par les Princes chrétiens pour les engager à s’y soumettre ;
& elle l’emporte sur la perte continuelle des richesses & des hommes, qui périssent dans les navires jetés à
la côte.
Lorsqu’Alexandre604 revint de la Lybie en Egypte, il fut frappé de l’heureuse situation & de la beauté de ces
deux ports. L’architecte Dynocharès605 , qui l’accompagnoit, traça soudain le plan d’Alexandrie, & Ptolémée I
la fit bâtir.
La campagne qui l’environne, & qui forme en partie le désert de Lybie, est stérile, affreuse, mais salubre ; &
ce fut une raison de plus pour faire préférer cette situation aux terreins humides & mal-sains de l’Egypte.
Cependant il n’y avoit point d’eau (p. 19) à Alexandrie, & Ptolémée fut obligé d’en tirer du Nil, par un canal
vulgairement appelé de nos jours, le canal de Cléopâtre, quoiqu’indubitablement il soit aussi ancien que la
ville même d’Alexandrie.
Toutefois si l’on a remédié dans l’origine à l’eau, qui manquoit à Alexandrie, cet inconvénient ne lui en est
pas devenu moins fatal par la suite ; & c’est une des principales causes de l’état de décadence où elle est
maintenant.
Sa situation la rend si importante & si favorable au commerce, que, dans toutes les guerres, chaque parti a
cherché à s’y établir. Il est aisé de la prendre, parce qu’il n’y a point d’eau ; & comme la même raison
empêche qu’on la conserve, les vainqueurs ont toujours essayé de la détruire, de peur que leurs ennemis, la
possédant à leur tour, n’en tirassent un trop grand avantage.
Nous ne devons peut-être pas supposer (p. 20) que la campagne, qui environne Alexandrie, fût aussi stérile
dans le tems de la prospérité de cette Ville, qu’elle le paroît maintenant. Nous voyons, par l’exemple de la
plupart des anciennes villes répandues dans les déserts de l’Afrique, que tandis qu’elles sont habitées, il y a
tout autour de plantes & des cultures, qui contiennent les sables, & les empêchent d’être emportés, çà & là,
par les vents.
J’imagine que les lacs qu’on voit en Egypte, en si grand nombre, sont des réservoirs, creusés pour
conserver de l’eau, & arroser les plantations, dans les mois où le Nil décroît. Le grand effet que peut
produire un peu d’eau sur la terre, s’apperçoit le long du canal de Cléopâtre, par la quantité d’herbes &
d’arbustes qui y croissent, ainsi que par les belles plantations de dattiers. Aussi je ne doute pas que, du
tems des Ptolémées, ces cultures ne fussent mieux soignées & ne s’étendissent bien plus loin.
(p. 21) La colonne de Pompée, les obélisques & les citernes souterraines, sont à présent toutes les
antiquités qu’on trouve à Alexandrie. Plusieurs Voyageurs les ont décrites savamment, & dans le plus petit
détail.
Le feuillage & le chapiteau de la colonne ont été assez généralement improuvés. Mais le faîte mérite
beaucoup d’attention.
La colonne entière est de granit, à l’exception du chapiteau qui paroît d’une pierre moins belle. Je
soupçonne que les feuilles, grossièrement taillées, qu’on y voit, étoient destinées à supporter des feuilles de
métal, ou des sculptures plus précieuses ; car le chapiteau a neuf pieds de haut, & les feuilles de pierres
proportionnées, auroient dû non-seulement être très-larges, mais mieux travaillées, & en état de résister aux
injures du tems.
(p. 22) Ce magnifique monument paroît, pour le goût, avoir été fait au siècle d’Adrien ou de Sévère. Mais
quoique le premier de ces Empereurs ait fait élever plusieurs édifices en Orient, on remarque qu’il ne les a
jamais chargés d’aucune inscription.
La colonne de Pompée portoit une inscription grecque. Aussi je crois qu’elle a été élevée sous le règne de
Sévère, comme un monument de la reconnoissance qu’Alexandre devoit à ce Prince, pour tous les bienfaits
qu’il lui avoit accordés. D’ailleurs aucun des Historiens, qui ont écrit avant le règne de Sévère, ne parle de ce
monument.
Je pense que la colonne vient de Thèbes dans la Haute-Egypte, & fut portée en bloc par le Nil. Il y a
cependant des personnes, qui ont imaginé que c’étoit un ancien obélisque, qu’on a depuis arrondi. Sa
longueur, de 80 pieds, auroit dû vraiment en faire un obélisque prodigieux, & il eût fallu qu’il eût été bien
large, pour pouvoir ensuite, (p. 23) dans une forme ronde, conserver la circonférence qu’il a, & être poli au
point de ne pas laisser apercevoir une trace des hiéroglyphes, qui devoient avoir été profondément gravés
sur les quatre faces.
Le tombeau d’Alexandre a été cité comme un des monuments de la ville à laquelle ce conquérant célèbre
donna son nom. Marmol606 raconte l’avoir vu en 1546. C’étoit, suivant lui, un édifice assez petit, bâti en
forme de Chapelle, dans le milieu de la ville, & près de l’église Saint-Marc. On le nommer Escander.
Ce récit n’est nullement probable : car tous ceux qui ont conquis Alexandrie dans les derniers siècles,
respectoient trop la mémoire du vainqueur de Darius, pour n’avoir pas pris le plus grand soin de son
tombeau. Les Sarrasins même n’auroient pas manqué de l’épargner ; & Mahomet a parlé (p. 24)
d’Alexandre comme d’un grand Roi, & comme d’un Prophète. Du tems de Strabon607 le corps de ce Prince
étoit conservé dans un cercueil de verre, après avoir été enlevé du cercueil d’or dans lequel on le déposa à
sa mort.
Les Grecs sont, pour la plupart, bien instruits de l’histoire de ces contrées, que les Cophtes, les Turcs & les
Chrétiens ; & après les Grecques, la connoissance la plus étendue des faits appartient aux Juifs.
Comme j’étois parfaitement bien déguisé, ayant porté pendant plusieurs années l'habit arabe, je ne fus
soumis à aucune gêne. Je me promenai à ma fantaisie dans les différents quartiers de la Ville, accompagné
par toutes les personnes de différentes Nations que je pouvois engager à me suivre. Je parlois
continuellement la langue (p. 25) arabe et on ne me prenoit que pour un Bédouin. Mais malgré tout
l'avantage que la liberté attaché à mon costume me procuroit, malgré toutes mes recherches, je ne pus
jamais rien apprendre touchant le tombeau d'Alexandre. Les Grecs, les Juifs, les Maures, les Chrétiens, me
parurent à cet égard également ignorans.
Alexandrie a été souvent conquise depuis César. Elle fut pour la dernière fois détruite par les Vénitiens & les
Habitants de l’isle de Chypre, quelques tems après la délivrance de Saint-Louis ; & nous pouvons dire d’elle,
comme de Carthage, periere ruinæ. Ses ruines même ont disparu.
Ses portes & les murailles, qui l’entourent à présent, & que quelques personnes ont cru être fort anciennes
ne paroissent pas avoir été bâties avant le treizième siècle. (p. 26) S’il y en a quelques portions d’une date
plus reculée, elles ont pu avoir été élevées par les derniers Califes qui précedèrent Saladin ; mais, à
l’exception de ces morceaux d’architecture, & des débris de colonnes, qui font placés horizontalement dans
divers endroits des murailles, tout les reste semble être fait dans les derniers tems, & même avec beaucoup
de précipitation.
Ce seroit vainement qu’on desireroit un plan de ce qu’étoit cette Ville fameuse, & qu’on essaieroit de retracer
l’ouvrage du Macédonien Dynocharès. Les débris de ses anciennes ruines sont profondément ensevelis
sous le sable, ou détruits par les dévastations des barbares ; & si Cléopâtre revenoit au monde, il lui seroit
impossible de reconnoître l’endroit où étoit situé son palais.
La seule chose qui puisse plaire maintenant dans Alexandrie, c'est une assez belle rue, bâtie à la moderne
et habitée par un (p. 27) grand nombre de marchands, pleins d'intelligence et d'activité, lesquels se
partagent les restes de ce commerce, qui fit autrefois la gloire et la splendeur d'Alexandrie.
Cette ville est fort peu peuplée. Les Habitants racontent qu’il a été question plus d’une fois de l’abandonner
tout-à-fait, pour se retirer à Rosette ou au Caire : mais qu’ils en ont été empêchés par plusieurs Prophètes
arabes, qui leur ont prédit que la Mecque étant détruite, (comme on croit dans le pays qu’elle doit l’être par
les Russes,) Alexandrie deviendra la Ville sainte, le corps de Mahomet y sera transporté. Ensuite, quand
Alexandrie sera détruite à son tour, les reliques du Prophète passeront à Carouan, dans le Royaume de
Tunis ; & enfin de Carouan à Rosette, où elle demeureroient jusqu’à la consommation des siècles, qui ne
sera pas alors très-éloignee.
Ptolémée place Alexandrie par les (p. 28) 30° 31’ de latitude Nord, & dans son Almagest par les 31°.
Notre professeur Greaves, dont l’un des motifs, dans son voyage d’Egypte, étoit de déterminer la situation
de cette Ville, paroît pourtant s’être trompé dans ses observations. Quoiqu’il eut un sextant de cinq pieds, il
a, d’après le medium de ses differens calculs, assigné à Alexandrie, 31° 4’ de latitude Nord, tandis que les
astronomes de l’Académie des Sciences de Paris, l’ont mise par les 31° 11’ 20’’ ; de sorte qu’entre le calcule
de M. Greaves & celui des François, il y a 7’ 20’’ de différence ; ce qui est beaucoup trop. Il n’y a rien à
présent qui puisse excuser une pareille erreur, comme du tems de Ptolémée. La nouvelle ville d’Alexandrie
est bâtie de l’Orient à l’Occident ; & comme tous les Voyageurs chrétiens font nécessairement leurs
observations sur la même ligne, il ne doit point y avoir de différence dans la situation.
(p. 29) M. Niebuhr donne 31° 12’ de latitude ; mais n’a point dit s’il avoit fait une seule ou plusieurs
oobservations. Pour moi, j’en ai fait trente-trois, avec un Quadrant de trois pieds, & j’ai trouvé 31° 11’ 16’’ ;
de sorte qu’en prenant le medium de ces trois calculs, il résulte que la latitude d’Alexandrie est de 31° 11’
32’’, ou en nombres ronds 31° 11’ 30’’, je ne pense même pas qu’il puisse y avoir 5’’ de différence.
Par un éclypse du premier satellite de Jupiter, que j’observai le 23 Juin 1769, je trouvai la longitude de
30° 17’ 30’’ à l’Est du méridien de Gréenvich.
Nous arrivâmes, le 20 juin, à Alexandrie, & nous apprîmes que la peste avoit ravagé cette Ville, & les
environs depuis le commencement de Mars. Il n’y avoient que deux jours que les habitans ouvroient leurs
maisons pour communiquer les uns avec les autres. On ne craignoit plus rien. Le jour de Saint-Jean étoit
passé ; la rosée (p. 30) miraculeuse tombée, & chacun vaquoit à ses affaires sans plus songer à la maladie.
J’eus un extrême plaisir en recevant tous mes instrumens. Je les examinai avec soin ; et le bon état, où ils
étoient, fut pour moi une nouvelle preuve de la reconnoissance que je devois à mes correspondans & à mes
amis. Muni alors de tout ce qu’il me falloit pour suivre le cours de mes entreprises, j’abandonnai le sentier
battu qu’offrent les recherches des tristes restes de la fameuse Capitale de l’Egypte.
On se rend ordinairement par terre d’Alexandrie à Rosette, parce que l’entré du bras du Nil, qui conduit dans
cette dernière Ville, & qu’on nomme le Bogaz, est embarassée, dangereuse, & tient souvent beaucoup de
tems les vaisseaux qui veulent y passer. »
- 678 - 681 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
FRANÇOIS DE TOTT (début juin au 12 juin 1777)
Tott, F. de, Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1784-1785.
François de Tott (1733-1793) est capitaine de régiment. En 1776, le ministre de la marine le charge
d’inspecter les consulats dans les Échelles du Levant et de Barbarie. L’objet de cette mission est de signaler
les abus dans les établissements consulaires. D’après les souhaits du naturaliste Buffon (1707-1788), il est
accompagné de Sonnini de Manoncour (1751-1812), voyageur de ce corpus.608
p. 7-8, 16, 22, 24, 28-37 (vol. IV) :
« Après notre départ de la Canée, la frégate mouilla à l’abri de cette île, d’où nous fîmes voile dans les
premiers jours de Juin pour nous rendre à Alexandrie. Les vents qui, à cette époque sont alisés de l’Ouest
au Nord sans jamais agiter la mer, permettant aux navigateurs de calculer l’instant de leur arrivée en Egypte.
J’observai, pendant le cours de cette navigation, une vapeur que le vent pressait devant nous, & qui
résistant à l’attraction du Soleil, & s’épaississant chaque jour, ne nous parut se former en nuages brumeux
qu’à l’approche du rivage d’Egypte, que l’aspect de la colonne de Pompée nous anonça avant de le
découvrir. Mais nous vîmes bientôt paraître le Château du Phare, & après avoir doublé le diamant, la frégate
mouilla dans le port neuf d’Alexandrie. Je dépêchai le même jour un exprès au Consul du Caire pour le
prévenir de mon arrivée, & requérir du Gouvernement les moyens de remonter le Nil jusqu’à la Capitale. Le
Vice-Consul du (p. 8) Caire accompagné de quatre Négocians & d’un Aga des Mamelucs, arrivèrent le
11 juin au matin, de Rosette, où ils avaient laissé les bateaux qui les avaient amenés, & que le Chék-Elbélet
envoyait pour me transporter au Caire. La mésintelligence qui commençait à se manifester entre les Beys, &
sur-tout la sortie des Murats, qui avec quelques troupes venait de quitter la capitale sous le pretexte de
soumettre les Arabes de la Charkié, mais en effet, pour vexer l’Egypte, rendaient cette précaution
nécessaire à ma sûreté. Nous partîmes le 12 au soir pour nous rendre à Rosette, afin d’éviter la grande
chaleur pendant la route de 12 lieues que nous avions à faire.
(p. 16) Le Nil dont j’avais observé la croissance, était parvenu au degré qui permet l’ouverture du canal de
Trajan. Les crieurs publics destinés à annoncer au peuple, la crue journalière du fleuve, venaient de
proclamer la fête de l’Arroussée609 ; mais nonobstant ces préparatifs, & ceux qu’on faisait pour poursuivre
les fuyards, j’obtins du Chek-Elbélet les moyens de retourner à Alexandrie, & je m’embarquai sur les mêmes
bateaux qui m’avaient amené, pour reprendre une navigation d’autant plus agréable, que l’élévation des
eaux permettait alors de parcourir des yeux la plus peuplée comme la plus riche contrée de l’univers.
(p. 22) C’est sans doute pour se prémunir contre les années où le Nil laisserait beaucoup de terres sans
anscement que les anciens Souverains de l’Egypte firent construire cette infinité de canaux, dont les
principaux sont encore entretenus ; mais dont le plus grand nombre a été abandonné ; & par une suite
nécessaire, plus de la moitié de l’Egypte, sans culture. Les plus soignés par le gouvernement, sont ceux qui
portent l’eau au Caire, dans la province du Fayoume, & à Alexandrie. Un officier préposé à la garde de ce
dernier, veille pour empêcher les Arabes de la Bachiré, qui jouissent du superflu des eaux de ce canal, de
les détourner avant qu’Alexandrie soit pourvu, ou de l’ouvrir avant le tems fixé, ce qui empêcherait la crue du
Nil.
(p. 24) Le sol de l’Egypte est effectivement si bas que ce n’est qu’à quelques monticules formées par les
décombres de l’ancienne Alexandrie, & à la prodigieuse élévation de la colonne de Pompée, qu’on peut
reconnaître cet atterissage ; toute la côte forme horison, & l’on apperçoit à trois lieues en mer, que quelques
palmiers qui paraissent sortir de ses eaux ; ce n’est pas cependant à ce seul nivellement que l’Egypte doit
l’inondation périodique qui l’arrose.
(p. 28) Les vestiges des canaux qui arrosaient les Provinces de l’O. & de l’E. du Delta, annoncent que
l’ancienne Egypte y avait ménagé la plus riche culture. On doit aussi présumer par l’étendue des ruines
d’Alexandrie, la construction du canal, & le nivellement naturel des terres qui entourent le lac Maréotis, &
s’étendent à l’O. jusqu’au royaume de Barca ; que ce pays aujourd’hui livré aux Arabes, & presque sans
culture, était aussi riche en productions de tout genre, que la ville d’Alexandrie l’exigeait pour sa propre
subsistance.
On observe par la disposition du canal d’Alexandrie, qu’en servant à abreuver cette ville, & à faciliter son
commerce, il devait encore en prolongeant la partie supérieure des terres cultivables qui sont à la rive
gauche du Nil, vis-à-vis le Delta, servir à les fertiliser, en même-tems qu’une digue construite au Béquers,
reculer les bornes de la mer, pour ajouter à l’Egypte un grand terrein dont (p. 29) la culture touchait aux
faubourgs de cette immense ville, reduite aujourd’hui à un petit bourg bâti sur le nouvel isthme qui s’est
formé entre les deux ports, & qui réunit l’île du Phare, à la terre ferme ; cette Capitale du commerce de
l’univers, comdamné depuis long-tems à ne servir que d’entrepôt aux consommations de l’Egypte, semble
s’être exilée elle-même de ses propres murailles ; mais on ne peut jeter les yeux sur l’étendue & la
magnificence de ses ruines, sans appercevoir que les plus grands moyens n’ont de valeur que dans la
proportion du siècle qui les emploie, & du génie des hommes placés pour les employer.
L’Egypte située pour associer à son commerce, l’Europe, l’Afrique, les Indes, avait besoin d’un port. Il devait
être vaste, & d’un abord facile, les bouches du Nil, n’offraient aucun de ces avantages, le seul port qui fut sur
cette côte, placés à douze lieues du fleuve, dans un désert, ne pouvait être apperçu que par un génie hardi :
il fallait y bâtir une ville, ce qui lui en dessina le plan. A quel degré de splendeur n’a-t-il pas porté Alexandrie
dans sa naissance, il la joignit au Nil, par un canal navigable, & utile à la culture, elle (p. 30) devint la ville de
toutes les Nations, la métropole du commerce ; il en honore les cendres que les siècles de barbarie ont
amoncelés, & qui n’attendent qu’une main bienfaisante qui les delaie, pour cimenter sa construction du plus
vaste édifice que l’esprit humain ait jamais conçu.
Le fond de roche qui borde la côte d’Egypte, démontre que l’île du Phare n’a pu être formée que du produit
des cendres d’Alexandrie, & que le bas-fond qui séparait les deux bassins, s’est élevé par les décombres
que la mer y a repoussé. Ce nouveau rivage atteste encore la vérité de cette observation, & les vagues y
mettent journellement à découvert nombre de pierres gravées, qui ne peuvent appartenir qu’aux décombres
de l’ancienne ville.
Ses ruines offrent à chaque pas le témoignage de son ancienne splendeur, & le manteau Macédonien que
son enceinte représente, en rappelant le fondateur, semble en avoir imposé aux Barbares dans les différens
saccagemens de cette ville. Les mêmes murailles qui garantissaient son industrie & ses richesses,
défendent encore aujourd’hui ses ruines, & presentent un chef-d’oeuvre de maçonnerie.
(p. 31) Quelques historiens prétendent que les Sarrasins ont substitué cette enceinte à l’ancienne qu’ils
avaient détruit ; mais si l’on pouvait reconnoître la main de ces déprédateurs, ce ne pourrait être que dans
les parties réparées, aussi dépourvues de propreté que de régularité ; on ne peut leur accorder la
construction des murs qui séparent Alexandrie de Nécropolis, il ne serait pas plus absurde de leur attribuer
l’élévation de la colonne de Pompée.
Ce monument dont l’objet & le fondateur sont également inconnus, placé près du canal, entre Nécropolis &
les murs d’Alexandrie, devait appartenir au faubourg qui, suivant les Auteurs, joignait le lac Maréotis. On
pourrait conjecturer par des fragmens de granite rose, & sur-tout par les anciennes fondations qui
environnent cette colonne, qu’elle était élevée au milieu de la place marchande ; mais sans porter nos
recherches au delà des bornes posées dans l’obscurité des tems, le seul examen de ce monument suffit à
l’admiration. Je ne répéterai pas la description que M. Maillet & différens voyageurs en ont donnés. Je me
bornerai à faire remarquer que cette masse énorme posée sur une pierre moitié moins grande que le
stilobate qui s’y appuie (p. 32) centralement, n’est soutenu depuis tant de siècles que par l’adhérence
précise des deux plans & la perfection de leur coupe horisontale. Ce point d’appui, que l’on peut examiner
librement par une excavation faite dans le blocage qui semblait soutenir la base, est un morceau de granite
enfoncé à plus ou moins de profondeur dans le roc calcaire qui compose le sol. L’inspection des
hiéroglyphes gravés sur la face que l’ouverture a mise à découvert, pourrait faire supposer qu’on a employé
pour cette pierre fondamentale, un fragment d’obélisque. Il paraît cependant plus naturel de penser que ces
caractères présentent l’historique de cette colonne.
Le parfait à-plomb que je viens de démontrer, ne laisse aucun doute sur la pose perpendiculaire & succesive
du stilobate, de la base, du fût & du chapiteau ; mais il n’est pas si aisé de concevoir les moyens employés
pour élever ce même fût d’un seul morceau de granite rose de plus de quatre pieds de module, d’ordre
corintien. Ce travail n’a pu s’effectuer sans le secours des grues, & cette observation ramenerait à croire que
l’imitation du corbeau d’Archimède, nous a précédé en Egypte ; ce qui n’est pas plus surprenant que (p. 33)
de trouver sous les laves du Vésuve, la représentation du valet & de la varlope de nos Menuisiers.
Ce monument n’est pas le seul dont le hardiesse étonne ceux qui abordent en Egypte, & l’aiguille de
Cléopâtre, non moins difficile à élever, ne permet pas d’attribuer aux arts de la Grèce des travaux répandus
avec profusion dans la haute Egypte. On observe même, dans le chapiteau de la colonne de Pompée, une
imitation trop grossière des feuilles d’acanthe, pour n’y pas reconnaître des mains plus accoutumées à
mouvoir ces masses énormes, qu’à manier le ciseau de Phidias. Celui des Egyptiens n’offre quelque
délicatesse que dans l’incision des hiéroglyphes. L’aiguille de Cléopâtre en est chargée sur les quatre
faces ; sa base cachée sous des décombres, ne permet pas de juger de son point d’appui ; mais l’examen
d’une semblable aiguille renversée & brisée près de la première, démontre qu’elles ont été toutes deux
posées sur quatre dez de bronze. On apperçoit aussi que ces deux obélisques alignées sur deux gros corps
de bâtiments à des distances égales, décoraient cet emplacement dont les vestiges manifestent un Palais.
On croit y reconnaître celui de Cléopâtre. (p. 34) J’ai vu plus distinctement dans une rotonde assez bien
conservée, & sur-tout dans plusieurs cachots qui l’environnent, le tribunal de justice, & j’ai été étonné de la
conservation de l’enduit qui en couvre les murs.
Des signes encore moins équivoques font reconnaître la principale place d’Alexandrie, plusieurs colonnes
dont deux placées au centre d’un des côtés de la place, & vis-à-vis un énorme amas de voûtes écroulées,
en désigant l’entrée du principal Temple, ne laissent pas de doute que ces ruines n’appartiennent à celui de
Jupiter Sérapis. Si l’esprit de destruction n’était pas toujours paresseux & ignorant, ces précieux débris
disparaîtraient plus promptement. J’ai vu les Barbares qui en sont dépositaires, occupés à fendre des
tronçons de colonnes pour en faire des meules de moulin, & j’ai eu la satisfaction de voir leur travail rendu
inutile par leur mal-adresse. Si ces motifs conservent les grandes masses, les statues ne peuvent échapper
à l’avarice qui les découvre ; mais ce n’est jamais qu’après avoir satisfait au fanatisme par la mutilation de
ces prétendues idoles, que les Arabes viennent les vendre aux Européens. Le peu de (p. 35) profit qu’ils en
retirent, en n’excitant point leurs recherches, les empêchent heureusement de fouiller ces décombres, &
réserve à nos neveux ce précieux dépôt.
Les faubourgs d’Alexandrie, celui qui joignait Nékropolis, & celui dont on distingue encore les rues dans la
plaine qui conduit à Rosette, contiennent sans doute beaucoup de richesses enfouies sous leur ruines, &
l’emplacement de Nékropolis est couvert de monticules qui invitent à considérer dans ces amas les débris
des Temples & des Monumens élevés par la piété superstitieuse des anciens Egyptiens. J’ai visité avec soin
les catacombes de cette ville, (le cimetiere d’Alexandrie) ; & quoiqu’il ne soit pas possible de les comparer
avec celles de l’ancienne Memphis, que les Arabes dérobent aux curieux, afin de leur vendre plus
certainement les momies qu’ils désirent, il est probable que la méthode des embaumemens étant la même,
la forme de ces catacombes ne peut différer que dans leurs proportions. On observe même que la nature
n’ayant pas offert dans cette partie de l’Egypte un banc de (p. 36) roches semblable à celui qui borde le Nil
au dessus du Delta, les anciens habitans d’Alexandrie n’ont pu s’en procurer l’imitation, qu’en faisant
d’abord un espèce de chemin creux dans le plateau de roc vifs qu’ils destinaient à Nékropolis. Cette
excavation de trente à quarante pieds de large, sur une longueur de deux cents & vingt-cinq de profondeur,
est terminée par des pentes douces à ses extrémités ; les deux côtés, taillés perpendiculairement,
contiennent plusieurs ouvertures larges & hautes de dix à douze pieds creusées horisontalement, & qui
forment par leur différens rameaux des rues souterraines. Celle de ces couvertures que la curiosité a
débarassé des décombres & des sables qui rendent l’entrée des autres incommode ou impossible, ne
contient plus de momies ; mais on y voit encore les places qu’elles occupaient, & l’ordre dans lequel elles y
étaient rangées : des trous de vingt pouces en carré, creusés de six pieds horisontalement, retrécis dans le
fond, & séparés l’un de l’autre par des cloisons de sept à huit pouces d’épaisseur ménagée dans le roc,
divisent en échiquiers les deux parois de ce souterrain.
Il est facil de juger, par cette disposition, (p. 37) que chaque momie entrait par les pieds dans la case qui lui
était destinée, & qu’on ouvrait de nouvelles rues à mesure que les habitans de Nékropolis se multipliaient. »
608 Guérard, B., « Tott, François de », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.), Biographie Universelle
ancienne et moderne 46, Paris, 1827, p. 311-314.
609 De l’arabe `Arūsa (fiancée).
- 682 - 684 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MARIE-DOMINIQUE DE BINOS (juillet 1777)
Binos, M.-D. de, Voyage par l’Italie, en Egypte, au Mont Liban et en Palestine, Paris, 1787.
L’abbé de Binos (1730?-1804) naît vers 1730 à Saint-Bertrand de Comminges dans une ancienne et notable
famille du comté de Foix. Il embrasse l’état ecclésiastique et est pourvu d’un canonicat de la cathédrale de
Comminges.610
p. 222-248 (tome I) :
« D’Alexandrie en Egypte, le 15 juillet 1777
M.
Cette ville, autrefois si belle, fait bien voir que la main cruelle du temps se joue du travail des hommes. Sa
double enceinte, ornée de tours de distance en distance, n’existe aujourd’hui que pour conserver à la
postérité ses tristes débris : telle en est l’horreur, que les nouveaux habitants ont préféré de bâtir dans
l’espace qui est entr’elle & la mer, plutôt que sur les monceaux de superbes monumens entassés les uns sur
les autres, aimant mieux donner à la crainte un air de respect pour ces misérables restes, que de poser des
fondemens sur les dépouilles de la vanité. Alexandrie a été appellée par les historiens sacrés Noammon, &
par les profanes Babylone : le nom qu’elle porte aujourd’hui lui vient d’Alexandre le Grand, qui la fit bâtir au
troisieme siecle avant l’Ere chrétienne, & qui la rendit capital du Royaume de l’Egypte qu’il venoit de
soumettre à la domination. Tout y etoit beau, & annonçoit la grandeur du souverain qui en étoit le maître ;
c’est-là qu’étoit le fameux Serapium, ou Gymnase, dont les historiens contemporains ont donné la
description, qui, toute intéressante qu’elle est, n’est qu’un foible dédommagement de la perte de l’original.
Ce beau Temple, dans lequel les Ptolémée mirent une bibliotheque composée de livres très-précieux, étoit
consacré aux fausses divinités, & servi par des Prêtres païens. Il surpassoit en beauté et en étendu ceux qui
étoit répandus dans les différentes contrées de l’Egypte, de la Phénicie & de la Grece, connus sous les
noms de Temple d’Isis, de Diane, d’Ephèse, de Jupiter, d’Apollon, de Minerve & d’autres faux-dieux. Le
Serapium étoit élévé sur une plate-forme faite de mains d’hommes, & soutenue par des arcades & des
voûtes souterraines qui servoient à différens usages secrets : on y montoit par plus de cent degrés de pierre.
Il étoit placé au milieu de l’espace, & environné de tous cotés par de magnifiques portiques carrés, & par
plusieurs rangs de bâtimens qui servoient de demeure aux ministres ; on ne peut rien ajouter à la
magnificence de ce lieu. Le dehors étoit orné de colonnes de marbre le plus précieux ; le dedans étoit revêtu
d’or, d’argent & d’airain ; il ne prenoit de jour que par un petit trou qui étoit du côté de l’Orient ; en sorte que
le soleil venant à se lever, envoyoit ses rayons sur la bouche de l’idole qui étoit placée vis-à-vis au fond de
ce temple. Aucune de ces beautés n’existe plus aujourd’hui ; & s’il est dans ces vastes débris quelques
beaux restes, on les admire plus les idées qu’ils font naître, que par leur beauté intrinsèque. Les autres
anciens monumens qui se sont le mieux conservés, sont les obélisques, les colonnes, les citernes, les
réservoirs, quelques palais, entr’autres celui qu’on dit avoir appartenu à Armide, dont le Tasse a parlé : le
nombre des colonnes est encore assez considérable ; on en voit des couchées à terre, d’autres debout, de
trente pieds de hauteur, & qui en auroient bien davantage si l’on dégageoit leur base des matériaux qui les
couvrent. L’obélisque de Virgile est près du somptueux palais d’Armide ; celui de Cléopatre est hors
l’enceinte de l’ancienne ville ; ils sont de granite rouge, & chargés d’hiéroglyphes. La plus majestueuse des
colonnes que j’y aie vu, est celle de Pompée. Elle est hors la ville, située sur un lieu qui rend son élévation
plus sensible : elle a quatre-vingt-deux pieds cinq pouces six lignes de hauteur, en y comprenant le
piédestal. A une lieue de la ville commence un canal dans lequel le Nil croissant envoie ses eaux, & un
second canal moins large les conduit aux réservoirs & aux citernes de la ville ; on en ferme la porte lorsque
tout est plein. Le nombre des citernes va à plus de trois cents : leur profondeur est double de celle de nos
puits ; cent suffisent pour abreuver vingt-quatre mille habitans. L’ouverture de chacune est un rond de
marbre blanc de trois pieds de diametre, qui paroît à fleur de terre. Les réservoirs, qui sont très-nombreux,
sont deux & trois fois plus profonds et plus larges qu’elles. Si l’on y jette une pierre, on n’entend le bruit de la
chute que long-temps après. Ils sont bâtis comme les citernes en marbre & en pierre de taille ; mais ce qui
rend ces ouvrages encore plus admirables, c’est la distribution compliquée de tant de canaux qui portent les
eaux à cette grande quantité de citernes & de réservoirs épars ça & là. Ces belles commodités doivent leur
conservation au besoin, plus qu’à l’amour de ce nouveau peuple pour les belles choses ; son indifférence
léthargique à cet égard est sans exemple : le regne des esclaves devenus Princes est bien différent de celui
des Rois qui enchaînoient la servitude pour laisser au génie & au goût toute leur liberté. Les anciens Rois
des Egyptiens, Menès, Meris, Sésostris, les Pharaons, consacroient à des monumens utiles les trophées de
leurs victoires : ceux d’aujourd’hui qui gouvernent les peuples de ce même climat, les font servir, par l’effet
du pouvoir despotique, à leur ambition & à leur vengeance. Un peuple d’étrangers et de vagabonds infeste
les routes & les campagnes : le passager trouve presque toujours sur ses pas des gens qui l’arrêtent ou le
depouillent ; il est toujours tourmenté par la crainte. Il est bien fâcheux pour la noble curiosité de n’avoir pas
un libre effor dans les lieux où elle pourroit le plus se satisfaire.
Je suis, &c.
Alexandrie, le 18 juillet 1777
M.
La ville telle qu’elle existe aujourd’hui, n’a guères plus de vingt mille habitans, d’après le rapport des
François qui y sont. Elle a deux ports, l’un pour les vaisseaux turcs, l’autre pour les etrangers ; tous deux
sont beaux, mais celui des turcs est plus sûr & plus vaste. Il y a dans la ville des troupes, & un commandant
qui releve du Bey résidant au Grand Caire. Ses appointemens sont tirés des revenus de la douane, dont les
droits sont exorbitans pour les Turcs ; ils payent onze pour cent, tandis que les Francs ou les autres
étrangers ne payent que trois. Mais si ceux-ci portent les denrées dans les lieux où l’on ne progresse pas
publiquement la Religion Chrétienne, ils payent jusqu’à dix-sept pour cent. Les principales productions du
pays sont le riz, le lin, le coton & la laine : on y voit différens fruits, des bananiers, des orangers, des
citroniers, des palmiers ou dattiers : ceux-ci sont élevés et droits, n’ayant de branches qu’au somment de la
tige ; les feuilles & les branches ressemblent à celles des roseaux ; leur fruit oblong a la grosseur des glands
des plus beaux chênes ; sa couleur au moment de sa maturité, ressemble à la pourpre. On voit beaucoup de
tamarins & d’autres arbres assez communs en Egypte, dont je parlerai lorsque j’en aurai pénétré l’intérieur.
Le gouvernement est cruel, ainsi que dans tous les lieux où les Beys exercent leur souveraineté. Le peuple
a, dans la figure, je ne sais quoi d’effrayant au premier abord. La religion Mahométane est la dominante. On
appelle Mosquées les lieux où l’on va exercer le culte public ; elles sont bâties en rotondes ou en carré long.
Les fidèles musulmans s’y rendent le vendredi, qui est un jour de fête pour eux, comme le dimanche & le
samedi le sont pour les Chrétiens et les Juifs : leurs prêtres y lisent au peuple assemblé des passages du
Coran, qui est leur loi. Leurs cimetières sont couverts de sépulcres de pierre de taille, au bout desquels est
placée une pièce de bois à quatre palmes de large, travaillée en forme de turban ou de croissant. Les Morts
sont portés dans la Mosquée la tête en avant, puis dans le cimetière ; on fait des prieres particulieres pour
eux dans ces deux endroits. Les pleurs, les gémissemens sont les compagnons du convoi funebre comme
par-tout ailleurs. Il y a dans chaque Mosquée un édifice fait en pyramide ou en forme de thiare, entouré
d'une balustrade ; c'est du haut de ces minarets que l'Arabe crie cinq fois le jour qu'il faut aller à la prière ; sa
voix est la cloche du quartier. La plus vaste & la principale mosquée est celle qui sert aux grands jours
solemnels, tels que le Bairan & autres fêtes de leur religion, qui y attirent une grande affluence. Près de ces
temples sont les tombeaux de leurs Saints.
Sur les fondemens de l’église de sainte Catherine, qui étoit dans l’ancienne ville, est une moquée bâtie en
rotonde, entourée d’une forêt de palmiers : moyennant une modique somme que les Arabes appellent le
Bacchis, j'entrai un vendredi à quatre heures du soir dans celle qui est placée dans un coin de l'Église de
St Athanase. Patriarche d'Alexandrie. Les cérémonies de Religion étant finies, et le peuple sorti, le
Concierge me conduisit par une petite porte dans le vaste espace de ce temple, anciennement desservi par
les plus savans Prélats qu'ait fourni l'Église grecque & maintenant profané par les lotions impures des zélés
sectateurs de Mahomet. Au milieu de la nef est un réservoir de verd antique, de huit pieds de long et de
quatre de large, dont l'eau est versée par des griffons sur les parties du corps que veulent purifier ceux qui
vont faire leur prière dans la Mosquée voisine. Les murs de ce grand édifice sont revêtus de tables de
marbre poli. Cent trente colonnes de douze pieds de hauteur, partie de granit et de marbre du pays,
soutiennent les différents arceaux rangés aux côtés de l'église, dans un desquels on voit une grande niche
revêtue de mosaique brute, à l'instar de celles que l'on voit à Venise dans l'Église de Saint-Marc. Un coin de
cette grande enceinte, fermé par une palissade, est destiné à la sépulture des Nationaux Mahométans, qui,
par des actions religieuses, ont mérité la vénération de leur secte, ou, selon le rapport des citoyens, à celles
de leurs prêtres, qu’ils appellent Imans. La Mosquée renfermée dans cette grande Église est petite, et faite
en carré long. Une salle dont le sol est couvert de nattes, des bancs, une niche dans laquelle est une lampe
tantôt éteinte, tantôt allumée, font tous ses ornemens. Aucun peuple n’a jamais été moins recherché que
celui-ci pour les Temples, malgrè les beaux modeles que l’idolâtrie née dans ces climats lui avoit laissés.
Chaque nation a un goût particulier, qui se manifeste par des effets sensibles : celui des anciens Egyptiens
se peignoit dans la grandeur des travaux publics, la beauté des édifices, la richesse des Temples, & dans ce
grand nombre d’entrées de leurs superbes villes, qui étoient comme autant d’asyles offerts à l’homme
social ; mais le goût des Egyptiens modernes n’a rien qui se fasse envier. La grandeur de leur luxe est
renfermée dans les appartemens des femmes, qu’on appelle Harem, où il est defendu d’entrer sous les plus
graves peines. Ceux qui ont eu la témérité d’y pénétrer assurent que les tapis précieux, les étoffes en or &
en soie, les pierreries, enfin tout ce qui peut fomenter la mollesse & la sensualité, y est porté au dernier
degré de magnificence, tandis que le sallon de compagnie où l’on reçoit les hommes, est meublé
très-simplement. Une chose qui étonne dans ce peuple, c’est son courage à supporter les exactions & les
vexations des souverains. Le Bey secrétement averti de la richesse d’un particulier, lui demandera une
grosse somme d’argent proportionnée ou quelquefois supérieure à l’idée qu’il a de sa fortune. Le refus
suivra sans doute la proposition, mais la prompte menace du supplice du bâton est une puissante clef qui
fait ouvrir le trésor : ce malheureux sujet le donne avec une générosité sans exemple, & se console par la
croyance que cette perte étoit dans la volonté de Dieu. On le voit dans cet état de misere, aussi tranquille
qu’avec ses trésors, s’aider d’une fermété héroïque, qui est son plus grand bien bien, & employer cette
fidelle compagne à reprendre les premiers moyens qui l’avoient insensiblement élevé au degré de fortune
dont il est déchu. Grand Dieu, s’écrit-il dans le moment fâcheux de cette crise, vous m’aviez donné ces
biens, vous les reprenez, soyez obéi en tout. Cependant la crainte de pareils événemens rend les riches
Egyptiens précautionneux & très-attentifs à cacher leur grande fortune sous les dehors d’une abjecte
simplicité. Cette qualité chérie, par la trompeuse politique, détourne quelquefois les yeux du Despote & la
défiance et l’avarice ; mais souvent lorsqu’elle est trop affectée, elle découvre le rideau à la curiosité, qui se
paye abondamment du fruit de ses recherches. Les vieux meubles déchirés, étalés dans les salles où l’on
reçoit les visites, les divans rongés par les chenilles & les vers, la modestie dans l’extérieur du train & des
habits, sont quelquefois des voiles trop transparents pour couvrir l’immensité des richesses, & pour en
imposer à l’oeil perçant de l’avidité qui s’en rend bientôt maitresse.
Lettre XLVII.
D’Alexandrie, le 20 juillet 1777.
Je voulois prendre aujourd’hui la voie de Rosette pour aller au grand Caire ; mais on me dit que les Arabes
ont quitté les déserts, que leurs courses s’étendent aux environs de cette ville, & que j’en serai infailliblement
atteint si je me mets en voyage ; ainsi j’attendrai que les chemins ne soient pas infestés de cette troupe
vagabonde, & que le mouvement, & que le mouvement tumultueux occasionné par l’ambition d’un Bey
résidant au Caire, qui a exigé d’eux une forte contribution, soit entièrement calmé. Ils cherchent à s’en
dédommager en mettant à contribution ceux qu’ils rencontrent sur leur chemin. Le désert qu’ils habitent est à
cinquante lieux d’ici : ils menent une vie pastorale, semblable à celle des temps d’Abraham ; ils se vantent
d’être les descendants des anciens ismaëlites : ils vont avec leurs troupeaux à laine, avec des vaches et des
chameaux, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, n’ayant pour équipage que des tentes qu’ils placent
aux lieux où ils s’arrêtent ; ils vivent de lait, d’olives, de figues, de biscuits & d’une pâte cuite sous la cendre,
qui leur tient lieu de pain. Ils menent une vie tranquille, mais au premier signal de guerre, ils se rassemblent
au nombre de cent mille, & quelquefois plus ; leur courage s’anime par l’amour de la liberté. Ils sont
robustes, adroits, & bon cavaliers ; ils ont d’excellens chevaux pour la course & pour la marche ; ils en ont de
maigres qu’on croiroit près d’expirer de faim que j’ai vu galoper d’une vitesse incroyable. Leur arme favorite
est la lance, ou un bâton de douze à quinze palmes de longueur, garni aux extrêmités d’un fer pointu ; ils
s’en servent avec la plus grande adresse, & le regardent comme une distinction particulière ; ils ne portent
de sabres & de pistolets que lorsqu’ils quittent leurs déserts pour se venger des torts qu’ils ont reçus du
Gouvernement, ou lorsque de plus grands besoins l’exigent. Ils dépouillent le voyageur sans le tuer, pourvu
qu’il ne résiste pas. Ils lui disent, après lui avoir tout enlevé, de leur donner ce qu’ils lui ont pris ; ainsi le don
forcé du malheureux qui tombent entre leurs mains, met le brigandage à couvert du reproche de l’injustice &
des lois particulieres qui défendent. Cependant ils sont fort hospitaliers. L’humanité a ses droits chez cette
Nation errante comme chez les plus policées : l’étranger sera dépouillé par les uns, & couvert par d’autres
qu’ils rencontrera. Leur démarche est fiere & imposante ; leur peau brunie par les chaleurs excessives du
climat, & les intempéries de l’air auxquelles ils sont presque toujours exposés, les rend désagréables à la
vue. La singularité de leur habit n’est guères propre à réparer cette laideur : une longue cape, faite de laine
de brebis & de poil de chameau, à bandes blanches & noires, un bonnet rouge brodé d’une toile blanche
assez fine qui couvre leur tête rasée, de larges culottes de lin qui leur vont jusqu’à la pantoufle, une ceinture
de toile ou de coton, une longue barbe, voilà le vêtement des Arabes. Ils sont naturellement belliqueux, mais
ils l’étoient plus dans les siècles reculés, lorsqu’après avoir soumis l’Egypte à leur domination, ils la
gouvernerent sous le nom de Rois-pasteurs deux siecles & demi après la fondation de la Monarchie
Egyptienne, d’où ils furent chassés par Amosis, qui rendit la domination aux chefs naturels du pays à qui elle
appartenoit. L’histoire ne rapporte pas qu’ils aient rien fait de remarquable depuis cette époque. Ils ont eu, il
est vrai, des guerres à soutenir avec leurs voisins, plutôt pour défendre leur liberté que pour asservir les
autres à leur joug. Leur Chef, qu’on traite de Roi, vit d’assez bonne intelligence avec le Grand-Seigneur. Ils
partagent à égales portions les offrandes qui se font à la Mecque par les Agis ou Pèlerins. Le jour de
l’élection de leur chef, ils le font jurer par le plus solemnel serment qu’il résistera aux Turcs, qu’il ne fera sa
demeure dans aucune ville ou château, & qu’il demeurera toujours en rase campagne sous les tentes & les
pavillons, & aux déserts comme leur grand-pere Kedar.
Je suis, &c.
Lettre XLVIII,
A Alexandrie, le 21 Juillet 1777
M.
Les maisons de cette ville sont, en général, bâties en pierres de taille, & ont assez d’élévation. Les rues sont
étroites, & donnent la facilité d’étendre un toit à l’autre des roseaux ou des nattes qui garantissent les
citoyens des brûlantes ardeurs du soleil ; elles sont arrosées plusieurs fois le jour ; ces précautions
diminuent l’excès de chaleur. L’hôtel de la Nation Françoise est bâti près du mole ; il sert de logement au
Consul, aux dragomans, & autres François faisant en tout le nombre de dix-huit. Les Républiques
d’Hollande, de Venise, de Raguse, l’Allemagne & l’Angleterre ont chacune un consul résidant, & leur hôtel
particulier. Ces différentes Nations n’ont de relation avec les Turcs & les Grecs habitants de la ville, que pour
des objets relatifs au commerce, & partagent entr’elles les agrémens de la société civile ; mais cette douceur
est souvent troublée par les fréquentes révolutions du Gouvernement toujours porté à saisir l’occasion
d’exercer la tyrannie envers les Etrangers. Cette animosité, arrêtée quelquefois par la crainte, a des accès
de fureur : un événement survenu quelque temps avant mon arrivée, en est une preuve sensible.
Un Perruquier Livournois & deux François étant allé à la chasse, la troisième fête de Pâques, à quelques
milles d’Alexandrie, entrerent avec leurs chiens dans un champ ensemencé de froment. Le propriétaire les
ayant apperçus, les avertit de se retirer ; le Perruquier résistant plus que les autres, fut menacé de coups de
bâton ; le chauffeur voulant éviter le mauvais traitement qui alloit s’ensuivre déchargea son fusil sur la tête
du paysan ; d’autres paysans ayant entendu le coup, accoururent au secours de leur frere-croyant, qu’ils
virent étendu mort. Ils furent aussitôt à la poursuite du meurtrier ; les deux qui n’avoient pas donné le coup,
échapèrent de leurs mains par le ministere de l’argent, mais ils retinrent le vrai coupable, & le conduisirent
devant le commandant de la ville, qui le fit pendre à l’instant. On craignoit même que la fureur des citoyens
ne se portât à massacrer la nation Françoise : les femmes donnerent dans cette occasion un spectacle de
cruauté extraordinaire ; on les voyait par un excès de rage signalée mordre & déchirer le cadavre pendu. La
Nation Françoise consternée de la catastrophe, attendoit, dans la retraite et le silence, le calme des esprits
aigris par ce tragique événement : mais quinze jours suffirent pour diminuer la fermentation ; les François
commencerent à se montrer dans la ville où on les regarda du même oeil qu’auparavant ; & tout y paraissoit
tranquille, qu’on n’auroit jamais soupçonné les projets de la plus noire vengeance. Le Consul François crut
pouvoir comme à l’ordinaire, prendre le plaisir de la promenade, escorté d’un janissaire ; il étoit déja à deux
milles de la ville lorsque le frere du défunt, imbu de l’axiome reçu dans cette nation, que la mort d’un Arabe
ou d’un vrai Croyant doit se payer par celle de cent Francs, épioit, dans les tentes placées le long de la
route, l’occasion d’exécuter son noir dessein. Le sort tomba malheureusement sur le pauvre Consul. Cet
Arabe, dont le visage étoit recouvert d’un voile noir, le voyant arriver, fit semblant de chercher au milieu du
chemin quelque chose, sans donner à comprendre que c’étoit pour se mettre plus à portée de faire son
coup. Le janissaire passa près de lui ; il ne se détourna pas, mais aussi-tôt que le Consul, qui venoit ensuite,
eut passé, il se releva, & lui tira un coup de pistolet à bout touchant, & le renversa mort. La Nation Françoise
désolée de la perte de son chef, & trop foible pour venger elle-même sa mort, eut recours au Bey résidant
au Caire afin d’obtenir une satisfation exemplaire ; il condamna la ville d’Alexandrie à lui payer trente mille
piastres. Les citoyens irrités de cette contribution, menacerent la Nation Françoise de sa perte entiere ; le
complot en étoit déjà formé, & à la veille d’être exécuté. Heureusement pour elle la crainte des canons & des
troupes françoises renfermées dans une frégate arrivée au port dans cette circonstance, changea l’infâme
conspiration en une députation des principaux de la ville vers les Dragomans, pour les supplier d’obtenir du
Bey une modération de la moitié de la contribution demandée. Cette proposition fut accompagnée de signes
de reconnaissance dont on devoit se défier ; mais quelqu’un dût être l’événement, ils furent accueillis, la
réduction fut obtenue à la sollicitation de la Nation Fraçoise, & tout reprit sa première tranquillité. La frégate
Françoise étoit en rade, & on sait que la terreur étant lâme d’un Gouvernement despotique, sa dureté ne
peut être amolie que par les mêmes moyens qui sont son soutien.
Mais si, pour rendre l’activité & la liberté au commerce, il étoit possible de tenir en station dans ces divers
parages quelque vaisseau armé & équipé de troupes de guerre, dès-lors la présence de cette forteresse
ambulante seroit la sauve-garde de la Nation, la protectrice immédiate de son commerce, & le censeur
severe de la cupidité du Gouvernement ; sans cette précaution la Nation Françoise n’aura jamais dans ce
pays qu’une existence précaire.
Je suis, &c.
Lettre XLIX,
A Alexandrie, le 22 Juillet 1777.
M.
Les Religions Grecque, Copte, Juive et Catholique sont tolérées dans cette ville, & les différens Sectaires
ont la liberté d’exercer leur culte dans les Temples bâtis dans l’intérieur des maisons : aucun n’a le privilège
d'avoir des cloches sonnantes ; toutes ont des Ministres particuliers. Les Cophtes, qu’on dit être les
descendans des anciens Egyptiens, ont une Eglise dont l’ensemble donne à croire que son antiquité
remonte à la naissance de la Religion Catholique : elle est honorée de la tête de S. Marc dans une urne qui
est placée dans leur chapelle, où l’on remarque une ancienne chaire de bois sculpté dans le goût antique.
Les Cophtes sont pour la plûpart schismatiques, & menent une vie austere & retirée : leurs jeûnes sont
fréquens & rigides ; ils suivent les rites de l’ancienne liturgie Egyptienne. Ils n’ont point de commerce avec
leurs femmes en Carême, ni lorsqu’ils doivent célébrer la Messe. Les Franciscains ont une maison que l'on
appelle l'Hospice de Terre Sainte. La France leur paie deux Janissaires pour en garder la porte, et chaque
vaisseau François qui va à Livourne, leur donne deux pataques ; ils ont dans leur jardin des palmiers, des
vignes, et une citerne dont l'eau est excellente. Voilà ce qui me restoit à vous dire de cette ville : je ne vous
parle pas de sa position voisine de la mer, de l’affluence des vaisseaux qui viennent dans ses ports, de la
multitude de chameaux & de dromadaires qu’on y voit, de la variété des oiseaux dont le plumage est
charmant, ni de la qualité d’autruches qui prennent leur naissance dans ce pays.
Je suis, &c. »
- 685 - 689 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
EYLES YRWIN (du 27 septembre au 8 octobre 1777)
Yrwin, E., Voyage à la mer Rouge, sur les côtes de l’Arabie, en Egypte, et dans les déserts de la Thébaïde ;
suivi d’un autre, de Venise à Bassorah par Latiquiée, Alep, les déserts, etc. dans les années 1780 et 1781,
Paris, 1792.
Eyles Yrwin (baptisé en 1751-1817) naît à Calcutta, mais reçoit une éducation en Angleterre. En 1766, il est
nommé writer à la Compagnie des Indes. De retour en Inde en 1774, il devient agent commercial et junior
merchant. Après avoir été suspendu du service de la Compagnie, il repart en Angleterre en 1777 dans le but
de chercher réparation. À l’occasion de ce voyage, il rédige un récit dans lequel on peut lire une description
d’Alexandrie.611
p. 140-191 (tome II) :
« …au coucher du soleil, nos gens distinguoient sans peine le Cap derrière lequel est Alexandrie. A huit
heures nous apperçumes le fanal dans le havre ; mais l’obscurité de la nuit nous fit perdre le coup-d’oeil que
la ville offre de ce côté. A neuf heures nous jettâmes l’ancre à cinquante pas du rivage, & Ibrahim descendit
à terre avec M. Meillon, pour prévenir de notre arrivée la personne pour laquelle M. Baldwin nous avoit
donné des lettres de recommandation. Nous nous disposions à passer encore cette nuit à bord, quand, à dix
heures sonnantes, Ibrahim revint avec le seigneur Brandi, qui avoit eu la politesse de venir nous chercher
(p. 141) lui-même. Nous laissâmes au bâtiment nos gens & notre bagage, & nous accompagnâmes ce
gentilhomme à une hôtellerie nouvellement arrangée, pour recevoir les étrangers de quelque distinction.
Nous y trouvâmes un excellent soupé, & de bons lits, où nous oubliâmes les fatigues & l’ennui de la
traversée de Rosette à cette ville.
Dimanche 28 Septembre.
Nous nous levâmes le matin de très-bonne heure, & notre premier soin fut de faire venir nos gens & notre
bagage. Notre logement étoit spacieux & commode : c’étoit originairement la factorerie angloise, quand nous
avions ici un consul. Notre hôte, qui étoit maître tailleur, avoit l’air d’un bon homme d’Italien. Sa femme étoit
une Grecque de Smyrne, qui parloit françois & italien. Cet avantage, joint à la douceur de son caractère,
contribua à rendre agréable notre séjour chez elle. On va juger si le désintéressement est la vertu favorite du
mari. Il nous demandoit à chacun deux rixdalles par jour, pour le lit et la table. Prix fou, en vérité, mais
pourtant fixé, au taux le plus raisonnable, par l’agent de M. Baldwin, pour la commodité des voyageurs
anglois.
(p. 142) Nous sortîmes, après le déjeûner, pour aller voir l’ancien port & la vieille ville d’Alexandrie. Nous
étions accompagné d’un Janissaire, à la solde des Anglois : précaution nécessaire ; on en a besoin à-la-fois
pour servir de guide & de protecteur contre les insultes de la populace. Conformément à l’usage qui règne
en cette place, nous avions repris l’ajustement européen, & congédié nos moustaches postiches ; & nous
nous étions, à notre grande satisfaction, débarrassés du costume gênant sous lequel nous avions tant de
peine à nous mouvoir. Nous nous rendîmes au bord de la mer, pour examiner le Havre Turc : il est à l’ouest
du Phare, & il offre un excellent mouillage & une retraite sûre aux vaisseaux qui viennent y chercher un abri
contre quelques coups de vent : mais, ce qu’il y a d’affreux, il est consacré aux Turcs seuls, qui ont la
barbarie d’en interdire l’accès aux Chrétiens, dans les temps mêmes où il leur est impossible d’être en
sûreté dans le Havre ordinaire. Les funestes suites de cette cruelle interdiction, se sont manifestées plus
d’une fois, particulièrement dans l’année 1767, où l’on vit quarante vaisseaux, de différentes nations, couler
à fond, ou échouer dans le port ordinaire, durant une violente tempête, qui s’étoit élevée (p. 143) du côté du
N. E. Mais en dépit de cette ordonance, il arrive quelquefois aux vaisseaux européens de se permettre
l’entrée de ce port ; & il n’y a pas quinze jours qu’on a vu un armateur maltois donner la chasse à un navire
turc, d’une force supérieure à la sienne, jusques sous la batterie du Phare, & lui lâcher une bordée au
moment même qu’il entroit dans la rade. Il y avoit cependant alors à l’ancre un vaisseau de ligne de soixante
canons ; &, ce qu’il y a d’inconvenable, c’est que, soit lenteur, soit poltronerie, il ne fit pas la moindre
tentative pour tirer vengeance d’une pareille insulte. Ce vaisseau est encore ici, & plusieurs frégates sont en
croisière pour la protection du commerce. Le trait que je viens de citer peut servir à en apprécier l’utilité, ainsi
que la bravoure des protecteurs.
Nous voulûmes entrer aussi dans le chantier, pour y voir un échantillon, probablement aussi merveilleux, de
leur habileté en fait de construction. Nous apperçumes sur le rivage une troupe de jeunes filles, prêtes à
s’embarquer pour le Caire. On nous apprit que c’étoient des esclaves grecques, tout fraîchement arrivées de
l’Archipel, & qu’on envoyoit en présent à l’un des beys de la capitale de l’Egypte. Ce fut le (p. 144) Janissaire
qui nous donna ces renseignemens ; nous l’avions engagé à entrer en conversation avec leur gardien. Ces
infortunées paroissent insensibles à leur situation : cette apathie, qui, peut-être, est pour elles un bienfait de
la nature, réprima un peu l’émotion que nous causa d’abord la connoissance de leur destinée. Elles étoient
tournées vers nous au moment que nous en approchions ; & malgré leurs voiles, le feu de leurs grands yeux
étincelans & noirs, & la perfection admirable des formes dont leur ajustement léger dessinoit mollement les
contours ; tant de charmes enfin, plutôt soupçonnés qu’apperçus, ne suffisoient que trop pour nous
convaincre que c’étoient des objets bien peu faits pour être soustraits, pour toujours, aux regards des
hommes. Le tressaillement involontaire, la surprise soudaine qu’elles manifestèrent, à la vue d’un
habillement si nouveau pour elles, réveilla la jalousie de leurs féroces gardiens, & ils les firent entrer, sur le
champ, dans la chaloupe qui les attendoit. Le prix de ces esclaves est, depuis cent jusqu’à mille sequins ; &
leur valeur est proportionnée autant à leurs qualités et talens, qu’à la beauté qu’elles possèdent. Helàs !
dans quel abrutissement le genre humain est-il donc tombé, pour faire de l’esprit, des perfections & (p. 145)
de la beauté, dans la plus aimable moitié de l’espèce humaine, l’objet d’un vil & abominable commerce, &
pour trafiquer de ces charmes, comme de la force & des talens méchaniques des nègres africains ! Sans
doute, la dernière branche de commerce est une violation inexcusable des droits de l’humanité ; mais l’autre,
par je ne sais quelle sacrilège rage qui leur est propre, infecte & fouille la source des sentimens les plus
doux & les plus nobles, & semble aller jusques dans le sanctuaire de la nature, pour y flétrir ses dons
mêmes, & profaner ses chefs-d’oeuvres.
Alexandrie, ou plutôt Scanderié, comme les Turcs l’appellent, est au 31°11’ de latitude septentrionale, sur
une colline qui, par une pente douce & graduelle, s’étend jusqu’au bord de la mer ; & décrit un demi-cercle
terminé par le fort à l’orient, & à l’occident par le Phare. Cette baye est ouverte aux vaisseaux étrangers, qui
s’y rangent, suivant l’ordre de leur arrivée, en face du môle, qui joint le Phare au continent. C’est pour cette
sûreté qu’ils choisissent cette position, parce que le môle rompt la force des vagues qui viennent s’y briser
du côté de l’Est. La mer baigne le pied des maisons, & les vents salutaires qu’on doit au voisinage de cet
élément, contribuent beaucoup à la salubrité de l’air qu’on (p. 146) y respire. La nouvelle ville paroît être
renfermée dans un quartier de l’ancienne, & n’occupe pas la huitième partie de son terrein, dont l’étendue
est attestée par les vieilles murailles qui subsistent encore. Sa population se monte à une trentaine de mille
ames, de toutes les nations. C’est bien le mélange le plus singulier qui existe peut-être sur aucune partie du
globe. Le gain ! le gain ! voilà ce qui attire tant d’individus à ce marché universelle : & par une autre
bizarrerie, la nation du souverain est celle qui retire le moins d’avantages de cette réunion mercantille.
J’entrevois bien volontiers dans le détail des antiquités qui abondent en cette contrée fameuse, si elles ne se
trouvoient décrites dans un ouvrage, qui paroît depuis peu, avec trop de précision & d’élégance, pour me
laisser le moindre espoir d’égaler les agrémens & le succès de son auteur. L’ouvrage dont je parle, publié
d’abord en allemand, & traduit depuis en françois, est une production de M. Niebuhr, qui a fait par ordre de
sa majesté danoise, le tour de la Basse-Egypte & de l’Arabie. Je ne saurois pourtant me dispenser de dire,
en passant, un mot sur les objets les plus remarquables. Garder un silence absolu sur un sujet si curieux, ce
seroit faire une double insulte au goût & aux connoissances du lecteur.
(p. 147) Nous avons eu à dîner la compagnie d’un jeune Suisse fort aimable, qui se dispose à partir pour les
grandes Indes. Il doit s’embarquer sur le premier bâtiment qu’on expédiera pour le Caire, où son intention
est d’attendre le départ de la flotte angloise, pour passer avec elle au lieu de sa destination. C’étoit pour
nous un vrai plaisir de répondre aux questions de ce jeune homme, relativement à un voyage si nouveau
pour lui, & sur une région où nous avions passé tant d’années.
Lundi 29 Septembre.
Le seigneur Brandi nous présenta au Consul de France. C’est un homme qui paroît bien né & rempli de
sentimens, & nous en avons entendu dire beaucoup de bien à notre compagnon de voyage, M. Meillon, qui
logeoit à la factorerie françoise. Il est tout récemment arrivé en cette ville ; il avoit comme nous sa curiosité.
Nous débutâmes par faire ensemble un tour de promenade du côté des ruines. Nous passâmes devant la
factorerie vénitienne, qui est tout près de celle de France. C’est un fort bel édifice & qui a beaucoup plus
d’apparence quaucune autre factorerie étrangère. Nous traversâmes d’abord une plaine aride &
sablonneuse, (p. 148) où nous vîmes répandus, çà & là, nombre de piliers de granite, d’une grandeur
prodigieuse. Il paroît qu’on les avoit transportés en ce lieu dans l’intention d’en faire un usage auquel on
aura depuis renoncé. Au sortir de cette plaine, nous passâmes sous une espèce de porte en arcade, qui
servoit, peut-être, à marquer l’une des divisions de l’ancienne ville. Au midi de cette porte est une grande &
haute tour toute en ruine, & environnée de murs, dans l’intérieur desquels est un petit bois de dattiers.
C’est-là que les antiquités commencent.
Quel sentiment profond & douleureux doit éprouver le spectateur instruit, à la vue des imposans & tristes
restes d’une ville si célèbre ! Avec quel regret il songe à la gloire passée, & à son unique splendeur ; &
quelle attristante comparaison de ce qu’elle est aujourd’hui, avec ce qu’elle fut ! Sans doute qu’on ne traitera
pas de charlatanisme sentimental cette expression naturelle & trop foible d’une sensibilité vraie : & j’oserai
dire, sans être taxé d’exagération, qu’il me fut impossible de contempler, avec sangfroid, un tel spectacle.
L’image de la destruction est bien faite pour affliger les regards, sur-tout quand l’objet détruit rappelle un
grand nom & une cité florissante ; & l’observateur (p. 149) sensible souffre & s’indigne à l’aspect de ces
ruines majestueuses, comme à la vue du portrait défiguré d’un personnage vénérable & cher, réduit à un
état de dégradation, qu’il seroit impossible de réparer. Non loin de la tour dont je viens de parler, est un
temple antique, dont une partie est encore habitable, & a long-temps été appropriée au culte de la religion
musulmanne. Ce point nous fit d’abord éprouver quelques difficultés à en obtenir l’accès. Mais, à la fin, notre
Janissaire nous en procura les clefs, & nous introduisit dans la partie abandonnée de cet édifice. C’est un
magnifique quarré d’un très-grand diamètre, entouré d’un triple rang de colonnes de granite, d’ordre
corinthien. Ces colonnes sont d’une belle hauteur & supportent un dôme qui malgré sa vétusté est encore en
assez bon état.
Les murs de ce temple sont revêtus, à l’intérieur, de marbres rapportés, de différentes couleurs : sorte de
marqueterie dont la singularité & la richesse ne peuvent qu’exciter l’admiration des étrangers. Au milieu du
quarré est une fontaine d’une forme très-antique & toute couverte d’inscriptions hiéroglyphiques. La
balustrade qui l’entoure, semble indiquer qu’elle servoit à quelques cérémonies mystérieuses.
(p. 150) De-là, nous nous rendîmes, par une plaine couverte de décombres, à un couvent de Franciscains.
Le bâtiment est simple & analogue au caractère des fondateurs. Nous y trouvâmes près d’un acre de terre
fort bien cultivé. Le sol étoit naturellement stérile ; mais, graces à l’industrie de ces laborieux solitaires, il
produit actuellement des végétaux en abondance. Partout on voit les traces honorables & les fruits de leur
activité. Un petit vignoble, planté récemment, leur promet un rapport avantageux ; & dans la contrée la plus
aride, leur jardin a les eaux nécessaires pour le fertiliser. Pour se procurer cet avantage, il leur a fallu
creuser, avec une peine & une patience infinie, un réservoir capable de retenir l’eau que leur fournit un
aqueduc voisin. C’est vraiment là le chef d’oeuvre de leur intelligence. Au moment où nous entrâmes, ces
bons pères étoient à jouer aux quilles. Il régnoit sur leurs visages épanouis une douce sérénité, & je ne sais
quel air de satisfaction enfantine, qui sembloit défier à la fois & les soucis & les vanités du monde. Il
commençoit à se faire tard, & nous ne poussâmes pas plus loin nos courses. A notre retour, nous fûmes
accueillis d’une ondée soudaine. C’étoit une nouveauté & un régal pour nous qui (p. 151) depuis six mois
n’avions vu tomber une goutte d’eau. Aussi, la savourâmes-nous avec une volupté inexprimable, mais peu
communicative apparemment ; car nous étions les seuls de la compagnie qui eussent l’air de trouver
délicieux d’être mouillés jusqu’aux os.
Nous regagnâmes sans autre accident la factorerie de France ; & le consul eut l’honnêteté de nous
présenter à son épouse, jeune dame remplie d’agrémens & de vivacité. Elle nous invita obligeamment à
faire une partie de cartes, & à passer avec elle le reste de la soirée. Nous n’eûmes garde de refuser une
offre aussi gracieuse. Il y avoit bien long-temps que nous n’avions vu de femme dont l’ajustement & les
manières ne présentassent toujours quelque chose d’étranger. Nous nous trouvions enfin auprès d’une
Européenne ; il nous sembloit, au premier moment, que nous étions en Europe. Cette dame ne paroît pas
avoir beaucoup de goût pour sa situation qui, d’après sa vivacité, ne peut que lui être insipide. Il est vrai que
la connoissance du caractère de la nation, au milieu de laquelle elle se trouve, peut avoir influé sur le dégoût
que cette contrée lui inspire. Il n’y a pas plus de dix-huit mois que le consul, prédécesseur de son mari, a
perdu la vie, par une suite des (p. 152) barbares principes qui règnent ici, en manière de vengeance. Un si
affreux souvenir est bien propre à lui causer des transes mortelles & à lui donner un fond habituel de
mélancolie que tout son enjouement naturel ne peut ni vaincre ni déguiser. Le lecteur verra ci-après les
particularités de cette histoire.
Mardi 30 Septembre.
Nous déjeûnâmes le matin à bord du vaisseau françois que M. Baldwin nous avoit recommandé pour notre
passage en France. Ce navire neuf & très commode se nommoit la Cléopâtre. Nous convinmes avec le
capitaine M. Calvi de lui donner par tête cent trente-trois couronnes pour notre passage ; prix exorbitant en
vérité pour un trajet de cette nature : mais c’est l’usage d’être ainsi rançonné ; il faut s’y résigner. Tous ces
messieurs qui reviennent des Indes sont regardés comme des millionnaires & taxés en conséquence soit
qu’ils voyagent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs. A cela près, nous n’eûmes qu’à nous applaudir du
choix de notre patron ; & nous lui devons la justice de dire qu’en s’engageant à nous fournir une table
délicate & abondante, il se référoit à cet égard, (p. 153) à notre générosité. A notre retour de la Cléopâtre,
nous passâmes tout près de plusieurs vaisseaux marchands de toutes les nations. Il y avoit parmi eux deux
bâtimens anglois dont l’un est frété par M. Baldwin pour Constantinople.
Après le dîner nous fîmes la partie d’aller voir la colonne de Pompée ; ce monument, l’admiration des siècles
passés & le prodige du nôtre ! Notre compagnie, déjà nombreuse, fut augmentée de deux capitaines de
vaisseaux anglois & de M. de Meillon qui vint nous rejoindre avec plusieurs jeunes gens attachés à la
factorerie françoise. Nous montâmes les premiers ânes qui se présentèrent ; & toujours sous l’escorte de
notre fidèle janissaire, nous reprîmes notre course de la veille. Nous laissâmes le couvent à notre droite &
nous traversâmes une quantité de débris divers, dont quelques-uns paroissoient être les restes d’un ancien
aqueduc. Ce n’étoient tout autour de nous que hautes tours démentolées, dont l’air de grandeur annonce
encore qu’elles ont dû être des postes d’une grande importance. A peu de distance, un objet plus curieux
vint fixer notre attention. C’étoit un assez grand nombre de colonnes de marbre ou de granite, rangées sur
deux lignes parallèles & qui paroissent avoir supporté quelque portique (p. 154) superbe. Elles sont toutes
d’une seule pierre, & ont près de trente pieds de hauteur ; & nous en avons compté une trentaine qui se
tenoient encore sur leur piédestal. Mais que sont ces colonnes, quelle que soit d’ailleurs leur beauté en
comparaison de celle qui parut en ce moment à nos yeux ? Enterrés comme nous étions dans des
monceaux de décombres & des monticules de sable, nous n’avions pu l’apercevoir malgré sa prodigieuse
hauteur. Nous y touchions presque sans nous en douter ; & quand elle frappa soudainement nos regards,
nous le croyions à peine ; il sembloit qu’elle venoit d’être placée là par enchantement. Que le lecteur n’exige
pas que je lui rende compte de ce que j’éprouvai à la vue de ce chef-d’oeuvre. Sa majesté, son immensité,
son antiquité, l’effet de son apparition inattendue, qui joignit l’excès de la surprise au comble de l’admiration ;
la réunion enfin de ces sensations diverses me rendit pendant quelques minutes tou-à-fait immobile ; & mes
yeux, mon imagination, tous mes sens, toutes mes facultés, tout mon être, furent comme accablés de je ne
sais quelle impression de grandeur, dont le langage humain ne peut rendre la force, la nature ni les
charmes. Je ne tenterai pas davantage de décrire le monument lui-même ; (p. 155) tout ce que je puis faire,
c’est d’en donner les mesures & les dimensions. Suivant les calculs les plus invraisemblables, il a dix pieds
de hauteur. Le fût, qui est d’une seule pierre de granite, en a quatre-vingt-dix, & le piédestal vingt &
davantage. Le chapiteau est d’ordre corinthien, ce qui lui donne cet heureux mélange de noblesse & de
simplicité, mérite si rare dans les productions de l’architecture moderne. Ce monument a très peu souffert
des outrages du temps : c’est en partie sans doute à la dureté & à la perfection du poli de la pierre qui le
compose qu’il doit l’avantage d’avoir conservé sa beauté première. Elle est après tant de siècles dans un
état d’intégrité qui tient du prodige ; & il promet de transmettre la mémoire d’un héro patriote, à la postérité la
plus reculée de la nation ignorante & demi-barbare, à laquelle l’aspect de cette merveille impérissable redira
du moins toujours le nom du grand Pompée ! Le piédestal seul a été un peu endommagé par les instrumens
des voyageurs, curieux de se procurer, n’importe à quel prix, la possession de quelques fragmens de cet
antique ; & la colonne a perdu, il y a environ quatre ans, une de ses volutes, par un accident, dont quelques
officiers anglois sont les auteurs ; l’anecdote est (p. 156) trop singulière & trop plaisante, pour n’en pas
régaler le lecteur.
Ces joyeux enfans de Neptune conçurent un projet bien étrange & dont l’impossibilité apparente ne fut pour
eux qu’un nouveau motif de s’obstiner à l’exécuter. On lança la chaloupe à la mer ; on y embarqua tous les
ustensiles nécessaires pour l’entreprise projettée & nos héros descendirent sur le rivage, bien résolus à
boire un bowl de punch sur le sommet de la colonne de Pompée. En arrivant sur les lieux, chacun proposa
son avis ; mais toutes les tentatives furent inutiles, & l’on alloit abandonner cette belle entreprise, quand le
même génie qui l’avoit imaginée suggéra les moyens de l’exécuter ; on envoya chercher à la ville un
cerf-volant. Les habitans, instruits de ce qui se passoit dans leur voisinage, accoururent en foule pour être
témoins de l’adresse et de de l’audace des Anglois. On alla dire au gouverneur que ces marins vouloient
abattre la colonne de Pompée. Mais se reposant sur leur respect pour la mémoire du général romain, ou
pour le gouvernement turc, il eut la politesse de répondre que les Anglois étoient incapables d’insulter les
vestiges de la gloire de Pompée. Il agit très-sagement, sans connoître la disposition des hommes à qui
(p. 157) il auroit eu affaire ; car dans ce moment, l’empire turc ne les en auroit pas empêchés. Enfin, ce
cerf-volant arrivé, on l’enleva si juste au-dessus de la colonne que quand il tomba du côté opposé, la ficelle
se trouva arrêtée en travers du chapiteau. Alors le principal obstacle étoit vaincu. On attacha une grosse
corde à une extrémité de la ficelle du cerf-volant & en la tirant par l’autre bout de la même ficelle on la fit
passer dessus le sommet de la colonne. Un des marins y grimpa avec cet unique secours, & en moins d’une
heure, on fit un hauban par le moyen duquel les autres rejoignirent leur compagnon. Juchés à cet énorme
hauteur ils burent leur punch au bruit des applaudissemens de toute la multitude étonnée. Le chapiteau de
cette colonne, lorsqu’on le regarde d’en-bas, ne paroît pas pouvoir tenir plus d’un homme. Mais nos marins
assurent que huit personnes y sont encore très à l’aise. L’unique dommage que cette visite causa à la
colonne, fut la chute de cette volute dont nous avons déjà parlé. Elle tomba par terre avec un bruit effroyable
& fut emportée en Angleterre par un de ces capitaines qu’une dame avoit chargé de lui apporter un morceau
de ce beau monument. La découverte que firent nos compatriotes compense bien (p. 158) le mal qu’il
essuya de leur part. Sans eux on ignoreroit encore qu’il y avoir autrefois sur cette colonne une statue dont il
reste un pied cassé au-dessus de la cheville. Cette statue étoit sans doute celle de Pompée lui-même qui
placée à une si grande élévation devoit être gigantesque pour paroître seulement de la taille ordinaire d’un
homme.
Il y a dans cette histoire des circonstances capables de lui donner un air de fiction ; mais elle est démontrée
de manière à convaincre l’incrédulité même. Indépendamment du témoignage positif d’un grand nombre de
témoins oculaires, nos aventuriers ont laissé une preuve parlante de fait, par les lettres initiales de leurs
noms, (p. 159) qu’on voit très-lisiblement tracés en noir, justement au-dessus du chapiteau. Nous avions été
si long-temps à contempler cette magnifique colonne, qu’il étoit trop tard pour pouvoir aller plus loin. Il fallut
donc songer à retourner sur nos pas ; & après nous être suivant l’usage munis d’un morceau de la précieuse
relique, nous nous mîmes à regagner le port qui est à près à un mille & demi de distance. Vers le milieu de
la route. Nous montâmes sur une éminence assez considérable formée de deblais amoncelés des fouilles
faites par les Turcs pour la recherche des antiques qui se trouvent en abondance en ces lieux. De cette
hauteur nous eûmes le beau coup-d’oeil de la vieille & nouvelle ville, ainsi que du port d’Alexandrie.
Mercredi premier Octobre.
Le seigneur Brandi me fit, le matin, présent d’un antique. C’est une pierre bleue sur laquelle on a gravé une
tête de Jupiter Capitolin. La petite collection que j’ai faite en ce genre ne vaut pas la peine d’être offerte au
lecteur, malgré la certitude où je suis du moins qu’elle n’est composée que d’originaux ; car, ni l’éloignement
de la Haute-Egypte, ni l’habileté (p. 160) des contrefacteurs, ne peuvent à cet égard favoriser la supercherie.
Un étranger ne doit cependant pas faire sans précaution ces sortes d’emplettes à Alexandrie. On m’a plus
d’une fois offert des cachets qui avoient toute l’apparence de vrais originaux ; mais l’inspection d’un
connoisseur les métamorphosoit bientôt en copies. Il y a néanmoins des temps où l’on trouve une grande
quantité de ces sortes d’antiques, dans le voisinage d’Alexandrie. Quand le hasard fait découvrir aux gens
qui suivent cette branche de commerce une mine de curiosités de cette nature, c’est pour les amateurs
éclairés, une occasion favorbale de meubler à peu de frais leurs cabinets d’originaux. C’est ainsi que le
seigneur Brandi avoit su se procurer un nombre assez considérable d’antiques. Un des articles qui nous a
fait le plus de plaisir dans cette collection, c’est un buste d’Alexandre, parfaitement exécuté & très peu
endommagé.
Dans l’après-dîner nous allâmes avec nos montures & notre escorte ordinaires voir l’obélisque de Cléopâtre.
Il est à l’orient de la ville neuve & à si peu de distance que nous y arrivâmes en moins de dix minutes. Ce
monument est presqu’entièrement caché du côté de la mer & on n’en apperçoit guères que la pointe qui
(p. 161) s’élève majestueusement au milieu d’un monceau de décombres : ce sont vraisemblablement, les
débris d’un cercle d’édifices superbes qui l’entouroient autrefois. C’est une opinion assez généralement
répandue, qu’il y avoit originairement trois obélisques qui portoient également de Cléopâtre ; l’un desquels
passe pour avoir été enseveli sous les sables. Quoi qu’il en soit, il est bien sûr qu’il y en avoit deux élevés à
150 pieds environ l’un de l’autre & que l’un a été renversé par la violence d’un ouragan. On le voit étendu
par terre de toute sa longueur. Ces obélisques sont de granite, d’une seule pierre ; ils ont soixante pieds de
long & toutes leurs faces sont couvertes d’inscriptions hiéroglyphiques. Celui qui est encore sur pied est un
des plus admirables monumens de cette cité fameuse ; & sa beauté ne le cede qu’à celle de la colonne de
Pompée. Il est étonnant qu’on n’ait pas encore tenté de transporter en Europe celui qui est renversé :
l’entreprise ne sauroit ni plus surprenante, ni plus impraticable que celle du déplacement de l’obélisque érigé
en l’honneur d’Auguste & de Tibère & qui est la merveille de Rome moderne. Les anciens nous ont à cet
égard comme à tant d’autres donné (p. 162) l’exemple : pourquoi ne pas oser être du moins leur imitateur ?
Comme un pareil monument termineroit avec noblesse l’une des perspectives de Chatfworth ! Quel prix il
ajouteroit à la belle collection de Stowe ! Mais la dépense d’une telle acquisition ne convient qu’à la fortune
d’un souverain ; & l’objet est trop précieux pour que tout autre qu’un monarque soit digne de la posséder.
Quant au dessein de cet obélisque, ainsi que de la colonne de Pompée, je ne puis mieux faire que de
renvoyer le lecteur à l’ouvrage de M. Niebuhr & aux desseins de M. Dalton dont la collection publiée en 1752
contient indépendamment de la vue de ces deux monumens, l’élévation & la coupe des pyramides d’Egypte.
Nous avions eu trop de plaisir à contempler l’obélisque pour pouvoir le quitter sans regret. Son aspect et la
vue des ruines, pleines encore de majesté, qui frappoient de tous côtés nos regards, nous rappelloient tant
d’intéressants souvenirs, nous retraçoient tant de grandes ou délicieuses images ! Il nous sembloit être au
temps des Ptolémés. Ici Marc-Antoine savoura dans la coupe de la volupté cette ivresse qui lui devint si
fatale ; ici Cléopâtre offrit aux hommages d’un peuple enchanté la beauté sur le trône ; ici (p. 163) régnèrent
la joie, les plaisirs, les folâtres jeux ; ici, hélas ! un héro & une reine charmante perdirent tous deux &
l’empire & la vie, pour s’être trop peu défiés des attraits séducteurs de l’amour !
A quelques cents verges de distance de la place que nous venions de quitter est un angle des anciennes
murailles de la ville. Dans la partie orientale où nous nous trouvions alors, on voit encore très distinctement
les vestiges de ces murs, ainsi que celles du fossé qui les entouroit & des tours dont on les avoit flanqués, à
distances égales, pour les fortifier davantage. Celle qui étoit à l’angle dont je viens de parler, paroissoit être
beaucoup moins dégradée que les autres. Nous avons eu la curiosité d’y entrer. Au milieu de l’édifice, il y a
une vaste chambre de forme circulaire & sans autre plafond que le sommet même de la tour ; mais un
escalier étroit qu’on y apperçoit indique manifestement qu’il doit y avoir eu d’autres pieces au-dessus de
celle qui subsiste aujourd’hui. Nous fîmes encore quelques tours de promenade de ce côté ; & en retournant
à la maison, nous visitâmes l’église de Sainte Catherine, qui appartient à des moines grecs. Un d’eux eu la
complaisance de nous conduire à une espèce (p. 164) de sanctuaire, éclairé d’une lampe pour nous montrer
la pierre sur laquelle Sainte Catherine a été décapitée. Cette pierre est en grande vénération & les bons
pères font tout leur possible pour persuader aux étrangers qu’on y voit des gouttes de sang de leur patrone.
Ils n’avoient point de contradiction à craindre de notre part, notre zèle n’étoit pas assez amer. Mais comme
la charité paroissoit être de leur goût, encore plus que la modération, nous leur fîmes quelques petites
largesses au risque d’être un peu complices de cette innocente & pieuse imposture.
Jeudi 2 Octobre.
Nous apprîmes le matin qu’il venoit de périr au Boghas, ou à la barre du Nil, cinq chaloupes d’une flotte
partie depuis deux jours pour Rosette. Le jeune Suisse dont j’ai parlé plus haut s’étoit trouvé
malheureusement sur un de ces bâtimens & n’avoit pu sauver que sa vie. Cette nouvelle nous fit beaucoup
de peine & nous fûmes d’autant plus sensibles à l’accident que nous nous intéressions vivement à la
victime. Si néanmoins le lecteur se rappelle la description que nous avons faite de ce difficile & périlleux
passage, peut-être jugera t-il que ce jeune (p. 165) homme doit encore se féliciter & s’estimer trop heureux
de ne pas avoir été submergé avec ses effets. La violence du vent & la rapidité du courant doivent avoir
causé sur la Barre par l’impétuosité de leur choc, un gonflement prodigieux qui est presque toujours
également fatal au navire & au navigateur. Les négocians françois de cette ville passent pour avoir
beaucoup souffert de cet accident. Leur perte ne peut en effet être que très considérable parce qu’ils avoient
de riches ballons à bord des deux bâtimens qui ont péri. Mais le malheur de notre jeune Suisse fut ce qui
nous toucha davantage. Le souvenir de notre propre détresse contribuoit sans doute à nous rendre
sensibles à des peines que nous avions nous-mêmes éprouvées ; & jamais nous n’avions été si bien
disposés aux douces & nobles impressions de la compassion & de la pitié : tant il est vrai qu’à certains
égards, le malheur est pour le coeur humain le meilleur des maîtres & qu’il n’est pas de leçons capables que
les siennes de le rendre attentif à la voix de l’humanité !
C’est un spectacle également singulier & risible que la vue des matériaux, ainsi que le goût & la forme de la
plupart des bâtimens de cette ville. Le marbre s’y trouve avec une telle profusion qu’il (p. 166) n’y a point de
rues où l’on ne voit de nobles débris des palais antiques employés aux usages les plus communs & même
les plus vils. C’est bien la bigarrure la plus étrange qu’on puisse imaginer ! J’ai vu une écurie soutenue par
des colonnes du plus beau granite & une étable pavée de tables de marbre magnifique. J’ai dit que ce
spectacle étoit plaisant ; j’ai eu tort ; il est plutôt fait pour attrister : il rappelle trop la prophétie terrible lancée
contre cette idée opulente & superbe dans les plus splendides édifices & les palais même de ces rois étoient
condamnés à devenir un jour l’habitation abjecte des bêtes des champs. Mais voici ce qui est réellement
ridicule. Les cours des factoreries étrangères sont décorées des colonnes les plus belles & les mieux
choisies qu’on ait pu se procurer : mais la différence des ordres, parmi lesquels le dorique, l’ionique, le
corinthien sont mêlés & confondus, jointe à l’inégalité de hauteur & de diamètre, fait de ce chaos de
colonnes étonnées pour ainsi dire d’être ensemble l’assemblage non pas le plus gracieux mais bien le plus
bizarre, & la disparate la plus extraordinaire qu’il soit possible de se figurer. Il faut pourtant être juste :
comme dans cette disposition on a plus consulté la commodité que l’élégance ce défaut de goût est au fond
très excusable.
(p. 167) Il ne nous restoit plus guères que le canal à visiter. Nous y fîmes un tour dans l’après-midi. Pour y
arriver nous prîmes une route qui conduit à la porte du S. E. & divise l’ancienne ville en deux parties égales :
le trajet ne fut que l’affaire d’une demi-heure. Cette porte paroît avoir été un magnifique morceau
d’architecture ; & deux colonnes qui subsistent encore donnent la plus haute idée du goût & de la noblesse
de l’édifice. Le canal n’est qu’à un quart de mille de distance. Fait pour conduire l’eau du Nil à Alexandrie, il
sert encore après tant de siècles à l’usage auquel il a été destiné ; & dans les inondations, il procure à cette
ville une quantité d’eau suffisante pour remplir les citernes pour la consommation de l’année suivante. Ce
grand ouvrage étoit indispensable pour corriger le défaut qui rendoit, sans lui, ce sol aride, absolument
inhabitable, & est, à tous égards, digne du héros dont il porte le nom. Mais le canal, à peu de milles
au-dessus, est comblé par les sables, au point de n’être pas navigable pour les plus petites barques, plus
d’une semaine ou deux, dans le cours de l’année entière. Il y a sur ce bras artificiel du Nil, une arche de la
plus hardie largeur, qui semble être susceptible de réparation. Mais l’indolence & ignare (p. 168) insouciance
des Turcs ne fait rien réparer : & ils laissent stupidement le pont & le canal se dégrader sous nos yeux,
tandis qu’il ne faudroit qu’une dépense médiocre (par comparaison du moins à son objet) pour rétablir dans
toute sa splendeur, ces superbes & utiles ouvrages de l’antiquité. Sur les bords du canal sont diverses
plantations qui servent à la consommation de la ville. Ce sont les seules qu’il y ait dans cette stérile & sèche
contrée. Au-delà, le désert s’étend jusqu’au Nil.
Nous avons fait en revenant, le tour des murs de l’ancienne ville, dans la partie occidentale que nous ne
connaissions point encore. Ces murs sont flanqués de tours, comme du côté de l’orient ; mais ils se sont
moins bien conservés & les brêches y sont beaucoup plus fréquentes.
Vendredi 3 Octobre.
Rien ne retardoit plus notre départ que les dépêches qui devoient nous parvenir du Caire, surpris qu’elles ne
soient pas encore arrivées & nous les attendîmes avec impatience.
Comme il ne se passa rien dans le cours de cette journée qui mérite l’attention du lecteur, je ne crois pouvoir
mieux faire, pour remplir (p. 169) ce vuide de mon journal, que de lui raconter l’histoire de l’assassinat du
consul de France. Ce fait, malheureusement trop réel, est aussi curieux, par la singularité de ses
circonstances, que déplorable par ses fuites & son atrocité ; & je le crois plus que suffisant pour justifier
l’idée peu favorable que j’ai donnée des Arabes, en différens endroits de cet ouvrage.
Trois jeunes gens, attachés à la factorerie françoise, avoient été faire, aux environs de la ville, une partie de
chasse aux pigeons. A leur retour ils rencontrèrent, par le plus malheureux hasard, quelques Arabes, qui,
avec leur impudence ordinaire envers les Chrétiens, toutes les fois qu’ils se sentent les plus forts, leur
demandent insolemment les armes. Ceux-ci comme cela est fort naturel, les refusent avec autant de
hauteur. Ce refus cause une dispute très-vive ; puis un combat encore plus animé & plus opiniâtre, & les
jeunes François alloient probablement succomber sous le nombre, quand l’un d’eux lève son fusil, couche
un Arabe en joue & le fait tomber roide mort. Ce coup inattendu fait, sur la troupe ennemie, l’effet de la
foudre. Saisie de terreur, elle fuit & disparoît. Voici nos jeunes gens débarrasés de leurs vils & insolens
agresseurs. Mais ils ne se félicitèrent (p. 170) pas long-temps de leur victoire ; les conséquences en étoient
terribles & presque inévitables, & il n’y avoit pas à balancer à fuir sur-le-champ pour s’y soustraire. Chacun
se disperse de son côté. Le coupable savoit bien qu’il n’y avoit pas de sûreté pour lui dans Alexandrie,
quoiqu’il n’eût ôté la vie que pour la défense de sa propriété, contre un injuste agresseur. Il prend donc le
parti de gagner le premier village sur le bord de la mer & d’y louer une mule pour se rendre à Rosette. Il fait
le trajet avec la dernière diligence & ne met pied à terre que pour entrer dans une chaloupe qui partoit pour
Damiette. Par bonheur, qu’au moment même de son arrivée en cette ville, il se trouve justement un vaisseau
qui met à la voile pour Constantinople ; il s’y embarque & réussit ainsi à échapper au sort qui l’attendoit. Un
de ses ompagnons se détermine à retourner à Alexandrie & y reste caché jusqu’à ce qu’il trouve une
occasion favorable de s’évader. La connoissance qu’il a de la langue du pays, la lui facilite bientôt. L’autre
se réfugie à la factorerie de France, qu’il regarde comme un asyle sacré. Mais l’infortuné jeune homme se
trompoit. Il n’étoit pas pour lui de retraite assuré contre ses farouches ennemis ; & quoiqu’il n’eût (p. 171)
que simple spectateur de l’accident, il étoit destiné à en porter la peine. Il y avoit alors des troubles dans
Alexandrie ; les camarades du mort ameutent la populace à la faveur du désordre, forcent les portes de la
factorerie, enlève le malheureux François & le pendent au premier arbre qu’ils rencontrent : & non content
de ce sacrifice, les monstres le coupent en morceaux & exposent ses membres, ainsi mutilés, dans
différents quartiers de la ville.
Qui n’auroit pas cru leur vengeance satisfaite par une pareille atrocité ? Ne sembloit-il pas, même en
sougeant à la barbarie de leurs maximes, qu’ils devoient être contens d’une représaille si cruelle & qui
confondoient l’innocent avec le coupable ? Mais non : leur soif du sang n’étoit pas encore assouvie. Comme
le meurtrier leur étoit echappé, ils tournèrent toute leur rage contre celui qui n’avoit commis d’autre crime,
que de donner retraite à son complice. Le consul, qui n’ignoroit pas à quel point les Arabes sont vindicatifs,
se tint renfermé chez lui pendant plus de deux mois entiers. Après ce laps de temps, il s’imaginoit que tout
étoit oublié ; & dans cette persuasion, sort pour prendre l’air, avec le janissaire de la nation. Un janissaire est
ici regardé comme une sauve-garde suffisante. (p. 172) Elle peut l’être en général ; mais dans cette
circonstance-ci, elle fut absolument inutile. Nos deux hommes rencontrent, près de la colonne de Pompée,
un inconnu, qui, sans affectation, demande au janissaire quelle est la personne qu’il accompagne. Celui-ci
n’a pas plutôt nommé le consul, que l’autre se retourne brusquement & lui lâche un coup de pistolet. La balle
perça le corps d’outre en outre & il expira sur-le-champ. L’infortuné périt comme le héro, près de la colonne
duquel il tomba, victime de la perfidie de la race égyptienne. Pour l’assassin, il s’évada en profitant du
trouble du janissaire & le gouvernement ne fit pas la moindre perquisition sur un monstre aussi odieux. Sa
dignité personnelle, autant que l’intérêt des autres nations, faisoient à la France une loi de ne pas laisser la
mort du consul sans vengeance : aussi, a-t-elle envoyé, cet été, deux frégates, pour demander satisfaction.
Mais soit que la force fût trop inégale, ou plutôt que le gouvernement payât à cette puissance, de quelques
avantages secrets, le sacrifice de l’honneur & même de la sûreté de ses ministres en Turquie, les deux
frégates repartirent sans avoir obtenu le moindre succès dans leur négociation.
(p. 173) Samedi 4 Octobre.
Nous apprîmes, le matin, qu’un vaisseau alloit couler bas dans le port. Nous nous transportâmes sur le quai,
où nous vîmes un polacre grec, submergé en moins d’une demi-heure & l’équipage s’estima très-heureux de
ne point perdre la vie. Il paroît que ce navire toucha l’ancre d’un autre, en gagnant au large. Je m’étonne de
ce que ces accidents ne soient pas plus fréquens dans un port où il faut que les vaisseaux soient toujours
amarrés, à cause de l’incertitude du mouillage. L’eau est si basse au reflux, qu’il faut indiquer aux étrangers
où sont jettées les ancres. L’usage qui se pratique dans les autres ports, pour la commodité des
propriétaires, est si nécessaire pour l’utilité publique & chaque vaisseau est obligé d’attacher des bouées audessus
de ses ancres. Ceux qui manquent à cette précaution, sont responsables des dommages causés par
leur négligence. C’est pourquoi les propriétaires du polacre grec pourront, dans cette circonstance, obtenir
des dédommagemens.
En revenant du quai, nous fûmes témoins d’un trait de force, qui nous parut prodigieux. (p. 174) Il passa
près de nous un porte-faix, chargé d’un double ballot de coton, que nous aurions cru capable d’écraser
l’homme le plus vigoureux. Celui-ci avoit des bottes pour lui tenir les jarrets plus fermes & marchoit tout
courbé, en appuyant les mains sur ses genoux. Si mille faits de cette nature n’étoient attestés par toutes les
personnes qui font le commerce du levant, on n’oseroit, sans craindre de passer pour exagérateur, citer les
fardeaux énormes dont les porte-faix turcs accoutumés à se charger. Je vis, le même jour, un autre
porte-faix, à l’endroit où l’on pèse les ballots, en prendre un de sept cents sur son dos, & le porter, tout en
vacillant, jusqu’au quai. Il est vrai que la distance est peu considérable ; & d’ailleurs, l’adresse & l’exercice
ont probablement plus de part encore, que la force réelle, à ses efforts, qui paroissent si étonnans. Je me
rappelle d’avoir entendu, pendant mon séjour dans l’Inde, parler assez souvent de porte-faix de la Perse, qui
se chargent sur le dos une pièce de vin, fardeau plus considérable encore. Ceux de la Chine à Canton, ne
sont pas moins renommés & ils passent pour avoir de plus l’art de rendre les mêmes charges infiniment plus
faciles à porter, au moyen d’un bambou qu’ils se mettent au travers sur l’épaule. (p. 175) Ce n’est guères
que dans les contrées où ceux qui s’adonnent à ces sortes de travaux sont en petit nombre, que ces
prodiges de vigueur sont un bien. A Paris ou à Londres, où les professions ne sont pas héréditaires & où il y
a toujours tant de bras à employer, les inconvénients de cet espèce de monopole seroient graves &
très-sensibles & quelques Hercules, tels que ceux dont je viens de parler y seroient infailliblement mourir de
faim une multitude de malheureux, en accaparant par la supériorité de leurs forces, les occupations qui font
leur unique ressource.
Nous dînâmes à bord d’un vaisseau anglais. La conversation roula sur les deux frégates françaises, dont il a
été question tout-à-l’heure & sur leur départ avant d’avoir obtenu la moindre satisfaction. Il paroît que les
François ont, en cette occasion, encouru la juste censure des nations étrangères ; & elles ont fait, entre les
Anglois et eux, des comparaisons qui ne sont nullement à l’avantage des premiers. L’histoire fournit, en
effet, plus d’un exemple d’une conduite parfaitement opposée de deux gouvernemens, en des cas
semblables. Tandis que l’un perd le temps à négocier pour obtenir la réparation des outrages qu’il a reçus,
l’autre dépêche (p. 176) une flotte pour la commander d’un ton à se faire obéir. Tandis que l’un s’amuse à
dresser des traités inutiles, l’autre a recours a un genre d’argumens beaucoup plus propres à faire entendre
raison aux puissances mahométanes. Mais sans doute qu’il y a quelque mystère sous des procédés si peu
dignes d’un peuple si impatient, d’ailleurs, à supporter des affronts, & si délicat sur le chapitre de l’honneur. Il
est très-probable que les avantages particuliers que lui procure son commerce en ces contrées, influent
beaucoup sur la conduite qu’il y tient. Ainsi l’intérêt est le moteur, comme la clef de la politique : c’est
uniquement à lui qu’il sacrifie cette considération dont il est si digne & dont il se montre, en tout autre
occasion, si jaloux. Rendons-lui justice, l’Europe entière a incontestablement les plus grandes obligations à
la France, pour la peine qu’elle a prise de purger l’Archipel des pirates qui l’infestoient, à la suite des guerres
de la Russie. Ces brigans étoient grecs, pour la plupart, & en si grand nombre, qu’il n’y avoit pas un
vaisseau marchand qui pût leur échapper. Les frégates françoises les poursuivirent par-tout sans relâche ; &
pour couper le mal par la racine, elles coulèrent à fond presque tous les bâtimens, & cela, sans tirer un
(p. 177) coup de canon. Les heureux effets de cette expédition ne tardèrent pas à se faire sentir ; & il est de
nototriété publique que jamais la Méditerranée n’a vu si peu de corsaires de toutes dénominations, que
depuis cette époque si glorieuse à la marine françoise.
Le capitaine Calvi nous présenta, dans l’après-dîner, à une famille grecque, qui consistoit en une dame d’un
certain âge, & ses deux filles. Les jeunes personnes pouvoient passer pour deux beautés ; mais le mauvais
goût et la bisarrerie de leur parure leur ôtoient une partie de leurs agrémens. Elles avoient l’une & l’autre la
tête & le col surchargés de je ne sais quelle quantité de sequins, enfilés à-peu-près comme des perles. Dans
le nombre des pièces qui composoient ces étranges colliers, j’apperçus une médaille d’Alexandre-le-Grand,
parfaitement conservée. Comme les caractères étoient romains, il y a tout lieu de croire qu’elle avoit été
frappé par l’un des Césars, en l’honneur de ce héros. J’avois grande envie d’en enrichir ma petite collection,
mais je ne pus réussir à me la procurer. L’aînée des deux soeurs, dont le mari étoit alors en France, pressa
vivement le capitaine de la passer sur son bord. Le navire étoit plein ; mais en galant François, il s’excusa
sur ses passagers, (p. 178) parmi lesquels il vouloit, lui dit-il poliment, entretenir la concorde que ses
charmes pourroient troubler. La franchise & la gaité de ce Provençal me promettent une traversée très
amusante.
Dimanche 5 Octobre.
Nous entendîmes le matin l’office à la factorerie génoise, où nous restâmes à dîner, sur l’invitation du
seigneur Brandi. Le consul de Gênes est un bon & aimable vieillard, de plus de soixante-dix ans, & de la
meilleure humeur du monde. Il remplit avec distinction son emploi depuis trente-un ans, au moins ; mais
comme les infirmités de son grand âge le rendent actuellement incapable de gérer par lui-même les affaires,
elles sont dirigées, sous son nom, par le seigneur Brandi, qui est, de plus, agent de M. Baldwin.
Dans l’après-midi nous avons été nous promener ensemble à un jardin qui est à quatre pas de la ville. C’est
absolument l’unique promenade qu’il y ait : aussi, la trouve-t-on délicieuse. Elle est toute couverte
d’agréables plantations d’arbres fruitiers de différentes espèces & son aspect riant, sa verdure, ses
ombrages, s’embellissent encore par le contraste des plaines sablonneuses dont l’oeil est fatigué par-tout
aux (p. 179) environs d’Alexandrie. Il n’y a sûrement eu que l’avantage de sa position, par rapport au
commerce, qui ait pu déterminer Alexandre à fonder une ville sur une plaine aussi stérile & aussi aride. On
ne pouvoit faire, à cet égard, un choix plus heureux ; & le rang qu’elle tient encore aujourd’hui parmi les cités
commerçantes, en dépit des révolutions qu’elle a tant de fois éprouvées dans sa religion, son gouvernement
et ses usages, est une preuve éclatante de la justesse & de la sagacité du discernement de son fondateur.
Tyr, Carthage & même l’aimable et brillante Athènes, ont disparu de dessus la terre & ses villes fameuses
n’existent plus que dans quelques pages de l’histoire ; au lieu que le port d’Alexandrie est toujours fréquenté
par une multitude de vaisseaux de diverse nations & rappelle encore par leur affluence le temps où il fut le
centre du commerce du monde.
J’ai eu plus d’une fois, occasion de parler de la distinction avec laquelle mes compatriotes sont traités dans
ce pays-ci. Une conversation que nous eûmes le soir avec notre janissaire, nous en fit découvrir la cause ; &
cette cause c’est toujours la crainte de la marine. Il y a plusieurs années que le commerce britanique au
levant ne faisoit que décliner. Pourquoi ? parce (p. 180) que l’Angleterre ne montroit plus, comme autrefois,
des flottes formidables & triomphantes dans ces mers, parce qu’elle avoit cessé de répandre la terreur sur
les côtes de l’Egypte. Mais elle recommence à se faire craindre, son règne va recommencer. Elle vient de
s’ouvrir, par la voie de la Mer Rouge, une communication dont elle ne peut que recueillir les plus grands
avantages. Son activité, son industrie, désormais libres des entraves qui les avoient enchaînées trop
long-temps, vont reprendre leur essor & déjà dans son commerce avec l’Egypte, elle se voit maîtresse d’en
prescrire à son gré les conditions. Que le lecteur se rappelle le secours que nous a procuré, dans la plus
grande détresse où nous nous soyons jamais trouvés, l’arrivée de la corvette l’Hirondelle à Jedda. Cette
corvette étoit montée à-peu-près d’une vingtaine de canons & avoit été expédiée pour porter des dépêches
de Madras à Suez. Depuis que les Portugais sont expulsés de l’Arabie, jamais vaisseau de guerre étranger
n’avoit paru dans ce port. Son apparition étoit un phénomène, & la foiblesse de ce gouvernement en fut
vivement alarmée. Fût-il plus foible & plus pusillanime encore, il n’a rien à craindre pour ses côtes de la
Méditerranée. La jalousie & les divisions des nations (p. 181) européennes sont, à leur honte, pour cette
partie de ses domaines, le trop solide fondement de sa sécurité. Mais du côté de la Mer Rouge, il faut qu’il
se soumette à la puissance à qui l’empire de l’Inde a donné celui de la navigation & du commerce de ce
golphe où elle règne sans compétiteurs : & cette puissance est l’Angleterre. Ainsi, une route frayée d’abord
par de hardis aventuriers, peut devenir, par la suite, d’une utilité infinie à la nation ; & la communication
nouvelle qu’elle établit, est faite pour élever le pouvoir & la prospérité de la compagnie à un degré
incalculable. On sait à quel point la rumeur grossit en général tous les objets & sur-tout (p. 182) le danger.
La force de la corvette l’Hirondelle fut portée au Caire à soixante pièces de canons, & l’excès de la terreur
qu’elle inspira fut encore au-dessus de celui d’une pareille estimation. On ne s’étonnera pas qu’on ait réussi
avec des moyens si foibles par eux-mêmes, à en imposer à ce gouvernement si l’on songe qu’il n’a pas
seulement, dans la Mer Rouge, une misérable galère pour la protection du commerce. Presque tout le
commerce de la Mer Rouge se fait sur des vaisseaux arabes ; mais en mettant, comme il seroit facile, un
embargo sur l’importation du café dans les ports égyptiens, on la feroit alors nécessairement passer toute
entière entre les mains des caravanes : révolution infiniment désavantageuse à l’Egypte, à qui le café
coûteroit, par cette voie, le double du prix auquel il revient, quand il est transporté par mer.
(p. 183) Lundi 6 Octobre.
Nous fûmes encore retenus de la manière la plus désagréable, par la négligence des agens de la Cléopâtre.
Il y avoit quatre jours que le capitaine Calvi étoit prêt à mettre la voile, & les dépêches qu’il attendoit du Caire
n’étoient pas encore arrivées. Ce qu’il y avoit de plus contrariant, & pour comble de disgrace, le vent se tint
constamment à l’est tout ce temps-là, & nous aurions eu fait un quart de notre projet à Marseille. Quand les
retards viennent de la nature, il semble que ce soit une raison pour s’y résigner de meilleure grace. Mais
quand ils viennent de la faute des hommes, il y a de quoi démonter un stoïcien.
Nous rencontrâmes, dans le cours de la journée, des objets bien propres à nous faire oublier nos petits
désagrémens personnels. A la vue du malheur, & du malheur extrême, est-il possible d’avoir d’autres
sentimens que ceux de la plus tendre commisération ? Les infortunés dont je parle, c’étoient le capitaine & le
capitaine d’un vaisseau françois naufragé, il y a quatre ans, sur les côtes de Barbarie. Ils furent, avec tout
l’équipage du navire, réduits en esclavage, & ne (p. 184) doivent aujourd’hui qu’au hasard leur liberté.
L’empereur du Maroc a envoyé une ambassade à la cour de France, & ces François ont été choisis dans
quarante autres, comme un présent digne d’être accepté par un Roi. Les particularités de leur histoire sont
très-intéressantes ; mais elles ressemblent à mille autres, connues de tout le monde, sur le même sujet. Il y
a parmi eux un jeune homme d’environ quatorze ans, dont le sort a été plus doux que celui de ses
compagnons. Quand ils arrivèrent à Maroc, l’empereur, par une sorte de grande pitié pour la jeunesse, le prit
pour le service de son serail. Là, son unique emploi étoit de préparer le café pour les femmes du prince, &
de leur faire des bouquets des plus belles fleurs qu’il y eût au jardin. C’est de la bouche même du jeune
homme que nous tenons ces détails ; on voit par-là, qu’à l’esclavage près, sa destinée n’avoit rien de fort
tolérable. Peut-être quelques-uns de mes compatriotes seront-ils bien aises & bien fières d’apprendre que la
sultane est une Angloise, élevée à cette dignité depuis plus de vingt ans. Elle paroît en avoir environ
quarante ; &, comme elle a donné deux fils à l’empereur, c’est peut-être à la considération de son heureuse
maternité, qu’elle doit la continuation d’une faveur qu’elle ne peut plus conserver par le pouvoir seul de ses
charmes. La vérité est, qu’en public il rend à son épouse surannée les honneurs dus à son rang, & qu’en
particulier il s’amuse avec une concubine françoise, qui a été prise par un de ses corsaires, & conduite au
sérail à cause de sa beauté. En vérité ces barbares sont devenus bien délicats & bien capricieux dans leurs
amours ! Eh quoi ! les dépouilles de la Grèce ne leur suffisent plus, il faut encore que l’Angleterre & la
France payent le tribut à leur infâme & insatiable lubricité ! Dans quelle inconcevable léthargie sont donc
plongées ces nations belliqueuses, qui laissent de pareils outrages sans vengeance ! Leurs frères gémissent
dans les galères de la Barbarie ; leurs soeurs dans la prostitution de ses sérails ; & tous gémissent en vain !
Ah ! si jamais les puissances de l’Europe apprennent à connoître leurs vrais intérêts ; si jamais elles se
réunissent, au lieu de se diviser, c’est alors, alors seulement, qu’on pourra se flatter de les voir enfin tourner
leurs armes contre leurs ennemis communs du genre humain, & qu’elles n’auront plus elles-mêmes la
douleur & la honte de voir leurs peuples esclaves de barbares qui sont l’opprobe & le rebut de la terre.
Le Ramazan est commencé. Cette institution, (p. 186) à la fois religieuse & diététique, est une imitation de
notre carême. Mais elle en diffère beaucoup par la nature & la sévérité de ses abstinences. Dans le carême,
le catholique le plus rigide se contente de changer de régime & à la privation près des alimens défendus, il
prend sans scrupule, sa dose ordinaire de nourriture. Dans le Ramazan, au contraire, le musulman change
en tout sa manière de vivre. Depuis que le soleil se lève jusqu’à ce qu’il se couche, il ne peut absolument
goûter d’aucune substance : l’eau même, un goutte d’eau lui est interdite par la loi de Mahomet. Mais la nuit
le dédommage complètement du jour. Les excès y succèdent à l’abstinence, & sont toujours en proportion à
la rigueur. Notre janissaire se ressent & par contre-coup, nous nous ressentons aussi des effets du
Ramazan. Le bon musulman n’est presque plus propre à rien, depuis que ce saint temps est commencé ;
heureusement que nous ne devons pas faire long séjour ici, sans quoi il faudroit nous résoudre à nous
passer de ses services. Les rues sont à présents vuides & désertes, pendant le jour ; mais, vers le soir, le
peuple commence à s’assembler dans les cafés & aux carrefours, en attendant que ses prêtres fassent la
proclamation du coucher du soleil. Dans cette (p. 187) attente, il compte les minutes, il trépigne
d’impatience, il s’agite ; le moment désiré arrive enfin & au premier signal, il court, vole à table… quelquefois
se dédommager de son jeûne, par une indigestion.
Mardi 7 Octobre.
Les dépêches de la Cléopâtre arrivèrent enfin. Mais le vent devint si impétueux, que le capitaine jugea qu’il y
auroit du danger à partir par un temps pareil. Il fallut attendre si le jour suivant nous seroit plus favorable.
Les nouvelles du Caire nous apprennent, dans ce monument, que les troubles ont recommencé sur le Nil &
que la guerre est sur le point de renouveller ses horreurs dans cette malheureuse région. Les beys fugitifs
ont enfin, après de longs & pénibles efforts, réussi à se rendre maîtres de Jirje. La situation de cette place
leur facilite les moyens de gêner, d’intercepter même la navigation du Nil. On prépare au Caire un armement
considérable pour chasser les rebelles de ce poste important. Tous les bâtimens, sans exception, sont
employés pour ce service & l’on s’attend à voir incessamment la communication entre Alexandrie & la
Métropole interrompue. Du reste, il est assez facile de prédire quelle (p. 188) sera l’issue de cette nouvelle
insurrection. C’est le dernier effort d’un parti réduit au désespoir & incapable de résisiter à la supériorité
réunie du nombre & de la discipline. Ismael-bey vient de mettre à prix la tête de ses adversaires. Ce moyen,
tout barbare qu’il est, se trouve justifié par l’exemple des nations les plus policées, qui ne rougissent pas de
le mettre en usage envers ceux que l’état considère comme des traîtres & finira rès-probablement par
délivrer pour jamais le bey de l’Egypte. Quoi qu’il en soit, & qu’il arrive, nous ne pouvons que nous féliciter
d’être loin de la scène, & ce bonheur est si grand que nous ne croyons pas l’avoir acheté trop cher par
toutes nos peines & nos fatigues.
Ibrahim vient de nous faire ses adieux & de s’embarquer dans une chaloupe qui part pour Rosette. Nous lui
avons donné des lettres de recommandation pour tous les capitaines qui peuvent aller à Suez ; & il n’y a
point de doute qu’il ne trouve une occasion favorable à l’égard de l’Aventure, navire auquel on se souvient
qu’il est encore attaché. La conduite de ce bon (p. 189) Indien a été constamment remplie d’honnêteté & de
candeur. Les fautes légères qu’il a pu commettre quelquefois ont été surabondamment réparées par
l’importance & le nombre de ses services ; & si nous avions en ce moment du pouvoir & des richesses, leur
plus doux, leur premier usage, seroit de donner à ce fidèle & estimable serviteur, comme nous le
souhaiterions, & comme il le mérite, des marques plus éclatantes de notre affection & de notre
reconnoissance. Que l’on rencontre donc à la manie de croire que la vertu ne se trouve que dans telle ou
telle secte. Que l’orgueil ou l’intolérance apprennent qu’il n’y a, parmi les hommes de distinctions réelles,
que celles qui résultent de la pratique du bien & du mal ; & qu’ils s’efforcent de devenir justes & charitables
envers ceux mêmes qui sont dans l’erreur.
Pour être prêts à partir au premier moment, nous acquittâmes dans la matinée toutes les dettes que nous
pouvions avoir en cette ville & nous n’oubliâmes pas notre janissaire. Avec (p. 190) quelle ardeur, quelle
allégresse nous reprîmes enfin le chemin de notre patrie ! Tout concouroit à nous la rappeller ; tout offroit,
pour ainsi dire, à nos yeux quelques traits épars de son image. L’air d’Alexandrie semble être un peu
imprégné de la fraîcheur salutaire du vent du Nord ; ses rues présentent à tous momens l’habillement qui
nous est si familier & son port est rempli de vaisseaux destinés pour ces contrées heureuses & chères où
règnent les sciences & la liberté. Il nous fut impossible à cette vue de réprimer ces émotions si puissantes &
si douces qui font palpiter nos coeurs ! Avouons-le au lecteur, notre joie à l’aspect des préparatifs de notre
départ, alloit presque jusqu’au délire. Parcourant le rivage, nous avions sans cesse les yeux tournés sur
notre navire & nos pieds ne posoient pas à terre, quand nous en voyons disposer les voiles pour son retour
en Europe. Notre curiosité étoit enfin satisfaite : rien ne nous retenoit plus ; & comme des chasseurs
harassés d’une poursuite pénible & périlleuse, nous ne soupirions qu’après le repos ; & il sembloit que nous
en jouissions par avance, à force de le désirer. Douce attente, dont l’ardeur fait tous les charmes ! & que le
souvenir (p. 191) même de nos peines & de nos dangers rendoit encore plus délicieuse !
Mardi 8 Octobre.
Le vent se trouvant, le matin, favorable pour notre départ, le capitaine fit tirer un coup de canon ; c’étoit le
signal de nous tenir prêts. A sept heures M. Meillon vint nous prendre avec le major Alexandre &
M. Hammoud, pour nous rendre ensemble au port où nous nous embarquâmes sur la Cléopâtre ; & à
onze heures, nous levâmes l’ancre & nous cinglâmes à pleines voiles vers Marseille. »
- 690 - 700 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CHARLES SIGISBERT SONNINI DE MANONCOUR (1777-1778)
Sonnini de Manoncour, C. S., Voyage dans la Haute et Basse Égypte, Paris, An VII de la République.
Le naturaliste Sonnini de Manoncour naît à Lunéville (Lorraine) en 1751. Au moment d’être reçu avocat à
Nancy, il se réoriente pour devenir officier et ingénieur de la marine. De 1772 à 1775, il visite l’Amérique et
l’Afrique occidentale. À son retour, il passe six mois à Montbard auprès du naturaliste Buffon (1707-1788)
qui lui propose de se rendre en Égypte en 1777 en compagnie de François de Tott (voyageur de ce corpus).
Il meurt en 1812.612
p. 102-155 (tome I) :
Attérage d’Alexandrie.
« L’attérage d’Alexandrie a aussi ses dangers : cette partie de l’Egypte est si basse qu’on ne l’approche
qu’avec beaucoup de précautions. Si l’on arrive du côté de la Lybie, c’est-à-dire du couchant, la premiere
reconnoissance de l’Egypte est Abousir, appelé par les Européens, Tour des Arabes. Ce sont deux
éminences, sur chacune desquelles une tour s’élève. On les distingue de quatre lieues en mer. L’une de ces
tours est ronde, l’autre est carrée. C’est du moins (p. 103) l’apparence qu’elles m’ont présentées quand je
les ai vues du large. Il sembleroit néanmoins que leurs formes sont différentes de celles que je leur ai
trouvées au loin, car Granger, qui paroît avoir visité ces bâtiments, n’en a pas donné une semblable
description. La partie des côtes de l’Egypte situées au levant d’Alexandrie, se distingue facilement de celles
qui sont à l’occident. Elles sont moins basses et coupées par plus d’inégalités ; elles n’ont pas non plus la
même nudité : l’on y remarque quelques traces de culture, des palmiers et des habitations. Enfin l’on
s’assure que l’on est dans la direction d’Alexandrie, à la vue de la (p. 104) colonne de Pompée et
auparavant à celle de deux monticules qui sont derrière la ville actuelle, et dans l’enceinte de l’ancienne.
Mais de quelques côté que l’on aborde ces côtes dangereuses, l’on ne peut trop user de prévoyance, parce
que toutes ces reconnoissances ne s’aperçoivent pas de fort loin, et que les courants entraînent les
vaisseaux, et les portent vers l’Afrique avec une rapidité qu’il est plus aisé de prévoir que de calculer.
Deux ports également spacieux se présentent aux vaisseaux qui veulent jeter l’ancre près d’Alexandrie. L’un
qui est au couchant de la ville, s’appelle le port vieux : son entré est un peu difficile, à cause de deux sèches
qui ne laissent entr’elles qu’un canal étroit ; mais son intérieur est un bassin profond, de bonne tenue, et à
l’abri des plus mauvais temps. L’autre qui est au levant, est séparé du premier par une péninsule de peu de
largeur, a reçu le nom de port neuf ; il a peu de profondeur ; une multitude de rochers et de bas-fonds
l’embarrassent, et il est entièrement ouvert aux vents du nord. Si d’après cela, l’on pensoit que ce dernier
port étoit à-peu-près abandonné, l’on se (p. 105) tromperoit. Le fanatisme l’emportoit ici sur l’intérêt bien
entendu. Tandis que les Alexandrins se mêloient volontiers avec les Européens, dans les opérations
commerciales, ils refusoient aux bâtimens d’Europe les moyens d’alimenter, sans risques un commerce dont
ils retiroient tant d’avantages. Les vaisseaux des sectateurs de Mahomet, avoient seul le droit d’entrer dans
le port vieux ; et, dussent ceux des autres nations périr, faute d’une retraite sûre, il leur étoit interdit de
pénétrer dans un lieu si dottement et si impolitiquement privilégié.
A l’entrée du port neuf, est un écueil appelé le Diamant. On doit le ranger de très-près, afin d’éviter des
bas-fonds qui sont de l’autre côté, et qui, recouverts de quelques pieds d’eau seulement, sont encore plus
dangereux. Le Diamant, de même, que les rochers à fleur d’eau qui l’avoisinent, pourroient bien être une
portion des ruines de l’ancien Phare ; en sorte que les vaisseaux se perdoient aujourd’hui sur les débris du
plus beau monument qui ait jamais été érigé pour leur conservation.
Le fond de sable du port neuf est hérissé de roches et de décombres, et ce champ (p. 106) humide de
destruction le devient souvent en la plus horrible désolation. Les cables se rongent et se coupent par le
frottement sur les pierres. Les navires pressés à la file, le long de la jetée, ont peine à résister à la violence
du vent, et à la fureur des vagues qu’il soulève, sur-tout pendant l’hiver, c’est-à-dire, pendant les mois de
novembre, de décembre et de janvier, époque où la température est un peu rafraîchie par les pluies et les
orages. A l’approche de ces tempêtes, les équipages abandonnent leurs bâtimens, dans la crainte d’être
brisés avec eux contre le rivage. Le premier navire dont les cables se rompent, tombe sur son voisin et
l’entraîne avec lui : tous deux vont heurter un troisième qui ne peut résister à leur choc, et, dans un instant,
la ligne entière est confondue, fracassée, engloutie. Il n’est presque point d’année qu’Alexandrie ne soit
témoin de pareils désastres, qui suffiroient pour rendre son port désert, si la cupidité pouvoit se rebuter par
les dangers.
Les vaisseaux de guerre, auxquels il faut une eau plus profonde, sont obligés de mouiller aussitôt qu’ils ont
doublé le Diamant et les deux Sèches, c’est-à-dire, tout (p. 107) à l’entrée du port. La frégate l’Attalante
passa ainsi plus d’un mois, fatiguée par un roulis continuel ; position inquiétante, que j’aimai mieux partager
avec mes amis, que de m’établir à terre, comme j’en étois libre, puisque je devois rester en Egypte. Ce
mauvais port est encore plus rempli de roches du côté de l’est. Les vaisseaux ne peuvent en approcher ; le
débarquement y est impracticable. Nous cherchâmes inutilement d’y aborder avec un canot, dans le dessein
de visiter les obélisques qui sont de ce côté. Nous manquâmes même de périr par les coups violens et
redoublés que l’agitation de l’eau faisoit donner sur les pierres. Ce hâvre détestable n’en est pas moins,
presque toujours, rempli de vaisseaux. Un mouvement continuel y indique l’activité du commerce. L’on y
charge les richesses de l’Asie et de l’Afrique, tandis qu’on y débarque les produits des arts et des
manufactures de l’Europe. Une position géographique d’une si haute importance, ne pouvoit échapper au
génie d’Alexandre. Au milieu de la rapidité de ses conquêtes, il sentit que là pouvoit s’élever le théâtre des
(p. 108) relations entre tous les peuples, et il offrit tout-à-coup Alexandrie à l’admiration et au commerce des
nations. Dinocrate en avoit tracé le plan sous les yeux d’Alexandre, et en dirigeoit les travaux. C’étoit un de
ces hommes à conceptions vastes et hardies, et dont les siècles sont avares. L’histoire nous a conservé un
trait remarquable et caractéristique de son génie. Dans l’intention de perpétuer le nom et la gloire du plus
grand conquérant par un monument durable à jamais, il avoit proposé d’y consacrer une partie même du
globe ; de tailler une énorme montagne, le mont Athos, pour en sculpter une statue inébranlable, qui n’auroit
eue pour base que la terre même, et qui auroit effacé tout ce que l’Egypte avoit enfanté de plus prodigieux.
Idée sublime qui rend l’artiste digne d’entrer en parallèle avec les héros.
Avec un Alexandre pour commander le plan d’une ville, avec un Dinocrate pour l’exécuter, l’on conçoit
combien celle-ci devoit être grande et magnifique. Les rois d’Egypte l’embellirent encore par des
établissements admirables dont la perte excite nos regrets. Sous le regne d’un Ptolémée, Sostrate, autre
architecte de Cnide, construisit un (p. 109) phare que les anciens comptoient entre les sept merveilles de
l’univers. Un autre roi forma une bibliothèque immense. Alexandrie, enfin, fut le centre des sciences et des
richesses : c’étoit le lieu du monde où le commerce étoit le plus en vigueur. Josephe assure qu’elle
rapportoit davantage au trésor des Romains, en un mois, que tout le reste de l’Egypte en un an. On y
cultivoit avec un égale succès les arts utiles et les arts agréables. Le luxe s’y introduisit et devint bientôt à
son comble ; des plaisirs vifs et brillans dégénérèrent en licence : ses délices passèrent en proverbe ; les
moeurs furent corrompues, et Alexandrie périt. Exemple terrible, mais constamment perdu pour les nations.
Je n’entreprendrai point de faire la description de cette fameuse ville d’Alexandre. Assez d’autres, sans moi,
ont essayé de remplir cette tâche. D’ailleurs, ces détails appartiennent à l’histoire, et je n’oublie pas qu’un
voyageur ne doit compte que de ce qu’il a vu, et non de ce qu’il a lu. Des monumens qui paroissent braver le
choc du temps, sont écroulés avec la ville dont ils faisoient l’ornement : des flammes que la férocité et
l’ignorance dirigèrent, ont dévoré (p. 110) la bibliothèque des Ptolémée : le phare est sous les eaux de la
mer, et la tour qui sert aujourd’hui de fanal n’en marque pas même la place. L’Alexandrie actuelle n’occupe
qu’une très-petite partie de terrain dans l’enceinte de celle d’Alexandrie ; c’est une ville ou plutôt un bourg
tout moderne, qui n’a d’ancien que les débris qui y sont épars. Le génie des habitans, les connoissances, les
arts, le commerce même, tout y est rétréci, et, si l’on étoit soutenu par les restes d’une ville jadis si superbe,
on auroit jamais le courage de parler de celle-ci.
Alexandrie moderne. Ses habitans. Juifs. Esprit de vengeance. Assassinat du consul d’Alexandrie. Langage.
Ruines.
(p. 111) Je dois prévenir qu’ayant séjourné plus d’une fois à Alexandrie, je donnerai de suite mes
observations, quoique faites à diverses époques. Je quitterai donc, pour quelques instants, la forme de la
relation, et je décrirai, d’un seul trait, ce que j’y ai vu à plusieurs reprises et sans m’astreindre à l’ordre des
dates de mes remarques. Je suivrai la même marche qui m’a parue plus naturelle et plus commode pour les
lecteurs, lorsque j’aurai à parler de quelque lieu que j’aurai visité en des temps différents.
Décrire de la ville d’Alexandrie, par le menu, après tant de grands personnages, a dit un excellent
observateur qui voyageoit en Egypte, sous le règne de François 1er, ce ne seroit que redite613. (p. 112)
Depuis l’époque à laquelle Bellon écrivoit, beaucoup d’auteurs, parmi lesquels on peut compter plus d’un
grand personnage, ont donné la description des restes de cette ville célèbre, et l’on ne peut, à présent, éviter
les redites. Mais, sans parler de quelques observations neuves que les restes de l’antique Alexandrie m’ont
fournies, la curiosité de ceux qui liront mon ouvrage seroit peu satisfaite, et leur attente seroit trompée, si,
pour leur donner connoissance de ce qui existe encore sur des plages si renommées, je les renvoyois à
d’autres livres que le mien. Je ne parlerai au superflus, que des choses que j’aurai pu examiner moi-même.
La latitude d’Alexandrie a été donnée par les anciens astronomes, avec assez de précision. Ptolémée, qui
étoit lui-même égyptien, l’avoit placée, dans sa géographie, à 31° 58’ dans son Almageste. Erastothène,
plus exact, avoit trouvé cette même latitude de 31° 12’, ce qui est extrêmement approchant des observations
des modernes auxquels la perfection de l’astronomie et des instrumens procuroit un grand avantage.
(p. 113) Elle a été déterminée par Chazelle de l’académie des Sciences de Paris, à 31° 11’ 20’. Sa longitude
est de 47° 56’ 33’.
La nouvelle ville, ou plutôt la bourgade d'Alexandrie est bâtie, en grande partie, sur le bord de la mer. Ses
maisons, comme toutes celles du Levant, ont leurs combles en terrasses : elles sont sans fenêtres, et les
jours qui en tiennent lieu sont presque entièrement bouchés par un treillis en bois, saillant, de différentes
formes, et si serré que la clarté peut à peine y pénétrer. Dans ces pays, plus qu'ailleurs, de pareilles
inventions qui transforment les logements en autant de prisons, sont de véritables jalousies. C'est à travers
cette symétrie, quelque fois élégante ; de barreaux, que la beauté peut voir ce qui se passe au dehors, sans
jamais être aperçue ; c’est dans ces sortes de réclusion éternelles que, loin de recevoir l’hommage que la
nature a commandé à tous les êtres sensibles, elle n’éprouve que mépris et qu’outrages ; c’est là enfin
qu’une portion du genre humain, abusant du droit odieux du plus fort, retient dans un esclavage avilissant
l’autre portion, dont les charmes auroient eu seuls la puissance d’adoucir, et (p. 114) l’âpreté du sol, et la
férocité de ses dominateurs.
Des rues étroites mal ordonnées, sont sans pavé comme sans police ; aucun édifice public, aucun bâtiment
particulier n'arrête les regards du voyageur, et, en supposant que les restes de l'ancienne ville n'eussent pas
frappé sa vue, il ne trouverait rien dans celle-ci qui pût attirer son attention. Des Turcs, des Arabes, des
Barbaresques, des Coptes, des Chrétiens de Syrie, des Juifs forment une population que l'on peut évaluer à
cinq mille habitants, autant qu’il est possible d’en juger dans un pays où l’on ne tient registre de rien. Le
commerce y attire en outre, de toutes les contrées de l’Orient, des étrangers qui n’y font qu’un séjour
momentané. Cet assemblage confus d’hommes de diverses nations, jalouses et presque toujours ennemies
les unes des autres, offriroit à l’observateur un mélange singulier de costumes et de moeurs, si un repaire de
brigands valoit la peine d’être observé.
On les voit se presser dans les rues, et y courir plutôt qu’y marcher : ils crient aussi, plutôt qu’ils ne parlent.
Je me suis arrêté souvent près de quelques personnes qui me (p. 115) paraissoient agitées par la colère :
elles donnoient à leur voix toute l’intensité qu’une large et forte poitrine pouvoit fournir ; leur physionomie
portoit les traits de la passion ; leurs yeux étincelloient ; des gestes violents accompagnoient des discours
qui sembloient plus violens encore. Je m’approchoit avec la crainte de les voir s’égorger à l’instant, et j’étoit
tout étonné d’apprendre qu’il ne s’agissoit que d’un marché de peu d’importance ; qu’aucune de leur paroles
n’étoit menaçante ; que leur extérieur seul étoit en mouvement ; qu’enfin tout ce fracas n’étoit que leur
manière accoutumée de marchander. Cette coutume de donner à sa voix la plus forte infléxion en parlant,
est commune à presque tous les peuples orientaux, à l’exception des Turcs, dont le maintien et les
habitudes sont plus graves et plus posées. Il n’est personne parmi nous, qui n’ait pu (p. 116) remarquer que
les Juifs, cette nation qui a su conserver son caractère et ses usages chez les autres nations, au milieu
desquelles elle se trouve dissiminée, ne parlent aussi très-haut, particulièrement qu’entr’eux. Si l’on en
excepte quelques individus, dont la gêne, dans l’imitation de nos manières, annonce assez qu’elles ne leur
sont pas naturelles, on les voit aussi, lorsqu’ils marchent dans nos rues, le corps perché en avant, et sans
aucun fléchissement du genou, former de petits pas vifs et précipités, qui approchent plus d’une course que
d’une marche ordinaire. On les retrouve en Egypte, où ils vivent dans l’abjection, encore plus qu’ailleurs, tels
que nous les connoissons, avares, adroits, insinuans et bas trompeurs. Leurs pillages ne sont pas comme
ceux des Bédouins et des autres voleurs de l’Egypte, ni éclatans, ni exécutés à force ouverte : ce sont, ainsi
que chez nous, des filouteries adroites, des larcins officieux qui remplissent leur bourse, et vident sans bruit
celle d’autrui. C’est ainsi que j’ai vu les Juifs, par-tout où j’en ai rencontrés ; on reconnoît en tous lieux leurs
vices indélébiles, tant qu’ils s’obstineront à ne pas franchir la ligne qu’ils ont tracées entre (p. 117) eux et les
autres peuples ; on les voit aussi en tous lieux déployer les mêmes moyens, les mêmes astuces, les mêmes
friponneries, vrais fléaux dans l’ordre social ; enfin cette même insensibilité, cette même ingratitude, dont ils
ont payé, dans ces derniers temps, la générosité et les procédés magnanimes de la France.
Quelques femmes juives d'Alexandrie avoient ouvert, de mon temps leurs maisons aux Européens ; elles
n'étoient ni sans beauté, ni sans esprit ; leur société n'étoit pas non plus sans agrémens, et s'il y avoit à leur
reprocher quelque chose de l'appétit désert donné du gain, signe caractéristique des hommes de leur nation,
du moins leurs larcins étoient plus doux, leurs tromperies plus aimables, et on leur pardonnoit aisément.
L’on sent de quels excès sont capables des hommes qui, dans les choses les plus ordinaires, montrent les
apparences de la fureur. Lorsque leur ame est exaltée, lorsqu’elle prend sa part des mouvements brusques
du corps, il n’est pas de frein pour eux. Semblables à un torrent impétueux qui épouvante, autant par son
bruit que par (p. 118) ses ravages, ils se livrent à toute la fougue de leur emportement ; c’est alors qu’ils se
rapprochent véritablement des animaux sauvages qui viennent leur disputer des sables qu’ils savent
également ensanglanter. De là des émeutes, des attroupement tumultueux, dont les Européens ont eu si
souvent à souffrir. Il est digne de remarque que ce caractère remuant et enclin à la sédition, ait été aussi,
quoiqu’avec moins de fureur, celui de l’ancien peuple d’Alexandrie.
Si la vengeance des autels, c’est sans doute en Egypte : elle y est la déesse, ou, pour mieux dire, le tyran
des coeurs ; et elle y est implacable. Non-seulement la plupart des hommes dont le mélange forme la masse
des habitans ne pardonnent jamais, mais, quelqu’éclatante que soit la réparation qu’on leur donne, ils ne se
jugent satisfaits que quand ils ont eux-mêmes trempé leurs mains dans le sang de celui qu’ils ont déclaré
leurs ennemi. Quoiqu’ils conservent long-temps leur haine, et qu’ils la dissimulent jusqu’à ce qu’ils trouvent
l’occasion favorable pour l’assouvir, les effets ne sont pas moins terribles : ils n’en sont pas (p. 119) mieux
raisonnés. Si un Européen, ou, comme ils parlent, un franc, a provoqué leur animosité, ils le feront retomber
indistinctement sur un Européen, sans s’embarrasser si celui-ci est parent, ami, ou seulement de la même
nation que celui dont ils ont reçu l’offense : ils ôtent ainsi à leur ressentiment ce qu’il peut avoir d’excusable,
et leur vengeance n’est q’une atrocité.
Alexandrie retentissoit encore, à mon arrivée, d’un attentat commis, il y avoit peu d’années, sur la personne
du chef de la nation françoise, dans cette échelle. Un perruquier françois chassoit aux environs de la ville ; il
se prit de querelle avec un arabe, et il eut l’imprudence de le terminer par un coup de fusil qui tua son
adversaire. La nouvelle de ce meurtre se répandit bientôt. Le peuple se souleva, et, dans sa rage, il vouloit
égorger, sans distinction, tout ce qui se trouvoit d’Européens. On parvint, avec beaucoup de peines, (p. 120)
à l’appaiser, en lui livrant le meurtrier, qui fut pendu sur la place publique ; mais un arabe, frère du mort,
quoique témoin de l’exécution, ne se crut pas assez vengé : il fit serment de sacrifier aux mânes de son
frères le premier franc qu’il rencontreroit. Tous les Européens se tinrent enfermés pendant trois mois entiers,
dans l’espérance que la fureur de cet homme se calmeroit. Au bout de ce temps, et d’après des informations
propres à les tranquiliser, ils crurent pouvoir sortir, sans risques, de leur retraite. Depuis huit jours ils se
montroient à l’ordinaire, dans la ville et dans la campagne, et aucun d’eux n’avoit eu de rencontres
fâcheuses. Le consul n’avoit pas encore osé s’exposer : il pensa, à la fin, qu’il pouvoit aussi prendre l’air,
sans courir de dangers. Il se promenoit avec un janissaire de sa garde, sur les bords du canal. Par un
hasard malheureux, l’Arabe qui, avec le sentiment de la vengeance soigneusement conservé dans le coeur,
portoit constamment des armes pour le satisfaire, se trouva dans le même canton. Il s’approcha du françois,
qui n’avoit aucune défiance, et aussi lâche que cruel, il l’étendit sur la poussière, d’un (p. 121) coup de fusil
qu’il lui tira au dos. Le janissaire, au lieu de venger, ou du moins de secourir celui qu’il étoit de son devoir de
protéger, se sauva à toutes jambes, et l’infortuné consul mourut de ses blessures quelques heures après.
Les négocians françois dépêchèrent à Constantinople un bâtiment léger, afin de réclamer justice. La Porte
ottomane envoya des officiers chargés d’ordres précis et sévères ; mais ces ordres, d’abord éludés, finirent
par demeurer sans exécution. L’assassin ne quitta pas même la ville, où il se montroit impunément. Les
négocians furent forcés de dissimuler leur propre sûreté ; et, outre l’affront que la nation françoise éprouva
par l’assassinat impuni de son délégué, le commerce national eut encore à regretter des sommes
considérables, dépensées inutilement pour demander une juste réparation.
(…)
(p. 122) Le tableau que je viens de donner des moeurs des habitans de l’Alexandrie moderne, quelque
sombre qu’il soit, n’est point exagéré. Je les ai peints tels que je les ai vus. Je pourrois invoquer, à l’appuis
de ce que j’en ai dit, le témoignage des voyageurs les plus (p. 123) estimés, et sur-tout celui des Européens
que les emplois, les spéculations commerciales ou la curiosité, ont fait séjourner quelques temps à
Alexandrie, et qui ont été les témoins, et peut-être les victimes de ce caractère de férocité. Si, à l’entrée
d’une armée victorieuse, ils ont su se présenter sous l’apparence de bonnes gens, on ne doit pas en être
étonné. L’homme le plus cruel est ordinairement le plus vil ; il n’a de valeur que quand il est assuré d’être le
plus fort ; il rampe dès qu’il devient foible ; mais il lui reste la perfidie et la trahison, et ces armes des ames
basses, il les emploiera toutes les fois qu’il croira n’être pas découvert.
La langue arabe est, généralement, en usage à Alexandrie, de même que dans l'Égypte entière. Mais la
plupart des Alexandrins, ceux particulièrement que des liaisons de commerce rapprochent des marchands
d'Europe, parlent aussi l'italien, adopté dans les ports du Levant. L'on y parle encore le moresque ou langue
franque : c'est un composé de mauvais italien, d'espagnol et d'arabe. Un étranger pouvoit, plus aisément
qu’ailleurs, s’y procurer des domestiques, lesquels, s’ils n’étoient pas d’une fidélité (p. 124) bien éprouvée,
avoient du moins la facilité de se faire entendre de ceux qui ne savent pas l’arabe. Un serdar, officier peu
considérable, y commandoit, et sa puissance n’alloit pas toujours jusqu’à contenir une populace effrénée.
Une étendue de sable et de poussiére, un amas de décombres étoit un séjour digne de la peuplade
d’Alexandrie, et chaque jour elle travailloit à en augmenter l’horreur. Des colonnes renversées et éparses ;
quelques autres droites encore, mais isolées ; des statues mutilées, des chapiteaux, des entablemens, des
fragmens de toute espèce jonchent le sol dont elle est environnée. L’on ne peut faire un pas, sans se
heurter, pour ainsi dire, contre quelques-uns de ces débris. C’est le théâtre hideux de la plus horrible
destruction. L’ame s’attriste, en contemplant ces restes de la grandeur et de la magnificence, et elle
s’indigne contre des barbares qui ont osé porter une main sacrilège sur des monumens que le temps, le plus
impitoyable des dévorateurs, auroit respectés.
Enceinte d’Alexandrie par les Arabes. Aiguilles de Cléopâtre. Palais des rois d’Egypte. Colonne de Pompée.
(p. 125) L’enceinte de la cité d’Alexandre, jadis si vaste, ayant plusieurs lieues de circuit ; et près d’un million
d’habitans, avoit été resserée par les Arabes qui l’avoient envahie. C’est cette nouvelle enceinte, formée de
cent tours voûtées et de murailles solides, qui enferme Alexandrie de nos jours, dont l’état, comme on l’a vu
dans le chapitre précédent, étoit si déplorable. Mais, trop petite pour une zone aussi étendue, il s’en faut de
beaucoup que la ville actuelle en occupe tout l’intérieur : elle en est séparée par des grands intervalles, qui
ne présentent que l’image du boulversement le plus complet, des décombres amoncelés et des débris
épars. Quelques auteurs avoient pensé que ces murs étoient ceux-mêmes qu’Alexandre avoit fait bâtir.
Cette opinion, (p. 126) depuis long-temps abandonnée, a été émise de nouveau par M. Tott614 ; mais leur
architecture n’a rien de celle des Grecs, ni de celles des Romains : elle est évidemment à la manière des
Arabes, et du même genre que celles des murailles du Caire, lesquelles ont été construites
incontestablement par eux. Des colonnes et d’autres morceaux de monumens vraiment antiques ont été
employés dans leur bâtisse, prouve sans réplique de leur construction plus moderne ; et les inscriptions en
caractères arabes et kufiques, dont les tours sont chargées en différens endroits, ne laissent aucun doute
sur leur origine. Elle n’a pas paru douteuse au plus grand nombre des voyageurs, entre lesquels je me
contenterai de citer le savant Pokoke, celui dont les recherches en antiquité ont été les plus profondes. « Ce
fut, dit-il, l’an 600 de l’hégire, 1212 de l’ère chrétienne, qu’un des successeurs de Saladin qui venoit
d’enlever l’Egypte aux califes de la famille des Fatimiens, fit bâtir les murailles d’Alexandrie moderne : on se
servit pour cet ouvrage, dont l’enceinte a deux lieues de France de circuit, des débris de (p. 127) l’ancienne.
Les murailles et les cent tours dont elles sont flanquées, sont composées de morceaux de marbres et de
colonnes brisées, confondues avec des pierres communes615. »
Les épaisses murailles et les cent tours qui les flanquent, n’embrassent, comme on vient de le voir,
qu’environ deux lieues de circuit, tandis que, d’après les évaluations, la ville d’Alexandrie avoit sept à huit
lieues de tour616. Les matériaux employés à la construction de quelques-unes de ces tours, autres que les
fragments des monumens plus anciens, sont d’une pièce singulière, et dont aucun voyageur que je
connoisse, n’a fait mention. L’on y voit de pierres ordinaires qu’aux endroits réparés ou construits plus
récemment. Dans l’origine, leur maçonnerie a été faite avec des masses pierreuses, formées d’une quantité
prodigieuse de petits coquillages fossiles et spatheux, mêlés sans aucun ordre avec une espèce de ciment
qui les lie tous ensemble, en sorte que cette matière, qui est de la consistance la plus dure, paroît être un
composé, une (p. 128) agrégation de l’art, plutôt qu’une pierre naturelle.
La solidité des murailles, la vaste capacité des tours, qui peuvent passer pour autant de forts, faisoient de
l’enceinte des Arabes, un rempart susceptible d’une longue défense. Malgré les dispositions et la résistance
des Mameloucks et de leurs troupes, une poignée de François, sans canons et presque sans munitions, l’ont
emporté à l’escalade, en peu d’instans. Alexandre avoit posé les fondemens d’une ville, dont le commerce,
les sciences et les prodiges de l’art ont perpétué la mémoire : Bonaparte a arraché les restes de cette même
ville des mains des barbares, dont la présence en souilloit les ruines ; il l’a rendue au commerce générale
que sa position lui assure, et qui rappelera son ancienne splendeur ; l’on ne sait lequel des deux héros, du
fondateur ou du restaurateur, excitera le plus d’admiration de nos neveux.
Vers l’extrémité orientale du croissant, formé par le port neuf, et près de la côte, sont deux obélisques. On
s’est accordé à les appeler aiguilles de Cléopâtre, quoiqu’il ne soit pas certain qu’elles aient été l’ouvrage
(p. 129) de cette reine de l’Egypte. On lui a également attribué, sans aucune preuve historique, des
excavations que l’on appelle ses bains, et la construction du canal qui amène encore les eaux du Nil dans
les citernes d’Alexandrie. Hommage rendu aux grandes qualités de la dernière reine de la race des
Ptolémées. C’est ainsi que tandis que le nom des hommes qui ont fait élever la plupart des édifices étonnant
de l’ancien Egypte, est absolument ignoré, la postérité conserve soigneusement le souvenir d’une femme,
illustre par sa magnificence, son génie, son caractère héroïque et son incomparable beauté ; de celle, dont
les charmes triomphèrent du plus grand des Romains ; de celle enfin à qui on ne peut reprocher que les
écarts d’une passion, difficile à vaincre dans une ame brûlante, et sous un ciel de feu, à laquelle les grâces
ne refusent point de sourire, et que la nature ne désavoue pas.
L’une des aiguilles de Cléopâtre est encore droite sur sa base, l’autre est renversée et presque entièrement
couverte par les sables. La première montre ce que peut la main de l’homme contre le temps ; la seconde,
ce que peut le temps contre les efforts (p. 130) de l’homme. Je n’ai pu en prendre les dimensions ; mais un
ancien voyageur françois, qui paroît les avoir mesurées avec le plus d’exactitude, assure qu’elles ont
cinquante-huit pieds six pouces de hauteur, et sept pieds de largeur sur chaque face de leur base617. Elles
ont été taillées d’un seul morceau de granit et elles sont chargées sur chaque pan, de caractères
hiéroglyphiques. La figure première de la première planche représente celle des deux aiguilles qui est droite,
vue du côté du nord. L’impression des hiéroglyphiques étoit encore très-nette sur les faces de cette aiguille,
et ils se distinguoient très-aisément, si l’on en excepte ceux qui regardent le levant, lesquels sont
entièrement effacés.
Près de ces obélisques, les rois d'Égypte avoient leur palais. L'on voit encore de superbes vestiges de sa
grandeur et de sa magnificence. Ils sont une carrière inépuisable de pièces de granit et de marbre, que les
Alexandrins actuels déshonoroient, en les employant avec les matériaux les plus communs, à la construction
de leurs maisons et de leurs édifices. Des fouilles légères dans (p. 131) cet emplacement fournissoient plus
abondamment qu'ailleurs, des médailles et des pierres gravées : elles étaient devenues rares, et l'on n'y en
trouvait presque plus, lorsque j'étois à Alexandrie. C'est aussi de ces ruines que vient la dent molaire fossile,
représentée de grandeur naturelle, planche deuxième. Elle passoit pour une dent d'homme, et par
conséquent de géant. Mais cette opinion ne peut être admise par quiconque a les plus légères notions
d'anatomie. En comparant cette dent avec celles des animaux connus, on se convaincra qu'elle appartenoit
à un éléphant.
Si l’on sort de l’enceinte des Arabes par la porte du Midi, l’on a devant soi un des monumens les plus
étonnans que l’antiquité nous ait transmis. Fière de n’avoir pas succombé sous les coups du temps, ni sous
les attaques plus terribles et plus promptes de la supertitieuse ignorance, s’élève avec majesté la plus
grande colonne qui ait jamais existé. Elle est du granit le plus beau et le plus dur, et elle est formée de trois
morceaux, avec lesquels l’on a taillé le chapiteau, le fût et (p. 132) le piedestal. Je n’ai pas eu les moyens de
mesurer sa hauteur, et les voyageurs qui m’ont précédé ne sont pas d’accord entre eux sur ce point. Savary
lui donne cent quatorze pieds de haut618, tandis que Paul Lucas, qui annonce l’avoir mesuré avec précision,
ne lui en a trouvé que quatre-vingt-quatorze619. Cette dernière opinion étoit généralement adoptée par les
Européens d’Alexandrie. La hauteur de la colonne y passoit pour être de quatre-vingt-quinze pieds de
France. Le piédestal a quinze pieds de haut ; le fût avec le socle, soixante-dix-pieds ; enfin le chapiteau, dix
pieds ; total, quatre-vingt-quinze pieds. Le diamètre moyen est de sept pieds trois quarts. D’après ces
proportions, la masse entière de la colonne peut être évaluée à six milles pieds cubes. L’on sait que le pied
cube de granit rouge d’Egypte pèse cent quatre-vingt-cinq livres. Le poids de la colonne est donc d’un
million cent dix mille livres, poids de marc.
Quelque dure que soit la substance de (p. 133) la colonne, elle n’a pu échapper à la corrosion du temps. Le
bas du fût est fort endommagé du côté de l’est, et l’on enlève sans peine, de ce même côté, des éclats du
piedestal. L’on a vu ci-devant que les hiéroglyphes de l’aiguille de Cléopâtre étoient rongés sur la face qui
regarde le même point. C’est très-vraisemblablement l’effet du vent de la mer.
On prétendoit que, sur la face opposée, c'est-à-dire au couchant, l'on distinguoit une inscription grecque,
lorsque le soleil donnoit dessus ; mais quelque attention que j'y aie apporté, je n'ai pu l'apercevoir.
Le terrain sur lequel la colonne est posée, s’étend affaissé, il a laissé à découvert une partie du pivot qui la
supporte. C’est un bloc de six pieds seulement en carré : il soutient, par son centre, un piédestal beaucoup
plus grand ; ce qui prouve le parfait aplomb de l’ensemble. Il est aussi de granit, mais d’une espèce
différente de celui de la colonne. Les gens du pays avoient bâti autour du pivot, dans l’intention de soutenir
le piédestal. Cette maçonnerie, parfaitement inutile, étoit formée de pierres de diverse nature, parmi
lesquelles des morceaux de (p. 134) marbre, détachés des restes de quelqu’ancien édifice, et chargés de
beaux hiéroglyphiques, se faisoient remarquer. Tandis que quelques-uns cherchoient à prévenir la chute du
monument, d’autres qui m’a-t-on dit, étoient des Bédouins, tentoient de le renverser, dans l’espérance de
trouver un trésor sous sa base en éclats. Il avoient employé l’action de la poudre ; mais ils étoient
heureusement fort ignorans dans l’art des mines. L’explosion ne détruisit qu’une portion de la bâtisse,
inutilement placée sous le piédestal.
Paul Lucas raconte qu’en 1714, un charlatan ayant monté sur le chapiteau avec une facilité qui surprit tout le
monde, il assura que le dessus étoit creusé. Nous savons depuis quelques années des renseignemens plus
positifs. Des marins anglois parvinrent au faîte de la colonne par le moyen d’un cerf-volant, qui servit à
établir une échelle de cordes ; ils trouvèrent comme l’homme de Paul Lucas, un grand creux en rond au
milieu du chapiteau, et de plus, un trou à chacun des coins. Il est donc certain que ce chapiteau, et de plus
servoit de base à quelque statue, (p. 135) dont les débris paraissoient perdus pour toujours. Des amis de
M. Roboli, qui avoit été interprète de la nation françoise à Alexandrie, m’ont raconté qu’il avoit découvert,
près de la colonne, des morceaux d’une statue qui, à en juger par ses fragmens, devoit être prodigieuse,
qu’il les avoit fait transporter à la maison occupée par les François, mais que, malgré toutes ses recherches,
n’ayant pu s’en procurer les autres pièces, il avoit fait jeter les premières dans la mer, près de la même
maison. On me les a montrées, sans qu’il m’ait été possible de rien distinguer, parce qu’elles sont presque
entièrement ensevelies sous le sable de mer. L’on m’a ajouté que ces fragments de statue, étoient du plus
beau porphire.
L’on a que des conjectures, plus ou moins fondées, sur l’époque et les motifs de la construction de la
colonne d’Alexandrie. Le nom de colonne de Pompée, sous lequel elle est généralement connue, indique
l’origine qu’on lui prête le plus communément. C’est, a-t-on dit, César qui l’a faite ériger, pour perpétuer le
souvenir de la victoire qu’il avoit remportée sur Pompée, dans la fameuse bataille de Pharsale. Appuyé
(p. 136) du témoignage d’un écrivain arabe, Savary a prétendu que c’étoit un monument de la gratitude des
habitans d’Alexandrie envers Alexandre-Sévère, empereur romain620. D’autres enfin, ont attribué l’élévation
de la colonne à un roi d’Egypte, Ptolémée-Evergette.
Le chevalier de Montagu, que ses vastes connoissances et ses avantures ont rendu célèbre, s’étoit formé,
pendant le long séjour qu’il a fait en Orient, une nouvelle opinion sur le même sujet. Il vouloit que la colonne
fut l’ouvrage d’Adrien, autre empereur romain, qui avoit voyagé en Egypte. Mais il n’avoit aucune preuve :
voulant néanmoins accréditer son opinion, il fut obligé, afin de persuader aux autres ce qu’il s’étoit persuadé
à lui-même, d’user d’une petite supercherie. Je tiens le fait d’un témoin irréprochable. Le savant anglois avoit
fait insinuer, par un de ses gens, une petite médaille de l’empereur Adrien, dans un endroit qu’il avoit
indiqué, entre le sol sur lequel pose la colonne et son stylobate. Il se rendit ensuite sur les lieux en
nombreuse compagnie, et après des recherches feintes, il fit tomber adroitement, avec (p. 137) la lame d’un
couteau, la médaille qu’il montra comme preuve incontestable de la vérité de sa découverte. Il la
communiqua dans sa patrie : elle n’y eut pas un grand succès, et elle ne pouvoit y en obtenir beaucoup, aux
yeux de ceux qui connoissent la colonne. En effet, du temps d’Adrien, les Grecs avoient répandu en Egypte
les principes de la belle architecture, et l’élégance dans tous les arts. L’on peut en juger par les restes de la
ville que le même empereur avoit fait bâtir dans la partie supérieure de cette contrée, en l’honneur d’Antinoë
sont taillés avec plus de délicatesse, et elles ont des formes plus élégantes que celle d’Alexandrie. Ce n’est
pas que celle-ci ne soit belle ; mais son principal mérite est d’être prodigieuse dans ses dimensions, et
vraiment étonnante par sa masse énorme.
Le même motif qui fait douter que la colonne soit du temps d’Adrien, l’éloigne encore plus de celui de
l’empereur Sévère. Abulfeda, cité par Savary, dit seulement (p. 138) qu’Alexandrie possède un phare
fameux et la colonne de Sévère621. Il n’ajoute rien de plus, et il n’indique pas même le lieu où la colonne de
Sévère fut élevée. La ville d’Alexandrie refermoit un si grand nombre de colonnes, qu’il est impossible
d’assigner à laquelle on doit appliquer le passage de l’histoire arabe. Alexandre-Sévère avoit la prétention
de descendre d’Alexandre le Grand : il devoit naturellement chérir une ville fondée par le conquérant son
aïeul, et il n’est point étonnant qu’il ait cherché à l’embellir encore par des ouvrages de tout genre, renversés
ou détruits avec ceux qui la rendoient déjà si magnifique. D’un autre côté, si l’on compare la colonne dédiée
à Sévère, et encore existante aujourd’hui dans l’ancienne ville d’Antinoë, avec celle d’Alexandrie, l’on jugera
qu’il n’est guère possible de supposer qu’elles soient l’une et l’autre du même temps. Les hiéroglyphes, dont
le pivot de granit, soutien inébranlable de la colonne, est chargé, paroissent encore une nouvelle preuve de
son élévation, plus ancienne que les règnes d’Adrien et de Sévère, et ils indiquent un travail d’une plus
haute antiquité. Cette (p. 139) considération, jointe au silence des historiens, paroît renvoyer même à une
époque plus reculée que celle de la défaite de Pompée, la construction de la colonne qui porte son nom. Si,
au milieu de ces incertitudes, qui, malgré les recherches savantes couvrent souvent de la même obscurité le
passé et l’avenir, je dois énoncer mon opinion, je serois tenté de faire honneur de l’érection de la colonne
d’Alexandrie aux temps anciens qui ont vu paroître tant de prodiges en Egypte, à ces époques où des
milliers d’hommes étoient employés, des années entières, au transport de masses de pierres, dont le
mouvement sembloit au-dessus des efforts humains et exiger ceux d’hommes extraordinaires.
Quoi qu’il en soit de ce sentiment, il seroit difficile de changer la dénomination que depuis long-temps on a
attaché à la colonne d’Alexandrie, et, quelques bonnes raisons que l’on ait à alléguer, il est très probable
que l’on continuera à l’appeler colonne de Pompée. Cependant il est aussi probable que la postérité se
rappellera que cette colonne fut le quartier-général d’où Buonaparte commanda l’escalade et la prise
(p. 140) d’Alexandrie ; que les corps des héros qui ont péri victimes de leur bravoure, sont déposés autour
du piédestal et que leurs noms y sont gravés ; il est aussi probable que, plus frappée du génie de la victoire
et des combinaisons sublimes, que de celui qui a illustré l’ancienne Egypte par des ouvrages surprenans,
tout en se chargeant de l’immortalité de la nation françoise, elle voudra en fixer la gloire, et que la colonne
de Pompée sera pour elle la colonne des François.
J’ai ouï dire à Alexandrie que l’on avoit eu autrefois le projet de transporter en France la colonne que l’on y
admire. Les Levantins et les navigateurs provençaux regardoient cette entreprise comme impracticable ; ils
oublioient, ou peut-être n’avoient-ils jamais su que cette masse de granit, avoit été tirée des carrières de
Syène, c’est-à-dire, de plus de deux cent lieues : ils ignoroient que Caïus-César avoit fait venir d’Egypte à
Rome un obélisque de cent coudées ou de vingt-cinq toises de hauteur, et de huit coudées ou deux toises
de diamètre : qu’Auguste voulut que Rome possédât aussi les deux obélisques élevés à Héliopolis, par
(p. 141) Sésostris, et qui ont chacun cent vingt coudées de haut ; que Constantin ordonna le transport d’un
autre obélisque, non moins considérable, et à la construction duquel Ramassès, roi d’Egypte, avoit employé
deux mille hommes ; ils ignoraient enfin que, de nos jours, Pétersbourg a vu placer dans son sein un rocher
amené d’assez loin, et du poids de trois millions de livres.
Les grandes entreprises sont les vrais monumens de la gloire des grandes nations. Il seroit digne de celle
qui, en peu d’années, a surpassé tout ce que les Romains nous ont présenté de faits héroïques, de
s’approprier la colonne d’Alexandrie. S’il falloit pour cela des moyens extraordinaires, le génie des sciences,
inséparable de celui de la véritable gloire, est là pour les tracer, et les arts qui s’élèvent aussi avec le peuple
qui les chérit, sauront les exécuter. Au milieu d’une des places de Paris, de celle de la Révolution, par
exemple, la colonne ne pourroit manquer de produire l’effet le plus majestueux. Une statue colossale
surmonteroit son chapiteau ; ce seroit l’image de la liberté : elle domineroit les palais des dépositaires du
pouvoir, et, par son attitude (p. 142) fière et imposante, elle seroit la terreur de quiconque oseroit abuser de
l’autorité, pour tourmenter ou trahir un peuple, de la puissance duquel elle seroit également un emblême
éternel.
Ruines. Canal d’Alexandrie. Citernes. Culture des environs du canal. Soude. Oiseaux. Moineaux.
Catacombes. Caméléons. Chackals.
(p. 143) Si en quittant la colonne d’Alexandrie, l’on continue à marcher vers le midi, on traverse une gorge
oblongue, spacieuse et assez profonde. Elle contient des restes de bâtimens anciens, parmi lesquels on
distingue, au niveau du sable, des murs épais et solides, disposés en forme de T. Vers l’extrémité de la
branche longitudinale de ce T, il y a des fragmens de colonnes de granit, et à l’extrémité même un
souterrain, dans lequel il n’est plus possible d’entrer. Les gens du pays nomment cet endroit Guigé. De là,
on arrive au canal ou kalish d’Alexandrie. Du temps d’Alexandre et des rois d’Egypte, Alexandrie n’étoit pas,
comme aujourd’hui, au milieu des sables : elle n’étoit pas enveloppé de cette ceinture d’aridité, qui en rend
(p. 144) à présent les environs si désagréables. Un lac, le Maréotis, qui n’en étoit qu’à une petite distance, et
deux larges canaux, dont l’un descendoit de la haute Egypte, et l’autre partoit de la branche du Nil à laquelle
on donnoit le nom de Bolbitique, y entretenoient une fraîcheur salutaire, en même–temps qu’ils y favorisoient
la végétation et la culture. Ces ouvrages qui attestoient la grandeur et la puissance de l’ancienne Egypte, et
dont l’entretien étoit également solicité par les besoins et par l’agrément, se soutenoient encore sous la
domination des califes. Abulfeda, historien arabe, parle d’Alexandrie comme d’une très-grande ville,
qu’environnent de superbes jardins. La perte de ce qui avoit coûté tant de peines et de travaux, étoit réservé
aux Turcs. Leur esprit destructeur a desséché ces amas d’eau qui, avec leurs ondes, développoient la
fertilité, comme il a tari les sources des connoissances et de l’energie dans l’ame des peuples, assez
malheureux pour être soumis au despotisme le plus effrayant.
Il ne reste plus, et encore dans un état de dégradation, que le canal de la basse Egypte ; (p. 145) pendant
l’inondation, il reçoit les eaux du Nil à Latif, vis-à-vis de fouah. On peut le passer sur trois ponts, de
construction moderne. Près du premier, du côté de la mer, est l’entrée du conduit souterrain, qui porte la
provision d’eau des habitans d’Alexandrie dans les citernes, dont les voûtes soutenoient toute l’étendue de
l’ancienne ville, et que tout le monde s’accorde à regarder, comme l’un des plus beaux monumens du
monde622. L’ouverture de cet aqueduc est murée, mais lorsque l’eau du canal avoit atteint, par
l’accroissement du fleuve, une certaine hauteur, les chefs de la ville alloient en cérémonie rompre la digue.
Quand les citernes étoient remplies, on la rétablissoit de nouveau, et les eaux du canal continuoient à couler
dans la mer, au port vieux. C’étoit au moyen d’une communication si facile, que s’effectuoit, le transport des
marchandises de toute l’Egypte. L’on évitoit ainsi le passage dangereux de l’embouchure du Nil, et les
hasards de la mer. Lorsque j’étois à Alexandrie (en 1778) il n’y avoit guère que cent ans que les bateaux
pouvoient encore y naviguer ; mais ce canal, dont les (p. 146) avantages sont inappréciables, étoit négligé
par des barbares indifférens sur leurs véritables intérêts. Les murs qui en soutenoient les bords se
dégradoient chaque jour ; le pavé du fond se couvroit de couches successives de limon ; aucun bateau ne
pouvoit plus y flotter ; une eau jaunâtre et dégoûtante ne seroit bientôt plus arrivée jusqu’aux citernes, qui
étoient elles-mêmes à moitié détruites ; bientôt aussi les habitans auroient manqué d’eau, et l’Alexandrie
moderne seroit disparue dans les sables, et n’auroient plus été qu’un repaire d’animaux féroces qui
sembloient déjà la menacer, en rôdant autour de ses murailles.
Les bords du canal sont animés par quelques-unes des riches productions de la nature vivante : plus loin
elle paroît morte ; ce n’est de toutes parts que sables, rochers et stérilité. Des arbres et des arbustes
croissent le long des eaux, et quelques tapis de verdure s’étendent aux environs. De légères dérivations de
l’eau portent la fécondité dans les champs, où l’on sème de l’orge et où l’on cultive différentes espèces de
légumes, particulièrement beaucoup d’artichauts. La culture de ce canton alloit autrefois beaucoup plus
(p. 147) loin : il auroit été facile aux Alexandrins modernes d’en reculer les bornes ; mais ils n’avoient
d’activité que pour le braigandage, et l’on n’est point surpris que des gens qui ne cherchoient point à se
conserver la seule eau qu’ils pussent boire, ne s’occupassent pas à se procurer l’agrément et l’abondance.
Ce sont-là les vestiges de la culture dont l’antique Alexandrie étoit entourée, les restes de ces superbes
jardins qui ajoutoient à sa magnificence, et dont Abulfeda vantoit encore les délices au temps des Arabes. Il
s’en faut bien, en effet, que quelques arbres épars et végétant à peine sur cette plage sablonneuse, suffisent
pour en voiler la sécheresse et la dureté : plusieurs espèces de soude, plantes âcres et salées, dont le nom
arabe kali a été donné aux substances alcalines, sont à-peu-près le seules qui aient la propriété de se plaire
sur ces côtes, et elles y rampent plutôt qu’elles ne s’y élèvent. Les Alexandrins les brûlent et retirent de leurs
cendres un sel fixe qui est un objet de commerce.
La verdure, la fraîcheur et l’ombrage avoient attiré sur les rives du canal une miltitude de petits oiseaux.
C’étoit au mois (p. 148) d’octobre ; je distinguai des bec-figues, des alouettes communes et des moineaux.
Des oiseleurs s’occupoient à prendre les deux premières espèces, et à détruire les seuls êtres qui pouvoient
donner quelqu’apparence de gaieté à leurs tristes habitations. Mais ces oiseaux, à l’exception des
moineaux, n’étoient que passagers à Alexandrie ; ils se reposoient des fatigues d’un long voyage près des
eaux du canal ; elles ne devoient plus bientôt leur offrir qu’un lit de limon ; elles étoient déjà stagnantes et
d’un goût saumâtre, et les oiseaux qui avoient le bonheur d’échapper aux pièges dont on les environnoit à
leur arrivée, se disposoient à chercher vers le Delta une terre plus heureuse, un site plus riant et des
retraites plus tranquilles.
Les moineaux, au contraire, plus habitués à la société de l’homme, parce que leur chair peu délicate ne
flatte point son goût, ne voyagent point ; à l’exception de quelques courses pour se procurer une nourriture
abondante, ils ne quittent point les lieux habités, (p. 149) ils en font aussi leur demeure. Ce sont des oiseaux
casaniers formant librement autour de nous une volière de parasites impudens qui partagent, malgré nous,
et nos provisions et notre domicile ; ils ont, en Egypte, les mêmes habitudes que nous leur connoissons,
même familiarité, même effronterie, même voracité. Ils y sont aussi les commensaux forcés des
Alexandrins ; ou en voit dans tous les lieux habités de l’Egypte ; ils sont également répandus en Nubie et
même en Abissinie. Une chaleur excessive ne leur est donc point contraire ; cependant on n’en trouve point
le long de la côte occidentale de l’Afrique ; depuis le cap Blanc, ou à-peu-près, ils y sont remplacées par les
bengalis623, les senegalis624, et par les petits moineaux du Sénégal625. Ne pouvant, d’après ce que je viens
de dire, attribuer la cause de ce fait au trop grand chaud, je crois l’avoir déterminée par (p. 150) la différence
des plantes alimentaires en usage dans ces parties de l’Afrique. Le froment et ses analogues sont cultivés
en Egypte, en Nubie, en Abissinie, de même que dans la Barbarie ; ils cessent de l’être aux environs du cap
Blanc ; d’autres plantes nutritives en tiennent lieu aux nègres qui habitent au midi de ce promontoire ; et les
graines de ces plantes ne sont plus une nourriture qui convienne aux moineaux ; en sorte que s’ils ne
fréquentent pas tous les pays à froment, il est du moins certain qu’ils ne se fixent jamais dans ceux où cette
espèce de grains et celles qui s’en rapprochent ne sont pas cultivées. Le coup-d’oeil rapide que nous venons
de porter vers quelques produits de la nature vivante, rafraîchit l’imagination fatiguée de planer au-dessus
des débris et des décombres. Grâces soient rendues à la mère de tous les êtres ! Louanges éternelles à sa
bienfaisance inaltérable ! Elle a voulu conserver sur un sol sec et rougeâtre et au milieu des horreurs de la
destruction, un point dans lequel elle a su, malgré les efforts des barbares qui la méconnoissent, faire briller
quelques traits de sa parure. C’est (p. 151) à regret que les pas s’éloignent, que les regards se détournent
d’un lieu que la comparaison rend si enchanteur. Ma plume cherche à faire partager au lecteur les
sensations douces que j’y ai éprouvées. Mais il faut se hâter de gagner une contrée où la nature a déployé
ses trésors. Cette pensée ranime mon courage, car nous avons encore des sables à franchir et nous devons
nous enfoncer dans le séjour ténébreux des morts, dans les catacombes.
Elles ne sont pas éloignées du canal : ce sont des galeries, se prolongeant au loin sous terre, ou plutôt dans
le rocher. Elles ont d’abord été vraisemblablement les carrières d’où l’on a tiré les pierres nécessaires à la
bâtisse des maisons d’Alexandrie, et, après avoir fourni aux hommes de ce pays les matériaux de leurs
habitations, pendant leur vie, elles sont devenues elles-mêmes leur dernière demeure après leur mort.
Quoique vastes, elles n’ont pas exigé des travaux bien pénibles, la couche de pierre étant calcaire et
tendre ; elle est aussi blanche que celle de Malte, et, comme elle, sa consistance augmente par l’impression
de l’air. Mais le rocher de (p. 152) Malte est à nu, au lieu que celui d’Egypte est, pour l’ordinaire, recouvert
par les sables. C’est sans doute à raison du peu de dureté du rocher que les anciens Égyptiens avoient
enduit l’intérieur des galeries avec une sorte de mortier qui a acquis une grande solidité, et que l’on casse
difficilement. La plupart de ces allées souterraines sont éboulées. Dans le petit nombre de celles où il étoit
encore possible de pénétrer, l’on voyait de chaque côté trois rangs de tombeaux, placés les uns au-dessus
des autres : ils ne sont pas, comme à Malte, taillés en long, mais transversalement : leurs grands côtés sont
en plan incliné en-dedans, de manière que le fond du tombeau est beaucoup plus étroit que la partie
supérieure. A l’extrémité de quelques-unes de ces galeries, il y a des chambres séparées avec leurs
tombeaux, et réservées sans doute à la sépulture d’une famille, ou d’un ordre particulier de citoyens.
S’il faut en croire les Arabes, les catacombes ont une communication souterraine avec les pyramides de
Memphis. Une pareille opinion de leur immense étendue, paroît exagérée ; elle n’est cependant pas
au-dessus des (p. 153) autres travaux gigantesques des Égyptiens, et elle vaudroit la peine d’être vérifiée. Il
est plus certain qu’elles vont jusqu’à la mer, au fond du port vieux ; du moins les trois grottes ou cavités
pratiquées dans le rocher de la côte, et que les Européens ont décorées, assez improprement, du nom de
Bains de Cléopâtre, paroissent en être une continuation.
J’ai vu à l’entrée des catacombes plusieurs caméléons. L’on sait, à présent, que le changement dans leurs
couleurs n’est point dû aux objets qu’on leur présente ; que leurs différentes affections augmentent ou
diminuent l’intensité des teintes, dont la peau très fine qui les couvre est comme marbrée ; qu’ils ne se
contentent pas d’une nourriture aussi peu substancielle que l’air, en avalant les mouches et les autres
insectes ; et qu’enfin tout ce que l’on avoit raconté de merveilleux au sujet de cette espèce de lézard, n’est
qu’un tissu de fables qui ont déshonoré jusqu’à nos jours la science de la nature. J’ai conservé quelques
caméléons, (p. 154) non pas que je fusse tenté de répéter l’expérience de Corneille le Bruyn qui, après avoir
assuré gravement que les caméléons qu’il tenoit dans sa chambre, à Smyrne, se nourrissoient de l’air,
ajoute qu’ils moururent les uns après les autres, en peu de temps ; mais je voulois connoître jusqu’à quel
point ils pouvoient se passer de nourriture. J’avois pris toutes les précautions, pour qu’ils en fussent
absolument privés, sans qu’ils cessassent d’être exposés au grand air. Ils vécurent ainsi pendant vingt
jours : mais de quelle vie ! De gras qu’ils étoient lorsque je les pris, ils furent bientôt très-maigres. Avec leur
embonpoint, ils perdirent peu-à-peu leur agilité et leurs couleurs ; leur peau devint livide et ridée ; elle se
colla sur les os, en sorte qu’ils paroissent desséchés, avant de cesser d’exister.
Les catacombes servent souvent de retraite aux chackals, très-nombreux dans cette partie de l’Egypte : ils
ne marchent qu’en grandes troupes et ils rôdent autour des habitations. Leurs cris sont inquiétants,
particulièrement la nuit ; c’est une espèce de glapissement que l’on peut comparer (p. 155) aux plaintes
aiguës d’enfants de différens âges. Ils dévorent avec avidité les cadavres et les voieries ; enfin, aussi cruels
que carnassiers, ils ne sont pas sans danger pour les hommes.
C’est du chackal que doit s’entendre tout ce que les auteurs ont dit du loup et même du renard d’Afrique ;
car, en convenant que ces animaux ont assez de rapports entre eux, il est pourtant vrai de dire qu’il n’y a ni
loups ni renards dans cette partie du monde. Le nom que le chackal porte en Egypte est deib : les fellahs ou
les habitans de la campagne l’appellent aussi, et sans doute d’après quelque conte populaire, abou Soliman,
père de Soliman.
Ces animaux féroces ne craignoient pas d'approcher d'Alexandrie ; ils en parcouroient l'enceinte pendant la
nuit ; souvent ils la franchissoient par des brèches dont elle étoit coupée ; ils entraient dans la ville, y
cherchoient leur proie et la remplissoient de leurs cris : espèce d'association digne des hommes qui
l'habitoient.
Mais un animal plus doux et en même temps plus extraordinaire, qui établit ses logemens souterrains dans
les environs d’Alexandrie, est la gerboise ou jerbo. »
p. 178-179 :
« Les sables et les décombres qui environnent l’Alexandrie moderne, sont très-fréquentés par les jerbos. Ils
y vivent en troupes, et ils y pratiquent des terriers, qu’ils (p. 179) creusent avec leurs ongles et leurs dents.
L’on m’a dit qu’ils perçoient même la pierre tendre qui est sous la couche de sable. Sans être précisément
farouches, ils sont très inquiets : le moindre bruit, ou quelqu’objet nouveau, les fait retirer dans leurs trous
avec précipitation. On ne peut en tuer qu’en les surprenant. Les Arabes savent les prendre vivans, en
bouchant les issues des différentes galeries de leurs terriers, à l’exception d’une seule, par laquelle ils les
forcent de sortir. Je n’en ai jamais mangé, mais leur chair ne passe pas pour un fort bon mets ; cependant le
peuple d’Egypte ne les dédaigne pas. Leur peau, dont le poil est doux et luisant, est employée à des
fourrures communes. (…) »
Factorerie françoise. Statue. Adanson et ses malheurs. Auguste, autre interprète françois. Tombeau antique.
Le nom d’Alexandre encore en honneur en Egypte. Vénitiens et Anglois. Commerce. Germes. Poissons.
p. 201-218 :
« J’étois logé à Alexandrie, dans la maison occupée par le consul et les négocians françois : elle est près de
la mer, dans le fond du port neuf. C'est un bâtiment carré dont les côtés enferment une grande cour autour
de laquelle, et sous les arcades, sont des magasins. Les arcades sont soutenues par des colonnes, ou pour
mieux dire, par des parties de colonnes arrachées aux décombres de l’ancienne ville : plusieurs sont de
granit, et il s’en trouve une de porphire.
Il y avoit aussi, dans cette cour, une statue de grandeur naturelle, en pierre blanche et représentant une
femme assise avec un enfant debout à côté d'elle. C'est (p. 202) un assez bon ouvrage ; la draperie,
particulièrement, a du mérite. Des Arabes avoient trouvé cette statue dans les ruines, et ils l'avoient vendue
à un interprète français qui vouloit la faire passer dans sa patrie. Mais il mourut avant d'avoir pu exécuter
son projet ; et depuis ce temps, la statue étoit restée en but aux chocs des ballots de marchandises que l'on
remuait sans cesse autour d'elle, et qui l'avoient même mutilée, sans que personne ait songé ni à la
conserver, ni à l'envoyer à sa destination, où assurément elle eut été reçue avec intérêt. Il falloit que le génie
de la destruction régnât avec bien de l’empire, sur des plages joncheés des tristes effets de sa puissance,
pour s’être introduit dans l’enceinte destinée à une nation policée.
Les logemens sont au-dessus des magasins ; les croisées sont, par conséquent, très-élevées, et une seule
porte, bien solide, ferme ce vaste enclos. On la renforçoit encore dans les momens de tumulte, par des
ballots amoncellés. Si le soulèvement ne s’appaisoit pas, et si l’on avoit lieu de craindre que le peuple ne fît
quelque brèche, tout le monde se glissoit par les fenêtres pendant la nuit, (p. 203) et alloit se réfugier à bord
de quelque vaisseau.
Il n’y avoit autrefois qu’un vice-consul à la tête de cet établissement ; mais M. Tott, dans le cours de son
inspection, avoit retiré le consul du Caire, où il étoit impossible de le mettre à l’abri des insultes et des
vexations des Mameloucks, pour le placer à Alexandrie. L’on peut juger qu’il n’y étoit guères plus en sûreté.
Le pavillon françois flotter sur la terrasse de la factorerie ; il auroit mieux valu, peut-être, qu’il n’y parût pas,
puisqu’on ne parvenoit pas à l’y faire respecter.
Parmi le petit nombre de François qui y demeureroient, et dont le caractère honnête et obligeant n’est point
effacé de ma mémoire, l’on distinguoit un nom cher aux sciences, celui d’Adanson. Le frère de l’académicien
de Paris, dévoué dès sa jeunesse, à l’étude des langues orientales, remplissoit, depuis long-temps, les
fonctions délicates d’interprète dans le Levant. Il avoit éprouvé, en Syrie, une de ces cruelles aventures,
également l’opprobe du gouvernement qui les commande et de celui qui les tolère sans en tirer vengeance.
Victime de son devoir, il le fut aussi de la détestable barbarie d’un (p. 204) Pacha. Chargé de lui porter, de
concert avec son collègue, et au nom de la nation françoise, des justes réclamations, ils furent livrés tous
deux, par les ordres du féroce musulman, au supplice cruel de la bastonnade sur la plante des pieds. L’autre
interprète expira sous les coups, et Adanson plus malheureux peut-être, les pieds fracassés et douloureux,
privé presqu’absolument de la faculté de marcher, survécut à son atroce supplice, et à l’affront que le
gouvernement de France laissa impuni, comme celui de l’assassinat de son consul à Alexandrie.
Une catastrophe aussi terrible auroit suffit seule pour exciter le plus grand intérêt, en faveur de M. Adanson,
s’il n’avoit d’ailleurs été recommandable, par ses connoissances et par ses talens. Mais la récompense du
mérite modeste et éloigné, n’entra point dans le recueil des usages des gouvernemens. Les battans de leurs
portes dorées ne s’ouvroient presque jamais qu’à la sottise chamarée, ou à l’importune inutilité. L’homme qui
n’avoit que des talens vivoit, pour la plupart du tems, isolé et sans récompense, si toutefois un pareil
isolement n’étoit pas un cortège plus brillant et plus honorable (p. 205) que celui de la puissance injuste et
aveugle. Adanson végétoit à Alexandrie, et il y partageoit le service d’interprète avec M. Auguste, dont
l’esprit et l’aménité étoient presqu’un phénomène dans ce pays-là, et qui l’auroit fait avantageusement
distinguer dans tous les pays du monde. Si je n’avois eu à me louer que de quelques politesses d’usage, je
me serois dispensé de faire une mention particulière de ces deux interprètes, sans savoir s’ils sont encore à
portée d’entendre cette expression de ma reconnoissance ; mais c’est à eux, c’est à leur complaisance
éclairée que j’ai dû les facilités de faire mes observations dans des contrées difficile à visiter ; et les
voyageurs sentiront combien de pareilles rencontres sont heureuses ; car ils savent, comme moi, combien
elles sont rares.
J’avois entendu parler d’un monument curieux, d’une espèce de tombeau antique qui se trouvoit dans une
mosquée hors de l’enceinte d’Alexandrie ; je manifestois en vain le désir de le voir ; l’on m’assuroit que
c’était chose, non seulement dangereuse, mais impraticable. Le consul de France et M. Adanson
m’invitoient fort à n’y pas (p. 206) songer. Cependant M. Auguste, moins timide, se chargea de m’y conduire
furtivement, et à l’insçu des autres François. Un janissaire de la factorerie nous accompagna ; le scheick de
la Mosquée, iman chez les Turcs, curé chez les chrétiens, nous attendois, et nous pûmes examiner assez à
notre aise, moyennant quelqu’argent dont M. Auguste étoit convenu avec le prêtre. Ce temple est ancien ; il
a été construit par un Calife ; les murailles sont plaquées de marbres de diverses couleurs, et l’on y voyait
encore quelques beaux restes de mosaïque.
Le tombeau, objet de notre démarche, et que l’on peut regarder comme un des plus beaux morceaux
d’antiquité que l’Egypte conserve, avoit été transformé par les Mahométans, en une pièce de piscine, en un
réservoir consacré à contenir l’eau de leurs ablutions pieuses. Il est fort grand, et il seroit un carré long, si
l’un des petits côtés n’étoit arrondi en forme de baignoire. Il étoit fermé vraisemblablement autrefois par un
chapiteau ; mais on n’en voit plus de traces, et il est entièrement ouvert. Il est tout d’une pièce et d’un
superbe marbre à taches vertes, jaunes, rougeâtres, etc. (p. 207) sur un fond d’un beau noir ; mais ce qui le
rend principalement intéressant, c’est la quantité prodigieuse de petits caractères hiéroglyphiques, dont il est
chargé, en dedans et en dehors. Un mois suffiroit à peine pour les copier fidèlement : aussi n’y en a-t-il pas
eu, jusqu’à présent, de dessins exacts. Celui que je vis, à mon retour d’Egypte, chez le ministre Bertin, à
Paris, ne pouvoit servir qu’à donner une idée de la forme du monument, les hiéroglyphes ayant été tracés
d’imagination et au hasard. C’est à-peu-près comme si, en cherchant à copier une inscription, l’on se
contentoit d’écrire des lettres sans ordre et sans suite. Ce n’est néanmoins qu’en copiant scrupuleusement
les figures de cette écriture symbolique, que l’on parviendra à la connoissance d’un langage mystérieux,
d’où dépend celle de l’histoire d’un pays jadis si célèbre. Lorsque ce langage sera connu, on apprendra
l’origine du sarcophage et l’histoire de l’homme puissant dont il renfermoit la dépouille. Jusques-là c’est le
champ vague et mobile des conjectures.
À côté de la tombe, sur un morceau de marbre gris, servant de pavé à la mosquée, (p. 208) j’ai apperçu une
inscription grecque, mais en lettres romaines ; comme elle étoit à moitié effacée, il auroit fallu plus de temps
que nous n’en avions pour la déchiffrer. Je ne pus y distinguer, au premier coup d’oeil que le mot
CONSTANTINON.
Il étoit autrefois impossible d’entrer dans une mosquée, et c’est la raison du silence des voyageurs au sujet
du sépulcre qui la rend si intéressante. Un duc de Bragance fut le premier européen qui le visita, ou plutôt
qui le découvrit, car le hasard seul l’en fit approcher. Il passoit devant le temple ; la porte étoit ouverte ; il
n’appercevoit personne aux environs et il eut la curiosité d’entrer. Des enfans qui l’avoient vu, s’attroupèrent
et vinrent crier autour de lui. Si leurs cris eussent été entendus, c’en étoit fait du prince Portugais ; il tira sa
bourse et il fit taire les enfans, en leur jetant quelques pièces de monnoie qui lui procurèrent sa sortie libre et
paisible. Depuis, M. de Montagu, dont j’ai eu occasion de parler, avoit offert inutilement une forte somme
pour entrer dans la mosquée. Mais quelque temps après, desservie par un scheick, dont le goût pour l’or
l’emportoit sur les loix (p. 209) du fanatisme, elle fut ouverte à tout étranger qui vouloit payer un sequin.
L’année même que j’arrivai à Alexandrie, plusieurs Anglois y étoient allés sans précautions ; des gens du
peuple les virent, et murmurèrent fortement. Le commandant d’Alexandrie se hâta de réprimander le scheick
et de lui défendre de recevoir aucun chrétien. L’éclat que cette affaire manqua d’occasionner, dans un pays
où les Européens vivoient dans des craintes continuelles, étoit trop récent pour ne pas laisser encore des
inquiétudes. Mais notre promenade à la mosquée avoit été si sagement combinée, qu’il n’en fut pas
question, et que personne n’en fut instruit.
J’ai été témoin un jour de la frayeur que l’idée seule d’un attroupement séditieux à Alexandrie, faisoit naître
dans l’ame de nos François. Un négociant vint annoncer qu’un européen avoit tué un homme du pays. Les
portes de la factorerie furent fermées à l’instant, les ballots alloient être mis en mouvement pour servir de
contre-forts ; on cherchoit déjà à bord de quel navire on pourroit se réfugier, en descendant par les fenêtres,
lorsqu’heureusement l’on fit informé que c’étoit un (p. 210) musulman qui en avoit tué un autre.
Cependant, si une communication continuelle avec les diverses nations de l’Europe n’avoit encore pu
adoucir les moeurs des Alexandrins, l’on doit convenir qu’elle les avoit déjà disposés à moins d’intolérance
sur certains objets. Alexandrie, par exemple, étoit avec Rosette, la seule ville d’Egypte où les Européens
pussent conserver leurs vêtemens. Par-tout ailleurs, il leur étoit interdit de paroître, sans le costume oriental.
Il ne falloit pourtant pas abuser de cette sorte d’indulgence ; car, en se montrant en foule ou avec
quelqu’éclat, particulièrement dans les lieux éoignés de la marine, on couroit les risques d’être insulté.
L’on ne pouvoit encore s’abstenir de savoir quelque gré aux habitans de ce pays d’avoir conservé à leur
bourgade le nom de la ville ancienne. L’on trouve Alexandrie, dans le nom arabe Escanderiè, et l’indignation
dont on ne pouvoit se défendre contre les barbares, dont la nouvelle ville étoit plutôt infestée que peuplée,
cessoit un instant lorsqu’on les entendoit, ainsi que cela m’est arrivé plus d’une fois, proférer avec quelques
respect le nom d’Alexandre. Il est pour eux (p. 211) l’attribut du courage et de la victoire. Ennté Scander,
disent-ils quelquefois, tu es un Alexandre ; c’est à leurs yeux le plus grand éloge de la valeur. Tant il est vrai
que ce ne sont ni les marbres, ni les bronzes qui perpétuent la mémoire des hommes. Les grandes actions
peuvent seules transmettre leurs noms, d’âge en âge. Tout s’efface, tout périt : les vertus et les bienfaits
restent, comme des monumens inaltérables élevés dans les coeurs, comme l’héritage éternel de l’admiration
et de la reconnoissance.
Les Vénitiens et les Anglois avoient aussi des établissemens de commerce à Alexandrie. Les premiers, de
même que les François, suivoient dans leur négoce la même marche que leurs prédécesseurs. Les Anglois,
au contraire, cherchoient à se frayer les routes nouvelles. De fréquens voyages de leurs agens dans l’Inde,
leur prodigalité, qui leur attiroit la bienveillance des chefs du pays, toujours disposés en faveur de ceux qui
les payoient le mieux, enfin leur activité pour des opérations qu’ils avoient soin de tenir secrètes, tout
annonçait le projet qu’ils avoient conçu et qu’ils avoient déjà executé en partie, de s’approprier le (p. 212)
commerce exclusif de l’Inde par la mer Rouge.
La ville d’Alexandrie, si bornée de nos jours, ne fournissoit pas une consommation qui fût de
quelqu’importance. Aussi le commerce qui s’y fait est un commerce d’entrepôt ; mais, comme je l’ai dit, il
étoit considérable, et il peut devenir immense. Les douanes rapportoient de grandes sommes : elles étoient
entre les mains d’une compagnie de commerçants chrétiens de Syrie. Pour juger de leur adresse, il suffira
de savoir qu’ils avoient supplanté les Juifs, chargés avant eux de cette partie du fisc.
Les marchandises que les navires d’Europe transportent à Alexandrie, sont conduites par eau jusqu’au
Caire, d’où, après avoir fourni aux besoins et au luxe de cette ville populeuse, elles se distribuent dans toute
l’Arabie, dans la haute Egypte, et jusqu’en Abissinie. Les petits bâtimens qui servent à les conduire
d’Alexandrie jusqu’à Rosette, la première ville d’Egypte sur le Nil, et à ramener à Alexandrie les denrées de
l’Egypte et de l’Arabie, se nomment germes. Ce sont des espèces de barques solides, et d’une assez belle
construction. Elles ne sont pas pontées, elles tirent peu d’eau, et suivant (p. 213) leur grandeur, elles ont
deux ou trois mâts, avec de très-grandes voiles latines, dont les antennes, fixées au haut des mâts, ne
peuvent s’amener ; en sorte que, quelque mauvais temps qu’il fasse, les matelots sont obligés de monter sur
toute leur longueur, pour serrer les voiles, manoeuvre aussi longue que difficile. Leur port est, en général, de
cinq ou six tonneaux. L’on pourroit certainement construire des barques pontées d’une grandeur plus
considérable, et qui ne tireroient pas plus d’eau. Les marchandises n’y seroient pas exposées à être
mouillées et gâtées par l’eau de la mer, ainsi qu’elles le sont souvent, et les expéditions n’éprouveroient pas
des retards, quelquefois préjudiciables au commerce, à cause d’une mer trop grosse qui arrête la navigation
des germes. Quoique la distance qu’elles ont à parcourir en mer ne soit guère de plus de douze lieues, et
qu’au milieu de cette route elles aient une baie, dans laquelle elles peuvent trouver un abri sûr, à Aboukir, ce
cabotage n’est pas sans danger. Si un vent impétueux souleve des vagues, toujours tumultueuses sur les
hauts fonds, elles courent risque d’être remplies d’eau et submergées. Mais le péril le plus (p. 214) imminent
auquel elles soient exposées, est à l’embouchure de la branche occidentale du Nil, l’ancienne Bolbitique,
aujourd’hui Branche de Rosette. C’est une barre formée par les sables, sur lesquels les flots pressés par les
vents du large, et combattus par le courant du fleuve, viennent se briser avec fureur. Une petite île,
partageant l’embouchure de cette branche, laisse, de chaque côté d’elle, un détroit appelé, dans le pays
Boghass, canal ou détroit : mais il s’en faut bien que ce passage soit praticable dans toute sa largeur. Il n’y a
qu’un chenal étroit que la mobilité du fond et l’agitation des eaux font varier chaque jour. Un pilote, reis, ou
patron du Boghass, est continuellement occupé à sonder cette passe changeante, et à l’indiquer aux
germes. Malgré ces précautions, elles échouent souvent, et bientôt, remplies par des masses d’eau et de
sable, elles périssent avec leurs chargemens et leurs équipages. Les accidents sont plus fréquens à l’entrée
du Nil qu’à la sortie, les germes qui viennent de la mer ne pouvant pas se dispenser de donner dans la
passe, quand elles n’en sont plus qu’à peu de distance, au lieu qu’en descendant le (p. 215) fleuve, elles
retournent facilement, si, en approchant de la barre, elles la trouvent trop mauvaise. Pendant la crue du Nil,
les eaux plus hautes rendent ces accidens moins fréquens : mais, lorsque le fleuve est rentré dans son lit, il
est si peu profond à son embouchure, qu’il est bien difficile que les barques n’y touchent pas. Quelle que soit
l’habitude des marins égyptiens, ils ne la passent jamais sans trembler. L’on m’en a montrés qui avoient
éprouvé une si grande frayeur, que leur barbe en avoit blanchi. Pendant l’été de 1778, il n’y avoit que trois
pieds d’eau dans le chenal. On a même observé que le terrain s’élevoit progressivement d’une année à
l’autre. La même chose est arrivée à la branche de Damiette, dont le Boghass, quoiqu’il fût entouré de bancs
de sable qu’une ancienne pratique avoit appris à éviter, ne passoit pas pour dangereux : il n’étoit même
d’aucune considération dans les arrangemens des marchands qui frétoient les germes. Cependant vers la
fin de l’année 1777, pendant mon séjour à Rosette, ce passage se trouva absolument fermé, après le plus
grand accroissement du Nil, et les premières barques qui voulurent (p. 216) le tenter, y périr. Le péril que
l’on court sur celui de la branche de Rosette croissoit chaque année, à mesure que le fond s’élevoit ; et
comme il étoit inutile d’attendre, de l’ignorance et de l’apathie des Egyptiens, la construction de travaux
propres à resserer les eaux et à donner plus de profondeur au canal, il y avoit tout lieu de présumer que
bientôt aucun bâtiment n’auroit pu franchir cette barre formidable. Alors on auroit peut-être songé à nettoyer
le canal d’Alexandrie, ou, si l’insouciance des habitans les eût aveuglés au point de négliger un travail aussi
important, toute communication par eau auroit été interdite entre Alexandrie et le reste de l’Egypte, et le
commerce auroit été forcé de se servir de la voie dispendieuse de terre.
C’est celle que suivent généralement les voyageurs et les négocians d’Europe, ainsi que ceux qui préfèrent
une légère augmentation de dépense, au risque de se noyer sur le Boghass. C’est celle que j’ai prise toutes
les fois que j’ai eu à traverser l’espace qui est entre Alexandrie et Rosette.
Avant de quitter les côtes, je vais donner une notice des poissons de mer que j’ai eu occasion de remarquer,
parmi les espèces (p. 217) nombreuses que l’on y pêche. J'y ai vu cette espèce de raye que l'on connoît
sous le nom de aigle de mer626 et dont la chair est dure et de mauvaise odeur ; le chat de mer627, qui ne vaut
guère mieux ; la palamide628, espèce de petit thon ; le poisson pointu qu'on nomme aiguille629 et le mulet630.
L'on y pêche aussi le poisson qui, sur les tables des Romains, occupait un place distinguée, et auquel on a
donné le nom de loup631 à cause de sa voracité. (p. 218) Les marins provençaux l'appellent carousse ; (…).
Enfin, ce qui est plus intéressant pour les partisans de la bonne chère, c'est que l'on y mange d'excellents
rougets632. »
- 701 - 714 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CLAUDE SAVARY (1778)
Savary, C., Lettres sur L’Égypte, Paris, 1785-1786.
Claude Savary naît à Vitré en Bretagne en 1750. Il fait ses études au Collège de Rennes puis part en 1776
pour l’Égypte où il passe trois ans jusqu’en 1779. Rentré en France, M. Le Monnier, médecin du roi et
membre de l’Académie des Sciences, lui fournit une pension avec laquelle il peut rédiger ses mémoires.
C’est ainsi qu’il publie les Lettres sur l’Égypte. Maîtrisant la langue arabe, on lui doit plusieurs ouvrages : Vie
de Mahomet, Morale de Mahomet, une traduction du Coran et une Grammaire arabe. Il meurt en 1788.633
p. 19-38 (tome I) :
« Alexandrie, monsieur, mérite d’attirer vos regards. Le rang qu’elle occupa parmi les villes célèbres, les
savans auxquels elle donna le jour, les monumens qui attestent encore après deux mille ans sa gloire
passée, ont des droits à votre curiosité. C’est pour la satisfaire que je parcours depuis trois mois les lieux où
elle fut ; c’est en lisant les auteurs Grecs, Latins, Arabes, que j’apprends à la reconnoître, au milieu des
ruines qui la couvrent ; c’est en comparant ce qu’ils ont écrit avec les objets qui sont sous mes yeux, que je
puis vous en tracer le plan. Avouez qu’il est douleureux de chercher une ville fameuse au milieu de ses
propres murailles.
L’Asie-mineure étoit soumise, l’orgueil de (p. 20) Tyr humilié. Alexandre marcha vers l’Egypte, écrasée sous
le joug des Perses. Il s’en rendit maître sans combat, parce que les peuples, contens de briser leurs fers, le
regardèrent comme un libérateur, et lui tendirent les bras. Il falloit pour conserver cette conquête éloignée de
ses états, une forteresse avec un port qui pût recevoir des flottes nombreuses. L’Egypte manquoit d’un si
précieux avantage ; Alexandre le lui procura. Un terrain resseré entre le lac Maréotis, et le beau port que
formoit l’île de Pharos, lui parut propre à ses desseins. Il y traça l’enceinte d’une grande ville à laquelle il
donna son nom, et alla visiter les merveilles de la haute Egypte, tandis que l’ingénieur (p. 21) Dinocharès
travailloit à l’exécution de son plan. Ce voyage dura près d’un an. A son retour, Alexandrie étoit presque
achevée. Il la peupla en y faisant passer les habitans des villes voisines, et suivit le cours de ses exploits.
Alexandrie avoit une lieue et demie de long sur un tiers de largeur, ce qui donnoit à ses murailles environ
quatre lieues de circuit. Le lac Mareotis la baignoit au midi, et la Méditerranée au nord. Des rues droites la
coupoient parallèlement dans sa longueur. Cette direction laissoit un libre passage au vent de nord, le seul
qui porte en Egypte la fraîcheur et la salubrité. Une rue de deux mille pieds de large, commençoit à la porte
de la marine et finissoit à la porte de Canope. Des maisons magnifiques, des temples, des édifices publics la
décoroient. C’étoit une longue place où l’oeil ne pouvoit se lasser d’admirer le marbre, le porphyre, les
obélisques qui devoient (p. 22) embellir un jour Rome et Constantinople. Cette rue, la plus belle qu’il y ait eu
dans l’univers, étoit coupée par une autre égale en largeur, ce qui fermoit en cet endroit un carré d’une
demi-lieue de circonférence. Du milieu de cette grande place on voyoit les deux portes, et les vaisseaux
arriver à pleines voiles du nord et du midi.
Un môle d’un mille de long fut jeté du continent à l’île de Pharos, et divisa le grand port en deux. Celui qui
est au nord conserva son nom. Une digue tirée de l’île au rocher où l’on bâtit le Phare, le mit à l’abri des
vents d’ouest. L’autre fut appelé Eunoste ou de bon retour. Le premier se nomme aujourd’hui le port neuf ; le
second, le port vieux : un pont qui joignoit le môle à la ville, leur servoit de communication. Il étoit élevé sur
de hautes colonnes enfoncées dans la mer, et laissoit un libre passage aux navires. Le palais qui
commençoit bien avant le promontoire Lochias, se prolongeoit presque jusqu’à la digue. Il occupoit plus d’un
(p. 23) quart de la ville. Chacun des Ptolémées avoit ajouté à sa magnificence. Il renfermoit dans son
enceinte le Musée, asyle des savans, des bosquets, des édifices dignes de la majesté royale, et un temple
où le corps d’Alexandre avoit été déposé dans un cercueil d’or. L’infâme Séleucus Cibyosactès viola ce
monument, enleva le cercueil d’or, et en mit un de verre à sa place. Dans le grand port, on trouvoit la petite
île d’Antirhode, où l’on avoit élevé un théâtre et une maison royale. Le port Eunoste en contenoit un petit
nommé kibotos, et creusé de main d’homme : il communiquoit, avec le lac Mareotis, par un canal. Entre ce
canal et le palais, on admiroit le temple de Sérapis, et celui de Neptune, bâti près de la grande place où se
tenoit le marché. Alexandrie s’étendoit encore sur les bords du lac, du côté du midi. Sa partie orientale offroit
le gymnase avec des portiques de plus de six cents pieds de (p. 24) long, soutenus par plusieurs rangs de
colonnes de marbre. En sortant de la porte de Canope, on rencontroit un cirque spacieux, destiné à la
course des chars. Plus loin, le fauxbourg de Nicopolis bordoit le rivage de la mer, et sembloit une seconde
Alexandrie. On y avoit construit un superbe amphithéâtre, avec un stade pour la célébration des
Quinquennales.
Telle est la description que les anciens, et Strabon sur-tout, nous ont laissée d’Alexandrie. Cette ville, dont la
fondation remonte 333 avant notre Ère, fut soumise successivement aux Ptolémées, aux Romains, et aux
Empereurs Grecs. Vers le milieu du sixième siècle, Amrou Ebn el As, général d’Omar, l’emporta d’assaut
après un siège de quatorze mois, qui lui coûta vingt-trois mille hommes. Héraclius, Empereur de
Constantinople, n’envoya pas un seul vaisseau y porter secours. Ce prince offre un exemple rare dans
l’histoire. Il avoit montré de la vigueur la première année de son règne, (p. 25) ensuite, il s’étoit endormi
long-temps dans l’oisiveté et la molesse. Réveillé tout-à-coup au bruit des conquêtes de Cosroès, le fléau de
l’orient, il se mit à la tête de ses armées, parut dès sa première campagne un grand capitaine, ravagea la
Perse pendant sept ans, et rentra dans sa capitale couverte de lauriers ; puis, devenu théologien sur le
trône, il perdit son énergie, et s’amusa le reste de sa vie à disputer sur le Monothéisme, tandis que les
Arabes enlevoient le plus belles provinces de son empire. Insensible aux cris des malheureux Alexandrins,
comme il l’avoit été à ceux des habitants de Jérusalem qui s’étoient défendus pendant deux ans, il les laissa
succomber sous l’ascendant de l’infatigable Amrou. Toute leur brave jeunesse périt les armes à la main.
Le vainqueur, étonné de sa conquête, écrivit au Calife : « J’ai pris la ville de (p. 26) l’Occident. Elle est d’une
immense étendue. Je ne puis vous décrire combien elle renferme de merveilles. Il s’y trouve 4000 bains,
12000 vendeurs d’huile fraîche, 4000 Juifs qui paient tribut, 400 comédiens, etc . »
La bibliothèque où les soins des Ptolémées avoient rassemblé plus de quatre cent mille manuscrits, excita
l’attention du conquérant. Il demanda les ordres du Calife. « Brûlez ces livres, répondit le féroce Omar ; s’ils
ne renferment que ce qui est dans le Coran, ils sont inutiles, et dangeureux s’ils contiennent autre chose. »
Arrêt Barbare qui réduisit en cendres une grande partie des travaux de la docte antiquité. Combien de
connoissances, combien d’arts, combien de chefs-d’oeuvres ce fatal incendie a fait disparoître de la terre !
C’est peut-être à cette époque funeste qu’on doit attribuer l’ignorance qui a couvert d’un voile les contrées
qui furent le berceau des sciences. Si les trois quarts des ouvrages que possède l’Europe étoient anéantis
tout-à-coup, que l’Imprimerie n’existât pas, et qu’un peuple sans lettres s’empara de cette belle partie du
monde, elle retomberoit dans la barbarie, d’où tant de siècles ont eu peine à la tirer. Tel a été le sort de
l’orient.
(p. 27) Alexandrie, soumise à la domination des Arabes, perdoit peu-à-peu de son éclat. L’éloignement des
Califes de Bagdad ne leur permettoit pas d’y encourager puissamment le commerce et les arts. La
population diminuoit chaque jour. L’an 875 de notre Ère, on abbatti les anciens murs, on en ressera
l’enceinte de moitié, et l’on construisit ceux qui subsiste encore de nos jours. Leur solidité, leur épaisseur, les
cent tours dont ils sont flanqués, les ont conservés contre les efforts des hommes et les ravages du temps.
Cette seconde Alexandrie, que l’on peut nommer celle des Arabes, étoit encore florissante au treizième
siècle. L’alignement de ces rues offroit l’image d’un échiquier. Elle avoit conservé une partie de ses places et
de ses monumens. Son commerce s’étendoit depuis l’Espagne jusque dans l’Inde ; les canaux étoient
entretenus ; les marchandises remontoient dans la haute Egypte par le lac Mareotis, et dans les Delta par le
canal de Faoüe.
(p. 28) Le Phare bâti par Sostrade de Cnide, subsistoit encore. Cette tour merveilleuse, comme l’appelle
César, avoit plusieurs étages : ils étoient entourés de galeries soutenus par des colonnes de marbre. Elle
s’élevoit après de quatre cents pieds. On avoit placé au sommet un grand miroir d’acier poli, disposé de
manière qu’on y appercevoit l’image des vaisseaux éloignés avant qu’ils fussent visibles à l’oeil. Cet édifice
admirable leur servoit de signal. On y allumoit des feux pendant la nuit, pour les avertir de l’approche des
côtes de l’Egypte, qui sont si basses qu’on court risque d’échouer avant d’avoir pu les distinguer. Alexandrie,
dans sa décadence, conservoit encore un air de grandeur et de magnificence qui excitoit l’admiration.
Au quinzième siècle, les Turcs s’emparèrent de l’Egypte : ce fut le terme de sa gloire. L’astronomie, la
géométrie, la poésie (p. 29) et la grammaire y étoient encore cultivées. La verge des Pachas chassa ces
restes des beaux arts. La défense de transporter au-dehors les bleds de la Thébaïde porta le coup mortel à
l’agriculture. Les canaux se comblèrent ; le commerce languit ; Alexandrie des Arabes fut tellement
dépeuplée, que dans sa vaste enceinte il ne se trouva pas un seul habitant. Ils avoient abandonné de
grands bâtimens qui tomboient en ruines, que l’on n’osoit réparer sous un gouvernement où c’est un crime
de paroître riche, et avoient élevé des masures sur le rivage de la mer. Déjà le Phare, mis au nombre des
sept merveilles du monde, étoit détruit ; l’on avoit construit à sa place un château carré, sans goût, sans
ornement, et incapable de soutenir le feu d’un vaisseau de ligne. Aujourd’hui, dans l’espace de deux lieues
fermées de murailles, on ne voit que colonnes de marbre, les unes renversées dans la poussière et sciées
par tronçons (car les Turcs en font des meules de moulin), les autres debout, affermies sur leur base par
l’énormité de leur poids ; on ne voit que débris de pilastres, de chapiteaux, d’obélisques, que montagnes de
ruines entassées les unes sur les autres. L’aspect de ces décombres, le souvenir des monumens (p. 30)
fameux qu’ils representent, affligent l’ame et font verser des larmes.
La moderne Alexandrie est une bourgade de peu d’étendue, contenant à peine six mille habitans, mais
très-commerçante, avantage qu’elle doit uniquement à sa situation. Elle est bâtie sur le terrain qu’occupoit le
grand port, et que la mer en se retirant a laissé à découvert. Le môle qui joignoit le continent à l’île de
Pharos, s’est élargi et est devenu terre ferme. L’île d’Antirhode se trouve au milieu de la nouvelle ville. Une
hauteur couverte de ruines la font reconnoître. Le port Kibotos est comblé. Le canal qui y conduisoit les eaux
du lac Mareotis, a disparu. Ce lac lui-même, dont les bords étoient couverts de papyrus et de dattiers, ne
subsiste plus, parce que les Turcs ont négligé d’entretenir les canaux qui y portoient les eaux du Nil. Belon,
observateur fidèle, qui voyageoit en Egypte quelques années après la conquête des Ottomans, (p. 31)
assure que de son temps le lac Mareotis n’étoit éloigné que d’une demi-lieue des murs d’Alexandrie, et qu’il
étoit entouré de forêts de palmiers. Au moment où j’écris, les sables de la Libye en occupent la place. C’est
au gouvernement destructeur des Turcs qu’il faut attribuer ces changements déplorables.
Le canal de Faoüé, le seul qui communique maintenant avec Alexandrie, et sans lequel cette ville ne
pourroit subsister, puisqu’elle n’a pas une goutte d’eau douce, est à moitié rempli de limon et de sable. Sous
l’empire des Romains, sous la domination même des Arabes, il étoit navigable toute l’année, et servoit au
transport des marchandises. Il répandoit la fécondité dans les plaines qu’il traversoit. Ses bords étoient
ombragés de dattiers, couverts de vignes, ornés de maisons de plaisance : de nos (p. 32) jours, l’eau n’y
coule que vers la fin d’août, et y reste à peine assez de temps pour remplir les citernes de la ville. Les
campagnes dont il entretenoit l’abondance, sont désertes. Les bosquets, les jardins qui environnoient
Alexandrie, ont disparu avec l’eau qui les fertilisoit. Hors des murs, on aperçoit seulement quelques arbres
clair-semés, des sycomores, des figuiers, dont le fruit est délicieux, des dattiers, des capriers, et la soude qui
tapisse des sables brûlans dont la vue est insupportable.
Cependant tous les signes de l’ancienne (p. 33) magnificence d’Alexandrie, ne sont pas effacés. Les
citernes sous toute la ville, les nombreux conduits qui y portent les eaux, sont presque en leur entier après
deux mille ans. Vers la partie orientale du palais, on voit deux obélisques, nommés vulgairement les aiguilles
de Cléopâtre. Ils sont de pierre thébaïque, et chargés d’hiéroglyphes : l’un est renversé, rompu et couvert de
sable ; l’autre posé sur son piédestal. Ces obélisques, chacun d’une seule pierre, ont environ soixante pieds
de haut sur sept pieds carrés à la base. Vers la porte de Rosette, on trouve cinq colonnes de marbre à la
place qu'occupoient les portiques du gymnase. Le reste de la colonnade, dont l'alignement étoit
reconnaissable, il y a cent ans, a été détruit par la barbarie des Turcs.
Ce qui fixe le plus l’attention des voyageurs, est la colonne de granit rouge, située (p. 34) à un quart de lieue
de la porte du midi. Le chapiteau est corinthien, à feuilles de palmier unies et sans dentelure. Il a neuf pieds
de haut. Le fût, et le tore supérieur de la base, sont d’un seul morceau de quatre-vingt-dix pieds de long et
de neuf de diamètre. La base est un carré d’environ quinze pieds sur chaque face. Ce bloc de marbre, de
soixante pieds de circonférence, repose sur deux assises de pierres liées ensemble avec du plomb, ce qui
n’a pas empêché les Arabes d’en arracher plusieurs pour y chercher un trésor imaginaire. La colonne entière
a cent quatorze pieds de hauteur ; elle est parfaitement bien polie, et seulement un peu éclatée du côté du
levant. Rien n’égale la majesté de ce monument. De loin, il domine sur la ville et sert de signal aux
vaisseaux. De près il cause un étonnement mêlé de respect. On ne peut se lasser d’admirer la beauté du
chapiteau, la longueur du fût, l’imposante simplicité du piédestal. Je suis persuadé que si cette colonne étoit
transportée devant le palais de nos Rois, toute l’Europe viendroit payer un tribut d’admiration au plus beau
monument qui soit sur la terre.
Les savans et les voyageurs ont laissé des efforts infructueux pour découvrir à quel (p. 35) prince on l’avoit
érigé. Les plus sages ont pensé que ce ne pouvoit être en l’honneur de Pompée, puisque Strabon et
Diodore de Sicile n’en ont point parlé. Ils sont restés dans le doute. Il me semble qu’Abulfeda pouvoit les en
tirer. Il l’appelle la colonne de Sévère ; et l’histoire nous apprend que cet empereur visita l’Egypte, donna un
sénat à la ville d’Alexandrie, et mérita bien de ses habitans. Cette colonne fut une marque de leur gratitude ;
l’inscription grecque à moitié effacée que l’on y voit du côté de l’occident, lorsque le soleil l’éclaire, étoit sans
doute lisible du temps d’Abulfeda, et conservoit le nom de Sévère. Ce n’est pas le seul monument que la
reconnoissance des Alexandrins lui ait élevé. On voit au milieu (p. 36) des ruines d’Antinoë, bâtie par Adrien,
une magnifique colonne dont l’inscription, encore subsistante, la dédie à Alexandre Sévère.
A une demi-lieue au midi de la ville, on descend dans les catacombes, ancien asyle des morts. Des allées
tortueuses conduisent à des grottes souterraines où ils étoient déposés. Le fauxbourg de Nécropoli,
s’étendoit jusques-là. En avançant du côté de la mer, on trouve un grand bassin creusé dans le rocher qui
borde le rivage : sur les côtés de ce bassin, on a taillé au ciseau deux jolies salles, avec des bancs qui les
traversent. Un canal fait en zig-zag, afin que le sable s'arrête dans les détours, y conduit l'eau de la mer :
elle y vient pure et transparente comme le crystal. J'y ai pris le bain. Assis sur le banc de pierre, on a de
l'eau un peu au-dessus de la ceinture. Les pieds reposent mollement sur un sable fin. On entend les vagues
bruire contre le rocher, et frémir dans le canal. Le flot entre, vous soulève, se retire, et en rentrant et sortant
tour-à-tour, apporte une eau toujours (p. 37) nouvelle, et une fraîcheur délicieuse, sous un ciel embrasé. On
appelle vulgairement ce lieu le bain de Cléopâtre. Des ruines annoncent qu'autrefois il était orné.
Je ne puis, Monsieur, quitter cette ville sans vous rappeller quelques-uns des faits mémorables, dont elle a été le théâtre. Près de ce monticule, César, incendiant l’arsenal des Alexandrins, brûla une partie de la bibliothèque des Ptolémées. A l’extrémité de ce port, repoussé par les ennemis, il se jeta tout armé dans les flots, et toujours maître de son ame, il prévit que la foule des fuyards feroient couler bas son navire, et en gagna à la nage un autre plus éloigné. Cette présence d’esprit le sauva, car son vaisseau fut englouti avec ceux qui s’y étoient précipités. Là, Cléopâtre, célèbre par sa beauté, ses talens et ses artifices, l’enlaça dans ses filets, enchaîna son indomptable activité ; et l’endormant en sein de voluptés, le conduisit à sa suite dans un voyage sur le Nil, quand il auroit dû faire voile pour Rome, dont cette complaisance pouvoit lui fermer à jamais l’entrée. Près de ces colonnes, tristes débris du gymnase, l’orgueilleuse Reine d’Egypte, assise sur un trône d’or, reçut aux yeux de l’univers de titre d’épouse (p. 38) d’Antoine, qui lui sacrifia sa gloire. Ayant perdu dans les plaisirs le temps de vaincre, elle se fit mordre par une vipère ; il se perça de son épée, et leur mort offrit un grand exemple à la postérité.
Le Musée dont ces décombres m’annoncent l’emplacement, fut l’asyle des sciences. Appien, Hérodien, Euclide, Origène, Philon, et une foule d’autres savans, les y cultivèrent. Maintenant l’ignorance et la barbarie ont couvert la partie des beaux arts. Il faudroit une grande révolution pour leur rendre la vie.
Cette lettre, Monsieur, est fort longue ; je n’y joindrai point les observations sur les moeurs et le commerce des Alexandrins. Ces détails auront leur tour. Je me hâte de quitter une ville où l’on vit au milieu des ruines, où tous les objets inspirent la tristesse, où les habitans sont un mélange de Mores et de Turcs que les crimes ont chassé de leur patrie, où les Arabes Bedouins viennent vous dépouiller en plein jour, où enfin toute la nature morte pendant onze mois de l’année, ne se pare un instant de verdure que pour causer de longs regrets.
J’ai l’honneur d’être, etc. »
- 715 - 718 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JAMES CAPPER (1777-1779)
Capper, J., Observation on the passage to India, through Egypt and across the Great Desert, Londres, 1785.
James Capper (1743-1825) est marchand avant de devenir en 1768 capitaine de l’armée de Madras. En
1773, il est nommé par la Compagnie des Indes commissaire général des côtes du Coromandel avec le titre
de colonel. En 1777, il est envoyé en mission pour explorer la faisabilité d’une ouverture d’un nouveau
réseau pour la transmission des renseignements entre l’Europe et l’Inde. Après une révolte en Inde en 1780,
James Capper devient commandant d’artillerie à Madras. Après avoir démissionné de la Compagnie des
Indes en 1791, il retourne en Angleterre.634
Lettre écrite le 29 novembre 1780
p. 43-45 :
« With respect to a description of Alexandria and its environs, I shall beg leave as before to refer you to
Pococke, Norden and Niebuhr, &c. taking the liberty however in some few points to deffer from them ; and
likewise to add some observations that I have not met with in (p. 44) either of the abovementioned writers,
concerning the present and also the former state of Egypt.
The Mole of about one thousand yards on length which was built to form a communication with the island of
Pharos does not appear to me to have been taken sufficient notice of by any person. As Alexandria was built
with a view to commerce, this mole, notwithstanding some appearances of gothic work in the arches, is
probably coeval with the foundation of the city. Of what excellent materials then must it have been originally
composed to have resisted the beating of the wind and waves for near two thousand years ! Dr. Pococke
with great reason admires the arched cisterns under the houses for the reception of the water of the Nile, of
which however there are not more than five or six remaining at this time ; but in my opinion the same labour
and expence would have been better bestowed in lining the canal from the Nile to Alexandria, with the same
durable materials as those of the Mole ; by means of which the city to the end of time would have been
amply supplied with water ; and goods with great ease have been transported to it, from all parts of Egypt.
For want of being lined the banks of the Calisch (p. 45) or canal are now fallen in, which is one of the
principal causes of the decline of the trade, and of course of the ruin of the city. »
634 Walker, J. M., Walker D. A., « Capper, James (1743-1825) », Oxford Dictionary of National Biography,
Oxford, 2004 ; [www.oxforddnb.com].
- 719 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
EMMANUEL LOUIS HENRI ALEXANDRE DE LAUNAI D’ANTRAIGUES (1779)
De Launai d’Antraigues, E. L. H. A., L’Égypte galante, janvier-février 1779, Bruxelles, 1942.
Le comte d'Antraigues (1753-1812) est le neveu du comte de Saint-Priest, ambassadeur à Constantinople,
qui l’invite à voyager en Égypte. Admirateur de l’antiquité, il serait surtout ami des plaisirs.635
p. 17-25 :
« La ville d’Alexandrie est habitée par plusieurs peuples qui se sont presque naturalisés et qui différent
cependant extrêmement par leur caractère. Les naturels du pays, restes infortunés, échappés au glaive des
Sarrasins s’appellent Coptes, ce sont les plus malheureux des hommes, avilis et il faut l’avouer fort
méprisables. Leur religion est un mélange des opinions de Dioscore et d’Eutychès. Ils n’ont dans le fait,
aucune croyance. L’excès de l’ignorance les conduit à l’indifférence des philosophes, mais cependant ils
retiennent quelques cérémonies qu’ils observent avec soin, croient fermement qu’elles suffisent au salut. La
friponnerie de leurs prêtres les engage à les multiplier. Ces misérables papas n’entendent pas même la
langue sacrée de leurs livres et prononcent leurs prières sans savoir ce qu’ils disent, en cela assez
semblables à quelques évêques de France. Les Arabes des déserts de la Lybie s’établissent souvent à
Alexandrie. Ce sont (p. 18) d’aussi mauvais mahométans que les Coptes sont de mauvais catholiques. Ces
Arabes sont très différents pour le caractère de ceux de la côte orientale du Nil, chez lesquels on trouve
quelques vertus. Ceux de la Lybie n’en ont aucunes. Voilà ceux qui composent la plus grande partie du
peuple d’Alexandrie. Le temps n’a point affaibli ni effacé le caractère que leur donne l’antiquité. Ce peuple
inconstant, avide, fripon, lâche, insolent, adroit, souple, peut se reconnaître encore au tableau que César
traça de leurs vices pendant son court séjour en Égypte. Les Turcs forment une très petite partie de la
population. Quelques-uns viennent s’y établir pour être les correspondants des négociants de
Constantinople. Le reste n’est qu’un amas de fils d’esclaves affranchis et la plus grande partie est incorporé
dans la milice… La ville est commandée par deux agas. L’un réside au château qui est à l’entrée du
Port-Neuf et est subordonné à l’aga de la ville. Celui-ci est nommé par les beys du Caire qui le déposent
fréquemment. Il a inspection sur le civil et le militaire. Quant à la police, un cadi, envoyé de Constantinople,
ou du moins élu par le mufti, y rend la justice distributive. La justice criminelle est du ressort de l’aga qui a
droit de vie et de mort. Pour le maintien de la police de la ville, il y a un officier nommé ouali qui parcourt les
rues la nuit, arrête les gens suspects, les fait frapper sous la plante des pieds, les conduit dans les prisons,
(p. 19) mais ne peut les faire mourir sans l’ordre de l’Aga. Sa seule déposition suffit pour constater le crime
et ce seul privilège fait tout le revenu de sa charge par la terreur qu’il inspire et les avanies qu’il exige. Toute
la milice est aux ordres de l’aga, mais l’aga est vraiment aux siens. Toute sa force, que la loi ne modère
jamais cède à la leur quand ils se réunissent, et c’est toujours aux dépens du pauvre peuple que l’on achète
du pouvoir, que ceux-ci excitent des murmures et que l’on trouve le moyen de les apaiser. Le Grand
Douanier d’Egypte, qui réside au Caire, envoie ici un de ses lieutenants pour exiger les droits prescrits sur
les marchandises. C’est avec cet officier que les consuls étrangers ont le plus de relations. Son autorité
s’étend à tout parce que son maître est le dépositaire des trésors des Beys, qu’il est toujours en faveur et
que sur sa seule plainte il arrive souvent que les agas soient déposés.
Les moeurs des Coptes, celles des Arabes et des soldats sont très dissolues. Cette ville est un vrai séjour de
débauche. Ce n’est pas que la jalousie s’y affaiblisse pour tout ce qui concerne les harems. La même
rigueur assure aux femmes une sagesse forcée, mais la ville est peuplée d’une multitude de filles de joie soit
coptes ou des habitantes des rivages du Nil qui viennent ici exercer leur métier. Nulle gêne ne contraint leurs
lascives inclinaisons avec les Arabes ou les Turcs, mais un chrétien ou un franc, surpris avec ces (p. 20)
femmes court risque de la vie et n’échappe au bourreau qu’à force d’argent. Ces filles amoureuses des
Européens les accablent d’agaceries, elles les suivent, les excitent par les gestes les plus expressifs. Dès
qu’elles ne sont pas aperçues par les Turcs, elles lèvent leur voile et souvent lèvent à la fois tout ceux qui
cachent leurs attraits. Il n’en est aucune, même dans le rang le plus vil, qui ne connaisse toutes les
ressources de la plus exquise volupté et ce sont leurs talents qui les font valoir à nos yeux plus que leur
figure qui paraît bizarre aux étrangers. Toutes les naturelles du pays sont grandes, bien faites, leur teint est
basané et leurs traits réguliers. Leurs yeux vifs et ardents annocent le tempérament brûlant qui les anime.
Jusqu’ici la nature semble les avoir bien partagées, mais une parure du pays gâte leur visage et les difforme.
Dès qu’elles ont douze ans, elles se peignent le menton depuis la lèvre inférieure jusqu’au col en bleu de roi.
Cette couleur est si mordante qu’une fois appliquée elle ne s’efface jamais…
Souvent les Turcs les prennent dans leur harem et les enferment un mois ou deux. Ils en jouissent jusqu’à
satiété et les rendent ensuite au public. Un franc hasarderait sa tête s’il se donnait une telle licence. S’il jouit
de quelqu’une ce n’est que la nuit et fort à la dérobée, à moins qu’il ne l’introduise dans l’okkel de la nation
dans lequel l’ouali ne peut pénétrer.
(p. 21) Par un hasard singulier j’ai trouvé ici les deux Pachas ; Izzet qui part et Ismaël qui arrive pour le
remplacer. Les Beys sont infiniment mécontents d’Izzet, ils le chassent. Ismaël est désespéré qu’on l’ait tiré
de sa chère retraite de Scio pour l’envoyer pompeusement en exil au Caire ; ainsi l’un et l’autre voient
l’Egypte avec chagrin. Comme Izzet est très surveillé par les Beys, et que pendant qu’il attend le vent
favorable pour partir on ne lui laisse voir personne, j’ai pris le parti, le lendemain de mon arrivée, d’envoyer
chez lui mon drogman lui offrir vos respects et les assurances de votre soumission et votre zèle pour ses
intérêts, lui faisant ajouter que l’étranger chargé de lui apporter ces paroles l’était aussi d’une pélisse que
vous le priez d’accepter et aurait des objets de conséquence à lui communiquer. Il répondit à mon drogman
qu’il me verrait à l’heure même, sans les chiens du Caire qui le gardaient ; mais que si je voulais me rendre
chez lui à minuit, il me recevrait et m’écouterait avec le plus grand plaisir. A minuit, suivant les instructions
qu’il avait donné au drogman, je m’habillai en schoudar et allai avec Selim vêtu comme moi et mon drogman
me présenter à la porte du Pacha. On nous laissa entrer sans rien dire. Les gens du Pacha nous
conduisirent sur le champ à l’appartement où il m’attendait avec son fils. En m’approchant de lui, je baisai
humblement sa veste, il me releva et me fit asseoir auprès de lui, mon drogman à genoux entre (p. 22) nous
deux, et Selim à deux pas de moi, debout…
Il m’a dit qu’il avait cinq vaisseaux chargés d’argent, et qu’avec cela on attendait la mort ou le vizirat et qu’il
aura l’un ou l’autre. Il m’a fait revêtir d’une pélisse d’hermine, et m’a renvoyé après une audience de
vingt-cinq minutes, après m’avoir dit que le vizir actuel n’avait qu’une tête de cheval, qu’il fallait la détacher
pour lui faire place…
Le lendemain j’eus une audience publique d’Ismaël Pacha, maintenant Pacha du Caire. J’avais à lui
remettre les lettres de l’ambassadeur de France et votre recommandation. A sa porte étaient plantées les
trois queues de cheval au bout de la pique dorée. Je fus d’abord introduit chez le Kiaïa du Pacha qui m’offrit
le café, sorbet et parfums, puis la pipe que je refusai, ensuite douze officiers du Pacha vêtus en drap d’or
vinrent me prendre pour me conduire à l’audience du Pacha. La chambre où il était, était petite et cependant
remplie d’esclaves, le Pacha assis sur son divan et le cadi à genoux à peu de distance de lui. Je
m’approchai et me prosternai devant ce sot pour baiser sa veste, ce qu’il ne me laissa pas faire et il
m’ordonna de m’asseoir. Je lui donnai la lettre de l’ambassadeur qu’il fit lire par son secrétaire à genoux
devant lui. Quand cela fut fait on lui tendit la votre et mon drogman en vous nommant le pria de la lire
lui-même. Oh ! si vous aviez vu son étonnement, sa fierté l’abandonna ; il la lut trois (p. 23) fois et, ayant fait
éloigner le cadi et le secrétaire, il me fit signe de m’approcher. Le drogman se mit à genoux entre nous deux
et alors ce ne fut que protestations pour la princesse Ghika. Jamais Turc ne s’humilia à cet excès, et l’on voit
bien que celui-là a couru des dangers en sa vie. Il implore votre crédit sur la Scha-Mirhina, il me dit mille
choses que je n’entendais pas, quoiqu’on me les traduisît, je répondis en général et vis bien que cet Ismaël
était fait pour être au plus le valet du pacha Izzet. Il me fit offrir sorbet, café, parfums et une pélisse
d’hermine. Au moment de me retirer je lui baisai sa veste et lui demandai sa protection dans mes voyages. Il
me la promit. En sortant je trouvai encore les gens du kiaya qui me conduisirent dans ma chambre. L’accueil
du maître avait animé le kiaya. Il me fit boire café, sorbet et parfumer. Jamais de ma vie je n’ai tant bu en si
peu de moments. Je restai près d’une heure avec ce kiaya. Après un demi quart d’heure il fit sortir tous ses
esclaves et ne fit rester qu’une vingtaine de jeunes gens de quinze ou dix-huit ans très jolis, et soit que la
nature les eut favorisés, soit qu’ils colorassent leurs visages, ils avaient des physionomies célestes. Ils
exécutèrent plusieurs danses très lascives devant nous. Ce pauvre Ismaël a des goûts un peu vifs, mais ils
ne sont pas pour votre sexe. Je vis que le kiaya n’était pas moins empressé que lui. Leurs danses me
parurent agréables. Ils s’embrassaient avec grâce, se (p. 23) baisaient avec assez de volupté et le feu de
leurs regards exprimait l’ardeur des passions et la langueur des désirs. Le kiaya m’en offrit si je trouvais
quelque figure qui me séduisait… En vérité il me persécuta pour faire un choix, au point qu’enfin il me
demanda quel était au moins celui de tous que je trouvais le plus joli. Je lui en désignai un et à l’instant il lui
donna l’ordre de me baiser les mains, de m’embrasser et de danser avec moi, ce qu’il fit avec grâce, je me
laissai embrasser, enfin il fallut sortir après avoir donné une montre au kiaya et trente sequins à ses jeunes
esclaves. Je revins chez moi, à peine y étais-je arrivé que le même jeune esclave que j’avais trouvé et
désigné pour être le plus agréable vint, conduit par un eunuque noir, m’apporter un kereket de la part des
kiaya. Dès qu’il fut dans ma chambre et qu’il m’eut offert ce kereket, l’eunuque sortir et le laissa seul avec
nous. Vous ne pouvez imaginer et je ne puis vous décrire tout ce qu’il fit en notre faveur, il se déshabilla, je
le laissai faire, puis il se mit à danser seul une danse singulière pour les attitudes lascives et voluptueuses
qu’il dessinait, Selim le regardait et il me parut même que ce n’était pas sans quelque sentiment de plaisir. A
son âge la nature se trompe, on aime tout ce qui paraît aimable et les grâces du jeune âge sont celles de la
volupté. La figure d’un enfant de seize ans n’a point l’empreinte de la mâle figure de l’homme. Tout annonce
ce (p. 25) plaisir, la mollesse se peignent dans leurs regards, et sans les marques qui séparent les sexes, à
l’âge de Selim, on ne peut décider auquel une jolie figure appartient. Ajoutez à cela que ces enfants du kiaya
et ceux qui s’appliquent aux mêmes plaisirs ont l’art de rapprocher leurs manières de celles du sexe auquel
ils veulent enlever les droits. Les recherches les plus voluptueuses leur sont familières. Voilà les excuses de
Selim pour le plaisir qu’il prit à voir danser cet enfant. »
635 Clément, R., Les Français d’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, Ifao, Le Caire, 1960, p. 247.
- 720 - 722 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
MARK WOOD (du 16 au 17 mai 1779)
Wood, M., Remarks on a journey to the Esat Indies, by way of Holland and Germany to Venice, and from
thence to Alexandria, Grand Cairo, and Suez, to Ft. St. George. Undertaken by order of the Secret
Committee of the court of East India Directors, the 24th day of March, 1779, Litchfield, 1875.
Mark Wood (1750-1829) est officier d’armée et ingénieur. Après avoir été élève à la Compagnie des Indes, il
part pour l’Inde en 1770. En 1779, il est promu capitaine avant d’être envoyé en mission par le comité secret
de la Compagnie des Indes pour porter des dépêches de l’Inde vers l’Égypte. Entre 1780 et 1785, il est
chargé à Calcutta de superviser l’inspection du fleuve Hooghly. Il est nommé géomètre général du Bengale
en 1786 et ingénieur en chef du Bengale en 1788. Il quitte l’Inde définitivement en 1793.636
p. 32-35 :
« May 16th. In the morning passed several coasting vessels and were under some anxiety lest we might be
visited by some of the Barbary corsairs, or French cruisers. Towards mid-day got sight of Alexandria, and
landed about six o’clock in the evening. Proceeded to the house of a Venetian merchant, who receives and
in general entertains the English. Sent off an express to Mr. Baldwin, the English resident at Grand Cairo, to
acquaint him of our arrival, and desiring that he would, without loss of time, give such directions (p. 33) to the
commander of any of the Company’s vessels (lying at the port of Suez) as might be most likely to expedite
our dispatch.
We had now been a month on board this miserable boat, and about twenty days of this time in the Adriatic,
whereas with common management the passage ought to have been made in seven or eight days, and was
the journey to be performed again, I could almost with certainty engage to perform it within that time. The
delay greatly retarded our progress to India. In the evening received a visit from Mr. Baldwin’s agent, who
undertook to prepare every thing for our journey to Rozetto, a large town situated at the mouth of the Nile,
and about forty miles distant from Alexandria. Having for some days past been greatly indisposed, I wished
to have performed this voyage by sea, but having learnt that the passage was uncertain and likewise
dangerous, occasioned by a shoal or bar which great violence, I determined to travel by land, and for this
purpose directed camels to be prepared for carrying our necessaries, and mules for ourselves and servants.
The appearance of Alexandria from the sea is very beautiful, and conveys some idea of its former grandeur,
but which, on landing, quickly vanishes. The large Turkish castle, the extensive ruins of the ancient walls of
the city, the old and new ports crowled with forests of masts, give it an appearance of opulence which it little
deserves, for immediately on landing, this mighty city dwindles into obscure houses, and narrow dirty streets,
amidst heaps of ruins.
The old port is reserved entirely for the vessels of the faithful, and the new for those of the different states of
the Mediterranean, who carry on a considerable trade, and are the chief support of the place.
The country about Alexandria is low, a dismal barren sand ; on which, excepting a few scattered palm trees,
no verdure is to be seen.
The French carry on a great trade with this port, and of all the European states, appear to be of the greatest
consideration and to have the greatest wight.
(p. 34) Had their consul been a man of observation and activity, be might easily have possessed himself of
our dispatches, and prevented either Captain Nowlan or myself getting to India, without ever appearing in it.
The Christian merchants settled here, as well as throughout Egypt, are subject to continual insults and
oppression, and only support themselves by largesses to the officers of government.
Although I only remained at Alexandria a few hours, I had an instance of their very wanton insults to be
Christians. Hearing a public crier making a noise about the streets, and surrounded by a crowd of people, my
curiosity led me to inquire of the Venetian merchant, what it was the man said, who explained to me that it
was prohibiting, under a severe penalty, any Musulman to serve in a Christian family.
The sudden transition from Europe to Africa in the course of a few days, with the difference not only in the
manners, but in the language, dress, and complexion of the people, cannot fail to make on a stranger a very
lasting impression.
Having written to my friends at Castle Nuovo, Colonel Marini Conti and the Providitor, and sent them
presents of coffee and to each a piece of Indian muslin, by our Scalavonian captain, I gave him a certificate
of his good conduct, although he was not by any means entitled to it. I knew not whether most to blame the
poor Scalavonian or the English consul at Venice for providing so badly.
May 17th, 1779. Sent forward the camels with our baggage early in the morning, under the charge of my
servant, and about three o’clock in the afternoon followed myself, attented by two Arabs ; one as a linguist or
interpreter, the other as a guide, each of us mounted on a mule. We passed close to the ancient palace of
Cleopatra, which appears to have been a very extensive building, at present only a heap of ruins. Observed
a continuation of subterraneous aqueducts, which my interpreter informed me had a communication with the
Nile, and which, at the periodical rise of the river, supplied the reservoirs in the city of Alexandria with water.
(p. 35) The whole of the country from Alexandria to Rozetto is a barren sand, and is in many parts covered
with salt water and shells, from which I conclude that some branch of the Nile has formerly emptied itself into
the sea, close to the city of Alexandria.
The road to Rozetto is along the sea coast ; and for many miles a dryke or stone wall is constructed, from
fifteen to twenty feet in breadth, which not only serves for a road, but to prevent the encroachments of the
sea. »
636 Carnduff, B., « Wood, Sir Mark, first baronnet (1750-1829) », Oxford Dictionary of National Biography,
Oxford, 2004 ; [www.oxforddnb.com].
- 723 - 724 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
ELIZA FAY (1779)
Fay, E., Original letters from India (1779-1815), par M. M. Kaye, Londres, 1986.
À l’âge de 23 ans, l’Anglaise Eliza Fay (1755/1756-1816) suit son époux nommé avocat à la Cour suprême
de Calcutta. Le couple arrive à Calicut (Inde) en 1779 au moment de la guerre dans le Mysore. Les Fay sont
emprisonnés pendant trois mois et demi. En 1781, Eliza demande à être séparée de son époux et retourne
en Angleterre en 1782. Elle revient à Calcutta pour s’y installer en tant que modiste, mais son commerce est
un échec. En 1794, elle commence une nouvelle carrière de commerçante, voyageant entre l’Angleterre,
l’Inde et les États-Unis. Encore une fois, son entreprise se révèle être un désastre. Peu de choses de sa vie
sont connues après 1797. En 1816, elle retourne à Calcutta pour publier un ensemble de correspondance
formant vingt-trois lettres envoyées à sa famille entre 1779 et 1783.637
p. 69-74 :
23rd (july). We are now off Alexandria which makes a fine appearance from the sea on a near approach ; but
being built on low ground, is, as the seamen say « very difficult to hit ». We were two days almost abreast of
the Town. There is a handsome Pharos or light-house in a new harbour, and it is in all respects far
preferable ; but no vessels belonging to Christians can anchor there, so we were forced to go into the old
one, of which however we escaped the dangers, if any exist.
My acquaintance with the Reverend Father has terminated rather unpleasantly. A little while ago being upon
deck together, and forgetting our quarrel about the libation, I made a remark on the extreme heat of the
(p. 70) weather, « Aye » replied he, with a most maliognant expression of contenance, such as I could not
have thought it possible, for a face begnin like his to assume, « aye you will find it ten thousand times hotter
in the Devil’s House » (Nella Casa di Diavolo). I pitied his bigotry and prayed for his conversion to the
genuine principales of that religion, whose doctrines he professed to teach.
Mr. Brandy to whom Mr. Fay sent ashore an introductory letter, came on board to visit us. I rejoice to hear
from him, that there are two ships at Suez, yet no time must be lost, lest we miss the season. This gentleman
resides here, as Consul for one of the German Courts, and may be of great use to us. We received an
invitation to sup with him to-morrow ; he has secured a lodging for us, and engaged a Jew and his wife to go
with us to Grand Cairo as drogman, (or interpreter) and attendant : should we proceed by water, which is not
yet decided on, Mr. B- will provide a proper boat. I am summoned to an early dinner, immediately after which
we shall go on shore with our dragoman, that we may have time to view whatever is remarkable.
« 24th July, 1779. Having mounted our asses, the use of horses being forbidden to any but Musselmans, we
sallied forth perceded by a Janissary, with his drawn sword, about three miles over a sandy desert, to see
Pompey's Pillar, esteemed to be the finest column in the world. This pillar which is exceeding lofty, but I have
no means of ascertaining its exact height, is composed of three blocks of Granite : (the pedestal schaft and
capital, each containing one). When we consider the immense weight of the granite, the raising such
masses, appear beyond the power of man. Although quite unadorned, the proportions are so exquisite, that
it must strike every beholder with a kind of awe, which softens into melancholy, when one reflects that the
renowned Hero whose name it bears, was treacherously (p. 71) murdered on this very Coast, by the
boatmen who were conveying him to Alexandria ; while his wretched wife stood on the vessel he had just
left, watching his departure, as we may naturally suppose, with inexpressible anxiety. What must have been
her agonies at this dreadful event !
Though this spendid memorial bears the name of Pompey, it is by many supposed to have been erected in
memory of the triumph, gained over him at the battle of Pharsalia. Leaving more learned heads than mine to
settle this disputed point, let us proceed to ancient Alexandria, about a league from the modern town ; which
presents to the eye an instructive lesson on the instability of all sublunary objects. This once magnificent
City, built by the most famous of all Conquerors, and adorned with the most exquisite productions of art, is
now little more than a heap of Ruins ; yet the form of the streets can still be (as I recollect to have read of
Athens) had fore-courts bounded by dwarf walls, so much in the manner of our Lincoln’s-Inn Fields, that the
resemblance immediately stuck me.
We saw also the outside of St Athanasius's Church, who was bishop of this Diocese, but it begin now a
Mosque were forbidden to enter, unless on condition of turning Mahometans, or losing our lives, neither of
which alternative exactly suited my ideas, so I deemed it prudent to repress my curiosity. I could not however
resist a desire to visit the Palace of Cleopatra, of which few vestiges remain. The marble walls of the
Banqueting room are yet standing, but the roof is long since decayed. Never do I remember being so
affected by a like object. I stood in the midst of the ruins, meditating on the awful scene, ‘till I could almost
have fancied I beheld its former mistress, revelling in Luxury, with her infatuated lover, Marc Anthony, who
for her sake lost all.
(p. 72) The houses in the new Town of Alexandria thro’ which we returned, are flat roofed, and, in general,
have gardens on their tops. These in some measure, in so warm a country, may be called luxuries. As to the
bazars (or markets) they are wretched places, and the streets exceedingly narrow. Christians of all
denominations live here on paying a tax, but they are frequently ill treated ; and if one of them commits even
an unintentional offense against a musselman, he is pursued by a most insatiable spirit of revenge and his
whole family suffers for it. One cannot help shuddering at the bare idea of being in the hands of such
bigotted wretches. I forgot to mention that Mr. Brandy met us near Cleopatra’s needle’s, which are two
immense obelisks of granite. One of them, time has levelled with the ground ; the other is entire ; they are
both covered with hieroglyphic figures, which, on the sides not exposed to the wind and sand from the
desert, remain uninjured ; but the key being lost, no one can decypher their meaning. I thought Mr. B- might
perhaps have heard something relative to them ; he, however, seems to know no more than ourselves. A
droll circumstance occurred on our return. He is a stout man of a very athletic make, and above six feet
high ; so you may judge what a curious figure he must have made, riding on an ass, and with difficulty
holding up his long legs to suit the size of the animal ; which watched an opportunity of walking away from
between them, and left the poor consul standing, erect, like a colossus : in truth, it was a most ludicrous
scene to behold.
25th July. The weather being intensely hot, we staid at home ‘till the evening, when Mr. Brandy called to
escort us to his house. We were most graciously received by Mrs. B- who is a native of this place ; but as
she could speak a little Italian, we managed to carry on something like conversation. She was most curiously
bedizened on the (p. 73) occasion, and being short, dark complexioned, and of a complete dumpling shape,
appeared altogether the strangest lump of finery I had ever beheld ; she had a handkerchief bound round her
head, covered with strings composed of thin plates of gold, in the manner of spangles but very large,
intermixed with pearls and emeralds ; her neck and bosom were ornamented in the same way. Add to all this
an embroidered girdle with a pair of gold claps, I verily think near four inches square, enormous earrings, and
a large diamond sprig on the top of her forehead, and you must allow, that altogether she was a most brillant
figure. They have a sweet little girl about seven years of age, who was decked out much in the same style ;
but she really looked pretty in spite of her incongruous finery. On the whole, though, I was pleased with both
mother and child, their looks and behaviour were kind : and to a stranger in a strange land (and this is
literally so to us) a little attention is soothing and consolatory ; especially when one feels surrounded by
hostilities, which every European must do here. Compared with the uncouth beings who govern this country,
I felt at home among the natives of France, and I will even say of Italy.
On talking leave, our Host presented a book containing certificates of his great politeness and attention
towards travellers ; which were signed by many persons of consideration : and at the same time requesting
that Mr. Fay and myself would add our names to the list, we complied, though not without surprize, that a
gentleman in his situation, should have recourse to such an expedient, which cannot but degrade him in the
eyes of tis Guests.
It being determinated that we shall proceed by water, for reasons too tedious to detail at present, I must now
prepare to embark. I shall endeavour to keep up my spirits. Be assured that I will omit no opportunity of
writing, and (p. 74) comfort yourselves with the idea, that before this reaches you, I shall have surmounted all
my difficulties. I certainely deem myself very fortunate in quitting this place so soon. Farewell ; all good be
with you, my ever ever dear Friends prays,
Your own,
E. F.
637 Teltscher, K., « Fay, Eliza (1755/6-1816) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, 2004 ;
[www.oxforddnb.com].
- 725 - 726 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
DOMENICO SESTINI (1781)
Sestini, D., Le guide du voyageur en Égypte ou description des végétaux et des minéraux qui existent en
Égypte, Paris, 1803.
L’abbé florentin Domenico Sestini est numismate (1750-1832). Il accompagne M. Sulivan de la Compagnie
des Indes anglaise et Milord Ainslie, ambassadeur à la Porte.638
p. 295-301 :
« et le 26 au soir, nous mouillâmes dans le port franc d’Alexandrie.
L’attérage d’Alexandrie est très-difficile à cause du défaut d’élévation de la côte. On voit la colonne de
Pompée et ses décombres de l’ancienne Alexandrie, avant de découvrir la terre. Un écueil appelé la pointe
de diamant, (p. 296) rend l’entrée du port dangereuse : le capitaine et un pilote côtier viennent faire entrer
les bâtimens.
Ce port est presque comblé de sable, de tronçons de colonnes, et de décombres. Le fond est si mauvais
qu’il use en peu de tems, les cables : il ne sera bientôt plus possible d’y entrer ; et il est d’ailleurs si peu sûr
que, quand les vents violents du Nord sont violens, les vaisseaux périssent dans le port même. A côté du
port franc, et séparé seulement par l’ancien phare, est le porto vecchio, qui est commode, profond, sûr, et la
sortie sont sans danger ; mais les Francs n’ont pas la permission d’y mouiller. Je ne conçois pas comment
tous les ambassadeurs étrangers ne se sont pas réunis, pour en obtenir l’usage de la Porte, pour le
commerce des Européens. Je croirais que les consuls, qui logent tous près du port franc, n’ont pas fait les
démarches nécessaires, et ont préféré leur commodité aux avantages des négocians et des marins.
Je ne ferai pas une grande description d’Alexandrie, il y en a déja tant de faites : je dirai seulement qu’au
premier coup d’oeil, un voyageur n’y voit qu’un amas de ruines. Alexandre qui la fit bâtir avait choisi un lieu
très-propre au commerce : il y a peu de restes (p. 297) de son ancienne magnificence. La colonne de
Pompée qui était au centre de la ville, en est à une grande demi-lieue : la base et le chapiteau sont de
granite rouge. Elle est très-haute et très-grosse. Le fût est chargé d’hiérogliphes. Savari qui en a donné les
dimensions, dit qu’Aboulfeda l’appèle la colonne de Sévère. Cet empereur donna un sénat à Alexandrie, en
passant en Égypte ; et cette ville lui consacra cette colonne par reconnaissance.
J’ai encore trouvé ici de la lave poreuse, et j’avoue que j’en suis un peu embarassé. Il n’y a en Égypte, ni
montagnes, ni autre chose qui puisse faire croire à des volcans ; ce sera le résultat de quelque grand
incendie qui aura calciné les pierres calcaires des édifices. Je n’y puis trouver d’autre explication. Au delà de
la colonne de Pompée, est le canal qui conduit les eaux du Nil aux réservoirs d’Alexandrie. Il est de
construction très-antique et très-solide. Plus loin est le lac maréotis, près duquel était la ville des morts,
Nécropolis. A droite du port franc, est encore debout un obélisque qu’on appèle l’aiguille de Cléopatre ; et
auprès, un autre abattu. Tous deux sont de granit rouge. On a fait une mosquée de l’église S. Athanase. Il y
a une belle colonade et une urne antique ; les Francs y entrent difficilement. Au bout de la rue où est cette
église et près l’ancienne porte (p. 298) de Canope, sont encore debout plusieurs colonnes de granit rouge.
Les pères de la terre sainte ont une église assez belle et un logement commode à Alexandrie. Celle des
Copthes est misérable : on y montre le fauteuil de saint Marc. Il est suspendu en l’air. Pour moi je le prendrai
pour un vieux fauteuil à barbe.
L’église grecque qui vient d’être reconstruite est peu de chose ; les Turcs ne permettent pas la magnificence
dans ces édifices. On y voit un tronçon de colonne sur laquelle fut martyrisée sainte Catherine. Les prêtres
le disent, le peuple le croit, et surtout paie pour la voir. Il y a aussi un trésor de reliques, composé de
colonnes, de chaises, de dents, d’os, de langes et de vieux manuscrits, objets de la superstition populaire
qu’entretiennent les moines grecs, au détriment de la véritable foi. Près du port, sont les anciennes
catacombes et les bains de Cléopatre creusé dans le tuf, ouvrage de peu de peine.
Alexandrie est habitée par des Arabes, des Turcs, des Cophtes, des Arméniens, des Maronites, des Grecs,
des Juifs et des Européens. La population en est peu considérable, et diminue avec le commerce. Les
vexations des beys l’ont déja rendu presque nul dans la haute Égypte. Les consuls ont été forcés
d’abandonner le Caire, il n’en reste plus qu’à (p. 299) Alexandrie. Les Français et les Vénitiens y font le plus
d’affaires. Tous les Francs habitent la même rue, et n’en sont pas plus unis. Comme dans toutes les
échelles du Levant, chacun y porte des prétentions, des préjugés, des intérêts nationaux et individuels,
desquels il résulte des divisions, des haines, des animosités, des jalousies qui ne tournent, ni au profit du
commerce, ni à celui de la probité.
Le commerce d’Égypte est cependant encore très-considérable, et s’étend dans la chretienté, la Turquie, la
Barbarie, la Syrie, les pays de Gedda, de Sennar et autres lieux. La France, l’Angleterre et Venise y portent
beaucoup de draps, de soieries, et des galons de Lyon et de Valence ; du papier de France et d’Italie, du
plomb, de l’étain, des épices, de la cochenille, du bois du Brésil et de Campêche, de la salse pareille, de
l’ambre gris et jaune, du mercure, du cinabre, de l’arsenic, du souffre, du vitriol, du fil de fer et de laiton, du
verd, de la céruse, des miroirs, des merceries de Venise et d’Allemagne, du fer de Suède, des clous, de
l’acier, des armes à feu, des lames d’épée, des amandes, des prunes, des confitures de Provence et de
Livourne, du corail, et plusieurs autres petits articles ; surtout beaucoup de sequins de Venise et d’écus
d’empire.
Les Hollandais et les Toscans y font peu de (p. 300) commerce. La Turquie, la Morée et Candie envoient à
Alexandrie, des mastics, de l’alun, de la garence, des figues et les raisins secs, des noisettes, de l’huile, du
savon, du vin, du tabac, de la réglisse, de la soie, des toiles pour faire des bonnets à la turque, des pélisses,
des challes d’Angora, des mouchoirs de mousselines de couleur et brochés, du bois à brûler, et quelques
autres petits objets : la Barbarie, beaucoup d’huile d’olive, des bonnets de laine rouges, des baracans, des
futaines et autres étoffes de soie et de coton, du tabac et du coton en balles : Gidda, grande quantité de café
moka, des encens, de la myrrhe, de l’aloës, du tamarisc, de l’assa foetida, des mirobolans, de la mère perle,
du turbit, du curcume, des baies de laurier et de lierre, de la noix vomique, du crétonar, du benjoin, de la
civette, du musc, de l’ambre gris, des drogues des Indes ; et surtout une immense quantité de toiles fines de
coton, d’étoffes de soie et de coton qui se fabriquent à Surate et au Bengale, de poivre, de gingembre, et
autres épices. Les nègres de Sennar, voisins de la Barbarie, apportent en Égypte, tous les ans, des dents
d’éléphants, de la gomme arabique, de la poudre d’or et des perroquets. L’Égypte à son tour, fournit à ces
différens (p. 301) commerces, beaucoup de riz et de lin, de la casse, de la cire, des cotons filés, de la laine,
des plumes d’autruche, du safran, du sel amoniac, du sené, de l’hermodacte, du sucre, des dattes, des
fèves, des pois, des lentilles, grande quantité de bled, de l’huile de lin et de susain, des cuirs de boeufs et de
chameaux.
Ses manufactures consistent en toiles de lin et de coton de plusieurs espèces et de plusieurs prix.
L’exportation des comestibles est défendue pour la chretienté ; mais malgré la prohibition, on en tire une
grande quantité de riz et de café. »
638 Lumbroso, G., Descrittori Italiani dell’Egitto e di Alessandria, Reale Accademia dei Lincei CCLXXVI, Rome,
1879, p. 505-506.
- 727 - 728 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
HENRI ROOKE (1782)
Rooke, H., Voyage sur les côtes de l'Arabie heureuse, sur la mer Rouge et en Égypte, Londres, Paris, 1788.
Henri Rooke est major d’infanterie.
p. 132-136 :
LETTRE XII
« Le grand Alexandre en est le grand fondateur, ensuite les Romains qui l’admiroient, s’occupèrent de
l’orner, Cléopâtre y fixa son séjour, Antoine vaincu s’y réfugia ; enfin cette cité fameuse autrefois par la
magnificence, par son luxe et par les savans qui l’habitoient, est maintenant un amas de ruines ; les bains,
les palais, les portiques, les amphithéâtres sont confondus. Tel est l’état misérable auquel les Sarrazins l’ont
réduite en la prenant. Mais un événement encore plus lamentable, c’est la destruction de la fameuse
bibliothèque des Ptolomées, contenant cent mille volumes. Après s’être emparé de cette ville, le Général
Musulman envoya demander au khalife ce qu’il vouloit faire des livres, celui-ci voulut qu’on les brûlât. « Nous
n’en avons pas besoin, dit-il, s’ils s’accordent avec le Coran, & s’ils sont contraires à ce saint livre ce sont
des impiétés ». D’après cet ordre, les musulmans employèrent la bibliothèque à chauffer leurs bains pendant
six mois.
La colonne de Pompée est le plus beau monument qui existe dans cette ville. On la voit sur une éminence à
un quart de mille des murailles, du côté du midi ; elle est de granite rouge, le fût a quatre-vingt-dix pieds de
hauteur et neuf de diamètre, la colomne entière a cent quatorze pieds, le chapiteau est en ordre corinthien.
Je ne veux pas vous laisser ignorer de quelle manière des marins anglais sont parvenus à monter sur cette
colomne. Ils enlevèrent d’abord un cerf-volant par-dessus, de manière que pour le faire tomber de l’autre
côté, ils lâchèrent la corde qui fut arrêtée sur le sommet. Alors ils y en attachèrent d’autres petites en travers,
qui formaient une espèce de hautban, comme au mât d’un vaisseau. Une fois montés, ils burent en
réjouissance un bol de punch, & s’aperçurent qu’il y avoit eu autrefois une statue pédestre dont il restait
encore un morceau de pied.
Il y a en outre deux obélisques qui portent le nom de Cléopâtre, peut-être faisoient-ils partie des ornemens
du palais de cette princesse qui n’étoit pas éloigné de la mer. L’un est renversé & à demi enseveli dans le
sable, l’autre est encore droit. Il a soixante-trois pieds de hauteur, & toutes les faces en sont chargées
d’hyérogliphes. On montre des appartements souterrains qu’on appelle des catacombes, mais leur forme me
porte à croire que c’étoient des salles de bains.
Les ruines ayant élevé le sol, les salles se trouvent comblées. Il ne reste plus maintenant un bâtiment assez
entier pour que l’on puisse juger de son ancienne forme & de l’usage auquel il étoit destiné. Le Phare même,
une des sept merveilles du monde, n’est plus maintenant qu’une forteresse Turque bâtie au même endroit, &
peut-être avec les anciens matériaux.
On a trouvé dans ces ruines beaucoup de médailles, d’anneaux, de statues antiques, & il serait très possible
de découvrir une infinité d’autres choses, si l’on obtenait la permission d’y fouiller. Mais les naturels sont
jaloux des chrétiens, ils croient que nous cherchons des trésors cachés, & ces perquisitions deviennent
dangereuses pour les amateurs qui les font.
La ville moderne d’Alexandrie n’est pas bâtie à la place de l’ancienne, mais sur une portion de terrain qu’on
appelloit hepta-stadium, elle n’a pas de murailles. C’est une espèce de presqu’île qui se trouve entre deux
ports. Celui qui regarde le midi, nommé autrefois portus Eunostus, & aujourd’hui le vieux-port est le meilleur.
Les vaisseaux turcs seuls viennent y mouiller ; l’autre, le port-neuf, est destiné aux chrétiens ; à l’une de ses
extrémités étoit le fameux phare.
Les historiens nous apprennent que le corps d’Alexandre fut embaumé et enterré dans cette ville. On l’avoit
d’abord enfermé dans un cercueil d’or que l’on prit, comme vous pouvez bien vous l’imaginer, & on y
substitua un cercueil de verre qui fut conservé jusqu’au temps d’Auguste. Ce prince voyant ce monument
dans un si pitoyable état, l’orna d’une couronne d’or, & l’arrosa de ses larmes.
Voici bientôt un mois que je suis témoin de la triste révolution qu’ont éprouvée dans Alexandrie les hommes,
les moeurs, les arts & les sciences ; c’est trop long-tems m’arrêter sur un tableau désagréable, je monte
demain à bord d’un vaisseau destiné pour Tunis, il doit relâcher à Malte & je débarquerai dans cette isle,
parce que la quarantaine y est moins longue que dans aucun port d’Italie. Je serai bien charmé de vous
apprendre mon arrivée. »
- 729 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
CONSTANTIN-FRANÇOIS CHASSEBOEUF VOLNEY (janvier 1783)
Volney, Voyage en Égypte et en Syrie, par J. Gaulmier, Paris, La Haye, 1959.
Né en 1757 en Anjou, Volney fait ses études aux collèges d’Ancenis et d’Angers. À l’âge de dix-sept ans,
ayant reçu un héritage de la succession de sa mère, il se rend à Paris pour y étudier les hautes sciences et
les langues anciennes. Il acquiert de nouveau un héritage avec lequel il décide de partir en Égypte et en
Syrie. Il prépare son voyage pendant un an en habituant son corps aux plus rudes privations. Il s’initie à
l’arabe qu’il étudie pendant deux ans, de 1780 à 1782, au Collège Royal de France.639 Puis, en 1782, il se
met en route à pied. Après une absence de quatre années, il revient en France et publie sa relation en 1787.
Son ouvrage au succès immense passe pour le chef-d’oeuvre du genre. Il meurt en 1820.640
p. 25-28 :
« De l’Égypte en général, et de la ville d’Alexandrie.
C’est en vain que l’on se prépare, par la lecture des livres, au spectacle des usages et des moeurs des
nations ; il y aura toujours loin de l’effet des récits sur l’esprit à celui des objets sur les sens. Les images
tracées par des sons n’ont point assez de correction dans le dessin, ni de vivacité dans le coloris ; leurs
tableaux conservent quelque chose de nébuleux, qui ne laisse qu’une empreinte fugitive et prompte à
s’effacer. Nous l’éprouvons surtout si les objets que l’on veut nous peindre nous sont étrangers ; car
l’imagination ne trouvant pas alors des termes de comparaison tout formés, elle est obligée de rassembler
des membres épars pour en composer des corps nouveaux ; et dans ce travail prescrit vaguement et fait à
la hâte, il est difficile qu’elle ne confonde pas les traits et n’altère pas les formes. Doit-on s’étonner si, venant
ensuite à voir les modèles, elle n’y reconnaît pas les copies qu’elle s’en est tracées, et si elle en reçoit des
impressions qui ont tout le caractère de la nouveauté ?
Tel est le cas d’un Européen qui arrive, trransporté par mer, en Turkie. Vainement a-t-il lu les histoires et les
relations ; vainement, sur leurs descriptions, a-t-il essayé de se peindre l’aspect des terrains, l’ordre des
villes, les vêtements, les manières des habitants ; il est neuf à tous ces objets, leur variété l’éblouit ; ce qu’il
en avait pensé se dissout et s’échappe, et il reste livré aux sentiments de la surprise et de l’admiration.
Parmi les lieux propres à produire ce double effet, il en est peu qui réunissent autant de moyens
qu'Alexandrie en Égypte. Le nom de cette ville qui rappelle le génie d'un homme étonnant ; le nom du pays
qui tient à tant de faits et d'idées ; l'aspect du lieu qui présente un tableau si pittoresques ; ces palmiers qui
s'élèvent en parasol ; ces maisons à terrasses qui semblent dépourvues de toit ; ces flèches grêles des
minarets, qui portent une balustrade dans les airs, tout avertit le voyageur qu'il est dans un autre monde.
Descend-il à terre, une foule d’objets inconnus l’assaille par tous les sens ; c’est une langue dont les sons
barbares et l’accent âcre (p. 26) et guttural effraient son oreille ; ce sont des habillemens d’une forme
bizarre, des figures d’un caractère étrange. Au lieu de nos visages nus, de nos têtes enflées de cheveux, de
nos coiffures triangulaires, et de nos habits courts et serrés, il regarde avec surprise ces visages brûlés,
armés de barbe et de moustaches ; cet amas d’étoffe roulé en plis sur une tête rase ; ce long vêtement qui
tombant du cou aux talons, voile le corps plutôt qu’il ne l’habille ; et ces pipes de six pieds ; et ces longs
chapelets dont toutes les mains sont garnies ; et ces hideux chameaux qui portent l’eau dans des sacs de
cuir ; et ces ânes scellés et bridés, qui transportent légèrement leur cavalier en pantoufles ; et ce marché
mal fourni de dattes et de petits pains ronds et plats ; et cette foule immonde de chiens errans dans les
rues ; et ces espèces de fantômes ambulans qui, sous une draperie d’une seule pièce, ne montrent
d’humain que leurs yeux de femme. Dans ce tumulte, tout entier à ses sens son esprit est nul pour la
réflexion ; ce n’est qu’après être arrivé au gîte si désiré quand on vient de la mer, que devenu plus calme, il
considère avec réflexion les rues étroites et sans pavé, ces maisons basses et dont les jours rares sont
masqués de treillages, ce peuple maigre et noirâtre, qui marche nu-pieds et n’a pour tout vêtement qu’une
chemise bleue, ceinte d’un cuir ou d’un mouchoir rouge. Déjà l’air misérable de misère qu’il voit sur les
hommes et le mystère qui enveloppe les maisons lui font soupçonner la rapacité de la tyrannie, et la
défiance de l’esclavage. Mais un spectacle qui bientôt attire toute son attention, ce sont les vastes ruines
qu’il aperçoit du côté de la terre. Dans nos contrées, les ruines sont un objet de curiosité : à peine
trouve-t-on, aux lieus écartés, quelques vieux châteaux dont le délabrement annonce plutôt la désertion du
maître, que la misère du lieu. Dans Alexandrie, au contraire, à peine sort-on de la ville neuve dans le
continent, que l’on est frappé de l’aspect d’un vaste terrain tout couvert de ruines. Pendant deux heures de
marche, on suit une double ligne de murs et de tours, qui formaient l’enceinte de l’ancienne Alexandrie. La
terre est couverte des débris de leurs sommets ; des pans entiers sont écroulés ; les voûtes enfoncées, les
créneaux dégradés, et les pierres rongées et défigurées par le salpêtre. On parcourt un vaste intérieur
sillonné de fouilles, percé de puits, distribué par des murs à demi enfouis, semé de quelques colonnes
anciennes, de tombeaux modernes, de palmiers, de nopals, et où l’on ne trouve de vivant, que des chacals,
des éperviers et des hiboux. Les habitans, accoutumés à ce (p. 27) spectacle, n’en reçoivent aucune
impression ; mais l’étranger, en qui les souvenirs qu’il rappelle s’exaltent par l’effet de la nouveauté, éprouve
une émotion qui souvent passe jusqu’aux larmes, et qui donne lieu à des réflexions dont la tristesse attache
autant le coeur que leur majesté élève l’âme.
Je ne répèterai point les descriptions, faites par tous les voyageurs, des antiquités remarquables
d’Alexandrie. On trouve dans Norden, Pococke, Niebuhr, et dans les lettres que vient de publier Savary, tous
les détails sur les bains de Cléopâtre, sur ses deux obélisques, sur les catacombes, les citernes, et sur la
colonne mal appelée de Pompée. Ces noms ont de la majesté ; mais les objets vus en original perdent de
l’illusion des gravures. La seule colonne, par la hardiesse de son élévation, par le volume de sa
circonférence, et par la solitude qui l’environne, imprime un vrai sentiment de respect et d’admiration.
Dans son état moderne, Alexandrie est l'entrepôt d'un commerce assez considérable. Elle est la porte de
toutes les denrées qui sortent de l'Égypte vers la Méditerranée, le ris (sic) de Damiette excepté. Les
Européens y ont des comptoirs, où des facteurs traitent de nos marchandises par échanges. On y trouve
toujours des vaisseaux de Marseille, de Livourne, de Venise, de Raguse, et des Etats du Grand Seigneur ;
mais l'hivernage y est dangereux. Le port neuf, le seul où l'on reçoive les Européens, s'est tellement rempli
de sable, que dans les tempêtes les vaisseaux frappent le fond avec la quille ; le plus, ce fond étant de
roche, les câbles des ancres sont bientôt coupés par le frottement, et alors un premier vaisseau chasse sur
un second, le pousse sur un troisième, et de l'un à l'autre ils se perdent tous. On en eut un exemple funeste
il y a seize ou dix-huit ans ; quarante-deux vaisseaux furent brisés contre le môle, dans un coup de vent du
nord-ouest ; et depuis cette époque on a de temps à autre essuyé des perles de quatorze, de huit, de six,
etc. Le vieux port, dont l’entrée est couverte par la bande de terre appelée cap des Figues, n’est pas sujet à
ce désastre ; mais les Turcs n’y reçoivent que des bâtimens musulmans. Pourquoi, dirait-on en Europe, ne
réparent-ils pas le port neuf ? C’est qu’en Turkie, l'on détruit sans jamais réparer. On détruira aussi le port
vieux, où l'on jette depuis deux cents ans (p. 28) le lest des bâtimens. L’esprit turk est de ruiner les travaux
du passé et l’espoir de l’avenir ; parce que dans la barbarie d’un despotisme ignorant, il n’y a point de
lendemain.
Considérée comme ville de guerre, Alexandrie n'est rien. On n'y voit aucun ouvrage de fortification ; le phare
même avec ses hautes tours n'en est pas un. Il n'a pas quatre canons en état, et pas un canonnier qui sache
pointer. Les cinq cents janissaires qui doivent former sa garnison, réduits à moitié, sont des ouvriers qui ne
savent que fumer la pipe. Les Turks sont heureux que les Francs soient intéressés à ménager cette ville.
Une frégate de Malte ou de Russie suffirait pour la mettre en cendres ; mais cette conquête serait inutile. Un
étranger ne pourrait s’y maintenir, parce que le terrain est sans eau. Il faut la tirer du Nil par un kalidj, ou un
canal de douze lieues, qui l’amène chaque année lors de l’inondation. Elle remplit les souterrains ou citernes
creusées sous l’ancienne ville, et cette provision d’eau doit durer jusqu’à l’année suivante. L’on sent que si
un étranger voulait s’y établir, le canal lui serait fermé.
C’est par ce canal seulement qu’Alexandrie tient à l’Egypte ; car, par sa position hors du Delta, et par la
nature de son sol, elle appartient réellement au désert d’Afrique : ses environs sont une campagne de sable,
plate, stérile, sans arbres, sans maisons, où l’on ne trouve que la plante qui donne la soude, et une ligne de
palmiers qui suit la trace des eaux du Nil par le Kalidj.
Ce n’est qu’à Rosette, appelée dans le pays Rachid, que l’on entre vraiment en Egypte : là l’on quitte les
sables blanchâtres qui sont l’attribut de la plage, pour entrer sur un terreau noir, gras et léger, qui fait le
caractère distinctif de l’Egypte ; alors aussi pour la première fois, on voit les eaux de ce Nil si fameux : son
lit, encaissés dans deux rives à pic, ressemble assez bien à la Seine entre Auteuil et Passy. Les bois de
palmiers qui le bordent, les vergers que ses eaux arrosent, les limoniers, les orangers, les bananiers, les
pêchers et d’autres arbres donnent, par leur verdure perpétuelle, un agrément à Rosette, qui tire surtout son
illusion du contraste d’Alexandrie, et de la mer que l’on quitte. Ce que l’on rencontre de là au Kaire, est
encore propre à le fortifier. »
639 Gaulmier, J., Jean Gaulmier. Un orientaliste en Syrie, Ifpo, Damas, 2006, p. 146. Contrairement à ce qui
est avancé, Volney n’a pas appris l’arabe dans un couvent du Mont-Liban.
640 Durozoir, Ch., « Volney, Constantin-François Chasseboeuf », dans L.-G. Michaud et J.-Fr. Michaud (éd.),
Biographie Universelle ancienne et moderne 49, Paris, 1827, p. 437-451.
- 730 - 731 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
JEAN POTOCKI (août et octobre 1784)
Potocki, J., Jean Potocki. OEuvres I, par F. Rosset et D. Triare, Louvain, Paris, Dudley, 2004.
Jean Potocki (1761-1815), seigneur polonais mais d’éducation française, est à la fois savant, écrivain et
homme politique. Imprégné par l’esprit des Lumières, il est ami de Voltaire (1694-1778). Il est le fondateur
des études de langues et civilisations slaves. Il passe de nombreuses années à voyager dans l’empire
ottoman. En 1789, il fonde à Varsovie un club politique progressiste et une "imprimerie libre". Il est l’auteur
de plusieurs romans dont le Manuscrit trouvé à Saragosse, chef-d’oeuvre de la littérature fantastique, ainsi
que de nombreux récits de voyage et travaux historiques. Il se donne la mort en 1815.641
p. 44-45 :
LETTRE XIII
« Le 16 août à Alexandrie
La peste était très forte dans l’île de Cos, presque toute la maison du consul en était morte ; ainsi vous jugez
bien que nous nous sommes gardés d’aller à terre et que nous avons continué notre route. Le lendemain
21 juillet, nous avons longé de très près la ville de Rhodes : j’y ai ressenti le premier accès d’une fièvre qui
m’a rendu si faible que, vingt-quatre heures après, je ne pouvais plus quitter mon lit. Bientôt le chevalier
Kownacki s’est trouvé atteint de la même maladie. Ensuite tous mes domestiques et un missionnaire qui
s’était joint à nous se sont (p. 45) trouvés dans le même état. J’ignore absolument tout ce qui s’est passé
pendant mon voyage de Rhodes à Alexandrie. Arrivé devant cette ville, je n’avais pas la force de monter sur
le gaillard, et je me suis traîné à la proue ; mais au lieu de voir le port, ma faiblesse ne m’a laissé apercevoir
qu’un nuage blanc, et j’ai regagné mon lit avec assez de peine. J’ai quitté le vaisseau au bruit du canon
qu’on tirait pour me faire honneur et qui m’a rompu la tête au point de me faire évanouir. Venu dans la
maison du consul, j’ai appris que ces environs délicieux du mont Ida, dont je vous ai dit tant de bien, sont
situés sous le climat le plus perfide. J’y avais passé quinze nuits en plein air, c’est plus qu’il n’en faut pour y
prendre toutes les fièvres du monde. Mais ce n’est pas absolument ma faute, car je n’étais pas averti. Nous
avons heureusement trouvé, ici tous les secours imaginables, un fort bon médecin, et dans la maison du
consul autant de soins que j’aurais pu en trouver chez vous. Aussi je n’ai pas tardé à me rétablir. K. m’a suivi
de près, mais mes gens ont eu des rechutes et aucun n’est en état de me suivre au Caire. Je me prépare
actuellement à ce voyage que je dois faire dans cinq ou six jours. Déjà vous ne me reconnaîtriez plus. Je
porte un grand turban à la druse ; j’ai la tête rasée, et des habits à l’égyptienne, qui sont un peu différents de
ceux de la Turquie. Je ne vous parle ni de la colonne de Pompée, ni de l’aiguille de Cléopâtre, ni des
catacombes, ni de toutes les autres antiquités d’Alexandrie, dont tous les voyageurs ont déjà tant parlé.
p. 55-56 :
LETTRE XIX
Le 8 octobre à Alexandrie
Nous sommes partis de Boulak le premier octobre ; la nuit suivante nous avons été côtoyés par des pirates,
mais comme ils étaient plus mal armés que nous ils n’ont pas jugé à propos de nous attaquer. Nous
sommes arrivés le même jour à Rosette. Le lendemain, les Arabes ont fait une incursion dans les faubourgs
de cette ville. Le chevalier Kownacki, qui s’y promenait alors, a manqué de tomber entre leurs mains.
Alexandrie, où nous sommes depuis deux jours, vient d’échapper à un fléau non moins fâcheux que la
famine. On a manqué d’y mourir de soif, et voici comment. Cette ville est située au milieu d’un désert de
sable, et à plus de dix lieues du Nil et de toute espèce d’eau douce. Alexandre, qui voulait placer dans cet
endroit le siège de son empire, avait paré à cet inconvénient en faisant creuser un canal qui y conduisait les
eaux du Nil et servait en même temps au transport des marchandises. Ce canal, comblé peu à peu par la
négligence des gens du pays, ne se remplit plus que pendant le plus grand accroissement du fleuve. Alors
tout le monde est très empressé à creuser des canaux pour fertiliser son terrain ; comme il faut en donner à
tout le monde, on ne peut laisser entrer l’eau dans le canal d’Alexandrie que pendant huit jours, ce qui suffit
à peine pour remplir leurs citernes. Encore faut-il y envoyer des soldats, sans quoi les Arabes, dont les
terres sont infertiles faute d’être arrosées, ne manqueraient pas de l’enlever. Cette fois-ci le kiachef (p. 56)
préposé à cet ouvrage était un homme très attaché à Ibrahim-bey, qui, ayant appris la disgrâce de son
maître, courut aussitôt le rejoindre dans la Haute-Egypte et laissa le canal à la merci des Arabes. Ceux-ci se
dépêchèrent d’y faire des saignées, et les malheureux Alexandrins, après avoir vu couler l’eau dans leurs
citernes pendant trois ou quatre heures, la voyant manquer tout d’un coup, tombèrent dans un désespoir
affreux. Les étrangers voulaient se retirer à Rosette, le peuple se lamentait et il s’était élevé une espèce de
guerre civile entre les principaux de la ville, parce que les uns voulaient qu’on attaquât les Arabes et les
autres qu’on leur envoyât des présents. Heureusement pour eux Mourad-Bey apprit la chose à temps et fit
remplir le canal une seconde fois, autant du moins que le permettait la baisse du Nil. Enfin, lorsque nous
sommes arrivés à Alexandrie, les habitants étaient un peu remis de leur frayeur et quoiqu’ils s’attendissent à
n’avoir que de la mauvaise eau, et en petite quantité, ils ne craignaient plus de mourir de soif. »
641 Bouillet, M.-N. et Chassang, A., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, 1878, p. 1536.
- 732 - 733 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
PIERRE-MARIE-FRANÇOIS DE PAGÈS (1788-1790)
Pagès, P.-M.-F. de, Nouveau voyage autour du monde en Asie, Amérique et Afrique, 1788, 1789 et 1790,
Paris, 1797.
Le vicomte de Pagès, né à Toulouse en 1748, entre dans la marine en 1767, comme enseigne de vaisseau
dans l’escadre des Indes occidentales lorsqu’il décide de fuir pour se lancer dans une aventure autour du
monde. À partir du Cap-Haïtien, il visite la Louisiane, le Texas, le Mexique, avant de revenir en Europe en
1771 par Manille, les Indes et la Méditerranée orientale. En 1773, il accompagne le commandant Kerguelen
dans son expédition au Pôle Sud et, en 1776, il part de Hollande pour le Spitzberg. Les publications de ses
nombreux voyages lui valent d’être nommé correspondant par l’Académie des Sciences. S’étant retiré à
Saint-Domingue, il est égorgé en 1793 lors de la révolte des esclaves.642
p. 179-181 (vol. I) :
« De retour au Caire, nous partîmes pour Alexandrie. On la distingue en deux villes, l’ancienne et la
nouvelle ; ni l’une ni l’autre ne répondent à la célébrité que cette ville eut jadis. Elle fut fondée par Alexandre
le Grand, qui lui donna son nom. Cette dénomination illustre est peut-être tout ce qui lui reste de son
ancienne splendeur. Des bâtimens à la turque ont succédé à ses chefs-d’oeuvre d’architecture grecque et
romaine. Ce qu’on appeloit la fameuse tour du phare est actuellement un lourd château surmonté d’une
lanterne, dont l’emploi devroit être d’éclairer les vaisseaux durant la nuit ; il ne lui manque pour le faire que
d’être entretenue et allumée. Vis-à-vis de ce château est un bâtiment à peu près de la même espece : il est
nommé le petit pharillo, pour le distinguer de l’autre qui porte le nom de grand. Tous deux sont placés à
l’entrée du port, et lui servent de défense. Le dernier a très-mal remplacé un superbe édifice construit par
(p. 180) Ptolémée. C’étoit le même qui renfermoit cette fameuse bibliothèque, si nombreuse dans un tems
où les livres étoient si rares.
Ce qu’Alexandrie offre aujourd’hui de plus remarquable, c’est l’obélisque de Cléopatre et la colonne de
Pompée. L’obélisque de Cléopatre est encore debout en entier : le nom qu’il porte et les magnifiques ruines
qui l’environnent, font présumer que le palais de cette reine, connu aussi sous le nom de palais de César, en
étoit peu éloigné. Un obélisque est une grande pièce de marbre à quatre faces et qui se termine en pointe.
Celui de Cléopatre est un des plus grands qui se trouvent en Egypte. Un monument peut-être encore plus
digne de l’attention des curieux, est la fameuse colonne de Pompée. Il n’est cependant pas certain qu’elle ait
été élevée en l’honneur de ce Romain célèbre, ou à celui de Titus et d’Adrien, qui l’un et l’autre voyagèrent
en Egypte. La hauteur de la colonne est de cent quatorze pieds ; le fust seul a quatre vingt-huit pieds neuf
pouces de haut : il est de marbre granit rouge, et d’une seule pièce. Le chapiteau est (p. 181) d’un autre
morceau de marbre, et le piédestal d’une pierre grise qui ressemble assez au caillou pour la dureté et le
grain. »
642 Bouillet, M.-N. et Chassang, A., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, 1878, p. 1409.
- 734 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
WILLIAM GEORGE BROWNE (du 10 janvier au 24 février 1792 et du ? au 1er mai 1792)
Browne, W. G., Nouveau voyage dans le Haute et Basse Égypte, la Syrie, le Dar Four, où aucun Européen
n’avoit pénétré, Paris, 2002.
William George Browne naît à Londres en 1768. À 17 ans, il est envoyé au collège d’Oxford. Après avoir lu
le récit de voyage de James Bruce et les découvertes de l’African Association, il décide de devenir
explorateur. Il se rend tout d’abord en Égypte et arrive à Alexandrie en 1792 avant de visiter l’oasis de Siwa.
Il passe le reste de l’année à étudier l’arabe et à examiner les ruines de l’ancienne Égypte. En 1793, il visite
les monts du Darfour, contrées totalement inconnues jusque-là. Il serait le premier Européen à s’être
approché aussi près des sources du Nil. Il revient à Londres en 1798 pour publier son récit et repart en 1800
pour visiter la Sicile, la Grèce et l’Asie Mineure. En 1813, alors qu’il quitte Tabriz pour Téhéran, il est
assassiné.643
p. 33-41 :
« Anciennes murailles et ruines d’Alexandrie. Ses deux ports. Ses réservoirs. Végétation. Antiquités.
Population. Gouvernement. Commerce. Manufactures. Anecdotes.
Mon passage des côtes de la Grande-Bretagne à celles d’Egypte, n’eut rien de remarquable, si ce n’est le
contraste entre l’hiver que je venois de laisser sur les premières, et l’été que je trouvai en approchant des
autres. Il n’y a que les marchands et les marins qu’un voyage par mer n’ennuie pas. Le nôtre fut exempt de
danger et ne dura que vingt-six jours ; mais aussi il fut dépourvu de tout ce qui pourroit amuser mes lecteurs.
J’arrivai en Egypte le 10 janvier 1792.
Alexandrie n’a que bien peu de restes qui puissent la faire reconoître pour l’un des principaux monumens de
la magnificence du conquérant de l’Asie, l’entrepôt du commerce de l’Orient, et le théâtre du luxe d’un des
triumvirs romains et de la célèbre reine d’Egypte. Sa décadence a, sans doute, été graduelle ; mais quinze
siècles ont fait insensiblement disparoître toute son ancienne opulence.
Les murailles qui entourent à présent Alexandrie, ont été bâties par les Sarrasins, et par conséquent elles ne
peuvent donner aucune idée de ce qu’étoit autrefois l’étendue de cette ville. Elles ont, en quelques endoits,
plus de quarante pieds de haut, et il n’y en a aucun où elles paroissent en avoir moins de vingt ; mais
quoiqu’épaisses et flanquées de tours, elles ne pourroient résister, si ce n’est à la cavalerie des mamelouks,
de qui seuls les habitans ont à craindre quelque attaque, ce qui fait qu’ils entretiennent ces murailles avec
quelque soin. Elles les défendent aussi contre les Arabes bédouins qui habitent une partie de l’année (p. 34)
les bords du canal, et enlèvent souvent le bétail dans les environs.
Les troupeaux peu nombreux dont les habitans d’Alexandrie tirent une partie de leur subsistance, paissent
l’herbe dont le voisinage du canal favorise la végétation, et sont reconduits tous les soirs dans la ville avant
qu’on ferme les portes ; on ne les laisse même pas sortir le jour, lorsqu’on sait qu’il y a des tribus ennemies
dans les environs.
Les murailles d’Alexandrie ne sont curieuses que par quelques tours qui tombent en ruine, et le seul reste de
l’ancienne ville qui soit digne de remarque, est une colonnade qu’on voit près de la porte du côté de
Raschid, et qui est plus qu’à moitié détruite. Cette colonnade s’appelle l’amphitéâtre du sud-est, parce
qu’elle est placée dans un lieu élevé, d’où l’on voit aisément la ville et le port. Il ne reste plus rien du singulier
faubourg nommé Nécropolis, c’est-à-dire, la cité des morts.
On ne peut croire que l’ancienne ville d’Alexandrie n’ait occupé que le petit aire que renferme sa nouvelle
muraille. La première enceinte étoit certainement bien plus étendue que celle qu’elle a aujourd’hui ;
cependant il n’y a qu’un coin de cet espace entre les deux ports qui soient rempli de maisons, le reste est en
partie occupé par des jardins qui produisent les fruits et les légumes analogues au climat, et auxquels les
gens du pays sont le plus accoutumés, et en partie par les immondices et les décombres qu’on y jette ;
d’ailleurs cette dernière partie ne peut être propre à la culture, par rapport aux ruines qui remplissent le sol
jusqu’à une très-grande profondeur. Quoiqu’il ne soit pas possible de connoître les anciennes limites de la
ville, ni d’assigner avec précision la situation de ses principaux édifices, elle conserve encore ses restes
informes de sa grandeur première. On voit de toutes parts des monceaux de décombres ; de sorte que
non-seulement les soins que les habitans prennent de creuser la terre, mais même de fortes ondées de
pluie, font découvrir des morceaux de marbre précieux, des fragments de sculpture et d’anciennes
médailles.
Le port situé à l’est, et appelé, je ne sais pourquoi, le nouveau port, n’a, suivant toute apparence, jamais été
un bon port, parce que le fond y est rocheux ; mais il y a en outre, le désavantage d’être exposé à certains
vents ; cependant parmi les navires européens qui le fréquentent, il peut y en avoir toujours une vingtaine en
sureté. Ils sont dans un étroit (p. 35) espace, qui ne fait qu’une très-petite partie du port, parce que dans tout
le reste de ce port, l’eau est très peu profonde ; ce qui semble, jusqu’à un certain degré, occasionné par la
grande quantité de lest qu’on y jette continuellement. Le gouvernement ne fait aucune attention à cet abus,
qui finira par rendre le port impraticable. Dans le dessin que Norden a tracé de ce port, on voit que l’eau va
jusqu’à l’entrée de l’ancienne douane ; plusieurs habitans d’Alexandrie disent l’y avoir vue, et des traces
encore subsistantes le prouvent ; mais à présent elle en est très éloignée. D’après cela on pourroit croire
que la mer se retire, et que la nature a contribué, plus que toute autre chose, au changement qui s’est opéré
dans le port.
Le vieux port, réservé aux seuls mahométans, est spacieux, quoiqu’il le soit pourtant un peu moins que le
nouveau. On y trouve par-tout de cinq à six brasses d’eau, et même, en quleques endroits, davantage.
L’ancrage s’étend le long d’une partie de l’isthme et de la péninsule. A son extémité orientale, où il semble
que doit avoir été anciennement le phare, on voit un fort en ruines qui est joint au continent par une
chaussée de pierre, dans laquelle on a pratiqué plusieurs arches pour affoiblir l’effet des eaux. Il y a aussi du
côté du couchant une muraille qui n’est pas moins dégradée que le fort.
Les maisons sont, pour la plupart, en maçonnerie, à deux étages, et très commodes pour le pays. Elles ont
des toits en terrasse : mais elles sont bien garanties de la pluie qui tombe de tems en tems pendant
l’automne.
Les grandes et profondes citernes construites à Alexandrie pour recevoir l’eau du Nil, et la conserver
pendant le décroissement annuel du fleuve, étoient probablement en très-grand nombre, et ce nombre
s’étendoit d’une extrémité de la ville à l’autre ; mais aujourd’hui il n’y en a plus que sept en état de servir.
Elles contiennent assez d’eau pour l’usage des habitans ; et comme elles sont un peu éloignées des
maisons, une petite partie de la classe indigente tire sa subsistance du transport de l’eau. On la charrie sur
des chameaux, et ce que porte un de ces animaux se vend quatre ou cinq paras644.
(p. 36) Les toits des citernes sont supportés par une très-épaisse charpente, qui vraisemblablement est
aussi ancienne que les citernes mêmes ; car on ne peut guère penser que les modernes habitans
d’Alexandrie aient entièrement changé une partie si essentielle de ces réservoirs, et substitué du bois à la
pierre dans un lit où l’un est très-rare et l’autre très-abondant.
La ville d’Alexandrie n’est que peu élevée au-dessus du niveau de la mer, et il semble très-difficile de la
mettre en état de résister long-tems aux attaques d’un ennemi.
L’on trouve en plusieurs endroits d’Alexandrie une couche végétale légère, et propre à toute espèce de
culture : mais cette couche y a été sans doute apportée ; car le sol naturel y est composé de pierre et de
sable, et par conséquent d’une stérilité absolue. Les jardins y produisent quelques oranges et quelques
citrons. Les dattes qu’on y recueille sont bonnes, mais non de la première qualité, et cependant leur culture
est la plus lucrative pour le propriétaire. Elle a encore un autre avantage, c’est que le verd des dattiers, dont
les jardins sont remplis, soulage l’oeil que fatiguent la blancheur des maisons et la sécheresse d’un sol
sablonneux.
Toutes les herbes potagères et les racines qu’on cultive en Angleterre, croissent très-bien à Alexandrie
lorsqu’on a soin de les arroser. Les arbres fruitiers qui m’ont paru y être indigènes, sont le nerprun645 et le
caffier, que les gens du pays appellent Kischné, et qui se trouve aussi dans l’Amérique méridionale. Le
premier porte un fruit de la grosseur d’une cerise, et ayant également un noyau, mais ressemblant plus à la
pomme par la couleur et par le parfum646.
Parmi les principaux monumens de l’antiquité qui restent à Alexandrie, ceux qui ont éprouvé le moins de
dégradation sont la colonne, qui porte improprement le nom de Pompée647 et l’Obélisque648. L’inscription
gravée sur la colonne est en partie effacée, et on n’y peut même plus lire tout ce que Pococke en a autrefois
copié.
Il y a dans la grande mosquée un ancien sarcophage de marbre serpentine, qui sert aujourd’hui de citerne. Il
ressemble beaucoup à celui (p. 37) qui est au Caire, et que Niebuhr a décrit avec le plus grand soin. Il n’est
guère moins chargé d’hiéroglyphes, et il a en outre l’avantage d’être entier, et de point se ressentir des effets
du tems. On rapporte qu’un des fermiers de la douane, qui quitta l’Egypte il y a quelques années, s’étoit
arrangé avec les chefs du pays, pour charger sur un vaisseau européen ce précieux monument de
l’antiquité, dans le dessin d’en faire présent à l’empereur d’Allemagne. Mais la nuit où l’on devoit
l’embarquer, le secret fut découvert, et les habitans d’Alexandrie s’assemblèrent en tumulte pour s’opposer à
ce qu’on violât la propriété d’une mosquée. Il fallut donc renoncer à emporter le sarcophage, que depuis on
garde avec tant de vigilance, qu’il est devenu difficile pour un européen de le voir ; et c’est ce qui est cause
que je ne décris pas d’une manière plus détaillée ce monument qui semble avoir presque échappé à
l’observation des voyageurs qui m’ont précédé.
La population d’Alexandrie est composée de mahométans de diverse nation, d’un grand nombre de
chrétiens grecs, qui ont une église et un couvent, où vivent trois ou quatre moines, et qui est agréablement
situé dans la partie la plus élevée de la ville, où sont les jardins ; d’arméniens, qui ont aussi une église, et de
quelques juifs, à qui on a accordé la permission d’avoir une synagogue. Je crois que toute cette population
ne s’élève à guères moins de vingt mille ames649 ; cependant je n’ai pas assez long-tems resté dans le pays
pour pouvoir l’assurer d’une manière positive.
Les franciscains de la Terre sainte ont à Alexandrie un couvent occupé par trois ou quatre d’entre’eux. Les
consuls et les négocians européens ont leurs maisons toutes près l’une des autres, dans l’est de la ville et
sur le bord de mer. Ils ne font société qu’entr’eux, portent l’habit de leur nation, vivent absolument comme en
Europe ; et s’ils sont troublés, ce n’est jamais que par leurs querelles particulières.
Il est certain que les habitans d’Alexandrie n’ont pas la réputation d’aimer les étrangers ; mais je crois qu’en
général ils ne se permettent quelque malhonnêteté à leur égard, que quand ils sont provoqués ; et peut-être
se trouvent-ils aussi souvent dupes des marchands francs, que ceux-ci le sont des courtiers et autres agens
du pays que leur affaire de commerce les obligent d’employer.
(p. 38) Le commandement du fort et du peu de troupes qu’il y a dans la ville, est confié à un sardar, qui
tantôt a le titre de caschef, tantôt n’est qu’un officier inférieur des mamlouks. Le gouvernement civil est entre
les mains des habitans. Le cadi ou principal magistrat est un arabe nommé à cette place par le
grand-seigneur ; les autres magistrats sont les scheiks de quatre sectes et les imams des deux principales
mosquées. On peut observer à cette occasion, que dans l’Orient les principaux magistrats sont toujours de
l’ordre sacerdotal.
Sous le règne des Ptolémées, les revenus d’Alexandrie s’élevoient à douze mille cinq cents talens, ce qui en
évaluant le talent à 193 liv. 15 sols sterl. ne fait guère moins de deux millions et demi sterl. Aujourd’hui on
croit que ces revenus n’excèdent pas 4500 bourses ou 225000 liv. sterl.
Le commerce d’Alexandrie est plus considérable que celui de Damiette. Tout ce que l’Europe envoie en
Egypte et tout ce qu’elle en tire passe par Alexandrie. Le bois de charpente, ainsi que celui qui sert à la
construction des vaisseaux, et qu’on porte à Alexandrie, sort de Candie et des autres îles de l’Archipel. Le
cuivre travaillé ou brut y est porté de Constantinople, et la quantité est très considérable. Le café, le riz, les
cuirs non tannés partent non seulement d’Alexandrie, mais des autres ports de l’Egypte. Le passage de tant
de marchandises tient ordinairement les habitans dans une activité très-analogue à leur caractère ; et si
quelque cause enchaîne et les force de rester oisifs, on ne peut pas dire que ce soit leur faute.
La navigation d’Alexandrie à Rosette se fait sur de petits bateaux, qui portent depuis quinze jusqu’à
cinquante tonneaux ; et lorsque les marchandises sont arrivées à Rosette, on les embarque sur des bateaux
d’une autre forme pour les transporter au Caire.
Parmi les productions de l’Orient, dont les négocians européens prennent une grande quantité en retour des
marchandises qu’ils portent à Alexandrie, on distingue le safran qu’on cultive en Egypte, et le séné, qui vient
principalement par la voie de Suez, mais dont une partie est receuillie en Nubie, et même près de la
première cataracte du Nil.
L’Europe a fourni long-tems à l’Egypte environ huit cents balles de drap par an ; mais lorsque j’ai quitté le
pays, ce commerce étoit beaucoup diminué à cause des obstacles qu’y opposoit la guerre des (p. 39)
Européens ; et le prix auquel étoit monté le drap, obligeoit beaucoup d’égyptiens de lui substituer les étoffes
du pays. Livourne fournit à Alexandrie du corail travaillé, et Venise de la verroterie.
Les habitans d’Alexandrie sont remarquables par la facilité avec laquelle ils parlent plusieurs langues ; mais
l’arabe dont ils se servent est mêlé de beaucoup de mots tirés du turc et d’autres idiomes.
Parmi leurs traits caractéristiques, les habitans d’Alexandrie ont conservé cet esprit de persévérance et cette
adresse qu’a remarquée en eux un ancien historien650. Par exemple, quand pour garantir leurs maisons des
dégâts que la mer peut y faire, ils veulent couper en deux une ancienne colonne de marbre de trois ou
quatre pieds de diamètre, ils y font une entaillure d’un demi-pouce de profondeur, et qui s’étend sur un
douzième de la circonférence, puis ils mettent à chaque extrémité de l’entaillure un morceau d’acier de la
grandeur d’une pièce d’argent de cinq francs, et ils enfoncent un coin dans le milieu. Pendant ce tem-là, cinq
ou six morceaux d’acier semblables aux premiers, sont placés à égale distance autour de la colonne, et on
les y fait entrer à petits coups de marteau. Par ce moyen la colonne est partagée régulièrement et en
très-peu de tems.
L’on fabrique à Alexandrie des lampes et des phioles de verre verd et de verre blanc. L’on y emploi du
natrun au lieu d’autre alkali, et la plage basse des côtes d’Egypte fournit d’excellent sable.
Il y a quelque tems qu’il s’éleva une querelle entre les habitans d’Alexandrie et le gouvernement, à
l’occasion de la conduite des chrétiens syriens qui étoient chargés de la douane. Les habitans d’Alexandrie
ne sont pas les plus dociles de tous ceux qui vivent sous le joug des mamlouks, et leur situation
topographique et quelques autres circonstances les ont souvent enhardis à résister aux ordres du
Gouvernement. Ils affectent, sur-tout aujourd’hui, de considérer les beys qui dominent comme des
usurpateurs rebelles à l’autorité de la Porte. Aussi chaque parti s’attache constamment à profiter des
moindres fautes de ses adversaires. Les beys veulent étendre sur les habitans d’Alexandrie le despotisme
qu’ils exercent sur le reste des Egyptiens, et les habitans d’Alexandrie cherchent à perpétuer la dépendance
mitigée ou l’autocratie imparfaite dans laquelle, à force de subterfuges et d’expédiens, ils se sont jusqu’à
présent maintenus.
(p. 40) Les affaires étoient dans cet état quand Mourad-bey, sous la juridiction duquel étoit le district
d’Alexandrie, donna l’ordre de fermer les magasins publics651 où se fait le principal commerce. Un caschef
fut envoyé pour faire exécuter cet ordre ; mais il n’étoit point accompagné de soldats, et cependant
Mourad-bey l’avoit chargé d’arrêter et de conduire au Caire le scheik Mohammed el Missiri, l’un des
premiers mullas, parce que ce sheikh s’étoit toujours montré le principal opposant aux volontés des beys.
J’ai su aussi qu’il étoit très-distingué par son esprit et par son éloquence.
La plupart des habitans s’étant assemblés dans la principale mosquée, résolurent de contraindre le caschef
à sortir de la ville. Ils se déterminèrent en même-tems à chasser le sur-intendant de la douane, qui s’étoit
rendu odieux par toute espèce de fraudes et contre lequel on avoit souvent porté des plaintes au bey.
Quelques membres de l’assemblée furent chargés d’aller avertir le caschef et le sur-intendant de ne pas
rester dans la ville jusqu’à la nuit, sous peine de mort. Mais le peuple étoit trop impatient pour leur laisser un
aussi long délai, et ils furent obligés de partir soudain, le caschef par terre, et le sur-intendant par mer.
Aussitôt on s’occupa à réparer les murailles de la ville, à y placer du canon, et à mettre tout en état de
défense. Le scheik Mohammed conseilla aux habitans de se diviser en districts, ce qui fut exécuté. On
décida en outre que tous ceux qui avoient le moyen d’acheter des armes s’en procureroient, et que ceux qui
ne pouvoient pas en acheter seroient armés aux dépens du public. Environ un mois après, on apprit qu’un
corps de troupes, commandé par deux caschefs, marchoit contre Alexandrie pour faire rentrer les habitans
dans le devoir. Dès que les Alexandrins surent que cette troupe étoit à Rosette, ils envoyèrent au-devant
d’elle pour lui annoncer que si elle venoit sans intentions hostiles, elle seroit reçue amicalement ; mais que si
elle devoit exercer contre eux quelque violence, tous les habitans s’opposeroient à son entrée. L’un des
caschefs étoit celui qui avoit été expulsé de la ville ; l’autre étoit un homme du premier rang, et avoit occupé
quelque tems la place des Yenktchery Aga. Les domestiques de ce dernier, au nombre d’environ deux cents
gens de pied, composoient toute leur suite ; par conséquent leurs forces étoient très-peu considérables.
(p. 41) Le caschef déclara qu’il n’avoit d’autre dessein que de certifier que les coeurs des habitans étoient
toujours attachés au Gouvernement, et n’avoient point l’intention de lui faire la guerre, comme Mourad-Bey
avoit été porté à le croire, en apprenant qu’ils s’étoient mis en état de défense. Il leur conseilla en
même-tems de donner une preuve de leur amour pour la paix, en députant au Caire trois ou quatre
d’entr’eux, pour expliquer aux beys le sujet dont ils avoient à se plaindre, et pour préparer les moyens de
vivre en bonne intelligence avec eux.
Ce conseil ne fut pas suivi, et le caschef n’en donna point d’autre. Au bout d’une quinzaine de jours il quitta
Alexandrie, n’ayant reçu des habitans qu’un présent de très-mince valeur, et quelques bagatelles que les
marchands européens lui offrirent en considération de sa dignité. Ainsi se termina cette querelle, sur laquelle
je me suis peut-être trop étendu, mais qui jette quelque lumière sur la situation et le caractère du
gouvernement des mamlouks. »
p. 55 :
« Après avoir passé un mois à me rétablir de la maladie que m’avait occasionnée mon excursion dans
l’Ouest, je me préparai à quitter de nouveau Alexandrie. Pendant plusieurs jours, les vents empêchèrerent
qu’il ne partît des bateaux pour Rosette ; mais cela ne me contrariait nullement. Je préférais toujours
voyager par terre, parce que c’était le moyen de faire des observations plus nombreuses et plus
intéressantes ; et ce qu’on disait des Bédouins qui infestaient le chemin de Rosette, ne me détermina pas à
sacrifier l’avantage de voir le pays. Je me mis donc en route le premier mai. J’étais à cheval et je fus quatre
heures à me rendre au village d’Abou-kir.
En sortant d’Alexandrie, on fait environ deux milles au milieu des vestiges d’anciens édifices, mais dont
aucun ne mérite d’être remarqué. On voit aussi beaucoup de dattiers croissant sur les bords du canal, et
assez d’herbre pour nourrir de petits troupeaux qui appartiennent aux habitants d’Alexandrie. »
- 735 - 739 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
GUILLAUME-ANTOINE OLIVIER (du 3 octobre 1794 à mai 1795)
Olivier, G.-A., Voyage dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant
les six premières années de la République, Paris, 1804.
Guillaume-Antoine Olivier naît en 1756 près de Fréjus (Var). Il est reçu docteur en médecine à l’âge de
17 ans. Berthier de Sauvigny, intendant de Paris, lui permet de diriger l’énumération des productions
naturelles de Paris. Plusieurs mémoires sur la géologie, la minéralogie, ainsi que sur les plantes, les
quadrupèdes et les insectes sont ainsi rédigés. Plus tard, Jean-Baptiste Gigot d’Orcy, receveur général des
finances possédant un cabinet d’histoire naturelle, propose à Guillaume-Antoine Olivier de mettre à jour une
histoire générale des insectes. Mais la révolution le force à suspendre cette entreprise. En 1794, le ministre
Rolland envoie une ambassade, composée de Guillaume-Antoine Olivier et Jean-Guillaume Bruguière, au
roi de Perse pour lier des relations avantageuses au commerce de France. Notre voyageur revient à Paris
en 1798 en rapportant de nombreuses collections sur toutes les parties de l’histoire naturelle. En 1800, il est
nommé membre de l’Institut. Quatre ans plus tard, il publie son récit de voyage qui obtient un grand succès.
Il meurt en 1814.652
p. 1-44 :
Départ de Candie. Arrivée à Alexandrie. Situation de la ville moderne ; étendue de ses ports. Population,
moeurs et industrie de ses habitans. Gouvernement, milices et tribunal de justice.
« Les observations que nous avions à faire dans l’île de Crète étant terminées au commencement de
brumaire an 3, nous nous rendîmes à Candie afin de profiter du premier navire français qui ferait voile de ce
port pour l’Égypte, où nous voulions arriver avant l’hiver. Le capitaine Jauvat, de Saint-Tropès, qui chargeait
alors du savon, des raisins secs, du miel et divers fruits pour Alexandrie, nous reçut à son bord, et nous
emmena, le 2 frimaire, à Dia, où il alla mouiller en attendant que son chargement fût complet.
Nous fîmes voile de Dia le 8 frimaire an 3, vers les huit heures du matin, avec un vent de nord-ouest si
faible, que nous eûmes de la peine à sortir du port. La chaloupe nous remorqua pendant quelque tems : une
bouffée de vent nous poussa ensuite lentement près d’un îlot sur lequel nous apperçûmes de la verdure.
Comme le vent cessa alors entièrement de souffler, le capitaine envoya la chaloupe et quelques matelots
sur cet îlot, tant pour pêcher à la ligne et prendre des oursins, que pour ramasser les plantes qui s’y
trouvaient.
Nous restâmes en calme plus d’une heure : au premier souffle qui nous vint du nord-ouest, le capitaine fit
signal aux matelots de revenir à bord. La pêche n’avait pas été abondante ; mais l’équipage fut regalé d’une
grande quantité de poireaux qui croissent naturellement sur cette petite île, et nous eûmes le plaisir de voir
la luzerne arborescente en fleur.
Nous côtoyâmes la partie septentrional de Crète. Le tems était fort beau et l’horizon très-pur. Nous eûmes
pendant toute la journée le plaisir de considérer les points de vue très-agréables que présente cette partie
de l’île. Nos regards se fixaient alternativement sur ces vallons arrosés, sur ces collines boisées, sur ces
coteaux verdoyans où croissent l’olivier, le chêne et le caroubier ; sur ces terres incultes où le myrte, le
lentiste et le térébentine ont pris la place que la vigne occupoit autrefois.
Nous étions au coucher du soleil devant la rade de Mirabel ; nous nous trouvâmes le lendemain matin sur le
cap Sidera. Le vent tourna au nord dès que nous eûmes dépassé ce cap ; il fraichit même un peu, et nous
permit de faire une lieue et demie par heure. Nous eûmes bientôt doublé le cap Salomon, et après midi nous
perdîmes l’île de vue. Notre navigation fut très-heureuse les jours suivans : le ciel fut toujours beau, le vent
peu fort à l’ouest ou au nord, et la mer faiblement agitée. Le 12 au soir, avant le coucher du soleil, on
apperçut du haut du grand mât la tour des Arabes, située à dix lieues à l’ouest d’Alexandrie. Nous
dirigeâmes aussitôt à l’est-nord-est, et le lendemain matin, le 13 frimaire, nous reprîmes notre route, et nous
entrâmes dans le port neuf d’Alexandrie à une heure après midi. Le sol de l'Égypte est uni ; la côte est
basse, et l'atterrage est dangereux. Les navigateurs, en hiver, ne s'avancent qu'avec précaution et la sonde
à la main ; ils craignent avec raison qu'un vent trop fort de nord ou de nord-ouest ne les fasse échouer sur
une terre qui se dérobe pour ainsi dire à la vue ; ils sont attentifs à observer la couleur des eaux, qui leur
apprend s'ils sont à l'est ou à l'ouest d'Alexandrie : elles sont blanchâtres et un peu troubles à l'est à cause
du Nil ; elles sont transparentes et limpides à l'ouest. En jetant la sonde vis à vis du Delta, chaque brasse de
profondeur qu'elle leur donne est évaluée à un mille de distance de la terre. En face d'Alexandrie, au
contraire, et à l'ouest de cette ville, il faut être près des côtés pour trouver le fond. Une troisième observation
qui n'est point à négliger, c'est que les terres à l'est d'Alexandrie présentent presque partout des dattiers,
tandis qu'elles sont nues et incultes à l'ouest.
Le soleil leur apprend encore s’ils sont vers le Delta ou vers le golfe des Arabes ; car si, après avoir passé le
32e degré de latitude avec un vent favorable, ils ne reconnaissent pas bientôt la côte, ils doivent juger alors
qu’ils sont à l’ouest d’Alexandrie, et qu’ils ne tarderont pas à découvrir le cap Caroubier ou la tour des
Arabes. De celle-ci au cap Durazo le terrain va en s’élevant : la côte est blanchâtre et les terre sont partout
incultes.
Les reconnaissances d’Alexandrie sont les deux monticules factices qui se trouvent dans l’enceinte de la
ville arabe, et la colonne de Sévère, placée au-delà sur un terrain un peu élevé.
La vue d’Alexandrie et de ses environs n’a sans doute rien d’étonnant pour celui qui vient des côtes de
France, d’Italie ou de quelque port de l’Empire othoman ; cependant cette ville qui semble sortir du sein des
eaux, les minarets qui se confondent avec la colonne de Sévère, les palmiers qui se dessinent parmi eux,
les deux monticules qui s’élèvent comme deux montagnes sur un sol plat, la presqu’île du phare et son
château, les aiguilles de Cléopâtre et les murs de l’ancienne ville arabe, tout présente un coup d’oeil, sinon
magnifique, du moins très-pittoresque.
Il est vrai qu’on arrive en Égypte avec l’imagination fortement préoccupée et le coeur extrêmement ému. On
est impatient de voir une cité si justement célèbre : on veut mesurer l’espace qu’elle occupoit dans le temps
de sa gloire, et contempler les restes des monumens qui ont fait si long-tems l’admiration des Grecs et des
Romains. L’oeil cherche avec empressement dans le port immense que les Européens fréquentent, et dans
celui que le fanatisme réserve aux Musulmans, les navires qui devraient y déposer les productions de
l’Europe, et y charger les richesses de l’Orient. On est curieux de voir ce canal qui apporte annuellement le
tribut du fleuve, et ces citernes qui conservent et distribuent leurs eaux au gré des habitans.
Occupé de ces idées, le voyageur descend à terre : il ne voit pas une foule d’Arabes presque nus qui sont
autour de lui. Toute son attention se porte sur un nombre prodigieux de tronçons de colonnes de porphyre,
de granite et de marbre qu’un peuple ignorant a confusément entassés le long de la mer pour opposer une
barrière aux vagues, et former un quai spacieux, assez mal entretenu.
Les matelots de notre navire nous conduisirent à la maison qu'habitaient le proconsul de la République et
tous les négociants français : elle est à la partie méridionale du port neuf, vers l'extrémité de la ville. C'est un
vaste bâtiment carré, au milieu duquel est une grande cour, où nous remarquâmes sur leurs affûts deux
pièces de canon dirigées vers la porte d'entrée : on aurait pris celle-ci pour la porte d'une forteresse, tant elle
était épaisse. Cet appareil menaçant, qui ne s’accorde guère avec l’humeur pacifique des négocians, a paru
sans doute nécessaire dans un pays où la populace, fanatique et féroce, est toujours prête à se soulever
contre les Européens, et se porter à toutes sortes d’excès contre eux. Il faut alors que la crainte retienne les
plus hardis, ou que les obstacles donnent le tems à la force armée d’accourir et de dissiper l’atroupement.
Les premiers jours de notre arrivée furent employés à parcourir la ville arabe, dont il ne reste aujourd’hui que
l’enceinte, et la ville moderne bâtie sur la digue qu’on avait élevée pour joindre le continent à la petite île de
Pharos. Cette digue forma deux vastes ports capables de recevoir tous les navires que le commerce le plus
étendu pourrait y amener : celui de l’ouest se nomme le port vieux ; l’autre est connu sous le nom de port
neuf ou de grand port. Comme les eaux du Nil donnent à celles de la mer, au devant d’Alexandrie, une
direction de l’est à l’ouest, le grand port se comble de jour en jour, et la digue a pris, de ce côté, un tel
accroissement, que les Turcs ont pu, des ruines de la ville arabe, y élever celle que nous voyons
aujourd’hui.
Le port neuf doit être plutôt regardé comme une rade que comme un port ; il est trop ouvert et trop exposé
aux vents du nord. D'ailleurs il n'a pas assez de fond pour recevoir les gros vaisseaux de guerre. Les navires
marchands mouillent le long du môle qui unit l'île de Pharos au rocher sur lequel le phare était placé. Les
bateaux du pays peuvent seuls mouiller le long du quai de la ville. Dans les mauvais temps un navire un peu
gros, surtout s'il est chargé, court le risque de toucher de sa quille contre le fond et de s'ouvrir. Un
incovénient plus grand encore, c’est que les navires sont obligés de se serrer et se placer sur plusieurs
rangées : leurs câbles sont croisés ; de sorte que si, par un coup de vent, les cables d’un navire cassent,
celui-ci peut entraîner son voisin, et de l’un à l’autre tous peuvent être dans le plus grand danger. On en a vu
périr plusieurs fois un grand nombre de cette manière. Nous avons été témoins, en pluviôse, de la perte d’un
navire français par un vent impétueux de nord-ouest ; il vint échouer dans le port, un peu au dessous du
pharillon.
Les Européens ne peuvent aller mouiller dans le port vieux : l’entrée leur est interdite. Le gouvernement et le
peuple s’y opposent également. Toutes les tentatives que l’on a faites à ce sujet ont été infructueuses. Les
vaisseaux de guerre peuvent en été mouiller à l’entrée du port neuf, à l’est du Diamant ; mais en hiver ils
doivent éviter les parages de l’Égypte, ou se résoudre à aller dans la mauvaise rade d’Aboukir, pour en
repartir le plus tôt possible. Un vaisseau de guerre français, obligé de relâcher à Aboukir à cause d’une forte
voie d’eau, obtint du gouvernement du Caire, par la voie du commissaire des relations commerciales, un
firman qui lui permettait d’entrer dans le port vieux afin de s’y réparer. Les ordres étaient très-précis et
conçus de la manière la plus forte ; mais le peuple d’Alexandrie s’y opposa avec tant d’opiniâtreté, que le
vaisseau fut obligé de mettre à la voile pour Malte, dans l’état où il se trouvait, au risque de périr dans la
traversée. Cette obstination de ne vouloir permettre l’entrée des vaisseaux européens dans le port vieux est
d’autant plus surprenante, qu’elle est contraire aux intérêts de la ville, puisque l’abord des bâtiments, en
hiver, serait plus considérable. Elle nuit d’ailleurs plus particulièrement aux marchands turcs, nolisataires de
presque tous les navires caravaneurs ; car il arrive souvent qu’ils sont en charge dans le port neuf, ou qu’ils
n’ont pas encore mis à terre leur cargaison lorsqu’ils se perdent par un mauvais tems.
Deux raisons principales s’opposent à l’admission des navires européens dans le port vieux ; la première,
c’est que la douane ayant tous ses magasins sur le quai du port neuf, les douaniers seraient obligés d’en
faire construire de nouveaux sur l’autre ; ce qui leur occasionnerait une dépense assez grande. Il est à
remarquer que les navires des Musulmans viennent ordinairement décharger leurs marchandises dans le
port neuf, et qu’ils ne vont dans l’autre que pour y passer la mauvaise saison. La seconde raison, est la plus
forte sans doute, c’est que l’ignorance, toujours crédule, a laissé accréditer un bruit que le fanatisme a
répandu. On a persuadé aux Alexandrins que, du moment où les navires européens seront reçus dans le
port des vrais Croyans, la ville ne tardera pas à être soumise aux Infidèles. On sent bien, d’après cela, que
la proposition que les négocians français ont faite quelquefois de construire à leurs frais les magasins de la
douane sur l’autre port, ne pouvait être acceptée sans soulever une populace fanatique et féroce, dont la
haine contre les Européens ne s’est que trop souvent manifestée. Les négocians d’ailleurs ne proposaient
de faire les avances des frais que nécessitait la construction des nouveaux magasins, qu’à la condition qu’ils
en seraient remboursés peu à peu sur les droits que paient leurs marchandises ; ce qui ne présentait pas à
la cupidité turque des avantages assez considérables.
L’île de Pharos, connue aujourd’hui sous le nom arabe de Ras-el-Tin ou cap des Figuiers, est devenue une
presqu’île depuis qu’elle fut unie au continent par une chaussée. Elle a plus de demi-lieue de longueur, et
elle présente un terrain blanchâtre, peu élevé, très peu fertile. Sous la couche de terre végétale, il y a une
roche tendre calcaire, semblable à celle de la côte. On sème sur cette presqu’île un peu de blé et on y
cultive quelques figuiers dont les fruits, à ce qu’on a dit, sont assez bons. Pour garantir ces arbres du vent
de mer qui les ferait périr ou qui en gâterait le fruit, on élève autour de chacun d’eux une palissade en
roseaux, que l’on répare soigneusement chaque année aux approches de la récolte. On voit tout le long de
la mer, dans la partie qui se trouve sur le vieux port, des ruines d’anciens édifices, parmi lesquelles on
distingue des citernes ; ce qui prouve que cette presqu’île était très-habitée autrefois, et que l’eau du canal
pouvait y parvenir.
On remarque pendant l’hiver, sur cette presqu’île, un bassin d’eau salée qui sèche au printemps, et fournit
en été du sel en abondance.
Le rocher sur lequel était bâtie la tour qui servait de reconnaissance aux marins pendant le jour, et qui avait
un phare pour les guider pendant la nuit, est uni à l’île de Pharos par une digue étroite, bâtie sur des brisans.
Au lieu de ce monument, regardé comme une des sept merveilles du monde, on voit sur ce rocher un
château à moitié ruiné, dénué d’artillerie, incapable de résister aux canons d’une simple corvette. Un peu
au-delà du phare, on remarque un autre rocher beaucoup plus petit, désigné par les marins sous le nom de
Diamant. Les navires qui entrent dans le port neuf ont soin de l’éviter, et de passer à l’est. Il serait à désirer
que la digue fût prolongée jusqu’au Diamant ; le port neuf deviendrait meilleur ; les vagues entreraient avec
moins d’impétuosité dans ce port par les vents d’ouest, de nord-ouest et de nord, et le mouillage serait un
peu plus étendu.
La population d’Alexandrie est évaluée à près de vingt mille habitans. Elle est un mélange de Sarrasins,
anciens conquérans de l’Égypte ; de Bédoins arabes, pasteurs et cultivateurs que la paresse ou le
libertinage a fait renoncer à la vie indépendante ; de Maugrebins maures ou arabes de la côte de Barbarie,
et d’un petit nombre de Turcs que le commerce a fait venir de Crète, de Rhodes et de Stancho. Il y a aussi
quelques Grecs depuis long-tems établis en Égypte, et quelques chrétiens originaires de la Syrie. On y
compte en outre trois cents Juifs et cent cinquante Européens.
Les Arabes d’Alexandrie ont un caractère qui leur est propre, et qui diffère à bien des égards de celui des
Turcs. Ils sont plus bruyants, plus communicatifs ; ils ont plus de vivacité, plus d'esprit et moins
d'éloignement pour les moeurs, les usages et la langue des Européens ; mais ils sont en général aussi
fanatiques, aussi méchant, aussi séditieux. Le plus léger mécontentement excite parmi eux des émeutes ; le
moindre prétexte leur fournit l’occasion d’accuser les Chrétiens, et d’en exiger des taxes plus ou moins
fortes. Aussi avides, aussi âpres au gain que les Turcs, ils se livrent presque tous à quelque industrie
particulière, parce qu’ils n’ont pas, autant qu’eux, la ressource du pillage et des avanies. La plupart sont
marins, et font les voyages de Rosette et du Caire : beaucoup sont employés au transport des
marchandises, au pilotage, au service du port et à tous les travaux que le commerce nécessite. Il y a parmi
ces derniers des plongeurs fort adroits que l'on accuse de percer quelque fois, pendant la nuit, le fond des
navires européens, pour avoir occasion de réparer eux-mêmes le dommage qu'ils ont fait. Ils attaquent
ordinairement les navires chargés et prêts à mettre la voile, parce qu'ils s'attendent que le capitaine
s'adressera à des plongeurs plutôt que de décharger son vaisseau ; ce qui serait long et
dispendieux. L’Arabe qui a fait le mal ne manque jamais de se présenter sur le champ moyennant cinquante
ou soixante piastres qu’on lui compte.
On nous a raconté qu'un capitaine italien, qui s'attendait à pareille friponnerie, fit mettre, quelques jours
avant son départ, des filets autour de son navire, dans lesquels un plongeur se trouva pris. Comme celui-ci
fut retiré mort des filets, cette affaire a eu des suites désagréables, tant pour le capitaine que pour la nation
à laquelle il appartenait, parce qu’en Égypte, ainsi que dans tout l’Empire othoman, rien n’excuse l’Infidèle
qui fait périr un Musulman.
La culture des terres aux environs d’Alexandrie est très-bornée, et confiée à des Arabes bédoins qui habitent
sous des tentes. Le terrain qui environne la ville est sec et aride. On ne cultive guère que les terres basses
qui sont entre le canal d’Alexandrie et le lac Maréotis, ainsi que les jardins qui se trouvent dans l’enceinte de
la ville arabe. Les terres voisines de la côte, depuis Aboukir jusqu’au Marabou et bien au-delà, sont peu
susceptibles de culture, ou ne le sont pas du tout.
Quoiqu'on ne doive pas regarder Alexandrie comme ville manufacturière, on y compte néanmoins deux
cents métiers pour la fabrication d'une étoffe légère de soie, que sert à vêtir les femmes et les enfants des
riches ; il y a en outre quatre cents métiers de toiles dites maugrébines, propres à faire des chemises, et
cinquante métiers d'une étoffe grossière de laine, dont les femmes du peuple s'enveloppent.
On fabrique huit mille maroquins rouges, que l'on regarde comme les meilleurs de l'Égypte ; ils passent
presque tous au Caire.
Il y a trente savonneries qui travaillent plus ou moins suivant le prix des huiles. La soude est abondante en
Égypte ; mais on est obligé de tirer les huiles de Crète, et quelquefois de la Syrie, de la Morée et de la côte
de Barbarie. Le savon est moins estimé que celui de Crète, et se vend à plus bas prix.
Alexandrie n’est à proprement parler qu’une ville d’entrepôt, où sont déposées les marchandises que
l’Égypte reçoit de l’Europe, de la Barbarie et de la Turquie, et celles qu’elle donne en échange, qui
proviennent de son crû ou qui sont apportées de la Nubie et de l’Éthiopie par les caravanes, ou de l’Yémen
et des Indes par les vaisseaux de la Mer-Rouge.
Damiette est l’entrepôt du commerce maritime de la Syrie avec l’Égypte : on y embarque aussi le riz destiné
pour Constantinople et pour toute la Turquie. Les navires mouillent en sûreté, pendant sept à huit mois de
l’année, dans la rade qui se trouve à l’ouest du fleuve ; mais ils ne s’y exposent guère pendant l’hiver. Les
bateaux du pays entrent dans le Nil lorsque le Bogas est libre, et ils vont décharger leurs marchandises à la
ville même, distante de plus de deux lieues de la mer.
Pendant long-tems Alexandrie a été en quelque sorte indépendante, et n’a reconnu ni l’autorité légitime de la
Porte ni celle que les Mameluks ont usurpée. Quoique le gouvernement du Caire y envoyât un commandant
militaire, et que les caravelles du Grand-Seigneur vînssent mouiller annuellement dans le port, le pouvoir
néanmoins est resté entre les mains des principaux officiers des mutéferricas, désignés sous le nom de
Schorbadgis ; quelquefois aussi il s’est concentré entre celles des scheiks ou gens de loi. Il est arrivé
plusieurs fois que des chefs de parti se sont rendus redoutables, et sont venus à bout de forcer les
magistrats à condescendre aux désirs d’un peuple mécontent et irrité. Mais depuis le règne d’Ali-Bey tout est
rentré dans l’ordre, et Alexandrie n’a plus obéi qu’aux officiers que le Caire y envoie.
Le premier de ces officiers est le serdar ou commandant des janissaires : il a la haute police de la ville ; il est
l'aga de la douane, et prend connaissance de toutes les contestations relatives au commerce. C'est lui qui
est directement chargé de protéger les Francs, de les mettre à l’abri de toute insulte, et de leur faire rendre
justice lorsqu’ils la réclament.
Le second est l'aga des châteaux : il est commandant en chef des mutéferricas ou milice arabe de la ville. Il
est logé au château situé à l'entrée du port neuf : il a l'inspection de ce port, et il retire la meilleure partie du
droit d'ancrage, auquel sont soumis tous les bâtiments qui viennent y mouiller.
Le troisième est le bey Kiayassi autrement nommé aga de la bannière : il commande dans le port vieux, et a
sous ses ordres tersanadgis, autre corps de milice arabe ; il a la garde de la ville pendant la nuit et
l'inspection des femmes publiques. Il perçoit un droit sur le vin, excepté sur celui que les Européens font
venir pour leur usage. Les gens du pays ne peuvent faire entrer ni vendre cette denrée sans sa permission.
C’est le pacha de Négrepont qui doit nommer à cette place ; mais comme le kiayassi qu’il envoie, est obligé
d’obtenir son firman du pacha du Caire, et que celui-ci est depuis long-tems à la merci des beys
commandans de l’Égypte, il s’ensuit que la place de Kiayassi-bey dépend d’eux aujourd’hui, et qu’ils
nomment ou font nommer quelqu’un qui leur soit dévoué.
Le quatrième est l'aga du pacha du Caire : il délivre les firmans aux capitaines des navires européens qui
chargent du riz ou du café pour la Turquie. (On sait qu'il est défendu de transporter ailleurs ces denrées.)
Depuis quelque tems le grand-douanier du Caire fait délivrer ces firmans par son préposé à Alexandrie, qui
tient compte à l’aga du pacha du produit de ces firmans ; et c’est depuis lors aussi que cette place est
souvent conférée au serdar des janissaires. Le cinquième est le serdar des azabs il n'a d'autre emploi aujourd'hui que de percevoir un droit sur les cuirs
qui viennent de l'intérieur de l'Égypte, dont il rend compte au douanier du Caire.
Le corps des janissaires est peu nombreux : il n'est composé que de cinquante hommes qui reçoivent leur
paye, et deux cent cinquante agrégés qui n'en reçoivent point. Les uns et les autres sont Turcs : ils ont la
garde de la douane, et font la patrouille pendant le jour. Le corps de milice le plus considérable est celui des
mutéferricas ou soldats proposés à la garde des châteaux : il y en a douze cents qui reçoivent leur paye, et
un plus grand nombre qui sont simplement agrégés, et qui ne reçoivent rien. La somme destinée à la paye
des mutéferricas du grand château, situé sur le rocher du phare, s’élève en tout à 2280 aspres par jour ;
celle du second château, qui donne sur la campagne, monte à 650 aspres, et celle du troisième château,
situé sur la presqu’île Ras-el-Tin au fond du port vieux, monte à 300 aspres.
Les officiers nommés schorbadgis sont au nombre de vingt-six pour le grand château, de quinze pour le
second, et de dix pour le troisième. Ces places, à la mort de ceux qui en sont pourvus, sont vendues au
profit du commandant ; mais chaque officier peut lui-même, de son vivant, transmettre sa place à son
successeur, et retirer une somme plus ou moins forte, suivant le grade qu’il a et la paye qu’il reçoit. Les
schorbadgis, qu'on ne peut destituer et qu'on n'ose envoyer au supplice lorsqu'ils se rendent criminels, sont
devenus très redoutables. À la tête du corps de milice le plus nombreux, ils ont la plus grande influence sur
les affaires publiques. On les a vus, dans toutes les occasions, exciter eux-mêmes les émeutes, et faire
mouvoir le peuple suivant leurs vues et leurs intérêts.
Le corps des azabs est sans force et sans considération, depuis qu'il a été réduit à un petit nombre
d'hommes, et qu’on a supprimé la paye qu’on lui donnait auparavant : le serdar ou commandant de ce corps
est le seul qui l’ait conservée.
Les tersanadgis sont au nombre de six cents : ils reçoivent par jour 2000 aspres, et ont un grand nombre
d’agrégés qui n’en reçoivent point. Nous avons dit que le kiayassi-bey était commandant.
La solde des milices d’Alexandrie et des autres villes de l’Égypte, ainsi que toutes les dépenses publiques,
est prises sur le tribut annuel auquel cette province est soumise envers la Porte othomane : il fut fixé, lors de
la conquête, à onze cents bourses de 25 000 médins653 chacune, qui doivent être prélevées sur les terres et
sur les douanes.
Le tribunal de justice est composé d'un simple cadi que la Porte change ou confirme chaque année ; d'un
naïb, arabe de la ville, et de plusieurs écrivains également arabes.
Il y a trois mouftis qui sont regardés comme orthodoxes, quoi qu'ils diffèrent entre eux sur quelques points
de doctrine et de jurisprudence : le premier est nommé maliki-mufti. Les opinions qu’il suit sont reçues des
habitans de la Mecque, de Médine, du Caire, d’Alexandrie et de la Barbarie. Le second est l’hannéfi-mufti :
ses opinions sont celles de la Porte et de la plus grande partie des Turcs et des Beys du Caire. Le troisième
est le chafy-mufti : ses opinions sont adoptées en Syrie, et par le plus grand nombre des habitans de
Rosette et de Damiette. Il y a un quatrième mufti au Caire, dont les opinions sont suivies dans l’Yémen, à
Bassora, à Bagdat, et par plusieurs habitans de la Romélie.
On compte dans Alexandrie 46 mosquées du premier rang et 42 du second.
Des Arabes du Désert : querelles survenue entre eux et les Alexandrins. Description de l’enceinte arabe.
Des aiguilles de Cléopâtre. Des monticules factices. Des citernes et des jardins.
Les terres incultes et arides qui s’étendent au loin à l’occident et au midi d’Alexandrie, sont depuis bien des
siècles le domaine de quelques tribus d’Arabes pasteurs qui errent péniblement, en été, avec leurs
troupeaux dans les déserts de la Lybie, et qui se transportent en hiver aux environs des côtes maritimes et
sur les bords du lac Maréotis, pour consommer les herbages qu’y font pousser les premières pluies
d’automne.
Ces Arabes nomades vivent ordinairement en paix avec les Alexandrins, et viennent à diverses époques
échanger leur beurre, leur fromage et leur superflu de leurs troupeaux contre de l’orge, des légumes, des
étoffes et quelques métaux. Mais à notre arrivée en Égypte, la bonne harmonie qui régnait depuis long-tems
entre les citadins et ces habitants des déserts avait été troublée par le supplice inattendu de deux de ces
derniers, accusés de divers crimes. La guerre venait de s’allumer à cette occasion ; les portes de l’ancienne
ville avaient été fermées, et l’on se disposait à repousser toute attaque qui serait faite par des hommes, que
l’on regarde avec raison comme peu redoutables. Les Bédoins qui habitent sous des tentes, et qui cultivent
la terre au nord du lac, étaient entrés dans la ville, et l’on voyait sans inquiétude, du haut des murs, des
cavaliers qui rodaient quelquefois au loin dans l’intention de surprendre quelque habitant. On n’était point
tenté de marcher contre eux, parce qu’on sait qu’ils fuient au moindre danger, et qu’on ne saurait les
atteindre dans la vaste étendue de leurs déserts.
Cet état de guerre ne pouvait durer long-tems : il ne convenait ni aux uns ni aux autres. Les Arabes pasteurs
n’avaient plus le même débouché pour la vente de leurs denrées, et ne savaient où s’adresser pour celles
qui leur étaient nécessaires. Les Alexandrins, de leur côté, étaient obligés de tirer par mer toutes leurs
subsistances ; de sorte que l’intérêt faisant taire tout ressentiment et toute animosité, on en vint à des
explications. On se fit des présens de part et d’autre : on promit d’oublier ce qui venait de se passer, et la
paix fut conclue. Nous avons vu venir peu de temps après de ces déserts une caravane qui apportait des
dattes, du beurre et du fromage, et amenait en même tems quelques chevaux.
Pendant que les portes furent fermées, nous parcourûmes plusieurs fois l’enceinte de la ville arabe, et nous
observâmes avec attention les restes des monumens qui y sont répandus. Elle a trois mille six cents pas
ordinaires ou mille cinq cents toises de l’est à l’ouest, et mille deux cents ou cinq cents toises du nord au
sud. Ce qu’il y a de plus remarquable, ce sont quelques restes d’anciens édifices, les deux obélisques
connus sous le nom d’Aiguilles de Cléopâtre, les deux monticules factices, les citernes, et les jardins que les
modernes Alexandrins y vont cultiver.
Lorsqu’on parcourt la ville arabe, on est frappé de l’élévation du sol et des décombres que l’on voit : partout
des amoncellemens considérables attestent les fouilles nombreuses qu’on y a faites pour en retirer les
débris, dont la ville moderne a été construite. On rencontre partout des ouvriers occupés à déblayer, à trois
ou quatre toises de profondeur, les restes des fondemens des anciens édifices. On fait de la chaux avec les
marbres et les pierres calcaires : les autres matériaux sont employés aux nouvelles constructions. Les
colonnes un peu grosse sont sciées, et converties en meules de moulin : celles de moyenne grosseur
servent à soutenir les galeries des maisons, et sont toujours placées sans art, sans goût : jamais on ne voit
deux colonnes égales pour la hauteur, l’épaisseur et la matière. Le chapiteau sert bien souvent de base, et
quelquefois un morceau de bois informe est adapté au tronçon d’une colonne de la plus grande beauté.
Les Arabes et les modernes Alexandrins ont tellement detruit les anciens monumens grecs, qu’on doit être
surpris de voir encore debout trois colonnes de granit thébaïque, qui faisait partie de cette superbe
colonnade qui régnait tout le long de l’ancienne rue de Canope. On voit tout près de là quelques restes du
lycée, formés de briques liées par un mortier très-dur. Ces restes annoncent par leur étendue, la majesté de
l’édifice auquel ils ont appartenu ; mais on ne peut s’en faire une idée juste, parce que ces ruines sont
couvertes en grande pârtie par des terres rapportées.
Les obélisques situés près du port neuf sont des masses trop considérables, et leur matière est d’ailleurs
trop dure pour qu’ils puissent être entamés. Ils existeront sans doute encore long-tems dans cet état, et tout
ce qui les entoure sera détruit avant qu’ils présentent des changemens sensibles. L’un d’eux est encore
debout ; l’autre est renversé, et caché en partie sous le sable. Ils sont de granite rose, et couverts de
hiéroglyphes depuis leur base jusqu’à leur sommet. Ils sont parfaitement bien conservés sur trois faces,
mais un peu endommagés sur celle du nord. L’obélisque qui est encore debout a sa base dans le sable, de
sorte qu’on ne peut reconnaître la manière dont il est posé. Mais à en juger par celui qui est renversé, et au
dessous duquel on remarque quatre cubes de bronze, ainsi que l’obélisque égyptien de la place de
l’Hyppodrome de Constantinople. Il serait curieux de faire déblayer la base de celui qui est debout, autant
pour s’assurer de ce fait, que pour connaître le piédestal sur lequel il a été posé, et par ce moyen le véritable
niveau du sol de l’ancienne ville, que tant de ruines successivement entassées paraissent avoir élevé de
plusieurs pieds.
Il n’est pas douteux que les deux monticules que l’on voit dans l’enceinte de la ville arabe n’aient été formés
par la main de l’homme, puisqu’on y remarque des fragmens de toute espèce de poterie, de brique, de
marbre, de granit et de porphyre. Mais quel a été l’objet de leur formation ? A-t-on seulement voulu entasser
des décombres pour déblayer le terrain ? ou bien leur formation a-t-elle eu pour motif de servire de
reconnaissance aux marins, comme ceux du sud de la ville, moins élevés et plus étendus, eurent pour objet
peut-être de la mettre à couvert du vent du sud.
Si les Arabes avaient eu seulement l’intention de déblayer le sol de l’ancienne ville, il était plus simple de
jeter les décombres dans la mer, ou de les laisser hors de l’enceinte de leur ville, plutôt que de les entasser
à grands frais dans l’intérieur. Il nous paraît probable qu’ils ont voulu, à l’imitation des Grecs qui les avaient
précédés, avoir dans leur ville des points élevés pour guider les marins, et pour découvrir au loin, de leur
sommet, les flottes ennemis qui pouvaient se montrer sur leur parages. On sait que les anciens Alexandrins
avaient, sur une tour de près de quatre cents pieds de haut, un phare pour guider les navigateurs sur une
côte basse, fréquente en naufrages.
Parmi les fragments dont nous venons de parler, nous avons remarqué des morceaux cassés de porcelaine,
qui s'y trouvent en assez grande quantité. En les examinant, on voit que l'art de la fabrication de la
porcelaine n'était pas si avancé en Égypte, qu'il l'est aujourd'hui en Europe. La pâte n'a point de blancheur et
la compactibilité de celle de la Chine : elle a un oeil grisâtre, et la couverte n'est que du verre fondu : elle est
inégale dans son épaisseur, écaillée et d'une teinte verdâtre.
Des savans antiquaires ont prétendu que les vases murrins étaient des vases de porcelaine. Pline, en
annonçant le prix excessif que le luxe y avait mis dans le tems où toutes les richesses de l’Orient refluaient
vers Rome, n’a pu cependant indiquer l’origine de ces vases précieux. Il n’est pas douteux que si les
Égyptiens avaient su fabriquer à cette époque de la porcelaine, Pline et les autres auteurs romains
n’auraient pas manqué de le dire ; et ces vases d’ailleurs n’auraient pas conservé la valeur que le luxe y
mettait, puisqu’il était si facile aux Romains de se procurer le produit des arts Égyptiens. Il faut donc croire,
ou que les vases murrins n’étaient pas des vases de porcelaine, ou que ces vases précieux, tirés de la
Chine, venaient en Égypte et en Syrie par la voie de l’Inde. Il en résulterait donc que, du tems des
Ptolémées, les Égyptiens commerçaient avec les Chinois par l’intermède des Indiens, qu’ils achetaient leur
porcelaine, et la transmettaient ensuite aux Romains.
Si l’on considère la lenteur de ce commerce et les dangers qui devaient résulter d’une navigation timide le
long des côtes, sans autre boussole que la terre et les étoiles, on ne sera pas surpris de l’extrême rareté des
produits de la Chine, et conséquemment du prix excessif que le luxe avait mis aux vases de porcelaine.
Tout porte à croire que les arts sont d’une très grande antiquité dans l’Inde et dans la Chine, et qu’ils ont fait
peu de progrès depuis une époque très-reculée jusqu’à nous. La porcelaine la plus ancienne que nous
connaissions, est même plus estimée que celle de nos jours : d’où je conclus que celle que l’on rencontre
dans les décombres d’Alexandrie, et dont nous avons eu souvent occasion de voir des vases entiers à
Constantinople, à Rosette, à Ispahan, n’est point venue de la Chine, puisqu’elle en diffère considérablement,
mais qu’elle a été fabriquée en Égypte postérieurement au siècle de Pline, afin d’imiter celle de la Chine,
que la rareté rendait excessivement chère. Il serait curieux sans doute de découvrir l’endroit d’où les
Égyptiens tiraient la terre propre à la fabrication de leur porcelaine, à laquelle on pourrait donner un plus
grand degré de perfection, d’autant plus qu’elle pèche plutôt par la couverte que par la pâte. Mais comment
parcourir avec sécurité la haute Égypte tant qu’une nation fanatique, ennemie des sciences et des arts,
occupera ces contrées si justement célèbres ?
La facilité qu’il y eut de former deux vastes ports, capables de contenir tous les navires que le commerce le
plus étendu pouvait y amener, fut ce qui détermina le conquérant de l’Asie et de l’Égypte à jeter les
fondemens d’une ville sur un rivage désert, aride, entièrement privé d’eau douce. Mais Alexandre, prévoyant
la gloire future d’une cité qui devait servir d’entrepôt aux productions de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, et
devenir le point central du commerce des Nations, fit creuser un canal spacieux navigable, qui recevait
annuellement les eaux du Nil. De nombreuses citernes devaient les recevoir et les conserver pour le besoin
des habitants. Plusieurs d’entre elles, peu spacieuses, appartenaient à des particuliers ; mais il y en eut
beaucoup d’autres, très-vastes, qui vraisemblablement étaient publiques, et appartenaient également à
toutes les classes de citoyens. Celles-ci, qu’un besoin impérieux oblige de conserver et d’entretenir, sont
encore le plus sûr témoignage de l’étendue et de la population de l’ancienne Alexandrie.
La forme des citernes varie à l'infini : leur ouverture, semblable à celle d'un puits, présente ordinairement, de
chaque côté, une suite d'entailles qui donnent le moyen d'y descendre ; leur intérieur offre des carrés,
surmontés chacun d'une voûte. Elles sont ordinairement à divers compartiments, et deux ou trois rangs de
loges les unes sur les autres, soutenus par des arceaux et des piliers. Leur paroi est en briques revêtues
d'un ciment rougeâtre que le temps n'a pu altérer, et qui est encore de la plus grande solidité.
L’ouverture de ces citernes se trouve au dessus du niveau du canal, lors même de la plus grande élévation
de l’eau ; ce qui porte à croire que l’on employait autrefois, pour les remplir, le même moyen que l’on met en
usage aujourd’hui. Chaque année, vers le milieu de fructidor654, époque de la plus grande crûe du Nil, on
introduit l’eau du grand canal dans les canaux particuliers qui se répandent dans tous les sens, et qui sont,
pour la plupart, creusés dans une roche coquillère tendre. Au moyen de roues à auges que des boeufs font
tourner, l’eau est élevée, et versée ensuite dans des rigoles qui la conduisent aux citernes. Quoiqu’on ait
négligé de conserver les petites citernes des maisons des particuliers ; quoique la plupart des grandes
soient comblées ; quoiqu’un très-grand nombre serve à l’arrosement des jardins ; enfin, quoiqu’on ait laissé
obstruer les divers canaux qui se répandaient hors de l’enceinte de la ville arabe, Alexandrie reçoit
néanmoins l’eau nécessaire à toute sa consommation. Mais, par une négligence qui n’étonne pas chez un
peuple dont aucun regard n’est dirigé vers le bien public, la plupart des citernes dont l’ouverture est plus
basse que le sol environnant, reçoivent, lors des pluies, une eau qui se charge de sel marin, de nitre et de
beaucoup de saletés en passant sur un terrain imprégné de ces substances ; ce qui altère l’eau pure et
saine du Nil qu’elles contiennent. Tant pour masquer le goût de l’eau qui résulte de ces substances
étrangères, que celui qui provient des outres dans lesquelles on la transporte des citernes aux maisons, les
Alexandrins ont coutume de se servir du mastic de Scio ou d’amandes pilées ; ce qui déplaît aux étrangers
qui n’y sont pas encore accoutumés.
Toutes les citernes dont on se sert aujourd’hui sont dans l’enceinte de la ville arabe. On a négligé celles qui
se trouvaient au dehors, et aucune ne fut construite sur le sol de la ville moderne, qui n’existait pas
anciennement, et qui ne s’est agrandi, autour de la digue, que par des atterissements successifs. Les
citernes les plus éloignées de la ville moderne servent à l’arrosement des jardins. Il n’est pas rare qu’on en
découvre de nouvelles parmi les fouilles que l’on fait. Cette découverte est précieuse, parce qu’elle donne
lieu à la formation d’un nouveau jardin, et qu’elle procure de nouvelles richesses aux habitans. Mais on a eu
l’attention de réserver aux besoins de la ville celles qui se trouvaient le plus à sa portée.
Les jardins d'Alexandrie sont plantés de dattiers : on y cultive en même tems le henné, le Sébastien, le
citronnier et l'oranger. Il y a quelques figuiers, quelques mûriers et une grande espèce de jujubier. Les
abricotiers, les pruniers et les grenadiers y sont rares. Les plantes potages, telles que le chou, la chicorée, la
laitue, l'artichaut, le céleri, la fève et le pois y sont assez communes. On y voit plus abondamment
l'aubergine, la ketmie et la melochie.
Quoique ces jardins ne soient pas aussi beaux que ceux de Damiette, de Rosette et du Caire ; quoiqu’ils ne
soient pas aussi variés, aussi ombragés et aussi frais, ils sont néanmoins très-agréables : ils contrastent
singulièrement avec la nudité du sol environnant, avec l’aridité du terrain que l’on apperçoit tout autour. Les
négociants européens vont souvent s’y délasser de leurs travaux, et y goûter des plaisirs qui ne sont
vivement sentis que par les habitans des pays chauds. Là ils ne craignent pas les Arabes pillards, qui
viennent souvent jusqu’aux murs de la ville, et qui dépouillent quelquefois l’homme trop confiant que le désir
de se recréer fait sortir sans précaution. Il est vrai que ces jardins et l’espace contenu dans l’enceinte de la
ville arabe soit bien suffisans pour toutes les promenades que l’on est dans l’usage de faire à pied ou sur
des ânes, et auxquelles on donne presque toujours la préférence. Les courses et les parties de plaisir autour
de la ville et au Kalidje exigent des apprêts, des précautions, un concours de personnes armées, des chefs
arabes pour escorte ; ce qui les rend extrêmement rares et assez chères.
De la colonne de Pompée. Des catacombes qui se trouvent aux environs, et de celles qui s’étendent à
l’ouest. Des bains de Cléopâtre. Escorte nombreuse des Turcs et d’Arabes. Grand dîner aux environs du lac
Maréotis. Course au cap Marabou.
La première fois que nous sortîmes de la ville, la paix entre les Alexandrins et les Arabes n’était pas encore
faite ; ce qui engagea le cit. Reboul, proconsul de la République, à nous accompagner, et à nous faire
escorter par ses janissaires et par quelques scheiks arabes. Plusieurs Européens se joignirent à nous pour
satisfaire leur curiosité : nous étions tous armés ; de sorte que notre troupe avait plus l’apparence d’un
détachement militaire qui marchait à l’ennemi, que d’une société de curieux qui allait seulement contempler
les restes de ces superbes monumens échappés à la destruction des siècles et à la féroce barbarie des
hommes.
Nos premiers pas furent dirigés vers la colonne de Pompée, que l’on doit, suivant Savari, nommer
dorénavant colonne de Sévère. Elle étonne par sa masse et par sa beauté. Elle a près de quatre-vingt-dix
pieds de hauteur. Le fût est d’une seule pièce, d’un beau granit rose : il a environ soixante-quatre pieds de
longueur, et huit pieds quatre pouces de diamètre vers sa base. Le chapiteau est d’ordre corinthien, et a
neuf pieds dix pouces de hauteur. Le piédestal est un carré d’environ dix pieds de hauteur, revêtu de marbre
blanc. Cette colonne supportait autrefois une statue, à en juger par les trous que remarquèrent au dessus du
chapiteau des officiers d’une frégate française mouillée à Alexandrie, qui y montèrent par le moyen d’un
cerf-volant. Le fût a éprouvé un peu de dégradation à ses extrémités : il présente, du côté de l’est, une félure
assez considérable, à l’endroit par où il pose sur sa base. L’inscription qu’il y avait sur la face occidentale est
si effacée, qu’il est impossible d’y lire un seul mot, et même d’en distinguer des lettres.
Ce superbe monument était autrefois dans l’enceinte d’Alexandrie : il se trouve aujourd’hui à quatre ou cinq
cents toises de l’enceinte arabe, du côté du sud. Comme il est placé sur le sol le plus élevé de l’ancienne
ville, rien ne le domine et n’en dérobe la vue : il sert de reconnaissance aux marins ; et lorsqu’on arrive par
mer, quoiqu’il se trouve à plus d’un mille au-delà de la ville moderne, les minarets des mosquées paraissent
grêles et écrasés, tant il s’élève au dessus d’eux.
Une observation peu importante sans doute, mais que nous ne croyons pas devoir omettre, c’est que le
terrain sur lequel cette colonne a été élevée, est plus bas d’environ quatre pieds et demi que la base du
piédestal ; ce qui suppose qu’il y avait cinq à six marches tout autour, ou que les vents et les pluies ont peu
à peu entraîné les terres de ce sol élevé.
Les Arabes, soupçonnant des trésors sous un monument qui excite la curiosité des voyageurs, n’ont pas
manqué de faire des efforts pour se les approprier : ils ont découvert une grande partie de la face
occidentale du piédestal, et ont pénétré aussi avant qu’ils ont pu. Mais quel dut être leur étonnement quand
ils s’apperçurent que leur avidité semblait avoir été prévue par l’obstacle invincible que l’habile architecte y
avait opposé ? Cette colonne, d’un poids énorme, pose sur un bloc de poudingue silicieux, grisâtre, de la
plus grande dureté, qui n’a pas plus du tiers de la largeur du piédestal, de sorte que toutes les pierres qui
l’entourent, ne semblent lui servir que de revêtement, et ne concourir en rien à son affermissement.
Quand on examine avec attention le piédestal, ces pierres formées de gros quartiers de marbre blanc, sur
lesquelles on apperçoit des hiéroglyphes ; ces blocs de granit rose, semblables à des tronçons de grosses
colonnes, mal rapprochés les uns des autres, inclinés en divers sens, l’un d’eux cassé, et présentant un des
morceaux plus élevé que l’autre de quelques pouces, on est porté à croire que ce piédestal a été démoli en
grande partie par les Arabes, ensuite reconstruit avec les mêmes matériaux, de la manière que nous le
voyons aujourd’hui ; car pourrait-on se persuader que le même génie qui a présidé à la coupe, au transport
et à l’érection de ce monument, eût négligé de surveiller cette partie essentielle de l’ouvrage, qui devait
concourir à en assurer la durée, et contribuer si puissamment à le transmettre à la postérité la plus reculée ?
Quoi qu’il en soit, il n’est pas moins certain que la colonne n’est soutenue que par le bloc de poudingue
silicieux qui occupe le centre, et qui n’a guère plus de la moitié de son diamètre655. Ce bloc présente des
hiéroglyphes sur la face que l’on a découverte. Des voyageurs ont remarqué, avant nous, que ces
caractères sont renversés, et que par conséquent ce bloc avait appartenu à quelque monument plus ancien.
Après avoir payé à la colonne son tribut d’admiration, le voyageur ne manque pas de visiter les catacombes
qui se trouvent à peu de distance de là, dans la partie du sud-ouest, tout près du Kalidje. Quoiqu’elles ne
soient pas si spacieuses que celles que nous avons vues par la suite, elles méritent cependant l’attention
des curieux. Pour en avoir une idée exacte, il faut se représenter un escalier creusé dans un tuf calcaire,
sabloneux, tendre ; des chambres carrées et voûtées, qui communiquent les unes aux autres, et qui sont
taillées dans le tuf ; ensuite quatre ou cinq rangées latérales de loges, où l’on plaçait les bières de
sycomore, contenant les corps embaumés. Ces loges ont ordinairement près de deux pieds en carré, et six
ou sept de profondeur. On en voit sur le nombre qui ont une dimension double de celle des autres, et
quelques-unes percées dans leur fond, qui conduisent à de nouvelles chambres moins spacieuses, dans
lesquelles il n’y a point de loges. Les affaissements qui ont eu lieu, et surtout les sables et les terres que les
eaux ont fait couler dans l’intérieur, empêchant de pénétrer dans toutes les chambres et d’en suivre toutes
les divsions.
Dans les premiers jours de pluviôse les négociants français, voulant nous donner une fête qui nous fût
très-agréable, arrêtèrent que nous parcourrions avec eux la ville des morts, jusqu’au-delà des bains de
Cléopâtre, et que nous viendrions dîner aux environs d’une mosquée située vers le lac Maréotis. Quoique la
ville eût fait, depuis quelques jours, sa paix avec les Arabes, la prudence exigeait qu’on ne négligeât aucune
des précautions que l’on prend en pareil cas. On se fit escorter par plusieurs militaires, et on invita à se
joindre à nous quelques scheiks arabes et un grand nombre de Turcs qualifiés.
Nous partîmes sur les huit heures du matin, bien armés, et montés sur des chevaux arabes que nous avions
bien de la peine à retenir. Nous sortîmes par la porte de la colonne, et après avoir longé les murs à l’ouest
nous dirigeâmes notre marche vers la mer. Il n’y avait pas un quart d’heure que nous avions quitté les murs
de la ville lorsque notre troupe s’arrêta pour nous laisser visiter une catacombe. Nous en avions déjà
rencontré en grand nombre, mais leur ouverture était trop obstruée pour nous permettre d’y entrer. Celle-ci
ne s’annonçait guère mieux. Que l’on se figure un trou de renard presque horizontal, situé dans un
enfoncement, et l’on aura une idée assez juste de son entrée. Il faut se glisser, en rampant avec effort,
l’espace de douze à quinze pieds, après quoi on se trouve dans une chambre carrée, assez grande, mais si
comblée par les terres que les eaux pluviales y ont entraînées, qu’on peut à peine s’y tenir assis sans
toucher de la tête contre la roche taillée qui en forme le plafond. L’un des côtés est terminé par un
enfoncement semblable à une alcove. On passe de là, encore en rampant, dans d’autres chambres
également encombrées par les terres, dont les parois ne présentent rien de remarquable. On y distingue, en
quelques endroits, les loges à momies, qui ont été détruites avec intention, et dans d’autres on les trouve
encore entières et parfaitement semblables à celles dont nous avons déjà parlé. Ces loges, dans quelques
chambres, n’avaient pas été vidées au ciseau, mais leur position y était indiquée par des lignes rouges
tracées sur le mur, aussi fraîches que si on venait tout récemment de les former. L’une de ces chambres
présente une sorte de décoration en sculpture, au milieu de laquelle on voit une statue en forme de momie,
de la taille d’un enfant, saillante de huit à neuf pouces, mais adhérente à la roche.
Quelques-unes des loges furent fermées après qu’on y eut placé le corps embaumé ; car elles portent
l’empreinte de leur cloison en maçonnerie, formant des bavures tout autour de leur ouverture. Ces cloisons
étaient enduites d’un ciment à chaux et à sable de deux ou trois lignes d’épaisseur, qui existe encore en
beaucoup d’endroits, et qu’on retrouve aussi sur les murs et sur le plafond de toutes les chambres ; ce qui
n’a pas empêché que quelques murs ne soient endommagés, et qu’une partie des voûtes ne soit affaissée.
Ceux d’entre nous dont le corps avait un peu trop d’ampleur, ou n’étaient pas entrées dans la catacombe, ou
n’avaient pu nous suivre dans tous les détours qu’on est obligé de faire dans ces souterrains. Nous
parcourûmes de cette manière plusieurs salles, glissant avec peine dans des passages forcés, étroits, tantôt
horizontaux, tantôt en pente et quelquefois presque perpendiculaires ; après quoi nous sortîmes couverts de
sueur et de poussière, et extrêmement fatigués d’une marche aussi pénible. Les tours et les détours qu’on
est obligé de faire dans cette course souterraine ne laissent qu’une idée confuse du plan et de la disposition
de la catacombe ; cependant on ne doit pas douter que ces travaux n’aient de la régularité. La confusion
qu’on y trouve, dépend moins de la nature des lieux que l’on parcourt, que de celle des passages par où on
arrive.
Lorsqu’on réfléchit sur les progrès de l’ensablement qui a eu lieu dans ces souterrains, et sur son élévation
bien au dessus des véritables portes de communication d’une chambre à l’autre, on est réellement surpris,
et d’autant plus qu’il n’a pu s’opérer que par les ouvertures naturelles, puisque les parois des chambres sont
revêtues d’un ciment peu altéré, et que le plus grand nombre des voûtes sont entières : celles d’ailleurs qui
se sont en partie affaissées, laissent voir la roche, qui forme un second plafond inégal, irrégulier, mais qui
intercepte toute communication extérieure. Comment ces ensablemens ont-ils pu parvenir de l’ouverture de
la catacombe creusée dans le roc, aux divisions les plus éloignées, sur un sol où les pluies sont rares ? Car
malgré la saison humide dans laquelle nous étions, l’intérieur de ces souterrains était très-sec, et offrait
plutôt de la poussière que de la boue.
Si cet ensablement était antérieur à l’expoliation des catacombes, on pourrait espérer de trouver quelque
loge fermée, contenant encore la momie qu’on y avait déposée ; mais l’expérience prouve le contraire ; car
des curieux, sans doute dans cet espoir, ont fait déblayer le sable vis-à-vis les loges, et ont découvert ainsi
les rangs inférieurs. Leur attente a été trompée ; ils ont vu les loges encombrées. Il faut donc croire que ces
expoliations sont très-anciennes, et remonter jusqu’aux Grecs et aux Romains, ou peut-être seulement à
l’époque où la religion chrétienne, intolérante et fanatique sous les empereurs d’orient, s’est introduite en
Égypte. La même phrénésie religieuse, qui portait les fidèles à démolir les temples, ces beaux monumens
de l’architecture grecque, les aura poussés sans doute dans ces asyles sacrés de la mort. Ces momies,
conservées avec tant de soin, n’auront été pour eux que des cadavres de réprouvés, qui ne méritaient pas
sur la terre une place distinguée.
En dirigeant notre route vers la mer, nous entrâmes dans d’autres catacombes qui ne présentent rien de
plus remarquable que les précédentes. Mais ici les eaux, poussées avec force contre le rivage par les vents
de nord, ont insensiblement miné la roche, et découvert les catacombes pratiquées dans une étendue
d’environ demi-lieue. On ne voit partout que des éboulemens, des blocs de tuf entiers, sur lesquels on
remarque encore les loges à momies ; des chambres peu dégradées, que la mer occupe ; des voûtes
encore existantes. On suit la plupart des divisions où les eaux ont pénétré, et où elles viennent se briser
avec fracas.
En suivant la côte on parvient aux bains de Cléopâtre : ils consistent en une grande pièce carrée, à laquelle
on apperçoit une ouverture du côté nord, et trois à l’est, taillées dans la roche, par où l’eau de la mer
s’introduit, et s’élève à environ deux pieds. Cette pièce communique par une porte avec deux chambres
carrées, taillées de même dans la roche, qui présentent à l’intérieur une banquette d’environ un pied de
haut : l’une d’elle a une ouverture du côté de la mer, par où l’eau s’introduit et se renouvelle ; mais l’autre ne
la reçoit que par sa porte. On voit à côté de celle-ci une petite citerne assez bien conservée, qui semble
adossée, et qui faisait partie d’un ancien édifice dont on apperçoit encore quelques restes. La mer paraît
avoir gagné beaucoup sur cette partie de la côte, et avoir détruit les ouvrages qui étaient les plus avancés.
Nous aurons bientôt occasion de remarquer que rien n’indique l’abaissement du niveau de la mer sur la côte
d’Égypte, depuis une époque de plus de deux mille ans, tandis que, selon quelques auteurs, il est si évident
sur la côte méridionale d’Europe.
Nous ne savons pas ce qui peut avoir donné lieu à la dénomination que porte cet endroit, et si on doit le
prendre plutôt pour des bains que pour une catacombe. Il ne nous paraît pas vraisemblable, d’après l’idée
que l’histoire nous donne de Cléopâtre, que cette reine, aussi magnifique que voluptueuse, eût choisi pour le
champ ordinaire de ses récréations le voisinage des morts, ce lieu de solitude, de silence et de méditation ;
qu’elles eût élevé une maison de plaisance sur un local si justement vénéré, destiné seulement à venir y
remplir des devoirs religieux. Comment se persuader d’ailleurs que cette femme, jeune et belle, eût été
assez peu soigneuse de la fraîcheur de son teint pour l’exposer au contact de l’eau salée, en prenant
habituellement des bains de mer dans un lieu qui répondait si mal à la magnificence qu’elle étalait ?
Ce local nous a paru avoir été une catacombe semblable à celles que la mer a découvertes sur toute cette
côte ; et ce n’est peut-être que sous le règne des Arabes qu’on aura eu l’idée d’en faire des bains et d’y
construire une habitation. On ne doit pas être surpris que cette catacombe fût creusée un peu au dessous
du niveau de la mer, puisque la plupart de celles qui se trouvent le long du rivage le sont également ; et ce
qui ne permet pas de douter que celles-ci aient été des catacombes, c’est que l’on y voit encore des loges à
momies, en tout semblables à celles qui sont à une grande distance de la mer.
La première idée qui doit se présenter lorsqu’on porte ses regards sur le nombre prodigieux de ces
sculptures, qui occupent un espace considérable le long de la mer, à l’occident de l’ancienne Alexandrie,
espace que les Grecs désignaient sous le nom de Nécropolis, c’est de savoir quel fut le peuple assez
nombreux pour exécuter de si grands travaux, quelle a été l’époque de ces monuments de piété,
d’attachement et peut-être même d’orgueil. L’Histoire ne dit point que les Grecs et les Romains aient jamais
embaumé leurs morts, et creusé, dans les entrailles de la terre, des lieux assez spacieux pour les y déposer
et les conserver à perpétuité. Ils les brûlaient au contraire, et élevaient des monuments somptueux à ceux
qui s’étaient illustrés ou qui avaient bien mérité de la patrie. Il faut donc remonter aux Égyptiens, à ce peuple
industrieux, savant et superstitieux qu’il est si intéressant de connaître et de suivre dans tous les détails de
son existence politique et religieuse.
Si les anciens Égyptiens avaient seuls pris le soin d’embaumer et de conserver leurs morts, on serait alors
porté à croire que, lors de l’arrivée d’Alexandre en Égypte, il existait déjà une ville assez considérable, à
laquelle ce conquérant n’avait fait que changer le nom qu’elle portait avant lui ; car en admettant
qu’Alexandre a fondé cette ville, il faudrait supposer qu’elle fut peuplée à la fois et de Grecs et d’Égyptiens,
et qui ceux-ci conservèrent au milieu de leurs vainqueurs leurs cérémonies religieuses, et qu’ils continuèrent
d’embaumer leurs morts ; ou bien il faudrait supposer que les Grecs, après leur établissement en Égypte,
adoptèrent les moeurs du peuple vaincu, et imitèrent des usages qui flattent la vanité de l’homme.
Mais ce qui doit faire croire que les nombreuses catacombes d’Alexandrie sont antérieures à l’établissement
des Grecs et des Romains en Égypte, c’est qu’on n’y trouve point l’architecture grecque, et qu’on n’y voit
aucune inscription : on sait bien cependant que les Grecs et les Romains les répandaient partout ; on sait
qu’ils n’élevaient aucun momument, quelque mince qu’il fût, sans y tracer l’époque et les motifs qui y
donnaient lieu. Auraient-ils manqué d’en remplir les catacombes destinées à passer à la postérité la plus
reculée, et à lui transmettre les noms des personnages illustres qu’on y déposait ?
Les Turcs et les Arabes de notre suite, que la curiosité n’occupait pas comme nous, quoique munis d’un
ample déjeûner, étaient cependant impatiens de s’acheminer vers la mosquée, où ils savaient bien que le
dîner les attendait : ils nous rappelaient souvent qu’il était déjà tard, et que la nuit nous surprendrait hors de
la ville. Nous cédâmes enfin à leurs sollicitations, et nous prîmes le chemin de la mosquée, en nous
détournant un peu à droite pour entrer dans des souterrains très-spacieux, que les Arabes nous dirent avoir
été des magasins publics.
Les terres de tout l’espace que nous avons parcouru, ne sont guère susceptibles de culture : nous vîmes
seulement dans quelques endroits bas, peu étendus, du côté du lac, des orges et des blés assez beaux,
parce que les pluies y amènent un peu de bonne terre des lieux plus élevés. Du reste, tout ce terrain paraît
avoir été boulversé. Les Arabes en ont vraisemblablement tiré les pierres dont ils ont bâti les murs de la
ville ; ce qui a sans doute détruit un grand nombre de catacombes. Au-delà de ce terrain on découvre le lac
Maréotis, qui occupe en hiver une étendue assez considérable. Son bassin, dont les bords sont à sec dans
cet endroit, vient resserer la langue de terre sur laquelle nous nous trouvions, et ne lui laisse pas demi-lieue
de largeur.
Arrivés à la mosquée, nous trouvâmes plusieurs tentes dressées : deux d’entre elles se faisaient remarquer
par leur beauté et leur étendue. L’intérieur était garni de nattes, en tapis, et le pourtour était orné de matelas
et de coussins formant un divan à la turque. On avait étendu au milieu de la nôtre une natte sur laquelle on
servit un beau dîner, moitié à la française, moitié à l’orientale. Les Turcs et les Arabes dînèrent entre eux et
furent servis dans leur tente avec la plus grande profusion. La plupart d’entre eux, moins scrupuleux et plus
hardis que les autres, vinrent auprès de nous, moins pour goûter nos mets, que pour boire à la dérobée
quelques verres de vin et de liqueur.
La mosquée auprès de laquelle nous nous trouvions, est en grande vénération, tant aux habitans de la ville,
qu’à ceux du désert. L’imam, indépendamment de ses revenus fixes, reçoit assez souvent des offrandes de
la piété crédule des sectateurs de Mahomet. On dit cependant que, calculant ses revenus sur ceux de ses
prédécesseurs, il se plaint de la tiédeur de ses croyans, et de la diminution trop sensible de la religion du
Prophète.
A la fin de pluviôse nous vînmes nous embarquer au port vieux, dans l’intention de nous rendre au Marabou,
cap situé à deux lieues à l’occident d’Alexandrie. Parvenus à l’extrémité de la presqu’île Ras-el-Tin, nous
remarquâmes sous l’eau une suite de rochers qui s’étendent en ligne droite jusqu’au Marabou, parallèlement
à la côte. Ce sont ces rochers qui rendent l’entrée du port vieux très-dangereuse aux gros vaisseaux. Il faut
pour les franchir, avoir recours à un pilote de la ville, ou reconnaître les marques que les Arabes ont élevées
sur la côte. On nous a assuré que la meilleure passe tire de vingt-sept pieds d’eau ; ce qui permet en tout
tems aux vaisseaux de guerre de la plus grande force d’entrer dans le port : elle est à peu de distance ouest
du rocher qui se trouve marqué sur la carte.
Pour ne pas nous rendre suspects aux marins arabes qui nous conduisaient, nous ne voulûmes pas sonder
nous-mêmes les passes ni porter trop loin nos observations. Nous nous fîmes mettre à terre au-delà des
catacombes dont nous venons de parler, et nous suivîmes la côte en herborisant et en chassant. Comme la
journée était belle et qu’il faisait déjà assez chaud, nous trouvâmes divers insectes et quelques plantes
fleuries : nous vîmes des lézards, des serpens, des cailles et des hirondelles, et nous tuâmes quelques
gerboises qu’une douce chaleur avait fait sortir de leurs terriers.
Après trois quarts d’heure de marche nous apperçumes les traces du canal qui portoit autrefois à la mer les
eaux du lac Maréotis. Le terrain que l’on avait coupé à cet effet n’a pas une demi-lieue de largeur. Nous
remarquâmes à l’embouchure de ce canal une suite de rochers que nous supposâmes avoir formé le port
Kibotos ; car, suivant les auteurs anciens, le lac Maréotis communiquait d’un côté, par un canal navigable,
avec le lac Moeris, et de l’autre avec le port Kibotos, situé à peu de distance du port Eunoste.
Avant d’arriver au cap nous marchâmes pendant quelques tems sur un terrain bas, uni, sabloneux. Nous
laissâmes à gauche des marécages, sur les bords desquels il y avait déjà une croûte saline assez épaisse.
Nous vîmes un peu plus loin des décombres et de vieux murs qui se prolongeaient au nord-ouest le long de
la mer.
Nous trouvâmes sur le cap un lis qui n'était pas encore fleuri : nous le reconnûmes à ses feuilles, et surtout à
ses oignons écailleux. Nous revînmes vers la fin de germinal656 pour le prendre ; mais il était déjà passé, et
malheureusement les oignons que nous envoyâmes à Paris ne parvinrent point à leur destination. Il faut
espérer que cette plante intéressante n’aura pas échappé aux Français qui sont venus après nous en
Égypte.
A côté du cap il y a trois petites îles, sur l’une desquelles est une mosquée qui prend de loin la forme d’un
navire à la voile. C’était naguère la demeure d’un solitaire musulman que les Alexandrins et les Arabes du
désert vénéraient comme un saint personnage ; ce qui n’empêchait pas qu’il ne fût exposé à la visite des
Arabes pillards, qui venaient de tems en tems lui enlever ses provisions, et l’obliger de recourir au zèle pieux
des habitans de la ville. Lorsque nous arrivâmes à cette mosquée nous la trouvâmes abandonnée, parce
que depuis la mort de ce béat solitaire personne ne s’était présenté pour occuper sa place.
Au-delà du Marabou la côte est inhabitée dans une grande étendue, ou n’est fréquentée, ainsi que nous
l’avons déjà dit, que par les Arabes pasteurs, qui dépouillent avec avidité les marins qui ont le malheur d’y
faire naufrage.
Des ruines qui existent sur le rivage du port neuf. Preuves que le niveau de la mer n’a pas baissé sur la côte
d’Égypte depuis plus de deux mille ans. Étendue de l’ancienne ville. Du canal. Du lac Maréotis. Histoire
naturelle.
Si nous nous transportons maintenant de l’autre côté de la ville, le long du rivage du port neuf jusqu’au cap
Lochias, nous serons étonnés de voir sur toute cette étendue, où quelques auteurs placent le palais des
Ptolémées, des ruines considérables, dont les fondemens sont établis, en certains endroits, bien au dessous
du niveau de la mer. On y rencontre surtout un gros corps de maçonnerie, bâti en briques, dont la masse,
imposante par son épaisseur, s’avance à peu près de dix toises dans la mer, et dont les fondemens,
construits en gros quartiers de pierres de taille, sont maintenant submergés par les eaux, sans qu’il soit
possible de soupçonner, d’après l’horizontalité des couches de maçonnerie, le moindre affaissement dans
cette partie. Au-delà de ces ruines on apperçoit, sur le bord de la mer, une suite assez longue de grosses
pierres de taille, qui paraissent être les restes d’un quai, dont les parties supérieures ont été démolies afin
d’en employer les matériaux à quelque édifice moderne. Ce mur, d’une construction très-solide, avait été
soutenu du côté de la terre par de fortes encoules, dont plusieurs se sont très-bien conservées. Tout cet
espace, jusqu’au cap, est parsemé de ruines que la mer a découvertes : on y apperçoit entre autres des
pièces de maçonnerie, construites en briques, cimentées à leur intérieur, ayant de chaque côté une rangée
perpendiculaire d’entailles pour faciliter la descente d’un homme dans leur intérieur : elles sont
accompagnées de canaux de communication, et paraissent avoir été autant de citernes de maisons
particulières, destinées à recevoir de l’eau douce.
La plupart de ces maçonneries sont en briques si fortement liées entre elles, qu’on en voit des masses
considérables, écroulées dans la mer, que les vagues ne peuvent entamer. Parmi toutes ces ruines
d’anciens édifices, on remarque des pavés d’appartemens, des bassins de différentes formes, dont
quelques-uns en demi-cercle, placés au milieu d’un massif considérable de maçonnerie ; des encaissements
de six pieds de longueur, rétrécis à l’une des extrémités, en forme de baignoires, où l’on apperçoit une sorte
de cruche en poterie, enclavée dans le mur, qui paraît avoir été destiné à verser de l’eau dans la baignoire.
Toutes ces constructions, au reste, sont surmontées de deux ou trois toises de décombres, excepté du côté
de la mer, que les eaux et les éboulemens ont découverts ; ce qui ne permet pas d’avoir une idée exacte de
leur construction, ni de reconnaître parfaitement l’usage auquel elles étaient destinées.
Ce que l’on apperçoit a si peu d’analogie avec nos édifices ; les canaux sont si petits ; les puits, portant des
entailles latérales, sont si étroits ; les pièces ont si peu d’étendue, et les massifs de maçonnerie sont si épais
et si disproportionnés, qu’on ne peut supposer autre chose, sinon qu’il y avait, dans la maison de chaque
particulier, plusieurs citernes et des chambres à bains, soit d’eau de mer, soit d’eau douce. On doit regretter
que personne n’ait essayé de faire déblayer une partie de ces décombres, pour bien reconnaître le plan et la
disposition de ces constructions.
Mais ce qui frappe le plus dans ces ruines, c’est que, parmi des canaux, les uns ont leur pente de la mer à la
terre ; et les autres, placés au dessous, l’ont de la terre à la mer. En les considérant attentivement, on ne
peut s’empêcher de croire qu’il y avait, parmi ces citernes, des chambres à bains qui recevaient l’eau de la
mer par quelque mécanique dans le canal supérieur, et la dégorgeait ensuite dans le canal inférieur.
L’ouverture de celui-ci n’est souvent pas à deux pieds au dessus du niveau des eaux ; ce qui nous paraît
une preuve incontestable que, dans l’espace de plus de deux mille ans, le niveau de la mer, sur la côte
d’Égypte, ne doit pas avoir baissé, car il aurait fallu employer la même mécanique pour dégorger l’eau, que
celle qui était nécessaire pour l’y introduire ; et alors il eût été inutile d’avoir un canal inférieur, puisqu’il se
serait trouvé au dessous du niveau des eaux si la mer avait seulement baissé de deux pieds.
Parvenus à la pointe du cap Lochias, en face de la jetée à l’extrémité de laquelle on a bâti, sur divers
rochers, le petit château connu par les marins sous le nom de Pharillon, nous remarquâmes un rocher aplati,
sur lequel on a pratiqué plusieurs canaux pour donner passage à l’eau de la mer, et pour l’introduire dans de
petits bassins où un homme pouvait se placer à son aise. Ces canaux, entièrement taillés dans la roche,
sont très-dégradés : leur voûte est détruite ; deux seulement ont conservé des parties qui indiquent la
manière dont ils avaient tous été formés. La mer étant un peu agitée, les canaux étaient remplis lorsque
nous les avons vus ; mais dans les tems les plus calmes ils reçoivent à peine six pouces d’eau, et même, à
ce qu’on nous a dit, ils sont presque à sec lorsque le vent est au sud. Ainsi donc, en supposant que l’eau eût
coulé autrefois dans les bassins à plein canal, il n’en serait pas moins prouvé que l’abaissement du niveau
de la mer, depuis une époque de plus de deux mille ans, n’aurait pas excédé demi-pied ; ce qui paraîtrait
contradictoire avec le nombre d’autres observations qui portent la mesure de cet abaissement sur la côte
méridionale de l’Europe, depuis une pareile époque, à plus de onze pieds.
Les décombres que l’on apperçoit autour de l’enceinte arabe indiquent assez la position et la grandeur de
l’ancienne ville. Elle s’étendait du nord au sud, depuis le rivage de la mer jusqu’aux environs du canal, et
depuis les catacombes et les monumens de Nécropolis jusqu’au-delà du cap lochias ; ce qui lui donnait plus
de deux mille toises de long, et environ onze cents de large. Dans ce calcul ne sont point compris ces villes,
ces bourgs, ces villages qu’on avait construits tout le long de la côte, depuis Aboukir jusqu’au Marabou, ni
ces maisons de plaisance dont on voit encore tant de restes sur les bords du lac.
Alexandrie reçoit annuellement du Nil l’eau nécessaire aux besoins des habitans, par un canal qui prend sa
source a Rahmaniéh, et vient aboutir au port vieux, après avoir traversé l’extrémité occidentale de la ville
arabe. Ce canal était navigable autrefois pendant toute l’année ; mais il est tellement comblé à présent, qu’il
ne reçoit l’eau du fleuve que lors de sa plus grande crûe. Si nous en croyons la tradition du pays et les
auteurs arabes, il n’y a pas encore deux cents ans qu’il la recevait pendant toute l’année, et qu’il servait au
transport des marchandises lorsque le Bogas de Rosette n’était pas praticable ; ce qui arrive fréquemment
en hiver et au printems. On se servait, à cet effet, de petits bateaux plats nommés cayasses.
La construction de ce canal a été si solide, et sa conservation est telle, que peu de dépenses suffiraient pour
le mettre en état, réparer les murs intérieurs dont il est revêtu, et le creuser au point de recevoir quelques
pieds d’eau, lors même du plus grand abaissement du fleuve. Le commerce d’Alexandrie avec l’intérieur de
l’Égypte se ferait alors avec plus de sûreté et infiniment poins de dépenses ; il ne serait pas entravé par les
difficultés et les dangers que présente le bogas. Ses bords pourraient, comme autrefois, être cultivés, et la
ville ne serait pas menacée d’être privée d’eau, ainsi qu’elle l’est depuis que les digues de la Madiéh sont
rompues, et que les eaux de la mer, poussées dans l’intérieur des terres par les vents impétueux de nord et
de nord-ouest, sont venues former un vaste lac au sud d’Aboukir, et se sont avancées jusqu’au pied du
canal.
Le bey, gouverneur de la Bahiréh, province qui s’étend depuis Gizéh jusqu’à Alexandrie, est chargé de
veiller au canal, d’empêcher que les Arabes n’y fassent des saignées, pour arroser leurs champs, avant que
les citernes de la ville soient remplies. Il reçoit, à cet effet, 23,750 piastres ou trente-huit bourses de 625
piastres chaque, suivant les anciens statuts. Moyennant cette somme il fournit les roues qui élèvent l’eau et
la versent dans les rigoles, les boeufs qui font tourner ces roues, et il paie les hommes nécessaires à cette
opération ; et si la crûe du Nil n’était pas suffisante pour permettre à l’eau d’entrer dans les canaux qui
aboutissent à l’intérieur de la ville arabe, il serait obligé de la faire transporter par des chameaux, et d’en
remplir les citernes sous peine de perdre la vie. Pour recevoir cet argent, il doit se faire délivrer une
attestation au mékemé, signée du cadi, des commandans, des gens de loi et des principaux habitans. On
assure qu’il y a près de cent ans, la crûe du Nil n’étant pas suffisante, le bey de la Bahiréh fut obligé
d’employer trois mille chameaux pour le transport de l’eau du Kalidje aux citernes. Les habitans de la ville
n’ayant pas été satisfaits de la quantité d’eau qui leur avait été fournie de cette manière, lui refusèrent
l’attestation dont il avait besoin, et le commandant du Caire lui fit trancher la tête.
Si l’on va de la porte de Rosette directement au sud, après trois quarts d’heure de marche sur un sol uni, on
arrive au Kalidje, en suivant les petits canaux souterrains, destinés à distribuer annuellement à la ville les
eaux du fleuve. On apperçoit sur le mur intérieur du Kalidje les ouvertures de ces canaux, placées les unes
au dessus des autres : on doit les ouvrir successivement, à mesure que le niveau des eaux s’élève ; mais il
est probable que les canaux inférieurs sont obstrués aujourd’hui ou n’aboutissent plus à l’enceinte arabe,
puisque les citernes de la ville ne pourraient être remplies si l’eau ne parvenait aux ouvertures supérieures.
Quelques familles d’Arabes bédouins sont campées aux environs du Kalidje pour la culture des terres : elles
y passent ordinairement toute l’année, quoiqu’elles n’aient plus rien à faire depuis la récolte des grains, qui a
lieu en germinal et en floréal, jusqu’à l’époque de la plus grande crûe du Nil. Les terres sont si sèches
pendant l’été, qu’elles ne permettent aucune sorte de culture. Il n’est pas douteux cependant que si ces
Arabes pouvaient arroser leurs champs dans cette saison, ils ne fissent des récoltes très-productives en
fruits, en melons et en diverses plantes potagères. Les endroits les plus élevés, ceux qui ne peuvent être
arrosés, sont plantés de dattiers, et semés en blé et en orge. Le terrain le plus bas, situé entre le Kalidje et le
lac Maréotis, fournit du blé, de l’orge, des fèves, des pois, du trèfle et quelques plantes potagères. Vers le
lac il y a des prairies naturelles, d’où on retire un fourrage abondant au commencement de floréal.
Le lac Maréotis occupe en hiver une étendue assez considérable : ses eaux sont saumâtres, quoiqu’elles ne
communiquent pas directement avec celles de la mer. Il est si peu profond, que les Arabes des villages
situés à l’occident et au milieu le traversent sans avoir de l’eau jusqu’aux genoux. Il est vrai qu’ils ont
l’intention de tracer leur route pour ne point s’égarer, ou pour ne pas s’enfoncer dans les endroits où le
terrain se trouve un peu trop mou. Dès la fin de floréal les eaux disparaissent, et il reste à sec pendant l’été.
Les Arabes y viennent alors ramasser un sel marin assez abondant, moins salé et moins âcre que le sel
ordinaire.
Le lac n’a pas été creusé à main d’homme, ainsi que l’a dit Maillet, puisque tout le sol environnant est uni et
bas, dans une étendue très-considérable. Nous aurions désiré savoir s’il est au dessus ou au dessous du
niveau de la mer ; mais nous manquions d’instruments propres à cette opération, et les Européens d’ailleurs
ne sauraient être trop circonspects dans un pays où le peuple profite volontiers du moindre prétexte pour se
soulever contre eux, et en exiger de l’argent657.
Les Européens établis à Alexandrie chassent assez souvent autour de ce lac, en prenant la précaution de se
faire accompagner de quelque Arabe bédoin établi aux environs. Les diverses espèces de bécassines sont
si communes dans les prairies où l’eau séjourne, qu’on peut tirer plus de cent coups de fusil dans une
matinée. En suivant le Kalidje on peut tuer des canards, des sarcelles, des vaneaux, des pluviers, des
courlis : on trouve des tourterelles et des coucous sur les dattiers. On chasse aux grives pendant l’hiver dans
les jardins : on y tue aussi des bécasses, mais elles y sont extrêmement rares.
Vers la fin de fructidor658, le passage des cailles qui viennent de la Turquie européenne, est si abondant,
qu’un chasseur en tue un grand nombre dans quelques heures. Les Arabes se les procurent par un moyen
bien simple : ils font de petits trous tout le long de la côte, en ayant l’attention d’en diriger l’ouverture vers le
nord. Les cailles vont se nicher, en arrivant dans cet abri : les Arabes approchent avec quelque précaution
pendant la chaleur du jour, et, en passant la main dans le trou, ils sont presque sûrs d’y trouver un de ces
oiseaux. Ils les mettent en cage, et viennent les vendre à Alexandrie pour un para chaque, et souvent pour
un demi-para. En pluviôse, on voit revenir les cailles de l’intérieur de l’Afrique : on les chasse alors dans les
blés et dans les pois : elles ne sont pas aussi grasses ni d’aussi bon goût qu’en automne, mais on en peut
manger plus long-tems sans en être dégoûté.
Les Européens habitués à chasser se font des protecteurs parmi les Bédoins en leur donnant de tems en
tems quelques étrennes, et surtout en leur distribuant de la poudre, de la grenaille et des balles. Lorsqu’on
approche de leurs tentes, les femmes, les jeunes filles et leurs enfans, bien loin de se cacher, viennent au
devant des chasseurs pour leur demander de l’argent. On ne manque jamais de leur distribuer quelques
paras.
On voit sur le lac et aux environs un grand nombre de canards, de hérons, de pélicans, de flamands, d’ibis
et d’autres oiseaux aquatiques, sans pouvoir ni les approcher ni les tirer. Les Arabes vont, pendant la nuit,
tendre des filets sur le lac même, et ils prennent par ce moyen beaucoup de canards et de sarcelles qu’ils
viennent vendre vivans à Alexandrie. Ils sont dans l’usage de leur tirer les pieds, de nouer ensemble
l’extrémité des deux ailes, et de les exposer en vente dans cet état.
On trouve aussi dans ce lac quelques coquillages marins et un autre fluviatile, qui appartiennent au genre
ampullaire. Celui-ci n’est pas si abondant que les deux autres ; car, malgré nos recherches et la promesse
que nous avions faite à des Arabes de les bien récompenser s’ils nous en apportaient de vivans, nous
n’avons pu en obtenir aucun. Nous soupçonnons qu’il s’enfonce dans la terre, et qu’il y passe la saison des
chaleurs et de la sécheresse.
Il y a dans le Kalidje quatre espèces de coquilles peu ou point connues des naturalistes, dont nous
donnerons ici la description et la figure.
La première, pl. 31, fig. 2, A B, semble tenir le milieu entre le genre ampullaire et le genre cyclostome ; elle a
même beaucoup de rapports, pour la forme de l’animal, avec des planorbes. Elle est très-voisine de la
coquille connue parmi les marchands sous le nom de prune de reine-claude ; elle est plus déprimée et
moins globuleuse : son ombilic est plus grand, et circonscrit par une arête bien distincte : une seule zone
pâle, définie par deux bandes brunâtres, parcourt le milieu du dernier tout.
La seconde, pl. 31, fig. 9, A B, paraît au premier aspect n’être qu’une variété de la cyclostome vivipare ;
mais elle est olivâtre, pâle, sans aucune bande ou zône. Sa spire est un peu alongée et plus aiguë ; sa lèvre
est bordée de verdâtre au lieu de brun.
La troisième, pl. 31, fig. 6 est remarquable en ce que l’ouverture est ovale. Je l’ai trouvée, ainsi que la petite
operculée aquatique, dans l’intérieur des momies d’Ibis.
La quatrième paraît avoir formée un genre nouveau, dont plusieurs espèces sont dans les collections : il
diffère de la mélanie par le défaut d’échancrure à la base ; du bulime, par l’habitation et l’opercule ; de la
turritelle, par la lèvre non sinuée.
On trouve aux environs de la colonne une hélice très-remarquable par sa forme : on la prendrait au premier
aspect pour un trochus que les flots de la mer auraient rejeté sur le rivage. Pl. 31, fig. 5, A B.
Parmi les quadrupèdes qui fréquentent les environs d'Alexandrie, on doit remarquer la hyène, le chacal, une
espèce de chat, plusieurs gazelles, le porc-épic et la gerboise. Il est extrêmement rare qu'on y rencontre
l'once, le léopard et le lion.
La hyène ne se montre que la nuit : elle reste pendant le jour dans des cavernes, dans des fentes de
rochers, dans des souterrains spacieux ; ce qui fait qu’on n’entre jamais dans les catacombes sans prendre
la précaution de se faire précéder par des Arabes armés. On trouve souvent dans ces catacombes des
ossements de gros et de menu bétail, qui prouvent qu’elles sont fréquentées par ce féroce animal.
Le chacal est bien plus fréquent que la hyène ; il vient roder autour de la ville pendant la nuit, et il se retire
dans les déserts pendant le jour.
Nous avons vu fréquemment dans les fèves, dans les fromens et dans les orges un animal de la grosseur et
de la forme d’un chat ordinaire : il fait la guerre aux petits oiseaux, aux rats, aux gerboises ; il est timide, et
fuit au moindre bruit. On nous a dit qu’il était commun dans les déserts, et qu’il habitait sous quelque arbuste
touffu, dans des crevasses ou sous tout autre abri. Nous l’avons tiré plusieurs fois à la balle sans avoir pu
l’atteindre. Des Arabes bédoins nous en apportèrent une peau, à laquelle il manquait la tête et le bout des
pieds.
Cet animal est d’un gris un peu fauve en dessus, mélangé de noirâtre, avec une bande d’un gris-noir qui
règne tout le long du dos, et qui se prolonge sur la queue. Vers le bout de celle-ci, on remarque deux
anneaux noirâtres : les côtés du ventre sont d’un gris blanc, avec quelques petites bandes traverses,
obscures ; les cuisses ont quelques bandes noires, et le dessous du corps est blanc, avec une très-légère
teinte fauve.
La gazelle, antilope dorcas, est commune en Égypte, en Syrie, en Arabie, en Perse. Elle est de la grandeur
d’une chèvre ordinaire ; mais ses pieds sont plus minces, et son corps est beaucoup plus délié. Ses cornes
sont élevées, courbées, munies de renflemens circulaires depuis la base jusqu’aux deux tiers de leur
longueur : elles sont environ un pied de long lorsque l’animal a acquis tout son développement. Le pelage
est fauve en dessus, blanc en dessous : on remarque sur les flancs une bande obscure qui sépare ces deux
couleurs. La queue est très-courte, noirâtre en dessus, et blanc en dessous.
La forme de la gazelle est très-agréable : son naturel est doux et timide, et sa légéreté ne peut être
comparée qu’à celle du cerf. Elle figure dans les chansons orientales, autant que le lis et la rose dans les
poésies érotiques des Européens. Les Arabes et les Persans ne parlent jamais de l’objet dont ils sont épris,
sans comparer ses yeux aux grands yeux noirs de la gazelle, sans lui trouver la gentillesse, la douceur et la
timidité de cet animal.
Le bubale, l’algazel et le pasan ne se montrent presque jamais aux environs d’Alexandrie : on ne les voit que
dans la haute Égypte et dans l’intérieur de l’Afrique.
Le porc-épic n’est pas non plus fréquent : la gerboise au contraire y est très-commune ; elle habite les
déserts et les lieux qui ne sont point exposés aux inondations du Nil ; elle se creuse un terrier assez profond,
dans lequel elle pratique diverses galeries ; elle se ménage plusieurs issues et vit en société : comme elle
ne se nourrit que de végétaux, elle fait beaucoup de tort aux cultures qui sont établies autour de son
habitation. Ce petit animal multiplie considérablement : la femelle a trois ou quatre portées par an, et met
bas chaque fois cinq ou six petits.
La gerboise, regardée par les Anciens et par les Modernes comme un animal bipède, mérite de fixer un
instant l’attention du naturaliste. Il est important de détruire une erreur commise par des voyageurs infiniment
estimables, et propagée par des auteurs dont l’opinion est d’un très-grand poids en histoire naturelle.
La démarche de la gerboise diffère sans doute de celle des autres quadrupèdes ; mais il n’est pas exact de
dire qu’elle n’avance qu’en sautant sur eux, comme la plupart des oiseaux. Je les ai vues très-fréquemment
auprès de leurs terriers, en hiver, aux environs d’Alexandrie ; je les ai souvent tirées de très-près, étant à la
chasse ; je me suis même tapi quelquefois derrière des décombres pour être plus à la portée de les
observer. Lorsqu’elles n’étaient point effrayées, souvent assises dans une position presque verticale, et
appuyées sur leurs métatarses, elles faisaient un petit saut sans toucher à terre des pieds de devant : les
jambes postérieures restaient à demi-ployées ; le corps était un peu incliné pendant le saut, et les gerboises
reprenaient aussitôt leur première position : elles avançaient peu, s’arrêtaient à chaque pas, portaient de
tems en tems à leur bouche un brin d’herbe qu’elles mangeaient.
Je les ai vues sortir de leur terrier et y rentrer, marchant lentement à quatre pattes, les jambes postérieures
presque entièrement ployées : elles avançaient par intervalles ; les pieds de devant faisaient quelques pas
avant que le train de derrière fût attiré à eux.
Mais lorsqu’elles sont surprises à quelque distance de leur terrier, la frayeur leur fait accélérer la marche :
elles s’élancent à un mètre de distance et même davantage, ne touchent à terre qu’un instant des quatre
pieds, se relèvent aussitôt, et s’élancent de nouveau avec la plus grande prestesse et sans interruption.
Ce mouvement continuel donne à la gerboise une démarche très-singulière, et la fait paraître presque
toujours en l’ai dans une position oblique ; c’est ce qui sans doute aura trompé les voyageurs, et leur aura
fait croire que cet animal ne touchait à terre que des pieds de derrière.
Dans sa démarche précipitée, la gerboise ne suit pas une ligne droite ; elle saute et bondit tantôt d’un côté,
tantôt d’un autre, cherchant à se sauver dans le premier terrier qu’elle rencontre. Il paraît que la queue,
longue, aplatie et latéralement velue à l’extrémité, agit d’abord comme levier, ou sert de point d’appui, ainsi
que l’ont observé Schaw et Pallas, et contribue beaucoup à faire élancer la gerboise lorsqu’elle est à terre :
elle agit ensuite comme gouvernail lorsque l’animal est en l’air, et occasionne ce mouvement irrégulier ou
cette démarche en zigzag, qui lui donne le moyen d’échapper aux chacals, aux oiseaux de proie et aux
serpens, qui lui font une guerre continuelle.
La gerboise n’est pas un animal nocturne, ainsi que quelques auteurs l’ont avancé, puiqu’elle sort
très-fréquemment de son terrier pendant l’hiver, à toutes les heures de la journée, comme elle y rentre, en
été, lorsque la chaleur se fait trop vivement sentir. Pallas a observé que cette espèce s’engourdit, ainsi que
les autres, au sud de la Sibérie, où il y a eu occasion de la voir ; mais en Syrie, en Arabie, en Égypte, où la
température est beaucoup plus douce, la gerboise ne s’engourdit pas, et continue, pendant l’hiver, à se
mouvoir et à se nourrir.
On rencontre aux environs d’Alexandrie quelques plantes intéressantes, telles qu’une espèce de nitraire à
fruit rouge, succulent, d’une saveur très-fade, de la grosseur d’une olive ordinaire ; le caprier sans épines,
que les Alexandrins négligent, mais dont les boutons et les sommités des rameaux, confits au vinaigre, sont
aussi bons que ceux du caprier commun ; le peganum harmala, qui croît partout abondamment, et auquel
les Arabes attribuent diverses propiétés, celle entre autres de purifier l’air à une grande distance si on en
brûle à la fois une certaine quantité ; le pallasia, arbuste singulier, qui végète très-bien sur un sable pur et
mouvant ; le cynomoir écarlate, plante parasite que l’on trouve sur les racines des salicornes, des kalis et
autres arbustes des environs de Kalidje. Elle fleurit en pluviôse, et a un goût légérement amer et une odeur
un peu aromatique. Les Arabes l’emploient avec succès pour les dyssenteries, les pertes de sang, les plaies
récentes. Toute la plante a une belle couleur écarlate, et, si on l’exprime, le suc qu’elle rend, est de la même
couleur. Soumise à quelques expériences, elle a donné à des étoffes de laine, de soie, de coton, de chanvre
et de lin une couleur de nankin et un rose foncé, un peu brun. Ces couleurs ont résisté au savon, au vinaigre
et à l’action du soleil. Nous invitons les teinturiers à pousser plus loin nos expériences. Le cynomoir croît
non-seulement en Égypte, mais à Malte, en Sicile, aux environs de Livourne, à Tunis et sur toute la côte de
Barbarie.
En hiver, les terrains les plus secs, les plus sablonneux, sont couverts de plusieurs espèces de ficoïdes. Les
Arabes arrachent ces plantes au printems, les laissant sécher pendant plusieurs jours, les entassent ensuite
et y mettent le feu : les cendres qui en résultent sont apportées à Alexandrie, et transportées de là à
Marseille et à l’île de Crète, pour la satisfaction du savon. »
- 740 - 755 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|
L’ARCHIMANDRITE CONSTANTIN (1795)
Volkoff, O. V., Voyageurs russes en Égypte, RAPH XXXII, Ifao, Le Caire, 1972.
L’Archimandrite Constantin, est nommé supérieur du monastère du Mont Sinaï. Plus tard, il devient
patriarche oecuménique de 1830 à 1834. Érudit et auteur d’ouvrages historiques, il est exilé comme
philosophe. Il publie son ouvrage sous le titre de L'Ancienne Alexandrie et l’agrémente de gravures et de
plans. L’auteur ne nous dit rien sur les raisons de son voyage. Oleg Volkoff suppose qu’il s’agit d’un
pèlerinage aux Lieux saints interrompu par un naufrage. L’Archimandrite Constantin meurt en 1859.659
Remarque : O. V. Volkoff ne traduit pas le texte dans son intégralité mais donne un résumé tout en citant le
récit. Le texte se divise en deux parties : dans la première, le voyageur décrit l’ancienne Alexandrie en
quarante pages et, dans la deuxième, la nouvelle Alexandrie en une page.
p. 335-343 :
« Sur un fond de maisons et de mosquées, de rochers et d’une rade remplie de navires, se dressent, au
premier plan, l’obélisque de Cléopâtre et la colonne Pompée. Prés de celle-ci plane un jeune homme ailé,
entouré de voiles flottants dont un pan joue le rôle de la feuille de vigne traditionnelle, laissant par ailleurs,
tout le reste du corps complètement nu. Cet individu auquel des cheveux hérissés en forme de flammes
donnent un air vaguement diabolique, tient une faux avec laquelle il se propose de démolir la colonne. À
côté de lui, une jeune femme, également ailée, mais plus vêtue, aux cheveux gracieusement bouclés,
brandit de la main gauche une trompette, et de la droite, retient le bras, armé de la faux, du méchant démon.
Aucune explication n’accompagne cette gravure, mais la présence de la faux laisse supposer que le
personnage ainsi armé symbolise, malgré son extrême jeunesse, le Temps, décidé d’abattre les derniers
vestiges de l’ancienne Alexandrie, alors que la jeune femme –figurant la Renommée- intervient pour sauver
les glorieuses ruines.
L'auteur débute par une description des deux ports, "nommés, selon une ancienne appellation l'Africain et
l'Asiatique" et flanqués chacun d'une forteresse turque. Ces deux bâtiments ne présentent, en eux-mêmes,
rien d'intéressant mais méritent quelques lignes à cause des lieux célèbres où ils se trouvent.
Le premier, nommé « grand Pharillon » comporte une tour avec une lanterne pour guider les navigateurs, et
se dresse sur l'île « Phare » où s'élevait jadis la merveille construite par Ptolémée. L'autre, que
l'Archimandrite appelle « petit Pharillon », également placé sur une île, « ne garde aucune trace de cette
splendide bibliothèque, qui, par la rareté et l'excellence des livres, passait pour le trésor le plus précieux du
monde ».
(p. 336) « Ces deux îles sont jointes à la terre par un retranchement du port. Le retranchement de l'île Phare
(sic) s'allonge sur environ une verste660, et est bâti partie en brique et partie en pierre de taille (…). L'autre retranchement du port conduit au petit Pharillon, et, à part deux tours, pouvant, au besoin, servir de défense,ne présente rien de particulier. »
L'auteur se plaint que l'ignorance et la superstition de la garnison logée sur le « petit Pharillon » empêchent une étude attentive des lieux, où, dit-il (en contradiction avec sa propre phrase citée plus haut), « sont les ruines de la bibliothèque des Ptolémées ». Il ne put examiner que les tours, « certaines rondes, d'autres
carrées, d'autres tout à fait irrégulières et, pour ainsi dire, d'une architecture laide ».
« Leur structure, à l'intérieur, répond au désordre de l'extérieur : certaines tours ont un mur double et un
escalier de pierre jusqu'au sommet ; d'autres n'ont aucune entrée, sinon un trou dans la voûte qu'il faut
atteindre au moyen d'une échelle. Les voûtes de tous les étages, sans aucune symétrie, reposent tantôt sur une seule colonne, tantôt sur plusieurs, parfois sur un grand pilastre carré. Des embrasures s'ouvrent sur tout le pourtour [des tours] et, dans les ouvertures des rangées inférieures se voient les débris et les troncs des colonnes, de divers marbres, dans la position de canons pointés… »
(p. 337) « Les murs, entre les tours, aussi bien que les tours elles-mêmes, de formes diverses, sont délabrés et ruinés. Ils ont soit quarante soit cinquante pieds de hauteur, et vingt pieds au moins d'épaisseur. »
« A l'intérieur de la ville il n'y a que des tas de ruines, trois monastères, quelques jardins, des mosquées et des citernes d'eau (…) »
« Le monastère de St Saba est en bon état [de conservation]. Placé sous [la juridiction du] patriarche d'Alexandrie, il est dirigé par un higoumène et [renferme] la seule église où les chrétiens grecs [orthodoxes] vont prier et [même] y vivent. Sur le côté gauche il y a une chapelle de la vierge-martyre Ste Catherine où l'on garde un morceau de marbre sur lequel fut décapitée la sainte. »
« Un autre monastère est catholique, au nom de Ste Catherine ; un prieur le dirige avec ses frères, des Capucins. »
« Enfin un troisième couvent, copte, est placé sous la protection de St Marc et contient une chaire d'où, selon la tradition, l'évangéliste prêcha la vérité. »
« Entre les monastères grec et catholique s'élève une énorme mosquée, à moitié ruinée, d'un style ancien et
magnifique ; selon l'opinion universelle, elle était jadis une cathédrale patriarcale dédiée à St Jean
l'Aumônier. »
(p. 338) « Dans les environs du monastère de Saint-Saba on voit jusqu’à maintenant les restes du palais de
la sainte reine Catherine. Plus loin sont deux collines de débris, à tel point émiettées par les chercheurs de
trésors qui les fouillent, qu’elle forme actuellement deux énormes élévations de poussières. La pluie en fait
sortir parfois des pierres ciselées connues sous le nom de « antikis », ou d’autres objets semblables ; quant
à des choses importantes [au point de vue archéologique], elles s’[y] trouvent très rarement. Les sarrasins
agirent à Alexandrie comme les Goths et les Vandales en Italie, à Rome : extrayant avec une pointe de fer
les pierres des bagues, ils prenaient l’or et jetaient les pierres. On peut voir cela sur beaucoup d’« antikis »
trouvés jusqu’à maintenant. »
« Sur le chemin des arcs de Pompée s’élèvent six colonnes de (p. 339) granit ; on ignore si elles se
dressaient des deux côtés de cette longue avenue et si elles formaient une galerie à la manière des
Anciens ; elles sont toutes sans ornements, sans chapiteau ; c’est pourquoi on ne peut deviner si elles
appartenaient à quelque ordre architectural [européen] ou si elles étaient faites à l’égyptienne ; leur surface
est lisse, en bas elles sont plus épaisses qu’en haut, et quoiqu’elles sont presque pour un tiers [de leur
hauteur] enfouies dans la terre, il semble pourtant qu’elles étaient [jadis] toutes de la même dimension.
D’ailleurs elles occupaient une place importante parmi les merveilles d’Alexandrie. »
Suit une description de la colonne de Pompée située à une demi-vestre des arcs du même nom. L’auteur
mentionne la croyance de beaucoup de voyageurs et d’habitants du pays, que la colonne tient « d’une façon
étonnante en équilibre sur une pierre centrale. » Puis il continue : « À deux verstes de la colonne Pompée,
après un trajet sur une plaine ouverte et étendue, on voit sur le côté gauche le « Khalitch » (Khalig), le canal
de Cléopâtre ; des arbres divers, surtout des dattiers, l’ombragent : là il y a des villages entiers [constitués
par] des abris mobiles des bédovins (sic), ou des Arabes africains nomades qui, d’une pauvreté extrême,
(p. 340) nichent [dans ces abris] comme des oiseaux, et dont le séjour, dans un endroit, dépend de la
fertilité de la terre qu’ils occupent : car quand la terre se restreint dans ses dons, ils partent chercher une
nouvelle [terre d’] abondance. Une telle liberté de vie est un don de leur pauvreté : s’ils étaient plus riches,
ils seraient plus dépendants. »
L’auteur nous fournit ensuite quelques explications au sujet de ce canal, destiné à servir de voie de
communication aux bateaux traversant le Delta, ainsi qu’à fournir de l’eau aux habitants. Malheureusement,
les rives de ce canal n’étant pas renforcées par de la maçonnerie, s’écroulèrent peu à peu, et ces
éboulements empêchent l’approvisionnement des citernes – dont il n’en reste que six- où les habitants
venaient puiser de l’eau.
« La diversité des colonnes qui soutiennent des voûtes au-dessus de ces citernes, le style gothique ou
sarrasin que l'on remarque dans leur disposition, prouve qu'elles ne sont pas [maintenant] dans leur état
original ; mais comme on l'a déjà dit plus haut, au sujet [de la ville] d'Alexandrie en général ; quand elles [les
colonnes] étaient détruites, et que la nécessité exigeait que certaines d'entre elles fussent reconstruites, on
les rétablissait de l'ensemble des morceaux ou des débris [qui subsistaient], sans s'astreindre à faire
ressembler [ces nouvelles colonnes ainsi constituées] à ce qu'elles étaient auparavant. Car ces citernes ne
sont que des réservoirs d'eau qui [la conservent mais] ne la purifient pas pour l'en tirer, on emploie des
pompes à eau grâce auxquelles on verse l'eau dans des sacs de cuir, spécialement faits pour cela et qu'on
transporte à dos de chameau ou d'âne dans la nouvelle Alexandrie pour la vente ; ayant vidé ainsi les
citernes, on les nettoie, [opération qui a lieu] surtout pendant la crue du Nil. »
(p. 341) « beaucoup de ces citernes ont été détruites à cause du grand travail qu’exige [leur entretien] et des
grands frais que cela entraîne ; car la quantité d’eau dépasse les besoins des habitants, peu nombreux, de
la nouvelle ville, [de l’eau] resterait, se gâterait par la pourriture et donnerait naissance à des épidémies ; la
fermeture du canal, l’empêchement du passage de l’eau, produiraient, d’eux-mêmes, les mêmes
conséquences néfastes ».
L’auteur mentionne deux autres arcs entre lesquels est la nouvelle Alexandrie « il y a une large place qui
sert le soir de promenade commune aux Européens qui demeurent là. »
Puis l'auteur passe à la description des catacombes. « D'énormes falaises projetées du rivage, des gorges
sinistres, forment un ensemble sauvage de cavernes naturelles ; de plus, à cause de la commodité de cette
situation naturelle et du genre de pierre tendre [qui constitue ces falaises], de véritables chambres ont été
creusées dans la falaise. Elles servaient de bains [aux habitants], et de refuge pour les petits bateaux
pendant le mauvais temps… »
Suit la description d'un temple souterrain. Par un long couloir « sinistre » on pénètre « dans une salle ronde
aux murs et aux plafonds lisses et polis, au plancher recouvert de sable et de toute sorte de détritus, et où
séjournent les chauve-souris et toute sorte de vermine. Mais ce n'est pas encore le temple ; un autre couloir
souterrain conduit dans une chambre circulaire dont le plafond est taillé en voûte et qui a quatre portes
situées les unes en face des autres ; chacune d'elles est ornée d'une corniche et au-dessus du fronton de
chacune d'elles est représenté un croissant. De ces quatre portes, l'une est ouverte, [quant aux] trois autres,
[elles] forment dans le mur des renfoncements qui s'abaissent plus bas que le temple et contiennent chacun
un réceptacle taillé dans de la pierre, maintenant vide, [mais] qui était, semble-t-il, jadis, le tombeau d'un
homme célèbre ou d'un tzar. »
(p. 342) À moitié écroulés, les autres couloirs qu'on entrevoit, sont impénétrables, ajoute l'auteur. Enfin il
mentionne, creusées au sommet de la falaise, "des fosses, profondes, approximativement, de soixante pieds
et larges de vingt, mais maintenant comblées de débris." C'est là que l'auteur place la nécropole de
l'ancienne Alexandrie.
Ayant terminé ainsi la description des vestiges de l’antique cité, il se pose maintenant un certain nombre de
questions sur Alexandrie ? Comment tout ce marbre fut-il transporté sur le rivage de la mer ? Que sont
devenues les ruines d’Alexandrie ? Il émet un certain nombre de suppositions basées sur les descriptions
des historiens, les Mémoires des voyageurs et ses propres déductions. Mais comme ces hypothèses ne
présentent, de nos jours, aucun intérêt, nous ne les reproduiront pas ici.
Sentimental, l’Archimandrite termine ce chapitre par un paragraphe plein de mélancolie : « Est-ce toi,
Alexandrie ?… Est-ce toi, la première ville de la Sagesse, des Sciences, des Solennités, de tout ce qui est
gracieux, de tout ce qui a de l’influence sur le bonheur des êtres sensibles ? Est-ce toi dont le nom était si
célèbre [qu’il était connu jusqu’au’] aux confins des créations terrestres ? Non, je ne te reconnais pas dans
ces cendres semblables aux os épuisés de la mortelle humanité, sur lesquels s’inscrit si profondément [la
trace de] la main puissante et infatigable du temps. »
L’auteur continue sur le même ton encore pendant une demi-page, puis passe à la Nouvelle Alexandrie.
(p. 343) « La nouvelle Alexandrie n’est rien d’autre qu’une pauvre orpheline, ayant reçu en héritage
seulement le grand nom de son père. » Quelques phrases déplorent l’état de délabrement où est tombé
l’antique capitale du monde civilisé ; l’auteur souligne que la ville actuelle n’est pas un phénix né des
cendres de l’ancienne cité, mais un être monstrueux sorti de l’enfer ; sous-entendu : une création des
envahisseurs du pays.
Le reste du livre (huit pages) est une simple compilation de passages tirés d’auteurs anciens décrivant le
Pharos, la bibliothèque, le Palais des Césars, le Sérapeum, l’Académie et les Obélisques.
- 756 - 758 -
Voyageurs à Alexandrie VIe-XVIIIe siècles
Corpus des récits, édition 2015. Oueded Sennoune
|